Crise syrienne, paysage intellectuel français et «Grand Remplacement»
Crise syrienne, paysage intellectuel français et «Grand Remplacement»
Entretien avec Robert Steuckers
Propos recueillis par Adriano Scianca pour « Primato nazionale »
- Que pensez-vous de la manière dont l'Europe a géré la crise de l'immigration suite à la crise syrienne?
L’Europe est inexistante en tant que puissance politique qui compte dans la région hautement stratégique qu’est le Levant. Elle n’a su ni impulser une politique de stabilité qui aurait joué dans son intérêt le plus légitime ni faire face aux catastrophes que l’intervention des Etats-Unis et de leurs alliés dans la région ont entraînées. Parmi ces catastrophes, la plus visible aujourd’hui en Europe, de la Grèce à l’Allemagne en passant par tous les pays des Balkans, est bien sûr cet afflux massif de réfugiés que les Etats européens ne sont pas capables d’intégrer à l’heure d’un certain ressac de l’économie européenne, perceptible même en Allemagne. L’intérêt de l’Europe aurait été de maintenir la stabilité au Levant et en Irak. C’était le point de vue du fameux « Axe Paris-Berlin-Moscou » qui s’était insurgé contre l’intervention de Bush en Irak en 2003. Les Etats-Unis, qui ne sont pas une puissance romaine au sens classique du terme et au sens où l’entendait Carl Schmitt, ne font donc pas comme Rome, ils n’apportent ni « pax romana » ni « pax americana » mais génèrent le chaos, auquel les populations essaient tout naturellement d’échapper, au bout d’une douzaine d’années voire d’un quart de siècle si l’on tient compte de la première intervention en Irak en 1990.
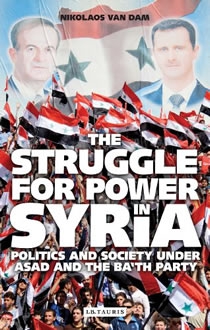 Ces pays, jadis structurés selon les principes de l’idéologie baathiste (personnaliste, transconfessionnelle et étatiste), avaient le mérite de la stabilité et faisaient l’admiration d’un grand diplomate néerlandais, Nikolaos Van Dam, docteur en langue et civilisation arabes, qui a consacré un ouvrage en anglais à la Syrie baathiste qui mériterait bien d’être traduit en toutes les grandes langues d’Europe. Cette stabilité, maintenue parfois avec rudesse et sévérité, a été brisée : on a cassé la forme d’Etat qui finissait vaille que vaille par s’imposer dans une région, soulignait aussi Van Dam, marquée par le tribalisme et allergique à cette forme étatique et européenne de gestion des « res publicae ». L’Europe a fait du « suivisme », selon la formule d’un observateur flamand des relations internationales, le Prof. Rik Coolsaet. Elle a benoîtement acquiescé aux menées dangereuses et sciemment destructrices de Washington, puissance étrangère à l’espace européen et à l’espace du Levant et de la Méditerranée orientale. Elle paie donc aujourd’hui les pots cassés car elle est la voisine immédiate des régions où l’hegemon-ennemi a semé le chaos. Celui-ci cherche à éviter ce que j’appellerais la « perspective Marco Polo », la cohésion en marche des puissances d’Eurasie (Europe, Russie, Inde, Chine), par le truchement des télécommunications, des nouvelles voies maritimes et ferroviaires en construction ou en projet, du commerce, etc. Par voie de conséquence, l’hegemon hostile doit mener plusieurs actions destructrices, « chaotogènes » dans les régions les plus sensibles que les géopolitologues nomment les « gateway regions », soit les régions qui sont des « passages stratégiques » incontournables, permettant, s’ils sont dominés, de dynamiser de vastes espaces ou, s’ils sont neutralisés par des forces belligènes, par un chaos fabriqué, de juguler ces mêmes dynamismes potentiels. La Syrie et le Nord de l’Irak sont une de ces « gateway regions » et l’étaient déjà au moyen-âge car ce Levant, avec sa projection vers l’hinterland mésopotamien, donnait accès à l’une des routes de la soie, menant, via Bagdad, à l’Inde et la Chine. L’Ukraine est une autre de ces « gateway regions ». L’abcès de fixation du Donbass est un verrou sur la route du nord, celle empruntée, avant la première croisade d’Urbain II, par les Coumans turcs, tandis que leurs cousins seldjouks occupaient justement les points-clefs du Levant, dont on reparle aujourd’hui : cette tenaille turque, païenne au nord et musulmane au sud, barrait la route de la soie, la voie vers l’Inde et la Chine, enclavait l’Europe à l’Est et risquait de la provincialiser définitivement.
Ces pays, jadis structurés selon les principes de l’idéologie baathiste (personnaliste, transconfessionnelle et étatiste), avaient le mérite de la stabilité et faisaient l’admiration d’un grand diplomate néerlandais, Nikolaos Van Dam, docteur en langue et civilisation arabes, qui a consacré un ouvrage en anglais à la Syrie baathiste qui mériterait bien d’être traduit en toutes les grandes langues d’Europe. Cette stabilité, maintenue parfois avec rudesse et sévérité, a été brisée : on a cassé la forme d’Etat qui finissait vaille que vaille par s’imposer dans une région, soulignait aussi Van Dam, marquée par le tribalisme et allergique à cette forme étatique et européenne de gestion des « res publicae ». L’Europe a fait du « suivisme », selon la formule d’un observateur flamand des relations internationales, le Prof. Rik Coolsaet. Elle a benoîtement acquiescé aux menées dangereuses et sciemment destructrices de Washington, puissance étrangère à l’espace européen et à l’espace du Levant et de la Méditerranée orientale. Elle paie donc aujourd’hui les pots cassés car elle est la voisine immédiate des régions où l’hegemon-ennemi a semé le chaos. Celui-ci cherche à éviter ce que j’appellerais la « perspective Marco Polo », la cohésion en marche des puissances d’Eurasie (Europe, Russie, Inde, Chine), par le truchement des télécommunications, des nouvelles voies maritimes et ferroviaires en construction ou en projet, du commerce, etc. Par voie de conséquence, l’hegemon hostile doit mener plusieurs actions destructrices, « chaotogènes » dans les régions les plus sensibles que les géopolitologues nomment les « gateway regions », soit les régions qui sont des « passages stratégiques » incontournables, permettant, s’ils sont dominés, de dynamiser de vastes espaces ou, s’ils sont neutralisés par des forces belligènes, par un chaos fabriqué, de juguler ces mêmes dynamismes potentiels. La Syrie et le Nord de l’Irak sont une de ces « gateway regions » et l’étaient déjà au moyen-âge car ce Levant, avec sa projection vers l’hinterland mésopotamien, donnait accès à l’une des routes de la soie, menant, via Bagdad, à l’Inde et la Chine. L’Ukraine est une autre de ces « gateway regions ». L’abcès de fixation du Donbass est un verrou sur la route du nord, celle empruntée, avant la première croisade d’Urbain II, par les Coumans turcs, tandis que leurs cousins seldjouks occupaient justement les points-clefs du Levant, dont on reparle aujourd’hui : cette tenaille turque, païenne au nord et musulmane au sud, barrait la route de la soie, la voie vers l’Inde et la Chine, enclavait l’Europe à l’Est et risquait de la provincialiser définitivement.
 Par ailleurs, dans un avenir très proche, d’autres zones de turbulences pourront éclore autour de l’Afghanistan, non pacifié, dans le Sinkiang chinois, base de départ d’une récente vague d’attentats terroristes en Chine, en Transnistrie/Moldavie ou ailleurs. L’Europe, dans cette perspective, doit être cernée par des zones de turbulence ingérables, afin qu’elle ne puisse plus se projeter ni vers l’Afrique ni vers le Levant ni vers l’Asie centrale au-delà de l’Ukraine. L’Europe a la mémoire courte et ses établissements d’enseignement ne se souviennent plus ni de Carl Schmitt (surtout le théoricien du « grand espace » et le critique des faux traités pacifistes dictés par les Américains) ni surtout du géopolitologue Robert Strausz-Hupé (1903-2002; photo ci-contre) qui, pour le compte de Roosevelt et de Truman, percevait très clairement les atouts de la puissance européenne (allemande à son époque), que toute politique américaine se devait de détruire. Ces atouts étaient, entre bien d’autres choses, l’excellence des systèmes universitaires européens, la cohésion sociale due à l’homogénéité des populations et la qualité des produits industriels. Le système universitaire a été détruit par les nouvelles pédagogies aberrantes depuis les années 60 et par ce que Philippe Muray appelait en France l’idéologie « festiviste » ; l’homogénéité des populations est sapée par des politiques migratoires désordonnées et irréfléchies, dont l’afflux massif de ces dernières semaines constitue l’apothéose, une apothéose qui détruira les systèmes sociaux exemplaires de notre Europe, qui seront bientôt incapables de s’auto-financer. Les Européens seront dès lors dans l’impossibilité de consacrer des budgets (d’ailleurs déjà insuffisants ou inexistants) à l’insertion de telles quantités de nouveaux venus. L’Europe s’effondre, perd l’atout de son excellent système social et ne peut plus distraire des fonds pour une défense continentale efficace ou pour la « recherche & développement » en technologies de pointe. Avec le scandale Volkswagen, qui verra le marché américain lui échapper, un coup fatal est porté à l’industrie lourde européenne. La boucle est bouclée.
Par ailleurs, dans un avenir très proche, d’autres zones de turbulences pourront éclore autour de l’Afghanistan, non pacifié, dans le Sinkiang chinois, base de départ d’une récente vague d’attentats terroristes en Chine, en Transnistrie/Moldavie ou ailleurs. L’Europe, dans cette perspective, doit être cernée par des zones de turbulence ingérables, afin qu’elle ne puisse plus se projeter ni vers l’Afrique ni vers le Levant ni vers l’Asie centrale au-delà de l’Ukraine. L’Europe a la mémoire courte et ses établissements d’enseignement ne se souviennent plus ni de Carl Schmitt (surtout le théoricien du « grand espace » et le critique des faux traités pacifistes dictés par les Américains) ni surtout du géopolitologue Robert Strausz-Hupé (1903-2002; photo ci-contre) qui, pour le compte de Roosevelt et de Truman, percevait très clairement les atouts de la puissance européenne (allemande à son époque), que toute politique américaine se devait de détruire. Ces atouts étaient, entre bien d’autres choses, l’excellence des systèmes universitaires européens, la cohésion sociale due à l’homogénéité des populations et la qualité des produits industriels. Le système universitaire a été détruit par les nouvelles pédagogies aberrantes depuis les années 60 et par ce que Philippe Muray appelait en France l’idéologie « festiviste » ; l’homogénéité des populations est sapée par des politiques migratoires désordonnées et irréfléchies, dont l’afflux massif de ces dernières semaines constitue l’apothéose, une apothéose qui détruira les systèmes sociaux exemplaires de notre Europe, qui seront bientôt incapables de s’auto-financer. Les Européens seront dès lors dans l’impossibilité de consacrer des budgets (d’ailleurs déjà insuffisants ou inexistants) à l’insertion de telles quantités de nouveaux venus. L’Europe s’effondre, perd l’atout de son excellent système social et ne peut plus distraire des fonds pour une défense continentale efficace ou pour la « recherche & développement » en technologies de pointe. Avec le scandale Volkswagen, qui verra le marché américain lui échapper, un coup fatal est porté à l’industrie lourde européenne. La boucle est bouclée.
- Partout en Europe des mouvements hostiles à l'immigration ont beaucoup de succès. Dans bon nombre de ces cas, cependant, ces partis n'ont pas très clairement compris qu’attaquer l'immigration sans se battre contre la vision du monde libérale et les mécanismes du capitalisme est une bataille qui ne touche pas les racines du Système. Que pensez-vous?
Votre question pointe du doigt le problème le plus grave qui soit : effectivement, les succès récents de partis ou mouvements hostiles à cette nouvelle vague migratoire, considérée comme ingérable, sont dus à un facteur bien évident : les masses devinent inconsciemment que les acquis sociaux des combats socialistes, démocrates-chrétiens, nationalistes, communistes et autres, menés depuis la fin du 19ème siècle, vont être balayés et détruits. Le paradoxe que nous avons sous les yeux est le suivant : depuis 1979 (année de l’accession au pouvoir de Thatcher en Grande-Bretagne), la vogue contestatrice de l’Etat keynésien, jugé trop rigide et mal géré par les socialistes « bonzifiés » (Roberto Michels), a été la vogue néolibérale, mêlant, en un cocktail particulièrement pernicieux, divers linéaments de l’idéologie libérale anti-étatique et anti-politique. Une recomposition mentale erronée s’est opérée : elle a injecté dans toutes les contestations des déviances et errements politiques régimistes une dose de néolibéralisme, dorénavant difficilement éradicable. Quand ces partis et mouvements anti-immigration acquièrent quelque pouvoir, même à des niveaux assez modestes, ils s’empressent de réaliser une partie du vaste programme déconstructiviste des écoles néolibérales, préparant de la sorte l’avènement d’horreurs comme le Traité transatlantique qui effacera toute trace des Etats nationaux et tout résidu d’identité populaire et nationale. On combat l’immigration parce qu’on l’accuse de porter atteinte à l’identité mais on pratique des politiques néolibérales qui vont bientôt tuer définitivement toute forme d’identité. Le combat contre le néolibéralisme et ses effets délétères doit être un combat socialiste et syndicaliste musclé (retour à Sorel et Corridoni), pétri, non plus des idées édulcorées et dévoyées des pseudo-socialistes actuels, mais des théories économiques dites « hétérodoxes », dérivées de Friedrich List, des écoles historiques allemandes et de l’institutionnalisme américain (Thorstein Veblen). Parce que ces écoles hétérodoxes ne sont pas universalistes mais tiennent compte des contextes religieux, nationaux, civilisationnels, culturels, etc. Elles ne théorisent pas un homme, un producteur ou un consommateur abstrait mais un citoyen ancré dans une réalité léguée par l’histoire. Etre en rébellion contre le système, négateur des réalités concrètes, postule d’être un hétérodoxe économique, qui veut les sauver, les réhabiliter, les respecter.
- Que pensez-vous des positions actuelles, plus ou moins «identitaires» des intellectuels comme Zemmour, Onfray, Houellebecq, Finkielkraut, Debray?
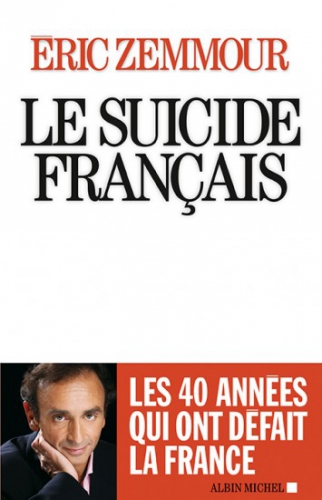 Tous les hommes que vous citez ici sont bien différents les uns des autres : seuls les praticiens sourcilleux de la médiacratie contrôlante et du « politiquement correct » amalgament ces penseurs en une sorte de nouvel « axe du mal » au sein du « paysage intellectuel français » (PIF). Zemmour dresse un bilan intéressant de la déconstruction de la France au cours des quatre dernières décennies, déconstruction qui est un démantèlement progressif de l’Etat gaullien. En ce sens, Zemmour n’est pas un « libéral » mais une sorte de personnaliste gaullien qui estime qu’aucune société ne peut bien fonctionner sans une épine dorsale politique.
Tous les hommes que vous citez ici sont bien différents les uns des autres : seuls les praticiens sourcilleux de la médiacratie contrôlante et du « politiquement correct » amalgament ces penseurs en une sorte de nouvel « axe du mal » au sein du « paysage intellectuel français » (PIF). Zemmour dresse un bilan intéressant de la déconstruction de la France au cours des quatre dernières décennies, déconstruction qui est un démantèlement progressif de l’Etat gaullien. En ce sens, Zemmour n’est pas un « libéral » mais une sorte de personnaliste gaullien qui estime qu’aucune société ne peut bien fonctionner sans une épine dorsale politique.
Onfray a toujours été pour moi un philosophe plaisant à lire, au ton badin, qui esquissait de manière bien agréable ce qu’était la « raison gourmande », par exemple, et insistait sur l’homme comme être de goût et non pas seulement être pensant à la façon de Descartes. Onfray esquissait une histoire alternative de la philosophie en ressuscitant des filons qu’une pensée française trop rationaliste avait refoulés ou qui ne cadraient plus avec la bien-pensance totalitaire inaugurée par Bernard-Henry Lévy à la fin des années 70, période où émerge le « politiquement correct » à la française. Plus récemment, Onfray a sorti un ouvrage toujours aussi agréable à lire, intitulé « Cosmos », où il apparaît bien pour ce qu’il est, soit un anarchiste cosmique, doublé d’un nietzschéen libertaire, d’un avatar actuel des « Frères du Libre Esprit ». Certaines de ses options le rapprochent des prémisses organicistes, dionysiaques et nietzschéennes de la fameuse « révolution conservatrice » allemande, du moins dans les aspects non soldatiques qu’elle a revêtus avant la catastrophe de 1914. D’où un certain rapprochement avec la nouvelle droite historique, observable depuis quelques jours seulement.

Houellebecq exprime, mieux que personne en Europe occidentale aujourd’hui, l’effondrement moral de nos populations, leur dé-virilisation sous les coups de butoir d’un féminisme exacerbé et délirant, ce qui explique, notamment, le succès retentissant de son ouvrage Soumission aux Etats-Unis. Houellebecq se déclare affecté lui-même par la maladie de la déchéance, qui, qu’on le veuille ou non, fait l’identité européenne actuelle, radical contraire de ce que furent les fulgurances héroïques et constructives de l’Europe d’antan. L’homo europaeus actuel est un effondré moral, une loque infra-humaine qui cherche quelques petits plaisirs furtifs et éphémères pour compenser le vide effroyable qu’est devenue son existence. Pour retrouver une certaine dignité, notamment face à ce féminisme castrateur, cet homo europaeus pourrait, pense Houellebecq, se soumettre à l’islam, le terme « islam » signifiant d’ailleurs soumission à la volonté de Dieu et aux lois de sa création. Ce passage à la « soumission », c’est-à-dire à l’islam, balaierait le féminisme castrateur et redonnerait quelque lustre aux mâles frustrés, où ceux-ci pourraient reprendre du poil de la bête dans une Oumma planétaire, agrandie de l’Europe.
Le parcours de Finkielkraut est plus étonnant, dans la mesure où il a bel et bien fait partie de ces « nouveaux philosophes » de la place de Paris, en lutte contre un totalitarisme qu’ils jugeaient ubiquitaire et dont ils étaient chargé par la « Providence » ou par « Yahvé » (Lévy !) de traquer les moindres manifestations ou les résurgences les plus ténues. Ce totalitarisme se percevait partout, surtout dans les structures de l’Etat gaullien, subtilement assimilé, surtout chez Bernard-Henri Lévy, à des formes françaises d’une sorte de nazisme omniprésent, omni-compénétrant, toujours prêt à resurgir de manière caricaturale. Ces diabolisations faisaient le jeu du néolibéralisme thatchéro-reaganien et datent d’ailleurs de l’avènement de celui-ci sur les scènes politiques britannique et américaine. Finkielkraut a été emblématique de ces démarches, surtout, rappelons-le, lors de la guerre de l’OTAN contre la Serbie. Finkielkraut avait exhumé des penseurs libéraux serbes du 19ème siècle inspirés par le philosophe différentialiste allemand Herder, pour démontrer de manière boiteuse, en sollicitant les faits de manière pernicieuse et malhonnête, que deux de ces braves philologues serbes, espérant se débarrasser du joug ottoman, étaient en réalité des précurseurs du nazisme (encore !). Ce travail de Finkielkraut était d’autant plus ridicule qu’au même moment, à Vienne, un journaliste très connu, Wolfgang Libal, également israélite mais, lui, spécialiste insigne du « Sud-Est européen », écrivait un ouvrage à grand tirage pour démontrer le caractère éminemment démocratique (national-libéral) des deux philologues, posés comme pionniers de la modernité dans les Balkans !!
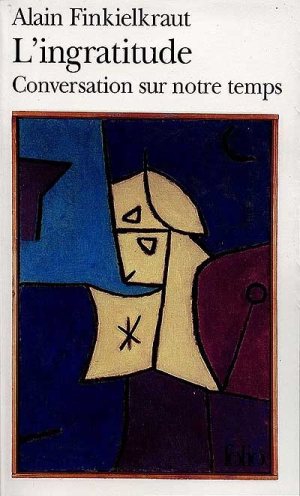 Après son hystérie anti-serbe, Finkielkraut, sans doute parce qu’il prend de l’âge, s’est « bonifié » comme disent les œnologues. Son ouvrage sur la notion d’ingratitude, qui est constitué des réponses à un très long entretien accordé au journal québécois Le Devoir, est intéressant car il y explique que les malheurs de notre époque viennent du fait que l’homme actuel se montre « ingrat » par rapport aux legs du passé. J’ai lu cet entretien avec grand intérêt et beaucoup de plaisir, y retrouvant d’ailleurs une facette de l’antique querelle des anciens et des modernes. Je dois l’avouer même si le Finkielkraut serbophobe m’avait particulièrement horripilé. A partir de cette réflexion sur l’ingratitude, Finkielkraut va, peut-être inconsciemment, sans doute à son corps défendant, adopter les réflexes intellectuels des deux Serbes herdériens qu’il fustigeait avec tant de fureur dans les années 90. Il va découvrir l’« identité » et, par une sorte de tour de passe-passe qui me laisse toujours pantois, défendre une identité française que Lévy avait posée comme une matrice particulièrement répugnante du nazisme !
Après son hystérie anti-serbe, Finkielkraut, sans doute parce qu’il prend de l’âge, s’est « bonifié » comme disent les œnologues. Son ouvrage sur la notion d’ingratitude, qui est constitué des réponses à un très long entretien accordé au journal québécois Le Devoir, est intéressant car il y explique que les malheurs de notre époque viennent du fait que l’homme actuel se montre « ingrat » par rapport aux legs du passé. J’ai lu cet entretien avec grand intérêt et beaucoup de plaisir, y retrouvant d’ailleurs une facette de l’antique querelle des anciens et des modernes. Je dois l’avouer même si le Finkielkraut serbophobe m’avait particulièrement horripilé. A partir de cette réflexion sur l’ingratitude, Finkielkraut va, peut-être inconsciemment, sans doute à son corps défendant, adopter les réflexes intellectuels des deux Serbes herdériens qu’il fustigeait avec tant de fureur dans les années 90. Il va découvrir l’« identité » et, par une sorte de tour de passe-passe qui me laisse toujours pantois, défendre une identité française que Lévy avait posée comme une matrice particulièrement répugnante du nazisme !
Debray est un penseur plus profond à mes yeux. Le début de sa carrière dans le paysage intellectuel français date des années 60, où il avait rencontré et accompagné Che Guevara en Bolivie. Cet aspect suscite toutes les nostalgies d’une époque où l’aventure était encore possible. Jean Cau, ancien secrétaire de Sartre (entre 1947 et 1956) qui, ultérieurement, ne ménagera pas ses sarcasmes à l’encontre des gauches parisiennes, consacrera en 1979 un ouvrage au Che, intitulé Une passion pour Che Guevara ; en résumé, nous avons là l’hommage d’un ancien militant de gauche, passé à « droite » (pour autant que cela veuille dire quelque chose…), qui ne renie pas la dimension véritablement existentielle de l’aventure et de l’engagement pour ses idées, fussent-elles celles qu’il vient explicitement de rejeter. Debray a donc mis, dans une première phase de sa carrière, sa peau au bout de ces idées. Peu ont eu ce courage même si d’aucuns ont cherché plus tard à minimiser son rôle en Bolivie.
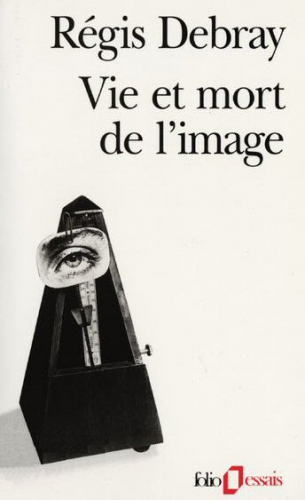 Dans les années 80, Debray, devenu, plutôt à son corps défendant, faire-valoir du mitterrandisme ascendant, participera à toutes les mascarades de la gauche officielle, en voie de « festivisation » et d’embourgeoisement, où les cocottes et les bobos se piquent d’eudémonisme et se posent en « belles âmes » (on sait ce que Hegel en pensait…). Les actions qu’il mène, je préfère les oublier aujourd’hui, tant elles ont participé des bouffonneries pariso-parisiennes. Mais entre l’épisode du militant guevariste et celle du néo-national-gaulliste d’aujourd’hui, il n’y a pas eu que cette participation à la lèpre républicano-mitterrandiste, il y a eu le passage du Debray militant et idéologue au Debray philosophe et « médiologue » (une science visant à cerner l’impact des « médiations », des images, dont éventuellement celles des médias, sur la formation ou la transformation des mentalités et des aspirations politiques). C’est dans le cadre de ce statut de « médiologue », qui commence en 1993, que Debray va glisser progressivement vers des positions différentes de celles imposées par le ronron médiatique ou le « politiquement correct » des « nouveaux philosophes » (Lévy, etc.) « qui », dit-il, « produisent de l’indignation au rythme de l’actualité ». Debray, comme l’indique alors le titre d’un de ses ouvrages récents, Dégagements, se « dégage » de ses engagements antérieurs, l’espace de la gauche, de sa gauche, ayant été phagocyté par de nouveaux venus qui se disent « occidentaux » et participent à la pratique perverse de la table rase, notamment en Amérique latine : leur travail de sape serait entièrement parachevé si des hommes comme Evo Morales, qu’il qualifie positivement d’« indigéniste », ne s’étaient pas dressés contre son vieil ennemi l’impérialisme américain, appuyé par les bourgeoisies compradores.
Dans les années 80, Debray, devenu, plutôt à son corps défendant, faire-valoir du mitterrandisme ascendant, participera à toutes les mascarades de la gauche officielle, en voie de « festivisation » et d’embourgeoisement, où les cocottes et les bobos se piquent d’eudémonisme et se posent en « belles âmes » (on sait ce que Hegel en pensait…). Les actions qu’il mène, je préfère les oublier aujourd’hui, tant elles ont participé des bouffonneries pariso-parisiennes. Mais entre l’épisode du militant guevariste et celle du néo-national-gaulliste d’aujourd’hui, il n’y a pas eu que cette participation à la lèpre républicano-mitterrandiste, il y a eu le passage du Debray militant et idéologue au Debray philosophe et « médiologue » (une science visant à cerner l’impact des « médiations », des images, dont éventuellement celles des médias, sur la formation ou la transformation des mentalités et des aspirations politiques). C’est dans le cadre de ce statut de « médiologue », qui commence en 1993, que Debray va glisser progressivement vers des positions différentes de celles imposées par le ronron médiatique ou le « politiquement correct » des « nouveaux philosophes » (Lévy, etc.) « qui », dit-il, « produisent de l’indignation au rythme de l’actualité ». Debray, comme l’indique alors le titre d’un de ses ouvrages récents, Dégagements, se « dégage » de ses engagements antérieurs, l’espace de la gauche, de sa gauche, ayant été phagocyté par de nouveaux venus qui se disent « occidentaux » et participent à la pratique perverse de la table rase, notamment en Amérique latine : leur travail de sape serait entièrement parachevé si des hommes comme Evo Morales, qu’il qualifie positivement d’« indigéniste », ne s’étaient pas dressés contre son vieil ennemi l’impérialisme américain, appuyé par les bourgeoisies compradores.
Enfin, les révolutions socialistes (et communistes) sont d’abord des nationalismes, écrit-il en 2010 : en dépit de l’omniprésence du Front National dans la vie politique de l’Hexagone, Debray ne craint plus le mot, à l’heure où les nouvelles gauches « néo-philosophiques » perdent et ruinent tout sens historique et basculent dans la moraline répétitive et incantatoire, dans le compassionnel et l’indignation programmée. Debray se déclare aussi « vieux jeu » : ce n’est pas le reproche que je lui ferai ; cependant, l’abus, dans ses œuvres polémiques récentes, est d’utiliser trop abondamment le vocable (également incantatoire) de « République » qui, pour tout observateur non parisien, est un véhicule d’éléments délétères de modernité donc d’ignorance du véritable tissu historique et populaire. De même, sa vision de l’« Etat » est trop marquée par l’idéologie jacobine, figée au fil des décennies depuis le début du 19ème siècle. Ceci dit, ses remarques et ses critiques (à l’adresse de son ancien camp) permettent de réamorcer un combat, non pas pour rétablir la « République » à la française avec son cortège de figements et d’archaïsmes ou un Etat trop rigide, mais pour restaurer ce que Julien Freund, à la suite de Carl Schmitt, nommait « le politique ». Combat qui pourrait d’ailleurs partir des remarques excellentes de Debray sur la « représentation », sur le « decorum », nécessaire à toute machine politique qui se respecte et force le respect : Carl Schmitt insistait, lui aussi, sur les splendeurs et les fastes du catholicisme, à reproduire dans tout Etat, sur la visibilité du pouvoir, antidote aux « potestates indirectae », aux pouvoirs occultes qui produisent les oligarchies dénoncées par Roberto Michels, celles qui se mettent sciemment en marge, se dérobent en des coulisses cachées, pour se soustraire au regard du peuple ou même de leurs propres militants. Schmitt hier, Debray aujourd’hui, veulent restaurer la parfaite visibilité du pouvoir : nous trouvons là une thématique métapolitique offensive qu’il serait bon, pour tous, d’articuler en nouveaux instruments de combat. Debray est sans nul doute une sorte d’enfant prodigue, qui a erré en des lieux de perdition pour revenir dans un espace à l’air rare et vif. L’histoire des idées se souviendra de son itinéraire : nous jetterons dès lors un œil narquois sur les agitations qu’il a commises dans les années 80 dans les allées du pouvoir mitterrandien et vouerons une admiration pour l’itinéraire du « médiologue » qui nous aura fourni des arguments pour opérer une critique de la dictature médiatique et pour rendre au pouvoir sa visibilité, partageable entre tous les citoyens et donc véritablement « démocratique » ou plutôt réellement populiste. Derrière cela, les quelques « franzouseries » statolâtriques et « républicagnanates », qu’il traine encore à ses basques, seront à mettre au rayon du folklore, là où il rangeait lui-même le vieux et caduc « clivage gauche/droite », dans quelques phrases bien ciselées de Dégagements.
- Êtes-vous d'accord avec la thèse du Grand Remplacement?
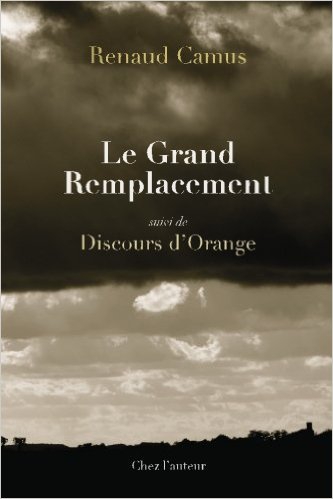 Je ne considère pas la notion de « Grand Remplacement » comme une thèse mais comme un terme-choc impulsant une réflexion antagoniste par rapport au fatras dominant, comme une figure de rhétorique, destinée à dénoncer la situation actuelle où le compassionnel, introduit dans les pratiques politiques par les nouveaux philosophes, évacue toute éthique de la responsabilité. Vous avez vous-même, en langue italienne, défini et explicité la notion de « Grand Remplacement » (http://www.ilprimatonazionale.it/cultura/grande-sostituzione-32682/ ). Vous l’avez fait avec brio. Et démontré que Marine Le Pen comme Matteo Salvini l’avaient incluse dans le langage politico-polémique qui anime les marges dites « droitières » ou « populistes » des spectres politiques européens d’aujourd’hui. Renaud Camus, père du concept, a le sens des formules, du discours (selon une bonne tradition française remontant au moins à Bossuet). Il est aussi le créateur de deux autres notions qui mériteraient de connaître la même bonne fortune : la notion de « nocence », contraire de l’« in-nocence », puis la notion de « dé-civilisation ». Renaud Camus se pose comme « in-nocent », comme un être qui ne cherche pas à nuire (« nocere » en latin). Les régimes politiques en place, eux, cherchent toujours à nuire à leurs citoyens ou sujets, qu’il haïssent au point de vouloir justement les remplacer par des êtres humains perdus, venus de partout et de nulle part, attirés par les promesses fallacieuses d’un paradis économique, où l’on touche des subsides sans avoir à fournir des efforts ni à respecter des devoirs sociaux ou citoyens. Les établis forment donc le parti de la « nocence », de la nuisance, auquel il faut opposer l’idéal, peut-être un peu irénique, de l’« in-nocence », sorte d’ascèse qui me rappelle tout à la fois le bouddhisme de Schopenhauer, le quiétisme de Gustav Landauer, but de son idéal révolutionnaire à Munich en 1919, et l’économie empathique de Serge-Christophe Kolm, inspiré par les pratiques bouddhistes (efficaces) qu’il a observées en Asie du Sud-est (cf. notre dossier : http://www.archiveseroe.eu/kolm-a118861530 ). Si la « nocence » triomphe et s’établit sur la longue durée, la civilisation, après la culture et l’éducation, s’effiloche, se détricote et disparait. C’est l’ère de la « dé-civilisation », du « refus névrotique de l’héritage ancestral », commente l’écrivain belge Christopher Gérard. Ce pessimisme n’est pas une idée neuve mais, à notre époque, elle constitue un retour du réalisme, après une parenthèse trop longue de rejet systématique et pathologique de nos héritages.
Je ne considère pas la notion de « Grand Remplacement » comme une thèse mais comme un terme-choc impulsant une réflexion antagoniste par rapport au fatras dominant, comme une figure de rhétorique, destinée à dénoncer la situation actuelle où le compassionnel, introduit dans les pratiques politiques par les nouveaux philosophes, évacue toute éthique de la responsabilité. Vous avez vous-même, en langue italienne, défini et explicité la notion de « Grand Remplacement » (http://www.ilprimatonazionale.it/cultura/grande-sostituzione-32682/ ). Vous l’avez fait avec brio. Et démontré que Marine Le Pen comme Matteo Salvini l’avaient incluse dans le langage politico-polémique qui anime les marges dites « droitières » ou « populistes » des spectres politiques européens d’aujourd’hui. Renaud Camus, père du concept, a le sens des formules, du discours (selon une bonne tradition française remontant au moins à Bossuet). Il est aussi le créateur de deux autres notions qui mériteraient de connaître la même bonne fortune : la notion de « nocence », contraire de l’« in-nocence », puis la notion de « dé-civilisation ». Renaud Camus se pose comme « in-nocent », comme un être qui ne cherche pas à nuire (« nocere » en latin). Les régimes politiques en place, eux, cherchent toujours à nuire à leurs citoyens ou sujets, qu’il haïssent au point de vouloir justement les remplacer par des êtres humains perdus, venus de partout et de nulle part, attirés par les promesses fallacieuses d’un paradis économique, où l’on touche des subsides sans avoir à fournir des efforts ni à respecter des devoirs sociaux ou citoyens. Les établis forment donc le parti de la « nocence », de la nuisance, auquel il faut opposer l’idéal, peut-être un peu irénique, de l’« in-nocence », sorte d’ascèse qui me rappelle tout à la fois le bouddhisme de Schopenhauer, le quiétisme de Gustav Landauer, but de son idéal révolutionnaire à Munich en 1919, et l’économie empathique de Serge-Christophe Kolm, inspiré par les pratiques bouddhistes (efficaces) qu’il a observées en Asie du Sud-est (cf. notre dossier : http://www.archiveseroe.eu/kolm-a118861530 ). Si la « nocence » triomphe et s’établit sur la longue durée, la civilisation, après la culture et l’éducation, s’effiloche, se détricote et disparait. C’est l’ère de la « dé-civilisation », du « refus névrotique de l’héritage ancestral », commente l’écrivain belge Christopher Gérard. Ce pessimisme n’est pas une idée neuve mais, à notre époque, elle constitue un retour du réalisme, après une parenthèse trop longue de rejet systématique et pathologique de nos héritages.
Je mettrais en parallèle la double idée de Renaud Camus d’une « dé-culturation » et d’une « dé-civilisation » avec l’idée de « dissociété », forgée par le philosophe Marcel De Corte au début des années 50. Pour De Corte, monarchiste belge et catholique thomiste, l’imposition des élucubrations libérales de la révolution française aux peuples d’Europe a conduit à la dislocation du tissu social, si bien que nous n’avons plus affaire à une « société » harmonieuse, au sens traditionnel du terme comme l’entendait Louis de Bonald, mais à une « dissociété ». L’idée, en dépit de son origine très conservatrice, est reprise aujourd’hui par quelques théoriciens d’une gauche non-conformiste, dont le Prof. Jacques Généreux qui constate amèrement que les pathologies de la dissociété moderne sont une « maladie sociale dégénérative qui altère les consciences en leur inculquant une culture fausse ». Généreux, socialiste au départ et rêvant à l’avènement d’un nouveau socialisme capable de gommer définitivement les affres de la « dissociété », quitte, déçu, le PS français en 2008 pour aller militer au « Parti de Gauche » et pour figurer sur la liste « Front de Gauche pour changer l’Europe », candidate aux élections européennes de 2009. En mars 2013, les idées, pourtant pertinentes, de Généreux ne séduisent plus ses compagnons de route et ses co-listiers : il n’est pas réélu au Bureau politique ! Preuve que la pertinence ne peut aller se nicher et prospérer au sein des gauches françaises non socialistes, bornées dans leurs analyses, sclérosées dans des marottes jacobines et résistancialistes qui ne sont qu’anachronismes ou tourneboulées par les délires immigrationnistes dont l’irréalisme foncier est plus virulent et plus maladivement agressif en France qu’ailleurs en Europe.
Ceci dit, l’idée de « Grand Remplacement » est à mes yeux un des avatars actuels d’un ouvrage écrit en 1973, le fameux récit Le Camp des Saints de Jean Raspail, où l’Europe est envahie par des millions d’hères faméliques cherchant à s’y installer. Les grandes banlieues des principales villes de France étaient déjà occupées par d’autres populations, complètement coupées des Français de souche. Dorénavant on voit la bigarrure ethnique émerger, à forte ou à moyenne dose, dans de petites villes comme Etampes, Vierzon ou Orléans, où elle semble effectivement « remplacer » les départs antérieurs, ceux de l’exode rural, ceux du départ vers les grandes mégapoles où dominent les emplois du secteur tertiaire. La France donne l’impression de juxtaposer sur son territoire deux ou plusieurs sociétés (ou dissociétés) parallèles, étanches les unes par rapport aux autres. Personne n’est satisfait ; d’abord les « remplacés », bien évidemment, dont les modes de vie et surtout les habitudes alimentaires sont dénigrées et jugées « impures » (ce qui fâche tout particulièrement les Français, très fiers de leurs traditions gastronomiques) mais aussi les « remplaçants » qui ne peuvent pas reproduire leur mode de vie et manifestent dès lors un mal de vivre destructeur. Le plan satanique du libéralisme se réalise dans cette bigarrure : la société est disloquée, livrée à la « cash flow mentality », déjà décriée par Thomas Carlyle au début du 19ème siècle. Le néolibéralisme, amplification monstrueuse de cette « mentality », étendue à la planète entière, ne peut survivre que dans des sociétés brisées, de même que les « économies diasporiques » ou les réseaux mafieux, pourfendus par les gauches intellectuelles non conformistes mais non combattus sur le terrain, dans le concret de la dissociété réellement existante.
- Dans le parlement italien, on est en train de changer les lois sur la citoyenneté, en introduisant le principe de la citoyenneté par le lieu de naissance (jus soli) à la place de celui fondé sur la nationalité des parents (jus sanguinis). Selon vous quelles conséquences cela aura sur le tissu social de notre pays?
Le débat opposant le jus sanguinis au jus soli est ancien. Il remonte à l’époque napoléonienne. Napoléon voulait accorder automatiquement la nationalité française à toute personne vivant en France et ayant bénéficié d’une éducation (scolaire) française. Le but était aussi de recruter des soldats pour les campagnes militaires qu’il menait partout en Europe. Les rédacteurs du Code civil optent toutefois pour le jus sanguinis. Ces dispositions seront modifiées en 1889, vu l’afflux massif d’immigrés dans la France du 19ème siècle, essentiellement belges et italiens, dans une moindre mesure allemands et espagnols. Même visée que celle de Napoléon : la France de souche connait un ressac démographique, encore léger toutefois, face à une Allemagne qui, elle, connaît un véritablement boom démographique, en dépit des émigrations massives vers les Etats-Unis (plus de 50 millions de citoyens américains sont aujourd’hui d’origine allemande). Il faut à cette France angoissée devant son voisin de l’Est une masse impressionnante de soldats. De même, il faut envoyer des troupes dans un Outre-Mer souvent en révolte où les effectifs de la « Légion étrangère » ne suffisent pas. Dans Paris, sur les monuments aux morts de la première guerre mondiale, on lit plus de 10% de noms germaniques, allemands, suisses ou flamands, quelques noms italiens (ou corses ?), ce qui ne mentionne rien sur les immigrés romans de Suisse ou de Wallonie, parfois de Catalogne, dont les patronymes sont gallo-romans, comme ceux des Français de souche. La France s’est voulue multiethnique dès la fin du 19ème siècle, forçant parfois les immigrés européens, notamment en Afrique du Nord, à acquérir la nationalité française. Tant que cet apport volontaire ou forcé était le fait de peuples immédiatement périphériques, l’intégration et la fusion s’opéraient aisément. Après l’horrible saignée de 1914-18, quand les villages de la France profonde sont exsangues, une immigration plus exotique prend le relais de celle des peuples voisins. La départementalisation de l’Algérie et l’entrée, d’abord timide, de travailleurs algériens, puis subsahariens, colore la nouvelle immigration. Rien à signaler dans un premier temps. Ou rien que des broutilles. A partir du moment où certaines banlieues deviennent à 90% exotiques, le projet d’intégration et d’assimilation cafouille : pourquoi s’intégrer puisque l’environnement de l’immigré n’est en rien « Français de souche » ? Il lui est désormais possible de vivre en complète autarcie par rapport à la population d’origine. La société devient « composite » comme le déplorent les théoriciens indiens du RSS et du BJP qui estiment aussi que de telles sociétés n’ont pas d’avenir constructif, sont condamnées au chaos et à l’implosion. Pour les sociétés européennes, l’avenir nous dira si ces prophéties des théoriciens indiens s’avèreront exactes ou fausses. En attendant, l’introduction du jus soli, au détriment de tout jus sanguinis, en Italie comme ailleurs en Europe, est le signe d’un abandon volontaire de toute idée de continuité, d’héritage. Avec les théories du genre (le « gendérisme ») et les pratiques du néolibéralisme -dont la délocalisation et la titrisation soit l’abandon de toute économie patrimoniale et industrielle au profit d’une économie de la spéculation boursière- ce glissement annonce l’éclosion d’une société nouvelle, éclatée, amnésique, jetant aux orties l’éthique wébérienne de la responsabilité, pour la remplacer par des monstrations indécentes de toutes sortes d’éthiques de la conviction, prononcée sur le mode de l’hystérie « politiquement correcte » et travestie d’oripeaux festivistes et compassionnels. Bref, un Halloween planétaire et permanent.
Forest-Flotzenberg, octobre 2015.