Volkoff
La guerre psychologique n'est pas un vestige oublié de la guerre froide. Sa réactivation par certaines puissances correspond à la volonté soit de compléter les moyens matériels visant à résorber des conflits asymétriques persistants soit à détabiliser une région cruciale économiquement ou géopolitiquement par un travail de sape. Il ne s'agit pas d'un simple art de la ruse, c'est en effet une erreur courante de réduire ces techniques de pouvoir au seul domaine idéologico-culturel, c'est-à-dire à la façon dont les sociétés se représentent (erreur éloquente en ce qu'elle traduit dans nos sociétés dépolitisées surtout un malaise sur le dispersement du consensus social, remettant peu voire aucunement en question les mécanismes de consentement à la légalité donnée comme légitimité). Ce qui se donne à appréhender, c'est bien plutôt une logique de normalisation visant à modifier voire à reconfigurer les matrices spatiales et temporelles d'une région du monde en tant que ces dernières seules permettent à la finale d'avoir prise sur les rapports de production ou les échanges marchands. Cette logique ne peut de fait se reproduire, c'est-à-dire repousser ses limites structurelles, qu'en se transnationalisant (il n'est guère possible de mettre un gendarme du monde derrière chacun). Il ne reste plus à l'anomie occidentale qu'à s'occupper en aval dans le meilleur des mondes et non à remonter en amont vers le type de pouvoir qui alimente le nouvel espace d'une Colonie pénitentiaire qui ne connaît ni intérieur ni extérieur, ni privé ni public, ni passé ni avenir. Les fanatismes de notre époque (Gasset, Monnerot ou Heidegger déjà le soulignaient) ne sont au demeurant que le revers du "système à tuer les peuples" : des sortes d’ersatz de la vie dont on prive les hommes quand on les traite comme des masses, c’est-à-dire « quand on les a vidés de la réalité substantielle qui était liée à leur singularité initiale, ou encore au fait d’appartenir à un petit groupe concret. Le rôle incroyablement néfaste de la presse, de la radio, du cinéma aura précisément consisté à passer une sorte de rouleau compresseur sur cette réalité originale pour lui substituer un ensemble d’idées et d’images surajoutées et dépourvues de toute racine réelle dans l’être même du sujet. Mais alors tout ne se passerait-il pas comme si la propagande venait apporter une sorte d’aliment à l’espèce de faim inconsciente qu’éprouvent ces êtres dépouillés de leur réalité propre ? » (Gabriel Marcel, Les hommes contre l’humain). Le contraire de désinformer, ce n'est donc pas contre-informer (il ne suffit pas déconstruire idéalement le mur comme si maîtriser l'information suffisait à contrôler le rapport de force), c'est bel et bien informer mais en son sens premier, c'est-à-dire donner forme, composer. Penchons-nous maintenant avec Vladimir Volkoff sur en quoi désinformer n'est donc pas simplement tromper mais aussi déformer totalement.
Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation
◘ 1. Volkoff et la subversion
 Vladimir Volkoff, fils d’immigrés russes en France, est principalement un romancier prolixe, qui s’est spécialisé dans le roman historique, dont les thèmes majeurs sont la Russie et la guerre d’Algérie, et dans le roman d’espionnage.
Vladimir Volkoff, fils d’immigrés russes en France, est principalement un romancier prolixe, qui s’est spécialisé dans le roman historique, dont les thèmes majeurs sont la Russie et la guerre d’Algérie, et dans le roman d’espionnage.
Lorsqu’il servait à l’armée, il a entendu, un jour, une conférence sur la guerre psychologique. Pour la petite histoire, il fut le seul, parmi ses camarades, à avoir apprécié ce cours. Ses compagnons tournaient ce genre d’activité en dérision. Volkoff, lui, s’est aussitôt découvert un intérêt pour ces questions.
Son héritage familial le prédisposait à être attentif aux vicissitudes du communisme et aux techniques mises au point par les Soviétiques en matières de manipulation. Poursuivant ses investigations, Volkoff découvre le livre de Mucchilli, intitulé La subversion, où la guerre subversive se voit résumée en trois points :
• 1. Démoraliser la nation adverse et désintégrer les groupes qui la composent.
• 2. Discréditer l’autorité, ses défenseurs, ses fonctionnaires, ses notables.
• 3. Neutraliser les masses dans le but d'empêcher toute intervention spontanée et générale en faveur de l’ordre établi, au moment choisi pour la prise non violente du pouvoir par une petite minorité. Selon cette logique, il convient d’immobiliser les masses plutôt que de les mobiliser (cf. : les révolutionnaires professionnels de Lénine, avant-garde du prolétariat).
Après le succès de son roman Le retournement, dont le thème central est l’espionnage soviétique en France, Volkoff est engagé par le SDECE pour écrire un autre roman, sur la désinformation cette fois et avec la documentation que le service avait rassemblée. Volkoff commence par réfléchir, puis accepte cette mission. Résultat : son livre intitulé Le montage. Il connaît vite un succès important. Sollicité par ses lecteurs, qui veulent savoir sur quoi repose ce livre, il publie Désinformation, arme de guerre, une anthologie de textes sur le sujet. Rappelons que Volkoff, dans Le montage, fait référence à Sun Tzu et à l’objectif du stratège de l’antiquité chinoise : gagner la guerre avant même de la livrer. Citations : « Dans la guerre, la meilleure politique, c’est de prendre l’État intact ; l’anéantir n’est qu’un pis aller ». « Les experts dans l’art de la guerre soumettent l’armée ennemi sans combat. Ils prennent les villes sans donner l’assaut et renversent un État sans opérations prolongées ». « Tout l’art de la guerre est fondé sur la duperie ». Sun Tzu, et à sa suite, Volkoff, formule ses commandements :
• 1. Discréditez tout ce qui est bien dans le pays de l’adversaire.
• 2. Impliquez les représentants de couches dirigeantes du pays adverse dans des entreprises illégales. Ébranlez leur réputation et livrez-les, le moment venu, au dédain de leurs concitoyens.
• 3. Répandez la discorde et les querelles entre citoyens du pays adverse.
• 4. Excitez les jeunes contre les vieux. Ridiculisez les traditions de vos adversaires [Volkoff ajoute : Attisez la guerre entre les sexes].
• 5. Encouragez l’hédonisme et la lassivité chez l’adversaire.
Comme le fait remarquer Volkoff, la subversion ne peut faire surgir du néant ce type de faiblesses. Comme dans toute pensée de l’action indirecte, il faut savoir détecter, chez l’adversaire, toutes formes de faiblesse et les encourager. Tout peuple fort, en revanche, échappe à cette stratégie indirecte ; il n’est pas aussi facilement victime de ces procédés.
◘ 2. De ce que n’est pas la désinformation
Avant d’expliquer ce que n’est pas l’information, il convient de formuler une mise en garde et de bien définir ce qu’est l’information à l’âge de la “société de l’information”. Le militaire distingue l’information, d’une part, et le renseignement, d’autre part. L’information est ce qui est recueilli à l’état brut. Le renseignement, quant à lui, est passé par un triple tamis :
• a) l’évaluation de la source (est-elle fiable ou non ? connue ou inconnue ? Quelles sont ses orientations philosophiques, politiques, religieuses, etc. ?) ;
• b) l’évaluation de l’information (est-elle crédible ou non ?) ;
• c) le recoupement de l’information. Dans toute information ou pour tout renseignement, il y a un émetteur et un récepteur. Les questions qu’il faut dès lors se poser sont les suivantes : Pourquoi l’émetteur émet-il son message ? Pourquoi le récepteur est-il visé par l’émetteur et pourquoi écoute-t-il son message ? L’officier de renseignement, en charge du recoupement, doit savoir que chacun est marqué par sa subjectivité. Il doit pouvoir en tirer des conclusions. Ce qui nous amène à constater que l’objectivité, en ce domaine, n’existe pas. Ceux qui prétendent donner une information objective sont soit idiots soit malhonnêtes.
A. LA DÉSINFORMATION N’EST PAS DE LA PROPAGANDE.
Quand on fait de la propagande, on sait que c’est de la propagande. On sait qui émet et on sait qui est visé. La propagande est claire. Elle vise à convaincre en semblant s’adresser à l’intelligence mais, en réalité, elle vise les émotions.
B. LA DÉSINFORMATION N’EST PAS DE LA PUBLICITÉ.
Le but de la publicité n’est pas de tromper mais de vendre. Le mensonge n’est qu’un moyen d’influencer le consommateur. Elle s’adresse aux pulsions et à l’inconscient des gens. La propagande feint de convaincre, alors que la publicité cherche à séduire, et son but est clair : “achetez Loca-Laco” ou “votez Clinton”.
C. LA DÉSINFORMATION N’EST PAS DE L’INTOXICATION.
Elle ressemble à la désinformation puisqu’elle vise, via des informations, à tromper et à manipuler subtilement une cible. Mais l’intoxication ne vise que les chefs, pour les amener à prendre une mauvaise décision, qui doit causer leur perte.
◘ 3. Qu’est ce que la désinformation ?
La désinformation dépend de trois paramètres :
• 1. Elle vise l’opinion publique, sinon elle serait de l’intoxication.
• 2. Elle emploie des moyens détournés, sinon elle serait de la propagande.
• 3. Elle a des objectifs politiques, intérieurs ou extérieurs, sinon elle serait de la publicité.
Ce qui nous conduit à la définition suivante : la désinformation est une manipulation de l’opinion publique, à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés.
◘ 4. Comment la désinformation est-elle conçue ?
Au niveau de la méthode, nous relevons une analogie avec la publicité.
• A. On doit définir qui est le bénéficiaire de l’opération : c’est celui pour qui l’opération est montée.
• B. On doit disposer de celui qui va réaliser l’opération : l’agent (CIA ou KGB).
• C. On doit procéder à une étude de marché : quel message va-t-on utiliser pour arriver au but et comment toucher la cible ?
• D. On doit déterminer les supports : la télévision, la presse, une pétition, internet, un intellectuel, etc.
• E. On doit déterminer les relais : les “idiots utiles” et les agents payés dans les sphères de la télévision, de la presse écrite, des pages de la grande toile, les artistes, les acteurs, les écrivains, etc.
• F. On doit déterminer les caisses de résonnance : tous les individus qui, touchés par l’information fausse, la répandent en toute bonne foi, la lancent et la propagent sur un mode idéologique ou autre.
• G. On doit déterminer la cible : elle peut être la population du pays adverse dans son ensemble ; elle peut aussi viser une partie de la population (par ex., les enseignants) voire des pays tiers (p. ex. : l’opération “swastika” à la fin des années 50, pour faire croire à une résurgence du nazisme en Allemagne).
La diabolisation est une forme de désinformation, car elle vise à détruire l’image de l’adversaire (ou de ses chefs) par des méthodes pseudo-objectives. Quelles sont-elles ? Quelques exemples :
• a) Diffuser de faux documents “officiels” ;
• b) diffuser de fausses photos ou de vraies photos décontextualisées (exemples récents : un cliché de morts serbes avec une légende qui les désigne comme “kosovars”) ;
• c) fabriquer de fausses déclaration ou un montage ;
• d) diviser les antagonistes en “bons” et en “mauvais”, en donnant à ce manichéisme des airs “objectifs” ; dans la foulée, on passe sous silence les crimes des “bons”, et on s’abstient de toute critique à leur égard.
◘ 5. Comment la désinformation se pratique-t-elle ?
• a. On nie le(s) fait(s) ou on utilise le mode interrogatif ou dubitatif quand on les évoque. Les formules privilégiées sont : “On dit que… mais il s’agit d’une source serbe, ou néo-nazie, ou paléo-communiste, ou…”. On discrédite ainsi immédiatement l’information vraie que l’on fait passer pour peu “sûre”.
• b. On procède à l’inversion des faits.
• c. On procède à un savant mélange de vrai et de faux.
• d. On modifie le motif d’une action, par ex., l’agression des États-Unis et de l’OTAN contre la Serbie a été présentée non pas comme une action militaire classique mais comme une “mission humanitaire”. Pour l’Irak, la volonté de faire main basse sur les réserves pétrolières du pays est camouflée derrière une argumentation reposant sur le “droit international”.
• e. On modifie les circonstances ou on ne les dit pas. Ce procédé est souvent utilisé dans les informations relatives au conflit israélo-palestinien ou à la guerre civile en Irlande du Nord.
• f. On noie l’information vraie dans un nuage d’informations sans intérêt.
• g. On utilise la méthode de la suggestion, conjuguée au conditionnel. Exemple : “Selon nos sources, il y aurait eu des massacres…”.
• h. On accorde une part inégale à l’adversaire dans les temps consacrés à l’information. Un exemple récent : on a accordé trois minutes d’antenne à Le Pen au second tour des Présidentielles françaises du printemps 2002, ainsi qu’à Chirac, mais, avant cette distribution “égale” du temps d’antenne, on a présenté pendant vingt minutes des manifestations anti-Le Pen.
• i. On accorde parfois la part égale en temps, en invitant les deux camps à s’exprimer : le premier camp, qui est dans les bonnes grâces des médias, est représenté par un universitaire habitué à parler sur antenne ; l’autre camp, auquel les médias sont hostiles, est alors représenté par un chômeur alcoolique.
• j. On estime que chaque camp a une part égale en responsabilité. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, les Palestiniens lancent des pierres, les Israéliens ripostent avec des chars. Le conflit est jugé insoluble : les deux camps sont de “mauvaise volonté”. Ainsi le conflit perdure au bénéfice du plus fort.
• k. On présente l’information en ne disant que la moitié d’un fait. Exemple pris pendant la crise du Kosovo : “Les Serbes ont utilisé des gaz”. Sous-entendu : des “gaz de combat” ou des “chambres à gaz”. En réalité, la police serbe avait dispersé une manifestation avec des gaz lacrymogènes.
◘ 6. Comment réagir face à la désinformation ?
• 1. Il faut d’abord rester modeste et ne pas prétendre simplifier à outrance des réalités complexes. L’homme libre, l’esprit autonome, pose un jugement historique (généalogique, archéologique), profond, sur les réalités politiques du monde.
• 2. Il faut, dans tous les cas de figure, rester méfiant. Il faut systématiquement recouper les informations, s’interroger sur la plausibilité d’une information médiatique, se méfier des répétitions et des appels systématiques à l’émotion.
• 3. Il faut s’informer soi-même, lire des ouvrages élaborés sur les peuples, les régions, les régimes, les situations incriminées dans les grands médias. Une culture personnelle solide permet de repérer immédiatement les simplifications journalistiques et médiatiques.
• 4. Il faut lire des ouvrages et des journaux ouvertement idéologiques, non conformistes, qualifiés de “marginaux”, car ils expriment des vérités autres, mettent en exergue des faits occultés par les grands consortiums médiatiques. Lire ces ouvrages et cette presse doit évidemment se faire de manière intelligente et critique, pour ne pas tomber dans des simplifications différentes et tout aussi insuffisantes.
• 5. Il faut créer et animer des cercles alternatifs d’analyse, afin de ne pas laisser “sous le boisseau” les vérités que l’on a glânées individuellement par de bonnes lectures alternatives.
► Intervention de Philippe Banoy, lors de la Xe Université d’été de Synergies Européennes, Basse-Saxe, août 2002.

pièces-jointes :
Le « montage » de Vladimir Volkoff

La critique n'a pas lu Vladimir Volkoff, ou n'a pas voulu comprendre ses très étonnantes arrière-pensées. Car la conversion au christianisme orthodoxe de Popov, élément de pointe du KGB et héros du «Montage», le dernier roman de ce singulier Russe blanc, n'est-elle pas la marche ultime vers un imperium réalisé par l'Union soviétique, et par elle seule ? Sa formidable puissance militaire, (ci-dessus fusées intercontinentales traversant la Place Rouge), est celle d'un empire et évoque pour Jean Robin « la geste barbare et messianique de l'empire mongol », qui aurait pu, au XIIIe siècle, « instaurer la monarchie universelle ».
Nos contemporains, c'est une banalité de le dire, sont des gens excessivement pressés, traqués, cernés qu'ils sont de tous côtés par le néant d'un monde qu'ils ont façonné à leur image – sorte d'infini en négatif (si cette contradiction métaphysique nous est permise) devant quoi il n'est d'issue (fatale...) que la fuite en avant. Et cette hâte qu'ils mettent en toute chose est, en bonne logique, directement proportionnelle à l'importance qu'ils accordent à leur fonction.
On ne s'étonnera donc pas qu'à de rares et honorables exceptions près, les journalistes – gens suprêmement importants – se soient empressés de ne pas lire Vladimir Volkoff, se contentant, comme on dit, d'en entendre parler. Ce qui explique d'ailleurs que les médiats (nous tenons au « t »...) aient si largement fait écho à son dernier roman, Le montage (1), après que Le retournement (2) eut frôlé le Goncourt, par inadvertance n'en doutons pas. Alors qu'une lecture attentive eût dû les reléguer, le premier surtout, en quelque Sibérie littéraire d'où l'on se fût appliqué à ce qu'ils ne revinssent jamais. Mais la renommée, à ce prix, n'alla justement pas sans quelques malentendus.
De Jean-François Kahn, qui, un matin de belle ardeur antifasciste, mit une telle application à confondre sur les ondes Montage et Retournement que c'en devint suspect, à certain contradicteur véhément d'« Apostrophes » que la charité nous interdit de nommer, nous eûmes le pitoyable et très attendu spectacle d'une intelligentsia « de gauche » qui abdique dès que les choses, de compliquées qu'elles sont au quotidien, deviennent complexes.
Car nous soupçonnons fort Volkoff de quelque peu mépriser l'intelligente sottise et l'agitation mentale qui, leur tenant lieu de pensée, rassurent nos élites, nous le soupçonnons, disons-nous, de faire fi des vaines et triviales complications, mais de cultiver en revanche avec une malicieuse délectation, cette ambiguïté qui accompagne le jeu de tout homme bien né sur la scène du vrai monde, multiforme et, au plan des apparences, contradictoire. Mais de cette contradiction féconde qui n'est ni chaos ni absurdité et dont nul, nonobstant la fascination qu'elle exerce, ne se peut satisfaire, qui, au-delà du voile des susdites apparences, a perçu l'Unité pérenne, l'Ordre immuable dont la fulgurante nostalgie, dés lors, ne le quittera plus.
Ce n'est pas par hasard si Volsky, dans Le retournement, éprouve une sorte de curiosité passionnée à l'égard d'Igor Maksimovitch Popov, son ennemi, son double maléfique, son ombre... ou son frère jumeau. Ne faut-il pas y voir comme un reflet de l'épopée des Devas et des Asuras de la mythologie hindoue qui, après s'être farouchement affrontés sur la scène terrestre, redeviennent Un dans les coulisses de l'Autre Monde. Tout cela n'était que magie d'Indra.
« (...) bien entendu, il n'y avait dans mon cœur aucune haine à l'égard d'aucun Igor Maksimovitch, et pourtant je savais – de science certaine, comme dit Retz – que, les camps ayant été dessinés et les équipes recrutées avant que la partie ne commençât, Popov et moi appartenions à des côtés opposés. (...) Mais si profond que fût cet instinct, ce qui m'intéressait dans Popov, c'était l'adversaire plus que l'ennemi (...) Ce qui m'amenait à réfléchir à ceci : entre le chasseur et le gibier il y a toujours des différences et des affinités ; les différences étaient évidentes mais quelles affinités unissaient le major soviétique Popov et le lieutenant français Volsky ? » Là est la très périlleuse question, qui dépasse les deux protagonistes, ou du moins ce qu'ils croient savoir d'eux-mêmes et des camps auxquels ils appartiennent.
Par-delà les affinités « raciales » – l'un et l'autre slaves, n'est-ce pas – et « professionnelles » – bien sûr – la réponse pourrait bien se trouver en effet dans le Retournement véritable, le seul, l'authentique, qu'en grec on appelle Métanoïa et que l'on désigne plus communément sous le nom de conversion... Car Popov, l'épouvantable criminel, le dur des durs du KGB, ne se convertira pas pour rien ni par hasard au christianisme orthodoxe. Comme disait Péguy : « Ceux qui sont bons pour le péché sont du même royaume que ceux qui sont bons pour la Grâce ». Et le Christ a lancé contre ceux qui ne sont « ni chauds ni froids » un anathème qui résonne encore, fût-ce aux oreilles des hiérarques post-conciliaires.
Redoublons d'audace : ne serait-ce pas, d'une certaine manière, la Troisième Rome des slavophiles qu'emblématise, à l'instant de sa première et dernière communion, Igor Maksimovitch Popov – cette Russie, héritière pour une part de l'Imperium dont, comme toutes les entités géopolitiques en qui s'incarna fugitivement l'archétype, elle trahit abondamment la mission. Corruptio optimi pessima... Nous connaissons tout cela par cœur depuis quelques siècles, nous autres Français de France – cette France qu'on appela la « Fille aînée de l'Église ».
Mais il est dans le Cycle du Graal, un curieux épisode qui devrait nous intéresser : celui du mariage de Sire Gauvain avec l'Épouse Hideuse, qui se change finalement en une belle jeune fille, identifiée dans le conte à la Terre-Mère et à la Souveraineté. Image de notre Imperium corrompu en attente d'une légitimation spirituelle qui, instantanément, en inversera le sens. « C'est quand tout semblera perdu que tout sera sauvé »... Une telle métamorphose se rencontre d'ailleurs dans de nombreuses légendes celtiques, toujours liée, précisément, à la royauté à conquérir. Ainsi dans l'épopée de Lughaid Laighe, celui qui osera dormir avec la Dame Repoussante deviendra roi. Si nous n'interrogeons pas les mythes, si nous renouvelons l'erreur du chevalier qui, au château du Graal, omit de parler, la réalité, à nos yeux, restera opaque. Puisque les faits historiques, nous dit Guénon, « traduisent selon leur mode les réalités supérieures, dont ils ne sont en quelque sorte que l'expression humaine », posons aujourd'hui la question « symbolique » qui fera s'évanouir l'illusion tragique d'une irréconciliable dualité : qui donc, dans le monde actuel, hypostasie l'Épouse Hideuse, et quel est le héros qui, par le « Fier Baiser », lèvera la malédiction ?
N'est-ce pas justement ce Fier Baiser que Volkoff l'Exilé a voulu donner à la ci-devant Russie, sous les espèces de la conversion de Popov – irruption quasi parousique de la transcendance au sein de la matière brute (« Scrupules : néant. Humour : néant », est-il dit du bolchevik). Puisque : « Nous ne saurions pas jouer un rôle, raconter une histoire, qui nous seraient complètement étrangers ». Est-il même nécessaire d'attendre cet heureux dénouement, ne suffit-il pas de le savoir prévu de toute éternité dans les matrices de la Sagesse ? Au risque de perdre son âme par excès de précipitation...
Aussi bien, « quelque part », comme disent nos jargonautes à la mode, Volskoff - ou peut-être bien Volky - ne se serait-il pas senti un peu, un tout petit peu complice de la profession de foi (première manière) de Popov le Monstre. Un « quelque part » qui se situerait bien sûr du côté de ces univers parallèles et crépusculaires, de ces possibles inexploités « où les choses auraient été un peu autres ». C'est qu'il est si pesant d'enfiler chaque jour la défroque du même acteur. Alors un soir, rien qu'un soir, petit père, pourquoi pas ? Et que le Diable nous emporte...
« Le bolchak, c'est la grand-route, et le bolchevik, c'est celui qui a enfilé la grand-route. On nous accuse d'opportunisme : c'est accuser le soleil de briller. Quand on avance, le paysage est bien forcé de changer. C'est pour cela que Lénine est le plus grand génie de tous les temps : parce qu'en réalité il n'y a pas de léninisme. Marx est encapsulé dans le marxisme, Engels dans la dialectique : ils peuvent être dépassés ; Lénine souffle où il veut. Il a écrit État et Révolution, mais il a aussi organisé la terreur, et il a aussi organisé la NEP. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité ».
Axiome (à revoir en fin de partie) qui ne peut pas éveiller quelque écho chez un Volsky-Volkoff qui avoue lui-même : « Adolescent, lorsque je voyais les communistes gagner à tous les coups, sur tous les plans, je me demandais si je ne ferais pas mieux d'aller les rejoindre. D'abord c'est plus amusant de gagner que de perdre, puis je n'ai jamais beaucoup cru aux idées, enfin je pensais qu'il était peut-être de mon devoir de tenir le manche aujourd'hui comme ma famille l'a toujours fait durant quelques générations. »
Puisque aussi bien, comme il le confie « officiellement » cette fois à Jacqueline Bruller (3), Évangile à l'appui : « Il n'est pas le pouvoir qui ne vienne d'en haut ». Donc « d'une certaine manière, le régime soviétique a fondé une légitimité en Russie ». Tiens tiens... De toute façon, « (...) il n'y a que deux sortes de gouvernement, les gouvernements aristocratiques et les gouvernements monarchiques ».
Car pour ce qui est du peuple, son « poids » « fait problème », comme on dit maintenant : « pour moi, le peuple ressemble fâcheusement à une abstraction : ce singulier, à la place du pluriel attendu, me paraît louche ».
Dans ces conditions, comment, répétons-le, ne pas prêter une oreille complaisante aux propos de Popov le « Rougeaud » ?
« Vous pensez que ça m'intéresse vraiment, le bonheur du peuple ? Que j'y crois vraiment, à la noblesse du travail ? Le peuple, je l'ai flairé d'assez près : si vos intellectuels qui se lamentent sur le sort des classes populaires avaient passé autant de journées que moi sur les chantiers, autant de nuits que moi dans les baraquements, ils ne s'attendriraient pas autant. Tout peuple a le sort qu'il mérite ; ce sont les séquelles lacrymogènes du christianisme qui ont mis à la mode les jérémiades populistes. (...) Vous n'avez jamais remarqué qu'il n'y a pas plus sélectif, pas plus élitiste, comme ils disent, c'est-à-dire plus aristocrate que nous ? C'est parce que nous ne sacrifions jamais une chance à une idée. Jules César aussi était bolchevik. »
Et puis, le verbe torrentiel du conseiller d'ambassade Popov charrie quelques pépites qu'un orpailleur comme Volkoff doit bien contempler au fond de son tamis avec un imperceptible sourire...
« Vous n'imaginez pas, j'en suis certain, la puanteur offensante que l'Occident fait monter à nos narines bien mouchées. Vous riez de nous parce que nous manquons de ceci ou de cela. Mais ne sentez-vous pas comme il vaut mieux manquer que vomir ? (...) L'Occident tout entier n'est plus qu'une gigantesque poubelle pleine d'invertis, de pervertis et de convertis. Vous engendrez des enfants par plaisir, vous en faites des criminels par platitude, et quand ils vous violent et vous égorgent, vous n'avez même pas le bon sens de les bousiller. N'avez-vous pas compris cette chose si simple : l'Occident a le cancer... ?
« Oh ! nous allons nous occuper de vous un de ces jours. Nous allons arriver avec notre matériel chirurgical. Malheureusement, il sera trop tard pour le scalpel, il faudra travailler à la scie (...) comment, je vous le demande, pouvez-vous supporter d'avoir sous les yeux vos propres représentants ? (...) Vos gouvernants qui ne savent que se vautrer devant vous pour obtenir vos suffrages et qui, une fois élus par la gauche, gouvernent à droite et vice versa ? (...) Ou vos intellectuels, peut-être ? Ah ! ceux-là, je me demande comment ils ne vous lèvent pas le cœur, ces encensoirs professionnels, ces marie-couche-toi-là de l'intelligence, ces thuriféraires non rétribués que travaille l'envie inavouée de se faire empaler par nous ! Tous vos Russell et tous vos Sartre, à genoux dans la crotte ! (...) Ah ! comme nous sabrerons gaiement à droite et à gauche quand le moment sera venu ! Une collectivité qui n'a plus de goût pour elle-même doit disparaître : c'est scientifique, et c'est, de plus, juste ».
À en troubler le repos éternel d'un Léon Bloy, que nous croyons déjà entendre, du fond de son sépulcre : « Il me semble avoir dit tout cela avant vous, jeune homme ! » Au fait, n'est-ce pas lui qui attendait « les Cosaques et le Saint-Esprit » ?
C'est d'ailleurs là que les choses se corsent un peu car s'il est assuré qu'on ne manquera pas de cosaques, il est moins certain que le Saint-Esprit sera au rendez-vous...
Quoi qu'il en soit, il nous semble bien trouver là de quoi conforter telles idées en vogue, d'origine incertaine il faut l'avouer – hic jacet lepus... – selon lesquelles, derrière son masque effrayant, semblable à ceux des « gardiens du Seuil » tibétains, la Sainte Russie, rendue à sa vocation, serait déjà prête à prendre la tête de quelque croisade contre les turpitudes occidentales. Divine surprise ou gigantesque piège à... nostalgiques ?
Mutatis mutandis, cette attente rappelle curieusement l'espérance qui fit naître en Occident au XIIIe siècle, la geste barbare et messianique de l'Empire mongol, en qui l'on vit l'instrument de la Providence, propre à instaurer la monarchie universelle. Le roi de France était destiné, dans cette saga eschatologique, à unir les États chrétiens d'Occident en une « nation européenne » qui se fût intégrée à la fédération mongole, reproduisant ainsi, à une beaucoup plus vaste échelle, les rapports existant à l'époque carolingienne entre Empire et Royaume (4). Le lien spirituel en eût été ce christianisme nestorien dont Guénon disait qu'il constituait comme une « couverture » de l'Agarttha, le Centre spirituel suprême, et dont l'extrême tolérance à l'égard des autres communautés religieuses rejoignait la conviction du chamane Gengis Khan et de ses successeurs, selon qui il suffisait que tout homme adorât Dieu – l'athéisme seul étant passible de mort – sous la « forme » et selon les rites de son choix.
Comme le dit justement Sophie de Sède : « L'idée d'une unification mondiale sous l'hégémonie tartare a sans doute rencontré plus de sympathies qu'on ne croit, même en Europe. » Et d'ajouter, relativement aux zélateurs et informateurs du Grand Khan : « Ces gens-là n'étaient pas plus des «traîtres» ou des « collaborateurs » que, par ex., les Gibelins en Italie. Ils étaient très probablement animés par la même nostalgie d'unité et de paix universelle. »
D'ailleurs, ce « Salut par les Tartares » n'était pas sans glorieux antécédents. Saint Augustin, sur son lit de mort, ne bénissait-il pas les Barbares qui assiégeaient Hippone ?
Tout le problème est de savoir s'il eût béni Popov... Et nonobstant ces alléchantes préfigurations historiques, il ne faudrait pas que l'on nous refît, mine de rien, le coup de 39-45, qui avait si bien réussi. Dans cette hypothèse, « on » pousserait le raffinement, pour piéger les ultimes récalcitrants à la mort douce onusienne et trilatéraliste (en attendant pire), jusqu'à jeter la Russie dans une aventure militaire en Europe, dont, moyennant l'intervention judicieusement différée des Américains, « on » s'arrangerait pour qu'elle sortît vaincue. Mais pas avant d'avoir suscité des collaborateurs exterminables à volonté, au premier rang desquels les imprudents et les naïfs qui eussent été poussés dans les bras de l'envahisseur par le dégoût de la « société d'excrémentation », comme dirait Popov et – éventuellement – par le souvenir des vaticinations quelque peu sulfureuses de ce drôle de paroissien qu'était Léon Bloy.
Et si contrairement à cette hypothèse (Belzébuth n'est avare ni de scénarios ni de « montages ») la Russie triomphait, l'Amérique ayant abandonné sans remords l'Europe à son sort, ceux qui resterait debout au milieu des ruines risqueraient alors de faire l'expérience de la camisole de force, succédant à celle du cabinet capitonné.
À moins que... À moins que Igor Maksimovitch Popov, justement, ne se convertisse, on se tue à nous le dire. Et comment, à en croire Volkoff, qui en rajoute allègrement dans la provocation, un gaillard de sa trempe pourrait-il renier le « pragmatisme absolu » dont il dévoile, au prêtre qui le confesse, les très inattendus prolongements :
« P - Qu'est-ce que le bolchévisme ?
I – La croissance maximum. Quand vous dessinez un avion, vous essayez de créer celui qui ira le plus vite, le plus loin. (...) Puis la technique fait des progrès. Vous en construisez un autre, encore plus rapide, avec un rayon d'action encore plus étendu, et vous vendez l'autre aux pays sous-développés. Les idées, c'est la même chose. J'ai compris qu'on pouvait aller plus loin avec Dieu que sans.
P – Dieu, pour vous, c'est une forme de bolchevisme ?
I – C'est une majoration.
P – Vous voulez dire que cette crois tracée sur le monde, c'est le signe + ?
I – Il y a là en effet une coïncidence intéressante. (...) Dieu s'est imposé à moi avec toute la force de l'évidence. Si vous pensez qu'un léniniste est mal équipé pour reconnaître une évidence pareille, vous faites erreur : nous sommes pragmatiques, nous saisissons par les cheveux toutes les évidences qui passent à portée. (...) D'ailleurs la dialectique... nous savons mieux que personne que l'extrême est et l'extrême ouest, c'est la même chose, et qu'à condition de pousser la chaudière, on arrive à des transformations imprévisibles. »
Il faut bien convenir que tout cela, dans sa candide simplesse, vous a un petit côté tonique et roboratif, et de toute façon une autre allure que les tristes épousailles des chrétiens progressistes en rupture de dogme, et des marxistes déguisés en Machiavels de sous-préfecture, soucieux de cautions bourgeoises.
Mais à la fin des fins, et en dépit de tous les possibles « incarnements », comme dirait Céline, il n'est encore question que d'un Popov – pardon, que de Popov... Et qu'en est-il donc, Igor Maksimovitch, de la Sainte Russie ? Le « seul pays où une révolution chrétienne soit imaginable », dis-tu ? Peut-être bien, mais en ces temps d'incertitude et de désinformation tous azimuts, nous n'avons pour viatique qu'une prophétie gaullienne (5) : « Car enfin, l'Europe, la vraie, la grande, va de l'Atlantique à l'Oural et de la Méditerranée aux mers glaciales de l'Arctique... et rien encore ne dit que ce ne sera point cette grande Europe-là dont la réalisation s'imposera un jour... lorsqu'une certaine solidarité européenne sera née d'événements que l'on ne peut guère prévoir ; mais dont on sens bien qu'ils sont déjà dans les desseins de la Providence... » Et certes, quand le Général évoquait la Providence, c'était, croyons-nous savoir, non sans quelque excellent raison... dont contempteurs et « héritiers » frauduleux sont apparemment fort loin de se douter.
Vladimir Volkoff en appellait implicitement à une renaissance européenne, possible alors que lorsque les slaves se seraient débarassés du carcan communiste et nous-mêmes de la civilisation marchande. À l'Ouest comme à l'Est, la même religion monothéiste, issue du même biblisme messianique, inspire l'idéologie d'État. Volkoff a compris la semblable nature de cette double empreinte totalitaire qui marque l'Occident américain et le communisme, ces frères ennemis issus d'un même cousinage. L'Europe nouvelle devait pour lui comprendre le peuple russe dont la formidable réserve de spiritualité n'est pas nécessairement chrétienne. Le rêve de l'Empire hante de nouveau nos consciences, et Volkoff l'Exilé le réveille. Ni à l'Est, ni à l'Ouest, mais au centre du monde, sur ce vieux sol d'Europe où renaîtront les dieux transfigurés : boiront-ils le vin de la victoire dans le Calice d'Ardagh, coupe du Graal d'après les mythes celtes ?
Quoi qu'il en soit, et pour ce qui concerne Volkoff, il fallut attendre Le montage pour en savoir plus, et pour nous étonner, encore une rois, de la façon dont les critiques le lurent ! Mais c'est vrai, ils ne le lurent justement pas... Et pourtant, l'avertissement était engageant : « On ne me croirait pas si j'affirmais que Le montage n'est que le fruit de mon imagination. Puissent donc les camarades de tous les bords qui m'ont aidé de leur compétence trouver ici l'expression de ma gratitude. »
Il n'en voulut point dire davantage (et on le comprend) même lorsqu'il fut pressé par Bernard Pivot lors d'« Apostrophes », en septembre dernier. Ces propos – et silences – liminaires n'en rendent que plus intéressante l'histoire du « Directorat A », sorte de cercle intérieur du KGB dont les membres, surnommés « chapeaux-cachettes » (6), ont une Table de la Loi très spéciale, révélée il y a 2500 ans par le Chinois Sun Tzu (qui est authentiquement le plus grand stratège de son pays), et qui édicte treize commandements destinés à « prendre intact tout ce qui est sous le ciel ». (« Discrédite le bien », « ridiculise les traditions », « répands la luxure », etc.) Toutefois, ce cynisme pragmatique s'accompagne curieusement d'une justification que ne mentionne pas Volkoff et qu'il importe pourtant de connaître.
Si, « avant même que je n'ensanglante ma lame, l'ennemi s'est rendu » – citation favorite d'une « tête » du « Directorat A », Abdoulrakhmanov – Sun Tzu ajoute : « Il n'est qu'une façon de l'emporter définitivement sur son ennemi, c'est d'en obtenir la soumission volontairement acceptée. Cela n'est possible que si l'on est soi-même une cause juste absolument, qui, seule, permet de s'engager sur la Voie Royale de la loi morale pour établir et maintenir une nation sur la terre. Laissant à d'autres l'autre voie, qui toujours dégénère en voie de brigandage et de voleurs de grands chemins ». Comment ne pas évoquer ici l'exhortation de De Gaulle à emprunter « l'unique voie de la seule grandeur possible au service de tous les hommes » (7) ?
Pour l'heure, ces « chapeaux-cachettes », maîtres ès-désinformation et experts dans l'art d'intoxiquer les « élites » occidentales, mijotent la politique de l'URSS, « donc l'avenir du monde », selon que nous l'assure Mohammed Mohammedovitch Abdoulrakhmanov.
Il n'y aurait rien là que de relativement banal si, au-delà des techniques de pointe vieilles de 2500 ans mises en œuvre par le maître espion, ne se profilait l'ombre d'une idéologie nettement distincte, pour dire le moins, du marxisme-léninisme officiel, déjà relativisé quelque peu par Popov, on s'en souvient. Idéologie dont la chambre mortuaire d'Abdoulrakhmanov, ornée d'une icône (bien qu'il fût d'origine musulmane) soulignera l'influence sous-jacente. D'ailleurs, selon notre « héros », dont les propos revêtent nécessairement une valeur testamentaire, « il n'y a qu'une religion ». Cet universalisme gengiskhanide... ou guénonien, ne manquera pas de susciter quelque perplexité – si tant est que l'on n'ait pas renoncé à s'étonner – surtout si l'on sait que ce haut responsable du KGB se vante de surcroît d'avoir « bien botté le train au Chitane » (au Diable, le Shaytan) ; et souvent, ajoute-t-il, « je l'ai fait travailler pour moi ».
Où tout cela va-t-il donc nous mener ? « Au point technique où nous sommes arrivés... toutes les images procèdent de nous (...) Nous avons planifié le XXIe siècle, mon fils. Tout s'enclenche, tout se commande. Même sans nous, ils ne pourront que suivre nos signes de piste (...) » Mais encore une fois, où aboutit la piste ? À Dieu ou au Diable ?
Perplexité, avons-nous dit ? Ô combien. Et d'abord, relativement à la nécessité qui a poussé Volkoff – Volkoff le manichéen (!!), l'antisoviétique primaire (!!) – à scier aussi délibérément la branche sur laquelle... on a voulu l'asseoir, à semer le doute dans l'esprit de lecteurs qu'il était censé bombarder de certitudes « fascinantes » autant que monolithiques. Quel besoin avait-il donc, au cas que son propos eût été celui qu'on lui prête, et seulement celui-là, de nous rendre si sympathique qui n'est donc pas à convertir, lui, et qui croit au diable par-dessus le marché !
Pas plus que celui de Léon Bloy, le « Céline catholique » (ci-dessus), le christianisme de Volkoff n'est biblique et évangélique. Il a d'étranges accents païens. Le véritable christianisme, mièvre et racoleur, s'exprimerait plutôt dans les images bibliques iréniques. Le véritable christianisme, c'est-à-dire l'idéologie biblique et le moralisme humanitaire, trouve son accomplissement et réalise son essence dans l'athéisme occidental, dont les civilisations soviétiques et marchandes sont l'expression matérielle, et l'intelligentsia progressiste le Verbe incarné. De deux représentants de cette dernière, Sartre et Russell, Volkoff trouva cette très pertinente définition : « encensoirs professionnels ». Sous son obscurité volontaire, tout autre est le message de Volkoff : préparons le retour du divin.
Était-ce pour Volkoff l'aboutissement littéraire logique – et sans justification autre que la nostalgie métaphysique et les droits imprescriptibles du romancier – de cette fascination évoquée dans Le retournement, face à Popov l'Adversaire, et dès lors élargie à l'Empire des Soviets tout entier ? « Je est un autre », a dit Rimbaud. Et Volkoff, dans sa songerie : « Ayant été pleinement ce que je suis, je veux devenir pleinement le contraire. Quelle émotion ce doit être pour un facteur algébrique quand on le change de signe ! C'est cela que je veux éprouver. » Privilège insigne de celui qui a laissé le masque pour la plume, que de jouer les agents doubles par procuration. Au premier degré : tentation luciférienne du dédoublement, de la multiplication de l'ego, mais aussi, avons-nous dit, insatisfaction légitime de se sentir prisonnier d'un rôle de composition ; et surtout, plus ou moins consciemment, aspiration à transcender la dualité, à dépasser (non plus quantitativement mais qualitativement) les limites du « moi » pour s'identifier au soi, havre ultime, quoique différemment nommé, de toutes les navigations métaphysiques. Dans l'Éternel Présent, ou dans l'imagination de l'écrivain-démiurge, la possibilité-Volsky et la possibilité-Popov vivent en effet cette « distinction sans séparation » (bhêdâbhêdâ disent les Hindous), qui préserve l'Unité tout en autorisant la multiplicité chatoyante des existences individuelles.
Ci-dessus : l'encensoir professionnel, Jean-Paul Sartre, juché sur un tonneau, harangue les journalistes devant les usines Renault en 1970. Plus que la sénilité d'un homme, celle de toute une idéologie. Sartre et ses fantasmes ouvriers hantent toujours les rêveries des « petits profs » socialistes. Mais Volkoff s'amuse de leur mauvaise conscience : Popov a fait virer la mystique prolétarienne au fascisme rouge. Au delà de l'humanitarisme délétère des intellectuels occidentaux, Volkoff débusque en fait le vieux projet universaliste : unifier rationellement la planète et construire un type d'homme homogène, qu'il soit communiste, américain ou social-larmoyant. Le KGB, comme les autres, conspire à ce dessein. Mais ce qu'il ne sait peut-être pas, et que Volkoff décèle, c'est que sous l'ironie de l'histoire, le KGB, derrière tous ses « montages », prépare à son insu le retour des démiurges. L'avenir n'appartient ni à l'Ouest, ni à l'Est. Il appartient aux dieux muets et à venir dont Volkoff, innocemment, dessine les premières ombres.
Ayant réalisé cela, Volsky l'Exilé pourra annoncer sans trahir : « Je suis venu » ; et Popov pourra répondre sans condescendance : « J'ai toujours su que vous viendriez ». Mais le dialogue, alors, se déroulera bien loin de la rue Barbet-de-Jouy puisque l'un et l'autre auront gagné leur vraie patrie, laissant Volkoff savourer la très pythagoricienne plénitude qu'engendre la conciliation des contraires.
À la réflexion, « ils » ont bien fait de ne pas le lire. Ces vertigineux à-pic, ces abysses traversés de lueurs étranges eussent ajouté à leur angoisse pathologique. Pour le reste, il va sans dire qu'on ne saurait établir le moindre rapprochement entre nos digressions et les intentions et opinions véritables de Vladimir Volkoff. Le romancier, après avoir donné vie à ses personnages, ne saurait être légalement tenu pour responsable s'ils lui échappent, et dès lors se mettent à vivre leur vie, ou celle que leur inventent des lecteurs imaginatifs. Et, bien sûr – on ne le répétera jamais assez pour la tranquillité des familles – il n'était question dans tout cela que de romans...
► Jean ROBIN, éléments n°47, 1983.
Notes :
(1) Éd.. Julliard / L'Âge d'Homme.
(2) Éd.. Julliard / L'Âge d'Homme.
(3) L'Exil est ma patrie, entretiens, Le Centurion.
(4) Voir à ce sujet, de Sophie de Sède, la Sainte Chapelle et la politique de la fin des temps, Julliard.
(5) In RP Martin, Le Livre des compagnons secrets, ACL / Rocher.
(6) Référence à ces couvre-chefs des contes russes qui confèrent l'invisibilité à ceux qui les portent.
(7) Cf. RP Martin, op. cit.

HOMMAGES
"Il ne semble pas que le monde ait jamais connu un politiquement correct aussi omniprésent, aussi insidieux, aussi triomphant que le nôtre", se plaisait à dire Vladimir Volkoff [cf. Manuel du politiquement correct] pour qui le communisme était une "épidémie mentale". Alors qu'il avait plusieurs fois tenté en vain de rentrer à l'Académie française, il disait : "Je me reconnais comme russe et comme français, j'aime me servir de la langue française alors que je peux écrire en russe ou en anglais". Selon Pierre-Guillaume de Roux, le directeur littéraire des éditions du Rocher-Privat, "il a construit une œuvre importante qui nous a tous marqués avec le Retournement, un livre très neuf, où il mêlait théologie et espionnage. La théologie est toujours au cœur de la problématique de ses livres."
◘ Itinéraire de l'écrivain
 Vladimir Volkoff est mort chez lui de façon soudaine le 14 septembre 2005 [à son domicile de Bourdeilles, dans le Périgord.]. Fils de Russes blancs contraints de fuir leur pays après la révolution de 1917, il était né à Paris le 7 novembre 1932. Arrière-petit-neveu du compositeur Tchaïkovski, il était le descendant d'une longue lignée d'officiers du tsar évoqués dans La Garde des ombres (Éd. de Fallois/L'Âge d'Homme, 2001), livre qui révèle aussi l'extrême précarité de son enfance et le courage de ses parents qui l'ont élevé dans le souvenir de la patrie perdue et la loyauté à l'égard du pays d'accueil, devenu sa patrie d'élection.
Vladimir Volkoff est mort chez lui de façon soudaine le 14 septembre 2005 [à son domicile de Bourdeilles, dans le Périgord.]. Fils de Russes blancs contraints de fuir leur pays après la révolution de 1917, il était né à Paris le 7 novembre 1932. Arrière-petit-neveu du compositeur Tchaïkovski, il était le descendant d'une longue lignée d'officiers du tsar évoqués dans La Garde des ombres (Éd. de Fallois/L'Âge d'Homme, 2001), livre qui révèle aussi l'extrême précarité de son enfance et le courage de ses parents qui l'ont élevé dans le souvenir de la patrie perdue et la loyauté à l'égard du pays d'accueil, devenu sa patrie d'élection.
Après une licence de lettres classiques à la Sorbonne, il travaille comme enseignant (1955-1957) puis s'engage dans l'armée pendant la guerre d'Algérie (1957-1962). Son premier roman, L'Agent triple (1962), évoque cette expérience décisive. De 1966 à 1976, il séjourne aux États-Unis et enseigne la littérature française et russe à l'université d'Atlanta, tout en écrivant sous le pseudonyme de Lieutenant X un grand nombre de romans d'espionnage pour adolescents, la série des Langelot (Bibliothèque verte et récemment rééditée par les éditions du Triomphe).
Peu après son retour en France, l'éclatant succès du Retournement (Julliard/L'Âge d'Homme, 1979) lui vaut une renommée internationale confirmée par Le Montage (1982), Grand Prix du roman de l'Académie française. Entre-temps, il a publié Les Humeurs de la mer, fresque ambitieuse en 4 volumes qui montre une filiation voulue avec Lawrence Durrel auquel il consacre un essai (Lawrence le magnifique).
Viendront ensuite Le Trêtre, Le Professeur d'histoire, Nouvelles américaines, L'Interrogatoire, Petite Histoire de la désinformation (Le Rocher, 1999) et un grand nombre de romans inspirés par l'histoire russe, celle de la Serbie et le monde des services secrets, parmi lesquels Le Berkeley à cinq heures (1993), La Crevasse (1996), L'Enlèvement (Le Rocher, 2000), Le Contrat (2000), Le Complot (2003), L'Hôte du pape (2004), Les Orphelins du tsar (2005), etc. Le Rocher prépare la publication en 2006 d'un nouveau roman, Le Tortionnaire, âpre récit ayant pour cadre la guerre d'Algérie. Florence de Baudus a consacré à l'imaginaire de l'écrivain une étude littéraire, Le Monde de Vladimir Volkoff (Le Rocher, 2003).
• Recommandons les Dossiers H consacré à Volkoff (L'Âge d'Homme, 2006).
• Le commandant Bunel, qui fut naguère traîné devant les tribunaux pour avoir voulu sauver des vies serbes, salue la mémoire d'un camarade de combat : Au revoir, Vladimir
Adieu l'ami !
Dès l'enfance, Vladimir Volkoff avait été jeté dans le cours tragique de l'histoire. Son talent en avait été embrasé. Évocation.
 La mort d'un ami est toujours cruelle, surtout quand cet ami avait encore tant à donner. Pourtant, je ne me rebelle pas devant la mort. Elle fait partie de la vie. Comme la feuille se détache de l'arbre, nous quitterons tous l'existence, avec l'espoir seulement d'avoir été fidèles et d'avoir transmis l'héritage. Fidèle transmetteur, Vladimir Volkoff l'a été de façon exemplaire.
La mort d'un ami est toujours cruelle, surtout quand cet ami avait encore tant à donner. Pourtant, je ne me rebelle pas devant la mort. Elle fait partie de la vie. Comme la feuille se détache de l'arbre, nous quitterons tous l'existence, avec l'espoir seulement d'avoir été fidèles et d'avoir transmis l'héritage. Fidèle transmetteur, Vladimir Volkoff l'a été de façon exemplaire.
Nous nous étions connus tardivement. Il m'avait précédé de loin en notoriété avec le retentissement du Retournement, immense succès de l'année 1979, tant en France qu'à l'étranger où ce roman fut traduit par les plus célèbres éditeurs. Ce livre l'a placé d'emblée à l'égal des plus grands, Graham Greene ou John Le Carré, mais avec une musique bien à lui. Succès cependant tardif, comme il l'a rappelé lui-même dans un retour sur le passé distillé avec parcimonie : « Depuis l'âge de sept ans, j'écrivais; depuis que j'en avais dix-huit, j'envoyais à des éditeurs des manuscrits régulièrement refusés; passé trente-deux, j'avais publié quelques romans assez peu lus. Or, j'en avais quarante-huit, et voilà que, avec Le Retournement, j'étais fêté, jalousé, traduit, honoré, insulté, ce qui est toujours flatteur... »
Dans la journée qui a suivi l'annonce de la mort de Vladimir, j'ai interrompu mon travail pour me consacrer à lui. De ma bibliothèque, j'ai extrait les livres qu'il m'avait dédicacés au fil du temps et je les ai disposés devant moi, un verre de whisky comme il les aimait à portée de main, à côté d'une dague virile, pour célébrer notre goût commun des armes, de la guerre et de la chasse. Ayant ainsi sacrifié aux rites, je me suis immergé avec volupté dans une relecture à la billebaude, en commmençant par Le Retournement. J'avais conservé le souvenir piquant du héros principal, le petit lieutenant « rempilé » dans les « services », Kiril Volsky, double de Vladimir, « moustache foireux tourné gens-de-lettres ». Regard pétillant et langue alerte, toujours tiré à quatre épingles, sarcastique, malicieux, attentif aux dames et à l'étiquette, rarement pris au dépourvu, Volsky cultivait l'insolence à l'égard des larbins étoilés, le mépris amusé des cousins barbares d'outre-Atlantique et une indéracinable nostalgie pour la Sainte Russie de ses ancêtres. Il campait un type bien français d'agent secret, version pied-nickelé, damant le pion aux énormes machines de la concurrence ou de l'ennemi.
Si on me forçait à tout avouer, je dirais cependant que, parmi tous les livres de Volkoff, mon préféré est Le Berkeley à cinq heures (Le Livre de Poche), relu au minimum deux fois l'an, quintessence de son imaginaire romanesque, libre de toute théologie. Mais Le Retournement est incontestablement son chef-d'œuvre avec La Leçon d'anatomie, deuxième volume de la tétralogie méconnue des Humeurs de la mer, écrite sous la lumière crue de la guerre d'Algérie, dans une forme savante, en hommage à Lawrence Durell, l'un des maîtres de Vladimir en littérature avec Dostoïevski. Pas plus que les autres œuvres de Volkoff, Le Retournement n'est un « roman d'espionnage ». C'est un roman qui utilise l'intrigue à rebondissement d'une affaire d'espionnage comme prétexte romanesque pour divertir le lecteur et se livrer à moult méditations sur des personnages dont la vérité est révélée par des situations tour à tour cocasses ou tragiques. Selon la théorie volkovienne qui peut être retournée : « Un maître-espion réussi est un écrivain rentré. »
Dès que l'on entre dans Le Retournement, on hume d'abord l'intense jubilation de Volkoff qui prend tout son temps pour embobiner le lecteur en virtuose de fascinantes digressions et de descriptions truculentes ou profondes : « je traversais la Seine en savourant l'inimitable présence de ce fleuve domestiqué depuis si longtemps qu'on pense à lui comme à une personne. » Oui, se déploie dans ce roman l'élégance vive et souple du style, un don magique d'évocations infinies, mêlées de réflexions philosophiques, tout cela mis en scène avec une incroyable richesse d'imagination, une admirable précision des mots, un art époustouflant de l'intrigue où les rebondissements imprévus s'emboîtent sans fin comme des poupées russes.
Dans un monde littéraire frappé d'asthénie, Volkoff a fait beaucoup de jaloux. Le maigre pipeau de la plupart de ses contemporains sonne tristement en comparaison de ses orchestres symphoniques. Comme tous les grands de sa génération, Déon ou Raspail, sa sensibilité avait été nourrie par la guerre et les tragédies du siècle dont l'expérience fait cruellement défaut aux fils de la consommation et du nihilisme tiède.
Une dédicace accompagnée d'un croquis représentant deux épées croisées figure sur mon exemplaire du Retournement. Elle témoigne de notre première rencontre. Lui m'a vraiment découvert par la lecture du Cœur rebelle (1994) qui lui montra que nous étions frères d'armes. Par la suite, il manifesta toujours à mes livres un soutien généreux. Un jour, au micro d'Anne Brassié, évoquant mon Dictionnaire amoureux de la chasse, il eut ce mot prouvant la subtilité de sa perception : « On voit bien que pour Venner le Grand Pan n'est pas mort... » Nous avions en commun de fortes complicités et une estime réciproque. D'avoir crapahuté jadis sur les même pistes sans fin y était pour quelque chose, d'autant que nous avions tiré de cette aventure les mêmes colères et les mêmes aversions. Nous nous réjouissions aussi de la chance qui nous avait été donnée de vivre la guerre – une petite guerre – à vingt ans.
Nous différions cependant sur des sujets qui n'ont pas altéré notre amitié. Il était magnifiquement réactionnaire au sens le plus noble, alors que je me projetais dans l'avenir en m'appuyant sur le passé. Il n'attendait plus rien du monde actuel, se réfugiant dans l'espérance transcendantale d'un autre monde, s'étonnant de ce qu'il appelait mon optimisme. Cela tenait à nos deux Weltanschauung, comme il disait, bien distinctes. Pour faire bref, il croyait au mal et moi à la beauté. Il se plaçait dans le prolongement d'une histoire relativement courte, marquée par la forme intangible de l'orthodoxie et de la monarchie russe, dont il voyait la source dans la conversion de saint Vladimir. Je me situe dans une histoire beaucoup plus longue, celle de la tradition européenne qui a trouvé dans les poèmes d'Homère ses livres sacrés. À mes yeux, ce que nous vivons est à peu près aussi noir que l'imaginait Volkoff, à cette différence près que je crois à l'éternel retour. Au long des millénaires, nous, « vieux Européens », avons déjà connu tellement d'autres périodes sinistres où tout semblait s'abolir ! Mais toujours sont venues des renaissances, surgies de la rivière souterraine de nos permanences. Celles-ci continuent de courir secrètement, ruisselet aujourd'hui, torrent invincible demain. Et peu importe de ne pas vivre soi-même le futur réveil. L'essentiel est d'y croire et d'y travailler.
► Dominique Venner, Nouvelle Revue d'Histoire n°21, nov. 2005, p. 33-34.
◘ Vladimir Volkoff, de la stratégie à la démonologie
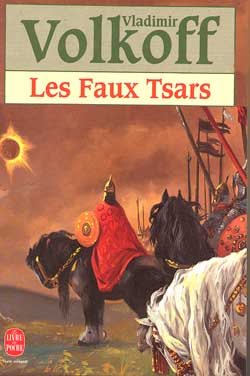 Emporté subitement dans la nuit du 13 au 14 septembre 2005, Vladimir Volkoff était l'un des grands témoins littéraires du XXe siècle. L'écrivain Volkoff s'était essayé dans nombre de genres : des romans pour la jeunesse à la science-fiction, du traité de versification aux essais métaphysiques, de la biographie au pamphlet et du théâtre au scénario de BD. Cependant, c'est pour son rôle de vulgarisateur de la guerre secrète qu'il semble devoir passer à la postérité.
Emporté subitement dans la nuit du 13 au 14 septembre 2005, Vladimir Volkoff était l'un des grands témoins littéraires du XXe siècle. L'écrivain Volkoff s'était essayé dans nombre de genres : des romans pour la jeunesse à la science-fiction, du traité de versification aux essais métaphysiques, de la biographie au pamphlet et du théâtre au scénario de BD. Cependant, c'est pour son rôle de vulgarisateur de la guerre secrète qu'il semble devoir passer à la postérité.
Gloire équivoque : cette spécialité en forme d'oxymoron restreint la portée de son œuvre tout en la fixant dans les esprits. Certes, on « réhabilite » périodiquement les Ian Fleming, les John Buchan et les Pierre Nord, mais de là à les faire entrer de plain-pied dans l'histoire littéraire... Qu'en sera-t-il de Vladimir Volkoff ?
Sa prose « de combat » est continuellement sous-tendue par un projet de démonstration, du reste plus spirituelle que philosophique. Il est bien des écrivains à thèse – surtout de gauche – finalement admis dans la famille des écrivains tout court, mais les thèses de Volkoff vont à rebours du « sens de l'histoire », et elles y vont bille en tête. On pourrait bien plus précisément induire les convictions de l'auteur à partir des romans de Volkoff que de ceux, par exemple, de son maître Graham Greene.
L'œuvre est marquée dans son ensemble par la clarté thématique et psychologique du roman pour la jeunesse dans lequel il avait fait ses premières armes. Volkoff n'est pas un romancier des sourdes macérations. Les mille diaprures du mûrissement intérieur, chez ses personnages, se ramènent en quelque sorte aux sept couleurs de base. L'intervention de l'irrationnel elle-même est amenée d'une manière on ne peut plus rationnelle. C'est, au grand dam des maniéristes, ce qui rend la lecture de Volkoff si exaltante. Rien de plus jubilatoire, dans ses romans, que de voir des situations entortillées se résoudre sur des chutes nettes et sonnantes comme une épigramme.
À ces recettes de simplicité qui le disqualifient d'emblée auprès des « fins lettrés », Volkoff avait ajouté une œuvre de penseur politique qui, d'une certaine façon, fait doublon avec l'œuvre romanesque. Ses célèbres romans sur la guerre froide, Volkoff les a accompagnés d'une théorie et d'une typologie de la désinformation qu'il avait mises au jour en fonction des événements ultérieurs, notamment de la crise yougoslave où il avait vu un « cas d'école » illustrant ses thèses, en conséquence de quoi il avait très courageusement pris le parti du bouc émissaire, les Serbes. Cependant, tant par leur parti pris systématisant et docte, que par les schémas assez rigides que l'auteur avait voulu plaquer sur le phénomène étudié, ces écrits restent inférieurs aux œuvres qui les illustrent.
Comme cela arrive souvent lorsqu'on a affaire à un véritable écrivain, le romancier Volkoff fut plus sagace et plus subtil que le théoricien. Par-delà les thèmes et les époques, des Hommes du Tsar au Bouclage, c'est du salut de l'être humain que traitent ses récits. Non d'un salut collectif, mais du salut de chaque personnage comme être unique créé à la ressemblance de Dieu, et qui doit retrouver cette ressemblance sous le masque grimaçant dont la société et le pouvoir l'ont recouvert.
Romancier sotériologique, Volkoff fait intervenir la grâce jusque dans l'univers singulièrement glacial et déterministe de la guerre secrète. Une grâce qui, conformément à l'enseignement orthodoxe, n'est pas le produit des œuvres, mais qui - rançon d'une éducation et d'une culture occidentales - finit tout de même par y conduire. Toute variation spirituelle se traduit, dans ses romans, par quelque inflexion du fil des événements. La trame du récit se présente, de ce fait, comme le baromètre de l'inspiration de ses personnages. Pour rejoindre sa vocation divine, il faut sortir du déterminisme, or tout déraillement hors de cette ornière est le début d'une aventure que seul le romancier, non le théoricien, peut restituer. Quoi de plus palpitant à lire que le récit d'un miracle ?
Ainsi, du temps des troubles à la guerre civile larvée des mégalopoles occidentales, les choix de l'individu restent fondamentalement les mêmes. À ceci près que le XXe siècle a opéré une formidable confusion de valeurs, déguisant le Mal sous toutes les apparences de l'acceptable, du nécessaire et du bon. Ce mensonge constitue le noyau même de la grande idéologie du siècle, le communisme. D'où l'irruption cruciale de la désinformation, traitée comme un banal, quoique redoutable, outil de pouvoir par le Volkoff théoricien, et comme une véritable démonologie par le Volkoff romancier.
C'est bien après la fin de la Guerre froide que Volkoff a écrit la pièce maîtresse de sa réflexion sur le pouvoir du mensonge. Dans cette cathédrale romanesque qu'est Le bouclage, Volkoff à la fois donne libre cours à toute sa virtuosité de conteur et de portraitiste doté d'une remarquable faculté de captation des ambiances urbaines, et répond à des questions auxquelles ses essais théoriques ne pourraient répondre. (Il est remarquable que ce roman de premier ordre, ne serait-ce que par le thème et l'envergure, n'ait pas été mentionné dans la nécrologie que Le Monde lui a consacrée...)
Rappelons l'intrigue en quelques mots : suite à un traumatisme personnel, le gouverneur de l'Agglomération, une ville ouest-européenne qui ressemble fort à Barcelone, décide, malgré son confort de bonne famille et sa sensibilité gauchiste, de prendre le taureau par les cornes et d'éradiquer par n'importe quels moyens la pègre qui empoissonne sa vieille ville. Avec un réseau choisi d'alliés, il optera pour le bouclage militaire de la zone gangrenée, avec filtrage et liquidation des têtes du crime.
Malgré son but éminemment noble, et salutaire d'un point de vue anthropologique, ce « putsch » va heurter de front tous les tabous (c'est-à-dire les mensonges et auto-illusions) d'une société démocratique et conduira bien entendu à la perte tous ses protagonistes. La moralité est transparente : les méchants sont mieux protégés que les bons en démocratie, et toute rébellion en faveur de l'ordre naturel et contre l'illusion idéologique sera étouffée par des pions qui, par ailleurs, ne pensent peut-être même pas autrement que vous... Cette étude prodigieusement pénétrante du système d'inhibition morale des individus par le système médiatique est comme un condensé des réflexions anthologiques rassemblées par Volkoff dans sa Désinformation arme de guerre. Mais elle repose sur un postulat métaphysique que ni les auteurs de l'anthologie, ni leur collecteur, n'ont osé formuler : le mensonge gratuit, le mal pour le mal.
Dans la perspective de l'anthologie comme des écrits ultérieurs de Volkoff, la désinformation, quelque pernicieuse qu'elle soit, est toujours un outil au service d'une volonté précise : c'est une arme de guerre. On peut débattre, cela posé, des finalités et justifications de la guerre elle-même, mais l'outil, en quelque sorte, reste hors de cause.
Allez ensuite repérer, dans Le bouclage, les protagonistes, les commanditaires et les buts de cette guerre dont la subversion serait l'outil. Impossible ! La guerre d'influence à fronts délimités de Sun Tzu, de Tchakhotine ou de Forsyth est ici devenue une guerre sans fronts, une guerre à fronts sublimés, plutôt, passant à l'intérieur même des individus. Celui qui dénonce le mensonge social de l'Agglomération n'attaque plus une tentative ponctuelle de subversion : il s'attaque au ciment même d'un ordre établi... Ordre paradoxal et suicidaire, mais ordre quand même.
S'il avait voulu théoriser les intuitions du Bouclage, Volkoff aurait dû remonter a un échelon supérieur des trônes et des dominations, passer de stratégie en théologie. Il ne l'a pas fait, et c'est heureux. Comme Proust, comme Dostoïevski, Volkoff en est arrivé, en un point de son œuvre, à transmettre par le roman une connaissance que la raison mettra des décennies à formuler, si jamais elle y parvient.
On pourra objecter à Vladimir Volkoff une œuvre de qualité inégale, des romans parfois hâtifs et des essais parfois pontifiants. Mais le public continuera de le lire, pour la virtuosité de sa plume, l'allégresse de son espérance orthodoxe, l'amplitude de ses visions historiques exprimées dans quelques chefs-d'œuvre comme Les humeurs de la mer. Alliées au panache du personnage, ces qualités façonneront, à n'en pas douter, l'une des belles figures littéraires du morne après-guerre français.
► Slobodan Despot, éléments n°119, hiver 2005, p. 26.
◘ Mort d’une sentinelle
 Orthodoxe de foi, slave de race, français d’âme et d’esprit, royaliste de conviction, esprit libre et courageux jusqu’à la témérité, aristocrate indifférent aux contingences, officier en Algérie, puis professionnel du renseignement, devenu expert sur la désinformation, écrivain à la fois méticuleux et désinvolte, provocateur, profond et pénétrant, auteur de L'Agent triple, Le Retournement, Le Montage, La Désinformation, arme de guerre, Désinformation, flagrant délit, et, plus récemment de Pourquoi je suis moyennement démocrate et de Pourquoi je serais plutôt aristocrate, Vladimir Volkoff vécut en mousquetaire ferraillant contre les gardes du cardinal qui s’appelaient le conformisme, la pensée unique, l’esprit du temps, la mode, la lâcheté et la bêtise au front de taureau.
Orthodoxe de foi, slave de race, français d’âme et d’esprit, royaliste de conviction, esprit libre et courageux jusqu’à la témérité, aristocrate indifférent aux contingences, officier en Algérie, puis professionnel du renseignement, devenu expert sur la désinformation, écrivain à la fois méticuleux et désinvolte, provocateur, profond et pénétrant, auteur de L'Agent triple, Le Retournement, Le Montage, La Désinformation, arme de guerre, Désinformation, flagrant délit, et, plus récemment de Pourquoi je suis moyennement démocrate et de Pourquoi je serais plutôt aristocrate, Vladimir Volkoff vécut en mousquetaire ferraillant contre les gardes du cardinal qui s’appelaient le conformisme, la pensée unique, l’esprit du temps, la mode, la lâcheté et la bêtise au front de taureau.
Il fut un ami rare, discret mais toujours exigeant et souvent critique.
Il est mort le 14 septembre dans sa maison de Bourdeilles en Périgord, la Providence ayant sans doute considéré que notre famille est assez riche en hautes figures pour pouvoir se priver d’un combattant aussi courageux dans notre Camerone quotidien.
Voilà quelques mois, Le Libre Journal publia l’admirable prière à Jeanne d’Arc que ce chrétien de taille et d’estoc prononça devant la statue de la sainte de la patrie. Mais Volkoff fut aussi un observateur et un chroniqueur de l’intermonde ténébreux ou se déroulent les combats des grands squales : L’éclairage qu’il apportait sur cet univers de mensonge, de trahison, et de corruption qu’est la politique était à la fois original, audacieux et précieux.
Sur la guerre contre la Serbie, cet acte de gangstérisme américahen perpétré avec la complicité des shabbat goyim européens, il livra, dans Désinformation, flagrant délit, cette clef : « , si une Europe fonctionnelle se fait jamais, il y a de fortes chances pour que ce ne soit ni de l'Atlantique à l'Oural, ce qui est absurde, mais de l'Atlantique au Pacifique, ce qui est inscrit dans les données géographiques et mécontenterait sûrement l'oncle Sam. Il n'y a donc rien d'étonnant que l'oncle Sam mette dès maintenant tous les bâtons possibles dans les roues de cette Europe œcuménique-là. »
Dans le même livre, il avait littéralement prophétisé l’horreur irakienne : « Le droit d'ingérence s'exerce au nom des droits de l'homme, et, si l'ingérence se présente généralement comme une protection du plus faible, elle ne peut être pratiquée efficacement que par le plus fort, dont les critères, les mobiles et les méthodes seront toujours sujets à caution. Donner les brebis à garder au loup n'est pas en soi une solution satisfaisante.
Le principe de souveraineté avait l'avantage, même dans les tyrannies les plus horribles, de circonscrire le mal à l'intérieur d'un territoire et d'une nation. Le principe d'ingérence risque de communiquer la contagion au monde entier. »
Enfin, comme Jean Raspail, il restera l’un des très rares écrivains de stature européenne à avoir abordé de front la tragédie de l’immigration invasion et la menace islamique.
Dans L'Enlèvement, il donne la parole à un Arabe musulman, ce qui lui permet d’échapper au carcan de la langue de bois sans avoir à subir le pilori de la pensée unique :
« Je vais te dire moi. Des Arabes, il n'y en a presque plus. Une pauvre vingtaine de millions en Arabie saoudite, et puis divers mélanges en Afrique du Nord, en Jordanie, en Irak, et c'est tout, mon vieux, c'est tout. À la limite, je te dirai que les Arabes, avec leur nationalisme, ne sont pas de bons musulmans. Ils ont fait leur temps. L'islam, c'est l' oumma, c'est la collectivité de tous les croyants, idéalement de tous les hommes. Cela n'a rien à voir avec un peuple arriéré, qui n'a rien fait de grand depuis mille ans. L'islam, c'est l'avenir du monde, et en particulier de l'Europe qui, si elle ne se convertit pas, succombera au génocide culturel pratiqué par les Américains. Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi ? La drogue, l'alcoolisme, l'irrespect de l'âge, le terrorisme des parents copains, la criminalité, les prisons bourrées servant d'universités du Mal, la pornographie, la pédérastie, la pédophilie, ça te plaît, à toi ? C'est tout ce que la civilisation européenne est capable de produire maintenant, et ça s'appelle comment ? Çà s'appelle le matérialisme. Il y avait le matérialisme agressif des communistes qui s'est effondré, le matérialisme lénifiant des Amerloques n'est pas préférable. Vaut-il mieux mourir étranglé ou étouffé ? Pour moi, c'est pareil. Je ne vois vraiment qu'une chance pour l'Europe : c'est de reconnaître la seule vraie religion, et, par là, retrouver son indépendance, sa fonction, son destin. Non, dis-moi, tu n'es pas écœuré par le monde tel qu'il est ? »
Et, plus loin : « Tu sais, l'islam a toujours accepté la présence de ce que nous appelons les dhimmi sur son territoire. Il y a une maison de la foi, il y a une maison de la guerre, mais il y a aussi une maison du compromis.Je ne vais pas te demander de prononcer la Chahada là, d'un seul coup, devant moi, mais je voudrais que tu comprennes que nous respectons aussi les autres religions du Livre, que nous avons la Bible en commun, et que, finalement, nos "valeurs", comme disent les crétins, sont les mêmes. Je voudrais simplement que tu me fasses confiance quand je te dis que 732 est la date la plus noire de l'histoire de France, que, si seulement, Charles Martel avait été battu à Poitiers, la France serait probablement la maîtresse de l'Europe à l'heure qu'il est, qu'elle aurait déjà construit mille mosquées plus belles que Cordoue, que c'est elle, plutôt que l'Italie, qui aurait inventé la Renaissance, et qu'aujourd'hui, grâce à la présence de l'immigration maghrébine, la France est enfin en train de rattraper un retard de treize cents ans.
Tous les musulmans de France sont contre le désordre et contre le PACS ! Crée en France un État musulman et la criminalité y disparaîtra en quelques semaines. Comprends donc qu'aujourd'hui, en France, ce sont les musulmans qui défendent tes "valeurs". J’ai été frappé par ce que me disait un brave toubib français, probablement un peu réactionnaire. Il me disait : "J'en ai marre d'avorter des Françaises et d'accoucher des Maghrébines." Ne te fais pas d'illusions nous avons gagné la seule bataille qui compte, la démographique. »
Que l’on ne s’y trompe pas : ce n’est pas un malade qui a rendu l’âme, c’est un combattant.
Au cœur de la nuit, comme s’il avait entendu un appel, Vladimir Volkoff s’est levé. Il fait quelques pas et il est tombé, là, d’un coup.
Mort debout, frappé en plein front.
Comme une sentinelle.
► Serge de Beketch, Libre Journal de la France Courtoise n°357.
Chaque soir, selon la coutume orthodoxe, Vladimir Volkoff priait tous ses morts. “J’ai le sentiment, confiait-il, de me recruter une sorte de garde priante pour l’autre monde, une garde d’ombres qui m’accueillera sur le seuil du prétoire céleste quand mon tour viendra.” Son tour est venu le 13 septembre, beaucoup trop vite, subitement comme pour “l’hôte du pape”, le métropolite de Leningrad, dans les bras de Jean Paul 1er.
La vie et l’œuvre de Vladimir furent une victoire sur les destins brisés de sa famille. La révolution soviétique avait tout balayé. Son grand-père, ses parents, ses oncles ont tout reconstruit et le génie de la vieille Russie parlait de nouveau par la bouche de l’écrivain. Sa rubrique du Who’s Who annonce crânement : “profession du père, laveur de carreaux”. Son grand-père Diedouchka, marqué par la Première Guerre mondiale, cherchait à lui expliquer ce que la noblesse signifierait pour lui quand il serait grand. Il lui dit : “Pour l’assaut, le premier à sortir de la tranchée ce sera toi.” Devenu grand, Volodia — né en 1932 — mena le combat en Algérie. Une seconde fois, le sort des armes politiques eut raison de son camp. Il devint un témoin et rendit leur honneur aux combattants et toute sa force à la vérité historique.
La guerre devenue idéologique, il fut l’un des premiers à définir et dénoncer la désinformation comme arme massive du bloc communiste. Ce même grand-père, colonel de l’armée du tzar, aimait la France, la grande alliée à laquelle la Russie avait sacrifié sa propre armée en août 1914. Vladimir Volkoff hérita de cet amour et servit la France à son tour. Mais son immense joie fut de retourner sur la terre russe libérée et d’honorer la famille impériale à Saint-Pétersbourg.
Cet ancien agent des services secrets, qui a vu beaucoup de choses dans sa vie (en témoigne son roman Le Retournement), qui a vécu de longues années aux États-Unis, était Moyennement démocrate et Plutôt aristocrate selon les titres de ses deux percutants petits livres, remèdes infaillibles contre la bêtise égalitaire contemporaine.
La mère de Volkoff, sorte d’héroïne de Pasternak, écrivait des dialogues de théâtre. Fou de littérature à son tour et particulièrement de théâtre, l’écrivain avait écrit des pièces, les mettant en scène et les jouant lui-même. Qui a assisté à L’Interrogatoire, ce dialogue entre un officier allemand prisonnier et son geôlier, officier russe, a senti toute la force et la justesse de l’écrivain.
Ses deux plus grands regrets : que les Alliés aient osé remettre aux Soviétiques les prisonniers allemands et russes, sachant que les malheureux seraient exécutés dès leur arrivée, et que le monde dit libre n’ait jamais organisé de procès du communisme. Mais n’oublions pas, derrière le combattant, le poète tendre d’Il y a longtemps mon amour, l’homme pétillant d’humour, insolent du matin au soir pour le plus grand bonheur de ses amis et de ses lecteurs, l’homme riche de mille et un projets sans cesse mis en chantier, et enfin le passionné d’escrime.
Il ne savait ni le jour ni l’heure mais, comme la sentinelle, il était prêt. Pas nous…
► Anne BRASSIÉ, Rivarol.
◘ TOMBEAU POUR VLADIMIR VOLKOFF
« Je souhaite ardemment qu’on prie pour moi après ma mort. »
La Garde des ombres , 2001.
À l’annonce de sa mort, comment ne pas songer à cette citation, tirée de son livre le plus bouleversant, où l’auteur nous confie qu’il prie tous les soirs pour une galerie de personnages hauts en couleur : sa mère (« Il y a la guerre et tu t’appelles Volkoff. Bien sûr que tu es volontaire ! »), tel baroudeur, des amis, beaucoup d’aïeux, dont le grand-père Vladimir Alexandrovitch, responsable des services de renseignements de l’Amiral Koltchak, dernier régent de la Russie impériale. Disparu dans la tourmente révolutionnaire (sans doute fusillé avec son chef), ce général blanc ne laissa rien à son fils, qui connut les rigueurs de l’exil, si ce n’est une légende orale comme dans toutes les familles : la certitude qu’une photographie existait de lui en compagnie de seize officiers blessés et de la Tsarine, dans tel numéro de la revue Ogoniok, 1915. Toute sa vie, le père de Volkoff chercha ce cliché introuvable. En vain. En 1991, quand notre Volkoff, officier français, « retourna » en Russie, sa première démarche fut pour la bibliothèque de Saint-Pétersbourg. La numéro apporté, ouvert avec l’émotion que l’on devine, le petit-fils de l’officier blanc reconnaît un visage : « j’ai sous les yeux le visage du héros dont les gènes sont en moi. » Pour cette seule phrase, Volkoff est cher à mon cœur pour toujours, car tout y est : la fidélité à la patrie perdue, un style aux antipodes de la chiennerie moderne, le style « paladin », bref un modèle pour nous ses cadets, nés trop tard dans un monde trop flasque.
J’ai découvert Volkoff grâce au Retournement (en grec métanoïa), génial roman sur le thème de l’espionnage… et de la conversion religieuse. Puis, j’ai lu une grande partie de l’œuvre de celui que Robert Poulet, sans doute l’un des plus grands critiques littéraires du XXe siècle, décrivait en 1986 comme « « l’écrivain le plus fort et le plus subtilement brimé des lettres contemporaines ». Quelle jubilation à la lecture de son traité Du Roi (« le roi, personnage très mystérieux où le sacré religieux et le sacré politique se recoupent »), défense et illustration de la monarchie en tant que système anagogique, qui élève l’homme ! Comme Volkoff parvient, dans L’Interrogatoire, à cerner l’esprit tordu des puritains américains ! Et Pourquoi je suis moyennement démocrate, quelle charge contre l’imposture qui rabaisse l’homme ! Ne parlons pas du Bouclage, son roman le plus subversif, que la critique, terrorisée, ignora avec docilité.
Son éditeur, Vladimir Dimitrijevic, le décrit finement comme « un bon génie de la cité, un romancier optimiste et bienveillant envers ses personnages, dont aucun n’est assez vil, jusque dans les eaux les plus troubles, pour ne pas être touché par la grâce ». Car chez Volkoff, tout tourne autour du Mal et du Mensonge, dont l’utopie bolchevique fut l’un des grimaçants visages. Dès l’enfance, ce Russe blanc qui soit dit en passant incarna un parfait exemple d’assimilation à la terre d’accueil, put méditer sur l’omniprésence des forces démoniaques, celles-là mêmes qui saccageaient la sainte Russie.
Fervent lecteur de Volkoff, je lui écrivis donc pour lui dire mon admiration, non sans lui cacher tout ce qui nous séparait : il était – je devrais écrire : il est, dans l’éternité – orthodoxe ; je suis l’un de ces Gentils qui brûlent de l’encens aux anciens Dieux. À travers une dizaine de bristols frappés de ses armoiries, un dialogue courtois se noua : « Je demeure chrétien, mais je ne suis pas fermé à l’héritage polythéiste de l’Europe », « le paganisme ne m’étant pas étranger, tout chrétien que je me veux. J’ai aussi pleuré sur la mort de Pan ». Pour terminer ce bref hommage, un témoignage : quand je le rencontrai pour la première fois au Salon du Livre, au stand des éditions L’Âge d’Homme, nous n’étions plus des inconnus et, comme il me dédicaçait l’un de ses livres en usant d’une formule élogieuse, je répliquai : « Comme on dit en escrime : touché ». Son regard me transperça :
– Escrimeur ?
– Oui, Votre Haute Noblesse.
– Suivez-moi !
Impossible de ne pas obéir. Je le suivis dans l’allée et nous mimâmes quelques assauts au milieu des passants ahuris. Tel était Vladimir Volkoff, le frère d’armes que je pleure ce soir.
Dormez en paix, Votre Haute Noblesse. Nous prions pour vous.
► Christopher Gérard, Contrelittérature n°17, hiver 2006.
◘ Que sont les mousquetaires devenus ?
 Il y a de grands écrivains, il y en a de moins grands, mais certains écrivains, en dehors de leur qualité, ont la capacité de créer des mythes. Je ne sais plus le nom de l'auteur d'Arsène Lupin, ni de celui de Fantômas, mais Fantômas et Arsène Lupin sont des mythes, Alexandre Dumas aussi, qu'il soit très grand ou moyen, a crée un mythe : l'esprit mousquetaire.
Il y a de grands écrivains, il y en a de moins grands, mais certains écrivains, en dehors de leur qualité, ont la capacité de créer des mythes. Je ne sais plus le nom de l'auteur d'Arsène Lupin, ni de celui de Fantômas, mais Fantômas et Arsène Lupin sont des mythes, Alexandre Dumas aussi, qu'il soit très grand ou moyen, a crée un mythe : l'esprit mousquetaire.
Qu'est ce que l'esprit mousquetaire ?
C'est, me disait-on récemment, "un esprit de service et d'insolence". La définition me semble bonne, au-delà de ce que le vocable mème de mousquetaire, qui vient de mousquet mais a aussi des affinités avec moustache, peut avoir avoir de sonore et de provocant. Service, oui : les mousquetaires d'Alexandre Dumas sont au service du roi et, très précisément, de la reine, et, pour ce service, ils sont prèts à donner leur vie non seulement sans hésiter mais gaiement. Insolence, aussi, bien sûr : le cardinal est là pour qu'il y ait quelqu'un à défier, mais on ne le défie pas gratuitement, on le défie pour servir d'autant mieux celui qui doit ètre servi. Dans la trinité roi-reine-cardinal, la reine sert à être servi et le cardinal à être desservi, tandis que le roi assure la stabilité de l'ensemble.
Dans cette perspective, qu'est-ce qui compte pour un mousquetaire ? La vie ? Sûrement pas. La morale ? Encore moins. L'amour ? Peu... Mais l'amitité, oui. Le courage physique bien sûr. L'honneur (ou plutôt une certaine idée de l'honneur), plus que tout.
Et dans ces conditions, est ce que l'esprit mousquetaire peut signifier quelque chose aujourd'hui ou est-il à ranger définitivement au placard paléontologique ?
Lorsque j'écrivais – il y a quarante ans environ – un roman intitulé Les mousquetaires de la République, je voulais montrer que les sociétés ont les mousquetaires qu'elles méritent, et que, si la royauté était favorable à l'éclosion de cet "esprit de service et d'insolence", la république avec sa préférence délibérément accordée à la quantité plutôt qu'à la qualité, son civisme égalitaire débilitant, la mollesse invétérée de ces mœurs urbaines, ne pouvait produire que des mousquetaires idéalistes mais inefficaces, rebelles éphémères bientot domptés. Je pensais alors, je le pense toujours, que ni la gauche, pour qui le gouvernement des hommes est un paternalisme, ni la droite, pour qui c'est une gestion, ne sont équipées pour dispenser une denrée sociale pourtant élémentaire : j'entends l'inspiration. Oh ! il fut un temps, au tout début, où la Première République sut brièvement le faire : les volontaires de l'an II qui allaient se faire tuer en chantant la Marseillaise étaient surement inspirés-mal, mais ils l'étaient. Cela n'a pas duré. Rapidement, la République a retrouvé sa vocation qui est fondamentalement bourgeoise, et on ne sache pas que la bourgeoisie ait jamais été riche d'inspiration.
À notre époque, toute sorte de circonstances empèchent la renaissance de l'esprit mousquetaire, et avant tout le petit nombre d'hommes et de cause qui méritent d'ètre servis ; pour l'insolence, au contraire, les cibles foisonnent, mais quel intérèt y a t-il à cracher au nez de qui ne fera que s'essuyer avec un kleenex, à provoquer un quidam qui, tout au plus, vous enverra un papier bleu ?
Ces mots qui engagent
La disparition du duel, qui permettait à tout moment de "mettre sa peau au bout de ses idées" (selon une métaphore anatomiquement audacieuse), est en soi une catastrophe, autant pour l'esprit mousquetaire que pour la virilité, le respect des usages, l'honnêteté, le savoir-vivre et ce que les romains appelaient la dignitas : ne plus avoir l'occasion et l'obligation d'engager sa vie derrière chacune de ses paroles permet de dire et de faire n'importe quoi à n'importe qui, et comment réagir là-contre si on est un mousquetaire qui se respecte ? La gifle ou le coup de pied, même bien placé, n'ont pas les vertus curatives de l'épée choquée contre une autre épée.
Mais, il n'y a pas que le duel. Il y a à notre époque, toute une weltanschauung-guimauve, qui fait du mousquetaire un personnage odieux pour les uns, ridicule pour les autres. Le mousquetaire, par définition, n'est pas "politiquement correct" ; quant aux "Droits de l'Homme", pardonnez-moi, mais il s'en tamponne le coquillard. Il n'y a pas d'homme pour lui qui ne sache tenir une épée, et aux droits il préfère insolemment les passedroits. Imaginez-vous un mousquetaire ne mettant pas flamberge au vent devant un défilé de grèviste ou une parade de Gay pride ?
Et pourtant ?
Et pourtant il ne se peut pas que ce mélange de panache et d'inconscience, de respect et de mépris, de dérision et de vénération, ait complètement disparu de l'âme humaine pour être plus précis. Qui sont les mousquetaires d'aujourd'hui ? Oh ! il y a toujours les hommes courageux, depuis les médecins sans frontières jusqu'aux chuteurs opérationnels ou aux nageurs de combat, mais ont-ils la légèreté de leurs ancètres, leur élégence méprisante, leur dédain de toutes les conventions, y compris la mort ? Ont-ils cette qualité surpème que Hémingway appelait – expression à peu près intraduisable – grace under stress ? il n'est pas interdit d'en douter.
Non, si l'esprit mousquetaire peut encore servir de notre temps, c'est sans doute de façon plus intériorisée. Il consiste essentiellement, me semble t-il, à conserver son indépendance d'esprit dans l'univers de la pensée unique. À choisir les causes que l'on sert sans accorder de considération à leur popularité. À dire ce que l'on pense sans égard pour les idées reçues et les opinions à la mode. À faire un usage judicieux – et au besoin excessif – de l'esprit de contradiction. À ne céder aucune forme de vénalité. À savoir se montrer guelfe parmi les gibelins et gibelins parmi les guelfes. À appeler un chat un chat et un fripon, si haut placé qu'il soit, un fripon. À ne se laisser impressionner par rien ni personne. À avoir sa propre hiérarchie des valeurs sans se soucier de celle des autres. À répartir le service et l'insolence selon le mérite des uns et des autres. À savoir se choisir une reine qui soit assez noble et belle et un cardinal qui soit assez ignoble et puant.
Les ferrets de diamant sont à ce prix là.
► Vladimir Volkoff, Les Epées n°5, juin 2002.


