Fin Anticommunisme
La fin de l'anticommunisme
 Le leitmotiv de la “fin du communisme” a été répété à satiété, sur le mode du martèlement constant, ces derniers temps, spécialement pendant les journées de l'insurrection étudiante chinoise. On a donc assisté à sa relance en Europe, dans le monde des médias et dans les déclarations des personnages influents de la politique, de la culture et de l'économie. Ce ne fut pas à tort. Tandis que le bain de sang de la Place Tienanmen illustre la difficulté d'être de toute expérience de réforme dans un régime totalitaire, qui n'entend pas soumettre à discussion les prérogatives du contrôle social exercé par l'autorité politique (et donc sa propre formule de légitimité), les événements de Hongrie et de Pologne, les convulsions ethniques d'URSS et les difficultés concomitantes de la perestroïka de Gorbatchev donnent la mesure de l'effritement global d'un modèle politico-social qui, depuis 70 ans et jusqu'à nos jours, avait camouflé ses lacunes en matière d'innovation et justifié l'absence d'une réelle opposition révolutionnaire par les carences des systèmes bourgeois, tout en tentant de dissimuler des preuves éclatantes de son dysfonctionnement, comme l'isolement de la Russie bolchévique dans les années 20, l'impact de l'entrée des armées hitlériennes sur son territoire, la guerre froide et le sous-développement économique soviétique au moment où l'Occident connaissait un formidable boom.
Le leitmotiv de la “fin du communisme” a été répété à satiété, sur le mode du martèlement constant, ces derniers temps, spécialement pendant les journées de l'insurrection étudiante chinoise. On a donc assisté à sa relance en Europe, dans le monde des médias et dans les déclarations des personnages influents de la politique, de la culture et de l'économie. Ce ne fut pas à tort. Tandis que le bain de sang de la Place Tienanmen illustre la difficulté d'être de toute expérience de réforme dans un régime totalitaire, qui n'entend pas soumettre à discussion les prérogatives du contrôle social exercé par l'autorité politique (et donc sa propre formule de légitimité), les événements de Hongrie et de Pologne, les convulsions ethniques d'URSS et les difficultés concomitantes de la perestroïka de Gorbatchev donnent la mesure de l'effritement global d'un modèle politico-social qui, depuis 70 ans et jusqu'à nos jours, avait camouflé ses lacunes en matière d'innovation et justifié l'absence d'une réelle opposition révolutionnaire par les carences des systèmes bourgeois, tout en tentant de dissimuler des preuves éclatantes de son dysfonctionnement, comme l'isolement de la Russie bolchévique dans les années 20, l'impact de l'entrée des armées hitlériennes sur son territoire, la guerre froide et le sous-développement économique soviétique au moment où l'Occident connaissait un formidable boom.
Un “vide” à combler
Mais le débat a échoué dans la rhétorique pure : en effet, lorsque l'on parle de l'inévitable déclin de l'Empire d'Orient, on se perd dans une problématique mesquine, propre aux intellectuels occidentaux et aux médias audio-visuels, pour lesquels la disparition progressive de l'ex-Rideau de Fer n'est rien d'autre que le passage, plus ou moins pénible ou plus ou moins rapide, d'un système obsolète et dogmatique à l'unique alternative possible, celle du libéralisme de marché, pluraliste dans ses articulations politiques et concurrentiel dans sa dynamique économique. Mais les rares voix qui ont soulevé le problème du “vide à combler”, vide où se repèrent une soif de justice et un besoin de renouveau chez les fidèles de la lecture marxiste classique, ont laissé dangereusement de côté les problèmes réels suscités par la rupture du conteneur communiste (je pense aux interventions de Norberto Bobbio). Par ailleurs, ceux qui se sont préoccupés de la survivance des structures des partis communistes européens n'ont même pas jeté dans le débat le fait que la direction prise par le processus actuellement en acte est univoque : il s'agit d'un phénomène de transvasement dans les pratiques de gouvernement et dans le way of life de la civilisation occidentale, consumériste, individualiste, matérialiste et permissive, transvasement qui s'exerce dans des limites posées par le fait que ne sont même pas remises en question les prétentions occidentales d'hégémonie idéologique et de supériorité morale. On n'a pas saisi l'occasion de débattre des futurs possibles que connaîtraient les pays en train de sortir du “socialisme réel”. En somme, on a célébré une victoire que l'on croyait depuis longtemps acquise, première étape significative dans une guerre qui a pour objectif l'élimination complète ou l'assujettissement sans conditions du camp adverse.
Les lacunes chez les partisans de la “troisième voie”
Ce qui est encore moins compréhensible, c'est la platitude, mêlée de douce euphorie, avec laquelle certains commentateurs — peu nombreux en vérité — ont évoqué la “fin du communisme”, en insistant sur le fait qu'ils ne croyaient pas que l'alternative politique de cette fin de siècle, et des temps à venir, serait circonscrite à l'opposition/confrontation entre libéralisme et marxisme. Nous ne voulons pas parler ici seulement des socialistes qui, avec le temps et malgré quelques sursauts prometteurs mais sporadiques, semblent s'être résignés à penser et à mettre en pratique une variable secondaire du libéralisme, réduisant leur rôle à celui de simples réformateurs d'un filon idéologique qu'à l'origine et pendant plusieurs décennies, ils avaient fièrement combattu. Nous voulons surtout interpeller les défenseurs d'une hypothétique théorie de “troisième voie”, post-individualiste et post-collectiviste.
Une réflexion élémentaire, sommaire, aurait déjà dû suggérer à ces militants-là que le nouvel état de choses complique — et pas un peu — la tâche qu'ils se sont assignée. Pour 3 raisons essentiellement :
- A) La fin du communisme renforce l'hégémonie des systèmes libéraux, rehaussant leur crédit et leur “potentiel de réparation”, renforçant leur prétention de représenter le seul modèle universel adapté à l'époque moderne.
- B) La fin du communisme préfigure la nécessité de procéder à un immense saut qualitatif. En effet, le thème de la “troisième voie” est resté pendant très longtemps une simple idée-force, tenue à l'écart des affrontements réels de la politique concrète, déterminés par le binôme antagoniste libéralisme/marxisme. Il faut donc que cette idée-force d'une “troisième voie” se transforme en une véritable “seconde voie”, capable de se mesurer directement au libéralisme.
- C) La fin du communisme signale également la fin de l'anti-communisme, donc la disparition d'un instrument commode utilisé par les tenants de l'idée-force de la “troisième voie” pour agiter les consciences.
Voilà donc 3 défis cruciaux, pour lesquels, nous le verrons, le radicalisme de droite (qui se veut l'héritier de toute pensée de “troisième voie”) n'est pas du tout préparé à affronter.
Un libéralisme qui veut la mort de tous les modèles alternatifs
Sur le premier point, tous auront remarqué le ton arrogant et raisonneur des ayatollâhs du libéralisme, au moment des événements de Chine et à la faveur de la réaction émotive — bien compréhensible — de l'opinion publique à l'égard des brutales répressions contre la révolte étudiante. Sur ce chapitre, il y a bien entendu eu des nuances. Tandis que les commentateurs libéraux-conservateurs n'ont rien fait d'autre que d'insister, avec force et satisfaction, sur la “supériorité” du modèle occidental et sur l'inadéquation des peuples du Tiers-Monde à en saisir l'intrinsèque qualité (ou sur leur incapacité à le mettre en pratique), les opinion makers libéraux-progressistes ont enfourché leur dada, en l'occurrence l'idéologie des droits de l'homme, la portant à ses conséquences extrêmes et déclarant dans la foulée qu'il fallait liquider toute espèce d'alternative à sa domination sans partage. La première victime de la censure — c'est-à-dire le “mariage contre-nature” entre la révolution et la nation (1) — a d'abord essuyer quelques fléchettes, puis subi un véritable jeu de massacre : toutes les formes affirmatrices d'identité nationale ou toutes les volontés de retour aux racines (assimilées avec empressement au Volksgeist national-socialiste), dans la mesure où elles sont capables de s'opposer à l'universalisme égalitaire et assimilationniste. Pire, sur un plan plus général, toutes les expériences non occidentales nées des luttes de libération de l'ère coloniale, qui, pendant un temps avaient été exaltées par ceux-là mêmes qui les accusent aujourd'hui, avec un langage emprunté à la propagande maccarthyste, se voient reprocher de transformer « tout individu en une particule du corps collectif, l'emprisonnant dans son appartenance, lui niant le droit d'être “autre” et lui imposant une vérité imperméable au doute » (2).
On ne saurait trop regretter cette épouvantable volte-face. En apparence, elle simplifie l'échiquier idéologique puisqu'elle expulse l'un des protagonistes et ne laisse qu'un seul partenaire en place, le libéralisme occidental, avec toutes ses carences confirmées et avec sa terrifiante tendance à séparer toujours davantage la masse des citoyens des institutions, ôtant tout activisme dans la vie publique au profit d'une dictature implacable des valeurs économiques. Mais nos regrets ne pourraient être que superficiels si la critique adressée au libéralisme par ses adversaires patentés était instrumentalisable et capable d'enrayer la progression du libéralisme délétère. Hélas, les choses n'évoluent pas dans ce sens. Engoncés dans les souvenirs et les contradictions des expériences autoritaires de l'idéologie néo-fasciste, immobilisés dans la “non-politicité” du traditionalisme de la destra radicale, ces militants semblent en panne d'idées concrètes et pertinentes et la seule alternative qui semble s'être dégagée de ce magma, c'est celle du “national-populisme”, voguant dans le vague et incapable de forger des propositions originales.
Cette idéologie protestataire et confuse est parfaite pour farcir d'expressions tonitruantes les éditoriaux éternellement pareils à eux-mêmes des revues à circulation limitée ou pour soulager quelques intellectuels organiques relevant d'une culture marginale, toujours plus velléitaire et minorisée. Le national-populisme, spécialisé dans les vieilleries et dans les déclarations morales enflammées, n'a pas été capable de donner réponse aux questions que se posent les grandes masses ni d'interpréter les exigences des professions montantes. Présentant donc une carence totale en modèles alternatifs, les militants qui rêvent d'une “troisième voie” n'ont pas fait la preuve de leur habilité à élaborer des réponses en toute autonomie ; ils se sont limités à reprendre et à recycler, avec plus ou moins de bonheur, des thèses venues d'ailleurs et traitant de l'immigration extra-européenne, de l'anti-impérialisme, de la défense des identités ethno-linguistiques, de la critique de l'occidentalisme, etc., sans pouvoir encore les porter à leurs ultimes conséquences en forgeant en toute cohérence un anti-racisme différentialiste, un européisme à dimensions continentales, un neutralisme actif. Pire : le national-populisme a bégayé maladroitement quelques pauvres slogans dans tous les domaines où l'offensive libérale avait été la plus forte. Du problème des droits civils en passant par les rapports entre l'État et le marché dans la sphère économique, il n'a balbutié que des banalités sans fondement, en est resté à des luttes de principe — en réchauffant sempi-ternellement l'idée d'un corporatisme ignorant complètement les conflits sociaux des dernières décennies — et n'a offert aux esprits exigeants que des lectures ambiguës et réductionnistes de concepts pourtant centraux dans toute vision non-conformiste, comme la nation et la communauté.
Pas une seule fois, les adeptes du national-populisme ne se sont interrogé sur les parcours historiques possibles des doctrines qu'ils défendent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce qu'ils veulent vraiment : faire évoluer leurs idées vers une “dictature de développement”, vers une démocratie organique, vers une démocratie plébiscitaire, vers un néo-corporatisme à dimensions autarciques ou vers quelque chose d'autre (3) ? La seule chose qui soit certaine, c'est que sur un tel chemin, l'hypothèse d'une “troisième voie” triomphante risque de se réduire à très peu de chose : à ce que les doctrinaires du libéralisme voudraient qu'elle soit, c'est-à-dire une pauvre image utopique, alimentée d'esprit rebelle, à la pure et simple expression d'un état d'âme, où l'éternelle frustration trouverait refuge, en équilibre entre l'anarchisme et les suggestions de régime fort.
Fin du communisme = fin de l'anticommunisme
Face à ces vestiges, qui n'ont rien d'encourageant, s'ajoute la constatation que la fin du communisme de mouture soviétique signale aussi la fin de l'anti-communisme, c'est-à-dire la chute d'un élément capital dans les polémiques du radicalisme de droite. Nous dirions même plus : c'est la fin de tout anti-communisme, plus seulement de l'anti-communisme viscéral mais aussi de l'anti-communisme dans sa version plus sophistiquée, qui évoque un “effondrement à gauche” du communisme, au nom des instances “trahies” par les partis marxistes. Le relatif maintien électoral du PCI dans la période qui a immédiatement suivi les événements de Chine est de ce fait un signal d'une extrême clarté. Le communisme meurt (ou se transforme ou se dénature) non par un embourgeoisement de ses représentants — thèse chère aux chefs de file “nationaux-populistes” depuis au moins 2 décennies — mais bien plutôt par une disparition lente des instances qui en avaient motivé la naissance et le succès, par la transformation génétique des strates sociales qui l'avaient traditionnellement soutenu, par le réajustement des scénarios géopolitiques sur le plan international. Le communisme n'étant plus perçu comme une menace, il devient imperméable aux attaques frontales. Les canaux — intellectuels en première instance — qui avaient contribué à alimenter son avance ne sont pas du tout desséchés : leurs flux se dirigent ailleurs, faisant croître démesurément l'espace du radicalisme, de l'égalitarisme niveleur, du pan-conflictualisme social. Tandis que les expressions occidentales du marxisme s'incorporent dans la sociale-démocratie, l'idéologie qui hier se concentrait dans le marxisme est devenue transversale. Ce qu'Alain de Benoist avait mis en exergue il y a quelques années acquiert pleine actualité : « la société existante la plus voisine de la société idéale telle que la décrivait Marx est la société américaine » (4).
Si l'on veut formuler un discours positif, celui-ci ne trouvera jamais d'articulation si ne sont pas éliminées de la scène les équivoques, auxquelles nous venons de faire référence et qui sont portées par l'obstination de tous ceux qui se déclarent les héritiers de la défaite et ne veulent pas tourner définitivement la page interminable de l'après-guerre. Le travail de repenser théoriquement le politique, travail qui précède et prépare l'action politique proprement dite, a trouvé en la Nouvelle Droite un terrain de manœuvre et une source féconde. Les métamorphoses suggérées par ce courant d'idée — fondé en premier lieu sur la défense des libertés collectives, sur l'opposition simultanée au despotisme du “socialisme réel” et à l'individualisme de “l'américanosphère”, sur le refus de reconnaître dans l'économie le paradigme privilégié des faits sociaux — constituent le point de départ le plus solide pour la construction d'une alternative à l'anti-communisme traditionnel, à ses inconséquences, à ses limites et à ses contradictions.
► Marco Tarchi, Vouloir n°56-58, 1989.
• Notes :
(1) voir Rosellina Balbi, Vuoto a perdere, in : La Repubblica, 6.6.1989.
(2) Ibidem.
(3) Chacune de ces formules recèle en elle-même bon nombre d'éléments contradictoires. Sur certains de ceux-là, relatifs à la démocratie organique et à la démocratie plébiscitaire, cf. notre postface intitulée Una riposta alla crisi ?, in : A. de Benoist, Democrazia : il problema, Arnaud, Firenze, 1985, pp. 101-108.
(4) Cf. R. de Herte, Pourquoi nous sommes anti-communistes, in : éléments n°57-58, 1986, p. 2.

◘ Capitalisme libéral et socialisme, les deux faces de Janus
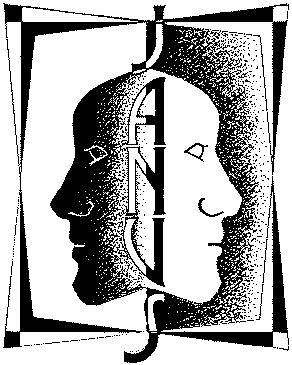 L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies 2 conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les 2 systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des États-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences ?
L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies 2 conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les 2 systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des États-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences ?
En 1952, dans son Introduction à la métaphysique, Heidegger écrivait : « L'Europe se trouve dans un étau entre la Russie et l'Amérique, qui reviennent métaphysiquement au même quant à leur appartenance au monde et à leur rapport à l'esprit » (1). Si, pour lui, notre époque se caractérisait par un « obscurcissement du monde » marqué par « la fuite des dieux, la destruction de la terre, la grégarisation de l'homme, la prépondérance du médiocre » (2), et si cet obscurcissement du monde provenait de l'Europe elle-même et avait commencé par « l'effondrement de l'idéalisme allemand », ce n'en est pas moins en Amérique et en Russie qu'il avait atteint son paroxysme.
L'affirmation de Heidegger, qui pose comme équivalentes, au plan de leur rapport à l'être, 2 nations porteuses d'idéologies généralement pensées comme antinomiques peut paraître provocatrice. Elle ne fait pourtant que reconnaître, au plan métaphysique, la parenté certaine qui existe, au plan historique, entre capitalisme et socialisme (dont le marxisme n'est que la forme la plus élaborée et la plus absolue).
Capitalisme et socialisme sont aussi intimement liés que les 2 faces de Janus. Tous 2 sont issus de la philosophie du XVIIIe siècle, marquée par la trilogie : raison, égalité, progrès, et de la Révolution industrielle du XIXe siècle, caractérisée par le culte de la technique, du productivisme et du profit, et s'ils s'opposent, c'est beaucoup plus sur les méthodes que sur les objectifs.
Divergences de méthodes
L'émergence du socialisme moderne tient au fait que non seulement la proclamation de l'égalité des droits par la Révolution de 1789 laissa subsister les inégalités sociales, mais que furent supprimées toutes les institutions communautaires (gérées par l'Église, les corporations, les communes) qui créaient un réseau de solidarité entre les différents ordres de la société, Quant à la Révolution industrielle, si elle marqua un prodigieux essor économique, elle provoqua également une détérioration considérable des conditions de vie des classes populaires, de sorte que ce qui avait été théoriquement gagné sur le plan politique fut perdu sur le plan social, La protestation socialiste tendit alors à démontrer qu'une centralisation et une planification de la production des richesses était tout-à-fait capable de remplacer la libre initiative des entrepreneurs et de parvenir, au plan économique, à l'égalité qui avait été conquise au plan juridique.
Bien que divergeant sur les méthodes (économie de libre entreprise ou économie dirigée), libéraux et socialistes n'en continuaient pas moins à s'accorder sur la primauté des valeurs économiques, et partageaient la même foi dans le progrès technique, le développement industriel illimité, et l'avènement d'un homme nouveau, libéré du poids des traditions. En fait, tant les libéraux que les socialistes pouvaient se reconnaître dans les idées des Saints-Simoniens, qui ne voyaient dans la politique que la science de la production, et pour lesquels la société nouvelle n'aurait pas besoin d'être gouvernée, mais seulement d'être administrée.
Négation de l'autonomie
La même négation de l'autonomie du politique se retrouve ainsi chez les libéraux et les socialites de toute obédience. À l'anti-étatisme des libéraux, qui ne concèdent à l'État qu'un pouvoir de police propre à protéger leurs intérêts économiques, et la mission de créer les infrastructures nécessaires au développement de la libre entreprise, répond, chez les sociaux-démocrates, le rêve d'un État qui aurait abandonné toute prérogative régalienne et dont le rôle essentiel serait celui de dispensateur d'avantages sociaux. On trouve même chez les socialistes proudhoniens un attrait non dissimulé pour un certaine forme d'anarchie. Quant aux marxistes, bien qu'ils préconisent un renforcement du pouvoir étatique dans la phase de dictature du prolétariat, leur objectif final demeure, du moins en théorie, le dépérissement de l'État. Le totalitarisme vers lequel ont en fait évolué les régimes marxistes constitue d'ailleurs aussi, à sa manière, une négation de l'autonomie du politique.
La pensée de Marx, nourrie de la doctrine des théoriciens de l'économie classique, Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill et Jean-Baptiste Say, est toujours restée tributaire de l'idéologie qui domine depuis les débuts de l'ère industrielle (3). Le matérialisme bourgeois, l'économisme vulgaire se retrouvent ainsi dans le socialisme marxiste. Marx rêve en effet d'une société assurant l'abondance de biens matériels et, négligeant les autres facteurs socio-historiques, il voit dans l'économie le seul destin véritable de l'homme et l'unique possibilité de réalisation sociale.
Mais ce qui crée les liens les plus forts est l'existence d'ennemis communs. Or, depuis l'origine, libéraux et marxistes partagent la même hostilité à l'égard des civilisations traditionnelles fondées sur des valeurs spirituelles, aristocratiques et communautaires.
Le Manifeste communiste (1848) est à cet égard révélateur. Loin de stigmatiser l'œuvre de la bourgeoisie (c'est-à-dire, au sens marxiste du terme, le grand capital), il fait en quelque sorte l'éloge du rôle éminemment révolutionnaire qu'elle a joué.
« Partout où elle (la bourgeoisie) est parvenue à dominer — écrit Marx —, elle a détruit toutes les conditions féodales, patriarcales, idylliques. Impitoyable, elle a déchiré les liens multicolores qui attachaient l'homme à son supérieur naturel, pour ne laisser subsister entre l'homme et l'homme que l'intérêt tout nu, le froid “paiement comptant”... Elle a dissous la dignité de la personne dans la valeur d'échange, et aux innombrables franchises garanties et bien acquises, elle a substitué une liberté unique et sans vergogne : le libre-échange » (4).
Prenant acte de cette destruction des valeurs traditionnelles opérée par la bourgeoisie capitaliste, Marx se félicite que celle-ci ait « dépouillé de leur sainte auréole toutes les activités jusque là vénérables et considérées avec un pieux respect » et qu'elle ait « changé en salariés à ses gages le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, l'homme de science ».
La haine du monde rural et l'apologie des mégapoles s'expriment également sans détours chez Marx, qui juge positifs les effets démographiques du développement capitaliste.
« La bourgeoisie — écrit-il — a soumis la campagne à la domination de la ville. Elle a fait surgir d'immenses cités, elle a prodigieusement augmenté la population des villes aux dépens des campagnes, arrachant ainsi une importante partie de la population à l'abrutissement de l'existence campagnarde ».
Il n'hésite pas non plus à faire l'éloge du colonialisme, se félicitant que « la bourgeoisie, de même qu'elle a subordonné la campagne à la ville (...) a assujetti les pays barbares et demi-barbares aux pays civilisés, les nations paysannes aux nations bourgeoises, l'Orient à l'Occident ». Cette domination sans partage de la fonction économique est magnifiée par Marx, de même que l'instabilité qui en résulte. C'est en effet avec satisfaction qu'il constate que « ce qui distingue l'époque bourgeoise de toutes les précédentes, c'est le bouleversement incessant de la production, l'ébranlement continuel de toutes les institutions sociales, bref la permanence de l'instabilité et du mouvement... Tout ce qui était établi se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané » (5).
Le faux débat
Mais la bourgeoisie capitaliste n'en a pas moins souvent cherché à faire croire qu'elle défendait les valeurs traditionnelles contre les marxistes et autres socialistes, ce qui amène Marx à rappeler, non sans une certaine ironie, que les marxistes ne peuvent être accusés de détruire des valeurs que le capitalisme a déjà détruites ou est en voie de détruire. Vous nous reprochez, dit Marx, de détruire la propriété, la liberté, la culture, le droit, l'individualité, la famille, la patrie, la morale, la religion, comme si les développements du capitalisme ne l'avait pas déjà accompli.
« Détruire la propriété ? Mais — dit Marx — s'il s'agit de la propriété du petit-bourgeois, du petit paysan, nous n'avons pas à l'abolir, le développement de l'industrie l'a abolie et l'abolit tous les jours. (...) Détruire la liberté, l'individualité ? Mais l'individu qui travaille dans la société bourgeoise n'a ni indépendance, ni personnalité. (...) Détruire la famille ? Mais par suite de la grande industrie, tous les liens de famille sont déchirés de plus en plus ».
Tous ces arguments de Marx ne relèvent pas seulement de la polémique. En effet, les sociétés capitalistes présentent bien des traits conformes aux idéaux marxistes. Ainsi, à l'athéisme doctrinal professé par les marxistes répond le matérialisme de fait des sociétés capitalistes, où toute religion structurée a tendance à disparaître pour faire place à un athéisme pratique ou à une vague religiosité qui, sous l'influence du protestantisme, tend à se réduire à un simple moralisme aux contours indécis, dont tout aspect métaphysique, tout symbolisme, tout rite, toute autorité traditionnelle est banni.
Résultat : le grégarisme
De même, au collectivisme tant reproché à l'idéologie marxiste (collectivisme qui ne se réduit pas à l'appropriation par l'État des moyens de production, mais consiste également en une forme de vie sociale où la personne est soumise à la masse) répond le grégarisme des sociétés capitalistes. Comme le note André Siegfried, c'est aux États-Unis qu'est né le grégarisme qui tend aujourd'hui à gagner l'Europe.
« L'être humain, devenu moyen plutôt que but accepte ce rôle de rouage dans l'immense machine, sans penser un instant qu'il puisse en être diminué (...) d'où un collectivisme de fait, voulu des élites et allègrement accepté de la masse, qui, subrepticement, mine la liberté de l'homme et canalise si étroitement son action que, sans en souffrir et sans même le savoir, il confirme lui-même son abdication » (6).
Curieusement, marxisme et libéralisme produisent ainsi des phénomèmes sociaux de même nature, qui sont incompatibles avec toute conception organique et communautaire de la société.
L'idéologie mondialiste est également commune au marxisme et au capitalisme libéral. Pour Lénine, qui soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la libération complète de toutes les nations opprimées n'est en effet qu'un instrument au service de la Révolution et ne peut constituer qu'une « phase de transition », la finalité étant « la fusion de toutes les nations » (7). Or, cette fusion de toutes les nations est également l'objectif du capitalisme libéral qui, tout en ayant utilisé les nationalismes des peuples de l'Est pour détruire l'Union soviétique, vise en fait à établir un marché mondial dans lequel toutes les nations sont appelées finalement à se dissoudre. Toutes les identités nationales sont ainsi destinées à disparaître pour être remplacées par un modèle uniforme, américanomorphe, au service duquel une intense propagande est organisée, modèle dont les traits caractéristiques sont le métissage, la culture rock, les jeans, le coca-cola, les chaînes de restaurant fast-food et le basic English, le tout étant couronné par l'idéologie des droits de l'homme dont les articles de foi sont dogmatiquement décrétés par les grands-prêtres d'une intelligentsia qui n'a d'autre légitimité que celle qu'elle s'est elle-même octroyée (8).
En fait, tant le marxisme que le capitalisme libéral approuvent sans réserves toutes les conséquences économiques et sociales de la Révolution industrielle, qui se traduisent par la destruction de tous les liens communautaires, familiaux ou nationaux, le déracinement et la grégarisation. Une telle évolution est en effet nécessaire aussi bien à l'établissement d'un véritable marché mondial, rêve ultime du capitalisme libéral, qu'à l'avènement de l'homme nouveau, libéré de toute aliénation, qui constitue l'objectif du marxisme. Pour ce dernier, le prolétariat était d'ailleurs appelé à jouer un rôle messianique et à porter plus loin le flambeau de la Révolution, afin de mener à son terme la destruction de toutes les valeurs traditionnelles.
Bourgeoisie et prolétariat chez Berdiaev
Pour le philosophe chrétien et traditionnaliste Berdiaev, capitalisme libéral et marxisme ne sont pas seulement liés au plan des sources idéologiques, mais ils sont également les agents d'une véritable subversion. « Tant la bourgeoisie que le prolétariat — écrit Berdiaev — représentent une trahison et un rejet des fondements spirituels de la vie. La bourgeoisie a été la première à trahir et à abdiquer le sacré, le prolétariat lui a emboîté le pas » (9). Soulignant les affinités qui existent entre la mentalité du bourgeois et celle du prolétaire, il déclare :
« Le socialisme est bourgeois jusque dans sa profondeur et il ne s'élève jamais au-dessus du sentiment des idéaux bourgeois de l'existence. Il veut seulement que l'esprit bourgeois soit étendu à tous, qu'il devienne universel, et fixé dans les siècles des siècles, définitivement rationalisé, stabilisé, guéri des maladies qui la minent » (10).
Si, pour Berdiaev, l'avènement de la bourgeoisie en tant que classe dominante a correspondu à un rejet des fondements spirituels de la vie, Max Weber voit, pour sa part, une relation étroite entre l'éthique protestante et le développement du capitalisme moderne. Ces 2 points de vue ne sont pas aussi contradictoires qu'ils peuvent paraître de prime abord. En effet, outre que la spiritualité ne se réduit pas à l'éthique, l'éthique protestante a tendu à devenir une simple morale utilitariste qui s'apparente en fait à la morale laïque, et qui n'est plus sous-tendue par une vision spirituelle du monde. Max Weber relève d'ailleurs que « l'élimination radicale du problème de la théodicée et de toute espèce de questions sur le sens de l'univers et de l'existence, sur quoi tant d'hommes avaient peiné, cette élimination allait de soi pour les puritains... » (11).
L'utilitarisme de l'éthique protestante apparaît d'ailleurs clairement dans sa conception de l'amour du prochain. En effet, selon celle-ci, comme le rappelle Max Weber, « Dieu veut l'efficacité sociale du chrétien » et « l'amour du prochain ... s'exprime en premier lieu dans l'accomplissement des tâches professionnelles données par la lex naturae revêtant ainsi l'aspect proprement objectif et impersonnel d'un service effectué dans l'organisation rationnelle de l'univers social qui nous entoure » (ibid.). C'est d'ailleurs par la promotion de cette conception éthique dans le monde chrétien que le protestantisme a pu créer un contexte favorable au développement du capitalisme moderne.
Mais l'état d'esprit qui en est résulté, et qui s'est développé sans entraves aux États-Unis d'Amérique, paraît bien éloigné de toute sorte d'éthique. Comme l'a relevé Karl Marx à propos des « habitants religieux et politiquement libres de la Nouvelle Angleterre » : « Mammon est leur idole qu'ils adorent non seulement des lèvres, mais de toutes les forces de leur corps et de leur esprit. La terre n'est à leurs yeux qu'une Bourse, et ils sont persuadés qu'il n'est ici-bas d'autre destinée que de devenir plus riches que leurs voisins » (12).
La bibliocratie du calvinisme
Étudiant les liens qui existent entre l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante, Max Weber avait souligné la “bibliocratie” du calvinisme, qui tenait les principes moraux de l'Ancien Testament dans la même estime que ceux du Nouveau, l'utilitarisme de l'éthique protestante rejoignant l'utilitarisme du judaïsme. Avant lui, Marx avait d'ailleurs déjà relevé les affinités qui existent entre l'esprit du capitalisme et le judaïsme même si cette analyse était peu conforme aux principes du matérialisme historique. Considérant que « le fond profane du judaïsme [c'est] le besoin pratique, l'utilité personnelle », Marx estimait ainsi que, grâce aux Juifs et par les Juifs, « l'argent est devenu une puissance mondiale et l'esprit pratique des Juifs, l'esprit pratique des peuples chrétiens », concluant que « les Juifs se sont émancipés dans la mesure même où les chrétiens sont devenus Juifs » (ibid.).
Ignorant délibérément la complexité des origines de l'idéologie socialiste, Berdiaev privilégiait quant à lui les affinités entre socialisme et judaïsme. Selon Berdiaev, le socialisme constitue en effet une « manifestation du judaïsme en terreau chrétien », et « la confusion et l'identification du christianisme avec le socialisme, avec le royaume et le confort terrestre sont dues à une flambée d'apocalyptique hébraïque », au « chiliasme hébreu, qui espère le Royaume de Dieu ici-bas » et « il n'était pas fortuit que Marx fût juif » (ibid., p. 154). Cioran rejoint sur ce point Berdiaev lorsqu'il écrit : « Quand le Christ assurait que le “royaume de Dieu” n'était ni “ici” ni “là”, mais au-dedans de nous, il condamnait d'avance les constructions utopiques pour lesquelles tout “royaume” est nécessairement extérieur, sans rapport aucun avec notre moi profond ou notre salut individuel » (13).
De différents points de vue, capitalisme libéral et socialisme moderne paraissent ainsi liés, non seulement au plan historique, mais également par leurs racines idéologiques, et ce n'est probablement pas un hasard si leur émergence a coïncidé avec l'effondrement du système de valeurs qui, pendant des siècles, avait prévalu en Europe, et qui affirmait, du moins dans son principe originel, la primauté de l'autorité spirituelle sur le pouvoir temporel, et la subordination de la fonction économique au pouvoir temporel.
Conversion rapide des anciens marxistes au libéralisme
L'écroulement des régimes marxistes, incapables d'atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, n'aura donc pas changé fondamentalement le cours de l'Histoire, puisque la Weltanschauung commune au marxisme et au capitalisme continue toujours à constituer le point de référence de nos sociétés. Se trouvent en effet toujours mis au premier plan : le matérialisme philosophique et pratique, le règne sans partage de l'économie, l'égalitarisme idéologique (qui se conjugue curieusement avec l'extension des inégalités sociales), la destruction des valeurs familiales et communautaires, la collectivisation des modes de vie et le mondialisme. C'est peut-être d'ailleurs ce qui permet d'expliquer pourquoi les socialistes occidentaux et la majeure partie des marxistes de l'Est se sont aussi facilement convertis au capitalisme libéral, qui paraît aujourd'hui le mieux à même de réaliser leur idéal (14).
Mais la chute des régimes marxistes a l'Est nombre de valeurs qui, bien qu'ayant été niées pendant des décennies, n'avaient pu être détruites. On voit ainsi, dans des sociétés en pleine décomposition qui redécouvrent les réalités d'un capitalisme sauvage, s'affirmer à nouveau religions, nations et traditions. Toutes ces valeurs qui refont surface, et dont l'affirmation avait été jugée utile par les États occidentaux, dans la mesure où elle pouvait contribuer au renversement des régimes marxistes, sont toutefois loin d'être vues avec la même complaisance dès lors que cet objectif a été atteint.
L'idéologie matérialiste des sociétés occidentales s'accommode en effet assez mal de tout système de valeurs qui met en question sa prétention à l'universalité et qui n'est pas inconditionnellement soumis aux impératifs du marché mondial. Tout véritable réveil religieux, toute affirmation nationale ou communautaire, ou toute revendication écologiste ne peuvent ainsi être perçus que comme autant d'obstacles à la domination sans partage des valeurs marchandes, obstacles qu'il s'agit d'abattre ou de contourner.
Objectif : le marché mondial
Ainsi, l'établissement d'un véritable marché mondial qui puisse permettre aux stratégies des multinationales de se développer sans entraves étant devenu l'objectif prioritaire, des pressions sont exercées au sein du GATT — par le lobby américain — pour que les pays d'Europe acceptent le démantèlement de leur agriculture, quelles que puissent en être les conséquences sur l'équilibre démographique et social de ces pays, sur l'enracinement de leur identité nationale et sur leur équilibre écologique.
De même, les cultures et les langues nationales doivent de plus en plus se plier aux lois du marché mondial et céder le pas à des “produits culturels” standardisés de niveau médiocre, utilisant le basic English comme langue véhiculaire, et aptes ainsi à satisfaire le plus grand nombre de consommateurs du plus grand nombre de pays. Quant aux religions, elles ne sont tolérées que dans la mesure où elles délivrent un message compatible avec l'idéologie du capitalisme libéral, et si elles s'accommodent avec les orientations fondamentales de la société permissive, qui ne sont en fait que l'application, au domaine des moeurs, des principes du libre-échange.
L'écologie dans le collimateur
L'écologie, enfin, n'est prise en compte que si elle ne s'affirme pas comme une idéologie ayant la prétention d'imposer des limites à la libre entreprise. Les valeurs néo-païennes qu'elle véhicule (que le veuillent ou non ses adeptes) sont par ailleurs vivement dénoncées. Ainsi, Alfred Grosser se plaît à relever que « ce n'est pas un hasard si l'écologie a démarré si fort en Allemagne où la nature (die Natur) tient une place tout autre qu'en France. La forêt (der Wald) y est fortement chargée de symbole. La tradition allemande ... c'est l'homme mêlé, confondu à la nature ». Ne reculant pas devant les amalgames les plus grossiers, il n'hésite pas à écrire : « La liaison entre les hommes et la nature, le sol et le sang, cette solide tradition conservatrice allemande a été reprise récemment par Valéry Giscard d'Estaing à propos des immigrés. C'était la théorie d'Hitler ». Et Grosser de conclure avec autant de naïveté que de grandiloquence : « La grandeur de la civilisation judéo-chrétienne est d'avoir forgé un homme non soumis à la nature » (15).
L'idéologie capitaliste libérale, actuellement dominante, entre ainsi en conflit avec d'autres ordres de valeur, et ces nouveaux conflits, dont nous ne voyons que les prémisses, pourraient bien reléguer au rang des utopies la croyance en une “fin de l'histoire”. En effet, ces conflits n'opposent plus, comme c'était le cas depuis 2 siècles, 2 idéologies jumelles qui, tout en se combattant, partaqeaient pour l'essentiel les mêmes idéaux fondamentaux et ne s'opposaient que sur les moyens de les réaliser. Les sociétés fondées sur le capitalisme libéral vont en effet avoir désormais à affronter des adversaires dont l'idéologie est irréductible à une vision purement économiste du monde. L'antithèse fondamentale ne se situe pas en effet entre capitalisme et marxisme, mais entre un système où l'économie est souveraine, quelle que soit sa forme, et un système où elle se trouve subordonnée à des facteurs extra-économiques.
On voit ainsi reparaître l'idée d'une hiérarchie des valeurs qui n'est pas sans analogies avec l'idéologie des peuples indo-européens et celle de l'Europe médiévale, où la fonction économique, et notamment les valeurs marchandes, occupait un rang subordonné aux valeurs spirituelles et au pouvoir politique (au sens originel de pouvoir régulateur de la vie sociale et des fonctions économiques). Bien que, dans cet ordre ancien, la dignité de la fonction de production des biens matériels fût généralement reconnue (16), il était toutefois exclu que les détenteurs de cette fonction puissent usurper des compétences pour l'exercice desquelles ils n'avaient aucune qualification. L'économie se trouvait ainsi incorporée dans un système qui ne considérait pas l'homme uniquement comme producteur ou consommateur, et l'organisation corporative des professions mettait beaucoup plus l'accent sur l'aspect qualitatif du travail que sur l'aspect quantitatif de la production, donnant une dimension spirituelle à l'accomplissement de toutes les tâches, même des plus humbles. Quant à la spéculation, au profit détaché de tout travail productif, ils n'étaient non seulement pas valorisés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils étaient profondément méprisés, tant par la noblesse que par le peuple, et ceux qui s'y adonnaient étaient généralement considérés comme des parias.
Le monothéisme du marché et de l'argent
Ce n'est en fait que depuis 2 siècles que les valeurs marchandes ont pris une place prépondérante dans la société occidentale, et que s'est instituée cette véritable subversion que Roger Garaudy qualifie de « monothéisme du marché, c'est-à-dire de l'argent, inhérent à toute société dont le seul régulateur est la concurrence, une guerre de tous contre tous » (17). Un champion de l'ultra-libéralisme, comme Hayek, reconnaît d'ailleurs lui-même que « le concept de justice sociale est totalement vide de sens dans une économie de marché ».
Cette subversion des valeurs est particulièrement sensible dans le capitalisme de type anglo-saxon que Michel Albert oppose au capitalisme de type rhénan ou nippon : le premier pariant sur le profit à court terme, négligeant outrancièrement les secteurs non-marchands de la société, l'éducation et la formation des hommes, et préférant les spéculations en bourse à la patience du capitaine d'industrie ou de l'ingénieur qui construisent et consolident jour après jour une structure industrielle ; le second planifiant à long terme, respectant davantage les secteurs non-marchands, accordant de l'importance à l'éducation et à la formation et se fondant sur le développement des structures industrielles plutôt que sur les spéculations boursières (18).
Il est d'ailleurs intéressant de relever que c'est le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui conserve un certain nombre de valeurs des sociétés pré-industrielles et s'enracine dans une communauté ethno-culturelle, qui se révèle être plus performant que le capitalisme de type anglo-saxon, qui ne reconnaît pas d'autres valeurs que les valeurs marchandes, même s'il aime souvent se draper dans les plis de la morale et de la religion.
Mais le meileur équilibre auquel sont parvenues les sociétés où règne un capitalisme de type rhénan ou nippon n'en demeure pas moins fragile, et ces sociétés sont loin d'être exemptes des tares inhérentes à toutes les formes de capitalisme libéral. On peut d'ailleurs se demander si le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui s'appuie sur les restes de structures traditionnelles, n'est pas condamné à disparaître par la logique même du capitalisme libéral qui finira par en détruire les fondements dans le cadre d'un marché mondial.
Par delà ces oppositions de nature éphémère qui existent au sein du capitalisme libéral, la question est finalement de savoir si celui-ci parviendra à établir de manière durable son pouvoir absolu et universel, marquant ainsi en quelque sorte la fin de l'histoire, ou s'il subira, à plus ou moins longue échéance, un sort analogue à celui de marxisme. En d'autres termes, une société ne se rattachant plus à aucun principe d'ordre supérieur et dénuée de tout lien communautaire est-elle viable, ou cette tentative de réduire l'homme aux simples fonctions de producteur et de consommateur, sans dimension spirituelle et sans racines, est-elle condamnée à l'échec, disqualifiant par là-même l'idéologie (ou plutôt l'anti-idéologie) sur laquelle elle était fondée ?
► Pierre Maugué, Vouloir n°97/100, 1993.
• Notes :

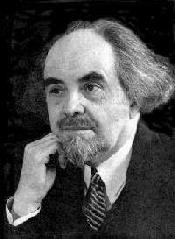 « Le bourgeoisisme n’est pas l’apanage d’une classe sociale, celle des capitalistes, bien que ce soit là qu’il s’épanouit le plus à l’aise. (...) Il existe un bourgeoisisme dans toutes les classes, chez les nobles, chez les paysans, chez les intellectuels, dans le clergé, dans le prolétariat. L’abolition de toutes les classes, socialement désirable, mènera probablement à un règne général du bourgeoisisme. La démocratie est un moyen de cristallisation du règne bourgeois. Ce règne du bourgeoisisme dans la démocratie est plus dépravé en France, plus vertueux en Suisse, mais on ne saurait dire lequel est le pire. (...)
« Le bourgeoisisme n’est pas l’apanage d’une classe sociale, celle des capitalistes, bien que ce soit là qu’il s’épanouit le plus à l’aise. (...) Il existe un bourgeoisisme dans toutes les classes, chez les nobles, chez les paysans, chez les intellectuels, dans le clergé, dans le prolétariat. L’abolition de toutes les classes, socialement désirable, mènera probablement à un règne général du bourgeoisisme. La démocratie est un moyen de cristallisation du règne bourgeois. Ce règne du bourgeoisisme dans la démocratie est plus dépravé en France, plus vertueux en Suisse, mais on ne saurait dire lequel est le pire. (...) L’utilitarisme, le désir de réaliser un but à tout prix et par n’importe quel moyen, la sécurité de l’homme obtenue à tout prix et par n’importe quel moyen, tout cela mène infailliblement au règne du bourgeoisisme. Ainsi les révolutions s’embourgeoisent, le communisme se transforme en règne du bourgeoisisme. (...) Le royaume du bourgeoisisme s’oppose au royaume de l’esprit, à la spiritualité pure de tout utilitarisme, de toute adaptation sociale. »
► Nicolas Berdiaev, extrait de : Esprit et réalité, ch. V, 1937.