Delvo
Hommage à Edgard Delvo pour son 90ème anniversaire
Parmi ces rares personnalités en Flandre : Edgard Delvo [1905-1999]. L'idée directrice, pour laquelle il a voué sa vie entière, est l'idée de justice sociale. À partir de cette idée, Delvo a toujours cherché à donner des fondements idéologiques solides à sa pensée et à son action. Il était essentiel pour lui de faire concorder doctrine et action. Toujours, Delvo est parti du réel, hic et nunc, et su que ce réel formait toujours l'ultime pierre angulaire sur laquelle reposait l'expérience personnelle, aussi riche soit-elle.
Au beau milieu de ce XXe siècle effervescent, cette option pour un réel toujours mouvant l'a contraint à arpenter des chemins très différents les uns des autres et à mener une existence des plus hasardeuses...
ENRACINEMENT SOCIALISTE
Edgard Delvo est né le 20 juin 1905 à Gand dans une famille d'ouvriers pauvres et socialistes. Son milieu familial le prédisposait donc à devenir, très jeune, un ouvrier, comme son père et son grand-père. Mais la nature l'a doté d'une intelligence assez vive. Avec l'aide d'une bourse pour élève doué, il peut aller au-delà de l'école primaire et, comme on le disait à l'époque, "faire ses moyennes". Plongé dès le foyer familial dans une ambiance socialiste, son enthousiasme pour cette idéologie ouvrière fut ravivé par l'homme de poigne, le génie du verbe, du socialisme gantois, Edouard Anseele. Plus tard, Delvo témoignera et dira que c'est surtout les dimensions humaines d'Anseele qui l'ont séduit et attiré. L'étape suivante dans l'évolution du jeune Delvo se déroule rapidement : au départ de ses prédispositions naturelles pour le travail intellectuel, Delvo, à partir de l'âge de 16 ans, approfondit ses connaissances du marxisme et devient un socialiste bien écolé et formé.
Après avoir obtenu son diplôme d'instituteur, il s'en va travailler dans "l'imprimerie populaire" (Volksdrukkerij), une entreprise appartenant au parti socialiste, qui fonctionnait pourtant pratiquement comme une pure entreprise capitaliste. Delvo s'est alors rapidement aperçu que bien que le socialisme se réclame de la doctrine marxiste (détruire le capitalisme par la lutte des classes et libérer le travailleur par le biais de la dictature du prolétariat), le socialisme belge, en pratique, visait la création, par la voie du réformisme, d'un capitalisme ouvrier, où les travailleurs seraient ipso facto transformés en de "petits bourgeois" de seconde zone. Il y avait donc une profonde césure entre la théorie socialiste et la pratique. Delvo en déduit immédiatement que les théories marxistes ne correspondent pas à la réalité sociale, comme il peut s'en apercevoir de visu dans sa propre entreprise socialiste.
Mais il est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions de ce constat. Le jeune homme Delvo doit encore accumuler de l'expérience. Mais la direction de la Volksdrukkerij lui donne rapidement l'occasion d'élargir ses horizons : il reçoit l'autorisation de suivre les cours de l'Université d'État de Gand à titre d'étudiant libre. Reconnaissant, Delvo, en autodidacte, acquiert un vaste savoir dans une quantité de sciences sociales et humaines, telles la psychologie, la pédagogie, la sociologie et aussi l'économie.
En même temps, Delvo s'engage à fond dans le mouvement de jeunesse socialiste. En toute connaissance de cause, il n'opte pas pour la Jonge Wacht (Jeune Garde), très inféodée au parti, mais pour la SAJ (Socialistische Arbeidersjeugd : Jeunesse Ouvrière Socialiste), qui s'inspirait davantage des Wandervögel allemands et prônait, dans ses programmes, une sphère indépendante de la jeunesse dans la société, l'épanouissement culturel de ses membres, un vécu communautaire socialiste et une sorte de retour à la nature.
UNE CENTRALE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
Delvo accumule du savoir à l'Université, son intelligence vive est rapidement remarquée par les dirigeants du parti : dès 1928, il occupe le poste de secrétaire flamand de la Centrale d'Éducation Ouvrière. C'est la première fois qu'un homme aussi jeune – 23 ans – est appelé à diriger l'écolage des cadres socialistes en Flandre. Une tâche dont Delvo s'acquittera parfaitement, au point d'être hissé au poste de Secrétaire général quatre ans plus tard.
Par son expérience quotidienne de la réalité sociale et en approfondissant sans cesse ses idées, Delvo finit par avoir des problèmes de conscience : la doctrine marxiste lui apparaît de moins en moins idoine à servir de fondement idéologique à ses sentiments et ses aspirations socialistes. Heureusement, il trouve un livre qui lui permet de sortir de cette impasse : Psychologie van het socialisme (traduit en français sous le titre d'Au-delà du marxisme), ouvrage publié en 1926 par Henri De Man. Ce livre lui ouvre des perspectives entièrement nouvelles : il remotive son engagement socialiste et étaye ses idées.
D'après De Man, le socialisme n'était rien d'autre que l'expression d'une idée éternelle de justice sociale, ancrée en l'homme, qui lui permettait d'agir selon sa propre conscience, en tant qu'être responsable, guidé par la raison, et de rechercher justement cette justice sociale. De cette façon, le socialisme apparaissait comme lié indissolublement à une vision humaniste globale. C'est la raison pour laquelle De Man a saisi la nécessité de dégager le socialisme de la doctrine marxiste et d'opposer au marxisme un socialisme à fondement éthique. Au lieu de considérer la question ouvrière et le socialisme comme des phénomènes déterminés par l'histoire et la matière, De Man et ses adeptes en viennent à la percevoir comme une problématique essentiellement d'ordre psychologique. Il ne s'agissait plus de réaliser l'émancipation ouvrière par le biais de la lutte des classes et de la dictature du prolétariat. Ni de reprendre à son compte les valeurs et la culture du monde bourgeois et capitaliste, comme le socialisme politique l'avait fait en pratique. Non : l'émancipation ouvrière devait être réalisée en donnant au travailleur une valeur propre, en créant pour lui un système de valeurs qui lui soit spécifique. Il s'agissait donc de faire advenir un nouveau type humain, qui n'aurait plus rien à voir avec les vertus bourgeoises, mais développerait ses propres valeurs et ses propres normes, une culture nouvelle, comme bases d'une société socialiste. Le socialisme ne visait donc pas la pure et simple matérialité (rôle du "socialisme-beafsteak"), mais se posait essentiellement comme un souci éthique, culturel et spirituel. Il ne s'agissait plus d'acquérir toujours davantage de biens matériels, mais de mettre au centre de l'éthique des travailleurs la joie au travail.
À la suite de leur vision humaniste intégrale et de leur désir de généraliser la justice sociale, leur souci socialiste ne pouvait plus se limiter à une seule classe sociale, mais devait nécessairement s'élargir à toute la réalité ambiante, où vivaient les hommes de chair et de sang : c'est-à-dire embrasser l'ensemble de la "communauté populaire". Dès qu'ils eurent opéré leur "renversement copernicien", De Man et Delvo, sur base de leur postulat d'élargissement, commencèrent à s'intéresser au nationalisme. Cela amena De Man à publier en 1931 une brochure, Nationalisme en Socialisme, où il accorde une valeur positive au "nationalisme de libération", concept que nous considérerions comme synonyme de notre "nationalisme populaire" (volksnationalisme). Mais contrairement à son maître-à-penser, Henri De Man, qui, ultérieurement, s'égarera dans les eaux du "nationalisme d'État" (staatsnationalisme), Delvo va approfondir ce concept au cours des années 30, ce qui le conduira à dire que tout sentiment socialiste véritable doit être indissolublement lié à une conscience nationale-populaire (et vice-versa). Sentiment socialiste et conscience nationale convergent tous deux vers un seul et unique but : la construction de la communauté populaire (volksgemeenschap).
PLANISME
Delvo est également devenu un protagoniste enthousiaste et convaincu du planisme de De Man. La vision planiste impliquait que toute la vie économique devait contribuer à un équilibre entre les besoins de la consommation et les capacités de production, où il fallait tabler et utiliser toute la créativité qui résidait en l'homme. Pour les planistes, cet équilibre et ce pari pour la créativité humaine n'étaient possibles que si l'on avançait une vision beaucoup plus nuancée de la propriété que les marxistes. Au lieu de nationaliser purement et simplement les moyens de production et la propriété, il fallait, disaient-ils, partir des diverses formes de propriété et voir si elles apportaient des avantages ou des inconvénients au peuple en tant que communauté. Sur base de ce tri, les planistes finirent par juger que les monopoles et les puissances d'argent devaient être freinées dans leurs initiatives et leur expansion, tandis que les initiatives privées qui donnaient des avantages au peuple devaient être stimulées. L'idéal consistait donc à construire une économie mixte avec secteurs nationalisé et privé. Mais il était essentiel, dans la vision planiste, que l'autorité et non la propriété soit transférée à l'État. Le contrôle de la gestion de la propriété a donc été considéré comme prioritaire par rapport à la possession de l'entreprise.
Pour réaliser un tel "Plan", il fallait, pensaient les planistes, réformer de fond en comble la démocratie, afin de dégager l'État de l'emprise des puissances d'argent et des groupes de pression. Pour accéder au stade de cette planification rationnelle, le système démocratique manquait d'une réelle direction, d'auto-discipline et surtout de responsabilité personnelle. Les planistes formulent une série de propositions, afin d'incorporer ces "vertus" dans le système démocratique et de rendre ainsi la démocratie plus forte. Le résultat aurait du être, pour De Man, Delvo et les planistes belges, le "socialisme démocratique". Bien entendu, les adversaires de ce planisme socialiste et démocratique n'ont pas hésité à accuser De Man et Delvo de plaider pour une "démocratie autoritaire". Ce reproche était injuste : les deux hommes sont restés des démocrates convaincus ; ils se reconnaissaient pleinement dans le principe des élections libres et du contrôle parlementaire, mais ils voulaient biffer les dysfonctionnement et les débordements du système, afin de le sauver et non pas de le torpiller définitivement.
En 1934, De Man et ses collaborateurs réussissent à mettre le parti socialiste officiellement sur la ligne du planisme et du "socialisme démocratique". Cela ne signifie pas, évidemment, que les instances du parti ont été convaincues de la justesse des thèses planistes au point de s'y convertir. Plus exactement, elles ont dû avouer leurs impuissance à résoudre la crises économiques des années 30 à l'aide des recettes marxistes, devenues au fil du temps, étrangères au monde et inefficaces. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti, l'opposition au projet planiste s'est rapidement organisée pour barrer la route à toute amorce de réalisation des idées de De Man et de Delvo. Les adversaires du planisme ont, en fin de compte, réussi à empêcher toute réforme graduelle et rationnelle de la démocratie belge.
VIF INTÉRÊT DES NATIONALISTES FLAMANDS
Vers la fin des années 30, certains nationalistes flamands commencent à manifester un vif intérêt pour les aspirations socialistes de De Man et de Delvo. Et ceux-ci commencent, pour leur part, à s'intéresser de plus près au nationalisme flamand. Une fraction des intellectuels nationalistes et une fraction des intellectuels socialistes se rapprochaient. À la tête des socialistes rénovateurs et d'esprit ouvert, Edgard Delvo. En 1939, il entre en contact avec le nationaliste flamand Viktor Leemans et avec le "national-solidariste" Joris Van Severen. Ces rencontres permettent à ces hommes venus d'horizons fort différents de constater qu'au fond ils sont très proches les uns des autres. Ils envisagent de fonder une revue, à laquelle ils collaboreraient tous et où ils confronteraient leurs points de vue dans un but constructif, mais la guerre éclate et ce projet ne peut pas se concrétiser.
Quand les Allemands entrent en Belgique le 10 mai 1940, le régime démocratique et la machine de propagande française suscite au sein de la population belge une psychose de terreur, en décrivant l'armée allemande comme une horde de barbares massacrant tout sur son passage, poussant des centaines de milliers de réfugiés sur les routes et les exposant aux risques de la guerre. Delvo prend cette propagande au mot et décide de combattre l'Allemagne et se présente comme volontaire, d'abord dans un bureau de recrutement de l'armée belge, puis de l'armée française. Mais Delvo ne rencontre que le chaos. Après l'effondrement des armées alliées, il s'aperçoit de la fausseté des propagandes belge et française, constate que les atrocités radiodiffusées ont été inventées de toutes pièces. Cette révélation le dégoûte des régimes démocratiques et il perd toute foi en eux.
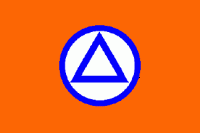 Delvo décide de réaliser ses aspirations socialistes-démocratiques dans le cadre de "l'Ordre Nouveau", plus précisément dans le giron du parti nationaliste flamand, le VNV [Vlaamsch Nationaal Verbond]. Deux éléments l'ont pousser à cette option. D'abord, ce fut Viktor Leemans qui le contacta en premier lieu à son retour de France. Plus fondamentalement, c'est un projet du VNV qui le séduit : celui de se transformer en un vaste mouvement d'unité flamande. Cette tentative de dépassement des étroits contingentements politiques de l'avant-guerre et de construction d'un vaste mouvement populaire surplombant les clivages politiciens en Flandre était, pour Delvo, l'occasion rêvée de concrétiser ses visions socialistes et nationales-populaires. Delvo est immédiatement introduit dans le "Conseil de Direction" du VNV, où il devient responsable de la formation des militants et membres, de l'école des cadres et de la propagande. Le fait que de telles responsabilités aient été déléguées à un dirigeant important du parti socialiste d'avant-guerre prouve que le VNV prenait effectivement cette opération au sérieux. Mais le projet de mouvement unitaire ne débouche pas sur les résultats escomptés. D'abord, la base, contrairement à la direction, ne souhaite pas dépasser aussi rapidement les clivages idéologiques d'avant-guerre et ne propose pas de nouvelle synthèse. Ensuite, les circonstances de la guerre n'autorisaient pas la réalisation d'un tel projet : les Allemands accordaient la priorité aux opérations de guerre, avant toutes autres considérations. En cas de nécessité, ils sacrifiaient d'abord les objectifs de nature idéologique.
Delvo décide de réaliser ses aspirations socialistes-démocratiques dans le cadre de "l'Ordre Nouveau", plus précisément dans le giron du parti nationaliste flamand, le VNV [Vlaamsch Nationaal Verbond]. Deux éléments l'ont pousser à cette option. D'abord, ce fut Viktor Leemans qui le contacta en premier lieu à son retour de France. Plus fondamentalement, c'est un projet du VNV qui le séduit : celui de se transformer en un vaste mouvement d'unité flamande. Cette tentative de dépassement des étroits contingentements politiques de l'avant-guerre et de construction d'un vaste mouvement populaire surplombant les clivages politiciens en Flandre était, pour Delvo, l'occasion rêvée de concrétiser ses visions socialistes et nationales-populaires. Delvo est immédiatement introduit dans le "Conseil de Direction" du VNV, où il devient responsable de la formation des militants et membres, de l'école des cadres et de la propagande. Le fait que de telles responsabilités aient été déléguées à un dirigeant important du parti socialiste d'avant-guerre prouve que le VNV prenait effectivement cette opération au sérieux. Mais le projet de mouvement unitaire ne débouche pas sur les résultats escomptés. D'abord, la base, contrairement à la direction, ne souhaite pas dépasser aussi rapidement les clivages idéologiques d'avant-guerre et ne propose pas de nouvelle synthèse. Ensuite, les circonstances de la guerre n'autorisaient pas la réalisation d'un tel projet : les Allemands accordaient la priorité aux opérations de guerre, avant toutes autres considérations. En cas de nécessité, ils sacrifiaient d'abord les objectifs de nature idéologique.
Cette réticence allemande a conduit Delvo à plaider en faveur d'une collaboration inconditionnelle avec l'Allemagne. Car, à ses yeux, à ce moment-là de la guerre, seule une victoire définitive du Reich national-socialiste permettrait aux Flamands de réaliser chez eux les aspirations socialistes et nationales-populaires, théorisées par Delvo. C'est en voulant joindre les actes à la parole que Delvo s'est présenté un jour comme volontaire pour combattre sur le Front russe, après l'entrée des troupes de Hitler en URSS. Mais Staf De Clercq, chef du VNV, a estimé que la présence de Delvo était plus utile en Flandre que dans les plaines de Russie : il a donc refusé l'engagement de Delvo et l'a obligé à rester au pays.
 En avril 1942, Delvo devient le chef de l'UTMI/UHGA (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels / Unie van Hand- en Geestesarbeiders), une organisation syndicale calquée sur le modèle du "Front du Travail" allemand et destinée à devenir un mouvement syndical unitaire en Belgique selon les modèles préconisés par "l'Ordre Nouveau". Delvo reçoit donc entre les mains un instrument potentiellement puissant, lui permettant de réaliser à terme ses objectifs socialistes et nationaux-populaires. La guerre l'oblige à se limiter et à n'ébaucher qu'idéellement la société qu'il appelait de ses vœux.
En avril 1942, Delvo devient le chef de l'UTMI/UHGA (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels / Unie van Hand- en Geestesarbeiders), une organisation syndicale calquée sur le modèle du "Front du Travail" allemand et destinée à devenir un mouvement syndical unitaire en Belgique selon les modèles préconisés par "l'Ordre Nouveau". Delvo reçoit donc entre les mains un instrument potentiellement puissant, lui permettant de réaliser à terme ses objectifs socialistes et nationaux-populaires. La guerre l'oblige à se limiter et à n'ébaucher qu'idéellement la société qu'il appelait de ses vœux.
Quand les dernières troupes allemandes évacuent la Belgique, Delvo se replie en Allemagne, bien décidé à s'engager jusqu'au bout pour ses idéaux. Il trouve tout de suite une place dans le gouvernement flamand en exil, le Vlaamse Landsleiding, où l'on tente, selon Delvo, de faire l'unité de toutes les tendances de la collaboration flamande encore prêtes à combattre aux côtés de l'Allemagne, dans l'espoir de réaliser leurs idées nationalistes, nationales-socialistes ou autres. Delvo devient le "plénipotentiaire" des Affaires Sociales et élabore un programme social, bien dans la ligne de ce qu'il avait suggéré dès le départ au VNV.
Après l'effondrement définitif du IIIe Reich, Delvo connaîtra des années fort sombres. En 1945, un tribunal militaire belge le condamne à mort par contumace. Sans cesse repéré et poursuivi, il n'avait plus qu'une solution : errer à travers l'Allemagne sous plusieurs fausses identités, séparé de sa femme et de ses enfants. Il exerça toutes sortes de petits boulots pour gagner maigrement sa vie. En 1965, il est frappé d'un infarctus, est dans l'incapacité de travailler et obligé de se livrer aux autorités allemandes. Mais comme il est persécuté pour des raisons politiques, les autorités allemandes le relâchent immédiatement et refusent de le livrer à la Belgique. En 1972, sa condamnation est ramenée à 20 ans de prison, si bien qu'il pourra rentrer au pays après 30 ans d'exil. En 1974, il est de retour en Flandre, mais sous le statut d'apatride.
Delvo a survécu à toutes ses années de misère, de difficultés matérielles, physiques et émotionnelles, parce qu'il a approfondi ses idées et ses réflexions, a lu, a continué à se former politiquement et philosophiquement. Le feu sacré qui brûlait dans le cœur du jeune militant socialiste de 1920 ne s'est finalement jamais éteint. Dès son retour, avec l'appui de la grande presse flamande (notamment le quotidien De Standaard), de la très sérieuse maison d'édition De Nederlandse Boekhandel, des milieux nationalistes de droite et de gauche (Voorpost, VUJO, etc.) et de l'hebdomadaire anversois 't Pallieterke, il tente une dernière fois d'éveiller l'intérêt des intellectuels flamands pour son socialisme populaire et national. Il publie coup sur coup trois ouvrages théoriques et autobiographiques. Delvo était convaincu, à son retour d'exil, que ses conceptions avaient gardé un certain degré d'actualité, tout en comprenant parfaitement que les circonstances avaient changé de fond en comble. Il est dès lors curieux de constater qu'un homme comme Delvo, qui a toujours mis l'accent sur la nécessité de bien coupler pensée et action et de se référer à la réalité actuelle, a limité ses ouvrages d'après-guerre à un regard rétrospectif sur l'histoire et ne nous a pas livré une analyse de la réalité nouvelle.
Mais Delvo, dans la seconde moitié des années 70 a été un conférencier fort demandé, surtout dans les milieux nationalistes flamands. Mais lorsque l'on relit aujourd'hui les textes de ces interviews et de ces conférences, on a le sentiment, un peu amer, que ce retour de Delvo dans le milieu nationaliste ou, du moins, chez les nationalistes qui avaient la volonté de suggérer un projet de société nouvelle, a finalement été peu fécond et que les formations nationalistes flamandes qui l'ont invité et écouté, n'ont pas mis à profit ses enseignements.
Cette année, E. Delvo a fêté son 90ème anniversaire. Il est devenu aveugle, mais son esprit est resté intact, toujours animé par ce formidable feu sacré. Il reste à l'écoute des grands débats par la radio, la télévision, des cassettes audio, des conversations, mais sa cécité l'empêche quand même de juger notre réalité trop changeante, trop effervescente, dans toutes ses nuances. La troisième Révolution industrielle a modifié en profondeur la société dans laquelle nous vivons. Par la diminution du temps de travail, par l'attention croissante que portent nos contemporains à leurs loisirs, par le changement des mentalités, le concept de "travail" a perdu bon nombre de ses significations d'antan. La mécanisation et la robotisation croissantes ont produit une nouvelle armée de chômeurs et une nouvelle société duale. Tout cela, et beaucoup d'autres choses encore, font que toute la problématique sociale doit être totalement repensée. Indubitablement, bon nombre d'idées, de méthodes et de structures que Delvo a analysées ont succombé aujourd'hui. Mais l'essentiel de la pensée de Delvo, c'est-à-dire sa volonté de lutter pour une véritable justice sociale et pour un ancrage du sentiment socialiste dans l'humus national, doit demeurer pour nous un leitmotiv. Dans notre travail de repenser la société, la question sociale et le statut de l'ouvrier, ce fil conducteur est indispensable pour aboutir à une NOUVELLE SYNTHÈSE.
► Peter Lemmens, Vouloir n° 126-128, 1995.
• In dienst der arbeidersopvoeding. Handboek voor medewerkers van de Opvoedingscentrale, Deurne, 1937, 244 p.
• De Belgische arbeidersbeweging. Geschiedkundige studie, Deurne, 1938, 47 p.
• Hedendaagsch humanistisch streven : democratisch socialisme en zijn beteekenis voor de BWP, Antwerpen, 1939, X-91 p.
• Arbeiders, mijn Kameraden! Ons geleidt de nieuwe tijd, Brussel, [1940], 31 p.
• Arbeid en arbeider in de volksche orde, Brugge, 1941, 42 p.
• Sociale collaboratie. Pleidooi voor een volksnationale sociale politiek, Antwerpen, 1975, 266 p.
• De mens wikt. Terugblik op een wisselvallig leven, Antwerpen, 1978, 189 p.
• Democratie in stormtij. Democratisch socialisme in de crisisjaren dertig, Antwerpen, 1983, 205 p.

 Militant socialiste depuis sa prime jeunesse, Edgard Delvo a été séduit par les thèses planistes de Henri De Man, a organisé les rencontres à Pontigny en France entre les planistes de l'Internationale, a dirigé la centrale d'éducation ouvrière à Bruxelles, a adhéré dans les années 30 à la politique de neutralité belge, s'est rangé dans le camp de la collaboration en 1940, y a tenté de réorganiser le syndicalisme belge dans une structure inspirée du Front du Travail allemand, l'UTMI (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), où confluaient socialisme, syndicalisme, coopératisme, planisme et nationalisme flamand. Condamné à mort en 1945, il vit trente ans d'exil en Allemagne et revient en 1975, il y a tout juste vingt ans, où la presse flamande lui réserve un accueil somme toute chaleureux. Depuis son retour d'Allemagne, Edgard Delvo a publié trois livres de mémoires et de réflexions. Pour son 90ème anniversaire, le 20 juin 1995, il a accordé à Robert Steuckers et à Peter Lemmens, un très long entretien pour Vouloir et Dietsland Europa (Anvers). Nous n'en publions qu'une fraction, qui concerne surtout ses plus jeunes années, moins évoquées dans ses mémoires.
Militant socialiste depuis sa prime jeunesse, Edgard Delvo a été séduit par les thèses planistes de Henri De Man, a organisé les rencontres à Pontigny en France entre les planistes de l'Internationale, a dirigé la centrale d'éducation ouvrière à Bruxelles, a adhéré dans les années 30 à la politique de neutralité belge, s'est rangé dans le camp de la collaboration en 1940, y a tenté de réorganiser le syndicalisme belge dans une structure inspirée du Front du Travail allemand, l'UTMI (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), où confluaient socialisme, syndicalisme, coopératisme, planisme et nationalisme flamand. Condamné à mort en 1945, il vit trente ans d'exil en Allemagne et revient en 1975, il y a tout juste vingt ans, où la presse flamande lui réserve un accueil somme toute chaleureux. Depuis son retour d'Allemagne, Edgard Delvo a publié trois livres de mémoires et de réflexions. Pour son 90ème anniversaire, le 20 juin 1995, il a accordé à Robert Steuckers et à Peter Lemmens, un très long entretien pour Vouloir et Dietsland Europa (Anvers). Nous n'en publions qu'une fraction, qui concerne surtout ses plus jeunes années, moins évoquées dans ses mémoires.
[Edgard Delvo en 1942, au moment où il prend la direction de l'UTMI]
• Monsieur Delvo, vous êtes consubstantiellement socialiste ; vous êtes né dans une famille socialiste, vous avez été totalement imbriqué dans la vie du mouvement socialiste jusqu'en 1945. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre famille et votre jeunesse ?
Je suis né à Gand le 20 juin 1905, dans une famille et un quartier ouvriers. Pour les gens de très modeste condition, c'était des temps difficiles : nos contemporains, et a fortiori les jeunes gens, ne s'imaginent plus combien pénibles étaient les circonstances de la vie quotidienne, même pour les bourgeois. La notion de "temps libre" n'existait pas : tout était orienté vers le labeur, vers les corvées de tous les jours. Impossible, dans un tel contexte, d'imaginer une forme ou une autre d'épanouissement ludique ou culturel. Mon père était un ouvrier métallurgiste, un ouvrier qualifié qui aimait son métier et y mettait tout son cœur. Il était certes mieux payé que les simples manœuvres, mais, comme tout le monde, il avait grand'peine à joindre les deux bouts. Mon grand-père, que j'ai bien connu, était une célébrité dans les cafés de Gand et des environs, non pas parce qu'il aimait trop la bière, mais parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent pour nourrir décemment sa ribambelle d'enfants. Il travaillait dix heures par jour et, le soir, il vendait encore de la sciure de bois et du sable pour répandre sur le sol des auberges et des bistrots. Mon père était l'ainé d'une famille de six enfants : sa qualité d'aîné lui donnait quelques privilèges ; c'est sur lui que se fondaient les espoirs de la famille. Le principal de ces privilèges était de recevoir une tartine complémentaire après le coucher. Ensuite, il a reçu l'autorisation d'apprendre à lire, alors que l'obligation scolaire n'existait pas encore dans le Royaume de Belgique, et que mon grand-père était analphabète.
Savoir lire donnait des avantages énormes : on pouvait apprendre rapidement, on pouvait lire les journaux, à cette époque où il n'y avait ni radio ni télévision. La seule distraction que s'accordait les gens était de jouer au lotto à la lumière d'une chandelle : mais de telles récréations étaient exceptionnelles, un luxe rare . Mon père a été un homme heureux, il était fier de ses talents. Il avait une conscience socialiste, tout comme mon grand-père. Ils avaient abandonné l'église. Mon grand-père avait été profondément choqué par l'anti-socialisme et l'anti-syndicalisme de son curé, qui refusait de prendre en compte la misère ouvrière. Cette arrogance avait fait naître un sentiment d'aigreur profonde dans les familles ouvrières : « nous ne valons rien aux yeux des curés ». Pourtant, mon père était fier de son travail : il façonnait des moules en argile pour couler des pièces. Il m'amenait le dimanche pour voir son œuvre et il me communiquait sa fierté. Pour nous le travail bien fait était une valeur inestimable et nous ne comprenions pas pourquoi les gens d'église le méprisaient. Mon père pourtant ne cultivait pas de ressentiment et n'était certainement pas un fanatique de la lutte des classes : quand il y avait une grève, il se retirait à la maison et élaborait des plans pour de nouveaux moules.
À 12 ans, j'ai pu fréquenter l'« école moyenne », alors qu'il n'y avait toujours pas d'obligation scolaire. J'emmagasinais facilement les matières, je travaillais bien, mais je n'oubliais pas non plus que j'étais un enfant de la rue, un enfant qui avait grandi au sein d'une communauté de voisins, solidaires et chaleureux. Malgré la misère ambiante, j'ai vécu une enfance insouciante. Mes parents, qui étaient doux et bienveillants, m'avaient accordé ce qu'ils n'avaient pas eu, eux : du "temps libre". Mais leur tolérance avait des limites fixées à l'avance : il fallait toujours que nous gardions une attitude digne. Paradoxalement, ces socialistes avaient quitté l'église mais vivaient toujours selon les canons de la charité chrétienne. Ils refusaient simplement, mais absolument, la hiérarchie catholique. Pour eux, l'église était l'ennemie du peuple, elle choisissait toujours le camps des nantis et des puissants. Mes parents n'étaient pas actifs dans le mouvement socialiste, mais lisaient le journal socialiste de Gand, Vooruit (« En avant », équivalent flamand du journal social-démocrate allemand Vorwärts). C'est ainsi qu'ils se tenaient au courant des événements du monde. L'idéologie de Vooruit était marxiste mais modérée, déjà réformiste. Mais les querelles idéologiques importaient peu : Vooruit avait le mérite de donner toute sa place au socialisme spontané du peuple.
Quand les voisins me demandaient ce que je voulais devenir plus tard, quand j'aurai quitté l'école, je répondais que je voulais devenir instituteur, maître d'école. Je le disais parce que c'était la profession que les gens de mon quartier m'attribuaient d'office : « tu es malin, tu deviendras instituteur ». Je fus un des rares fils d'ouvrier à pouvoir accéder en quatrième ; le directeur, un francolâtre fanatique qui haïssait tout ce qui était populaire et flamand, m'y avait accepté à contrecœur. Cet extrémiste inventait mille chicanes pour les élèves flamands de condition modeste. J'ai donc conservé un mauvais souvenir de cette école, que je fréquentais grâce à une bourse. Mais j'ai tenu bon et j'ai fait ma cinquième et ma sixième ; c'était au début de la Première Guerre mondiale, les temps étaient très difficiles. Nous étions à l'arrière du front allemand, en zone militaire et nous ne pouvions pas nous rendre à Bruxelles. Mes parents ne pouvaient plus me payer des chaussures : il a bien fallu que j'aille à l'école en sabots de bois, de beaux petits sabots qu'on m'avait décorés avec amour. J'étais gêné. Mon francolâtre de directeur m'a fait une vie : il ne voulait pas que les élèves viennent en sabots à l'école. Ce fut un prétexte pour démontrer bruyamment son arrogance de classe. Cet incident m'a appris une chose : pour l'ouvrier, ce n'est pas l'argent qu'il gagne qui est important, c'est que l'on respecte sa dignité.
J'ai donc eu de bons parents, qui m'ont éduqué dans la douceur, avec souci de l'avenir, malgré les difficultés. Ils m'ont laissé beaucoup de liberté, à condition que je ne suscite pas de plaintes, que j'aie un comportement exemplaire. Ils m'ont aussi transmis le sens de la communauté. À l'école moyenne, j'étais le condisciple d'un fils de fabricant de liqueur assez aisé, qui recevait des jouets merveilleux, notamment un coffret pour faire de la chimie amusante. Ce garçon ne pouvait pas nous fréquenter, son père le lui interdisait : il restait seul dans un coin avec ses éprouvettes, alors qu'il aurait bien donné tous ses jouets pour partir en randonnée avec nous. L'esprit de communauté est donc supérieur à l'individualisme bourgeois et à l'arrogance de classe : un grande leçon de mon enfance.
• Comment s'est passé pour vous la Première Guerre mondiale ?
À Gand, nous étions à l'arrière immédiat du front, dans ce que les Allemands appelaient l'Etappengebiet. Pour survivre, il ne nous restait plus que la débrouille, le marché noir, ramasser des escarbilles de charbons, retourner au troc. La Croix-Rouge américaine et le Plan Hoover permettaient aux enfants pauvres de recevoir le matin du cacao et un petit pain, et le midi, une soupe avec du lard, que l'on nous servait dans les bâtiments du théâtre.
Nous avons vu passé les uhlans dans notre quartier. Plus tard, des prisonniers russes étaient contraints à des travaux de terrassement pour le Canal Gand-Terneuzen. Nous échangions des denrées avec ces prisonniers et nous les réconfortions. Le plus mauvais souvenir de la guerre a été les réquisitions. Les Allemands ne réquisitionnaient pas les hommes qui avaient du travail. Mais les gens ne le savaient pas. La police gantoise venait demander si on travaillait, les gens ne disaient rien, croyant qu'on allait imposer leurs maigres revenus. Bon nombre de réquisitions se sont effectuées sur de tels quiproquos. Nous avons été frappés par la terrible discipline qui régnait dans l'armée allemande : les officiers giflaient ou bastonnaient leurs soldats en public quand ils avaient commis des pécadilles.
• Quand êtes-vous devenu un militant socialiste ?
C'est venu tout seul. Quand j'étais à l'« école normale » pour devenir instituteur, un professeur de néerlandais lisait Multatuli, la littérature pacifiste. C'était un socialiste. Il est venu chez moi pour me proposer de devenir correcteur dans l'imprimerie socialiste qui s'était réorganisée et entendait devenir une entreprise commerciale comme les autres, en ne se limitant plus à imprimer des tracts ou des pamphlets socialistes. J'ai d'abord refusé car je voulais achever mes études. Plus tard, j'y suis allé et je suis devenu automatiquement membre du parti : cela allait de soi ; on travaillait dans une entreprise socialiste, on était donc militant socialiste. La politique de commercialisation m'a d'abord séduit parce que l'atmosphère n'était pas politisée à outrance. Ce fut pour moi, à 16 ans, l'occasion de lire des livres plus sérieux et de me pencher sur l'idéologie socialiste. J'ai lu Marx, non pas pour adhérer à un catéchisme, mais pour prendre le pouls du socialisme à un moment de son histoire. Je n'en suis pas resté à Marx. J'ai voulu connaître le socialisme dans toutes ses moutures, même avant qu'il ne porte le nom de "socialisme" : chez les premiers chrétiens, chez les socialistes utopiques, chez les Indiens d'Amérique. J'ai voulu tout connaître de l'esprit de charité, de justice.
Les typographes étaient des ouvriers, mais ils étaient lettrés. Ils savaient communiquer le fruit de leurs lectures. Dans l'imprimerie socialiste, j'ai appris aussi à vivre dans un mouvement politique qui prévoyait toute une série de structures d'accueil pour ses membres et sympathisants. Les jeunes avaient le choix : ou bien militer à la Jonge Wacht (JW = Jeune Garde) ou bien adhérer à la Socialistische Arbeiderjeugd (SAJ = Jeunesse ouvrière socialiste). Ces deux structures étaient bien différentes l'une de l'autre. Dans la JW se regroupaient les activistes, toujours présents dans les meetings et dans les bistrots, où ils fumaient et buvaient comme les adultes. Les garçons de la SAJ voulaient quitter cette ambiance et retourner à la nature, camper, organiser des randonnées à pied ou à bicyclette. Les JW fréquentaient les dancings. Les SAJ remettaient les vieilles danses populaires à l'honneur. La jeunesse socialiste était donc séparée par deux esprits bien différents. Les SAJ, dont j'étais, avaient un esprit Wandervogel, c'étaient des amis de la nature ; ils voulaient réintégrer l'homme dans la nature. Nous avions l'impression d'aller plus loin, plus en profondeur. Bon nombre de garçons de la JW voulaient d'emblée faire une carrière politique. Les SAJ n'avaient pas cette préoccupation.
Petit à petit, l'imprimerie populaire (Volksdrukkerij) est devenue une entreprise purement capitaliste. La solidarité entre les membres du personnel s'est d'abord estompée puis a disparu. Les linotypistes se sentaient supérieurs aux typographes, qui estimaient valoir plus que les relieurs, qui, eux, n'adressaient pas la parole aux femmes de ménage.
Je suis ensuite devenu le chef de la SAJ de Gand. C'est à ce titre que j'ai rencontré pour la première fois Édouard Anseele (père), dit "Eedje Anseele", un tribun socialiste fort populaire, qui avait le sens de la communauté et qui cherchait de jeunes idéalistes, notamment dans les rangs des SAJ pour remplir de nouvelles fonctions dans le parti. Il m'a demandé si je connaissais la "coopérative". J'avais lu beaucoup de livres et d'articles sur les coopératives, notamment un ouvrage important pour toute mon évolution future, La République coopérative du Français Ernest Poisson. Édouard Anseele voulait que je dirige une revue d'esprit "coopérativiste". Son objectif était de relancer le mouvement coopératif afin de concurrencer le secteur capitaliste en offrant des marchandises à meilleur prix, en sautant au-dessus du maximum d'intermédiaires, notamment en affrétant une flotte marchande "rouge". Mais comme le parti, à cette époque, était encore belge-unitaire, le projet coopératif n'a pas trop bien marché, car, rapidement, un clivage a surgi entre Wallons et Flamands. Les Wallons ont refusé l'orientation "coopérativiste", au profit d'un syndicalisme plus anarchisant, de l'action directe, de la syndicalisation extrême et des grèves dures. Les Flamands, notamment les Gantois, rêvaient de la "République coopérative" d'Ernest Poisson.

[Édouard Anseele, père, dit « Eedje », figure de proue du socialisme gantois, héros du jeune Delvo et toujours au panthéon du socialisme belge. Un homme de cœur et de poigne, très près du peuple. Un socialisme de combat qui se sentirait sûrement très mal à l'aise parmi ceux qui se revendiquent aujourd'hui du « socialisme », tout en trafiquant avec des réseaux mafieux.]
J'ai toujours admiré Édouard Anseele (le père) car c'était un homme qui avait le sens de la décision, c'était un chef populaire, charismatique, incontesté. Ce leader populaire bénéficiait de la ferveur de son peuple. Son enterrement atteste cette dévotion des petites gens de sa ville. À la suite des conseils d'Anseele, j'ai voulu créer une culture nouvelle, solidaire et socialiste, bien organisée et bien insinuée dans le tissu social. Gand était le modèle de ce socialisme où toutes les branches du mouvement socialiste coopéraient en synergie. À Anvers, la fédération ne travaillait pas de la même façon : au contraire on contingentait, le plus hermétiquement possible, les différentes instances du mouvement socialiste. Beaucoup de Gantois ont animé le mouvement socialiste avec succès, même en dehors de leur ville et dans les hautes sphères du parti. Anvers n'a pas donné de leader charismatique au mouvement socialiste belge et flamand. Huysmans et De Man, tous deux Anversois, n'ont pas réussi a capté la ferveur des masses socialistes. De Man était animé de très bonnes intentions, comprenait quels étaient les ratés du parti, mais il est toujours demeuré un solitaire qui communiquait difficilement avec les petites gens. J'ai assisté à la réconciliation entre De Man et Anseele, mes deux héros, l'un sur le terrain, l'autre dans le monde sublime des théories.
• Comment avez-vous vécu l'immédiat après-guerre ?
En dépit de mon évolution future vers le nationalisme, le croquemitaine, pour moi, c'était le malheureux Borms, incarcéré pour collaboration en 1919. Bien entendu, nous ne le connaissions pas. Nous croyions ce que disait de lui la propagande de l'État belge. Notre mouvement socialiste suivait à la lettre la "Trêve du Havre", où le gouvernement belge réfugié en Normandie avait accepté pour la première fois en son sein des ministres socialistes, qui n'avaient peut-être pas reçu de portefeuille mais à qui on avait promis d'accorder le suffrage universel. Ce qui fut fait.
• Quand avez-vous rencontré De Man pour la première fois ?
De Man n'était pas né dans un milieu ouvrier comme moi. C'était un bourgeois d'Anvers. Dans notre mouvement, cette origine lui a causé des problèmes, pour une raison fort simple, qu'on comprend assez difficilement aujourd'hui : les ouvriers vivaient dans la nécessité, dans une nécessité extrême, et étaient prêts à suivre tous ceux qui leur promettaient ce qu'ils attendaient. Les bourgeois, eux, pouvaient se permettre d'avoir des principes, dégagés des affres de la nécessité. Les livres de De Man ont participé au renouveau du socialisme, mais, au départ, nous les lisions presque en cachette dans nos groupes de la SAJ. Sa réputation était mauvaise : il ne cessait de dire que le parti ne faisait rien d'essentiel pour le peuple, ce qui ne faisait évidemment pas plaisir aux gars qui trimaient sur le terrain. Pour De Man, la misère des ouvriers n'était pas seulement matérielle mais aussi culturelle ; en affirmant cette vérité, il se distanciait automatiquement du marxisme, alors qu'il se désignait encore comme marxiste. Un jour, pourtant, la fédération gantoise avaient restauré des orgues pour offrir des soirées musicales aux ouvriers : De Man a critiqué cette initiative, au grand mécontentement des militants, qui avaient cotisé et collecté. Coupé du peuple, De Man n'évoquait qu'une culture purement intellectuelle, où les orgues ne trouvaient pas leur place. En dépit de ces travers bien humains, De Man m'a énormément appris. Ses ouvrages étaient fascinants, tant ils modernisaient notre vision socialiste de la politique et de l'économie.
Quand je l'ai vu pour la première fois, en 1930, j'étais déjà secrétaire de la Centrale d'Éducation Ouvrière. Je l'ai invité à Bruxelles pour prononcer une conférence, à la tribune où étaient également venus Norman Angel, Harold Laski, Pietro Nenni, le Suisse Lucien Dubreuil et les Français Gaston Bergery, Lucien Laurat et Francis Delaisi. De Man est venu nous parler « du socialisme et du nationalisme ». Son analyse était très pertinente : il distinguait le socialisme du marxisme et le nationalisme agressif du nationalisme défensif. Une idée a commencé à germer en moi : l'idéal à atteindre c'était l'unité du peuple tout entier, organisateur d'un appareil étatique.
Plus tard, De Man est venu à Gand. Je l'ai accompagné dans le train. Mais, sur place, nos militants l'ont boudé. Néanmoins, j'ai pu avoir une première longue conversation avec l'inventeur du planisme. De Man refusait la pensée en termes de systèmes. Il évoquait l'homme réel, avec ses défauts et ses qualités. Il parlait de l'« être » et du « devenir » et optait bien entendu pour le deuxième de ces termes : nous, militants socialistes, activistes politiques, étions des hommes « en chemin », vers un but. Cette idée de devenir lui permettait de dire que Marx avait été le théoricien du « socialisme qui avait été » : la loi du devenir postulait que l'on évolue, que l'on adapte l'idée aux impératifs du temps. L'humanisme véritable ne consistait pas à répéter une doctrine figée mais à se mouler dans les méandres du devenir et des mutations sociales. À la suite de ces conversations et de mes lectures, j'ai expliqué la teneur de son Plan à nos militants. Même si cette matière est ardue, d'une haute densité philosophique, nos militants ont compris intuitivement que le Plan, théorisé par De Man, recélait des potentialités immenses pour la classe ouvrière et qu'il n'était pas de la démagogie.
► Propos recueillis par Robert Steuckers, Vouloir n° 126-128, 1995.

LE PLANISME DE PONTIGNY

Edgard Delvo, au centre, en 1934, en tant que secrétaire général de la « Centrale d'Éducation Ouvrière » à Bruxelles devant la « Maison du Peuple ». Quelques mois plus tard, il travaillera à l'organisation des journées de Pontigny, où participèrent les néo-socialistes français, dont Marcel Déat. Ces journées visaient à généraliser le planisme comme idéologie alternative au capitalisme et au bolchevisme.
Les partisans d'une économie dirigée, comme celle définie dans les "thèses de Pontigny", considéraient que la doctrine classique de la démocratie bourgeoise était dépassée. Ils s'étaient faits les protagonistes d'une conception modifiée de la séparation des pouvoirs : avant toute chose, il fallait rendre possible un gouvernement efficace et responsabiliser les hommes de ce gouvernement. L'idée directrice était que l'exécutif devait pouvoir diriger et que les corps représentatifs au sein de l'État puissent être agencés de façon à pouvoir exercer un contrôle efficace de la gestion gouvernementale. Ensuite, il fallait que ce système politique puisse assumer une mission plus importante dans le domaine économique, les corps représentatifs, fondés sur l'exercice du droit de gestion, devaient faire valoir leur droit à la parole et au contrôle, mais sans plus. Le droit de gestion et de gouvernement découlerait automatiquement du transfert du pouvoir : transfert du pouvoir par l'exécutif, transfert du contrôle par la représentation des intérêts corporatifs.
L'intervention chirurgicale, que réclamaient les planistes dans les structures économiques, devait les mener à une mission de plus vaste ampleur que la simple défense d'une démocratie malade. C'était justement ce projet de guérison du système de gouvernement parlementaire qui impliquait une série de mesures que les partis, dans pratiquement tous les États capitalistes, considéraient comme trop autoritaires. Dans ces circonstances, toute tentative de lancer une politique pianiste conséquente, était d'avance vouée à l'échec.
Dans les années 30, tous les États démocratiques occidentaux étaient sur la pente descendante. Plus personne ne pensait qu'ils allaient tout à coup être en mesure de résoudre la crise. Certes, la crise a été surmontée, mais seulement après qu'ait éclaté la Seconde Guerre mondiale : à partir de ce moment, les usines ont tourné à fond... pour parfaire une œuvre de destruction Toutes les fabriques manquaient de main-d'œuvre. Mais le prix de cette solution-là à la crise n'était-il pas trop élevé ? Du travail pour tous... parce qu'il y a eu 25 millions de morts...
► Edgard DELVO (ex. : Democratie in stormtij, DNB, 1983).

La gauche et la collaboration en Belgique :
De Man, les syndicats et le Front du Travail
 La collaboration de gauche en Belgique ? Elle prend son envol avec le manifeste que Henri De Man, chef de file du Parti Ouvrier Belge (POB), publie et diffuse dès le 28 juin 1940. De Man (1885-1953) a été agitateur socialiste dès l'âge de 17 ans, polyglotte, correspondant en Belgique de la social-démocratie allemande et des travaillistes britanniques avant 1914, volontaire de guerre, diplomate au service du Roi Albert Ier, professeur à Francfort avant le nazisme, initiateur du mouvement planiste en Europe dans les années 30, ministre, président du POB ; avec une telle biographie, il a été sans conteste l'une des figures les plus marquantes du socialisme marxiste européen. Hérétique du marxisme, sa vision du socialisme n'est pas matérialiste, elle repose sur les mobiles psychologiques des masses frustrées, aspirant à la dignité. Le socialisme, dans ce sens, est une formidable revendication d'ordre éthique. Ascète, sportif, De Man, issu de la bonne bourgeoisie anversoise, n'a jamais aimé le luxe. Le socialisme, déduit-il de cette option personnelle, ne doit pas embourgeoiser les masses mais leur apporter le nécessaire et les rendre spartiates.
La collaboration de gauche en Belgique ? Elle prend son envol avec le manifeste que Henri De Man, chef de file du Parti Ouvrier Belge (POB), publie et diffuse dès le 28 juin 1940. De Man (1885-1953) a été agitateur socialiste dès l'âge de 17 ans, polyglotte, correspondant en Belgique de la social-démocratie allemande et des travaillistes britanniques avant 1914, volontaire de guerre, diplomate au service du Roi Albert Ier, professeur à Francfort avant le nazisme, initiateur du mouvement planiste en Europe dans les années 30, ministre, président du POB ; avec une telle biographie, il a été sans conteste l'une des figures les plus marquantes du socialisme marxiste européen. Hérétique du marxisme, sa vision du socialisme n'est pas matérialiste, elle repose sur les mobiles psychologiques des masses frustrées, aspirant à la dignité. Le socialisme, dans ce sens, est une formidable revendication d'ordre éthique. Ascète, sportif, De Man, issu de la bonne bourgeoisie anversoise, n'a jamais aimé le luxe. Le socialisme, déduit-il de cette option personnelle, ne doit pas embourgeoiser les masses mais leur apporter le nécessaire et les rendre spartiates.
[De Man (debout) avec Emile Vandervelde avant la guerre]
Avec son fameux Plan du Travail de Noël 1933, De Man donne au socialisme une impulsion volontariste et morale qui séduira les masses, les détournera du communisme et du fascisme. Les intellectuels contestataires français, ceux que Loubet del Bayle a nommé les "non-conformistes des années 30", s'enthousiasmeront pour le Plan et pour ses implications éthiques. Pour l'équipe d'Esprit (regroupée autour d'Emmanuel Mounier), d'Ordre Nouveau (Robert Aron et A. Dandieu), de Lutte des Jeunes (Bertrand de Jouvenel), de L'Homme Nouveau (Roditi), De Man devient une sorte de prophète. Côté socialiste, en France, ce sera surtout le groupe "Révolution Constructive" (avec Georges Lefranc, Robert Marjolin, etc.) qui se fera la caisse de résonnance des idées de Henri De Man. Pierre Ganivet, alias Achille Dauphin-Meunier, adopte également le planisme demanien dans sa revue syndicaliste révolutionnaire L'Homme réel. Au sein du parti, Léon Blum craint le Plan du Travail :
- parce qu'il risque de diviser le parti ;
- parce qu'il implique une économie mixte et tend à préserver voire à consolider le secteur libre de l'économie ;
- parce qu'il crée une sorte de "régime intermédiaire" entre le capitalisme et le socialisme ;
- parce que la critique du parlementarisme, implicite chez De Man, rapproche son socialisme du fascisme.
Pour Déat, les idées planistes, exposées notamment par De Man à l'Abbaye de Pontigny (septembre 1934), reflètent un pragmatisme de la liberté, une approche de l'économie et de la société proche du New Deal de Roosevelt, et ne relèvent nullement du vieux réformise social-démocrate. Le planisme, avait affirmé Déat dans L'Homme Nouveau (n°6, juin 1934), n'impliquait aucune politique de compromis ou de compromissions car il était essentiellement révolutionnaire : il voulait agir sur les structures et les institutions et les modifier de fond en comble.
Presqu'au même moment, se tenait un Congrès socialiste à Toulouse : la plupart des mandats de "Révolution Constructive" s'alignent sur les propositions de Blum, sauf deux délégués, parmi lesquels Georges Soulès, alias Raymond Abellio, représentant le département de la Drôme. Georges Valois, proudhonien un moment proche de l'AF, est hostile à De Man, sans doute pour des motifs personnels, mais accentue, par ses publications, l'impact du courant para-planiste ou dirigiste en France.
Or, à cette époque, pour bouleverser les institutions, pour jouer sur les "structures", pour parfaire un plan, de quelque nature qu'il soit, il faut un pouvoir autoritaire. Il faut inaugurer l'« ère des directeurs ». Pratique "directoriale", planification, etc. ne sont guère possible dans un régime parlementaire où tout est soumis à discussion. Les socialistes éthiques, ascètes et spartiates, anti-bourgeois et combatifs, méprisaient souverainement les parlottes parlementaires qui ne résolvaient rien, n'arrachaient pas à la misère les familles ouvrières frappées par le chômage et la récession. Dans son terrible livre, La Cohue de 40, Léon Degrelle croque avec la férocité qu'on lui connaît, un portrait du socialisme belge en déliquescence et de De Man, surplombant cet aréopage de « vieux lendores adipeux, aux visages brouillés, pareils à des tartes aux abricots qui ont trop coulé dans la vitrine » (p. 175). De Man, et les plus jeunes militants et intellectuels du parti, avaient pedu la foi dans la religion démocratique.
Dès le déclenchement des hostilités, en septembre 1939, De Man opte personnellement contre la guerre, pour la neutralité absolue de la Belgique, proclamée par le Roi dès octobre 1936. Fin 1939, avec l'appui de quelques jeunes militants flamands, dont Edgard Delvo, il fonde une revue, Leiding (Direction), ouvertement orientée vers les conceptions totalitaires de l'époque, dit Degrelle. Il serait peut-être plus juste de dire que le socialisme planiste y devenait plus intransigeant et voulait unir, sans plus perdre de temps, les citoyens lassés du parlementarisme en un front uni, rassemblé derrière la personne du Roi Léopold III.
Après l'effondrement de mai-juin 1940, De Man publie un « manifeste aux membres du POB », où figurent deux phrases qui lui ont été reprochées : « Pour les classes laborieuses et pour le socialisme, cet effondrement d'un monde décrépit, loin d'être un désastre, est une délivrance » ; « [le verdict de la guerre] est clair. Il condamne les régimes où les discours remplacent les actes, où les responsabilités s'éparpillent dans le bavardage des assemblées, où le slogan de la liberté individuelle sert d'oreiller à l'égoïsme conservateur. Il appelle une époque où une élite, préférant la vie dangereuse et rapide à la vie facile et lente, et cherchant la responsabilité au lieu de la fuir, bâtira un monde nouveau ». Ces phrases tonifiantes, aux mâles accents, étaient suivies d'un appel à construire le socialisme dans un cadre nouveau. Cet appel a été entendu.
De toutes pièces, De Man commence par créer un syndicat unique, l'UTMI (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), officiellement constitué le 22 novembre 1940, après d'âpres discussions avec le représentant du Front du Travail allemand, le Dr. Voss. De Man, ami du Roi, voulait sauvegarder l'unité belge : son syndicat serait dès lors unitaire, ne serait pas scindé en une aile flamande et une aile wallonne. Le Dr. Voss, visant l'éclatement du cadre belge en deux entités plus facilement absorbables par le Reich, impose la présence des nationalistes flamands du VNV dans le comité central composé de socialistes, de démocrates-chrétiens, de syndicalistes libéraux. Edgard Delvo, ancien socialiste, auteur d'un ouvrage préfacé par De Man et paru à Anvers en 1939, collaborateur de Leiding, la revue neutraliste hostile à toute participation belge aux côtés des Anglais et des Français, théoricien d'un "socialisme démocratique" ou plutôt d'un populisme socialiste, est l'homme du VNV au sein de ce comité.
En 1942, poussé par les services du Front du Travail allemand, Delvo deviendra le maître absolu de l'UTMI. Ce coup de force des nationalistes provoque la rupture entre De Man et son syndicat : l'ancien chef du POB quitte Bruxelles et se réfugie en Haute-Savoie, grâce à l'aide d'Otto Abetz. Il sera désormais un "cavalier seul". Les socialistes, les libéraux et les jocistes quittent l'UTMI en 1942, laissant à Delvo les effectifs nationalistes flamands et wallons, peu nombreux mais très résolus.
En Wallonie, dès la parution du Manifeste du 28 juin 1940, plusieurs journalistes socialistes deviennent du jour au lendemain des zélotes enragés de la collaboration. Ainsi, Le Journal de Charleroi, organe socialiste bon teint depuis des décennies, était édité par une société dont l'aristocratique famille Bufquin des Essarts étaient largement propriétaire. Dès les premiers jours de juin 40, un rédacteur du journal, J. Spilette s'empare du journal et le fait paraître dès le 6, avant même d'avoir créé une nouvelle société, ce qu'il fera le 8. En novembre 1940, Spilette, avançant ses pions sans sourciller, s'était emparé de toute la petite presse de la province du Hainaut et augmentait les ventes. Els De Bens, une germaniste spécialisée dans l'histoire de la presse belge sous l'occupation, écrit que l'influence de De Man était prépondérante dans le journal.
Spilette défendait, envers et contre les injonctions des autorités allemandes, les positions de De Man : syndicat unique, augmentation des salaires, etc. Spilette baptisait « national-socialisme » la forme néo-demaniste de socialisme qu'il affichait dans son quotidien. Ensuite, rompant avec De Man, Spilette et ses collaborateurs passent, non pas à la collaboration modérée ou à la collaboration rexiste/degrellienne, mais à la collaboration maximaliste, regroupée dans une association au nom évocateur : l'AGRA, soit Amis du Grand Reich Allemand. L'AGRA, dont le recrutement était essentiellement composé de gens de gauche, s'opposait au rexisme de Degrelle, marqué par un héritage catholique. Les 2 formations finiront par s'entendre en coordonnant leurs efforts pour recruter des hommes pour le NSKK. Le 18 octobre 1941, Le Journal de Charleroi fait de la surenchère : il publie un manifeste corsé, celui du Mouvement National-Socialiste wallon, où il est question de créer un « État raciste » wallon. Spilette appelle ses concitoyens à rejoindre cette formation « authentiquement socialiste ».
À Liège, le quotidien La Légia, après avoir été dirigé par des citoyens allemands, tombe entre les mains de Pierre Hubermont, écrivain, lauréat d'un prix de "littérature prolétarienne" à Paris en 1931, pour son roman Treize hommes dans la mine. Les Allemands ou Belges de langue ou de souche allemandes, actionnaires de la société ou rédacteurs du journal, entendaient germaniser totalement le quotidien. Pierre Hubermont entend, lui, défendre un enracinement wallon, socialiste et modérément germanophile. Cette option, il la défendra dans une série de journaux culturels à plus petit tirage, édités par la Communauté Culturelle Wallonne (CCW).
Parmi ces journaux, La Wallonie, revue culturelle de bon niveau. Dans ses éditoriaux, Hubermont jette les bases idéologiques d'une collaboration germano-wallonne : défense de l'originalité wallonne, rappel du passé millénaire commun entre Wallons et Allemands, critique de la politique française visant, depuis Richelieu, à annexer la rive gauche du Rhin, défense de l'UTMI et de ses spécificités syndicales.
Fin 1943, les services de la SS envoient un certain Dr. Sommer en Wallonie pour mettre sur pied des structures censées dépasser le maximalisme de l'AGRA. Parmi elles : la Deutsch-Wallonische Arbeitsgemeinschaft, en abrégé DEWAG, dirigée par un certain Ernest Ernaelsteen. Ce sera un échec. Malgré l'appui financier de la SS, DEWAG tentera de se donner une base en noyautant les "cercles wallons" de R. De Moor (AGRA), foyers de détente des ouvriers wallons en Allemagne, et les "maisons wallonnes", dirigée par Paul Garain, président de l'UTMI wallonne, qui pactisera avec Rex.
Quelles conclusion tirer de ce bref sommaire de la "collaboration de gauche" ? Quelles ont pu être les motivations de ces hommes, et plus particulièrement de De Man, de Delvo et d'Hubermont (de son vrai nom Joseph Jumeau) ? La réponse se trouve dans un mémoire rédigé par la sœur d'Hubermont, A. Jumeau, pour demander sa libération. Mlle Jumeau analyse les motivations de son frère, demeuré toujours socialiste dans l'âme.
« Une cause pour laquelle mon frère restait fanatiquement attaché, en dehors des questions d'humanisme, était celle de l'Europe. Il était d'ailleurs Européen dans la mesure où il était humaniste, considérant l'Europe comme la Patrie de l'humanisme (...) Cette cause européenne avait été celle du socialisme depuis ses débuts. L'internationalisme du XIXe siècle n'était-il pas surtout européen et pro-germanique ? L'expérience de 1914-1918 n'avait pas guéri les partis socialistes de leur germanophilie (...). ... la direction du parti socialiste était pro-allemande. Et, au moment de l'occupation de la Ruhr,..., [mon frère] a dû aligner son opinion sur celle de Vandervelde [chef du parti socialiste belge] et de De Brouckère [autre leader socialiste], qui étaient opposés aux mesures de sanctions contre l'Allemagne.
Le Peuple [journal officiel du POB], jusqu'en 1933, c'est-à-dire jusqu'à la prise du pouvoir par Hitler, a pris délibérément et systématiquement fait et cause pour l'Allemagne, dans toutes les controverses internationales. Il a systématiquement préconisé le désarmement de la France et de la Belgique, alors que tout démontrait la volonté de l'Allemagne de prendre sa revanche. Mon frère (...) n'avait pu du jour au lendemain opérer le retournement qui fut celui des politiciens socialistes. Pour lui, si l'Allemagne avait été une victime du traité de Versailles avant 1933, elle l'était aussi après 1933 (...). Et si la cause de l'unité européenne était bonne avant 1933, lorsque Briand s'en faisait le champion, elle l'était toujours après 1933, même lorsque les Allemands la reprenaient à leur compte (...). [Mon frère] partait de l'idée que la Belgique avait toujours été le champ de bataille des puissances européennes rivales et que la fin des guerres européennes, que l'unification de l'Europe, ferait ipso facto la prospérité de la Belgique. »
Tels étaient bien les ingrédients humanistes et internationalistes des réflexes partagés par De Man, Delvo et Hubermont. Même s'ils n'ont pas pris les mêmes options sur le plan pratique : De Man et Hubermont sont partisans de l'unité belge, le premier, ami du Roi, étant centraliste, le second, conscient des différences fondamentales entre Flamands et Wallons, étant fédéraliste ; Delvo sacrifie l'unité belge et rêve, avec ses camarades nationalistes flamands, à une grande confédération des nations germaniques et scandinaves, regroupées autour de l'Allemagne (ce point de vue était partagé par Quisling en Norvège et Rost van Tonningen aux Pays-Bas). Mais dans les 3 cas, nous percevons :
1) une hostilité aux guerres inter-européennes, comme chez Briand, Stresemann et De Brinon ;
2) une volonté de créer une force politique internationale, capable d'intégrer les nationalismes sans en gommer les spécificités ; une internationale comportant forcément plusieurs nations solidaires ; Delvo croira trouver cet internationalisme dans le Front du Travail allemand du Dr. Ley ;
3) une aspiration à bâtir un socialisme en prise directe avec le peuple et ses sentiments.
De Man connaîtra l'exil en Suisse, sans que Bruxelles n'ose réclamer son extradition, car son procès découvrirait la couronne. Delvo sera condamné à mort par contumace, vivra en exil en Allemagne pendant 25 ans, reviendra à Bruxelles et rédigera 3 livres pour expliquer son action. Hubermont, lourdement condamné, sortira de prison et vivra presque centenaire, oublié de tous.
► Raoul FOLCREY.
◘ Bibliographie :
• ANTHOONS, Johny : Hendrik De Man en zijn opvattingen over de parlementaire democratie, mémoire en sciences politiques, Katholieke Universiteit te Leuven, Februari 1985.
• BRELAZ, Michel : Henri De Man, une autre idée du socialisme, Éd. des Antipodes, Genève, 1985.
• DE BENS, Els : De belgische dagbladpers onder duitse censuur, 1940-1944, DNB, Antwerpen/Utrecht, 1973.
• DEGRELLE, Léon : La cohue de 40, Avalon, Paris, 1991.
• DELCORD, Bernard : « À propos de quelques chapelles politico-littéraires en Belgique (1919-1945) », in Cahiers du Centre de recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale n°10, Bruxelles, nov. 1986.
• DELVO, Edgard :
- Hedendaagsch humanistisch streven. Democratisch socialisme en zijn beteekenis voor de BWP, De Sikkel, Antwerpen, 1939.
- Sociale collaboratie. Pleidooi voor een volksnationale sociale politiek, DNB, Antwerpen/Amsterdam, 1975.
- De mens wikt... Terugblik op een wisselvallig leven, DNB, Kapellen, 1978.
- Democratie in stormtij. Democratisch socialisme in de crisisjaren dertig, DNB, Antwerpen/Amsterdam, 1983.
• DE MAN, Henri : L'idée socialiste, suivi du Plan de Travail, L'Églantine, Bruxelles / Grasset, Paris, 1935.
• HUBERMONT, Pierre : éditoriaux de Wallonie, 1941-1944.
• JUMEAU, A. : Bon sang ne peut mentir, mémoire édité par Mlle A. Jumeau, sœur de Pierre Hubermont, alias Joseph Jumeau, Bruxelles, 1949.
• LEFRANC, Georges, « La diffusion des idées planistes en France », in Revue européenne des sciences sociales, t. XII, 1974, n°31, Droz, Genève.
• PATER, Léon : « Les thèmes sociaux de l'idéologie utmiste », in Wallonie, 3e année, n°12, déc. 1943.
• PFAFF, Dr. AAJ : Hendrik De Man. Zijn wijsgerige fundering van het moderne socialisme, Standaard, Antwerpen/Amsterdam, 1956.
• SLAMA, AG : « Henri De Man et les néo-traditionalistes français (1933-1936) », in Revue européenne des sciences sociales, t. XII, 1974, n°31, Droz, Genève.
• SPILETTE, Joseph : « Haut les cœurs ! », in Le Journal de Charleroi, 18/19 oct. 1941.
• STEUCKERS, Robert : « Henri De Man », in Études et Recherches n°3, 1984 (revue publiée par le GRECE, Paris).
• VERHOEYEN, Étienne : « De Unie van Hand- en Geestesarbeiders », in E. Verhoeyen e.a., Het minste kwaad, deel 9, België in de tweede wereld-oorlog, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1990.
• WILLEQUET, Jacques : La Belgique sous la botte : Résistances et collaborations 1940-1945, Éd. universitaires, Paris, 1986.
• Pour ce qui concerne l'œuvre de Henri De Man en général, consulter les publications de l'Association pour l'étude de l'œuvre d'Henri De Man, p.a. Département d'histoire du droit et des doctrines juridiques et politiques, Place de l'Université 3, CH-1211 Genève 4 (Suisse).

