Molnar
à propos d'une étude du Prof. Thomas Molnar
[Caricature de Rauch parue dans Die Zeit]
Grâce à l'action conjointe de la classe politique et des médias, l'Europe de 1992 est en passe de devenir le grand mythe de la fin du siècle. Mais de quelle Europe s'agit-il ? Cette question essentielle a été posée en ces termes au ministre français des affaires étrangères, Roland Dumas : « Qu'attendez-vous au juste du grand marché de 1992 ? » La réponse ne brille guère par son originalité mais elle reflète fidèlement l'opinion majoritaire de nos gouvernants : « D'abord, un moyen de lutte contre le chômage. Ne perdons jamais de vue que c'est la structure fédérale américaine qui ressemble beaucoup à un marché unique, qui a amené l'expansion économique aux États-Unis. Le grand marché devrait permettre d'accroître le revenu par habitant. Enfin, il générera une meilleure harmonisation politique. Bien que sa vocation soit économique, il aménera en effet les Européens à se rencontrer, à échanger, à vivre ensemble et fera donc apparaître des conditions nouvelles propices à l'épanouissement de l'unité politique ».
« Des mots, des illusions, de l'ignorance aussi », commente le professeur Thomas Molnar, dans un essai décapant, sans concessions pour « l'état d'hypnose de la classe politique en Europe vis-à-vis du modèle américain ». Le fonctionnement du grand marché commun, note Molnar, ne présuppose pas un système politico-juridique fédéral, comme l'affirment les prétendus "européistes" mais avant tout l'homogénéité culturelle d'une population conditionnée. L'économie en tant que telle n'apporte pas la paix mais souvent la guerre. Carlyle ou Maurras avaient bien vu que le matériel, l'économique, "les affaires matérielles" divisent autant qu'elles unissent. Comment croire que dans l'affaire du Koweit le bellicisme des dirigeants occidentaux a pour fondement des considérations humanitaires ?
Écrivain et essayiste d'origine hongroise, professeur de philosophie à l'Université de New York, Thomas Molnar est établi aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Spécialiste des idées et des faits politiques des 2 continents, infatigable conférencier et globe-trotter, nul n'était mieux placé que lui pour dénoncer la récupération et la trahison de l'idée d'Europe et pour dresser le constat honnête et désintéressé de la mentalité collaborationniste qui anime nos clercs et nos gouvernants européens.
L'Europe des patries, chère au général de Gaulle et aux rédacteurs de la revue du Front national, Identité, semble emporter la sympathie du professeur Molnar. Elle ne se confond pas avec l'Europe des peuples, défendue depuis 20 ans par les représentants de la Nouvelle Droite européenne, mais dans les 2 cas le diagnostic concorde. Entre Europe - Tiers-monde même combat (1986) d'Alain de Benoist, le Nouveau discours à la nation européenne (1985) de Guillaume Faye, les prises de position de l'ancien ministre des affaires étrangères, Michel Jobert, partisan déterminé du rapprochement entre l'Europe et le monde arabe et les analyses de Molnar, les parallélismes sont frappants.
La thèse de L'Europe entre parenthèses est qu'un danger menace l'Europe : « l'effacement de son identité multinationale et multiculturelle, au profit d'une sorte de désert où l'économique serait dominant et où les valeurs spirituelles seraient plus refoulées encore qu'aujourd'hui ». Sous prétexte de préserver la paix et de répandre le bien-être, nos gouvernants veulent généraliser le matérialisme. L'esclave heureux, le bonheur par le bien-être comme loi suprême, cette invention petite bourgeoise récupérée par le néo-libéralisme et son allié la social-démocratie, constitue, disait Jacques Ellul, « la trahison suprême de la quête du Graal que fut l'histoire de l'Occident » en dépit de ses pages les plus noires.
L'Europe dépolitisée a perdu la maîtrise de son destin
[Ci-dessous caricature de Jam parue dans la Brüsseler Zeitung, le 17 février 1944. Eleonor et Franklin Roosevelt élabore des plans pour les villes européennes détruites par l'aviation américaine. Une nouvelle cathédrale de Cologne avec piscine sur le toit et bar au 20ème étage ?]
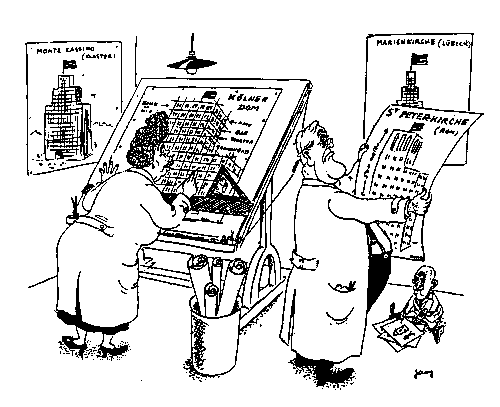 Molnar ne mâche pas ses mots. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, 2 modèles de sociétés se sont imposés sur le continent européen : le modèle soviéto-marxiste à l'Est, le libéralisme "made in USA" à l'ouest. L'Europe dépolitisée a perdu la maîtrise de son destin. Les Européens n'ont pas d'idéologie qui leur permette d'exprimer leur identité : les Américains ont le capitalisme, les Soviétiques ont (faudra-t-il bientôt dire "avaient") le marxisme. Pendant des décennies, Moscou a intimidé l'Europe de l'Ouest pour en extorquer des avantages et Washington a entretenu un climat de panique qui lui permettait d'imposer dans cette même Europe de l'Ouest ses systèmes d'armement et de s'attacher ses vassaux. Les 2 super-puissances se sont entendues à merveille pour maintenir le statu quo et perpétuer la servitude européenne.
Molnar ne mâche pas ses mots. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, 2 modèles de sociétés se sont imposés sur le continent européen : le modèle soviéto-marxiste à l'Est, le libéralisme "made in USA" à l'ouest. L'Europe dépolitisée a perdu la maîtrise de son destin. Les Européens n'ont pas d'idéologie qui leur permette d'exprimer leur identité : les Américains ont le capitalisme, les Soviétiques ont (faudra-t-il bientôt dire "avaient") le marxisme. Pendant des décennies, Moscou a intimidé l'Europe de l'Ouest pour en extorquer des avantages et Washington a entretenu un climat de panique qui lui permettait d'imposer dans cette même Europe de l'Ouest ses systèmes d'armement et de s'attacher ses vassaux. Les 2 super-puissances se sont entendues à merveille pour maintenir le statu quo et perpétuer la servitude européenne.
Avec pertinence, Molnar relève qu'à l'Ouest le modèle américain, en soi, n'alimente pas les débats et n'est pas évoqué dans les manuels de sciences politiques mais qu'il n'en est pas moins la référence tacite. « Lorsque son côté "capitaliste" s'accentue, écrit-il, (not. sous la présidence de Reagan), même les gouvernements socialistes de l'Europe — la France, l'Espagne, l'Italie — infléchissent leur ligne de conduite dans le sens de la privatisation des industries et des services ; lorsque le vent "démocrate" souffle de Washington, un autre son de cloche se fait entendre en Europe ». L'affaire du Golfe n'est-elle pas une illustration récente de cette dépendance ?
Le gauchisme, avant-garde du capitalisme triomphant
À partir d'analyses semblables, peu de temps avant de mourir, le philosophe catholique, Augusto del Noce, concluait que le marxisme est mort à l'Est parce que, d'une certaine façon, il s'est réalisé à l'Ouest. Et en effet, l'athéisme radical, le matérialisme, la non-appartenance universelle, le primat de la praxis et la mort de la philosophie, la domination de la production, la manipulation universelle de la nature, le faustisme technologique, l'égalitarisme et la réduction de l'homme au rang de moyen sont autant de similitudes qui font du néo-libéralisme le rejeton adultérin du libéralisme capitaliste et du socialisme marxiste.
Paradoxalement, la contestation de 1968 aura scellé l'alliance de l'esprit révolutionnaire et du néo-libéralisme bourgeois. Elle aura brisé, non pas les soutiens et les alliances du capitalisme, comme les gauchistes le souhaitaient, mais les dernières digues contre lui, leur ennemi le plus implacable : les valeurs traditionnelles. Comme l'ont fort bien montré Paul Gottfried dans The Conservative Movement (1988) et Marcello Veneziani dans Processo all' Occidente (1990), d'une part, le socialisme n'aura été qu'une étape, une phase de transition du libéralisme au néo-libéralisme, d'autre part, le libéralisme ne sera parvenu à se rendre maître du jeu qu'après s'être transformé en néo-libéralisme, c'est-à-dire après avoir renversé son propre fondement illuministe et ce qui était sa plus haute expression : la morale kantienne.
L'objectif : une planète entièrement américanisée
[La clochardisation de la population russe (dont un quart vit actuellement dans la pauvreté). Les pénuries, dues non pas au manque de matières premières mais à la désorganisation de moyens de transport, affligent la population russe et font que l'homme de la rue en vient à croire aux vertus du capitalisme made in USA. (photo Reuters)]
 L'intérêt des oligarchies néo-libérales, ploutocratiques, au pouvoir, ne peut donc être de construire l'Europe sur les nations, mais, comme le souligne Molnar, de la réduire à un immense marché transnational de l'Oural à la West Coast des États-Unis : l'Europe marchande absorbée par une planète américanisée. Telle est l'idée technocratique que caressent les "eurocrates" qui se nourrissent de l'illusion selon laquelle les vrais problèmes ne sont pas d'ordre politique mais technique. La dépendance et l'aveuglement ne semblent plus avoir de limites : la classe politique se persuade et prétend convaincre les gouvernés que l'étape des "souverainetés nationales" touche à sa fin, cédant le pas au mondialisme, à la coopération planétaire. Mais cela n'empêche pas les super-puissances de poursuivre leurs propres fins, de défendre leurs intérêts, de gérer leurs dominations en toute indépendance.
L'intérêt des oligarchies néo-libérales, ploutocratiques, au pouvoir, ne peut donc être de construire l'Europe sur les nations, mais, comme le souligne Molnar, de la réduire à un immense marché transnational de l'Oural à la West Coast des États-Unis : l'Europe marchande absorbée par une planète américanisée. Telle est l'idée technocratique que caressent les "eurocrates" qui se nourrissent de l'illusion selon laquelle les vrais problèmes ne sont pas d'ordre politique mais technique. La dépendance et l'aveuglement ne semblent plus avoir de limites : la classe politique se persuade et prétend convaincre les gouvernés que l'étape des "souverainetés nationales" touche à sa fin, cédant le pas au mondialisme, à la coopération planétaire. Mais cela n'empêche pas les super-puissances de poursuivre leurs propres fins, de défendre leurs intérêts, de gérer leurs dominations en toute indépendance.
À l'Ouest, les États-Unis ne sont aucunement disposés à voir leur hégémonie commerciale contestée par les Européens. Molnar a donc raison d'annoncer que tôt ou tard l'Europe économique devra se politiser, que le modèle américain "États-Unis d'Europe" finira par céder le pas à une Europe réarticulée selon des intérêts et des volontés nationaux, régionaux, ethniques, géopolitiques, militaires et autres dont nous ne connaissons pas encore l'identité, ni le poids.
Par delà les clivages partisans, les esprits les plus lucides en conviennent. Il est même étonnant de voir combien convergent les analyses des auteurs qui, à droite comme à gauche, demeurent indépendants et libres de toutes compromissions à l'égard de la "partitocratie", dont Gonzalo Fernandez de la Mora a décrit les mœurs délétères (La partitocratie, 1977). Ainsi, après A. del Noce, Claude Polin, A. de Benoist et T. Molnar, l'ancien compagnon de route de Che Guevara, le socialiste Régis Debray, rappelle dans un article publié dans Le Monde, le 17 novembre 1989, que les peuples et les cultures sont « les véritables sujets de l'histoire ». Il écrit : « Le capitalisme démocratique reste bien maître du terrain. Mais il s'abuserait lui-même en supposant qu'il le contrôle, et que l'histoire s'arrête avec son triomphe. Son indéniable victoire du moment pourrait bien porter dans ses flancs sa propre défaite à long terme, lorsque se sera dissipée l'illusion économique qu'il partageait avec feu son challenger. Libéralisme et marxisme ont communié en effet pendant un siècle dans le même présupposé, à savoir que dans la hiérarchie des choses sérieuses, l'économie occupe la première place, avant la politique, suivie elle même par la culture. Or, le jour n'est pas loin où l'on s'apercevra, dans notre monde post-industriel, que l'ordre des préséances devrait se lire en sens inverse. Que la culture est la première par rapport à la politique, elle-même plus importante que l'économie ».
 Pendant des décennies, des auteurs non-conformistes de droite l'ont dit et répété sans obtenir le moindre écho. Mais les années 90 s'annoncent enfin, n'en déplaise à Francis Fukuyama ou Willy Brandt, comme celles du "retour de l'histoire". Le monde arabe est en effervescence. En Europe, la renaissance des identités nationales, le réveil des communautés, des ethnies, des religions, contrarie le cosmopolitisme néo-libéral. Le réveil des peuples d'Europe s'accompagne de l'éclipse des empires. L'Empire soviétique se défait. L'Empire américain semble en panne. Selon Paul Kennedy, les États-Unis sont parvenus à ce point où les empires déclinent, à cause des fardeaux qu'ils accumulent, de leur expansion excessive et d'une cassure de leur grand projet, de leur volonté de puissance et de mission universelle. Le destin du vieux continent se joue déjà autour de l'Allemagne. Concluons avec Molnar : « Menacée d'être "exclue de l'histoire", l'Europe des peuples s'est ressaisie à la dernière minute, Anno Domini 1989 ».
Pendant des décennies, des auteurs non-conformistes de droite l'ont dit et répété sans obtenir le moindre écho. Mais les années 90 s'annoncent enfin, n'en déplaise à Francis Fukuyama ou Willy Brandt, comme celles du "retour de l'histoire". Le monde arabe est en effervescence. En Europe, la renaissance des identités nationales, le réveil des communautés, des ethnies, des religions, contrarie le cosmopolitisme néo-libéral. Le réveil des peuples d'Europe s'accompagne de l'éclipse des empires. L'Empire soviétique se défait. L'Empire américain semble en panne. Selon Paul Kennedy, les États-Unis sont parvenus à ce point où les empires déclinent, à cause des fardeaux qu'ils accumulent, de leur expansion excessive et d'une cassure de leur grand projet, de leur volonté de puissance et de mission universelle. Le destin du vieux continent se joue déjà autour de l'Allemagne. Concluons avec Molnar : « Menacée d'être "exclue de l'histoire", l'Europe des peuples s'est ressaisie à la dernière minute, Anno Domini 1989 ».
♦ Thomas Molnar, L'Europe entre parenthèses, La Table Ronde, 1990, 148 p.
► Arnaud IMATZ, Vouloir n°73/75, 1991.

L'Éclipse du sacré
[La querelle entre l'orthodoxie catholique et le néo-paganisme e n'est pas une querelle universitaire : elle implique 2 visions de la Cité radicalement antinomiques. Pour le néo-paganisme, le divin est immergé dans la Cité, à l'image de cette figure d'Athéna.]
 Un dialogue philosophique et religieux entre le païen Alain de Benoist et le catholique Thomas Molnar : tel est l'objet d'un livre paru récemment aux Éditions La Table Ronde. Et quand un exemplaire de cet ouvrage, intitulé L'éclipse du sacré, m'est parvenu, j'ai un peu eu l'impression de revenir 8 années en arrière. Un dialogue similaire, en effet, avait eu lieu dans la revue munichoise Criticón (n°47) de mai-juin 1978 entre Molnar et Armin Mohler. Molnar, fidèle aux thèses qu'il avait exprimées avec brio dans Dieu et la connaissance du réel (PUF, 1976), se faisait l'avocat du "réalisme" politique tandis que Mohler plaidait pour un "nominalisme". Dans le numéro d'automne (1978) de feu la revue bruxelloise Pour une renaissance européenne (n° 22/23) animée alors par Georges Hupin, j'ai résumé ce dialogue. Quelques mois plus tard, A. de Benoist consacrait un numéro de sa revue Nouvelle École (n°33, été 1979) au "nominalisme" [« Fondements d'une attitude nominaliste devant la vie »] et publiait en version française le texte de Mohler [« Le tournant nominaliste : un essai de clarification »]. La tradition nominaliste, l'option nominaliste de la "Nouvelle Droite" prenait forme, tandis que le Tout-Paris accueillait le second livre théorique de Bernard-Henri Lévy, Le Testament de Dieu (Grasset, 1979), qui sommait les Français de choisir pour Jérusalem et la Loi, contre Athènes et la polis. En 1981, de Benoist répondra à son tour au défi de Lévy, en publiant, chez Albin Michel, Comment peut-on être païen ?
Un dialogue philosophique et religieux entre le païen Alain de Benoist et le catholique Thomas Molnar : tel est l'objet d'un livre paru récemment aux Éditions La Table Ronde. Et quand un exemplaire de cet ouvrage, intitulé L'éclipse du sacré, m'est parvenu, j'ai un peu eu l'impression de revenir 8 années en arrière. Un dialogue similaire, en effet, avait eu lieu dans la revue munichoise Criticón (n°47) de mai-juin 1978 entre Molnar et Armin Mohler. Molnar, fidèle aux thèses qu'il avait exprimées avec brio dans Dieu et la connaissance du réel (PUF, 1976), se faisait l'avocat du "réalisme" politique tandis que Mohler plaidait pour un "nominalisme". Dans le numéro d'automne (1978) de feu la revue bruxelloise Pour une renaissance européenne (n° 22/23) animée alors par Georges Hupin, j'ai résumé ce dialogue. Quelques mois plus tard, A. de Benoist consacrait un numéro de sa revue Nouvelle École (n°33, été 1979) au "nominalisme" [« Fondements d'une attitude nominaliste devant la vie »] et publiait en version française le texte de Mohler [« Le tournant nominaliste : un essai de clarification »]. La tradition nominaliste, l'option nominaliste de la "Nouvelle Droite" prenait forme, tandis que le Tout-Paris accueillait le second livre théorique de Bernard-Henri Lévy, Le Testament de Dieu (Grasset, 1979), qui sommait les Français de choisir pour Jérusalem et la Loi, contre Athènes et la polis. En 1981, de Benoist répondra à son tour au défi de Lévy, en publiant, chez Albin Michel, Comment peut-on être païen ?
Une querelle venait de s'ouvrir : celle du christianisme (ou judéo-christianisme) contre le néo-paganisme, celle de l'universalisme contre l'existentialisme nominaliste. L'éclipse du sacré marque une seconde étape dans cette vaste polémique philosophique, tandis que Jacques Marlaud en tire un bilan païen, tout en resituant la querelle dans l'histoire des lettres françaises (Cf. J. Marlaud, Le Renouveau païen dans la pensée française, Le Labyrinthe, 1986).
Dans leur disputatio philosophique de 1978, Molnar et Mohler avaient jeté les bases de la querelle et l'on n'exagérerait pas en affirmant que ce dialogue polémique a quelque peu été "axial", en ce sens qu'il clarifiait les positions et permettait au public de choisir, en vue de construire une société conforme aux valeurs défendues par les protagonistes. Molnar appelait "réalisme" l'acceptation d'un "substrat" précédant et sous-tendant tout ce qui existe dans le cosmos. Ce substrat, affirme-t-il, est le soubassement d'un ordre intelligent, d'une structure de l'être et de la nature humaine. Pour Molnar, l'homme politique doit reconnaître ce "substrat" et s'y soumettre humblement, sans chercher à modifier la nature humaine, entreprise qui serait de toute façon vouée à l'échec.
Refuser de reconnaître le substrat divin du monde est le propre des pensées utopiques/gnostiques, écrit Molnar. Pour lui, Dieu (le substrat) n'est ni inaccessible (ce qui impliquerait qu'il laisse le monde au hasard, aux aléas) ni immanent (ce qui implique qu'il n'y aurait pas de distance, génératrice du sacré, entre les hommes et Dieu). Molnar le Catholique croit en un Dieu transcendant et personnel, c'est-à-dire simultanément distancié du monde et des hommes et présent au sein du monde par le truchement de l’incarnation. L'homme, être de raison, est ainsi un "pont" entre Dieu et le monde. La conception thomiste de Molnar veut que l'homme soit matière et forme à la fois ; en langage théologique : hylémorphique.
À ce réalisme, hostile aux "utopies" produites par les pensées ésotéristes, mystiques, immanentistes, Mohler opposait une sorte de pragmatisme qui réfutait l'idée d'un substrat universellement valable. Si les universalistes (parmi lesquels il rangeait Molnar) veulent bâtir un monde axé sur la notion de substrat unique, les nominalistes sont créateurs de formes ; ils répondent aux défis par des réponses hic et nunc, différentes selon les circonstances. La diversité des défis implique la diversité des réponses donc des formes et exclut toute espèce de monolithisme du substrat. Comme Faust, ces nominalistes voient le commencement de toute chose dans l'action. Mohler renoue là avec la pensée allemande de ce siècle, imprégnée de nietzschéisme.
Pour Molnar, formé à l'école thomiste et professeur à New York, l'équation "conservatisme (ou droite) = christianisme (catholique de préférence)" est une évidence. Mohler a, lui, toujours contesté cette équation. À la suite de Nietzsche, il conteste l'eschatologie chrétienne et sa vision linéaire de l'histoire. Pour Mohler, l'histoire n'est pas téléologique, elle ne tend pas vers Dieu, vers le Jugement Dernier mais reçoit, de temps à autre, l'impulsion de grands peuples ou de grandes personnalités. La position du nominaliste est celle du réalisme héroïque (bien différent du réalisme substantiel de Molnar) : « tout ce qui arrive est adorable » (L. Bloy). Ou comme dirait Nietzsche : Amor fati. Le monde est espace de création, d'action formatrice. L'homme crée à ses risques et périls et les aléas peuvent réduire à néant ses créations. Le risque demeure omniprésent.
Dans la querelle de 1978, indubitablement, Molnar, fort de ses écrits antérieurs et de ses recherches historico-théologiques, avait l'avantage de la clarté et aussi celui de s'inscrire dans une tradition philosophique bien discernable, celle du catholicisme romain. Mohler, lui, était moins clair mais plus prometteur. Il faisait appel à la fibre créatrice, au goût du défi et de la transgression.
Huit années après ce débat, Molnar a quitté ses démonstrations limpides et écrit un texte fourmillant d'expériences personnelles. Et A. de Benoist a approfondi son option "nominaliste", calquée au départ sur celle de Mohler et de son maître Walter Hof (1), et l'a étayée par une lecture assidue de Heidegger. Si, à mes yeux de modeste lecteur, Molnar me semblait avoir le dessus en 1978 (même si mes propres options me portaient à accepter pleinement le nietzschéisme de Mohler, sans que je n'ai encore eu la joie de lire W. Hof), de Benoist semble aujourd'hui avoir définitivement conquis la rigueur au profit des nominalistes et des néo-païens. Cette appréciation est sans doute bien personnelle, mais je persisterai désormais, jusqu'à nouvel ordre, à voir la quintessence des 2 démarches — la catholique/conservatrice de Molnar et la néo-païenne de de Benoist — dans Dieu et la connaissance du réel et dans la partie de L'éclipse du sacré rédigée par le philosophe païen.
Dans L'éclipse du sacré, en effet, Molnar campe fermement sur ses positions, tout en se faisant moins théoricien, moins historien des théologies européennes (une lacune à mes yeux, mais certainement un avantage pour ceux qui n'ont pas la manie, comme moi, de collectionner les références, pour en faire des bornes-repères dans cette forêt qu'est l'histoire des idées et des concepts) et plus "parabolique", plus narrateur d'expériences vécues. Au risque d'une certaine confusion doctrinale, qui, auparavant n'avait nullement été son propre. Molnar, en effet, est toujours à l'affût des manifestations tangibles de son substrat divin.
Cette quête inlassable s'avère chaque jour plus difficile dans un monde qui veut se soustraire à toute espèce de transcendance. La position de Molnar vis-à-vis du sacré est effectivement difficile à tenir ; pour lui, en effet, le "sacré" est médiateur, il est "connecté" au divin et à l'univers physique, matériel. En conséquence, Molnar refuse d'adorer un Dieu absent du monde, indifférent au monde ; il rejette les théologies qui expriment la radicale altérité du divin par rapport au monde, à l'univers physique. Deuxième conséquence, Molnar refuse la démarche mystique — celle d'un Maître Eckhart, par ex. — qui immerge le divin dans le inonde, abolissant du même coup la césure.
Catholique, Molnar aperçoit le sacré dans le mystère de l'incarnation, dans la communication qui en résulte entre les sphères du divin et de l'immanence. Indubitablement, le génie du catholicisme, par rapport aux théologies du Dieu inaccessible, a été de revaloriser la création, le monde physique et sensible par le recours à l'incarnation. Néanmoins, la césure subsiste, hiatus que le catholicisme n'a jamais éliminé, et le monde ne reçoit d'autre validité que celle d'être objet de la sollicitude divine, d'être lieu éventuel de l'incarnation. Molnar refuse donc, par fidélité aux dogmes catholiques, la démarche mystique, celle de l'immersion du divin dans l'univers. C'est essentiellement contre ce refus, contre le maintien de la césure chrétienne, héritée des théologies judéo-grecques où le Dieu unique est coupé du monde, que s'insurge le néo-païen A. de Benoist.
Sa démarche s'articule autour de 3 définitions : celle du sacré proprement dit, celle de la désacralisation et, enfin, celle de la sécularisation. Molnar constatait la disparition du sacré par l'avènement des gnosticismes laïcisés, qui cherchaient à transposer le parfait du divin dans le monde, générant dans la foulée les mirages utopiques. De Benoist, lui, constate une lente involution vers le désenchantement. Philologique, sa démarche a le mérite de commencer par une définition du sacré au départ des racines linguistiques indo-européennes des vocables exprimant la sacralité, le divin, la sainteté, etc.
Cette exploration, inspirée notamment de Benvéniste et de Dumézil, donne à sa démonstration une rigueur que semble avoir perdue Molnar par rapport à ses travaux antérieurs ; se situant dans la tradition romantique et nietzschéienne à la fois, de Benoist travaille ici par généalogie : il reconstitue l'histoire (hélas involutive) de la notion de sacré. Par l'analyse du vocabulaire grec, latin, celtique, germanique et slave, de Benoist, comme précédemment Mircea Eliade, peut déduire l'immanence du sacré comme trait récurrent de la religiosité indo-européenne qui, qu'on l'admette ou non, forme finalement la religiosité éternelle, la trame religieuse incontournable, des peuples d'Europe, issus de la patrie originelle commune à tous les locuteurs de langues indo-européennes.
De pseudo-morphoses en pseudo-morphoses (pour reprendre l'expression spenglérienne), cette religiosité a survécu au travers des travestissements chrétiens. Sigrid Hunke (in : La vraie religion de l'Europe, Le Labyrinthe, 1985), inspiratrice de de Benoist, a retracé de manière magistrale la longue histoire de cette religiosité toujours étouffée mais jamais annihilée. De la Gottheit (déité) de Maître Eckhardt à Heidegger, philosophe dont l'œuvre sous-tend tout le néo-paganisme de de Benoist, l'immanence, le monde créé, la nature, la Vie reprennent leurs droits, ravis jadis par le christianisme et ses théologies de la césure. Avec Heidegger, l'Être n'est plus hors du monde, mais fondamentalement "présence au monde". L'Être se dévoile au monde, par irruptions régulières mais est "toujours déjà-là". Le substrat que les théologies bibliques et chrétiennes percevaient en dehors de l'immanence se voit ré-ancré dans la "concrétude ravissante" de l'univers. L'incarnation n'est plus un événement exceptionnel, elle est une constante sans commencement ni fin.
Si l'immanence englobe le sacré et si celui-ci est manifestation du mystère de l'univers, la désacralisation, constatable dans notre actuelle civilisation, est un produit des théologies de la césure. Issues de la Bible, ces théologies posent une distinction radicale entre le monde et Dieu. Avec le théologien allemand Friedrich Gogarten, de Benoist démontre que la désacralisation commence précisément avec l'affirmation que le cosmos est distinct de Dieu. « Par là, écrit-il, le cosmos se trouve en effet vidé de toutes les forces vivifiantes que le paganisme antique y voyait se manifester et advenir à la présence » (p.130). Le monde historique va devenir, par suite, le théâtre d'un affrontement entre les forces politiques partisanes des théologies de la césure et les forces politiques partisanes des religiosités naturelles et cosmiques, désignées "idolâtres" pour les besoins des croisades.
Les théologies de la césure posent comme lieu de la perfection un au-delà, radicalement distinct de l'immanence. Elles biffent ainsi toute cité concrète de leur horizon. Ce qui a pour corollaire immédiat, la volonté de détruire les sacralités localisées, particulières, originales, en vue de construire le modèle unique de la Cité de Dieu. « La lutte contre "l'idolâtrie" est aussi, et peut-être surtout, lutte contre l'attachement au lieu sacralisé par les dieux qui le patronnent. Le lieu, en quelque façon, est toujours origine. Or, désormais, l'avenir porteur d'espérance prime l'origine. lahvé n'est pas le dieu d'un lieu. Se tenant hors du monde, il est de partout, c'est-à-dire de nulle part » (p.157).
Molnar tenait à préserver le lien de l'homme à la sacralité et évoquait l'exemple de la messe catholique, comme célébration de la présence du Christ, c'est-à-dire du divin, au milieu des hommes. De Bneoist démontre que l'éradication progressive des lieux sacrés du paganisme (qui ont subsisté dans le culte des saints, transformations des divinités celtiques ou germaniques) et l'abandon progressif, sous les coups du monde moderne, de cette religiosité populaire vaguement christianisée a brisé tous les liens qui unissaient les hommes entre eux et les a détachés du sacré communautaire. Paradoxalement, de Benoist exprime de manière plus cohérente la disparition du sacré, que Molnar déplore avec autant d'intensité que lui.
Avec cette disparition du sacré ou plutôt à cause de son refoulement et à cause de la non reconnaissance de sa présence dans l'immanence, on assiste, nous explique de Benoist, à une sécularisation planétaire, à un désenchantement (Entzauberung pour reprendre le mot de Max Weber). Désormais, « la modernité se caractérise par l'anonymat, le désassujetissement, l'impossibilité grandissante de communiquer, l'angoisse qui naît du sentiment de déréliction... » (p. 188). Nouveau paradoxe, mis en exergue par le néo-païen de Benoist : le christianisme, qui a voulu être la seule "vraie" religion avec ou sans incarnation, aboutit à l'abolition du sacré, à l'athéisme (quand il se laïcise dans l'Europe du XVllle), à l'incroyance. Un éventail de questions nous vient aussitôt : L'homme ne peut-il croire réellement, ne peut-il avoir de re-ligion (de re-ligere) que dans un cadre restreint ? Que dans le cadre de sa tribu ? La volonté de mondialiser donc de délocaliser une religion ne constitue-t-elle pas une chimère ? Une utopie ? L'homme ne reconnaîtrait-il de substrat qu'à petite échelle ? La perspective planétaire ne parviendrait-elle pas à s'inscrire dans les cœurs et à mobiliser la foi ?
A. de Benoist constate que l'Église, dans cette perspective de mondialisation, est obligée de redevenir iconoclaste (cf. p.192), de gommer le merveilleux des images de saints, merveilleux qui, pourtant, en dissolvant la pureté doctrinale du message chrétien et en incorporant des éléments de sacralité pagano-locaux, avait rendu le christianisme habitable. Ce retour aux origines iconoclastes permet de conclure à l'athéisme fondamental du christianisme, à l'impossibilité pratique du dieu sans lieu. L'idée que le christianisme est en fait un athéisme en gestation se retrouve aussi chez le philosophe Ernst Bloch (cf. Atheismus im Christentum : Zur Religion des Exodus und des Reichs, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1968). Les premiers athées, écrit-il, ont été les premiers chrétiens de la Rome de Néron qui niaient la divinité de la Cité.
La Cité : les 2 auteurs en parlent, certes, mais pas assez. Sera-ce l'objet d'un prochain ouvrage ? De Benoist l'a en tout cas anticipé par un opuscule part particuliérement intéressant sur la démocratie. Car le défi chrétien est un défi essentiellement politique. L'arasement culturel qu'il a provoqué en Europe a largement été dépassé par l'érudition, la philologie, etc. du XIXe siècle, même si le XXe siècle a rendu caduc les implications politiques de ces découvertes révolutionnaires. Le savoir du XIXe a, en quelque sorte, comblé les lacunes causées par la christianisation. Le recours à l'héritage païen chez de Benoist, conforté par la philosophie de Heidegger et l'histoire religieuse suggérée par Sigrid Hunke, devra ultérieurement se doubler d'un dépassement des implications politiques de la christianisation, c'est-à-dire des stratégies de construction de la Cité de Dieu, héritage augustinien et carolingien. Avec ce dépassement, il faudra recourir au droit coutumier et aux formes d'organisation gentilice et communautaire dont l'Europe entière a gardé la nostalgie. Le christianisme a confisqué à bon nombre de peuples européens le droit à l'auto-détermination. La lutte contre les injustices nées de la collusion des intérêts carolingiens et chrétiens relève d'une dimension historique. C'est dans l'histoire, dans la lutte politique concrète que se restaurera le sacré, en même temps que l'autodétermination des peuples.
A. de Benoist, dans 2 livres, Comment peut-on être païen ? et L'éclipse du sacré, nous indique les assises religieuses, métaphysiques et éthiques du renouveau païen en Europe. L'étape suivante sera indubitablement de tirer les conséquences politiques de cette démonstration, de ce nécessaire travail d'exploration. Ayant dégagé les grandes lignes d'une aliénation religieuse presque 2 fois millénaire pour le bassin méditerranéen et 11 fois centenaire pour l'Europe centrale et septentrionale, A. de Benoist ne pourra plus ignorer les aliénations concrètes, sociales, politiques et économiques que cette christianisation a imposées. Une telle réflexion sur l'aliénation le forcera sans doute à découvrir ou redécouvrir les racines de ce phénomène chez Schiller, Fichte et Schelling. L'œuvre de Robert Muchembled, qui oppose la culture populaire, demeurée largement païenne, à la culture des élites, chrétienne, constitue en ce sens un apport non négligeable, capable, de surcroît, de donner à la "Nouvelle Droite" de de Benoist une dimension révolutionnaire que lui ôtent, qu'on le veuille ou non, le vocable "droite" et les amalgames que fabriquent les journalistes et les chercheurs à courte vue.
Dans une telle optique, l'œuvre de de Benoist pourra devenir un outil de lutte contre l'aliénation culturelle et religieuse majeure de notre histoire et, donc, un instrument de libération continental. Ce corpus doctrinal pourra-t-il encore être classé à droite, c'est-à-dire du côté des avocats du statu quo ? Ou deviendra-t-il plus explosif que les concepts que manie de plus en plus maladroitement l'intelligentsia de gauche en France ? L'avenir nous le dira... En tout cas, la perspective ouverte par la politisation du discours néo-païen de de Benoist nous interdit le pessimisme, état d'esprit que l'on peut déplorer dans certains passages de L'éclipse du sacré...
♦ Alain de Benoist, Thomas Molnar, L'éclipse du sacré : Discours - Réponses, La Table Ronde, 1986, 299 p.
► Robert Steuckers, Vouloir n°28/29, 1986.
◘ Note :
( 1 ) L'œuvre de Walter Hof a été grandement appréciée par Armin Mohler. L'influence de ses travaux sur la genèse du "nominalisme" et du "réalisme héroïque" de la "Nouvelle Droite" française n'a pas encore été découverte par les observateurs. Nous y reviendrons. L'ouvrage principal de Hof est : W.H., Der Weg zum heroischen Realismus, Verlag Lothar Rotsch, Bebenhausen, 1974. On lire également avec profil l'article suivant de Hof : W.H., Vom verpönten zum obligatorischen Pessimismus, in : G.K. Kaltenbrunner, Der innere Zensor : Neue und alte Tabus in unserer Gesellschaft, Herder (Bücherei Initiative Nr.22), Freiburg LB., 1978.

◘ Entretien avec Thomas Molnar : Crise spirituelle, mondialisme et Europe
• Q. : Pour vous la disparition du spirituel et du sacré dans notre société a-t-elle pour cause la modernité ?
ThM : Je préfère inverser les termes et dire que la modernité se définit comme la disparition du spirituel et du sacré dans notre société. Il s'agit d'un réseau de pensée qui s'est substitué graduellement — peu importe le moment du débat historique — aux réseaux traditionnels et en a redéfini les termes et la signification.
• Q. : Comment l'Église universelle peut-elle s'opposer au mondialisme ?
ThM : Elle ne s'y oppose guère sauf dans certains cas et certains moments, et là aussi d'une manière plutôt inefficace. Ayant accepté, avec enthousiasme ou résignation, sa nouvelle position de lobby (depuis Vatican II), l'Église s'intègre à la société civile, ses présupposés philosophiques, sa mentalité, sa politique. Un jour, un changement pourra, bien sûr, intervenir, mais pas avant que la structure de la société civile elle-même ne démontre ses propres insuffisances. Donc, le changement ne viendra pas de l'Église dont le personnel perd la foi et se bureaucratise. Dans l'avenir prévisible, les grandes initiatives culturelles et spirituelles n'émaneront pas de l'Église. Plus ou moins consciente de cette réalité, l'Église se rallie en ce moment au mondialisme, religion nouvelle des siècles devant nous.
• Q. : S'opposer au modernisme et au mondialisme, n'est-ce pas refuser le progrès ?
ThM : Le mondialisme rétrécit le progrès, il ne s'identifie plus à lui. C'est que la bureaucratie universelle et ses immenses lourdeurs et notoires incompétences bloquent les initiatives dont la source ultime est l'individu, le petit groupe, la continuité, l'indépendance régionale, enfin la souveraineté de l'État face aux pressions impérialistes et idéologiques. Aujourd'hui, le "progrès" (terme particulièrement pauvre et ne recouvrant aucune réalité intelligible) s'inverse, la société perd ses assises, l'anarchie règne. Nous allons vers le phalanstère sans âme. Bientôt viendra l'épuisement technologique, car l'élan nécessaire pour toute chose humaine même matérielle, s'amoindrira, s'essoufflera. L'homme désacralisé ne connaît que la routine, assassine de l'âme.
• Q. : À vous lire, il semble que le sacré n'est pas divin. Pouvez-vous expliquer cette approche ?
ThM : Le sacré n'est pas divin dans le sens "substantiel" du mot ; il médiatise le divin, il l'active en quelque sorte. D'abord, le sacré change d'une religion à l'autre, il attire et ordonne d'autres groupes humains (Chartres a été bâtie sur un lieu déjà sacré pour les druides, mais ces sacrés superposés n'expriment pas la même "sacralité"). Le sacré nous révèle la présence divine, cependant le lieu, le temps, les objets, les actes sacralisateurs varient.
• Q. : Croyez-vous à une régénération du spirituel et du sacré en France et en Europe ?
ThM : Il n'existe pas de technique de régénération spirituelle technique que l'on utilise à volonté. L'Europe vit aujourd'hui à l'ombre des États-Unis ; elle importe les idées et les choses dont elle pense avoir besoin. Elle est donc menée par la mode qui est le déchet de la civilisation d'outre-mer. Bref, l'Europe ne croit pas à sa propre identité, et encore moins à ce qui la dépasse : une transcendance ou un telos [finalité]. "L'unité" européenne n'est qu'un leurre, on joue à l'Amérique, on fait semblant d'être adulte. En réalité, on tourne le dos au passé gréco-chrétien et le plus grotesque de tout, on veut désespérément devenir un "creuset", rêve américain qui agonise déjà là-bas.
Tout cela n'exclut pas la régénération, qui part toujours d'un élan inédit, de la méditation d'un petit groupe. Aussi ne sommes-nous pas capables de le prévoir, de faire des projets, en un mot de décider du choix d'une technique efficace. Sans parler du fait que la structure démocratique neutralise les éventuels grands esprits qui nous sortiraient du marasme. Sur le marché des soi-disant "valeurs", on nous impose la plus chétive, les fausses valeurs qui court-circuitent les meilleures volontés et les talents authentiques. Si le sacré a une chance de resurgir sur le sol européen, le premier signe en sera le NON à l'imitation. Ce que je dis n'est pas nouveau, mais force m'est de constater dans les "deux Europes", Est et Ouest, l'impression du déjà-vu : l'Europe, dans son ensemble c'est Athènes plongée dans la décadence et l'Amérique, nouvelle Rome, mais d'ores et déjà à son déclin. La régénération ne peut être qu'imprévue.
• Q. : Sans ce renouveau spirituel, que peut-il se passer en France et Europe ?
À court terme, des possibilités politiques existent, et la France pourrait y apporter sa part. L'Europe qui se prépare sera germanique et anglo-saxonne, la surpuissance de la moitié nord se trouve déjà programmée. Or, c'est la rupture de l'équilibre historique, car la latinitas n'a jamais été à tel point refoulée que de nos jours. La France pourrait donc redevenir l'atelier politico-culturel de la nouvelle Europe, grâce à son esprit et son intelligence des réalités dans leurs profondeurs. Bientôt, l'Europe en aura assez des nouveaux maîtres qui apportent l'esprit de géométrie, la bureaucratie la plus lourde, la mécanisation de l'âme. La France doit être celle qui crie « Halte ! » et, pour cela, pénétrer le continent, porteuse et l'alternative.
► propos recueillis par Xavier CHENESEAU, 1999.
◘ Bibliographie sélective :
1968 - Sartre, philosophe de la contestation
1970 - La gauche vue d'en face
1972 - La Contre-révolution
1974 - L'animal politique
1976 - Dieu et la connaissance du réel
1976 - Le socialisme sans visage
1978 - Le modèle défiguré : l'Amérique de Tocqueville à Carter
1982 - Le Dieu immanent
1982 - L'Éclipse du sacré
1990 - L'Europe entre parenthèses
1991 - L'américanologie : triomphe d'un modèle planétaire ?
1991 - L'hégémonie libérale
1996 - Du mal moderne : symptômes et antidotes
1999 - Moi, Symmaque (suivi de L'âme et la machine)
◘ Hommages :
In Memoriam : † Thomas Molnar, 20 juillet 2010 (Catholica)
In Memoriam : Thomas Molnar (1921–2010) (First Principles)
Prof. Thomas Molar, Early Pioneer of Traditional Catholicism

pièce-jointe :
 ◘ L’oppression de l’homme libéré
◘ L’oppression de l’homme libéré
♦ Ce texte est la traduction d’une partie du chapitre VII de Philosophical Grounds (Peter Lang, New York, 1991).
Le progrès amène ainsi l’homme à de nouvelles contradictions et à la prise de conscience que son autonomie, une fois achevée, est de nouveau à la recherche de l’hétéronomie. Et alors il est piégé. Non seulement par son orgueil qui ne se résout pas à extérioriser sa thèse ; mais aussi par l’abolition des structures externes et par leur remplacement par une culpabilité interne, qui étrangement, intensifie le mérite de l’individu.
***
Le principe de l’autonomie de l’homme, cet idéal qu’on a poursuivi des siècles durant, se trouve être un fardeau. L’histoire et la pensée modernes ont été façonnées par l’attente de l’indépendance progressivement réalisée dans tous les domaines. Indépendance de tout contrôle cosmique ou divin, indépendance de toute direction morale assurée par des institutions et en fin de compte, indépendance de toute structure ou modèle de pensée. La raison, par exemple, pour laquelle le régime bolchevique a représenté pendant des décennies un espoir absolu pour un très grand nombre de gens était que sa réelle brutalité pouvait être interprétée comme le présage de l’émancipation totale à venir.
Les souffrances qu’il infligeait étaient ressenties comme proportionnées à l’obscurantisme de l’histoire, des griffes duquel il essayait maintenant de sortir l’humanité. Qu’un système de salut aussi faux ait connu en ce siècle une fin honteuse n’a pas éteint la foi constamment renouvelée dans le fait qu’il valait la peine de payer le prix des échecs et des défaites puisque les chaînes devaient tomber. Cependant, malgré quelques étincelles qui maintenaient une lueur d’espoir, les illusions n’ont pu empêcher l’angoisse grandissante à l’idée que l’homme moderne ne pouvait assumer sa liberté.
Il semblait être parvenu rapidement aux limites de celle-ci lorsque soudain un abîme s’est ouvert : il s’est vu lui-même comme le héros d’efforts spéculatifs, mais aussi comme piètre constructeur de systèmes. Plus il s’entourait de garanties contre les risques, contre les maladies, la domination politique et le contrôle moral de ses actions, plus il devenait fragile, fatigué, dépendant, exploité par le système auquel il avait contribué, et qui prenait la forme d’une nouvelle prison. La conclusion inévitable que seuls quelques-uns en ont tiré fut que nous créons des systèmes pour les détruire ensuite et en créer d’autres à partir de leurs disjecta membra. (De là la vogue du structuralisme qui enseigne que les phénomènes se présentent comme éléments d’une structure à l’intérieur de laquelle, et seulement à l’intérieur de laquelle, ils prennent un sens).
La conséquence en est que l’homme moderne a été saturé de liberté et qu’il aspire maintenant à l’asservissement, ou au moins à la stabilité qu’une structure extérieure qu’il n’aurait pas construite, et qu’une autorité peuvent offrir. Cette aspiration se manifeste de nombreuses manières. L’individualisme et ses droits apparaissent soudain comme excessifs car les gens sont séparés les uns des autres et manquent de solidarité et de convivialité. L’absence imprévue de sentiments communautaires suggère que les liens traditionnels, les conventions sociales, l’autorité politique ne sont pas des entraves contraignantes comme la modernité a voulu le faire croire, mais des institutions grandement bénéfiques, justement parce qu’elles sont respectées et officiellement encouragées.
Cela est vrai pour les liens de citoyenneté, l’appartenance à une communauté qu’on n’a pas choisie comme le groupe linguistique, la nation ou l’église particulière. On a constaté que dans la mesure même où les liens antérieurs s’affaiblissaient, de nouveaux se formaient : à la place de l’Eglise, la secte ; à la place de l’autorité institutionnelle, le gourou escroc ; à la place de la nation, le groupe ethnique ; à la place de la grande communauté, la communauté californienne. La caractéristique de ces nouvelles configurations est leur caractère informel et en dehors de toute institution.
Mais là n’est pas l’aspect essentiel, et on en arrive bientôt à être soumis à la contrainte et à la rigidité. Il est significatif que l’individualisme soit maintenant en déclin : il est de plus en plus considéré comme un fardeau, il n’apparaît plus comme un horizon doré. Cependant, la société officielle reste empêtrée dans une référence à elle-même exclusive de toute autre, dans une souveraineté qu’elle s’arroge, dans l’autorité qu’elle se confère elle-même. Le peuple sent que ce ne sont que des formules creuses et que l’autorité qui ne vient pas de l’extérieur n’est pas authentique. Jean-Pierre Dupuy fournit d’intéressants commentaires : quand les lois sont produites par une société sans référence extérieure ni transcendance, les gens commencent par être flattés, puis rassurés, mais à la fin, ils se posent la question suivante : pourquoi, si je me suis donné une loi, Devrais-je y obéir lorsque elle est momentanément contraire à mes intérêts ou à mes caprices ? Et : si je suis mon propre souverain, pourquoi aurais-je besoin de lois ?
De ces contradictions de plus en plus évidentes de la modernité, il s’ensuit que des conflits s’engendrent à l’intérieur des formes actuelles de coexistence sociale, conflits accompagnés d’une sorte de clause tacite selon laquelle ils ne pourraient être résolus. Cela sonne comme une énormité, contraire à la nature humaine et à ses inclinations. Cependant, une brève réflexion peut éclairer cette proposition. Le philosophe Marcel Gauchet a, à cet égard, une remarque profonde : « Quand les dieux désertent le monde, quand ils cessent de venir signifier leur altérité, c’est le monde lui-même qui se met à nous apparaître autre, à révéler une profondeur imaginaire » (Le désenchantement du monde, Gal., 1985, p. 297).
L’objet de la quête de l’homme aujourd’hui est le monde dans toute son opacité puisqu’il n’est transparent que lorsque nous percevons au-delà de lui un créateur. On pensait autrefois que les conflits avaient pour cause des agents qui du dehors dressaient les hommes les uns contre les autres, parfois pour un bien ultérieur, parfois pour une harmonie subséquente mais non visible. Quand les conflits n’ont pas de justification transcendante aux yeux des participants, ils deviennent la raison d’être de l’existence, un poids qui enracine les hommes dans ce monde. Ils leur permettent de ressentir leur humanité.
Le conflit se transforme en lutte des classes, problèmes sociaux, etc., tumulte grâce auquel des perfectionnements pourront avoir lieu. En bref, le conflit donne aux hommes un sentiment de densité, la sensation d’une existence remplie, face à un arrière-plan de vide. Nous pourrions nous intéresser aux conséquences à travers la réflexion d’un autre philosophe social, Louis Dumont (Essais sur l’individualisme, Seuil, 1983).
La question à laquelle il essaie de répondre est celle de savoir quel enjeu représente l’individualisme moderne pour l’humanité. Sa réponse est que l’individualisme, non en tant que caractère, mais en tant qu’idéologie, requiert une « complète légitimation du monde » et par conséquent, « le transfert complet de l’individu sur le monde » présumé être le monde des traditions et des structures traditionnelles, avec en arrière-plan, la famille et la communauté, et plus particulièrement l’univers invisible.
Quand toute réalité ontologique a été liquidée au profit de l’individuel et du particulier (c’est le triomphe du nominalisme), l’individu et ses actions acquièrent le statut d’uniques existants. Et c’est ainsi que l’homme moderne se présente à nous. Nous sommes prêts à comprendre que ses conflits ne peuvent pas être expliqués plus longtemps par l’ironie supérieure d’un dieu, mais plutôt par l’analyse sociologique des intérêts et des droits respectifs, des motifs psychologiques, de l’arrière-plan idéologique et de l’orientation politique. Nous avons choisi le conflit comme thermomètre des relations humaines et sociales modernes, mais d’autres exemples auraient tout autant été valables.
Ils montrent tous le fardeau écrasant que l’homme a pris l’habitude de partager avec Dieu, que ce soit par le péché et le châtiment, ou la destinée et la puissance. L’homme n’a plus de co-agent. Maintenant, il croit, en tant qu’individu fièrement autonome et souverain, qu’il n’a plus de fardeaux à porter. Les fardeaux font partie du passé. L’homme postmoderne est capable de monter partout où il pose les yeux. La vérité est que, en réalité, les fardeaux sont maintenant de nature différente : c’étaient autrefois les lois imposées, les décisions des supérieurs, la vie en référence aux autres et aux nombreuses servitudes qu’ils impliquent. Les fardeaux ont maintenant changé, ils se nomment solitude, sentiment de culpabilité, et, comme nous l’avons vu plus haut, structures auto-construites.
Ces nouveaux fardeaux sont aussi lourds à porter que l’était le poids des contraintes institutionnelles anciennes. L’homme postmoderne n’est pas non plus exempté des systèmes de croyance qui enfermaient ses ancêtres dans un réseau concentrique de prétendues superstitions aliénantes. Dans la mesure même où l’homme moderne insistait sur la rationalisation des mythes immémoriaux et des vérités qui entouraient sa vie, il a commencé à recréer, de façon très inconsciente, des systèmes de substitution irrationnels. Après avoir désenchanté l’univers et l’avoir retiré du cercle des forces occultes, il a commencé à s’effrayer de ne plus trouver d’esprits ou de fantômes nulle part, et il a essayé d’échapper à ce désenchantement. Il s’est retrouvé à nouveau dans un monde de magie, de trompe-l’œil, d’angoisse et de terrifiants symboles de domination.
En bref, “l’univers ouvert” aspirait à se refermer. C’est un lieu commun de dire que l’homme postmoderne se sent oppressé et coupable : les romans, les poèmes, les pièces et les essais philosophiques s’en font tous l’écho. La liberté du Kirilov des Possédés nous plonge dans un abîme puisqu’elle nous apporte la très coûteuse nouvelle que c’est l’homme, et non Dieu, qui est le pire oppresseur de lui-même et que c’est l’opprimé qui se sent coupable. « Nous avons tué Dieu », comme le résume Nietzsche. L’oppresseur et l’instigateur de la culpabilité ne sont plus des êtres transcendants, ce sont de nouvelles structures, le travail de nos propres mains : la structure épistémologique, sociale, culturelle, politique, la structure de l’âme et de la conscience elle-même.
Alors que le péché originel est ridiculisé comme invention d’hommes alarmistes, comme astuce de curés ou comme signe d’une conscience mutilée, la culpabilité est brusquement redécouverte comme quelque chose qui ne peut s’expliquer d’aucune façon et qui ne peut certainement pas s’effacer. Elle est intégrée aux structures, à toutes les structures. Plus nous effectuerons des recherches sur le corps humain, sur l’âme et sur les paramètres de l’existence, et plus nous serons appelés de façon urgente à réhabiliter la vieille sagesse, et peut-être aussi les vieux démons
Le progrès amène ainsi l’homme à de nouvelles contradictions et à la prise de conscience que son autonomie, une fois achevée, est de nouveau à la recherche de l’hétéronomie. Et alors il est piégé. Non seulement par son orgueil qui ne se résout pas à extérioriser sa thèse ; mais aussi par l’abolition des structures externes et par leur remplacement par une culpabilité interne, qui étrangement, intensifie le mérite de l’individu. L’oppression est humiliante en plus du fait qu’elle est douloureuse ; la culpabilité rassemble les éléments significatifs en l’homme, le transforme en objet d’importance à ses propres yeux, le mesure à la hauteur du mal. Aussi étrange que cela puisse paraître, alors que nous sommes certains de pas être épris d’oppression, nous sommes indissociables du sentiment de culpabilité, il ne fait qu’un avec notre moi. Quoi qu’il en soit, il est notre propre création, particulièrement lorsque, comme aujourd’hui, il n’est pas perçu comme un acte objectif de désobéissance (péché originel), mais comme un acte qui se retourne sur lui-même.
Que l’homme libéré puisse se sentir à nouveau opprimé, c’est là la véritable condition postmoderne qui remet en question les idéaux modernes de liberté, de connaissance, de progrès, de lois qu’on se donne à soi-même, pour lesquels on a combattu et souffert pendant des siècles. Comme si elle avait atteint les limites de son expansion et de son auto-accroissement, l’humanité semble maintenant être confrontée à ce qu’on doit bien appeler une tragédie. Pour paraphraser Malraux à l’Unesco en 1948, si l’homme ne peut trouver son propre visage divin, il sera moins qu’un homme au siècle prochain. Cependant, découvrir un visage divin est impossible pour l’homme moderne car il a délibérément sculpté sa propre image avec des outils anti-divins.
Quoi qu’il fasse (lui, ou son nouvel avatar, l’homme postmoderne), ses actions l’enfoncent plus profondément à l’intérieur de structures d’auto-oppression que la majorité appelle encore libération. L’aspect est alors celui de l’homme problématique qui vient juste d’apprendre qu’il est enfermé dans un système, une succession de systèmes. Ni la linguistique, ni la psychanalyse, ces bulldozers de l’interprétation, ne peuvent en ouvrir les portes. Nous préférons alors appeler cette sombre conception « lucidité », et contempler notre vie en prison sans illusions.
Mais une nouvelle ironie nous attend : en même temps que nous produisons un système et que nous en devenons prisonniers, nous produisons aussi l’illusion que le système peut être forcé. Mais le système et le fait de croire que nous pouvons avoir le dessus sont nés tous les 2 d’une même impulsion humaine. Ceci pourrait être la découverte philosophique centrale de l’âge postmoderne. En effet la captivité dans un système nous permet de scruter pour ainsi dire par derrière la condition humaine et de reconnaître son aspect nocturne, la culpabilité de l’inachèvement.
De là s’ouvrent 2 possibilités, l’une pour les lamentations désespérées du prisonnier, l’autre pour sa métanoïa, sa conversion et l’acceptation de sa condition de créature. À vrai dire, cette dernière option est aussi un « système », mais elle apporte justification et apaisement.
► Thomas Molnar, Catholica n°34, 1992.


