FG Jünger
 ♦ Friedrich-Georg Jünger (1898-1977)
♦ Friedrich-Georg Jünger (1898-1977)
Né le 1er septembre 1898 à Hanovre, frère cadet du célèbre écrivain allemand Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger s'intéresse très tôt à la poésie et suit d'emblée un itinéraire d'éveil fort classique, en lisant et méditant Klopstock, Gœthe et Hölderlin. Grâce à cette immersion précoce dans Hölderlin, FGJ s'engoue pour l'Antiquité classique et voit l'essence de la grécité et de la romanité antiques dans une proximité avec la nature, dans une glorification de l'élémentaire et dans l'instauration d'une vision de l'homme qui demeurera impérissable, survivant au-delà des siècles dans la psyché européenne, tantôt au grand jour tantôt occultée.
L'ère de la technique a détaché les hommes de cette proximité vivifiante et s'est élevée dangereusement au-dessus de l'élémentaire. Toute l'œuvre poétique de FGJ est une protestation véhémente contre la prétention mortifère que constitue cet éloignement. Notre auteur restera marqué par les paysages idylliques de son enfance ; il leur vouera un amour inconditionnel qui ne fléchira jamais, reliant ainsi son moi à la Terre, à la flore et à la faune (surtout les insectes : FG partage avec son frère Ernst la passion de l'entomologie), aux êtres les plus élémentaires de la Vie sur la Terre.
[Ci-dessus : Ernst & Friedrich Georg Jünger beim Schachspiel, par A. Paul Weber, 1935]
◘ L'écrivain politique
 La Grande Guerre met fin à cette jeunesse plongée dans la nature. FGJ s'engage en 1916 comme aspirant officier. Grièvement blessé au poumon sur le front de la Somme en 1917, il passe le reste de la guerre dans un hôpital de campagne. Après sa convalescence, il s'inscrit dans une faculté de droit et obtient le titre de docteur en 1924. Mais il n'entame pas de carrière de juriste. Il devient écrivain politique dans la mouvance nationaliste de gauche, chez les nationaux-révolutionnaires et les nationaux-bolchéviques rassemblés derrière la personnalité d'Ernst Niekisch, éditeur de la revue Widerstand.
La Grande Guerre met fin à cette jeunesse plongée dans la nature. FGJ s'engage en 1916 comme aspirant officier. Grièvement blessé au poumon sur le front de la Somme en 1917, il passe le reste de la guerre dans un hôpital de campagne. Après sa convalescence, il s'inscrit dans une faculté de droit et obtient le titre de docteur en 1924. Mais il n'entame pas de carrière de juriste. Il devient écrivain politique dans la mouvance nationaliste de gauche, chez les nationaux-révolutionnaires et les nationaux-bolchéviques rassemblés derrière la personnalité d'Ernst Niekisch, éditeur de la revue Widerstand.
Dans cette revue et dans Arminius ou Die Kommenden, les frères Jünger inaugurent un style nouveau : celui du “nationalisme soldatique”, exprimé par les jeunes officiers revenus du front et demeurés rétifs aux mollesses de la vie civile. L'expérience des tranchées et des assauts leur a prouvé par la sueur et le sang que la Vie n'est pas un jeu inventé par le cerveau mais un grouillement organique élémentaire dont il faut saisir les pulsations. Le politique, dans sa sphère, doit prendre la température de ce grouillement, se mettre à son écoute, se mouler dans ses méandres et y puiser une force toujours jeune, neuve, vivifiante. Chez FGJ, le politique est appréhendé sous l'angle cosmique, en dehors de tous les « miasmes bourgeois, cérébraux et intellectualisants ».
Parallèlement à cette activité de journaliste politique et de prophète de ce nouveau nationalisme radicalement anti-bourgeois, FGJ se plonge dans Dostoïevski, Kant et les grands romanciers américains. Avec son frère Ernst, il voyage dans les pays méditerranéens : la Dalmatie, Naples, la Sicile et les Îles de l'Égée.
◘ L'exil intérieur
Quand Hitler accède au pouvoir, c'est un nationalisme des masses qui triomphe et non le nationalisme absolu et cosmique dont avait rêvé la petite phalange « froidement exaltée » qui éditait ses textes dans les revues nationales-révolutionnaires. Dans un poème, Der Mohn (Le Coquelicot), FGJ ironise et désigne le national-socialisme comme le « chant infantile d'une ivresse sans gloire ». Conséquence de ces vers sarcastiques : il subit quelques tracasseries policières, quitte Berlin et s'installe, avec Ernst, à Kirchhorst en Basse-Saxe.
Retiré de la politique après avoir publié près d'une centaine de poèmes dans la revue de Niekisch — lequel est de plus en plus menacé par les autorités qui finissent par l'arrêter en 1937 — FGJ se consacre à sa poésie et publie en 1936 un essai Über das Komische et achève en 1939 la première version de son ouvrage philosophique majeur, Die Perfektion der Technik (La perfection de la technique).
Les premières épreuves de ce livre sont détruites en 1942 lors d'un bombardement allié. En 1944, une première édition, réalisée à partir d'un nouveau jeu d'épreuves est réduite en cendres lors d'une attaque aérienne. Finalement, le livre paraît en 1946, suscitant un débat autour des questions de la technique et de la nature, préfigurant, en dépit de son orientation “conservatrice”, toutes les revendications écologiques allemandes des années 60, 70 et 80. Pendant la guerre, FGJ publie poèmes et textes sur la Grèce antique et ses dieux.
◘ L'essayiste après-guerre
 Avec la parution de Die Perfektion der Technik, qui connaît plusieurs éditions successives, les intérêts de FGJ se portent vers les thématiques de la technique, de la nature, du calcul, de la mécanicisation, de la massification et de la propriété. Refusant, dans Die Perfektion der Technik d'énoncer ses thèses sur un schéma classique linéaire, causal et systématique, FGJ développe ses idées “en spirale” et en vrac, éclairant tour à tour tel ou tel aspect de la technicisation globale. En filigrane, on aperçoit une critique des thèses qu'avait énoncées son frère Ernst dans Der Arbeiter (1932), où il acceptait comme inévitables les développements de la technique moderne. Sa démarche anti-techniciste se rapproche de celles d'Ortega y Gasset (Meditación de la técnica, 1939), de Henry Miller et de Lewis Mumford (qui utilisait le terme de “mégamachine”).
Avec la parution de Die Perfektion der Technik, qui connaît plusieurs éditions successives, les intérêts de FGJ se portent vers les thématiques de la technique, de la nature, du calcul, de la mécanicisation, de la massification et de la propriété. Refusant, dans Die Perfektion der Technik d'énoncer ses thèses sur un schéma classique linéaire, causal et systématique, FGJ développe ses idées “en spirale” et en vrac, éclairant tour à tour tel ou tel aspect de la technicisation globale. En filigrane, on aperçoit une critique des thèses qu'avait énoncées son frère Ernst dans Der Arbeiter (1932), où il acceptait comme inévitables les développements de la technique moderne. Sa démarche anti-techniciste se rapproche de celles d'Ortega y Gasset (Meditación de la técnica, 1939), de Henry Miller et de Lewis Mumford (qui utilisait le terme de “mégamachine”).
En 1949, il publie un ouvrage remarqué sur Nietzsche, où il s'interroge sur le sens à conférer à la théorie cyclique du temps énoncée par le solitaire de Sils-Maria. FGJ conteste l'utilité de théoriser et de problématiser une conception cyclique du temps car cette théorisation et cette problématisation finissent par octroyer au temps une forme unique, intangible, qui, chez Nietzsche, est posée comme cyclique. Le temps cyclique, propre de la Grèce des origines et de la pensée pré-chrétienne, doit être perçu sous l'angle de l'imaginaire et non sous celui de la théorie, ce qui permet de conjuguer tout naturellement sur un mode unique l'éternité et l'instant et fait disparaître les coupures arbitraires instaurées par le temps mécanique et segmentarisant des visions linéaires.
La temporalité cyclique nietzschéenne, par son découpage en cycles identiques et répétés, conserve, pense FGJ, quelque chose de mécanique, de newtonien, et n'est finalement pas “grecque”. Le temps selon Nietzsche reste un temps-policier, menaçant. Il n'est pas soutien, support (tragend und haltend). FGJ chante une a-temporalité, celle de la naturalité la plus élémentaire, de la Wildnis, ce royaume de Pan, ce fond-de-monde naturel intact, non touché par l'homme, qui est, en dernière instance, accès au divin, au secret ultime du monde. La Wildnis, concept fondamental chez le poète panique FGJ, est la matrice de toute vie et le réceptacle où retourne toute vie.
En 1970, FGJ fonde avec Max Himmelheber la revue trimestrielle Scheidewege, où s'exprimeront jusqu'en 1982 les principaux représentants d'une pensée à la fois naturaliste et conservatrice, sceptique à l'égard de toutes les formes de planification technique. De nombreux penseurs situés dans cette veine conservatrice-écologique y exposeront leurs thèses, parmi lesquels Jürgen Dahl, Hans Sedlmayr, Friedrich Wagner, Adolf Portmann, Erwin Chargaff, Walter Heitler, Wolfgang Hädecke, etc.
FGJ meurt à Überlingen, sur les rives du Lac de Constance, le 20 juillet 1977.
◘ Religiosité cosmique
[Ci-contre : Espace sacré. « Ainsi se résorbe, à chaque pas que nous faisons sur la montagne, le dessin confus des horizons : lorsque nous sommes parvenus assez haut, nous ne sommes plus environnés, en quelque lieu que nous soyons, que par un pur anneau qui nous fiance à l'éternité » (Sur les falaises de marbre)]
chaque pas que nous faisons sur la montagne, le dessin confus des horizons : lorsque nous sommes parvenus assez haut, nous ne sommes plus environnés, en quelque lieu que nous soyons, que par un pur anneau qui nous fiance à l'éternité » (Sur les falaises de marbre)]
Le germaniste américain Anton H. Richter, dans l'ouvrage qu'il a consacré à l'œuvre de FGJ, dégage 4 thématiques essentielles dans l'œuvre de notre auteur : l'Antiquité classique, l'essence cyclique de l'existence, la technique et l'irrationnel. Dans ses textes sur l'Antiquité grecque, FGJ pose la dichotomie dionysiaque/ titanique. Dans le dionysiaque, il englobe l'apollinien et le panique, en un front uni des forces intactes de l'organicité contre les distorsions, la fragmentation et l'unidimensionalité du titanisme et du mécanicisme de notre siècle.
L'attention de FGJ se porte essentiellement sur les éléments chtoniens et orgiaques de l'Antiquité. Dans cette optique, les motifs récurrents de ses poèmes sont la lumière, le feu et l'eau, forces élémentaires auxquelles il rend hommage. Se gaussant de la raison calculatrice, de son inefficacité fondamentale, il exalte, en contrepartie, la puissance du vin, l'exubérance de la fête, le sublime de la danse et les joies du carnaval. Pour arraisonner le réel, l'intuition des forces, des puissances de la nature, du chtonien, du biologique, du somatique et du sang, est une arme bien plus efficace que la raison, qui épure, équarrit, purge, découpe, dépouille et ne laisse au regard de l'homme contemporain que des schémas incomplets.
Apollon apporte l'ordre clair et la sérénité ; Dionysos apporte les joies, celles du vin et des fruits, de l'extase et de l'ivresse ; Pan, gardien de la nature, apporte la fertilité. Face à ces généreux donateurs, les Titans conquièrent, accumulent des richesses, guerroient cruellement contre ces dieux de la profusion et de l'abondance et, parfois, les tuent, lacèrent leurs corps et les dévorent. Pan est la figure centrale du panthéon de FGJ. C'est lui qui règne sur la Wildnis, que veulent dépouiller totalement les Titans. FGJ se réfère ensuite à Empédocle qui nous dit que l'homme forme un continuum avec la nature. Toute la nature est en l'homme et agit à travers lui par l'amour.
Symbolisé par les rivières et les serpents, le principe de récurrence, de retour incessant, de ce cheminement à rebours de toutes choses vers la Wildnis originelle voire le retour inéluctable de la Wildnis au sein de toutes choses, est central dans la poésie et la pensée de FGJ, qui chante le temps cyclique, si différent du temps linéaire/directionnel du judéo-christianisme, segmenté en moments uniques sur la voie, elle aussi unique, qui mène à la Rédemption. L'homme occidental moderne, allergique aux impondérables cachés ou visibles de la Wildnis, a opté pour ce temps continu et vectoriel, dans lequel son existence n'est qu'un segment entre 2 éternités a-temporelles. Deux types humains s'affrontent donc : l'homme moderne, imprégné de la vision judéo-chrétienne et linéaire du temps et l'homme archaïque, qui se perçoit comme indissolublement connecté au cosmos et aux rythmes cosmiques.
◘ La Perfection de la technique (Die Perfektion der Technik, 1946)
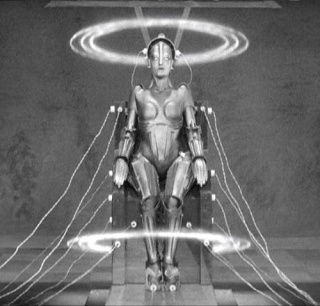 Dénonciation du titanisme machiniste de la pensée occidentale, cet ouvrage est la carrière où viennent encore puiser toutes les pensées écologiques contemporaines pour affiner leurs critiques. Divisé en 2 parties et un ex cursus, eux-mêmes divisés en une multitude de petits chapitres concis, l'ouvrage commence par un constat : la littérature utopique ne prend plus pour matière la politique mais la technique, ce qui provoque un désenchantement de la veine utopique. La technique ne résoud aucun problème existentiel de l'homme. Elle n'augmente pas le temps de loisir ; elle ne réduit pas le travail : elle ne fait que le déplacer du manuel vers l'« organisatif ». Par ailleurs, elle ne crée pas de richesses nouvelles, au contraire, elle condamne la condition ouvrière à être celle du paupérisme.
Dénonciation du titanisme machiniste de la pensée occidentale, cet ouvrage est la carrière où viennent encore puiser toutes les pensées écologiques contemporaines pour affiner leurs critiques. Divisé en 2 parties et un ex cursus, eux-mêmes divisés en une multitude de petits chapitres concis, l'ouvrage commence par un constat : la littérature utopique ne prend plus pour matière la politique mais la technique, ce qui provoque un désenchantement de la veine utopique. La technique ne résoud aucun problème existentiel de l'homme. Elle n'augmente pas le temps de loisir ; elle ne réduit pas le travail : elle ne fait que le déplacer du manuel vers l'« organisatif ». Par ailleurs, elle ne crée pas de richesses nouvelles, au contraire, elle condamne la condition ouvrière à être celle du paupérisme.
Le déploiement de la technique est dû à un manque général que la raison cherche à combler. Mais ce manque ne disparaît pas avec l'envahissement de la technique : il n'est que camouflé. La machine est dévorante, annihilatrice de substance : sa rationalité est dès lors illusoire. L'économiste croit, dans un premier temps, que la technique est génératrice de richesses puis s'aperçoit que sa rationalité quantitativiste n'est qu'apparence, que la technique, dans sa volonté de se perfectionner à l'infini, ne suit que sa propre logique, qui n'est pas économique. Le monde moderne est dès lors caractérisé par un conflit tacite entre l'économiste et le technicien : ce dernier vise à déterminer les processus de production en dépit de la rentabilité, facteur jugé trop subjectif. La technicité, quand elle atteint son plus haut degré, conduit à une économie dysfonctionnante.
Cette opposition entre la technique et l'économie étonnera plus d'un critique de l'unidimensionalité contemporaine, habitué à mettre sur un même plan les hypertrophies économique et technique. Mais FGJ voit l'économie telle que la définit implicitement son étymologie, soit la mise en norme de l'oikos, de la demeure de l'homme, bien circonscrite dans le temps et dans l'espace. La mise en forme de l'oikos ne procède pas d'une mobilisation outrancière des ressources, assimilable à l'économie du pillage et de la razzia (Raubbau), mais d'une fertilisation parcimonieuse du lieu que l'on occupe sur la terre.
L'idée centrale de FGJ sur la technique, c'est de dire qu'elle est un automatisme dominé par sa propre logique. Dès que celui-ci se met en route, il échappe à ses créateurs. Il se multiplie de façon exponentielle : les machines imposent la création d'autres machines, jusqu'à aboutir à une automatisation complète, à la fois mécanique et dynamique, dans un temps segmenté outrancièrement, donc dans un temps mort. Ce temps mort pénètre dans le tissu organique de l'être humain et soumet l'homme à sa logique mortifère. L'homme ne possède dès lors plus son temps, intérieur et biologique, mais cherche fébrilement l'adéquation au temps inorganique/mort de la machine. La vie en vient à être soumise inexorablement au grand automatisme que produit la technique et qui finit par la réguler entièrement.
L'automatisme généralisé est la “perfection de la technique”, à laquelle FGJ, penseur organiciste, oppose la maturation (die Reife) que seuls les êtres naturels peuvent atteindre, sans violence ni coercition. La caractéristique majeure de la gigantesque organisation technique, dominante à l'époque contemporaine, est la domination exclusive qu'exercent les déterminations et déductions causales, propres de la technique. L'État, en tant qu'instance politique, peut acquérir, par le biais de la technique, davantage de puissance. Mais c'est là, pour lui, une sorte de pacte avec le diable car les principes de la technique s'insinuent alors en lui pour extirper sa substance organique et la remplacer par de l'automatisme technique.
Qui dit automatisation totale dit organisation totale, au sens de gestion. Le travail, à l'ère de la multiplication exponentielle des automates, est organisé à la perfection au point qu'il se détache de l'immédiateté ergonique que procurent la main et l'outil. Ce détachement entraîne la spécialisation à outrance, ce qui implique interchangeabilité, normalisation, standardisation. FGJ ajoute la Stückelung (morcellement, tronçonnement, “piècisation”) où les “morceaux” ne sont plus parties (pars, partes, Teile) mais pièces (Stücke) réduites à une fonction dans l'appareil.
FGJ rejoint Marx pour dénoncer l'aliénation de ce processus mais se distingue de lui quand il considère le processus comme fatal tant qu'on reste enchaîné/ connecté (gekettet / angeschloßen) à l'appareillage techno-industriel. L'ouvrier (Arbeiter) est ouvrier précisément parce qu'il est connecté volens nolens à cet appareil. La condition ouvrière ne dépend pas de la modestie des revenus mais de cette connexion, indépendamment du montant du salaire. La connexion dépersonnalise, fait perdre la qualité de personne. L'ouvrier est celui qui a perdu le rapport intérieur qui le lie à son activité, rapport qui faisait qu'il n'y avait pas d'interchangeabilité possible, ni entre lui et un autre ni entre sa fonction et une autre. L'aliénation n'est donc pas d'abord économique, comme l'avait pensé Marx, mais technique.
L'automatisme général en progression dévalorise tout travail issu directement de l'intériorité du travailleur et enclenche le processus de destruction de la nature, le processus de “dévorement” (Verzehr) des substrats (des ressources offertes par Mère-Nature, généreuse donatrice). À cause de cette aliénation d'ordre technique, l'ouvrier est précipité dans un monde d'exploitation sans la moindre protection. Pour bénéficier d'un semblant de protection, il doit créer des organisations, notamment des syndicats, mais celles-ci et ceux-ci restent connectés à l'appareil.
L'organisation protectrice n'émancipe pas, elle enchaîne. L'ouvrier se défend contre l'aliénation et la “piècisation” mais accepte paradoxalement le système de l'automatisation totale. Marx, Engels et les premiers socialistes n'ont vu que l'aliénation politique et économique et non l'aliénation technique. Il n'y a pas eu, chez eux, prise au sérieux des machines. La dialectique de Marx, de ce fait, est devenue un mécanicisme stérile, au service d'un socialisme machiniste. Le socialisme est resté dans la même logique que celle de l'automatisation totale sous l'égide capitaliste. Pire, son triomphe ne mettrait pas fin à l'aliénation automatiste mais participerait de ce mouvement en l'accélérant, en le simplifiant et en l'accroissant.
La création d'organisations généralise la mobilisation totale, qui rend toutes choses mobiles et tous lieux pareils à des ateliers ou des laboratoires bourdonnants d'agitation incessante. Toute zone sociale tentant d'échapper à cette mobilisation totale contrarie le mouvement et subit en conséquence la répression : s'ouvrent alors les camps de concentration, s'amorcent les déportations de masse et les massacres collectifs. C'est le règne du gestionnaire impavide, figure sinistre apparaissant sous mille masques.
La technique ne produit pas d'harmonie, la machine n'est pas une déesse qui dispense du bonheur. Au contraire, elle stérilise les substrats naturels donateurs, organise le pillage jusqu'au bout de la Wildnis. La machine est dévoreuse, doit sans cesse être alimentée et, parce qu'elle accapare plus qu'elle ne donne, elle épuise les richesses de la Terre. D'énormes forces naturelles élémentaires sont arraisonnées par la gigantesque machinerie et retenues prisonnières par elle et en elle, ce qui conduit parfois à des catastrophes explosives et nécessite une surveillance constante, autre facette de la mobilisation totale.
Les masses s'imbriquent, volontaires, dans cette automatisation totale, annihilant du même coup les résistances isolées, faits d'individualités conscientes. Les masses se laissent porter par le mouvement trépidant de l'automatisation, si bien qu'en cas de panne ou d'arrêt momentané du mouvement linéaire vers l'automatisation, elles éprouvent une sensation de vide qui leur apparaît insupportable.
La guerre est désormais, elle aussi, totalement mécanisée. Les potentiels de destruction sont amplifiés à l'extrême. Mais l'éclat des uniformes, la valeur mobilisatrice des symboles, la gloire s'estompent. On n'attend plus des soldats qu'endurance et courage tenace.
La mobilité absolue qu'inaugure l'automatisation totale se tourne contre tout ce qui recèle durée et stabilité, notammant la propriété (Eigentum). FGJ, en posant cette assertion, définit la propriété d'une manière originale : l'existence des machines repose sur une conception exclusivement temporelle ; l'existence de la propriété sur une conception de l'espace. La propriété implique des limites, des délimitations, des haies, des murs et murets, des enclosures. Ces délimitations, le collectivisme techniciste, veut les faire disparaître.
La propriété donne un champ d'action limité, circonscrit, clos dans un espace déterminé, précis. Pour pouvoir progresser vectoriellement, l'automatisation doit faire sauter les verrous de la propriété, obstacle à l'installation de ses réseaux omniprésents de communication et de connection. Une humanité dépourvue de toutes formes de propriété ne peut échapper à la connection totale.
Le socialisme, en niant la propriété, en refusant que demeurent dans le monde des zones “encloses”, facilite précisément la connection absolue. Donc le possesseur de machines n'est pas un propriétaire ; le capitaliste machiniste sape l'ordre des propriétés, caractérisé par la durée et la stabilité, au profit d'un dynamisme omnidissolvant. L'indépendance de la personne n'est possible que s'il y a non connection aux faits et au mode de penser de l'appareillisme et de l'organisationisme techniques.
Entre ses réflexions critiques et acerbes sur l'automatisation et la technicisation outrancière des temps modernes, FGJ interpelle les grands philosophes de la tradition européenne. Descartes inaugure un dualisme qui instaure une séparation insurmontable entre le corps et l'esprit et élimine le systema influxus physici qui les reliait tous 2, pour le remplacer par une intervention divine ponctuelle qui fait de Dieu un Dieu-horloger. La res extensa de ce fait est chose morte : elle s'explique comme un agencement de mécanismes dans lequel l'homme, instrument du Dieu-horloger, peut intervenir à tout moment et impunément. La res cogitans s'institue alors comme maîtresse absolue des processus mécaniques régentant l'univers. L'homme peut devenir comme Dieu : un horloger qui peut manipuler toutes les choses à sa guise, sans crainte ni respect. Le cartésianisme donne le signal de l'exploitation techniciste à outrance de la planète.
► Robert Steuckers, 1991.
◙ Bibliographie :
☻ En allemand :
◘ 1) Œuvres juridiques, philosophiques ou mythologiques, essais, aphorismes :
- Über das Stockwerkseigentum, dissertation présentée à la faculté de droit de l'Université de Leipzig, 3 mai 1924
- Aufmarsch des Nationalismus, 1926
- Der Krieg, 1936
- Über das Komische, 1936
- Griechische Götter, 1943
- Die Titanen, 1944
- Die Perfektion der Technik, 1946, 1949 (2), 1953 (3)
- Griechische Mythen, 1947
- Orient und Okzident, 1948
- Nietzsche, 1949
- Gedanken und Merkzeichen, 1949
- Rhythmus und Sprache im deutschen Gedicht, 1952
- Die Spiele, 1953
- Gedanken und Merkzeichen, Zweite Sammlung, 1954
- Sprache und Kalkül, 1956
- Gedächtnis und Erinnerung, 1957
- Sprachen und Denken, 1962
- Orient und Okzident, 2ème éd. augmentée de textes nouveaux, 1966
- Die vollkommene Schöpfung, 1969
- Der Arzt und seine Zeit, 1970
◘ 2) Poésie :
- Gedichte, 1934
- Der Krieg, 1936
- Der Taurus, 1937
- Der Missouri, 1940
- Der Westwind, 1946
- Die Silberdistelklause, 1947
- Das Weinberghaus, 1947
- Die Perlenschnur, 1947
- Gedichte, 1949
- Iris im Wind, 1952
- Ring der Jahre, 1954
- Schwarzer Fluß und windweißer Wald, 1955
- Es pocht an der Tür, 1968
- Sämtliche Gedichte, 1974.
Le poème Der Mohn (1934) a été reproduit dans Scheidewege, 10 Jg., 3, 1980, pp. 283-284.
◘ 3) Œuvres dramatiques, récits, romans, conversations, souvenirs et esquisses de voyage :
- Der verkleidete Theseus : Ein Lustspiel in fünf Aufzügen, 1934
- Briefe aus Mondello 1930, 1943
- Wanderungen auf Rhodos, 1943
- Gespräche, 1948
- Dalmatinische Nacht, 1950
- Grüne Zweige, 1951
- Die Pfauen und andere Erzählungen, 1952
- Der erste Gang, 1954
- Zwei Schwestern, 1956
- Spiegel der Jahre, 1958
- Kreuzwege, 1961
- Wiederkehr, 1965
- Laura und andere Erzählungen, 1970.
◘ 4) Principaux articles dans les revues politiques nationales-révolutionnaires et nationales-bolchéviques (d'après Anton H. Richter, op. cit., infra) :
- « Das Fiasko der Bünde », in Arminius, 7, 41, 1926, pp. 5-7
- « Die Kampfbünde », « Der Soldat », « Kampf ! », « Normannen », in Die Standarte, 1, 1926, pp. 8-11, p. 198, pp. 342-343, p. 448
- « Deutsche Aussenpolitik und Russland », in Arminius, 8, 3, 1927, pp. 4-7
- « Gedenkt Schlageter ! », in Arminius, 8, 7, 1927, p. 4
- « Opium fürs Volk », in Arminius, 8, 28, 1927, pp. 4-6
- « Der Pazifismus : Eine grundsätzliche Ausführung », in Arminius, 8, 36, 1927, pp. 6-9 et 8, 37, 1927, pp. 6-8
- « Die Gesittung und das soziale Drama », in Die Standarte, 2, 1927, pp. 253-256
- « Des roten Kampffliegers Ende : Manfred von Richthofen zum Gedächtnis », in Der Vormarsch, 1, 1927/28, pp. 119-120
- « Dreikanter », « Die Schlacht », Der Vormarsch, 2, 1928/29, pp. 16-18 et pp. 296-298
- « Chaplin », « Der Fährmann », « Konstruktionen und Parallelen », « Vom Geist des Krieges », « Bombenschwindel », in Widerstand, 4, 1929, pp. 15-19, p. 139, pp. 177-181, pp. 225-230 et pp. 291-295
- « Revolution und Diktatur », in Das Reich, 1, 1930/31, pp. 9-12 ainsi que dans Die Kommenden, 5, 1930, pp. 541-542
- « Vom deutschen Kriegsschauplätze », in Widerstand, 6, 1931, pp. 257-263
- « Die Innerlichkeit », in Widerstand, 7, 1932, pp. 362-363
- « Über die Gleichheit », « Wahrheit und Wirklichkeit », « E.T.A. Hoffmann », Widerstand, 9, 1934, pp. 97-101, pp. 138-147 et pp. 376-383.
◘ 5) Participation à des ouvrages collectifs :
- Dans l'ouvrage édité par Ernst Jünger et intitulé Die Unvergessenen (1928), FGJ a écrit des monographies sur Otto Braun, Hermann Löns, Manfred v. Richthofen, Gustav Sack, Albert Leo Schlageter, Maximilian von Spee, Georg Trakl
- « Krieg und Krieger » in Ernst Jünger, Krieg und Krieger, 1930, pp. 51-67
- FGJ a écrit l'introduction du livre d'iconographie d'Edmund Schultz, Das Gesicht der Demokratie : Ein Bilderwerk zur Geschichte der deutschen Nachkriegszeit (1931)
- « Glück und Unglück », in Was ist Glück ?, actes d'un symposium organisé par Armin Mohler dans le cadre de la Carl Friedrich von Siemens Stiftung de Munich, Munich, 1976.
◘ 6) Sur F.G. Jünger :
- Franz Joseph Schöningh, « F. G. Jünger und der preussische Stil », in Hochland, févr. 1935, pp. 476-477
- Emil Lerch, « Dichter und Soldat : F. G. Jünger » in Schweizer Annalen, juillet-août 1936, pp. 343-347
- Wilhelm Schneider, « Die Gedichte von F. G. Jünger », in Zeitschrift für Deutschkunde, déc. 1940, pp. 360-369
- Walter Mannzen, « Die Perfektion der Technik », in Der Ruf der jungen Generation, 1, Nr.6, nov. 1946, pp. 13-15
- Stephan Hermlin, « F. G. Jünger : “Perfektion der Technik” », in Ansichten über einige neue Schriftsteller und Bücher, Wiesbaden, 1947
- Sophie Dorothee Podewils, F. G. Jünger : Dichtung und Echo, Hambourg, 1947
- Josef Wenzl, « Im Labyrinth der Technik : Zu einem neuen Buch FG Jüngers », in Wort und Wahrheit, 3, 1948, pp. 58-61
- Max Bense & Helmut Günther, « “Die Perfektion der Technik” : Bemerkungen über ein Buch von FG Jünger », in Merkur, 1948, pp. 301-310
- Karl August Horst, « F. G. Jünger und der Spiegel der Meduse », in Merkur, 1955, pp. 288-291
- Curt Hohoff, « F. G. Jünger », in Jahresring, 1956/57, pp. 379-382
- F. G. Jünger zum 60. Geburtstag, 1958 (avec « Rede auf FGJ » de Benno von Wiese et une bibliographie d'A. Mohler)
- Hans Egon Holthusen, « Tugend und Manier in der heilen Welt : Zu F.G. Jüngers “Spiegel der Jahre” », in Hochland, 51, févr. 1959, pp. 268-273
- Hans-Peter des Coudres, « F.-G. Jünger Bibliographie », in Philobiblon, Hambourg, VII/3, sept. 1963, pp. 160-192
- Franziska Ogriseg, Das Erzählwerk F. G. Jüngers, Dissertation, Innsbruck, 1965
- Heinz Ludwig Arnold, « FG Jünger : ein Erzähler, der zu meditieren weiss », in Merkur, 1968, pp. 859-861
- Sigfrid Bein, « Der Dichter am See : Zum 70. Geburtstag F. G. Jüngers », Welt und Wort, 23, 1968, pp. 299-301
- Dino Larese, F. G. Jünger : Eine Begegnung, Amriswil, 1968
- Armin Mohler, « FG Jünger », in Criticón, 46, 1978, pp. 60-63 (bibliographie complète pour l'essentiel)
- Wolfgang Hädecke, « Die Welt als Maschine : Über FG Jüngers Buch “Die Perfektion der Technik” », in Scheidewege, 10 Jg., 3, 1980, pp. 285-317 (analyse très fouillée de l'ouvrage philosophique majeur de FGJ)
- Anton H. Richter, A Thematic Approach to the Works of F.G. Jünger, Berne/Francfort s/M, 1982 (ouvrage le plus complet sur l'œuvre de FGJ ; la bilbiographie comprend également tous les articles non politiques de FGJ)
 ◘ 7) Pour comprendre le contexte familial et politique :
◘ 7) Pour comprendre le contexte familial et politique :
- Karl O. Paetel, Versuchung oder Chance ? Zur Geschichte des deutschen Nationalbolschewismus, Musterschmidt, Göttingen, 1965
- Marjatta Hietala, Der neue Nationalismus in der Publizistik Ernst Jüngers und des Kreises um ihn 1920-1933, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 1975
- Heimo Schwilk, Ernst Jünger : Leben und Werk in Bildern und Texten, Klett-Cotta, 1988
- Martin Meyer, Ernst Jünger, Munich, 1990
- Ulrich Fröschle, FG Jünger und der „radikale Geist“ : Eine Fallstudie zum literarischen Radikalismus der Zwischenkriegszeit, Thelem, Dresden, 2008
Le lecteur consultera également les multiples volumes du Journal d'Ernst Jünger (chez Christian Bourgois).
☻ En français :
♦ Chapitres de Griechische Mythen :
- « Apollon », in Nouvelle École n°35, 1979 *
- « Dionysos et le Grand Pan » ; « Héraclès et Achille » , p. 9-15 in Antaïos n°13, sept. 1998 *
- « Les titans et les dieux » ; « L’homme titanesque » in Krisis n°23, janv. 2000
* : Textes insérés sur ce billet.
♦ Chapitres de Nietzsche :
- « Le joueur de rôles » ; « La masse » in Nouvelle École n°51, 2000 [lire plus bas]
♦ Autres textes :
- « Prélude », préf. à Walter F. Otto, L'esprit de la religion grecque ancienne : Theophania, Agora/Pocket, 1995
- « Choix de poèmes » (29 poésies) in Lieux d’être n°2, 1998
- « Félicité » in Les Carnets (Revue du Centre de Recherche et de Documentation Ernst Jünger) n° 3, 1998
- « La perfection de la technique », Krisis n°24, nov. 2000
- « Dionysos », in Nouvelle École n°58, 2009
♦ Études :
- Robert de Herte, « Friedrich-Georg Jünger », in éléments n°23, sept. 1977
- Robert Steuckers, « L'itinéraire philosophique et poétique de FG Jünger », in Vouloir n° 45/46, 1988, pp. 10-12
- Volker Beismann, « Dans les couloirs du labyrinthe : le journalisme politique dans les premières œuvres de FG Jünger », in Nouvelle École n°48, 1996
- Danièle Beltran-Vidal, « Thèmes du néoplatonisme dans la création littéraire d'E. et FG Jünger », in Cahiers philosophiques de Strasbourg n°22, 2007
- — , « Exil intérieur et nouvelle définition de la communauté dans le recueil de poèmes Der Taurus de FG Jünger », in La communauté : fondements psychologiques et idéologiques d'une représentation identitaire, MSH, Grenoble, 2003
- Cahiers Ernst Jünger n°3 & n°6

 ◘ L'itinéraire philosophique et poétique de Friedrich-Georg Jünger
◘ L'itinéraire philosophique et poétique de Friedrich-Georg Jünger
Avertissement : La notice biographique ci-haut, destinée à l'Encyclopédie des Œuvres Philosophiques (PUF), reprenait en grande partie l'article ci-dessous. Nous le reproduisons ici à fin d'archivage.
[Le symbole du serpent, symbole circulaire, labyrinthique, symbole de proximité avec la terre et d'aspiration au soleil, tient une place essentielle dans l'œuvre de FG Jünger. Ci-dessous, Apollon, sculpté par le “Phidias” du XXe siècle, l'Allemand Arno Breker. Entre la “telluricité” du serpent et la “solarité” d'Apollon, FGJ explore le donné brut de la nature, soubassement obligatoire de tout agir humain et source éternelle de toute chose, source qu'il s'agit de protéger et de préserver, en dépit des idéologies quantitativistes, mécanicistes et profanatrices]
 Si le public français a été intensément familiarisé avec l'œuvre d'Ernst Jünger et si celui-ci est plus connu et prisé actuellement à Paris qu'en Allemagne, où des nervis braillent et gesticulent dans les rues quand il reçoit, enfin, le Prix Gœthe en 1982, son frère Friedrich-Georg demeure quasiment un inconnu et ses livres, profonds et fondamentaux, ne sont ni traduits ni commentés. Un universitaire américain, Anton H. Richter, a publié, lui, une étude en 1982 qui aborde les 4 thèmes majeurs de l'œuvre de Friedrich-Georg : l'antiquité classique, l'essence cyclique de l'existence, la technique et l'irrationnel. Mais, première question qui vient à la bouche de celui qui veut connaître son œuvre : sur quel arrière-plan biographique ces thématiques se détachent-elles ?
Si le public français a été intensément familiarisé avec l'œuvre d'Ernst Jünger et si celui-ci est plus connu et prisé actuellement à Paris qu'en Allemagne, où des nervis braillent et gesticulent dans les rues quand il reçoit, enfin, le Prix Gœthe en 1982, son frère Friedrich-Georg demeure quasiment un inconnu et ses livres, profonds et fondamentaux, ne sont ni traduits ni commentés. Un universitaire américain, Anton H. Richter, a publié, lui, une étude en 1982 qui aborde les 4 thèmes majeurs de l'œuvre de Friedrich-Georg : l'antiquité classique, l'essence cyclique de l'existence, la technique et l'irrationnel. Mais, première question qui vient à la bouche de celui qui veut connaître son œuvre : sur quel arrière-plan biographique ces thématiques se détachent-elles ?
Né le 1er septembre 1898 à Hanovre, le jeune Friedrich-Georg s'intéresse très tôt à la poésie et suit d'emblée un itinéraire d'éveil fort classique : Klopstock, Gœthe, Hölderlin. Avec cette immersion précoce dans Hölderlin, FG s'engoue pour l'antiquité classique et voit l'essence de la grécité et de la romanité antiques dans une proximité avec la nature, dans une glorification de l'élémentaire et dans l'instauration d'une vision de l'homme impérissable, qui survit dans la psychè européenne, tantôt au grand jour, tantôt occultée. Notre ère contemporaine, marquée par l'avènement de la technique s'est, elle, détachée de cette proximité vivifiante, s'est élevée dangereusement au-dessus de cet élémentaire sous-jacent et incontournable et a opté pour une autre vision de l'homme. Toute l'œuvre de FG constitue une protestation, sans véhémence mais empreinte de beaucoup de tristesse, à l'endroit de ce déclin, de cette assomption déshumanisante.
Paysages, flore, insectes
Les paysages ruraux et idylliques de son enfance, entre Hanovre, Schwarzenburg (Erzgebirge) et une maison de vacances de la famille (Rehburg-Steinhuder Meer) imprégneront définitivement le cœur de FG : ils deviendront les « paysages de son âme ». L'adolescent termine ses études secondaires à Detmold, à la lisière de la Forêt de Teutoburg, où, jadis, Arminius, chef des Chérusques, avait vaincu les légions de Varus. Friedrich-Georg, futur combattant nationaliste, futur auteur d'un texte sublime sur l'esprit des sagas scandinaves et des scaldes islandais, héritera d'abord d'un a priori contre la mythologie nationaliste qui obligeait les étudiants à rédiger rédactions ou dissertations sur la figure du libérateur antique de la Germanie, à l'ombre de sa gigantesque statue. Les résultats de cette pédagogie, faut-il le dire, furent plutôt navrants : des milliers de textes gribouillés à la hâte, pompiers, insipides. Plutôt que ce passé bruyant, que les souvenirs de cette bataille avivés par la résurrection du Reich sous l'impulsion de Bismarck, la Forêt de Teutoburg enseigne au jeune FG un amour de la flore et des insectes, amour qui relie son moi aux êtres les plus élémentaires de la Vie sur la Terre.
À cette flore et à cette faune, s'ajoute l'élément aqueux du Steinhuder Meer, où FG et Ernst se baignent nus, en dépit des conventions bourgeoises et afin d'endurcir leurs corps, de les confronter à la Nature brute, aux griffes des ronces, aux morsures des insectes, aux rayons du soleil. Ces exercices visent à débarrasser leurs personnes de l'armure pesante de la civilisation et le contact avec les eaux du lac constitue une volonté de renouer avec l'Urerlebnis (“le vécu primal”) qu'évoquait déjà Pindare : ariston men udor, la meilleure des choses est l'eau.
L'expérience de la guerre
Cette existence tranquille, naturelle, idyllique, détachée des turbulences de la technique avançant à pas rapides et fulgurants en ce début de siècle, la Grande Guerre va y mettre fin. FG s'engage en 1916, dès l'âge minimum requis et demande à recevoir l'instruction d'officier car il envisage directement d'embrasser la carrière des armes. Son bataillon s'enterre dans les tranchées de la Somme et, en 1917, le jeune FG est grièvement blessé et passe plusieurs mois dans un Lazarett de campagne. En 1920, l'armée, obligée de tenir compte des clauses du Traité de Versailles, licencie le jeune officier, qui, sous les conseils de son père, s'inscrit à l'Université pour y étudier le droit. En 1924, FG est “docteur”. Mais sa nature turbulente d'ancien soldat et sa sérénité profonde, renforcée par l'apprentissage de la Forêt, se montrent rebelles à l'endroit de cette jungle de paragraphes abstraits et désincarnés, à laquelle sont confrontés tous les juristes. En 1928, il renonce à cette carrière qu'il venait à peine d'entamer et s'en va rejoindre son frère Emst à Berlin. Ce seront des années d'indécision, sur fond de crise économique et d'instabilité politique.
À Berlin toutefois, FG amorce son destin d'écrivain, plus exactement d'écrivain politique : il publie ses articles dans la revue d'E. Niekisch, Widerstand, organe du mouvement national-bolchévique, partisan de l'alliance avec Moscou et propagateur d'un nationalisme anti-capitaliste intransigeant. La période nationale-bolchévique, qui est aussi celle d'un nationalisme soldatique fougueux et ardent, est également un segment de la biographie de FG dédié à la méditation, à l'étude et aux voyages : non seulement notre auteur approfondit ses connaissances hellénisantes, mais se plonge dans Dostoïevski, Kant et les romanciers américains. Avec Emst, Friedrich-Georg visite le Harz, la Dalmatie, Naples, la Sicile et les Îles de l'Égée.
Comme tous les proches du Groupe Widerstand, FG estime que le nazisme n'est pas un nationalisme conséquent, qu'il est trop superficiel et qu'il ne représente qu'une ivresse de gloriole sans objet ni avenir fécond. Cette causticité, exprimée notamment dans son poème Der Mohn, lui vaut quelques tracasseries policières puis, avec Ernst, il quitte la métropole bruyante, aux plaisirs vulgaires et tapageurs, qui finissent par lui faire horreur, et s'installe à Kirchhorst en Basse-Saxe.
« Aufmarsch des Nationalismus »
Anton H. Richter n'analyse pas dans son ouvrage le nationalisme de FG, exprimé dans Aufmarsch des Nationalismus, et n'aborde que l'esthétisme hellénisant de l'auteur, sa théorie cyclique du temps et sa philosophie critique à l'égard de la technique contemporaine. Cette lacune, nous devons la déplorer ; en effet, par le détour d'un texte de combat, apparaissent, sans fioritures et sans circonlocutions intellectuelles, les traits saillants d'une philosophie de la Vie, tablant sur l'élémentaire. Les accents pamphlétaires de FG opposent un « cerveau calculateur » aux « instincts du sang », tout comme le philosophe Klages avait opposé l'« esprit » à l'« âme » (Geist / Seele). Pour F.G., la Vie n'est pas un jeu inventé par le cerveau, c'est un grouillement organique dont il faut saisir les pulsations. Le politique, dans sa sphère, doit prendre cette température, ce pouls du monde, doit se mouler dans les méandres de l'organicité sauvage et y puiser une force toujours jeune, neuve, vivifiante. Cette vision quasi cosmique du politique, c'est le jeune nationalisme de la génération des tranchées, purgée des miasmes bourgeois, cérébraux et intellectualisants, qui l'injectera dans le concret. Il fera table rase des institutions mises en place par le libéralisme des marchands, des littérateurs et des irénistes irréalistes.
Ce plaidoyer vigoureux pour un néo-nationalisme organique, instinctif, somatique et élémentaire dérive, en fait, d'une désillusion cruelle : la beauté organique de la flore et de la faune bordant le Steinhuder Meer, avec ses luttes constantes de type darwinien, avec sa fécondité créatrice inépuisable, n'est pas la loi du monde moderne. Le soleil fécond de l'Égée, la flore printanière luxuriante de ce jardin méditerranéen qui périt sous les dards ardents de Phébus pour mieux renaître l'année, suivante, sont certes des beautés organiques impérissables mais leurs qualités n'ont pas la cote à l'ère du modernisme mécaniciste et des philosophades cérébrales. Cette nostalgie de l'organicité, blessure la plus intime de FG, préfigure, dans l'histoire des idées allemandes de ce siècle, l'écologisme non politisé de notre après-guerre et le souci constant de voir forêts, lacs, paysages, nature, montagnes, préservés des souillures industrielles. FG, tout en restant en dehors des débats politiciens et médiatiques, ferme en quelque sorte la boucle des contestations juvéniles allemandes, qui étaient nationatistes dans les années 20 et 30 et écologistes dans les années 70 et 80. FG est en fait partout à la fois : ancré dans le combat national contre le système de Versailles et présent en coulisse dans le discours de la contestation écologiste actuelle, grâce à son ouvrage majeur Die Perfektion der Technik (1939-46).
L'antiquité classique
[Une bacchante, peinture grecque sur vase, env. 470 av. JC]
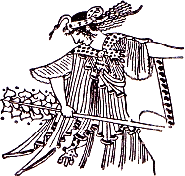 Dans les textes de l'antiquité hellénique, FGJ va vouloir découvrir un monde idéal, digne de nos plus ardentes fidélités. Si Nietzsche avait opposé l'apollinien au dionysiaque dynamique non dualiste et si Ludwig Klages avait opposé l'esprit intellectuel et technicien à l'âme naturelle et organique, FGJ posera la dichotomie Dionysiaque/Titanique. Et quand il dit « dionysiaque », il n'exclut pas les autres dieux grecs mais les englobe, eux et leurs spécificités parfois antagonistes, dans un monde harmonieux, contraire aux valeurs titaniques. Apollon et Pan se joignent à Dionysos dans une sorte de front uni de l'organicité contre les distorsions, la fragmentation et l'unidimensionalité de notre XXe siècle mécaniciste. L'attention de FGJ se porte essentiellement sur les éléments chtoniens et orgiaques de l'antiquité. Dans cette optique, les motifs récurrents des poèmes de FGJ sont la lumière, le feu et l'eau, forces élémentaires auxquelles il rend hommage.
Dans les textes de l'antiquité hellénique, FGJ va vouloir découvrir un monde idéal, digne de nos plus ardentes fidélités. Si Nietzsche avait opposé l'apollinien au dionysiaque dynamique non dualiste et si Ludwig Klages avait opposé l'esprit intellectuel et technicien à l'âme naturelle et organique, FGJ posera la dichotomie Dionysiaque/Titanique. Et quand il dit « dionysiaque », il n'exclut pas les autres dieux grecs mais les englobe, eux et leurs spécificités parfois antagonistes, dans un monde harmonieux, contraire aux valeurs titaniques. Apollon et Pan se joignent à Dionysos dans une sorte de front uni de l'organicité contre les distorsions, la fragmentation et l'unidimensionalité de notre XXe siècle mécaniciste. L'attention de FGJ se porte essentiellement sur les éléments chtoniens et orgiaques de l'antiquité. Dans cette optique, les motifs récurrents des poèmes de FGJ sont la lumière, le feu et l'eau, forces élémentaires auxquelles il rend hommage.
Se gaussant de la raison calculatrice, de son inefficience fondamentale, il exalte, en contrepartie, la puissance du vin, l'exubérance de la fête, le sublime de la danse et les joies du carnaval. Pour arraisonner le réel, l'intuition des forces, des puissances de la nature, du chtonien, du biologique, du somatique et du sang, est une arme bien plus efficace que la raison, qui épure, équarrit, purge, découpe, dépouille et ne laisse au regard de l'homme contemporain que des schémas incomplets. Apollon apporte l'ordre clair et la sérénité : Dionysos apporte es joies, celles du vin et des fruits, de l'extase et de l'ivresse ; Pan, gardien de la nature, apporte la fertilité. Face à ces généreux donateurs, les Titans conquièrent, accumulent des richesses, guerroient cruellement contre ces dieux de la profusion et de l'abondance et, parfois, les tuent, lacèrent leurs corps et les dévorent. L'analogie est claire : le monde libéral manchestérien, la ploutocratie avide des megabankers adipeux et suffisants, le capitalisme esclavagiste sont tous d'essence titanique, ils dévorent les beautés du monde et saccagent les forces d'organicité, tandis que le néonationalisme, prôné par les frères Jünger, est un retour triomphant des valeurs incarnées par Apollon, Dionysos, Pan.
La figure de Pan, roi de la « Wildnis »
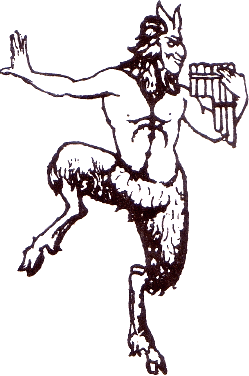 Pan est la figure préférée de FGJ. Il règne sur un fond-de-monde, la Wildnis, terme quasiment intraduisible qui signifie la nature non touchée par l'homme, le caractère vierge d'un paysage non violé par la démarche titanique. La Wildnis constitue, par son intégrité, l'accès au divin, l'accès au secret ultime du monde. Dans la Wildnis, royaume de Pan, matrice de la vie et réceptacle où retourne toute vie, l'apollinien et le dionysiaque sont encore réunis. Cette « zone matricielle », l'esprit titanique la considère comme dépourvue de valeur, comme non rentable et non rentabilisée. C'est, pour les incarnations modernes des Titans, une zone à exploiter donc à priver de sa substance intrinsèque.
Pan est la figure préférée de FGJ. Il règne sur un fond-de-monde, la Wildnis, terme quasiment intraduisible qui signifie la nature non touchée par l'homme, le caractère vierge d'un paysage non violé par la démarche titanique. La Wildnis constitue, par son intégrité, l'accès au divin, l'accès au secret ultime du monde. Dans la Wildnis, royaume de Pan, matrice de la vie et réceptacle où retourne toute vie, l'apollinien et le dionysiaque sont encore réunis. Cette « zone matricielle », l'esprit titanique la considère comme dépourvue de valeur, comme non rentable et non rentabilisée. C'est, pour les incarnations modernes des Titans, une zone à exploiter donc à priver de sa substance intrinsèque.
Ce projet titanique est toutefois impossible à réaliser, car ce serait tarir à jamais une source qui, malgré tous les efforts destructeurs, reste intarissable. Comme Stefan George, FGJ affirme que si la démarche titanique aboutit à dépouiller le dernier bosquet de la Wildnis de sa substance, elle se prive automatiquement de la source première de toutes choses, y compris de son existence propre :
Und wenn ins letzte dickicht du gebrochen
Vertrocknet bald dein nötigstes : der quell.(Et si dans le dernier des bosquets, tu fais irruption, s'assèche
Bientôt ce qui t'est le plus nécessaire : la source).(Stefan George, « Der Mensch und der Drud » in Das Neue Reich, 1928).
La démarche titanique est donc Frevel, sacrilège, sacrilège mortifére.
Le message d'Empédocle
FGJ se réfère à Empédocle qui nous dit que l'homme forme un continuum avec la nature. Toute la nature est dans l'homme et nos sentiments, pensées et états de conscience ont tous un équivalent, même ténu, dans l'oiseau qui chante à nos fenêtres, dans le poisson qui file dans l'eau claire, dans le papillon qui virevolte entre nos rosiers. L'amour, c'est la force naturelle qui agit en nous et à travers nous, dit Empédocle. Ce philosophe pré-socratique expose en outre la célèbre classification des « quatre éléments » : l'eau, la terre, le feu et l'air. FGJ reprend à son compte cette vénération à l'endroit de ces substances-racines, tout en privilégiant, notamment dans son recueil de poèmes intitulé Die Perlenschnur, la Terre Mère, origine de tout ce qui est. La Terre Mère est mère de ce qui est monstrueux comme de ce qui est beau. Elle est berceau de l'homme comme elle est cercueil de l'homme.
Ce culte affirmateur des éléments, inscrit dans le sillage d'Empédocle, n'empêche pas FGJ de souscrire avec enthousiasme aux canons classiques de la beauté hellénique, à la grâce mesurée qui s'en dégage, à l'harmonie conciliatrice qu'invente l'humanité grecque dans son acceptation du monde tel qu'il est.
L'hellénité suscite un enthousiasme chez FGJ, une flamme, une passion qu'il aime à comparer à l'élément « feu », symbole d'esprit vif, de vivacité poétique, de lucidité mentale, de la lumière pure de 1’éveil.
L'essence cyclique de l'existence
 Si le feu est complémentaire de la Wîldnis panique, les symboles de la rivière et du serpent, du cercle et de la danse, désignent, chez FGJ, le principe de la récurrence, du retour incessant, de ce cheminement à rebours de toutes choses vers la Wildnis originelle voire le retour inéluctable de la Wildnis au sein de toutes choses. Pour FGJ, en effet, le thème majeur, c'est celui de l'essence cyclique de l'existence. Ce regard sur la structure intime du temps est fondamentalement antinomique par rapport à la tradition judéo-chrétienne qui est, elle, d'essence linéaire. Le temps judéo-chrétien est directionnel, il est constitué de moments uniques sur la voie, elle aussi unique, qui mène à la Rédemption.
Si le feu est complémentaire de la Wîldnis panique, les symboles de la rivière et du serpent, du cercle et de la danse, désignent, chez FGJ, le principe de la récurrence, du retour incessant, de ce cheminement à rebours de toutes choses vers la Wildnis originelle voire le retour inéluctable de la Wildnis au sein de toutes choses. Pour FGJ, en effet, le thème majeur, c'est celui de l'essence cyclique de l'existence. Ce regard sur la structure intime du temps est fondamentalement antinomique par rapport à la tradition judéo-chrétienne qui est, elle, d'essence linéaire. Le temps judéo-chrétien est directionnel, il est constitué de moments uniques sur la voie, elle aussi unique, qui mène à la Rédemption.
L'homme occidental moderne, allergique aux impondérables cachés ou visibles de la Wildnis, a opté, volens nolens, pour ce temps continu et vectoriel, dans lequel son existence n'est qu'un segment entre 2 éternités a-temporelles. Dès lors, 2 types humains s'affrontent, à armes inégales, selon FGJ et Mircea Eliade (in : Cosmos et Histoire) : l'homme moderne, imprégné de la vision judéo-chrétienne et linéaire du temps et l'homme des sociétés archaïques et traditionnelles (parmi lesquelles il faut compter le lapon moderne et, très partiellement, l'Allemagne et sa pensée “organique”, faisant une très large place à l'écologie et à la nature), qui se perçoit comme indissolublement connecté au cosmos et aux rythmes cosmiques.
L'apport de Nietzsche
[Faune, statue en bronze la « Maison du faune » à Pompéi]
 L'idée de la récurrence éternelle et incessante, FGJ ne l'a pas inventée ; elle était dans l'air de son temps, marqué par la philosophie de Nietzsche, qui, disons-le ici schématiquement, juge que si le temps doit avoir un télos, ce télos aurait déjà été atteint. Pour Nietzsche, d'une certaine manière et au stade où en était la spéculation quant à son œuvre à l'époque de FGJ, les cycles se succèdent dans le temps, avec une régularité impeccable, chacun pareil au précédent. Par rapport aux visions traditionnelles du temps et à celle d'Héraclite l'Obscur, Nietzsche ajoute un élément supplémentaire, capital : l'idée du surhomme. Cette idée motrice et révolutionnaire permet de dépasser le nihilisme, implicite à toute vision cyclique du temps, répétitive et sans télos ; en effet, le télos de l'homme ne se situe pas au-delà d'une fin hypothétique et promise du temps mais surgit dans l'existence productrice de sublime de ceux qui accèdent par volonté ou par élection au niveau du surhomme. Ces moments fugaces, qui font si bellement irruption, par fulgurances, sur la trame du temps, constituent l'éternité, la promesse, le sel de l'humain. Le temps reste cyclique en toile de fond ; la transcendance se manifeste par fulgurances, grâce à l'agir, à la poïesis de l'homme qui atteint la surhumanité.
L'idée de la récurrence éternelle et incessante, FGJ ne l'a pas inventée ; elle était dans l'air de son temps, marqué par la philosophie de Nietzsche, qui, disons-le ici schématiquement, juge que si le temps doit avoir un télos, ce télos aurait déjà été atteint. Pour Nietzsche, d'une certaine manière et au stade où en était la spéculation quant à son œuvre à l'époque de FGJ, les cycles se succèdent dans le temps, avec une régularité impeccable, chacun pareil au précédent. Par rapport aux visions traditionnelles du temps et à celle d'Héraclite l'Obscur, Nietzsche ajoute un élément supplémentaire, capital : l'idée du surhomme. Cette idée motrice et révolutionnaire permet de dépasser le nihilisme, implicite à toute vision cyclique du temps, répétitive et sans télos ; en effet, le télos de l'homme ne se situe pas au-delà d'une fin hypothétique et promise du temps mais surgit dans l'existence productrice de sublime de ceux qui accèdent par volonté ou par élection au niveau du surhomme. Ces moments fugaces, qui font si bellement irruption, par fulgurances, sur la trame du temps, constituent l'éternité, la promesse, le sel de l'humain. Le temps reste cyclique en toile de fond ; la transcendance se manifeste par fulgurances, grâce à l'agir, à la poïesis de l'homme qui atteint la surhumanité.
Cette vision du temps et du surhomme, Nietzsche a tenté de la fonder philosophiquement, de lui donner des assises intellectuelles “officielles”, de la conforter au moyen d'arguments scientifiques. Poète, FGJ n'a eu, lui, aucune raison de cultiver de tels scrupules. Pour lui, la cyclicité du temps n'a nul besoin d'être prouvée ni réfutée. Chez Nietzsche, la tentative de prouver la cyclicité du temps participe d'un reliquat de la pensée théologique : la matière et l'espace sont ainsi des « formes subjectives », tandis que le temps est absolu dans sa forme unique, intangible, qui est ici en l'occurence « cyclique ». Le temps ne relève pas de la plasticité de l'imaginaire que Nietzsche inscrit dans toute sa pensée et, notamment, dans sa théorie de la matière et de l'espace.
Friedrich-Georg Jünger répond à Nietzsche
[Apollon inspirant une muse]
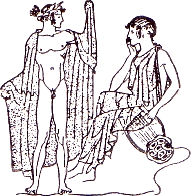 FGJ répond en poète à Nietzsche qui a une vision du temps trop figée : le temps doit être perçu sous l'angle de l'imaginaire. Celui qui ressent un temps imaginaire conjugue sur un mode unique l'éternité et l'instant et fait disparaître les coupures arbitraires instaurés par le temps mécanique et segmentaire des visions linéaires. L'éternité descend de son empyrée transcendante et s'ancre hic et nunc, dans notre monde présidé, en dernière instance, par les lois organiques et naturelles de la Wildnis. Le temps absolu – le temps qui régente – s'évanouit, se dissipe, pour faire place à une fantastique a-temporalité. FGJ se met ipso facto en marge de tout cet existentialisme angoissé par l'idée qu'au-delà du temps vectoriel il n'y aurait que le vide, que l'absence de telos bonheurisant. Ainsi, on constate que ce n'est pas le désespoir qui guide sa pensée, mais la confiance ; une immense confiance dans l'a-temporalité de la Wildnis.
FGJ répond en poète à Nietzsche qui a une vision du temps trop figée : le temps doit être perçu sous l'angle de l'imaginaire. Celui qui ressent un temps imaginaire conjugue sur un mode unique l'éternité et l'instant et fait disparaître les coupures arbitraires instaurés par le temps mécanique et segmentaire des visions linéaires. L'éternité descend de son empyrée transcendante et s'ancre hic et nunc, dans notre monde présidé, en dernière instance, par les lois organiques et naturelles de la Wildnis. Le temps absolu – le temps qui régente – s'évanouit, se dissipe, pour faire place à une fantastique a-temporalité. FGJ se met ipso facto en marge de tout cet existentialisme angoissé par l'idée qu'au-delà du temps vectoriel il n'y aurait que le vide, que l'absence de telos bonheurisant. Ainsi, on constate que ce n'est pas le désespoir qui guide sa pensée, mais la confiance ; une immense confiance dans l'a-temporalité de la Wildnis.
Cette simultanéité, toujours présente, implique qu'il n'existe aucune contradiction entre la récurrence éternelle et la présence éternelle. Niant la réalité, la rigidité, la lourdeur du temps, FGJ se place résolument à l'opposé diamétral des existentialismes qui surestiment la temporalité et l'histoire, parce qu'ils restent prisonniers d'une vision du temps oppressant, dans lequel l'homme est jeté, subit une déréliction qui le confronte sans cesse à la mort, point final absolu. Le temps n'est plus menaçant comme le Iahvé vétéro-testamentaire, dérivé des figures mythologiques proche-orientales comparables à Baal-Moloch, mais est soutien, support (tragend und haltend). La cyclicité non problématique immerge l'homme dans le cocon de la Wildnis qui peut l'épanouir ou le terrasser mais l'accueillera toujours en son sein. La temporalité nietzschéenne, par son découpage en cycles identiques et répétés, conserve quelque chose de mécanique, de newtonien, et n'est finalement pas grecque. Elle n'est pas dionysiaque, elle est titanique parce que l'homme qui est enfermé dans sa logique ne peut échapper à son mouvement circulaire. Il manque, chez Nietzsche, la dimension du dionysisme chtonien, plus plastique, plus ouverte aux fluctuations divergentes de l'élémentaire, ce que le temps-rouage mécanique, le temps rotatif, ne peut être.
Le serpent et la danse
Le serpent qui rampe sur le sol, qui s'insinue entre les branches des sous-bois, qui glisse sur les rochers baignés de soleil, est un animal doublement symbolique : il est lié, collé, ancré à la terre, à la telluricité de la Wildnis et se dresse vers le soleil, astre de feu, géniteur de la Vie. Cette double symbolique lie les 2 principes, les moule dans l'unicité cosmique où le temps qui régente, où le temps-policier, n'a pas sa place.
La danse est, elle aussi, symbole de cette simultanéité de l'instant et de l'éternité. Le héros russe de FGJ (in : Beluga), Nestyoukine, à qui sourit la fortune, retrouve sa terre et danse de joie devant les marins marchands britanniques Hoggs et Mikkelsen et suscite leur étonnement : l'étonnement d'hommes qui ne dansent jamais, qui sont dédiés corps et âme au titanisme moderne. Comment ne pas comparer ce Nestyoukine au héros de Nikos Kazantzaki, Zorba le Grec, qui danse au moment où il perd tous ses biens terrestres, indiquant du même coup que là n'est pas l'essentiel ? La danse solitaire, spontanée, est le recours de ceux que n'ont pas désertés les Muses face à ceux qu'elles ont abandonnés.
Die Perfektion der Technik (1939-1946)
Cette vision cyclique du temps, plongée dans un hellénisme dionysiaque et panique, n'a pu engendrer qu'une défiance agressive à l'endroit de la technique moderne. Celle-ci poursuit l'œuvre sacrilège de Boniface, l'« apôtre » des Germains, qui abattit, au nom du Christ, figure étrangère au Nord de l'Europe, le chêne sacré de la forêt tutélaire. L'acte fondateur du christianisme allemand est ainsi, affirme FGJ, un manque lamentable de déférence à l'égard du sacré de la nature. Mais Boniface aura des milliers de successeurs, qui ne feront plus directement appel à la religion chrétienne mais établiront un corpus doctrinal laïc, rationaliste et mécaniciste, d'essence titanique et porté par la volonté destructrice de rentabiliser, soumettre et éradiquer l'espace de la Wildnis. Cette hostilité idylliste et quelque peu pastoraliste envers la technique occidentale moderne sera dûment consignée dans un livre intitulé Die Perfektion der Technik. Les épreuves de cet ouvrage, achevé en 1939, sont détruites en 1942 lors d'un bombardement ; en 1944, une première édition, réalisée à partir d'un nouveau jeu d'épreuves, est réduite en cendres lors d'une attaque aérienne. Finalement, le livre paraît en 1946.
La thèse centrale de ce travail, écologiste avant la lettre, c'est de dire que la technique ne conduit pas à un âge paradisiaque parce qu'elle faciliterait le travail quotidien de l'homme, mais qu'au contraire, elle mobilise sans cesse son esprit et son corps, qu'elle complexifie à outrance le monde dans lequel il est condamné à vivre, si bien qu'aucune attention ne peut plus être consacrée à l'observation et à la reoonnaissance des rythmes lents de la nature, de la Wildnis. Le progrès technique n'a pas ôté du travail à l'homme mais l'a au contraire surchargé.
Les utopies technicisantes qui remplacent, au XXe siècle, les anciennes utopies politiques, parlent d'une abondance génératrice de bonheur, mirage qui révèle sa propre vacuité, du fait que cette abondance d'objets est corollaire d'un souci d'affairement constant, d'envie, de labeur harassant et, en dernière instance, inutile. À la lumière de ces quelques réflexions sommaires à propos de Die Perfektion der Technik, on pourrait dire qu'il s'agit là d'un de ces innombrables plaidoyers pour un monde idyllique, tout de douceur et tout ensoleillé, qu'ânonnent les écolos et les pastoralistes de tous poils, venus à l'avant-plan du règne des opinions par le biais de la mode hippy. Mais Die Perfektion der Technik est évidemment un ouvrage plus profond que cela.
Les étapes de la pensée occidentale anti-organique
[Silène : peinture grecque sur vase, env. 500 av. JC]
 À lui seul, il mérite une analyse détaillée car il ne se borne pas à énoncer des déclarations de principe, toutes hostiles à la technique, mais nous montre comment l'évolution de la pensée occidentale s'est opérée parallèlement à une extirpation toujours plus systématique des dimensions organiques de l'humain et de l'écosystème. Ainsi, FGJ observe chez Descartes une distinction mutilante entre res cogitans et res extensa ; chez Galilée et Newton l'avènement d'un temps « qui segmente », découpe, mutile et rend aveugle à l'égard des évolutions lentes de l'univers biologique et cosmique ; chez Kant, une volonté de dépasser les limites de la technica intentionalis et de se pencher sur les ressorts naturels et organiques de la technica naturalis ; chez Hegel, une notion de progrès qui correspond aux lois de la mécanique et qui aboutit à la conception d'un automatisme historique rigide et sans aléas. FGJ interpelle ainsi toute l’histoire philosophique occidentale et conclut à sa faillite.
À lui seul, il mérite une analyse détaillée car il ne se borne pas à énoncer des déclarations de principe, toutes hostiles à la technique, mais nous montre comment l'évolution de la pensée occidentale s'est opérée parallèlement à une extirpation toujours plus systématique des dimensions organiques de l'humain et de l'écosystème. Ainsi, FGJ observe chez Descartes une distinction mutilante entre res cogitans et res extensa ; chez Galilée et Newton l'avènement d'un temps « qui segmente », découpe, mutile et rend aveugle à l'égard des évolutions lentes de l'univers biologique et cosmique ; chez Kant, une volonté de dépasser les limites de la technica intentionalis et de se pencher sur les ressorts naturels et organiques de la technica naturalis ; chez Hegel, une notion de progrès qui correspond aux lois de la mécanique et qui aboutit à la conception d'un automatisme historique rigide et sans aléas. FGJ interpelle ainsi toute l’histoire philosophique occidentale et conclut à sa faillite.
Cela déborderait considérablement le cadre de cet article – qui n'est finalement qu'une recension et, en même temps, une introduction plus que brève à une œuvre méconnue dans l'espace linguistique francophone – d'examiner minutieusement cette esquisse d'une histoire alternative, écologisante et organiciste de la philosophie européenne ; néanmoins, les textes et les poèmes de FGJ doivent mobiliser nos attentions, à l'heure où le rationalisme de l'École de Francfort connaît la débâcle et où les dimensions organicistes de la pensée heidegerrienne, pensée de la « proximité », sont mises en exergue et que, simultanément, cette pensée, à cause de son irréductibilité aux simplismes schématiques des rationalismes moralisants et des caricatures philosophantes qui en découlent, se voit soupçonnée d'entretenir une collusion infâmante et indéfendable avec le national-socialisme hitlérien, pourtant bien mort sous les coups des forteresses volantes anglo-américaines, des charges furieuses de l'infanterie soviétique et de la « rééducation ».
Relire FGJ est donc une nécessité, afin de ressaisir le contexte de la pensée heideggerienne, d'explorer la périphérie d'une œuvre magistrale qu'une inquisition nouvelle veut araser.
♦ Anton H. RICHTER, A Thematic Approach to the Works of F.G. Jünger, Peter Lang, Bern/Frankfurt a.M., 1982, 121 S.
► Robert Steuckers, Vouloir n°45/46, 1988.

Apollon, Pan, Dionysos : la religiosité de Friedrich Georg Jünger Nombreux furent ceux qui s’étonnèrent de la conversion d’Ernst Jünger au catholicisme, quelques temps avant sa mort. Rares furent ceux qui s’attendaient à cette démarche, surtout parce que Jünger avait intensément étudié la Bible dans les années 40 et parce que le “platonisme” ne cessait plus d’imprégner son œuvre, surtout à la fin, tant et si bien qu’on a soupçonné, lors de son passage au catholicisme, une motivation “hérétique” cachée, de type “gnostique”. Sans doute les frères Jünger, Friedrich-Georg et Ernst, ont été rarement aussi éloignés l’un de l’autre qu’en ce point : pour FG, le christianisme n’a jamais été une tentation car il se souvenait, qu’enfant déjà, il ne comprenait pas « pourquoi il y avait des prédicateurs, des prêches et des églises ».
Nombreux furent ceux qui s’étonnèrent de la conversion d’Ernst Jünger au catholicisme, quelques temps avant sa mort. Rares furent ceux qui s’attendaient à cette démarche, surtout parce que Jünger avait intensément étudié la Bible dans les années 40 et parce que le “platonisme” ne cessait plus d’imprégner son œuvre, surtout à la fin, tant et si bien qu’on a soupçonné, lors de son passage au catholicisme, une motivation “hérétique” cachée, de type “gnostique”. Sans doute les frères Jünger, Friedrich-Georg et Ernst, ont été rarement aussi éloignés l’un de l’autre qu’en ce point : pour FG, le christianisme n’a jamais été une tentation car il se souvenait, qu’enfant déjà, il ne comprenait pas « pourquoi il y avait des prédicateurs, des prêches et des églises ».
Pourtant le paganisme de FGJ ne contenait aucune véhémence à l’égard de l’Église et de ses doctrines ; son paganisme était plutôt quelque chose d’étranger au christianisme, quelque chose qui se situait au-delà de l’Évangile ; ce “quelque chose” témoignait d’un résidu d’âme archaïque et, jeune, notre auteur ressentait déjà la nostalgie du temps « du Grand Père, ..., qui s’en allait vers le noisetier pour converser avec le serpent ». Le serpent, qui conserve chez Ernst Jünger une certaine ambivalence, est, chez Friedrich-Georg, un symbole tout à fait positif : « cette créature magnifique qui brille et se repose au soleil », « cet animal flamboyant du Grand Midi », consacré pour cela à Apollon, le dieu auquel Friedrich Georg se sentait tout particulièrement lié. Le serpent du Midgard nordique, animal apocalyptique, ne l’attirait nullement. Son paganisme ne se référait que très rarement aux traditions germaniques ; ce furent surtout les mythes grecs qui occupèrent sa pensée. À la suite de nombreux essais, Friedrich Georg finit par publier le volume Griechische Götter (Dieux grecs) en 1943, qui sera suivit de quelques livres sur des thèmes apparentés. Son engouement pour les dieux et la mythologie grecs, il le parachèvera par un long essai intitulé Mythen und Mythologie (Mythes et mythologie), paru en 1976, peu avant sa mort, dans la revue Scheidewege, dont il était l’un des co-fondateurs.
Cette fascination pour la mythologie grecque, il la doit bien évidemment à sa lecture de l’œuvre de Nietzsche. FGJ était fondamentalement païen au sens où l’entendait Nietzsche, c’est-à-dire qu’il concevait le paganisme comme « un grand oui à la naturalité », comme « un sentiment d’innocence au sein de la nature », comme la “naturalité” tout court. Ce n’était pas chez lui une adulation de “l’élan vital” ou de la “Vie” au sens darwinien du terme ou au sens de quelque autre théorie évolutionniste. Son but était de tenter de faire à nouveau rejaillir une vision archaïque de l’existence, surgie jadis, en des temps immémoriaux, et qui s’est prolongée et maintenue jusqu’à l’époque chrétienne, sous des oripeaux christianisés ; FGJ voulait se rappeler et rappeler à ses contemporains un mode de vie, d’existence, antérieur à l’histoire, anhistorique : « Sans le temps, tout est là, simultanément — Au milieu repose chaque cercle » (Ohne Zeit ist alles zugleich — In der Mitte ruht jeder Kreis), écrivait-il dans son poème Die Perlenschnur (Le collier de perles). Les forces originelles possédaient chacun un rang : Apollon, lumineux, qui apportait l’ordre et fondait des villes ; Pan, phallique, qui fécondait et habitait la Wildnis (“la nature inviolée”) ; Dionysos, en ébriété, sauvage et mutin, qui incitait à la fureur et à la frénésie.
Le monde créé par les Olympiens n’était nullement idyllique et portait sans cesse la menace en soi. Dans Chant de Prométhée, FGJ fait justement parler Prométhée, le laisse énoncer ses prophéties, lui, le Titan enchaîné aux parois du Caucase pour être puni de son audace sacrilège :
« Und die Erde, auf deren Nacken Olympos thronet,
Ruft die Giganten herbei, die einst ihr Schoss sich gebar.
Sie, die unüberwindliche Nährerin stolzer Geschlechter,
Rufet mit wilderem Ruf Götter zum Streite herbei.
Untergang seh ich zunächst, Verzweiflung, Jahrhunderte alten,
Unerbittlichen Krieg. Alles versinkt in Nacht ».
(Et la Terre, qui, sur ses épaules, porte l’Olympe, qui y trône,
Appelle à elle les Géants qui jadis naquirent de son giron.
Elle, l’infatigable nourricière de tant de fières lignées,
Appelle d’un cri plus sauvage encore les dieux au combat.
D’abord je vois poindre le déclin, puis le désarroi, enfin, une guerre,
Sans pitié, qui durera des siècles et tout s’enfoncera dans la nuit noire).
La figure de Prométhée n’a cessé de hanter FGJ. Le plus “intellectuel” des Titans avait volé le feu aux dieux et l’avait donné aux hommes. Dans son ouvrage Die Perfection der Technik (1939/1946), FGJ donne une interprétation fort intéressante du mythe de Prométhée, car il souligne le caractère éminemment solaire de ce feu donné aux hommes. Ensuite, il n’interprète pas la colère des dieux comme une réaction de jalousie envers les hommes, devenus eux aussi possesseurs de l’élément, mais comme une fureur de voir le feu divin, force élémentaire et primordiale, “mis en service”. Les dieux ne peuvent pas l’admettre. La nature titanique de la technique humaine est entièrement mise en exergue ici car elle n’a jamais trouvé la voie pour utiliser l’énergie solaire: dès lors, elle a toujours dû se rabattre sur des forces telluriques, comme celles qui se libèrent lors de la fission de l’atome. Disproportion, démesure et monstruosité sont les caractéristiques essentielles de tout ce qui relève du titanique et, partant, de la technique. La domination du titanique/technique ne pourra donc être éternelle, avance prudemment FGJ ; en effet, son poème se termine par les vers suivants :
« Dies war der Gesang des hohen Fürsten Prometheus.
Doch der Donner des Zeus schlug den Titanen hinab ».
(Tel fut le chant du noble prince Prométhée.
Malgré cela, le tonnerre de Zeus le jetta bas).
FGJ avait parfaitement conscience qu’une grande différence existait entre les réflexions que nous posons aujourd’hui sur le mythe et la pensée mythique en soi : le danger de confondre réflexions dérivées du mythe et pensée mythique est grand. Les réflexions sur le mythe et sur la permanence de sa puissance ont été à la mode, surtout pendant l’entre-deux-guerres. Aussi le nationalisme de facture barrèsienne, auquel les 2 frères Jünger avaient adhéré, était-il conçu comme une “foi”, une “religion”. FGJ avait expressément défini la Nation comme « une communauté de foi », une « communauté religieuse », qui s’exprimait par ses mythes et ses héros. Cette position n’a été qu’un engouement passager car les frères Jünger se sont assez rapidement aperçu que le mythe antique n’avait pas grand chose à voir avec la “foi” ou la religiosité au sens de la tradition biblique :
« La foi, en tant que force qui tient quelque chose pour vrai, qui vit et meurt dans la conviction de cette vérité, implique que ce qui est tenu pour vrai n’apparaît pas, ne se montre pas somatiquement. Rien ne paraît plus étrange et plus invraisemblable pour l’humanité actuelle que l’apparition physique des dieux. Car l’humanité actuelle ne croit pas en eux. Mais énoncer ce constat ne suffit pas. Les dieux ne peuvent plus apparaître à l’homme moderne, même s’il croit encore en eux. Et pourquoi pas ? Parce que l’apparition d’un dieu n’a rien à voir avec la foi ou avec l’absence de foi, car les mythes ne recèlent aucune réalité à laquelle il faudrait croire, aucune réalité que l’on pourrait toucher du doigt ou montrer ».
Les dieux ne demandent pas la foi, ils demandent des sacrifices. Les Anciens ne doutaient pas de leur existence parce qu’ils percevaient leurs actions, leurs effets, leurs manifestations, parce qu’ils leur étaient dans une certaine mesure proches, même s’ils étaient fondamentalement séparés des hommes. Mais cette proximité du divin apparaît impossible à ceux qui ne croient qu’à une rencontre avec le “Tout Autre”, dans le sens où l’enseignent les religions révélées. C’est donc cette “expérience” du divin, cette expérience qui rencontre le scepticisme des religions révélées, qui constitue la véritable racine de la religion de Friedrich Georg Jünger.
► Karlheinz Weissmann. (article paru dans Junge Freiheit n°38/1998; tr. fr. : Robert Steuckers)

Guerre industrielle et “prolétarisation” du guerrier chez Ernst et Friedrich Georg Jünger
[E. Jünger (à g.) et le lieutenant Von Kienitz prêts pour un coup de main à Regniéville (Meurthe-et-Moselle) en août 1917, © Archives E. Jünger, cliché F. Lagarde]
 « Les contrées ardentes qui nous attendent, aucun poète ne les a encore contemplées dans ses rêves. Ce sont des champs de cratères glacés, des déserts avec des oasis aux palmiers de flamme, des murailles roulantes de feu et d'acier, et des plaines dévastées par la mort où passent de rouges orages. Des troupes d'oiseaux d'acier y volent à travers les airs et des machines d'acier y rugissent dans les champs (...) » Feu et Sang (Blut und Feuer).
« Les contrées ardentes qui nous attendent, aucun poète ne les a encore contemplées dans ses rêves. Ce sont des champs de cratères glacés, des déserts avec des oasis aux palmiers de flamme, des murailles roulantes de feu et d'acier, et des plaines dévastées par la mort où passent de rouges orages. Des troupes d'oiseaux d'acier y volent à travers les airs et des machines d'acier y rugissent dans les champs (...) » Feu et Sang (Blut und Feuer).
Voici enfin publié le dernier volet manquant à la traduction française de la période guerrière d'Ernst Jünger. Sous-titré Bref épisode d'une grande bataille (Ein kleiner Ausschnitt aus einer grossen Schlacht : Kriegssausbruch 1914), c'est une nouvelle fois à la maison “Christian Bourgois éditeur”, et ce à quelques mois d'intervalle avec la parution de La guerre comme expérience intérieure, que nous devons de parcourir, excellemment traduit par Julien Hervier, ce texte original écrit en 1925. Exercice d'approfondissement du chapitre « La grande bataille » d'Orages d'acier, le recueil de mémoires qui le révéla à la littérature en 1920, ce court texte d'à peine 190 pages traite dans une écriture dense, alerte, riche en métaphores et autres fulgurances stylistiques de la participation de l'auteur à l'offensive allemande de 1917. Énième assaut qui, d'emporter la décision finale, ne fit qu'ajouter à la déjà trop longue liste des milliers de nouveaux cadavres.
Témoignage brut, à chaud, de l'engagement d'un jeune lieutenant des troupes de choc, l'échelle microscopique du témoignage, où n'intervient aucune considération d'ordre stratégique, accentue au paroxysme la fureur des combats, le déchaînement du facteur matériel et le retour au bestial de l'homme « civilisé », broyé par l'énormité des moyens mis en œuvre. Des propos dont l'amertume et la lassitude ne sont pas absentes.
Parallèlement vient de paraître dans la dernière livraison d'Allemagne d'aujourd'hui une longue étude de Danièle Bertran-Vidal — spécialiste des frères Jünger, déjà remarquée par son précédent livre Chaos et renaissance dans l'œuvre d'Ernst Jünger (Bern, 1995) — sur le premier Kriegsroman [récit de guerre] de Friedrich Georg Jünger, Der Erste Gang (La première marche). Livre de maturité, à l'inverse de Feu et Sang, rédigé en 1954, Der Erste Gang retrace en 8 récits le premier conflit mondial tel que le vécut l'empire austro-hongrois. S'appuyant sur des témoignages véridiques mais inventant personnages et actions, FGJ confronte les points de vue au sein de l'état multi-ethnique en guerre contre la Russie des tsars. Occasion d'effectuer le parallèle avec l'allié et cousin allemand, mais surtout, et ce qui retiendra davantage notre attention ici, d'aplanir sa réflexion sur les successives transformations du combat et l'inexorable régression du soldat de son rôle de sujet à celui d'objet, manœuvré, manipulé, fondu dans la mécanique de guerre.
Une thématique largement présente dans l'œuvre des frères Jünger (Le Travailleur, La Mobilisation Totale, La Perfection de la technique) qu'exposent ces 2 ouvrages avec une toute particulière acuité.
Les frères Jünger, chantres de la soldatesque
« Nous avons passé les derniers jours de l'automne à nous battre dans le sinistre plat pays des Flandres qu'assombrissaient de lourds nuages de pluie, nous avons ensuite été cantonné dans une position glaciale et peu sûre de l'Artois avant d'être jetés dans la brèche qu'avait ouverte dans le front l'offensive des tanks sur Cambrai ».
L'action de Feu et Sang se situe le 21 mars 1917, premier jour de la première offensive allemande lancée par le Grand-Quartier-Général après l'échec de Verdun. Le mois suivant, ce sera au tour du généralissime Nivelle d'engager la contre-offensive entre l'Oise et Reims : 30.000 morts et 80.000 blessés en 2 jours. Le fiasco sera complet et la mémoire collective conservera avec horreur le souvenir du “Chemin des Dames”. Au mois de juillet de la même année, un nouvel assaut allemand sur Langemarck verra se croiser le destin des 2 frères, Ernst ramenant vers l'arrière son jeune frère grièvement blessé, rencontré par hasard pendant la bataille. Coïncidence émouvante que relateront conjointement Ernst et FG Jünger dans Orages d'acier (1920) et Grüne Zweige (1951). Épisode hautement symbolique aussi pour qui connaît l'itinéraire littéraire et idéologique des frères Jünger, chantres de la soldatesque, penseurs de la civilisation révélés à eux-mêmes par la guerre.
« Ici devient visible une nouvelle race qui s'était formée elle-même à la rude discipline de la guerre — élevée à l'école des batailles et familiarisée avec les outils dont on se sert pour la besogne de mort. Ici la volonté avait fusionné avec l'usage des moyens en une unité du plus haut rang guerrier ».
À 30 ans d'écart, les mêmes préoccupations harcèlent littéralement les 2 essayistes, marqués au fer rouge, fascinés en historiens et philosophes par le changement radical opéré au cours des 4 ans de combat. De chaque côté, la même interrogation sur l'industrialisation de la guerre, la même analyse de la subversion complète des valeurs.
« Les forces de l'élémentaire croissent ». Ces propos ne sont pas de Ernst mais de FG Jünger et traduisent supérieurement l'unité de pensée qui anime leur démarche respective. Quand, dans Der Erste Gang, Waldmüller est affecté à l'état-major viennois en 1916, FGJ inscrit sa réflexion dans la sienne propre, et énumère les nouvelles caractéristiques de la « guerre d'usure » : stabilisation du front, rupture d'avec la tradition stratégique, enlisement du combattant dans la lassitude, la monotonie. « On nous en a vraiment trop demandé » note avec abattement Ernst Jünger au premier chapitre de Feu et Sang.
« On nous en a vraiment trop demandé »
Dans cet univers figé, c'est sur le matériel que misent prioritairement les nouveaux Alcibiades :
« ... matériel — ce terme étranger qui devait prendre bientôt pour nous un sens toujours plus terrible jusqu'à donner son nom aux batailles mêmes que nous allions livrer (...) Nous nous en fîmes une petite idée dans les premiers pilonnages d'artillerie (...) Mais c'est seulement après le broyage répété des offensives de Verdun (...) que se révéla à nous la volonté des grands États qui se traduisait sur le front en explosions de feu ».
Soigneusement programmée dans la logistique des belligérants, l'irruption de la révolution industrielle dans la menée des combats n'en stupéfie pas moins la piétaille des premières lignes. Le lyrisme épouvanté de E. Jünger en témoigne :
« Voila ce qu'est le matériel. Devant le regard surgissent de vastes régions industrielles avec les chevalements des puits de charbons et l'éclat nocturne des hauts fourneaux — salles des machines avec courroies de transmissions et volants étincelants, imposantes gares de marchandises avec leurs voies ferrées scintillantes, le papillotement des signaux lumineux de toutes les couleurs et l'ordonnance des blanches lampes à arc qui éclairent l'espace de manière géométrique. Oui, c'est là qu'on l'assemble et qu'on le forge selon les phases de travail méticuleusement réglées d'une gigantesque production, et ensuite il roule jusqu'au front sur les grandes voies de communication, comme une somme de performances et d'énergie emmagasinée qui se déchaîne contre l'homme de manière dévastatrice. La bataille est un affrontement entre industries et la victoire le succès du concurrent qui a su travailler plus vite et plus brutalement ».
L'emploi par FGJ de termes mathématiques et techniques renforce davantage encore ce caractère nouveau de la guerre et lui confère des qualités d'horlogerie, millimétrage, calcul, précision, mécanique. « La guerre, c'était avant tout du travail, un dur travail physique » glisse-t-il dans un monologue du soldat Hammerstein. « ... Une totalité (...) noces de l'outil et du bras » lui répond en écho Ernst Jünger. « Ici, il n'est pas question d'enthousiasme mais de travail terre à terre, objectif qu'on ne peut apprendre du jour au lendemain ».
Là commence le règne de l'absurdité
Point d'orgue de cette gigantesque préparation, l'assaut, fracassante libération du corps et de l'esprit dans la fusion de l'individu et de la matière. Les âmes dispersées, apeurées s'y rejoignent pour souder en une force irrésistible le bélier de la ruée. Feu et Sang regorge de ces considérations mêlant chair vivante et acier froid :
« Tout est monotone, uniforme et gris. Tout est objectif et fonctionnel comme la marche d'une machine en mouvement (...) Nous nous y insérons pour nous perdre dans le grand sens et la grande unité (...) candidats à l'examen d'histoire mondiale (...) Chacun devient par nécessité une partie vivante d'une force supérieure ».
Pour les états-majors, désormais, le nombre supplante la manœuvre, la quantité la qualité. L'individu s'efface devant le gaspillage inouï en vies humaines :
« La grande addition est posée : on va tirer là-bas le trait rouge de sa conclusion et nous sommes une fraction de petits chiffres avec lesquels on calcule » (Feu et Sang).
Au guerrier se substitue le spécialiste. Là commence le règne de l'absurdité toute malapartienne : « Il y a des pertes. Günther von Wedelstadt tombe lui aussi, victime d'un coup de plein fouet de notre artillerie. C'est son frère qui commande une des batteries ». Et dans cet enfer moderne, les frères Jünger discernent la part ineffable de l'homme, bourreau et victime de sa propre folie meurtrière dont se nourrira le nihilisme des années 20 :
« L'homme, en revanche, a été le premier à se former dans le feu des batailles ; c'est lui qui confère au combat et aux moyens qu'il utilise un nouveau visage plus terrible ».
... les argonautes tristes...
De part et d'autre, les mêmes images. « Ces visages sont livides, malpropres, minés par les nuits sans sommeil (...) les pommettes ressortant avec une netteté tranchante » (Feu et Sang), « maigres et émaciés (...) Des êtres hâves et efflanqués» (Der Erste Gang). Plus de passé et moins encore d'avenir pour les argonautes tristes. Et pourtant, dans cette guerre d'un genre neuf, combat d'ombres, immense chantier sillonné de fantômes, subsistent quelques parcelles d'humanité et de fierté recouvrée. Ainsi du face-à-face fortuit de EJ et d'un jeune officier allemand dans le feu de la bataille, où s'échangent un sourire et une goutte de gnôle : « Sans nous dire adieu, nous nous précipitons à sa suite, l'un par-ci, l'autre par-là, sans espoir de jamais nous revoir », et de sa lecture de journaux abandonnés dans une position britannique enlevée : « Les Huns. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons fait honneur à ce nom ».
EJ sera blessé 3 fois et aura tué 2 ennemis au cours de l'assaut. Le devoir accompli ? « On fait son devoir et, ce faisant, on y manque » lui rétorque Hammerstein alias FGJ.
En annexe de Feu et Sang, l'éditeur a eu l'heureuse idée de joindre un court récit de EJ, écrit en 1934 et intitulé La déclaration de guerre de 1914. On y trouve cet extrait à tout le moins prophétique :
« Dans la poche de ma tunique, j'avais glissé un mince carnet, il était destiné à mes notes quotidiennes. Je savais que les choses qui nous attendaient étaient irrémédiables ».
♦ Ernst Jünger, Feu et Sang, Christian Bourgois éd., 1998.
♦ « Un “Kriegsroman” oublié : Der Erste Gang de FG Jünger », Danièle Bertran-Vidal in Allemagne d'aujourd'hui, 1er trimestre 1998.
► Laurent Schang, Nouvelles de Synergies Européennes n°33, 1998.

Pièces-jointes :
 ◘ Friedrich Georg Jünger : Le frère méconnu
◘ Friedrich Georg Jünger : Le frère méconnu
Adulé du public français, Ernst Jünger semble avoir ravi la vedette à son frère, Friedrich Georg. La notoriété de ce dernier, essayiste et poète de talent, n'a en effet jamais passé le Rhin, malgré une abondante production (plus de 30 livres dont aucun n'est traduit en français) (1).
Né le 1er septembre 1898 à Hanovre, FGJ adhère durant son adolescence au Wandervogel (2). Mouvement de jeunesse communautaire et non-conformiste, le Wandervogel a pour ambition de donner aux jeunes Allemands une éthique “naturaliste” (communion avec la terre dans de grandes randonnées) et communautaire, en rupture absolue avec l'individualisme et le matérialisme ambiants.
En 1914, FGJ s'engage à la suite de son frère Ernst, aussi stoïquement que lui, sur le front de Flandre. Il en sort grièvement blessé au poumon et à l'épaule. Après une convalescence qui dure quelques mois, il réintègre l'armée comme lieutenant dans la Reichswehr. Il étudie ensuite le droit à l'université de Leipzig.
Entre 1926 et 1932, alors qu'il travaille dans un cabinet d'avocats, FG se lie aux milieux nationaux-révolutionnaires et notamment à la tendance nationale-bolchevique incarnée par Ernst Niekisch (3), dont la revue Widerstand, à laquelle collabore également son frère, sera interdite par le régime nazi en décembre 1934. Prônant un « socialisme prussien », c’est-à-dire à la fois aristocratique et populaire, organique et « démarxisé », héroïque et soldatique, les frères Jünger se prononcent pour une alliance de l'Allemagne avec la Russie contre l'ennemi prioritaire : le libéralisme occidental.
FG publie alors, dans la collection « Der Aufmarsch » que dirige son frère Ernst, Le nationalisme en ordre de bataille. Cet ouvrage néo-nationaliste se caractérise par un vitalisme faustien extrême : étatisme totalisant, volontarisme impérialiste et surhumanisme technophile s'y côtoient allègrement. On mesure bien, en lisant ce texte, l'évolution ultérieure de FGJ. Celui-ci ne publie aucun texte durant l'année 1933.
Mais dès 1934, dans un article intitulé « Réalité et vérité », rédigé dans le même esprit que Les falaises de marbre, il dénonce les mensonges, phobies et phantasmes de la propagande hitlérienne. Sous l'apparence de propos généraux se profile une critique radicale du totalitarisme national-socialiste. En 1937, FGJ récidive dans Der Taurus. Il y stigmatise le caractère inorganique et massificateur du parti au pouvoir, visant à l'uniformisation du peuple allemand. À propos des masses qui suivent la dynamique hitlérienne, il affirme : « Ils sont sans yeux, pâles, ennemis de la douce lumière. Ce peuple est avide de ronger les racines... ».
Abandonnant toute forme d'engagement politique, FGJ, qui s'est par ailleurs consacré à l'étude de la civilisation hellénique, se concentre sur l'analyse critique de la modernité, singulièrement de sa dimension technicienne. Il commence ainsi à rédiger, à partir de 1939, son essai sur La perfection de la technique (4).
Si FG pensait auparavant que la technique était neutre, qu'il suffisait de l'instrumentaliser positivement pour régénérer des valeurs héroïques, qu'il était en quelque sorte possible de dépasser la modernité avec les armes du monde moderne, l'expérience terrible de la Seconde Guerre mondiale acheva de confirmer à ses yeux la prophétie qu'avait déjà dressée Thierry Maulnier : « Le jour n'est pas loin où l'homme deviendra prisonnier de ses propres triomphes techniques ». À l'instar de son ami Martin Heidegger, mais sur un mode plus « poétique », FGJ dénonça l'« angoisse » et l'« aliénation » procédant de la technicisation du monde : loin de libérer l'homme, la technique l'enferme dans son statut laborieux, lui dicte son emploi du temps et l'enchaîne dans une course sans fin vers la satisfaction de besoins sans cesse renouvelés.
Le « point de perfection » de la technique correspond au stade de l'adéquation parfaite entre les impératifs de la machine et l'état du monde, c’est-à-dire à la rationalisation et à la mécanicisation de toutes choses. Alors, un monde entièrement transparent à lui-même pourra fonctionner sans heurt — sans histoire non plus. La technique n'est plus un moyen au service de l'homme mais s'institue comme sa propre fin : elle « tend non seulement vers l'informatique, mais aussi vers un être humain programmé ». Mais, passé son point de perfection, la technique se contentera de complexifier sa propre structure interne, et deviendra alors de plus en plus improductive : un « retournement » sera à cet instant envisageable.
Dans la seconde partie de sa vie, FGJ n'a de cesse d'approfondir ces réflexions, en les étendant notamment à la philosophie des sciences, et d'enrichir ainsi la première édition de La perfection de la technique. Il devient également un des piliers de la revue néo-conservatrice Scheidewege, et publie une autobiographie en 2 volumes : Grüne Zweige (1951) et Spiegel des Jahre (1958). Il s'éteint à l'âge de 78 ans, le 20 juillet 1977, à Überlingen, sur le lac de Constance.
► Arnaud Guyoy-Jeannin, éléments n°83, 1995.
◘ Notes :
- (1) Sur FGJ et la Révolution conservatrice allemande, lire l'ouvrage de référence d'Armin Mohler, La Révolution conservatrice en Allemagne, 1918-1932, Pardès, 1993, not. pp. 421-422.
- (2) Cf. Karl Höffkes, Wandervogel : La jeunesse contre l'esprit bourgeois, Pardès, 1987.
- (3) Cf. Ernst Niekisch,« Hitler, une fatalité allemande » et autres écrits nationaux-bolcheviks, Pardès, 1994. Cf. également la thèse de Louis Dupeux, National-bolchevisme : Stratégie communiste et dynamique conservatrice, 2 vol., Honoré Champion, 1976.
- (4) Die Perfektion der Teknik, Klostermann, 1946 (1ère éd.). La 7ème édition, considérablement augmentée, parut en 1953.

Dans les couloirs du labyrinthe
le journalisme politique dans les premières œuvres de Friedrich Georg Jünger
[Ci-dessous : affiche contre l'occupation française de la Ruhr en 1923]
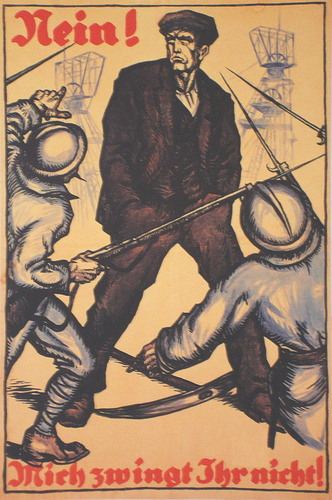 Plonger dans le passé d'un écrivain est un travail avec lequel on se fait peu d'amis. L'existence de zones obscures dans la vie d'un auteur est souvent un secret de Polichinelle, mais ni ses amis ni ses adversaires n'aiment à remuer les “péchés” de jeunesse : les uns afin de préserver l'illusion d'un auteur au passé immaculé, et d'éviter ainsi de créer des points d'attaque contre lui, les autres pour ne pas toucher à des pensées « dangereuses » et risquer de les faire remonter à la surface. De là naît une alliance profane qui rend quasi impossible le travail sur la totalité des textes d'un écrivain. Ainsi, peu d'éditions d'œuvres complètes intègrent également les textes contestés d'un auteur (1). Et ce sont surtout les “conservateurs” qui bricolent des hagiographies sur l'attitude de “résistance” et de “refus” des auteurs, en les présentant comme des esthètes apolitiques.
Plonger dans le passé d'un écrivain est un travail avec lequel on se fait peu d'amis. L'existence de zones obscures dans la vie d'un auteur est souvent un secret de Polichinelle, mais ni ses amis ni ses adversaires n'aiment à remuer les “péchés” de jeunesse : les uns afin de préserver l'illusion d'un auteur au passé immaculé, et d'éviter ainsi de créer des points d'attaque contre lui, les autres pour ne pas toucher à des pensées « dangereuses » et risquer de les faire remonter à la surface. De là naît une alliance profane qui rend quasi impossible le travail sur la totalité des textes d'un écrivain. Ainsi, peu d'éditions d'œuvres complètes intègrent également les textes contestés d'un auteur (1). Et ce sont surtout les “conservateurs” qui bricolent des hagiographies sur l'attitude de “résistance” et de “refus” des auteurs, en les présentant comme des esthètes apolitiques.
Un exemple classique est le cas des frères Jünger. Les citations d'Ernst, arrachées de leur contexte, resurgissent de temps à autre dans la presse (2), évitant au moins que l'auteur ne soit intégré dans le panthéon des écrivains allemands comme un classique reconnu — et dès lors qualifié d'« inoffensif et non lu ». Cet exploit, en revanche, a été réussi par son frère Friedrich Georg. En général, on l'approche uniquement à travers le lien de famille avec son frère Ernst, en tant que pendant sensible et introverti de ce dernier ou en tant que poète aux beaux vers classiques.
Mais les apparences sont trompeuses. Chez le même individu coexistent Docteur Jekyll et Mister Hyde. Et, en tant que Hyde, FGJ a rédigé sous la République de Weimar des écrits politiques d'un contenu troublant et d'une forme bien peu classique. En dehors d'un manifeste national-révolutionnaire, Aufmarsch des Nationalismus (La marche en avant du nationalisme), rédigé en 1926, et de plusieurs contributions dans des ouvrages collectifs, FGJ publia entre 1926 et 1934 au moins 26 articles dans 7 revues différentes. Il est à noter que ces articles, tout comme les contributions aux ouvrages collectifs et le petit livre sur le nationalisme, sont introuvables aujourd'hui et n'ont pas été intégrés aux œuvres complètes.
Ce travail a pour objet de mettre pour la première fois en lumière l'œuvre politique de FGJ telle qu'elle a été publiée dans les articles de revues (3).
Dans les revues de la Révolution conservatrice
Les publications de FGJ ont paru presque dans les mêmes revues que celles de son frère. Les premières furent rédigées en 1926, dans l'hebdomadaire Standarte. Après l'interdiction de celui-ci, Jünger écrit d'abord pour Arminius entre le 8 août et le 9 décembre 1926, puis pour la revue Vormarsch. Après un interlude au journal Der Tag (4) et des publications parallèles dans Das Reich et Die Kommenden (5), FGJ publia ses derniers articles dans la revue Widerstand (6) de Niekisch. Voilà pour les travaux journalistiques clairement identifiables. Quant aux publications sous pseudonyme, les recherches n'ont, hélas !, jamais été menées. L'existence prouvée d'un pseudonyme permet de penser que des écrits inconnus jusqu'à présent continuent de dormir dans certaines revues. Dans ce contexte, les Nationalsozialislistischen Briefe occupent une position particulière. Concernant cette revue, qui porte comme sous-titre « Halbmonatsschrift für nationalsozialistische Weltanschauung » (Bimensuel pour l'idéologie national-socialiste), le journal Völkischer Beobachter précisait :
« Les Nationalsozialistische Briefe ne sont pas un organe de parti politique, mais une revue indépendante. Ses articles n'ont pas un caractère partisan, mais celui de dissertations scientifiques et livrent matière à discussion » (7).
Cette revue, éditée par Gregor Strasser, où Joseph Goebbels était secrétaire de rédaction avant sa « conversion sur le chemin de Damas », était un des organes de l'aile gauche de la NSDAP. Bien qu'Otto Strasser ait commencé à diriger les Nationalsozialistische Briefe à partir du numéro 2 du 15 juillet 1930, Gregor Strasser en resta officiellement l'éditeur jusqu'au numéro 3 de la même année (8). Mais il est surtout intéressant de savoir qui furent ensuite les collaborateurs permanents de la revue, dès lors proche de la Kampfgemeinschaft Revolutionäre Nationalsozialisten (Communauté de combat des nationaux-socialistes révolutionnaires) de Strasser. Aux côtés de Friedrich Wilhelm Heinz, Ernst Buchdrucker, Eugen Mossakowski, Hartmut Plaas, Richard Schapke, Bodo Uhse, Erich Rosikat et du comte von Reventlow, nous retrouvons également Ernst et « Friedrich Jünger » : le secrétaire de rédaction étant Herbert Blank (9). Certes, nous n'y trouvons pas d'articles signés par FGJ ; il serait néanmoins possible d'examiner les articles anonymes ou écrits sous pseudonyme selon les méthodes d'analyse de texte, et de lui ainsi attribuer certains textes (10).
Des positions sans compromis
Les articles de FGJ étudient toujours les « questions de principe » touchant le nationalisme, et ne traitent que rarement des thèmes de la vie politique quotidienne. Ses premiers écrits représentent en quelque sorte une continuation de son livre, Aufmarsch des Nationalismus, et sont encore étroitement liés à cette pensée. Jünger se montrait surtout convaincu de l'importance des ligues de combat pour le nationalisme (11). Ainsi, dans son tout premier article intitulé « Die Kampfbünde » (Les ligues de combat) (12), FGJ écrit :
« Le nationalisme aujourd'hui ne doit être ni monarchique ni républicain, il ne doit être ni réactionaire ni libéral. Il faut qu'il soit nationaliste dans tous les sens du terme — incarnant de plus en plus la volonté d'aboutir à un nouvel État propre au nationalisme. Le mouvement nationaliste a d'autres devoirs que de remettre sur le trône une multitude de princes déchus ou de défendre une Constitution idéologique. Sa premiére tâche est l'anéantissement du système libéral dominant et le remplacement de l'État mécanique par un État organique, c'est-à-dire : installer l'absolutisme de la personnalité nationaliste à la place de majorités abstraites (...)
Le mouvement doit enfin prendre conscience que le système actuel de la formation des partis politiques ne peut être détruit par un parti politique. Le nationalisme ne doit pas développer sa force de combat de maniére libérale. Il doit plutôt commencer à surmonter l'État des partis et des classes en s'abstenant de former un parti et de participer à l'activité parlementaire. Il faudrait laisser s'épuiser ces formes libérales (...) Ce ne peut être la tâche du nationalisme de s'activer dans une opposition plus ou moins modeste. Rien ne s'améliorera si le nationalisme continue a se mouvoir docilement selon les vieilles stratégies. Un tel comportement ferait preuve d'infériorité intellectuelle et révélerait une ignorance des grands défis à venir ».
Ces lignes illustrent bien la position sans compromis de FGJ, surtout en ce qui concerne les partis, position qu'il continuera de défendre par la suite. D'autres réflexions, telles celles qui apparaissent par ex. dans la préface de Das Gesicht der Demokratie (Le visage de la démocratie), sont de nature purement tactique et ne changent rien à cette position de principe (13). L'article suivant, intitulé « Kampf ! » (14), fustige la corruption de la République de Weimar, tout en utilisant cette vénalité comme une arme contre la République. FGJ écrit :
« L'effritement de l'idée démocratique s'étend aujourd'hui à la totalité des organisations démocratiques et peut être décelé partout. Il se manifeste à travers une dissolution croissante, à travers cette anarchie proliférante qui est la fille du libéralisme. L'ère démocratique touche à sa fin. Rien ne confirme autant cette réalité que la position morale de ceux qui représentent cette ère — de façon modérée ou radicalement pathétique. Un désastre incroyable se prépare au sein de l'élite de la République, la pourriture se propage violemment : elle sort du sanctuaire et répand sur le peuple cette odeur de corruption qui plane toujours au-dessus de la décadence.
Sans être prophète, on peut prédire avec certitude qu'en cas de maintien des actuelles formes politiques, de nouveaux et incroyables scandales anéantiront le peu de confiance encore accordée au régime par certains incorrigibles. Ce phénomène est nécessaire, car la déchéance de l'idée démocratique se manifeste, non seulement de manière abstraite, mais aussi à travers le déclin personnel de ses représentants. Les pensées proclamées en 1789 avec feu et fierté révolutionnaire, ces pensées qui avaient encore empli l'Allemagne de 1848 avec affection et pathos bourgeois (fût-ce un pathos verbeux et emphatique), ces pensées ne sont aujourd'hui plus rien d'autre qu'une couverture de la corruption, du beau mensonge et de la saleté qui se répand rapidement ».
Mais après ces phrases, FGJ s'éloigne de l'analyse générale pour se lamenter de ce qu'un « grand Prussien » comme Hindenburg trône parmi toutes ces crapules. Il manifeste ainsi son incompréhension devant ce militaire vénéré s'acoquinant avec un système détesté, et il essaie de résoudre la contradiction entre sa lutte contre le parlementarisme et sa haute considération pour Hindenburg en distinguant le militaire du politique (15) :
« Il a rendu plus difficile notre tâche : nous sommes obligés de combattre sa position politique, mais, dans ce combat, nous garderons toujours le respect qui revient au vainqueur de Tannenberg ».
Cette réserve surprend, car elle sous-entend que FGJ croit en la possibilité de mener une guerre civile. Une telle croyance a aujourd'hui, après l'expérience de 2 guerres mondiales et de 50 années de paix, quelque chose d'émouvant et de naïf. Mais quelques lignes plus loin, FGJ proclame déjà avec ardeur la révolution nationaliste dans toute sa dureté :
« Le mouvement que le mois de novembre 1918 a mis en marche n'est pas encore terminé. Il n'a trouvé ni but ni réparation. En avant ! Achevons ce mouvement dans un autre sens ! Proclamons la révolution nationaliste de l'action et maintenons l'idée de la revanche, de la vengeance juste ! (...) Notre aspiration, notre fin, est le développement inconditionnel et inexorable de l'Allemagne. Nous sommes déterminés à lutter à tout prix pour ce but et à employer les moyens les plus durs et les plus impitoyables lorsque cela s'avérera nécessaire. Le nationalisme est uni dans son désir d'aimer et de vénérer la patrie comme étant la communauté de destin la plus puissante, de lui sacrifier son sang et sa fortune et de lui fournir tous les moyens nécessaires ; ce nationalisme doit éliminer par un combat déterminé tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin ».
Nous pouvons constater une forte affinité entre les propos de FGJ et le concept du mythe tel qu'il a été développé par Georges Sorel (16). Cette affinité s'exprime, entre autres, dans l'expression « révolution de l'action » — qu'il faut comparer à la « propagande d'action » anarchiste. L'approche jüngerienne du terrorisme puise aux sources les plus diverses : les racines anarcho-syndicalistes du fascisme italien autant que le futurisme de Marinetti, qui proclame dans son Manifeste : « Nous voulons célébrer la guerre, cette unique hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles pensées qui tuent et le mépris de la femme » (17). L'anarchisme, tout comme le socialisme chez Spengler, est utilisé comme thèse par les nationaux-révolutionnaires pour former, avec l'antithèse que représente la prussianité, la synthèse de l'« anarchisme prussien », cette expression étant ensuite employée comme concept de combat contre la République de Weimar.
Après l'interdiction de Standarte, FGJ commence à écrire pour la revue Arminius. Là, quelques mois seulement après son appel à la création de ligues de combat et d’un réseau les reliant entre elles, il résume ses tentatives dans un article au titre évocateur : « Das Fiasko der Bünde » (Le fiasco des ligues) (18). Ce texte occupe une place centrale dans l'évolution de la position élitaire de FGJ et de son entourage. Il s'agissait de prendre ses distances par rapport aux organismes de masse dont on avait constaté l'indétermination, et dont on doutait surtout qu'ils osent rompre un jour avec le « wilhelmisme ». Les desseins des ligues et ceux des nationalistes étaient trop différents : le droit et l'ordre pour les uns, la révolte et le refus militant de l'ordre établi pour les autres. Ainsi, FGJ observe-t-il au début de son article :
« L'heure est venue où l'on ne peut plus rester silencieux devant la politique des ligues de combat, où la franchise devient indispensable. Cette politique a mené vers un fiasco total (...) Y a-t-il encore quelque chose à attendre des ligues ? Ou devraient-elles plutôt être dissoutes afin de céder la place à un nouveau mouvement central de résistance ? »
L'analyse qui suit fait apparaître les divergences inconciliables séparant les 2 positions. Ainsi, on décelé clairement des allusions à l'expérience du « Casque d'Acier » (Stahlhelm), à l'orientation strictement légaliste de cette ligue, ainsi qu'à l'incapacité de sa direction à la transformer en organisme révolutionnaire. FGJ constate :
« On a enterré l'élan révolutionnaire dans le traditionalisme, on a rendu stérile l'expérience de la guerre, et la négation du système dominant a fait place à une approbation morose. On n’a pas tait le moindre effort pour se détourner du libéralisme ; sans avoir éliminé les nombreux éléments opportunistes, on fait déjà de la propagande pour de nouveaux adhérents. De cette façon, les ligues sont devenues un bourbier organisationnel, où les opinions les plus contradictoires fleurissent et se croisent sans gêne. Les dirigeants des ligues de combat ont eu le front de voter, de renforcer les partis par leurs voix et de les soutenir dans leur travail de sape ».
Ici se révèle bien le rejet du système parlementaire chez FGJ : tout soutien à un parti politique, quelle que soit sa couleur, est violemment refusé, puisque le parti politique en soi est à rejeter. C'est que le mot « parti », qui trouve son origine étymologique dans la « part », ne désigne qu'une « partie » de la population, impliquant donc une division en groupes concurrents au sein du système étatique et, finalement, la dissolution de ce système. Par conséquent, selon les nationalistes, un mouvement ayant inscrit la nation dans sa bannière ne peut collaborer avec un parti politique, car il approuverait ainsi la division de la nation.
Un nationalisme absolu
FGJ justifie donc le refus du système des partis par sa conception du nationalisme :
« Le nationalisme ne connaît pas de collaboration avec le système dominant, il ne connaît ni droite ni gauche, ni sympathie monarchiste, ni compromis. Son essence est l'activisme révolutionnaire, il est républicain, dictatorial. Il représente l'idée de l'État absolu et rejette l'État ploutocrate de Novembre. Il ne veut en aucun cas contribuer aux actions et aux discours de ce dernier, car il ne veut pas se rendre coupable de ce qui s'y passe ».
Or c'est justement cette collaboration-là que FGJ reproche aux ligues de combat : elles se seraient compromises avec un État qui n'est pas le leur ; au lieu de le combattre de toutes leurs forces, elles se laissent « retourner ». En acceptant ainsi les règles du jeu démocratique, les ligues s'excluent du camp militant et se retrouvent intégrées dans la vie politique quotidienne. Elles servent maintenant à assurer des sinécures ou à faire passer leurs intérêts. Elles occupent le rôle du bouc émissaire qui, en agissant au sein du système des partis, en vient toujours à découvrir ses faiblesses et devient la cible facile d'attaques de toutes sortes. Jünger juge cette manière d'agir en 2 phrases :
« Elles [les ligues] continuent à se transformer en associations d'anciens combattants et en partis politiques sans avoir le courage de se déclarer des mouvements de combat. Une telle boue doit en toutes circonstances être liquidée ».
Et il identifie la faiblesse des ligues :
« Il est temps maintenant de le dire clairement : la base intellectuelle des ligues est insuffisante ».
L'incapacité à sortir de son horizon étroit bloque le regard de la droite traditionnelle sur la situation nouvelle. FGJ parle dans ce contexte de la « pensée Stahlhelm », de la « pensée du mouvement jeune-allemand » (Jungdeutscher Gedanke) ou encore des « pensées des ligues de combat » — qui, toutes, provoquent la nausée chez les nationaux-révolutionnaires. Le fait d'insister sur les « pensées du front » (Frontgedanken) et le souvenir nostalgique du champ de bataille sont incapables à eux seuls de former une alternative efficace au libéralisme et au communisme. Mais FGJ est conscient que les fonctionnaires administrateurs des grandes propriétés héréditaires resteront insensibles à de telles revendications. Pour cela, il lance un appel destine à un public bien précis :
« Militants du Baltikum, de Haute-Silésie, de la lutte anti-séparatiste ! Saboteurs de l'invasion de la Ruhr ! Vous, à la fois ouvriers et soldats de la Grande Allemagne ! Aujourd'hui, vous vous trouvez au carrefour ! » (19)
Et il termine :
« Les ligues n'existent pas si elles ne sont pas nationalistes. Car l'avenir est au nationalisme pur et absolu, dont l'ère a commencé avec la marche sur Rome. Pour nous, il n'existe qu'une devise : “Vive le nationalisme révolutionnaire” ! »
Le fait de mettre sur pied d'égalité les notions de “nationalisme révolutionnaire” et de “marche sur Rome” définit clairement le champ conceptuel de l'auteur. FGJ établit ici un lien avec le fascisme révolutionnaire, mais nullement avec le national-socialisme, et encore moins avec la version victorieuse qu'allait par la suite en donner Hitler.
L'analyse de l'expression “marche sur Rome” — créatrice de mythe et de style — n'est pas l'objet de ce travail (20), mais il est remarquable que ni la marche de la Feldherrnhalle ni la bataille pour la prise de l'Annaberg ne sont interprétées ici comme moments-clés de l'ère nationaliste. Le fascisme en tant que tentative d’institutionnaliser le nationalisme fut le seul mouvement contemporain ayant comme objectif l'État fort. Il pouvait rejoindre, à cet égard, la vision étatique de FGJ. Ce n'est donc pas un hasard si la conception de l'État chez les fascistes et le prussianisme défendu par les nationaux-révolutionnaires se retrouvent sur plusieurs points (21).
Contre la Société des Nations
La relation avec la Russie, importante pour la Prusse, fournit le thème de l'article suivant de FGJ, intitulé « Deutsche Außenpolitik und Russland » (La politique étrangère allemande et la Russie) (22). L'auteur commence par condamner l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations, en 1926 ; il la considère en effet comme une manœuvre orchestrée par les Alliés afin d'empêcher une politique de révision de l'Empire, de couper tout contact avec la Russie (23) et d'entraver tout développement autocentré de l'Empire en l'intégrant dans une communauté de valeurs occidentales. Jünger écrit :
« La démocratie allemande savoure véritablement les événements qui ont accompagne l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations (...) Elle ne cache pas sa joie de voir l'Allemagne entraînée dans le tourbillon des idées occidentales (...) Elle veut nous faire croire naïvement qu'à la politique peut se substituer un système de civilisation humanitaire (...) Mais on rencontre partout l'attitude morale de petits bourgeois assoiffes de réconciliation et de scènes émouvantes, fussent-elles hypocrites. Fini la froideur et la réserve !
Les paroles n'ont plus assez d'espace (...) Ils [les bourgeois] débordent de verbiage et de banalités. Peu d'honnêteté, car l'on aime à se mentir (...) La Société des Nations et ses objectifs ne correspondent pas aux aspirations allemandes. Cette Société possède quelque chose d'imparfait et d'abstrait ; une union d'intérêts aussi contradictoires paraît suspecte dès que l'on tient compte de la dure réalité des États membres (...) Par ailleurs, son impuissance ne peut faire de doute : elle est trop idéaliste pour être efficace ».
Réapparaissent ensuite les motifs de la « froideur » et de la « réserve » — termes que Mohler désigne comme des ingrédients du « style fasciste ». Pour ce qui est de la nécessaire « adaptation militaire de l'Allemagne à la situation des grandes puissances modernes », ainsi que de « la modification indispensable du statu quo des frontières orientales et occidentales », FGJ constate qu'on ne saurait parvenir à une solution au sein de la Société des Nations, toute tentative de discussion à ce sujet étant déboutée avec indignation. Il note surtout « que l'égalité promise au sein de la Société n'a de valeur qu'idéologique », l'Allemagne étant certes plus souveraine, mais ne l'étant cependant pas entièrement. Dans ce contexte, les engagements allemands au sein de la Société des Nations pèsent encore plus lourdement aux yeux de FGJ. Il considère comme particulièrement néfaste :
« que l'Allemagne soit repoussée intellectuellement vers l'Ouest, qu'elle soit dominée par l'esprit français. Les yeux rivés sur Genève, l'Allemagne s'aliène l'Est. À la faveur d'une utopique entente franco-allemande, elle s'éloigne de la Russie. Dans ce moment crucial, l'Allemagne rejoint le cercle des adversaires qui cherchent à affamer l'Union soviétique (…) Tout ceci à un moment où le nationalisme russe s'accroît, où le Comité central a vaincu l'opposition et désavoue les partis communistes des États européens ».
Jünger défend l'Union soviétique, non parce qu'il porte une estime romantique et illusoire à sa culture, mais parce que la collaboration avec la Russie s'avère primordiale pour des raisons stratégiques :
« C'est un fait que la Russie et l'Allemagne ne sont divisées par aucune opposition significative. Rien ne s'oppose à un lien étroit entre les deux États ; ce lien est même exigé par des intérêts vitaux communs, et par une remarquable unité d'objectifs politiques (...) L'Entente bloque l'Allemagne à l'Est par un système étatique qui est devenu insupportable pour notre pays comme pour la Russie. C'est le Traité de Versailles qui, agissant au nom du principe des nationalités, viole pourtant ce même principe et provoque la balkanisation de la frontière orientale. Cette balkanisation couve une multitude de conflits, de sorte que tout espoir d'un avenir pacifique paraît utopique ».
Après une description des situations en Pologne, Tchécoslovaquie et Hongrie, Jünger conclut :
« Cette situation ne peut exister par elle-même. Elle ne se légitime qu'indirectement, se prolonge grâce aux idées de Versailles et doit se transformer et s'achever avec la disparition de celles-ci. La France étant le garant principal de ces États, la politique extérieure de Stresemann nous rend impuissants à l'Est et empêche tout changement décisif ».
Un tel changement ne pouvait s'effectuer, pour FGJ et l'équipe d'Arminius, qu'à travers l'annulation du Traité de Versailles. L'entrée dans la Société des Nations était ainsi perçue comme une nouvelle capitulation, ajoutant une approbation active à la simple acceptation de la politique de Versailles. Cette seconde capitulation impose à l'Allemagne les principes libéraux de l'Entente, alors que cette Entente se sert justement de ces principes pour masquer une politique profondément nationale (24). Néanmoins, Jünger reconnaît de manière réaliste qu'il ne se trouve guère alors de partisans d'une collaboration avec la Russie :
« Oui, aujourd'hui, toute la démocratie avec ses rejetons est antirusse. À droite, on trouve le ressentiment antibolchevique, à gauche, le probolchevisme mais, à droite comme à gauche, on est antirusse ».
Conclusion :
« C'est le devoir du nationalisme rigoureux de défendre une alliance puissante, capable d'entraver la bonne marche de la Société des Nations et d'affaiblir l'impact du Traité de Versailles. La possibilité d'une telle politique est réelle. Elle est inimaginable sans la Russie et se trouve renforcée par les liens amicaux avec l'Italie ».
Une écriture de plus en plus inactuelle
Avec cet article, FGJ se détache définitivement du Stahlhelm. Il prend la voie qu'avant lui avaient déjà empruntée Arthur Moeller van den Bruck (25) et les cercles dits « nationaux-bolcheviks ». Mais le cheminement de Jünger reste étrangement vague. Au lieu de poursuivre sa réflexion selon la manière annoncée, il reste sur sa réserve : paru en janvier, cet article sera suivi, au mois de juillet seulement, d'un nouveau papier, intitulé « Opium für das Volk » (De l'opium pour le peuple) (26). Entre-temps, Jünger n'a publié qu'un poème en 5 strophes, « Gedenkt Schlageter ! » (Souvenez-vous de Schlageter), qui va servir de préface au chapitre « Schlageter » du futur ouvrage intitulé Die Unvergessenen.
Nous sommes réduits à des conjectures concernant les raisons de ce silence journalistique, qui devait ensuite se répéter périodiquement. Le manque de sujets n'est pas une explication. Ce silence pourrait éventuellement être dû en partie au travail lié à la participation de Jünger à Die Unvergessenen (27). « Opium für das Volk », en tout cas, est l'un des premiers articles de Jünger qui ne traitent plus directement de la situation politique du moment, mais regroupent plutôt des considérations culturelles assorties de quelques critiques où l'on discerne encore des impulsions politiques.
Sa critique s'enflamme notamment à propos de l'usage croissant de la publicité, a laquelle il reproche une utilisation malhonnête (mais puissante) des mots. Pour lui, la grande ville symbolise le « cerveau lucide et froid » — la contrepartie du verbiage dominant. Grâce à son environnement, chaque citadin devrait rester insensible à des mots comme « liberté », « paix éternelle » ou « humanisme ». Pour Jünger, la grande ville représente la manifestation d'un pouvoir dont la technique fait plus de victimes que les batailles d'une guerre. Le verbiage, en revanche, obstrue la vue de l'homme, lui fait ignorer les problèmes les plus graves et l'enveloppe dans une sorte d'enivrement.
La tendance de Jünger à prendre ses distances par rapport aux questions politiques pour se consacrer davantage à des textes théoriques plus élaborés se confirme aussi dans l'article suivant, « Der Pazifismus — Eine grundsätzliche Ausführung » (Le pacifisme — Une étude de fond) (28). Dans ce texte, Jünger expose de manière plus explicite ses points de vue sur la valeur de la guerre, qu'il avait déjà abordés dans Aufmarsch des Nationalismus. Il décrit notamment la guerre comme une puissance naturelle, que l'on ne peut ni refuser ni éliminer. Jünger condamne sévèrement l'individualisme, considéré comme le fondement du pacifisme. Sa condamnation aboutit à qualifier les pacifistes influents d'« ennemis du peuple entier », et il appelle à s'en débarrasser par « un acte de légitime défense », en les envoyant au bagne (29) !
Après la publication d'un extrait légèrement modifié de Die Unvergessenen (30), Jünger publia un recueil de 30 aphorismes, intitulé « Dreikanter » (31). Cet ensemble, écrit dans un style polémique et acerbe, formulé avec brio, illustre le talent de l'écrivain pour les exposés pointus, un talent qu'il continuera à développer. Ces aphorismes sont des concentrés de son antilibéralisme élitaire qui, détaché du politique, touche parfois à la sphère métaphysique.
Dans ces 30 aphorismes, dont certains se répondent parfois les uns aux autres (par ex. : § 10-14, 16-19, 27-30), FGJ reprend certains éléments déjà abordés pour les développer. Ainsi, l'anarchisme est mentionné explicitement (§ 23) et le futurisme apparaît à travers le « mépris de la femme » (surtout § 29). En outre, surgissent pour la première fois les thématiques de la sensualité et de la fertilité, que Jünger continuera à étudier, notamment dans son ouvrage sur les dieux grecs — Griechische Götter (32) —, où ces réflexions sont approfondies. Les observations à propos de la douleur (§ 16 et 17) sont remarquables, car elles apparaissent comme des pensées préparatoires au célèbre essai de son frère, Sur la douleur (33).
Il serait d'ailleurs intéressant de retracer les influences mutuelles des 2 frères. FGJ rapporte dans ses mémoires le souvenir de longues promenades avec son frère, pendant lesquelles ils avaient échangé leurs points de vue et s'étaient mutuellement stimulés. Ainsi, la symbolique du rêve, par ex. (25), est également un motif qui revient continuellement chez E. Jünger. On doit considérer les « Dreikanter » comme une « matrice » où FGJ a déposé les premières ébauches de ses projets ou simplement les idées auxquelles il a pu se référer par la suite. Les remarques à propos de la langue et de son contenu (§ 1, 2, 3, 4), par ex., peuvent être interprétées comme fondatrices pour les philosophies du langage des 2 frères. Mais l'effet des « Dreikanter » sur les lecteurs du Vormarsch était tout autre. Là, on devait plutôt s'irriter du dédain que Jünger manifestait pour le sport, ainsi que de ses propos virulents au sujet de la femme, en totale contradiction avec l'image alors répandue de la « mère et compagne » (34).
Chaplin, un antibourgeois paradoxal
En 1929, FGJ changea de nouveau de lieu de publication : avec le numéro de janvier de Widerstand commença sa collaboration avec Ernst Niekisch. Sa première contribution parut sous le pseudonyme de Gregor Werl et fut consacrée à Chaplin (35). Charlie Chaplin représente pour Jünger le principe de l'anti-bourgeoisie — « une canaille en vêtements de bourgeois », qui aime le paradoxe dont le bourgeois n'est pas capable. Selon FGJ, cet esprit de paradoxe doit être compris comme un phénomène fondamentalement hostile au bourgeois, qu'il perturbe par l'énergie anarchique avec laquelle il inverse les directions de la boussole. Chaplin est désigné comme un anarchiste authentique (et ici se dévoile encore l'importance de l'« anarchisme conservateur » pour les frères Jünger et les cercles nationaux-révolutionnaires) :
« Chaplin est l'un des rares anarchistes de premier ordre parmi tous ceux qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Un anarchiste sérieux doit d'abord être un individualiste de pure souche. Il ne doit former aucune communauté, car toute communauté le discrédite. Il doit être solitaire, détaché du système des droits et des devoirs au sein duquel il est né. C'est seulement après avoir franchi ce pas qu'il deviendra libre et explosif. Un véritable anarchiste se fait d'abord exploser lui-même : cela aura un effet de dynamite sur son environnement, les autres seront déchirés à leur tour.
L'anarchisme est la seule, l'extrême conséquence du libéralisme. L'anarchiste, c'est le bourgeois qui explose. Dans ce sens, même Chaplin reste bourgeois, aussi fort que soit son antibourgeoisisme déclaré. Il ne découvrira pas l'espace où il n'y a plus de bourgeois, il n'aura pas accès au non-bourgeois (Unbürgerliches). Rien n'est plus impossible pour lui qu'une telle découverte, car elle est de nature héroïque. Mais il tient son rang en tant qu'anarchiste.
Pensons seulement entre quelles mains se trouve aujourd'hui l'anarchisme officiel, quelle racaille minable s'est rassemblée sous le drapeau noir. Elle forme des cliques, elle s'affiche dans des associations. Elle serait capable de représenter l'anarchisme au Parlement, si seulement le quota suffisait pour un mandat. Bon Dieu ! On considère ces gens-là comme dangereux, ces petits protestataires qui s'accrochent à la queue des manifestations communistes — franchement sans instinct, car c'est justement l'endroit où ils ne devraient jamais apparaître. Communisme et anarchisme, c'est l'eau et le feu.
Un anarchiste devrait être conservateur plutôt que communiste, et les plus dangereux le sont d'ailleurs, en ce sens qu'ils reconnaissent tout à fait l'ordre légal et moral pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Mais ceux-là appartiennent à une race à part et leur description n'a pas lieu d'être ici ».
Il n'est pas difficile de deviner qui appartenait à cette « race à part » : c'étaient les auteurs et penseurs appartenant au « cercle Jünger ».
La longueur des articles de FGJ publiés dans Widerstand est remarquable : alors que les premières publications ne dépassaient pas 2 pages, elles deviennent nettement plus importantes à partir de 1929. Jünger élabore ses articles, travaille les tournures : ses écrits ont peu de rapport avec le style journalistique de la plupart des revues. Par ailleurs, il cesse de faire paraître des poèmes dans les périodiques ; dans Widerstand, on ne lira sous sa plume que le poème « Der Fährmann » (Le passeur), qui sera repris dans le recueil Gedichte.
L'article suivant traite principalement de Thomas Mann. Dans une étude intitulée « Konstruktion und Parallelen » (36), FGJ attaque l'essai de Mann sur Freud (Die Stellung Freuds in der modernen Geistesgeschichte), ainsi que son livre Von deutscher Republik. Il condamne violemment la méthode répandue à l'époque et qui cherche à relier des choses inconciliables et incompatibles. Dans le premier écrit, Mann a ainsi essayé de représenter Nietzsche comme l'ancêtre de Freud. Lorsque Mann réclame une « humanité de demain » dont l'origine remonterait à Nietzsche, FGJ, qui doit beaucoup au philosophé de Sils-Maria, s'écrie, indigné :
« Comment ! Nietzsche père d'une “humanité de demain”, lui qui est le père même de l'anti-humanisme ! Nietzsche père d'un “néo-idéalisme”, lui qui, comme nul autre, a anéanti tout ce qui restait de l’idéalisme ! C'est grotesque ! Toutes les données sont faussées et on relie ce qui doit être définitivenient séparé ».
Cette « mise en parallèle » que Jünger juge fallacieuse apparaît de manière encore plus nette dans le deuxième écrit de Mann. Celui-ci s'y livre à une comparaison entre Walt Whitman et Novalis afin de « consolider l'édifice instable de la instable de la démocratie ». À l'affirmation de Thomas Mann selon laquelle la psychanalyse serait l'expression d'un irrationalisme moderne résistant à tout mauvais traitement réactionnaire, Jünger réplique en évoquant la position politique qui fut celle de Mann dans le passé :
« Juste un mot sur ce point. Il n'est pas sans risque de servir la politique par son talent littéraire. Une telle activité devient dangereuse lorsque l'on affiche son refus d'être politicien dans le pathos de l'objectivité. On ne peut écrire des réflexions apolitiques tout en faisant de la propagande démocratique. Pour être plus clair : on ne doit pas le faire ».
Cette affirmation ne laisse pas de doute : Jünger reproche à Mann de tenter de faire se rejoindre les 2 parallèles du conservatisme et de la démocratie. Mais il poursuit en sautant du particulier au général :
« Le cas particulier de Thomas Mann a un caractère symptomatique. Non seulement parce qu'il témoigne de tout ce qui est intellectuellement permis aujourd'hui en Allemagne, de ce que fabrique une “gauche intellectuelle” à partir d'un matériau authentique et éternel : du prêt-à-porter.
Mais surtout, le cas Thomas Mann est dangereux parce que l'Allemand est facilement perturbé par l'incertitude lorsqu'il doit choisir entre ce qui est favorable ou nuisible. Or, nous sommes des Allemands, non parce que nous devons bien être quelque chose, mais parce que nous concevons cette existence collective comme un destin que nous aspirons à accomplir passionnément.
Pour cela, nous nous défendons résolument contre toute tentative de souiller ou d'éliminer ce qui est pur. Même si un tel désir est ressenti comme inhumain, et comme borné à une époque qui voudrait tout être à la fois — de Nanouk l'esquimau jusqu'à la vache sacrée —, cela nous oblige à refuser tout va-et-vient entre l'esprit et sa contrefaçon intellectuelle. Que révèlent ces tentatives, si ce n'est une pensée informe, entrant dans n'importe quel contexte aussi facilement qu'elle en ressort — un jeu, qu'aujourd'hui nous aimons à qualifier d'intelligent ? ».
Dans le sillage des... Tatares !
La pensée de Jünger se développe vers de nouveaux horizons à travers l'article intitulé « Vom Geist des Krieges » (De l'esprit de la guerre) (37). Il s'agit probablement d'une ébauche de sa contribution à Krieg und Krieger : des paragraphes entiers seront repris mot à mot, mais certains passages n'y figureront pas. Ce sont ceux qui traitent de l'« anarchisme prussien » (figure qui trouve la même année — 1929 — son expression littéraire dans l'ouvrage d'EJ, Le cœur aventureux). L'influence nietzschéenne est manifeste. FG entonne un hymne à la guerre et à l'anéantissement du monde bourgeois :
« Mes frères, cette guerre fut bonne. Je dis qu'elle fut bonne rien que par le fait d'avoir existé. Parce que les hommes l'ont vécue autant qu'elle les a vécus » (38).
Pour FGJ, l'image du Hun utilisée dans la propagande alliée représente une distinction autant qu'une mission :
« Car une paix et un ordre qui sont les garants d'une exploitation silencieuse et discrète ne valent rien à nos yeux. Une paix qui rend l'enrichissement absolu ne vaut également rien (...) Nous allons faire sauter I'Europe (39), appeler les Scythes nos amis et boire la coupe de la fraternité avec les Tatares. Nous allons danser sur l'idole de l'ordre, nous allons le railler sans vergogne et abattre ses prêtres de Baal avec le couteau de Daniel. L'esprit de la patrie grogne dans nos ventres ; il veut se taire entendre et ébranlera, comme jadis les trompettes, les murs solides du Jéricho de la fraternité européenne ».
Si on lit l'article suivant (40) de Jünger dans Widerstand tout en gardant à l'esprit le précédent, on constate que le désir de faire « sauter l'Europe » s'est immédiatement atténué sous l'effet des bombes du mouvement du Landvolk, qui ont explosé en Sleswig-Holstein :
« De telles destructions de bâtiments publics n'ont aucun sens ; c'est une bêtise de démolir des murs lorsqu'il s'agit de démontrer l'absurdité de tout un système politique (...) Certes, personne ne peut empêcher les explosions spontanées de l'amertume et du désespoir (...) Mais notre devoir est de lutter clairement, ouvertement et nettement à partir du cœur même de la résistance (...) L'un de nos devoirs est d'en finir avec la démocratie selon les règles de son propre jeu. Nous ne voulons pas l'illégalité et nous n'en avons pas besoin, car toutes les méthodes légales de combat sont à notre disposition » (41).
Le petit zeste d'anarchisme qui persiste encore se ramène finalement à un refus de toute forme d'organisation et d'« actes localisés de violence » :
« Chaque soulèvement a sa période préparatoire (...) Pour cela, nul besoin d'organisations ; c'est au contraire un avantage de combattre librement et indépendamment. Aucune révolution ne peut se passer de la troupe de choc regroupant les hommes qui préparent les décisions ; le nationalisme révolutionnaire dépend particulièrement d'eux. Ils n'ont pas besoin d'une association secrète. Il suffit de bien aiguiser les armes intellectuelles (...) Ce ne sont pas des actes localisés de violence qui serviraient l'ensemble, ils lui nuiraient plutôt. Non, c'est tout l'ensemble qui doit être réveillé, la violence de la vie même (…) Du vent naît la tempête : que la tempête devienne ouragan et balaie tout ce qui a trop vécu sans risques à nos dépens » (42).
La question se pose évidemment de savoir si « vivre sans risques » ne s'appliquerait pas aussi... à FGJ. Dans cette première prise de distance, n'apparaît-il pas que l'« anarchiste littéraire » tente de se démarquer des véritables activistes ?
La phase décisionniste
En 1930, Jünger ne publiera qu'un seul article, « Révolution und Diktatur » (Révolution et dictature), dans le premier numéro de la revue Das Reich de Friedrich Hielscher (43). Dans cet article, il réfute avec virulence la croyance en la possibilité d'une conciliation des contraires, croyance qui revient à brider les décisions inévitables. Certes, cette conciliation serait nécessaire si elle pouvait s'inscrire dans une politique mondiale, où se décide le destin des grands systèmes en place tels que l'économie, la culture ou la politique. Mais une telle décision dépasserait les capacités du Parlement — et l'Allemagne serait alors mûre pour un coup d'État et pour la dictature. Or, la dictature, selon Jünger, ne doit pas être imposée de l'extérieur, mais plutôt se réaliser grâce à l'article 48 de la Constitution ; et la tâche la plus noble du nouveau gouvernement doit être l'organisation de la lutte de libération (44). Par cette prise de position, FGJ s'éloigne définitivement de l'« anarchisme prussien » pour se rapprocher d'un étatisme décisionniste inspiré de Carl Schmitt. On peut présumer qu'à ce moment-là, Jünger ébauchait déjà la préface à l'ouvrage Das Gesicht der Demokratie, où apparaissent également des idées schmittiennes.
Commence ensuite pour Jünger une nouvelle phase de recherche, durant laquelle le nombre de ses publications diminua. En 1931 et 1932, il publia un article par an, celui de 1932 ne dépassant pas une page imprimée. En 1933, année de la prise du pouvoir par Hitler, Jünger se tut complètement.
L'essai intitule « Vom deutschen Kriegsschauplatze » (De la scène de guerre allemande) (45) traite de l'esprit défaitiste régnant en Allemagne. Celui-ci provient d'une atmosphère générale de dissolution : « Le passé n'est plus assez réel, l'avenir pas assez visible » (46). Tout est indifférent, chacun recherche un sauveur qui ouvrirait la voie vers le salut et la sécurité. Mais « les théories ayant cours aujourd'hui n'aboutissent qu'à l'appauvrissement » (47). Jünger considère le socialisme comme la conséquence du processus de paupérisation, et non comme sa solution. La paupérisation implique toutes les institutions — « il n'y a pas d'éros social » —, y compris l'État qui maintient une armée d'assistés sociaux, « une armée sans armes, qui ne lutte pas pour des mers et des frontières, mais pour un pain et une chemise ».
Cependant, cet esprit défaitiste engendre aussi un espoir nouveau et paradoxal : la prise de conscience que, justement, il n'y a plus d'espoir possible, que tout devient disponible car plus rien n'est fondé. Les sauveurs auto-proclamés ne sauveront rien, car plus rien ne mérite d'être sauvé. La tâche de l'Allemagne est la mise en œuvre d'un processus de destruction planétaire qui abolira l'ordre impose de l'extérieur. Mais une telle pensée n'a pas encore effleuré le cerveau des responsables :
« Pour le moment, ils continuent à mener des attaques simulées, à se mettre d'accord, à ne jurer que par les programmes sociaux. Tout cela est du faux luxe : l'expropriation se fraye son chemin toute seule, et lorsque les derniers lambeaux des vieilles guenilles de l'opulence auront moisi, lorsque tout sera dévoré, tout mode de distribution des biens deviendra superflu. Depuis des années, ils bavardent à propos de la démocratie et du socialisme. Le jour où la nation entière portera l'uniforme de la misère, où elle mangera dans une même gamelle, ce bavardage aussi cessera » (48).
L'Allemagne doit reconnaître que sa dépendance est une fiction visant à l'empêcher de faire de la politique — l'objet de cette politique ne pouvant être que la destruction du système économique mondial :
« La Russie, les peuples de couleur, les minorités, la grande crise — ce sont là les vrais alliés de l'Allemagne. La pensée horizontale de la révolution mondiale est notre alliée autant que l'idée des nationalités, qui tranche dans le sens vertical » (49).
À l'apogée du chaos de la République de Weimar, Jünger est prêt à accueillir comme alliés tous les résistants au système dominant. Mais on notera également à quel point FGJ s'est éloigné de tout pragmatisme politique et quels mondes le séparent de la déclaration de Brecht : « d'abord la bouffe, ensuite la morale ». En fait, la venue de cet homme d'État ardemment désiré par Jünger et qui procéderait selon ses principes restait aussi improbable qu'un éventuel soutien de la part de la population affamée. C'est sans doute à partir de ce moment que Jünger s'éloigne définitivement de la politique et se rapproche d'une métapolitique où il observe et diagnostique.
1933 : un interrègne commence
Tout au long de l'année 1933, lorsque la structure idéologique du régime est encore difficile à cerner, Jünger ne se livre à aucune interprétation nouvelle du nationalisme, pas plus qu'il ne tente d'exprimer ses propres idées dans l'espoir qu'elles pourront ensuite se développer et infléchir la politique du moment. Après 16 mois de silence, en avril 1934, il reprendra cependant la parole dans Widerstand (50). La même année parait également son recueil lyrique Gedichte, où l'on pouvait trouver le poème Der Mohn, désaveu codé (mais compris par de nombreux lecteurs) du national-socialisme. C'est dans ce contexte qu'il faut situer ses 3 derniers articles, publiés en 1934.
Le premier est intitulé « Über die Gleichheit » (Sur l'égalité) (51). En apparence, Jünger chante les louanges du nouveau gouvernement. Mais il le fait de manière si élogieuse, en vantant notamment le style démocratique des nationaux-socialistes, que cette apologie prononcée par un anti-démocrate notoire sonne faux :
« Car la popularité est l'écho de l'égalité. Elle est à la mesure des performances des dirigeants. Il ne faut pas être méfiant ou soupçonneux envers la popularité, puisque dans les acclamations du peuple se révèle la voix de Dieu (...) Il ne faut pas se méprendre sur l'enthousiasme qui déferle sur le pays en grandes vagues. Il est une manifestation politique de la démocratie » (52).
Jünger met sur un pied d'égalité le national-socialisme et la démocratie — conviction qu'il conservera même après la guerre. Et il poursuit son analyse en lançant des flèches de tous les côtés :
« La limite de l'égalité se révèle dans la nationalité. L'État-nation n'a ni la force ni la volonté pour dépasser cette limite ».
Cela avait déjà été fatal à Napoléon, « un vrai empereur ». Si Napoléon était un “vrai” empereur, qui représente donc sa contrefaçon ? Jünger fait l'éloge ironique de la transposition du concept de race de la zoologie à la politique, notant que ce concept apporte une nouvelle orientation à l'ancienne interprétation de l'égalité :
« La loi de l'égalité qui domine la structure publique de la démocratie n'est pas rigide. Elle se transforme en absorbant de nouveaux contenus et en se débarrassant des anciens. L'État-nation démocratique cessera d'exister le jour seulement où la nationalité ne sers plus une limite pour l'égalité politique » (53).
Le combat de Jünger a toujours été orienté vers un État-nation fort et contre l'Europe : la notion de « race aryenne » à laquelle « appartiendraient la plupart des nations européennes selon l'opinion dominante » lui semble difficilement acceptable.
En 1934, il fallait commencer à écrire “entre les lignes”, et FGJ était maître dans cet exercice. L'article suivant, « Wahrheit und Wirklichkeit » (Vérité et réalité) (54), indique la nouvelle voie empruntée par Jünger : celle d'un philosophe de la culture dont les allusions politiques sont codées. Il analyse l'aliénation (Entortung) de l'homme moderne en introduisant des conceptions existentialistes, à propos notamment de la transformation du réel comme phénomène destructeur en réalité fictive apportant un simulacre de sécurité. L'homme moderne cherche une sécurité qui n’existe plus — tout comme le réel ne peut plus exister à une époque où les réalités s'effacent. Et de nouveau, au cœur de ce texte apparemment théorique, scintillent de subtils propos visant la situation politique quotidienne :
« Nous voyons que toute forme de pouvoir et d'autorité est devenue suspecte. Cela n'est possible que lorsque le pouvoir n'est plus intègre, lorsque l'acteur est devenu le représentant du pouvoir (55). Là où il apparaît pour devenir l'objet du culte des masses qui en ont besoin, la décomposition de la réalité bat son plein. Toutes les opinions ont perdu leur fraîcheur et une odeur de vernis, de peinture et de maquillage de coulisses parcourt tout le bâtiment. L'effet de scène prend son importance. L'acteur simule une réalité qu'il ne possède pas. Son répertoire est infiniment grand, car il n'y a pas de rôle qu'il ne soit capable de jouer.
Dans ce personnage, on peut étudier les symptômes de la déchéance sous tous ses aspects. Lorsqu'il marche sur son cothurne, le spectateur trompé croit voir un dieu ou un géant, et ouvre grand les yeux et la bouche. Mais ce n'est qu'un misérable faiseur de tours qui s'agite devant lui — et ses tours vont bientôt prendre fin. Il est évidemment bon que la fin approche, car il vaut encore mieux que l'homme disparaisse plutôt qu'il ne tente de s'accrocher à une fausse existence » (56).
Le dernier article de Jünger dans la revue de Niekisch (57) parut peu après la publication de son recueil de poèmes (également à la maison d'édition Widerstand). E.T.A. Hoffmann y est présenté comme un écrivain politique qui a opposé aux artifices de la bourgeoisie le monde des esprits élémentaires. L'image de la « perfection païenne » apparaît ici pour la première fois et ne cessera de revenir ensuite dans l'œuvre de FGJ. Celui-ci reproche à la bourgeoisie d'avoir accepté la rentabilité comme maxime suprême et d'être ainsi entrée en décadence. Le mythe de la communauté populaire (Volksgemeinschaft) est désavoué :
« Ainsi passe le pouvoir, du patriciat bourgeois vers le petit- et le tout-petit-bourgeois ; on se rapproche, on devient national et d'utilité publique. Cette solidarité est sans liberté ; elle est forcée, elle est l'expression même du dilemme » (58).
Jünger voit la solution dans la technique, qui va à l'encontre des ambitions de la bourgeoisie. Dans la technique se fixe la « nature de salamandre » de l'homme :
« La technicité est le lieu où perce la nature élémentaire et spirituelle de l'homme (...) La spiritualité élémentaire constitue une toute autre relation avec la Terre, elle contient un tellurisme plus puissant que les idéologies qui se réfèrent aux traditions locales, aux us et coutumes. Elle est plus forte que le traditionalisme national dans lequel se réfugie la démocratie vieillissante » (59).
Il est évident que de telles pensées opposaient FGJ à l'idéologie “du sang et du sol” des nationaux-socialistes obsédés par les “vieux Germains”. Cependant, dans ses dernières œuvres, Jünger allait de nouveau se distancier de la technique. En pensant les rapports du national-socialisme à la modernité, nous devons d'ailleurs également tenir compte du fait que la glorification de la technique pouvait être compatible avec l'idéologie dominante. Mais il ne serait pas légitime d'en déduire que FGJ a accepté le national-socialisme : ses idées concernant l'État et la nation étaient trop différentes, et son rejet du régime trop manifeste (ce fut aussi le point de vue des nazis).
Redécouvrir l'écrivain politique
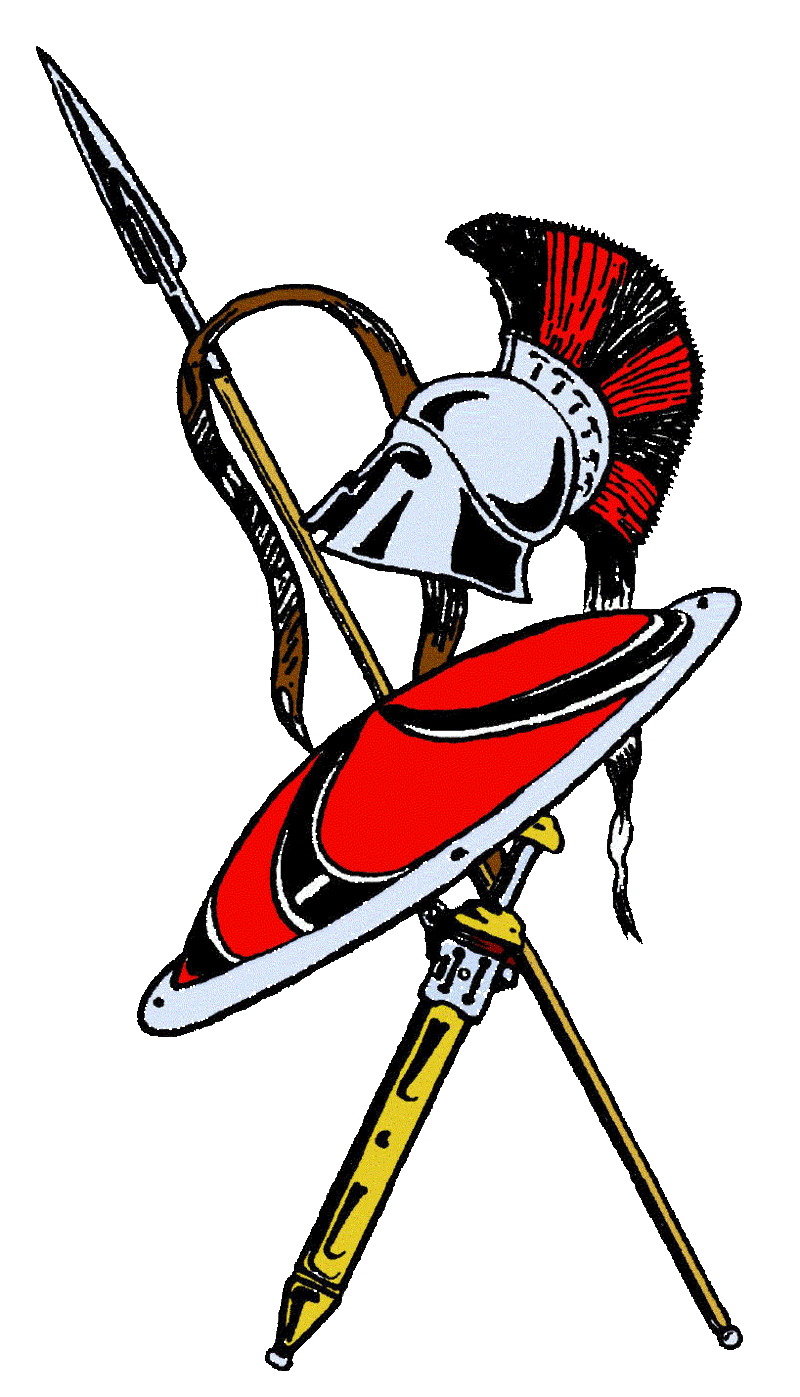 Le parcours de FGJ a commencé par des articles brefs, à la verve radicale, pour se terminer dans de longs essais culturels et philosophiques, où la politique demeurait sous-jacente. Cette évolution ne fut ni droite ni prévisible, mais forme plutôt des circonvolutions : Jünger s'est progressivement délesté de tout ce qui était dépassé pour enrichir sa pensée à travers de multiples sources. Et il transformait ce nouveau matériau selon ses idées propres, pour aboutir à de nouvelles synthèses, complètement différentes de leurs prémisses. Il embrassait de cette manière la quasi-totalité de la pensée de la Révolution conservatrice, sans pour autant tomber sous la contrainte d'un groupe en adhérant à une organisation ; il s'exprimait à propos des sujets qui lui paraissaient importants.
Le parcours de FGJ a commencé par des articles brefs, à la verve radicale, pour se terminer dans de longs essais culturels et philosophiques, où la politique demeurait sous-jacente. Cette évolution ne fut ni droite ni prévisible, mais forme plutôt des circonvolutions : Jünger s'est progressivement délesté de tout ce qui était dépassé pour enrichir sa pensée à travers de multiples sources. Et il transformait ce nouveau matériau selon ses idées propres, pour aboutir à de nouvelles synthèses, complètement différentes de leurs prémisses. Il embrassait de cette manière la quasi-totalité de la pensée de la Révolution conservatrice, sans pour autant tomber sous la contrainte d'un groupe en adhérant à une organisation ; il s'exprimait à propos des sujets qui lui paraissaient importants.
Il est sans doute regrettable qu'il n'ait publié que sporadiquement — probablement du fait de cette absence de contrainte. Néanmoins, la lecture de ses articles vaut aujourd'hui encore le détour. Leur réédition serait bien sûr une entreprise profitable pour l'histoire littéraire. Mais il est surtout remarquable de constater que la plupart des analyses de FGJ s'adaptent encore à la situation présente : un simple changement de nom est souvent suffisant. Cela signifie qu'en certains domaines — politique intérieure, diplomatie ou évolution des partis — la situation de Bonn se rapproche de celle de Weimar. Il est donc temps de redécouvrir FGJ comme écrivain politique. Il incarne l'agitation continuelle propre aux nationaux-révolutionnaires de la République de Weimar — ces hommes dont son frère Ernst disait :
« Notre espoir se fonde sur les jeunes gens qui souffrent d'une température élevée, car en eux se propage le pus vert du dégoût. Notre espoir se fonde sur ces âmes grandioses que nous voyons déambuler comme des malades entre les mangeoires bien alignées » (60).
Si l'influence de son frère aîné est manifeste, FG lui a parfois communiqué ses propres impulsions : la compréhension de l'œuvre symbiotique des Jünger n'est possible que si l'on prend en compte leurs différences autant que leur complémentarité.
Dans son Glossarium, Carl Schmitt n'a pas été tendre pour FGJ. Mais il faut sans doute distinguer les critiques selon qu'elles s'adressent au poète, au philosophe ou à l'écrivain politique. Toutefois, on ne doit pas non plus passer sous silence les points faibles de Jünger. Travaux “profanes” sur la vie politique, notes de lecture ou commentaires ne correspondaient pas à sa vocation, à l'exception de quelques écrits de jeunesse. Il faut ajouter à cela son silence journalistique, qui revenait périodiquement, et le caractère souvent répétitif de ses propos. Ainsi, on trouve dans presque tous ses articles une tentative d'interprétation de la guerre. Pourtant, de telles interprétations, ainsi que tous ces jugements détachés du quotidien, demeurent souvent d'une actualité troublante, 50 ans après la fin de “l'autre” guerre.
En conclusion, je voudrais mentionner une dernière ambiguïté, encore plus sensible chez FGJ que chez son frère : celle de l'écrivain formulant les thèses les plus radicales, mais reculant toujours devant leur application. Esthète de la violence sans avoir la volonté d'agir, FGJ ressemble à nombre de représentants contemporains de la “droite intellectuelle”. Mais peut-être est-ce là l'essence même des intellectuels !
► Volker Beismann, Nouvelle École n°48, 1996. (tr. fr. Nicola Hahn)
◘ Notes :
- (1) Pour citer cependant des exemples positifs, nous pouvons renvoyer aux éditions des œuvres complètes de Gottfried Benn et de Hans Grimm.
- (2) L'exemple le plus récent, mais certainement pas le dernier, est l'attaque de Walter Jens à propos de passages soi-disant antisémites dans les dernières œuvres d'Ernst Jünger. Jens se réfère pour étayer son propos à un article paru en 1930 dans les Süddeutsche Monatshefte.
- (3) Nous ne pouvons tenir compte des publications politiques parues séparément ou dans des ouvrages collectifs ; à part Aufmarsch, il s'agit surtout des contributions aux ouvrages collectifs édités par Ernst Jünger, Krieg und Krieger, Junker & Dünnhaupt, Berlin 1930 (le chapitre de FGJ a paru sous le même titre, pp. 53-67), ainsi que Die Unvergessenen, Andermann, Berlin-Leipzig 1928 (6 essais biographiques de FGJ). Il faut y ajouter la préface à l'ouvrage d'Edmund Schulz, Das Gesicht der Demokratie : Ein Bilderwerk zur Geschichte der deutschen Nachkriegszeit, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1931 (pp. 1-24). Nous ne pouvons pas non plus tenir compte de la poésie d'inspiration politique de FGJ, tel le recueil de poèmes jamais réédité Der Krieg, Widerstand, Berlin 1936.
- (4) Der Tag, Berlin, 7 mars 1928 ; cf. l'article « Der entzauberte Berg », consacré à La montagne magique de Thomas Mann.
- (5) Die Kommenden est une des plus intéressantes revues proches des ligues de la République de Weimar. Fondée en 1925 par la ligue Adler und Falken (Aigles et faucons) pour protester contre la revue Zwiespruch qui se considérait comme représentante de toutes les ligues, Die Kommenden a rapidement rayonné bien au-delà du public restreint des ligues. On constate son lien étroit avec le mouvement national-révolutionnaire à travers les noms de ses différents éditeurs : de janvier 1930 à juillet 1931, Ernst Jünger et Walter Laß figurent comme éditeurs, alors que Karl O. Paetel est secrétaire de rédaction. De 1934 à 1935, la revue adopta le titre Wille zum Reich – 9 Jhg. der Zeitschrift Die Kommenden (La volonté d'Empire – 9ème année de la revue Die Kommenden). L'entreprise de Hielscher, Das Reich, ne connut pas un tel succès. Entre 1931 et 1933, cette revue parut comme publication dactylographiée, censée poursuivre le débat déclenché par le livre de Hielscher, Das Reich. Les auteurs de la revue étaient les mêmes qui participaient ou avaient déjà participé aux autres périodiques de la RC. Il serait d'ailleurs intéressant d'évaluer le nombre de journalistes actifs de la droite nationale-révolutionnaire : on constaterait sûrement qu'il s'agissait d'une communauté fort restreinte.
- (6) FGJ a travaillé à Widerstand de 1929 jusqu'à la fin de 1934. Il y publia 9 articles, dont le premier (1929, pp. 15-19) parut sous le pseudonyme de Gregor Werl.
- (7) Völkischer Beobachter n°92, Munich, 1927, cité d'après l'organigramme des Nationalsozialistische Briefe n°2, Herbst 1930.
- (8) À propos de la rupture entre Gregor et Otto Strasser, cf. Patrick Moreau, Nationalsozialismus von links, Stuttgart 1984, pp. 44-45.
- (9) Nationalsozialistische Briefe, art. cit. La participation permanente de Jünger est prouvée parles organigrammes de la revue entre le 1er août et le 15 décembre 1930.
- (10) L'affirmation des frères Jünger de ne jamais avoir pris position pour un parti politique et d'avoir utilisé les revues comme des « véhicules » deviendrait ainsi caduque : un article de Jünger paru en 1930 dans la revue du mouvement dissident de la NSDAP appelé par la suite Schwarze Front (Front noir), pourrait difficilement être interprété comme une simple publicité pour ses œuvres littéraires. À l’origine d'une telle publication se trouve plutôt le désir, présent chez de nombreux « révolutionnaires nationaux », de soutenir l'aile socialiste, séparée, de la NSDAP, et de créer ainsi un mouvement d'opposition capable de faire face à la ligne de Hitler et de l'École de Munich.
- (11) Il partageait cette conviction avec son frère, qui appelait à la création d'un front commun des ligues dans son article « Schließt Euch zusammen ! » (Die Standarte, n°10, 1926). Mais les réponses des principaux dirigeants des ligues, publiées dans les numéros suivants, ainsi que la conclusion d'EJ dans le n°17, revêtent des divergences profondes entre les différentes organisations.
- (12) In Die Standarte n°10, 1926, pp. 8-11.
- (13) La NSDAP en tant que parti politique n'a jamais constituée une alternative pour les frères Jünger. Depuis les promesses hitlériennes de légalisation et la nette prise de distance de la NSDAP à l'égard du mouvement du Landvolk, E. et FG Jünger pouvaient tout juste concevoir une collaboration partielle avec l'aile gauche des nationaux-socialistes. À ce sujet, cf. aussi E. Jünger, « Nationalismus und Nationalsozialismus », in Arminius n°13, 1927, pp. 8-10, ainsi que « Reinheit der Mittel », in Widerstand, 1929, pp. 295-297. La publication d'un texte d'EJ dans le Völkischer Beobachter en septembre 1923 ne peut être considérée comme un soutien apporté à la NSDAP, ce parti étant alors relativement insignifiant. Au sujet de la participation des frères Jünger dans les Nationalsozialistische Briefe, voir supra.
- (14) Standarte, 1926, pp. 342-333.
- (15) Cette ambivalence était caractéristique des nationaux-révolutionnaires imprégnés de l'esprit militaire. Ils avaient d'abord connu l'ancienne armée en tant qu'instrument apolitique, puis les corps-francs comme structure hautement politisée. Dans l'État idéal des nationaux-révolutionnaires, où les différences idéologiques seraient effacées, I'armée devient un instrument étatique neutre, au-dessus de toute question politique, comme ce fut le cas en Prusse. Fidèles à cette conception, les nationaux-révolutionnaires s'obstinaient à vouloir définir l’armée de manière non idéologique, afin de donner un fondement à l'État au-delà des divisions de l'opinion et de la guerre civile qu'elle engendre.
- (16) À ce sujet, cf. aussi Karl O. Paetel, « Politischer Mythos und Realismus », in Zeitschrift für Geopolitik, 1955, pp. 705-713.
- (17) Filippo Tommaso Marinetti, « Manifest des Futurismus », in Der Sturm n°104, 1912, pp. 828-829, point 9.
- (18) « Das Fiasko der Bünde », in Arminius n°41, 1926, pp 5-7.
- (19) Cette énumération des « activistes de droite » fait apparaître un problème essentiel des frères Jünger – la question de l'engagement. FGJ parle ici de « co-militants » (Mitkämpfer), et non de « militants » (Kämpfer). C'est d'autant plus ricanant que ni Ernst ni FG n'ont été actifs dans les guerres civiles ici évoquées. FGJ quitta l'armée en 1920 en tant que lieutenant, pour terminer tranquillement ses études de droit à Leipzig. Il n'était pas membre du régiment des volontaires temporaires de Leipzig ; en mai 1921, il ne prit pas non plus le train avec l’Erste Sturmfahne Oberland (Premier corps d'assaut Oberland) qui transportait les associations de volontaires et étudiants des corps-francs vers la Haute-Silésie. Le radicalisme de l'action resta, comme plus tard lors de la lutte du mouvement du Landvolk, loin derrière le radicalisme littéraire. Cette ambivalence n'apparaît pas chez des hommes, comme Plaas, Heinz ou von Salomon.
- (20) Voir à ce sujet l'important exposé d'Armin Mohler, « Der faschistische Stil », in Von rechts gesehen, Stuttgart 1974. pp. 179-221. Ce texte demeure une référence pour présenter les conceptions esthétiques de la droite européenne non nationale-socialiste.
- (21) Nous ne pouvons nous accorder complètement avec les arguments contre cette thèse présentés par Friedrich Wilhelm Heinz dans le chapitre « Das Reich, der Reichsraum und der Faschismus », in Goetz Otto Stoffregen (Hrsg), Aufstand : Querschnitt durch den revolutionären Nationalism, Berlin, 1931, pp. 65-75.
- (22) « Deutsche Aussenpolitik und Rußland », in Arminius n°3, 1927, pp. 4-7.
- (23) Le traité germano-russe du 24 avril 1926 avait confirmé et élargi le traité de Rapallo de 1922. Il était considéré à l'étranger comme la tentative d'élargir vers l'Est la marge de manœuvre allemande qui était alors considérablement limitée.
- (24) Sur la problématique de la Société des Nations, cf. aussi les écrits de Carl Bilfinger, en particulier Der Völkerbund als Instrument britischer Machtpolitik, Berlin, 1940.
- (25) Dans ce contexte, nous attirons l'attention sur la réplique de Moeller à Karl Radek, parue dans le journal Gewissen du 30 juillet 1923, sous le titre « Wirklichkeit ». Elle forme, avec les articles du comte von Reventlov, la réponse principale de la “droite” intellectuelle à l'orientation dite “pro-Schlageter” du parti communiste.
- (26) « Opium für das Volk », in Arminius n°28, 1927, pp. 4-6.
- (27) Ernst Jünger (Hrsg), Die Unvergessenen, op. cit.
- (28) « Der Pazifismus – Eine grundsätzliche Ausführung », in Arminius n°36, 1927, pp. 6-9, et n°37, pp. 6-8. Ne serait-ce que par sa longueur, cet article occupe une place particulière dans Arminius.
- (29) Arminius n°37, p. 4. Des thèses semblables furent défendues par Wilhelm Stapel dans la revue Deutsches Volkstum, 1932, p. 175 : « Les pacifistes sont des propagateurs biologiques de la peste ». À ce sujet, cf. aussi Heinrich Kessler, Wilhelm Stapel als politischer Publizist, Nürnberg, 1967, p. 150.
- (30) « Des roten Kampffliegers Ende : Manfred von Richthofen zum Gedächtnis », in Der Vormarsch, 1927-1928, pp. 119.
- (31) « Dreikanter », in Der Vormarsch, 1928, pp. 161.
- (32) Griechische Götter : Apollon-Pan-Dionysos, Frankfurt/M, 1943. Dans son ouvrage de référence sur la Révolution conservatrice, Armin Mohler a vu dans cet essai de FGJ l'expression d'une « image conductrice » du mouvement qu'il a nommé « Der große Mittag » (Le grand Midi).
- (33) Emst Jünger, « Über den Schmerz », in Blätter und Steine, Hamburg, 1934, pp. 154-213. Cet essai se veut une continuation du Travailleur. Selon EJ, « apparaissent peut-être ici des transparences qui avaient été omises pour de bonnes raisons dans Le Travailleur ». Par ailleurs, il est intéressant de noter que l'ouvrage contient un « Annexe épigrammatique » de cent aphorismes.
- (34) Voir la biographie de Friedrich Hielscher, Fünfzig Jahre unter Deutschen, Hamburg 1954, p. 205, qui consacre un sous-chapitre à FGJ (pp. 205-210).
- (35) Gregor Werl, « Chaplin », in Widerstand n°1, 1929, pp. 15-19.
- (36) « Konstruction und Parallelen », in Widerstand n°6, 1929, pp. 177-181.
- (37) « Vom Geist des Krieges », in Widerstand n°8, 1929, pp. 225-230.
- (38) Ibid., p. 226.
- (39) Dans Le cœur aventureux, EJ écrit pour sa part : « Nous avons la réputation dans le monde d'être capables de détruire des cathédrales. C'est déjà quelque chose, à une époque où la conscience de la stérilité fait pousser les musées comme des champignons » (op. cit., p. 153).
- (40) « Der Bombenschwindel », in Widerstand n° 10, 1929, pp. 291-295.
- (41) Ibid., p. 294.
- (42) Ibid., p. 294 ff.
- (43) Ibid., pp. 9-12. Apparemment, il s'agit plus d'une faveur consentie à Hielscher que d'une adhésion intime de Jünger. Dans la préface de ses mémoires, Hielscher évoque avec brio les différentes revues qu'il a animées, et place Das Reich à la fin, comme une sorte d'accomplissement. Mais quand on lit d'autre part la critique acerbe de Niekisch à propos du livre de Hielscher (« Das Reich », in Widerstand n°10, 1931, pp. 295-302) – critique où s'introduisent aussi des ressentiments personnels –, on devine que Jünger devait se trouver devant un dilemme.
- (44) Ibid., p. 12.
- (45) « Vom deutschen Kriegsschauplatz », in Widerstand n°9, 1931, pp. 257-261.
- (46) Ibid., p. 257. (47) Ibid., p. 259. (48) Ibid., p. 262. (49) Ibid., p. 263.
- (50) En 1932 parut aussi l'article « Die Innerlichkeit » dans le n°12 de Widerstand, pp. 362 ff.
- (51) « Über die Gleichheit », in Widerstand n°4, 1934, pp. 97-101.
- (52) Ibid., p. 99.
- (53) Ibid., p. 101.
- (54) « Wahrheit und Wirklichkeit : Rückblick auf den Zerfall dût bürgerlichen Welt », in Widerstand n°5, 1934, pp. 138-147.
- (55) Jünger introduit là une note en bas de page : « Les rois bourgeois ne sont toujours que des acteurs de la royauté ». On ne peut supposer qu'il s'était inspiré de l'exemple de Gustaf Gründgens lorsqu'il dessinait ce portrait de “l'acteur”.
- (56) Ibid., pp. 146 ff.
- (57) « E. T. A. Hoffmann », in Widerstand n°11, 1934, pp. 376-383. Selon une annonce publiée dans le n°9 de Widerstand (1934), le recueil Gedichte devait paraître au plus tard début octobre.
- (58) Ibid., p. 382. (59) Ibid., p. 383.
- (60) Ernst Jünger, Le cœur aventureux, op. cit., p. 222.

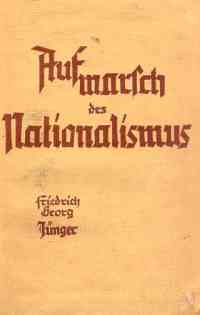 ◘ Préface à Aufmarsch des Nationalismus (1926)
◘ Préface à Aufmarsch des Nationalismus (1926)
Nous revendiquons le nom de nationalistes — un nom qui est le fruit de la haine que nous vouent la populace grossiére et raffinée, la canaille cultivée, le grouillement des attentistes et des profiteurs. L'objet d'une telle détestation, ce qui fait horreur à la vacuité des courants du progrès, du libéralisme et de la démocratie, a du moins l'avantage de ne pas être universel. Nous ne revendiquons pas l'universalité. Nous la rejetons, depuis les droits de l'homme et le suffrage universel jusqu'à la culture et aux vérités générales, en passant par le service militaire obligatoire et l'indignité généralisée qui en est le résultat nécessaire. Les particularités qui n'en sont pas et les revendications universelles sont des particularités et des revendications de masse, et plus une chose est répandue, moins elle a de valeur. Se réclamer de la masse, c'est tirer gloire du poids, c'est-à-dire d'une propriété physique, et voir dans le concept d'humanité le concept le plus élevé, c'est voir l'essentiel dans l'appartenance à une espéce déterminée de mammifères. L'universel, c'est ce qu'on pése, ce qu'on mesure et ce qu'on compte ; ce qui est exceptionnel, c'est ce dont on doit éprouver la véritable valeur. Vouloir l'universel signifie qu'on ne sent rien en soi d'exceptionnel et de valeur, tout au plus qu'on est objectif, exact, rationnel, méthodique, “sans parti-pris”. Vouloir le singulier signifie porter la mesure en soi, sentir la responsabilité du sang, reconnaître les puissances de l'âme comme les plus hautes.
La volonté du nationalisme moderne, le sentiment d'une génération nourrie jusqu'à la nausée de la phraséologie trop souvent prédigérée de l'Aufklärung, c'est le particulier. Il rejette mesures et surfaces, mais il aspire à ce qui les fonde et les engendre : la force de l'âme. Il ne tient pas à prouver ses droits par la science comme le marxisme, mais par l'abondance de la Vie même, que la science prenne appui sur elle ou non. Il ne veut ni délimitation ni définition des droits, mais il exige le droit de vivre qui procède de la Vie même, qui forme avec elle une nécessaire et indestructible unité, et qui doit forcément limiter et supplanter les autres sortes de droits s'il ne veut pas leur être subordonné. Il ne veut pas de la domination de la masse, mais veut celle de la personnalité dont la valeur intrinsèque et le degré de vitalité interne déterminent le rang et la prééminence. Il ne veut ni de la justice, ni de la liberté ni d'une égalité monotone ne reposant que sur des revendications, mais il veut jouir du bonheur qu'il y a à être exactement comme ça et pas autrement. Le nationaliste moderne ne veut pas non plus n'être tenu à rien et avoir “l'esprit libre”, il veut plutôt les liens les plus étroits, un ordre et une hiérarchie déterminés par la société, le sang et le sol. Il refuse le socialisme des revendications mais il veut le socialisme des devoirs, un monde dur et stoïque auquel l'individu se doit de tout sacrifier.
La mère de ce nationalisme, c'est la guerre. Ce que nos littérateurs et nos intellectuels ont à en dire est sans intérêt pour nous. La guerre, c'est l'expérience vivante du sang, c'est pourquoi ne compte que ce que de vrais hommes ont à en dire. Le douteux manifeste de nos littérateurs ne peur abolir ni la guerre ni ce que la guerre a produit. C'est tout au plus l'un de ces drapeaux livrés au vent qui flatteront dans une autre direction à la prochaine occasion. Que la guerre, mesure de toutes choses, puisse révéler l'étendue de la platitude, c'est là une question d'intérêt purement psychologique.
Le noyau de la jeunesse allemande n'a passé la guerre ni dans les cafés ni dans les bureaux bien chauffés. Ce fut sans doute un enfer — eh bien soit, il appartient à l'essence de l'homme faustien de ne pas revenir les mains vides, fût-ce de l'enfer. Barbusse et les siens peuvent bien voir ce qui leur chante dans ce purgatoire incandescent, nous y avons vu davantage. Nous n'en revenons pas dans l'esprit du refus pur et simple. Seule la violence de la matière nous a révélé la violence de l'idée. Seule l'horreur du sacrifice nous a fait pleinement connaître la valeur de l'homme et ses distinctions hiérarchiques. Plus clairement que l'indistinct rougeoiement du feu, nous avons vu luire le brasier blanc de la volonté.
Grenades, nappes de gaz, chars d'assaut — cela peut bien être essentiel à la lâcheté comme ça l'est à la brutalité, pour nous c'est bien moins, ce n'est que l'apparence extérieure des choses, le sinistre fond sur lequel se détachent des hommes d'une nouvelle trempe, durs comme l'acier. Nous pressentons l'avènement de ce nouveau type d'homme parmi tous les peuples d'Europe, car de même que la guerre n'a pas frappé seulement les Allemands, de même le nouveau nationalisme n'est pas une conséquence limitée à l'Allemagne. Partout, nous voyons cette énergie vigoureuse nourrie de sang, différente suivant le génie de chaque peuple, déjà victorieuse ou encore au combat et qui aspire à de nouvelles formes. Il faut nous en réjouir, tandis que nous lançons aux autres aussi : “Ce que vous êtes, devenez-le !”, car nous préférons de beaucoup vivre dans un univers ou ce qui prend forme a un sens, plutôt que dans une bouillie sans consistance, sans forme, sans caractère et sans particularité.
Mais on peut bien nous concéder cela : c'est nous qui avons le plus cruellement souffert de la guerre. C'est pourquoi nous sommes aussi ceux qui, après l'éblouissement de l'horreur, aurons le plus besoin de temps pour nous ressaisir, et nous sommes en droit d'espérer qu'une fois le nouvel État jailli de terre, nous en occulterons les plus beaux fruits.
La guerre est notre mère, elle nous a engendrés comme une génération nouvelle dans le sein brûlant des tranchées, et c'est avec une orgueilleuse fierté que nous reconnaissons nos origines. C'est pourquoi nos jugements se doivent d'être héroïques, des jugements d'hommes de guerre et non de boutiquiers qui voudraient d'un monde à leur mesure, Nous ne voulons pas l'utile, le pratique ou l'agréable, nous voulons le nécessaire — ce que veut le Destin.
Le soldat allemand de première ligne défile, droite, gauche, en avant. Laissons à chacune des colonnes le temps de se rendre compte du sens de la marche. Il s'avèrera que nous nous dirigeons tous vers le même point. Mais nous ne pourrons pas en finir avec notre monde si nous ne sommes pas d'abord venus à bout de nous-mêmes. Notre étendard n'est pas rouge, ni noir-rouge-or, ni non plus noir-blanc-rouge, c'est le drapeau du Reich nouveau et plus grand qui se fonde dans notre cœur et qui doit prendre forme en lui et à partir de lui. Le temps est proche où il pourra être déployé au grand jour. C'est la guerre qui est notre tradition commune, le grand sacrifice — prenons conscience du sens de cette tradition !
Cet écrit, que je salue en tant que frère, compagnon d'armes et ami, et que d'autres suivront bientôt, présente brièvement les quatre piliers fondamentaux du nationalisme moderne. Il correspond à l'attitude d'une jeunesse qui n'est ni doctrinaire, ni libérale ni réactionnaire, et qui veut se tenir éloigner de l'esprit de cette “Révolution du rutabaga” qu'elle considère comme quelque chose de fondamentalement impur. C'est dans les plus terribles paysages du monde que cette jeunesse a appris de haute lutte que tous les anciens chemins ont pris fin et qu'il est nécessaire d'en tracer de nouveaux. La première phase de sa formation s'est achevée, et une nouvelle commence.
Nous saluons le sang que les flammes de la bataille ne consumèrent pas, mais transformèrent en un feu brûlant ! Ce qui ne put être détruit là-bas sera à la hauteur de tous les autres combats. Nous saluons ceux qui viennent et qui, à l'ancienne dureté, devront allier une plus grande profondeur ! Les bataillons se forment, bientôt les rangs seront complets. Nous saluons les morts dont les esprits se dressent face à notre conscience et nous exhortent, interrogateurs. Non, vous ne serez pas morts pour rien ! Allemagne, nous te saluons !
► Ernst Jünger, in : Nouvelle École n°48, 1996.
(tr. fr. : Karin Moeglin, in Le nationalisme en ordre de bataille, mémoire de maîtrise, Strasbourg, 1992)
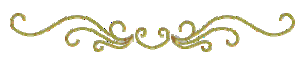
Friedrich Georg JÜNGER : NIETZSCHE
◘ LE JOUEUR DE RÔLES
 Le problème de l'acteur et du spectacle est à ce point crucial que Nietzsche aurait pu faire partir de là toute sa discussion du nihilisme. Il ne l'a pas fait, il a traité de la marche au nihilisme sous forme de développements thématiques, et non de personnages ; et il s'est abstenu de mettre l’acteur au centre des événements. Pourtant, l'acteur résume en lui la totalité du champ nihiliste : la problématique d'une volonté de puissance qui bascule dans le nihilisme peut s'étudier sur cet exemple précis. C'est donc lui qu'il nous faut envisager d'abord. Le laisser de côté, ne pas en tenir compte dans notre analyse, rendrait le processus incompréhensible. En revanche, nous aurons fait toute la lumière dès lors que nous aurons compris le rôle qu'y joue l'acteur. Qui est cet acteur, comment le rendre visible à nos yeux, telle est la première question qui se pose. Le personnage du nihiliste, dans La volonté de puissance, est interprété comme suit : « Le nihiliste est celui qui juge, du monde tel qu'il est, qu'il ne devrait pas être, et du monde tel qu'il devrait être, qu'il n'est pas » (WzM 585). Nietzsche ne nous a pas donné de l'acteur une interprétation aussi lapidaire ; elle pourrait s'énoncer ainsi : l'acteur est celui qui représente en scène ce qu'il n'est pas, et qui est ce qu'il ne représente pas.
Le problème de l'acteur et du spectacle est à ce point crucial que Nietzsche aurait pu faire partir de là toute sa discussion du nihilisme. Il ne l'a pas fait, il a traité de la marche au nihilisme sous forme de développements thématiques, et non de personnages ; et il s'est abstenu de mettre l’acteur au centre des événements. Pourtant, l'acteur résume en lui la totalité du champ nihiliste : la problématique d'une volonté de puissance qui bascule dans le nihilisme peut s'étudier sur cet exemple précis. C'est donc lui qu'il nous faut envisager d'abord. Le laisser de côté, ne pas en tenir compte dans notre analyse, rendrait le processus incompréhensible. En revanche, nous aurons fait toute la lumière dès lors que nous aurons compris le rôle qu'y joue l'acteur. Qui est cet acteur, comment le rendre visible à nos yeux, telle est la première question qui se pose. Le personnage du nihiliste, dans La volonté de puissance, est interprété comme suit : « Le nihiliste est celui qui juge, du monde tel qu'il est, qu'il ne devrait pas être, et du monde tel qu'il devrait être, qu'il n'est pas » (WzM 585). Nietzsche ne nous a pas donné de l'acteur une interprétation aussi lapidaire ; elle pourrait s'énoncer ainsi : l'acteur est celui qui représente en scène ce qu'il n'est pas, et qui est ce qu'il ne représente pas.
L'acteur, qui est-ce ? Dans l'Antiquité, d'abord un type d'homme relevant de la sphère dionysiaque, où il a son lieu naturel. C'est bien là qu'il nous faut le chercher, dans ses plus beaux et lumineux commencements, alors qu'il participe encore de la fête dionysiaque, “figurant” au sens plein du terme, type humain consacré à la fête, artisan même de la fête. C'est lui qui donne à la festivité son plus bel ornement. Le dieu se métamorphose ; l'expression de cette métamorphose est la fête, le masque. Nous pouvons remonter aux origines mêmes de l'acteur, les chœurs du dithyrambe dionysiaque, au moment où le choryphée se détache du chœur pour se placer face à lui.
De cette action dionysiaque, de ce festival sacré procède tout le théâtre antique, drame satyrique, tragédie, comédie, un monde de fictions, d'imaginations poétiques. Dès les premiers commencements, l'acteur fait partie de la fête, donc de la scène, montée tout exprès pour le festival dionysiaque, et sur laquelle il joue son rôle. Il procède de l'univers mythique. C'est dans le monde des métamorphoses que nous ne cesserons de le retrouver ; il y est chez lui, s'y trouve dans son élément. Il vagabonde, nomadise, promène de-ci de-là son art, suit le cortège de la fête.
Une question se pose : le mime se métamorphose-t-il vraiment, se transfigure-t-il, ou ne fait-il que mimer la métamorphose ? Il la mime ; son art est un art de reproduction. Il se fait l'organe d'une réalité qu'il imite. Sa mimique, son costume sont des masques, à l'instar de celui qu'il porte sur le visage dans le théâtre antique. Il est tout entier masque. Il n'est pas type, mais figurateur et imitateur du type. Si l'on s'en tient là stricto sensu, cela veut dire que l'individualité n'entre pas en ligne de compte, ou si peu. C'est pourquoi, chez les Grecs, la personnalité de l'individu était abolie par l'usage du cothurne et du masque, ce dernier servant aussi de porte-voix. La mascarade où l'individu devient méconnaissable remonte aux fêtes dionysiaques les plus anciennes : on se barbouillait le visage de lie de vin, on se couronnait de pampre, de vigne vierge, de lierre, on se voilait de lambeaux d'étoffe. Travestissement comme métamorphose sont dans la nature du dieu, d'où vient que s'institue un rite que perpétuent les masques de théâtre. Dans la plus haute antiquité, ils se modèlent sur une réalité mythique, mais dans la nouvelle comédie attique, avec ses personnages stéréotypés, ils deviennent des masques fixes, dont toute compagnie théâtrale possède son propre fonds. Ici aussi, l'individuel est en principe négligé, mais on se rapproche de lui par le biais de la caractérisation.
Là où la cité grecque se consacre encore à l'élaboration de grands types humains, l'acteur se situe en dehors de cette typificafion. Loin d'être un archétype, il est l'imitateur du type. Il reste cantonné au théâtre, à la scène, à la fête. L'acteur authentique ne se rencontre jamais que dans l'environnement immédiat de la fête. Là où l'individu se détache du typique, où se forme la “masse” — deux processus indissociables —, l’acteur cesse de représenter le type. Ce processus a des conséquences très remarquables. L'acteur cesse d'être ce qu'il était auparavant. Il ne se contente plus de la scène, du théâtre, où il imite et campe une réalité feinte. Il quitte la scène, il descend dans le monde, afin de faire du monde un théâtre.
Plus précisément, en dehors du théâtre, en dehors de la fête se forme une nouvelle couche d'acteurs. Ce mime d'un nouveau genre se trouve soudain partout ; tout un chacun est mime. Chacun donne à voir ce qu'il n'est pas ; chacun est ce qu'il ne donne pas à voir. Processus incompréhensible pour qui n'est pas capable d'y voir la conséquence de l'effondrement d'une ancienne hiérarchie des êtres et des valeurs. Un ordre ancien, une vieille solidité s'est perdue. Commence alors un nouveau cycle où l'homme se retrouve dépourvu de tout fondement. Et cette absence de fondement permet à l'acteur d'accéder à la prééminence.
L'inauthentique imite le type
Nietzsche a beaucoup étudié le phénomène de l'acteur, lequel lui a inspiré une répugnance croissante. « L'on fréquente des histrions, et l'on se fait grande violence pour les honorer, eux aussi. Mais personne ne conçoit à quel point il m'est dur et pénible de fréquenter des histrions ». De quel genre d'acteur parle-t-il ? De celui qui n'est plus ce qu'il a été. De celui qui n'est plus le participant à la fête dionysiaque, mais le Je-suis-partout, mais l'Homme-de-nulle-part de l'opération nihiliste où il se pousse, toujours plus visible, au premier rang des inspirateurs. Le Zarathoustra décrit cette situation dans les phrases suivantes :
« Où la solitude a cessé, là commence la foire ; là où la foire a commencé, commencent les clameurs des grands histrions et le bourdonnement des mouches vénéneuses. En ce monde, les meilleures choses ne sont rien, tant qu'il n'est personne pour les monter sur la scène : et ces monteurs-en-scène, le peuple les appelle les grands hommes. Le peuple ne comprend guère ce qui est grand, autrement dit ce qui crée. Mais il ouvre ses sens tout grand à tous les monteurs-en-scène et autres mimes des grandes choses.
« Le monde tourne autour de ceux qui forgent des valeurs nouvelles : il tourne et l'on ne le voit pas. Mais c'est autour des histrions que tournent le peuple et la gloire : tel est “le monde comme il va”.
« L'acteur a de l'esprit, mais c'est un esprit sans conscience. Il croit toujours à ce qui fait croire le plus fort — à ce qui fait croire en lui.
« Il aura demain une foi nouvelle, après-demain une autre encore. Ses sens sont vifs, comme ceux du peuple, et son flair est des plus mobiles.
« Bouleverser : c'est pour lui tout comme prouver. Rendre fou : c'est pour lui convaincre. Et de toutes les raisons, le sang est pour lui la meilleure. Vérité qui ne glisse qu'en fine oreille, il la nomme mensonge et rien. En vérité, il croit aux seuls dieux qui font quelque bruit dans le monde !
« La foire est pleine de pitres solennels — et le peuple se glorifie de ses grands hommes : pour lui, ce sont les maîtres du moment.
« Mais le moment les presse : de sorte qu'ils te pressent toi-même. De toi aussi, ils veulent un Oui ou un Non. Las, prétends-tu poser ta chaise à mi-chemin du Pour et du Contre ? »
Ces paroles du chapitre « Des mouches de la foire », loin d'être simple référence à l'actualité, rétrospective en quelque sorte, portent sur le futur et sont prophétiques. Cet histrion qu'on associe à la mouche, à la foire, n'est plus l'écolier de Thespis ; il joue ses rôles dans un espace autre, avec des moyens autres, en vue d'autres finalités. Le chapitre « De la vertu rapetissante » fait ressortir ce qu'il en est avec bien plus de netteté. Zarathoustra, fendant le peuple et l'observant, finit par dire :
« Il en est parmi eux de vrais, mais la plupart sont de mauvais acteurs.
« Il est des acteurs parmi eux qui le sont à leur insu, d'autres qui le sont à contrecœur – les authentiques sont toujours rares, surtout les acteurs authentiques.
« D'hommes, il n'en est guère ici : aussi leurs femmes se virilisent. Car seul l'homme qui l'est vraiment saura rédimer en la femme — la femme même ».
Un passage de La volonté de puissance parle plus net encore. La question pour Nietzsche est celle-ci : si l'on est authentique ou seulement mime, si l'on est authentique en tant que mime ou seulement mime de seconde main, si l'on est “représentant” ou bien le représenté lui-même. Qu'est-ce à dire ? Authentique est l'homme conforme au type. Inauthentique est celui qui imite le type, car il imite ce qu'il n'est pas, et par conséquent ne saurait devenir. L'homme typique, là où il imite, imite le type, s'imite lui-même ; il imite ce qu'il est et ce qu'il devient. L'authentique mime est le comédien-né, le comédien de métier, par profession et passion, par instinct et nécessité. C'est l'acteur qui ne quitte pas la scène, qui s'en tient à la sphère du festival sacré dionysiaque. Le pseudo-mime imite le mime authentique, ce qui ne donne rien qui vaille. On le rencontre en tous lieux, car une société dépourvue de types, où les individualités sont l'exception, grouille d'acteurs de seconde main.
Tout est à présent agencé, arrangé en fonction de cet instinct qui pousse à imiter, à contrefaire : toute réclame, toute propagande sont calculées en vue de cette contrefaçon. Le représentant est une sous-espèce du pseudo-acteur, aussi fréquente que vile, qui prolifère à l'infini aux temps où il en est fort peu pour se représenter eux-mêmes, où l'un représente l'autre et l'autre représente l'un, où l'on est assuré par des représentants et même réassurés. C'est la caractéristique de qui ne joue plus son rôle de manière active et spontanée que d'avoir en tout lieu besoin de représentants, et c'est la caractéristique de ce dernier que d'avoir besoin, pour jouer, de réactions à son jeu. La masse est dominée et servie par des acteurs de seconde main.
Si l'on se tient à ce distinguo entre mime authentique et pseudo-mime, il est aisé de reconnaître que les mimes authentiques ne sont qu'une minorité infime, que les pseudo-mimes ne cessent de les acculer dans une encoignure où ils se marchent réciproquement sur les pieds. Où que nous retrouvions l'acteur authentique, il flotte encore un soupçon de l'air de fête des vies d'antan, on perçoit la lumineuse gaieté de la fête, qui nous-mêmes nous illumine. Le comédien authentique ne renie pas son extraction festive et dionysiaque, il ne se renie pas lui-même. Il ne veut être que comédien. Le pseudo-acteur se renie en tant qu'acteur, il ne veut pas qu'on l'apostrophe en tant qu'acteur. C'est un homme sans air de fête ; il fait grisâtre, sordide, usé. C'est un produit du processus qui précipite l'homme, des hauteurs de l'ordre typique, dans les abîmes de la masse. L'évolution que contribuent à promouvoir le pseudo-acteur et le représentant a en soi quelque chose d'usant ; mais eux-mêmes manquent de fraîcheur, ont quelque chose d'usé. Ce côte usant et usé, ce manque de vivacité, tout comme la vivacité feinte et simulée qui va de pair avec l'accélération du mouvement mécanique, sont leur caractère propre.
De quels moyens le pseudo-acteur use-t-il pour s'imposer, pour accéder aux premiers rôles ? De tous, car tout, pour lui, s'est fait moyen ; ses moyens sont les rôles, ses rôles sont des imitations. Il tombe dans tous les trompe-l'œil par lui disposés en tous lieux. On dénomme psychologie l'ensemble des procédés que l'on élabore et applique où le pseudo-acteur est dominant. Où le type est inentamé, nul besoin de psychologie, car on se connaît, on sait fort bien à qui on a affaire. Où le type est absent, le mime prend le dessus, celui que Nietzsche qualifie de pseudo-mime. Le trait saillant d'une telle situation est que l'ancienne hiérarchie des êtres et des valeurs voit subsister son édifice, mais qu'il y manque les piliers, car les hommes qui lui donnaient sens sont en voie de disparition. Ce sont les prémices où le nihilisme se développe, où il parvient à faire son nid. L'acteur comme nihiliste — et vice-versa. Cela commence par des compromis, où l'on se compromet soi-même.
Quelque chose s'est consumé — condition préalable à toute bassesse, à toute vulgarité. Le type n'est plus là, à sa place s'exhibent en tous lieux les imitations, les pseudo-mimes, et ces imitations ne peuvent que devenir toujours plus faibles, toujours plus viles. On tombe sur le chrétien qui n'est plus chrétien, sur le mime de la hiérarchie chrétienne des valeurs. Il n'y a plus de rois, mais des acteurs qui s'entendent parfaitement à jouer le rôle du roi, et des rois qui s'entendent à celui de l'acteur. Ainsi de suite à l'infini. Le type met de l'ordre parmi les hommes et les choses. Le pseudo-acteur n'ordonne rien, ne fait qu'user et abuser de ce qui subsiste des hiérarchies et des valeurs anciennes ; il en use et abuse sous forme d'accessoires, de costumes, de masques, de décors. Mais on ne saurait en user ainsi bien longtemps.
L'idéologie mime la santé
Là où le type est inentamé, il n'y a pas d'idéologie. Là où le peuple est sain, il n'y a pas d'idéologie. C'est l'indice infaillible du type et de la santé ; ils ignorent l'idéologie, elle ne leur sert à rien, il n'en ont pas besoin. Dans une atmosphère impure comme celle de l'idéologie, ils ne pourraient ni vivre ni prospérer le moins du monde. L'acteur-idéologue invente l'idéologie, car elle répond à ses besoins vitaux, à sa consommation courante. Le nihilisme idéologique domine le XIXe siècle et veut tout faire rentrer à force dans ses systèmes. L'anarchisme est plus grossier, plus honnête, moins fardé, moins intellectuel ; il reste encore une tentative d'évasion. Mais ce n'est jamais qu'une sous-espèce du nihilisme, lequel impose le cap.
Les théories extrémistes de tout poil témoignent d'un processus de consomption qui ne cesse de s'aggraver. On devient plus franc, plus brutal, plus “honnête”, parce qu'il le faut bien. La pénurie est aux portes, ce n'est plus le moment de se payer de mots. La situation économique prend de l'importance ; à vrai dire, il n'y en a plus d'autre. Le matérialisme s'étale et se fait dialectique. La question sociale domine le premier plan. Tous les extrémistes, tous les radicaux sont des acteurs. Les esthètes plus fins, plus profonds, font à présent retraite, rejoignent le camp des isolés. Phase seconde, où l'on peut encore noter quelques progrès.
Soudain, tout apparaît infesté. C'est comme si un énorme cadavre que l'on ne peut découvrir empestait l'atmosphère. La peur, la haine, la défiance se mettent à croître à toute vitesse. La question de confiance ne cesse d'être posée, la recherche des coupables, des responsables commence. On se repasse la responsabilité en rond. L'indice parle clair : le pseudo-acteur s'empare des positions dominantes, il prend la direction des opérations. La pensée accusatrice ne cesse de s'aiguiser ; on élabore de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes. Ils servent à approfondir le soupçon, à l'étendre. Il remettent tout en question. L'acteur s'entend à tout ce qui est profond, c'est-à-dire aux rôles profonds, il les joue conjointement ou successivement Il démystifie à présent, il dévoile, arrache des masques, la bonne blague, quand ces masques et autres loups en couvrent d'autres, à l'infini.
Et puis vient le moment où le voile est levé sur ces procédures rhétoriques, tissées de dissimulation, de dégoût, de haine de soi, où chacun s'érige en procureur de l'autre. La bestialité entre en scène toute nue. L'envie de meurtre, qui dès longtemps brillait dans tous les yeux, se met à l'œuvre.

◘ LA MASSE
 Lorsque, dans une société, le processus de typification a subi des atteintes, lorsqu'elle ne parvient plus à produire le type à l'état pur, que s'ensuit-il ? Un bouleversement se produit qui va jusqu'aux fondations, arrivent la révolution, la suppression de l'ordre archétypique, une société dépourvue d'archétypes, une société bourgeoise telle que la Révolution française l'a installée à la barre sur tout le continent européen. Et là où il n'est plus d'émergence du type, on aboutit infailliblement à une massification. La masse, c'est l'homme sans type, l'homme qui vit en communauté atypique. Si l'on pouvait embrasser du regard les tableaux de la grande peinture occidentale, examiner, pour l'époque qui va de Giotto à Tiepolo, chaque peinture et chaque dessin, nulle part on n'y retrouverait de masse, quand bien même on y voit des personnages en grand nombre. Le nombre même y ressortit au type, la qualité des tableaux se mesure à la force et à la pureté de la représentation qu'ils en donnent.
Lorsque, dans une société, le processus de typification a subi des atteintes, lorsqu'elle ne parvient plus à produire le type à l'état pur, que s'ensuit-il ? Un bouleversement se produit qui va jusqu'aux fondations, arrivent la révolution, la suppression de l'ordre archétypique, une société dépourvue d'archétypes, une société bourgeoise telle que la Révolution française l'a installée à la barre sur tout le continent européen. Et là où il n'est plus d'émergence du type, on aboutit infailliblement à une massification. La masse, c'est l'homme sans type, l'homme qui vit en communauté atypique. Si l'on pouvait embrasser du regard les tableaux de la grande peinture occidentale, examiner, pour l'époque qui va de Giotto à Tiepolo, chaque peinture et chaque dessin, nulle part on n'y retrouverait de masse, quand bien même on y voit des personnages en grand nombre. Le nombre même y ressortit au type, la qualité des tableaux se mesure à la force et à la pureté de la représentation qu'ils en donnent.
Que va-t-on mettre à la place du type ? Rien d'autre que l'aplanissement des dénivellations, que le processus de nivellement. Cet aplanissement des dénivelées fournit à présent toute l'énergie nécessaire à la continuation de la vie, ce qui veut dire que le nivellement doit s'opérer toujours plus vivement. La dénivelée suppose une différence ; c'est elle qu'il faut appréhender. Le principe recteur est à présent l'égalité, principe effectivement dynamique tant que l'on travaille à l'aplanissement des dénivelées. L'ordre des types avait quelque chose de statique, que sa chute rend caduc ; se déclenche alors une dynamique qui ne fait que croître et embellir, si bien qu'on a tôt fait de s'apercevoir qu'elle est de nature élémentaire. Le résultat de ce processus dynamique est la massification. Lorsqu'il n'y a plus de dénivelée, apparaît la masse.
L'évolution est particulièrement sensible et contraignante dans le domaine technique, qu'elle investit de son automatisme mécanique. Les progrès de la mécanique sont un phénomène profond et révélateur, mais l'observateur ne s'en rendra compte que s'il fait le rapprochement avec les progrès de la massification. Le préalable à toute mécanique est la disposition machinale inhérente à la masse. L'automatisme mécanique suppose un automatisme dans l'homme. L'automatisme a pour caractéristique, outre la reproductibilité mécanique de certains processus, l'usure rapide que les automates s'infligent à eux-mêmes : phénomènes d'usure sur lesquels il convient de nous pencher. Le processus qui pousse à l'aplanissement des dénivelées tend vers un niveau terminal, qu'il s'efforce d'atteindre par tous les moyens. L'énergie de sa progression devient plus compréhensible si l'on considère que le nivellement porte en lui-même les moyens et réserves à exploiter et consommer coûte que coûte, à mobiliser à tout prix pour promouvoir le nivellement. Plus forte est la dénivelée, plus rapide est le mouvement, plus grande est sa force. C'est cette énergie disponible pour faire tourner tous les moulins qui doit être exploitée.
Et plus l'aplanissement des dénivelées se généralise, plus les méthodes d'exploitation doivent être poussées à l'extrême, plus on mettra de brutalité à promouvoir tout ce processus. Processus scientifiquement préparé, économiquement justifié, techniquement mis en œuvre. Quant à sa nécessité, elle fait rapidement l'objet d'un consensus omnium. Il est bien clair à présent que l'objectif visé (le niveau) est un état minimal. Il ne peut être qu'un état minimal, car on engouffre dans le processus bien davantage qu'il ne produit. Les principes de la thermodynamique nous l'enseignent. Pour en attendre plus, il faut croire au miracle. Que ce soit bien clair à nos yeux : détournons-les des illusions que nous font miroiter, pour mieux stimuler notre ardeur, tous ceux qui tirent profit de la chose, car ces illusions relèvent d'une pensée inexistante, quand elles ne servent pas à déployer des voiles et des rideaux de fumée.
Le processus de nivellement est un gigantesque processus d'exploitation et de consomption. Il exige un maximum de consommation et produit incroyablement peu, fort peu de choses en fait qui ne soient immédiatement réutilisées pour la consommation. L'agression contre toutes les réserves existantes est donc conduite avec la dernière énergie ; l'extrémisme de tout poil n'est jamais qu'une logique de consommateur, un “ôte-toi de là que je m'y mette” [NDT : en fr. dans le texte]. La dissipation se fait d'autant plus gigantesque que le mouvement approche du niveau terminal, car il subsiste alors d'autant moins de dénivellations que l'on puisse exploiter. C'est le moment où l'organisation apparaît comme une panacée qui doit, tel le bâton de Moïse, faire jaillir des sources en frappant le roc. En fait, elle est l'indice infaillible d'un effroyable appauvrissement ; elle exprime des êtres et des choses les derniers résidus de leurs sucs. Par organisation, il faut entendre l'ensemble des mesures qui poussent le nivellement vers son niveau terminal.
À ce point de notre discours, la question se pose : dans quelle mesure Nietzsche a-t-il prévu le processus, par quels moyens a-t-il prétendu le contrecarrer ? Il pensa tout d'abord user de moyens retardateurs, inhibiteurs, dilatoires. Moyens qui devinrent inapplicables lorsqu'il se fut convaincu de l'inexorabilité du processus, de sa force irrépressible. Il reconnut que l'action retardatrice est inopérante, et s'attacha dès lors à accélérer le processus, à pousser les feux, en accentuer la véhémence, et le faire parvenir aussi vite que possible à son niveau ultime. Sa pensée même est saisie par le dynamisme qui commençait à opérer alentour de toute sa puissance. Mais tout en souhaitant l'accélération du mouvement général, il se rendait fort bien compte qu'il ne pouvait être qu'éphémère, et s'orientait vers une catastrophe inéluctable. Il comprit la « stérilité profonde » (W XII, 367) du XIXe siècle.
Reconnaître cette stérilité ne fut pas chose facile ; l'apparence du superflu induisait les meilleurs esprits en erreur. Dans l'instant où le système des types est détruit, une profusion de talents jusqu'alors bridés se libère. Une profusion d'opportunités se fait jour en ce début d'évolution. Début qui est un moment de productivité ; les méthodes sont nouvelles, les moyens sont disponibles en abondance. L'aspect hectique de ces méthodes ne se fait jour que plus tard ; ce qu'elles apportent, il faut attendre la fin pour le voir. On a encore bien de l'héritage à dilapider avant que la perte ne devienne visible. Les sols ne s'appauvrissent que pour autant qu'on les sollicite à l'excès. Et il reste, à tous les égards, beaucoup de sol à exploiter. C'est bien pourquoi, comme l'enseignent les débuts capitalistes du mouvement, on ne fait grief à personne du pillage et du brigandage. Certes, dès le départ, ces agissements dégagent un effluve d'affairisme brutal et tonitruant, mais ils rapportent, et donc on ferme les yeux plutôt deux fois qu'une. Le succès est le grand critère, et l'on honore les exploiteurs à succès qui se sont distingués en tant que commerçants, industriels, ingénieurs ou inventeurs.
Le temps vient d'une nouvelle hiérarchie Nietzsche était attaché à la notion de type, tout en reconnaissant l'impossibilité, dans le présent qui était le sien, de constituer une nouvelle hiérarchie des valeurs ; la décomposition devait d'abord aller jusqu'au terme. Zarathoustra est donc heureux que les luttes entre classes sociales soient terminées ; sa haine du nivellement systématique est plutôt de façade. Car c'est pour lui un moyen en vue d'une fin ; il prépare les voies. Le retour à l'ordre des types est impossible. Dans l'immédiat, le temps est venu d'une hiérarchie des individus. Mais cette formulation n'est pas assez précise. Nietzsche ne distingue pas assez nettement entre l'homme isolé et l'individu.
L'homme isolé est celui qui se détache du type, tout comme la masse. Plus précisément encore, on pourrait dire de lui qu'il se détache du type tout comme de la masse. L'isolé et la masse se retrouvent alors face à face, sans aucune subordination ni coordination, séparés sans plus. Cette séparation fait la force des isolés, qui constituent une minorité toujours plus infime, émancipée du mouvement général. L'isolé n'est pas le conducteur des masses ; leur direction est assumée par le pseudoacteur. Quant à l'individu, au contraire de l'isolé ou de la masse, ce n'est pas un produit de l'histoire, il n'a pas la moindre fonction historique. C'est un atome issu de la fragmentation, un pur précipité, à moins qu'il ne tombe dans le domaine zoologique.
Voici les passages décisifs de La volonté de puissance : on doit constater « une évolution dont la vitesse et les moyens sont extrêmes » (WzM 864), ainsi qu'un « déplacement du centre de gravité de l'humain ». Contre les « excentriques » (les extrémistes) et la plèbe se forme l'alliance des « médiocres », les modérés de bon aloi. Leur tâche est de rallier autour d'eux les forces de retardement ; ils font traîner. Ils cherchent à émousser la pointe de l'évolution, à lui retirer son dard. Les scientifiques, les grands financiers, les Juifs font partie de ces forces conservatrices, comme d'ailleurs tous les libéraux, car libéral n'est qu'un synonyme de modéré. Nietzsche ne s'attarde pas à se demander combien de temps les retardateurs vont tenir contre le mouvement ; il passe à des constatations de plus grande importance. Il reconnaît le caractère consommateur de l'évolution qu'il caractérise comme « une consommation toujours plus économique de l'homme et de l'humanité » (WzM 866).
On en arrive à une « “machinerie” toujours plus étroitement intriquée des intérêts et des rendements ». Tout ce processus d'adaptation réciproque et d'aplatissement mène, conclut-il, à une sorte de « niveau stationnaire » de l'humain. Il se crée un énorme engrenage aux rouages toujours plus minces et plus subtils, machinerie dont l'ensemble dégage une force énorme, mais dont les différents facteurs ne représentent que des « énergies minimales, des valeurs minimales ». Cette « machinerie globale », la « solidarité de tous les rouages », représente une « exploitation maximale de l'humain ». L'« optimisme économique » grandit à mesure que s'accélère « la hausse des frais généraux ». Mais c'est le contraire qui se produit : « Les frais généraux de tous s'additionnent en une perte globale : l'homme se minimise – de sorte qu'on ne sait plus à quoi aura bien pu servir tout ce colossal processus ».
Ces remarques sont d'une perspicacité prodigieuse, car elles cernent, pénètrent, résument l'ensemble du processus technique, et cela en un temps où il ne fait que commencer, en un temps où le plus grand optimisme l'accompagne. Nietzsche prévoit que ce processus global affectera l'humain, que celui-ci va dépérir en lui. De cet enchaînement, il conclut à la nécessité d'un mouvement contraire, et désigne le Surhomme comme son vecteur. Car la visée d'une technique livrée à elle-même est un non-sens, et mène à un état où l'on ne sait plus du tout « à quoi aura bien pu servir tout ce colossal processus ». En d'autres termes : il perd le sens qu'on y a introduit pour mieux l'y retrouver, il devient incompréhensible.
Il mène à un état où l'esclavage se généralise. Ce n'est que lorsque le mouvement contraire se fait sentir que « la forme machinale de l'existence » recouvre une utilité propre, reçoit un sens.
La dictature, dénivellation mécanique de l'égalité
Arrêtons-nous d'abord là-dessus. Le processus de nivellement court, en vertu d'une forte dénivelée, vers son niveau ultime. La dénivelée est la plus forte où les différences sont les plus grandes. Plus l'approximation à ce niveau va progresser, plus la dénivelée sera faible.. L'égalité apparaît d'abord comme principe au service du nivellement. Elle est le postulat abstrait qui accomplit le travail révolutionnaire ; le résultat qu'elle obtient est la suppression du type. Lui répond le postulat tout aussi abstrait de l'unité, de l'uniformité. L'égalité entre de plus en plus dans les faits, elle est là, elle se montre dans une large uniformité de l'espèce humaine, dans la monotonie de ses formes. Cette égalité (æqualitas) n'est pas, cela s'entend, intégrale, n'est pas identitas indiscernibilum ; elle est le statu quo politique adopté par la masse en fonction du moment.
Du point de vue dynamique, c'est le principe qui fait progresser la massification. Il est aisé d'apercevoir que le processus de nivellement doit cesser lorsque l'état minimal est atteint, car l'état minimal n'est rien d'autre que le nivellement poussé à ses dernières conséquences et transcrit dans les faits. Le mouvement cesse-t-il pour autant ? Est-il rendu à son terme ? Le nivellement pouvait encore se ponctionner, on pouvait en tirer des énergies pour mieux tendre vers le niveau ultime, descendre vers le minimum. On vivait sur la dénivellation. Mais de ce niveau, de cet état minimal, il n'y a plus rien à tirer et l'on ne saurait par conséquent se reposer en lui. Très vite il apparaît qu'il n'est pas un continuum, que l'on ne peut s'y installer. Il n'est que le point du renversement de toutes choses. Dès lors qu'un quantum suffisant d'égalité est atteint, le nivellement se renverse. Mais dans quoi se renverse-t-il, qu'arrive-t-il alors ? Il arrive une dictature.
Arrive le tyrannus absque titulo, ainsi nommé parce qu'il ne gouverne pas en vertu d'un droit légitime, d'un pacte, en tant qu'ésymnète (1), mais en vertu d'un mandat directement conféré par les masses dont il s'autoproclame protecteur, et qui le reconnaissent comme tel. Aristote, déjà, était familier des processus qui conduisent à un tel renversement ; il mit la polis en garde contre un excès d'égalité. La dictature se trouve au début du mouvement (Jacobins), afin d'en faire le lit. Elle s'accentue en fin de mouvement, lorsque l'état minimal demande à être organisé. L'aspiration à l'égalité se réalise dans un centralisme opérant à la fois dans l'axe horizontal et vertical.
Car l'égalité, principe horizontal, ne peut être poussée bien loin si l'on ne l'assortit d'un agencement vertical, non pas au sens d'une hiérarchie, mais d'une organisation mécanique et bureaucratique. À mesure que le nivellement rend superflus d'abord les “états” d'Ancien Régime, puis les partis, puis les classes sociales, que toutes les dispositions constitutionnelles de la démocratie disparaissent, accède à la prépondérance une masse uniforme et compacte qu'anime une tendance à la concentration, à la condensation, à l'accumulation sur des espaces restreints.
Le conducteur des masses, qui s'empare alors des affaires, fait partie de la masse, il est primus inter pares. Ce n'est pas un isolé, mais un joueur de rôles. La masse ne peut être véritablement représentée et figurée que par un acteur, si l'on peut encore parler ici de représentation au sens politique du terme. Un souverain comme Néron s'en est bien rendu compte, a tiré parti de sa position dans ce sens ; il se mêla aux comédiens, acte de prostitution qui le rendit très populaire. La masse ne réagit qu'au théâtreux ; il est seul à pouvoir lui arracher des réactions. Il est l'idéal de la masse, son idole et son héros. Il ne descend pas de la branche consulaire des souverains, mais de la branche tribunitienne. Il n'est pas un souverain véritable, il ne fait que mimer la souveraineté, la camper en scène.
La vérité, c'est qu'un interrègne s'est ouvert, que l'on commence par combler à coup d'expérimentations. Le dictateur n'est pas indépendant de la masse, n'a pas de volonté distincte de la sienne. Sans la masse, il ne serait pas là. Il n'est qu'un outil, qu'un instrument mû par une nécessité machinale, la même nécessité que l'on voit à l'œuvre dans la machine. Il épouse les réitérations d'un élémentaire au fonctionnement aveugle. Et l'état minimal atteint par le nivellement le force à opérer avec des moyens d'une violence intégrale. Ce qui le rend effroyable, c'est la situation d'urgence dans laquelle il se trouve.
Pour qui ne perd pas des yeux l'évolution globale, il appert que l'état minimal n'est pas atteint partout, n'arrive pas dans tous les pays au même moment. Les ressources et réserves n'étant pas égales en tous lieux, les degrés d'urgence sont bien distincts. Le passage du processus de nivellement au niveau terminal n'est pas partout également bref il y a des pays qui disposent de sols plus riches et de gisements inexploités, de réservoirs intacts où il leur suffit de puiser. Le continent européen est dans un situation plus défavorable que les autres. C'est sa pauvreté qui régit le processus historique et le fait avancer. Les méthodes de travail et la pensée directrice sont partout les mêmes. Lorsque l'état de minimum est atteint, on en arrive au renversement. Un égalitarisme excessif mène nécessairement à la dictature, où la masse n'a plus besoin de représentation, mais s'identifie à ses dirigeants (principe d'identité).
De tels processus restent d'abord épisodiques. Pourquoi ? Le nivellement est un processus planétaire ; l'état minimal où l'on tend est un état planétaire. Les anticipations de cet état, solutions adoptées dans des limites régionales, ne seront couronnées de succès que là où elles se règlent déjà sur ce minimum planétaire, s'orientent vers ce but. Si elles comportent des formules incompatibles avec lui, elles restent éphémères et échouent. Au fond, on s'en rend bien compte, tout a déjà été consommé, et l'organisation (la répartition) est un ultime expédient pour sauvegarder avec l'énergie du désespoir un minimum d'ores et déjà atteint. Mais ce moyen fait augmenter la consommation de manière démesurée. En d'autres termes, le processus de consomption mobilise à présent des énergies énormes. Il ne reste plus cantonné aux limites d'un seul État, d'une seule nation, il commence à enfoncer les structures étatiques et nationales, scénario qui débute avec les deux conflits mondiaux.
Lorsque l'on a exproprié tout ce qui pouvait l'être à l'intérieur, lorsque les conflits extérieurs ont pratiquement épuisé la substance, alors commence, avec l'écroulement des États nationaux, l'impérialisme à visage découvert, la lutte pour la domination du monde, laquelle, grâce à ses moyens infiniment perfectionnés, à l'aide d'une technique parvenue à l'automatisme, orchestre le processus central de l'exploitation. Les concurrents les plus faibles sont éliminés de la direction du mouvement, le mouvement se centralise en vue d'une lutte finale. L'énergie de ce processus est colossale, sa force centrifuge énorme, car toutes les forces qui s'y opposent sont continuellement ponctionnées, consumées, dévorées. Le symptôme en est que les moyens de destruction acquièrent une force terrifiante, exactement proportionnelle aux progrès de la massification.
Vers l'éclatement de l'État-Moloch
La pensée de Nietzsche suit d'autres voies. L'attente qu'il met en l'homme et en son avenir est autre. Sa conception de la Volonté de Puissance n'est pas un traité politique ; il n'est nullement en phase avec la volonté politique exprimée par les peuples. S'il s'y était conformé, il n'aurait pas été contraint de se faire ermite et de se retirer à Sils Maria. Il aurait eu la vie plus facile. L'État national, en premier lieu, lui était étranger ; il se sentait penseur européen, et préféra s'expatrier. La politique, surtout couronnée de succès, lui semblait un très efficace moyen d'abêtissement, dangereux pour les jeunes gens sur lesquels on fondait des espoirs. Le mouvement qu'il voyait s'amorcer évoquait pour lui la force aveugle d'une locomotive se ruant à toute vapeur contre une paroi de rocs. Pour caractériser son dynamisme élémentaire aveugle, il a cette remarque :
« Les traités entre États européens durent aujourd'hui, très exactement, ce que dure la contrainte qui leur a donné naissance. C'est donc un état dans lequel la force (au sens de la physique) décide et impose ses conséquences. Celles-ci sont les suivantes : les grands États avalent les petits, l'État-Moloch avale les grands États — et l'État-Moloch éclate, car il finit par lui manquer la ceinture qui pourrait contenir sa panse, à savoir l'hostilité de ses voisins. L'éclatement en atomes d'États est la seule perspective à long terme qui s'ouvre encore à la politique européenne. Les luttes intestines de la société perpétuent l'habitude des guerres » (W XI, 139).
Cette notation a quelque chose de méprisant, on croit entendre le spectateur d'un processus à peu près dépourvu de sens. Elle se limite à la situation européenne, elle n'a donc, sous le rapport de l'évolution planétaire, qu'un intérêt local, mais n'en recèle pas moins le modèle de l'évolution générale. Celle-ci tend à un niveau d'ensemble caractérisé par l'état de minimum.
On peut alors se poser la question : ce niveau est-il tenable et ne va-t-il pas apparaître, sous celui-ci, un nouvel état minimal ? On doit répondre par l'affirmative, car il est inimaginable qu'on parvienne à s'installer en lui durablement. Le niveau ne se suffit pas à lui-même, il n'y a donc aucune possibilité de prévenir le renversement. Ce qui veut dire : tout niveau n'est pour l'évolution qu'une limite sans véritable caractère de nécessité, limite qui n'existe plus dès lors qu'elle est atteinte sur toute la ligne. Il est aisé d'en apercevoir les conséquences. Car on voit bien désormais que le nivellement tend à un état minimal intenable, lequel déclenche donc un nouveau processus de nivellement, etc., jusqu'à ce que le mouvement s'épuise faute de moyens. Et les moyens s'épuisent parce que l'homme s'épuise dans le mouvement.
L'homme qui se laisse pousser à cette évolution, qui s'y trouve poussé alors qu'il y pousse lui-même, dépérit également en elle. Il perd en stature, en puissance, il devient minime, et l'on discerne en lui toujours plus nettement le manque et les symptômes du manque. Si ce mouvement ne rapporte ni plus-value ni superflu, l'homme à lui adonné n'a pas davantage de rendement. On le consomme au profit des intérêts divers, sans qu'il laisse la moindre trace, sans faire à la postérité le moindre don qui perpétue sa mémoire. Tenir au large ce mouvement, ne pas s'y mêler et ne pas s'y laisser mêler, telle est la marque distinctive de l'homme solitaire, capable, au milieu du tumulte qui ne cesse de croître, de poursuivre son propre chemin.
Le signe tangible de la grandeur n'est pas dans la capacité à mettre les masses en mouvement, il « est dans l'être-autre, dans l'incommunicabilité, la distance dictée par le rang » (WzM 876), non dans l'effet produit, quand bien même il ébranlerait le globe. Si le mouvement n'est qu'« un phénomène régressif de très grand style » (WzM 866), où l'homme s'amenuise de plus en plus, c'est dans son inversion que réside le remède et l'avenir de l'« homme supérieur ». Cet être « synthétique, récapitulatif, justificateur » est le premier à donner sens à toute « machinalisation de l'humanité », en s'élevant au-dessus des formes d'existence machinales, en se les soumettant. En un tel homme, le superflu doit à nouveau paraître au jour, après s'être totalement dissipé dans cet énorme processus d'exploitation.
La « solidarité de tous les rouages » ne rapporte rien, elle ne fait que tout consumer. L'homme grand — impossible de l'ignorer désormais — n'est pas le batteur d'estrade des époques historiques, ni l'animateur ou le dompteur de la masse, ni l'auteur des effets les plus forts et les plus bruyants. À cela, les volcans s'entendent mieux : or, Nietzsche les a en aversion. La terre produit dans leurs entrailles un bien plus grand vacarme encore. L'homme grand est l'homme du don, du présent, de la munificence. L'homme du plus haut rang est l'homme du plus grand superflu.
Le progrès technique vise l'état minimal de la masse
La masse est le sujet de l'évolution historique qui se met en marche. Elle régit par sa seule existence le cours de cette évolution ; elle est l'instance anonyme qui fixe au mouvement son cap. En même temps, elle est objet de l'évolution, dans la mesure où elle en pâtit. Et elle en pâtit fortement. Sa raison d'être est de se faire la victime du mouvement qu'elle a elle-même déclenché. La masse est animée d'un mouvement variable, soumis aux lois de la mécanique. Mouvement mécanique et mouvement historique se rejoignent en elle, conjonction d'où résulte un automatisme toujours plus strict. Massification et progrès mécanique sont un seul et même processus. Le progrès technique ne peut se poursuivre si la massification cesse ; il s'achève là où elle trouve sa fin. Les bornes de la massification et du progrès technique coïncident exactement Continuer à exploiter cette technique là où il n'y a plus de masses est un non- sens.
Une telle éventualité n'a d'intérêt que si l'on persiste à méconnaître que la technique n'est autre que l'organisation du processus de consomption acheminant la masse vers l'état minimal, et que, par conséquent, ce processus de consomption parvenu à son terme, appareillage et organisation techniques deviennent superfétatoires. Cette constatation possède la rigueur d'une équation mathématique. Dès lors qu'en un point quelconque du processus la massification cesse, le progrès technique s'arrête aussi, et le perfectionnement de la mécanique n'a plus de raison d'être. Ce n'est pas pour rien que cette foi dans le progrès est la religion de la masse ; elle honore en lui le père nourricier qui lui garantit sa consommation.
« La croyance intime de la masse, c'est que l'on doit vivre gratis » (W XIV, 95). Car le « parasitisme est l'intime noyau de la bassesse morale ». En d'autres termes, la masse est consommatrice, elle parasite. Elle ne subvient pas à ses besoins, elle exige que d'autres y subviennent pour elle, qu'elle soit nourrie et entretenue. Elle s'en donne les moyens grâce au processus de nivellement, puis à l'organisation de l'état minimal. Elle est toujours affamée, et cette faim va croissant, comme bien l'on pense, à mesure que l'on se rapproche du niveau ultime. Sa croyance intime est épaulée et nourrie par « l'idéal socio-eudémonique » (W XII, 367), riche d'avenir, selon Nietzsche, du fait qu'il élabore « l'esclave idéal ».
Le dernier Nietzsche, avec sa tendance à accélérer le processus de nivellement, à le promouvoir partout, à faire de toute médiocrité un moyen en vue de cette fin, est en même temps convaincu qu'il est impératif de déclarer la guerre à la masse (WzM 861). En quoi l'inspire une différenciation qu'il ne précise pas davantage. L'homme médiocre et l'homme de la masse ne sont en aucun cas identiques. La médiocrité est un état qui se retrouve en tout temps, état nécessaire et bien déterminé.
Mais ce juste milieu n'est pas une caractéristique de la masse ; celle-ci ne connaît pas la mesure, encore moins la demi-mesure. Le Nietzsche de la fin s'abstient de s'en prendre à la médiocrité. Avec raison, car où ce genre d'attaque le mènerait-il ? La médiocrité est un état fort honnête, et parfaitement honorable. C'est avec la masse qu'il se refuse à conclure un pacte, pour la simple et lumineuse raison qu'elle n'observe aucun pacte, qu'elle est par nature violatrice des pactes, n'obéissant jamais qu'à la nécessité physique. On ne peut que lui déclarer la guerre.
Nietzsche voulait que la masse disparaisse. Il partait sans doute du principe qu'on ne pourrait pas l'intégrer dans la nouvelle hiérarchie des valeurs, qu'elle ne saurait pas même former le substrat d'une telle hiérarchie. Mais si la masse doit disparaître, alors doivent disparaître tous les facteurs de massification, il n'y a plus qu'à les supprimer. Et pour pouvoir les supprimer, il faut que la nécessité de cette suppression soit devenue sensible, soit comprise. Le processus de massification doit tout d'abord triompher ; il faut en passer par des états de choses parfaitement insupportables.
Et ce mouvement, qu'il faut concevoir comme un processus de consomption, y mène tout droit, c'est-à-dire qu'il finit par consumer la masse elle-même. Lorsque La volonté de puissance fut écrite, lorsque Nietzsche rédigea ses derniers aphorismes, le mouvement en était encore à ses débuts. Nietzsche a pu en voir les commencements, dont il a tenté d'inférer son parcours et son terme. Ses diagnostics et pronostics surprennent par leur incorruptible sagacité. Quelqu'un qui ne connaîtrait du monde que la quête du petit profit, se bornant à y investir ses capacités et ses aspirations avec savoir-faire et sagacité, n'aurait pu nous livrer de telles découvertes.
Une autre image de l'humain
Ce qui distingue Nietzsche, c'est qu'il avait une autre image de l'humain. L'homme tel qu'il le voyait ne cadrait pas avec cette évolution, car son dessein menait plus loin. Entre-temps, la massification a progressé. L'humain s'entasse et se condense aux centres de l'exploitation, dont il est et le profiteur et l'objet. Les populations s'accroissent ; on aboutit à une surpopulation, qui inspire des tentatives pour se donner de l'air, à l'intérieur comme à l'extérieur, car le risque de dépérir est omniprésent. La masse — l'homme sans type, l'homme qui a laissé se perdre le type — fait retour à l'élémentaire.
Les aspects mécaniques de la nécessité se reconnaissent dans la masse. Son accumulation, sa condensation amorphe se conforment aux lois de la gravitation, sont conséquences de besoins devenus mécaniques. Elles évoquent les engrenages, dans lesquels il faut voir des leviers prolongés, agencés en systèmes compacts. On peut étudier sur elle les lois du couple ou du levier. Son instabilité, sa mobilité sont extrêmes ; sans posséder de mouvement propre et spontané, elle est cependant très facile à mouvoir. Pour ce qui est de son mode d'action, elle est consommatrice ; elle est le plus grand consommateur que la terre ait produit. Elle est le résultat d'un nivellement très poussé des dénivellations ; là où elles ont disparu, la masse se dépose en précipité.
Lorsque la dénivelée disparaît, l'homme vit dans l'indifférenciation du collectif. Le collectif apparaît d'autant plus désirable qu'il est plus étendu, qu'il englobe davantage. Mais de tels collectifs ne peuvent être, par définition, que des coopératives de consommation, animées de pensées consommatrices, et dont le travail consiste à organiser la consommation. Celle-ci croît au fur et à mesure qu'ils prennent de l'ampleur. Ils travaillent donc, en s'agrandissant de la sorte, à leur propre éclatement, et à force de tout aspirer et de tout avaler, il s'acheminent vers le point de leur plus parfaite indigence, là où les tâches auxquelles ils s'affairent ne relèvent plus du moindre sens.
L'humain se fait extrêmement machinal, dans la mesure où il s'adapte de plus en plus à la machinerie globale. S'ouvrent alors des perspectives qu'il convient de peser et méditer. Si l'on parvenait vraiment à transformer l'homme en machine, le problème du comédien serait résolu. Il n'y aurait plus de mimes. Si l'on pouvait faire de l'homme un simple terme d'un système de réactions mécaniques et fonctionnelles, il apparaîtrait que le mime n'a pas sa place dans cette pure mécanique. Et dans une mécanique pure, il n'y a pas non plus de masse. Si l'homme se laissait ainsi façonner, si l'on pouvait faire l'ablation de certaines parties de son être qui s'opposent à ce processus — le la conscience de sa liberté — alors pourrait se créer un monde d'appareillages insurpassablement précis, aux ordres d'un technicien et de son état-major. Mais cet état idéal n'est réalisable que dans les modèles miniatures du monde industriel ; à plus grande échelle il échoue, car ce monde d'appareillages ne peut exister sans la masse. Masse et appareillage sont absolument indissociables. Un automatisme technique travaillant sans la masse est une contradictio in adiecto. Toute rationalisation, tout appétit rationalisateur trouvent ici leurs limites. Une telle conception ne peut trouver son sens que dans le désir sous-jacent de mettre un point final à la massification, car la masse vient au devant de ce désir.
La masse a-t-elle — on peut se poser la question — un destin ? Oui, elle possède une historicité propre, qui se manifeste au cours du processus de nivellement, ainsi que dans les états minimaux. Mais sa marche à travers l'histoire a pour moteur la volonté et le désir de se défaire de toute historicité, de s'en dépouiller totalement. Elle est l'aspiration humaine à faire retour à l'anhistoricité, à l'absence de destin. C'est l'horizon ultime de ses rêves, le désir qu'elle est incapable de formuler consciemment : désir le plus profond, le plus secret, dissimulé à sa pensée même. Anhistoricité, absence de destin — tel est le but ultime de tout idéal “socio-eudémonique”. Car il porte en lui le souhait de mettre un terme définitif à toute souffrance, de fermer pour toujours et complètement les seuils qui font entrer la tragédie dans l'existence. Aussi le chemin de la masse reconduit-il, par-deçà l'historicité, à l'élémentaire ; c'est en lui qu'elle veut se dissoudre, se précipitant dans la mer comme une horde de lemmings. Son élémentarisme aussi aveugle que puissant n'a pas au bout du compte d'autre but que de faire retour, de se dissoudre dans l'élément, se déformer en lui, rejeter toute forme propre et son fardeau, tout conditionnement historique que grève la souffrance inhérente à la vie.
Dans son esprit, la souffrance est dénuée de sens, elle entend vivre exempte de souffrance. En quoi s'exprime son profond désir de la mort, qui est pour elle pur néant, désir de tous les bonheurs euphoriques, anesthésiques, narcotiques. Ce désir œuvre en permanence au développement de l'automatisme mécanisé, car dans cette machinerie vide de souffrance, l'homme voudrait se résoudre lui-même sans douleur ; il en augure l'accomplissement de tous ses vœux. Il espère qu'elle lui ôtera son fardeau, qu'elle assumera, comme une armée d'esclaves muets et dociles, la charge de son bien-être. À la racine du profond besoin d'euphorie dont la masse déborde, toujours la même et indéracinable douleur.
Qui a reconnu ce besoin, qui s'entend à le calmer, l'apaiser, possède un pouvoir sur la masse. Le conducteur des masses, représentant de l'idéal socio-eudémonique, doit être un utopiste, savoir faire miroiter tout le désirable, jouer sur scène de tous les idéaux où se tapit la mort, non pas la mort partenaire au jeu de la vie, qui perpétuellement s'y retrempe, renouvelle et régénère, mais la mort qui conclut, le terme, finis rerum. Le conducteur des masses est dangereux, car il a le pouvoir de déchaîner des mouvements incontrôlables, destructeurs, outrepassant toute mesure historique, et qui prennent les dimensions de catastrophes élémentaires.
L'appétit de mort des masses se fait de plus en plus violent à mesure que la massification progresse. Et les moyens que la science, avec toujours plus d'efficacité, lui prépare, viennent y prêter la main. Leur efficacité est fonction de leur impact sur la masse. Le désir de faire une fin se concentre au bout du compte dans le pouvoir qu'elle se reconnaît de faire sauter la Terre elle-même. On arrive aux conséquences ultimes de tout atomisme. Mais ce ne sont pas ces moyens de destruction qui vont mettre fin à la masse. C'est le processus de consomption dont elle se consume elle-même. Voici venir le terme du mouvement, en même temps que le début de nouveautés inédites.
► Friedrich Georg Jünger, texte tiré de 2 chapitres de son Nietzsche (V. Klostermann, Franfurt/M., 1949). Tr. fr. : François Poncet, Nouvelle École n°51, 2000.
♦ Note du traducteur :
1. Du grec homérique αισυημητησ, « arbitre dans les jeux » (Odyssée 8, 258), αισυημητηρ des cités de l'âge classique, terme désignant le magistrat désigné par élection, légalement élu (Aristote, Politique, 1285a, 1295a).
♦ Abréviations utilisées pour indiquer les références :
- W (suivi du numéro du volume) : Werke, Friedrich Nietzsche, éd. Naumann, Kröner, Leipzig, 894.
- WzM : Wille zur Macht, tr. fr. : La Volonté de puissance, 2 vol., Tel/Gal., 1995.