Sorel
Georges Sorel : Socialisme et violence
Georges Sorel, ingénieur de formation, théoricien du socialisme, marxiste hostile aux réformismes démissionnaires, est sans doute la figure la plus intéressante de la pensée politique française du début du XXe siècle [ill. : Les Ouvriers rentrant chez eux, E. Munch, 1913-1915].
Pour la plupart de nos contemporains, l'évocation de Georges Sorel revient le plus souvent à l'analyse du théoricien de la violence. Son ouvrage le plus célèbre, Réflexions sur la violence (1908), constitue une contribution irremplaçable au mythe révolutionnaire. On sait l'importance que constitue pour ce penseur exceptionnel le concept de “mythe”. Le mythe révolutionnaire sorélien est inspiré d'une vision polémologique des rapports sociaux. La violence informe l'action révolutionnaire et l'investit d'une conception réaliste de l'histoire. Comme moyen d'agir sur le présent, le mythe prolétarien est un outil au service de la révolution anti-bourgeoise. C'est aussi un outil conceptuel qui doit d'abord s'opposer à la fois à l'utopie socialiste et au conservatisme libéral. Ce discours très original, activiste par excellence, donne une place privilégiée à l'œuvre de Sorel dans notre conception du socialisme.
Avant d'aborder l'analyse proprement dite du mythe de la violence comme idée-force chez Sorel, il est utile de présenter l'homme et son œuvre. C'est à partir de cette connaissance de l'environnement idéologique que nous pourrons, dans une seconde partie, présenter les caractères de cette “violence” en tant que mythe et des conséquences qui en découlent sur notre propre position.
I. Sorel : l'homme et l'œuvre
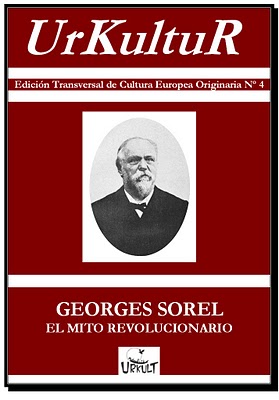 Georges Sorel (1847-1922) commence sa carrière en 1889. C'est l'époque des premières traductions françaises des œuvres de Marx. Déjà, on peur trouver en librairie Le Capital et Socialisme utopique et socialisme scientifique ; il faudra en effet attendre 1895 pour que paraisse le fameux Manifeste du parti communiste. En France, il est un fait que le marxisme constitue en 1889 un mouvement idéologique, beaucoup plus qu'un parti révolutionnaire. Et c'est en 1893 que Sorel se convertit au marxisme. Ce rapprochement de Sorel marquera toute son œuvre. Il n'impliquera aucun attachement aveugle aux valeurs marxistes. Le personnage est trop indépendant pour inscrire ses réflexions dans un système total. Mais au fait, qui est Sorel ? Le personnage a été l’objet de nombreuses analyses aussi brillantes que contradictoires. Pour les uns, Sorel est un penseur attaché à l'école rationaliste. Pour d'autres encore, il serait un chantre remarquable de l'irrationnel. Dans ses opinions politiques, il apparaît à certains comme un conservateur révolutionnaire (une espèce rare à son époque) ; pour d'autres, il est un néo-marxiste. Et les ouvrages abondent qui veulent prouver définitivement le bien-fondé de l'une ou l'autre opinion. Pour notre part, nous ne rentrerons pas dans ce débat.
Georges Sorel (1847-1922) commence sa carrière en 1889. C'est l'époque des premières traductions françaises des œuvres de Marx. Déjà, on peur trouver en librairie Le Capital et Socialisme utopique et socialisme scientifique ; il faudra en effet attendre 1895 pour que paraisse le fameux Manifeste du parti communiste. En France, il est un fait que le marxisme constitue en 1889 un mouvement idéologique, beaucoup plus qu'un parti révolutionnaire. Et c'est en 1893 que Sorel se convertit au marxisme. Ce rapprochement de Sorel marquera toute son œuvre. Il n'impliquera aucun attachement aveugle aux valeurs marxistes. Le personnage est trop indépendant pour inscrire ses réflexions dans un système total. Mais au fait, qui est Sorel ? Le personnage a été l’objet de nombreuses analyses aussi brillantes que contradictoires. Pour les uns, Sorel est un penseur attaché à l'école rationaliste. Pour d'autres encore, il serait un chantre remarquable de l'irrationnel. Dans ses opinions politiques, il apparaît à certains comme un conservateur révolutionnaire (une espèce rare à son époque) ; pour d'autres, il est un néo-marxiste. Et les ouvrages abondent qui veulent prouver définitivement le bien-fondé de l'une ou l'autre opinion. Pour notre part, nous ne rentrerons pas dans ce débat.
Nous suivrons une analyse chronologique, découpée en phases successives, mais où chaque strate soutient pour une part la pensée suivante. Il est indéniable que Sorel, par ex., a été séduit à un moment de son évolution par la nouveauté radicale des textes marxistes. Comment un intellectuel de son époque, ouvert aux idées neuves, en rapport épistolaire avec de nombreux intellectuels européens de toutes tendances (citons pour mémoire Roberto Michels, Benedetto Croce) n'aurait-il pas été attiré par un discours révolutionnaire proposant une lecture “scientifique” de l'histoire et de la misère. Mais il ne faut pas pour autant croire au “marxisme”, orthodoxe ou non, de Sorel. De la même façon, nous ne croyons pas au soi-disant “fascisme” de Sorel, qu'il est difficile de rattacher à l'idée contemporaine (historique) que l'on s'en fait aujourd'hui où 66 années se sont écoulées depuis la prise du pouvoir par Mussolini. L'œuvre de Sorel est beaucoup plus complexe.
Selon Paolo Pastori (Rivoluzione e continuita in Proudhon e Sorel, Giuffre, Roma, 1980, 244 p.), l'œuvre de Sorel constitue « une alternative au conservatisme réactionnaire et au progressisme révolutionnaire ». Ce dernier ajoute que la pensée sorélienne est un dépassement des oppositions traditionnelles de la pensée moderne entre, d'une part, les théories du droit naturel et, d'autre part, les théories subjectives du droit, du rationalisme absolu et du volontarisme. La finalité politique de l'idéologie est une révolution “pluraliste”, qui restaure une société ouverte, seule à même de contrer la menace par l'entropie sociale du capitalisme. La modernité n’est pas niée, elle est intégrée dans un ensemble communautaire organique. Plus proche de Proudhon que de Marx, Sorel adhère aux fondements idéologiques du penseur socialiste français. C’est-à-dire :
- Une conception plurielle de la raison. Le marxisme est un rationalisme moniste et absolu qui, comme le capitalisme, inscrit un projet social desséchant.
- Une vision pluridimensionnelle de l'homme. Le marxisme est un réductionnisme dangereux pour l'homme (à cause de son déterminisme économique) et la société (mécanique de la lutte des classes). La prise en compte d'une dialectique sociale qui refuse le dualisme classe ouvrière/entrepreneurs capitalistes et reconnaît un jeu plus riche de rapports sociaux.
- Un projet de synthèse sociale, où le sens de l'équilibre (en devenir) des classes sociales souligne la dialectique autorité/liberté, individu/communauté, passé/présent.
Sorel et Proudhon : un rapport de continuité
Il y a sans aucun doute chez Sorel et Proudhon un rapport de continuité. Sorel est un élève de Proudhon, qui actualise sa réflexion, au cours des différentes phases de ses recherches. Pour Pastori, Sorel est d'abord : un conservateur libéral (1889-1892), puis un marxiste de “stricte obédience” (1893-1896) ; cette seconde phase débouche sur une période de révision du marxisme déterministe et scientiste, pour aboutir en 1905-1908 à un retour à la pensée de Marx, qui sera définitivement abandonné en 1910-1911. Cette dernière phase constitue pour Sorel un point de retour à la pensée de Proudhon. Nous apprendrons donc à mieux connaître Sorel si nous voulons bien nous atteler à la tâche d'une étude sérieuse de l'auteur de La Guerre et la paix et de La capacité politique des classes ouvrières...
Proudhon est un penseur révolutionnaire dans ce XIXe siècle de la raison bourgeoise. Attaché à l'idée, il ne peut être considéré comme un “rationaliste” au sens commun du terme. Proudhon distingue plusieurs catégories du concept de raison : la raison humaine, la raison naturelle, la raison pratique, d'une part et, d'autre part, la raison publique et la raison particulière. La raison humaine est la faculté supérieure de concevoir « l'idéal qui est l'expression du libre pouvoir créateur des groupes historiques et des personnes ». Face à la raison raisonnante de la pensée bourgeoise et du marxisme à prétention scientifique, Proudhon revendique avec force l'espace de liberté de la pensée historique des groupes sociaux, et même de l’homme conçu comme un être de culture non-conditionné par des déterminisnes absolus.
Cette première raison est limitée à son tour par la raison dite, dans le langage proudhonien, “raison naturelle” ou “raison des choses”. Elle est nécessité objective, qui retient dans certaines limites indépassables, les aspirations démiurgiques de l’homme. La raison pratique est la synthèse finale des 2 précédentes. C'est à travers elle que l'on peut appréhender la confrontation de 2 raisons, celle de l'homme libre non-déterminé par un mécanisme de la matière, et celle du réel qui est la frontière des pouvoirs créatifs humains. Proudhon s'inspire d'une conception pragmatique. La seconde catégorie se décompose en raison publique ou générale, et raison particulière, reproduction de « l’instance de l'universalité » (la nécessité) et celle de la particularité (la liberté). La non-coïncidence des raisons évoquées implique une critique radicale des systèmes de pensée “absolutistes” en termes contemporains, des pensées totalitaires (marxisme, jacobinisme et rousseauisme démocratique). Proudhon, militant anti-totalitaire, privilégie la raison particulière. Ce “rationalisme pluraliste” informe alors la conception socio-politique de Proudhon.
La dialectique sérielle de Proudhon
La théorie des séries est un élément nécessaire pour comprendre sa pensée. Proudhon distingue dans tout processus 2 moments séparés : le premier moment est la division-individuation (constitution de séries simples), le second, celui de la recomposition de l'unité-totalité (constitution de séries composées). Proudhon affirme aussi l'indépendance des ordres de séries et l'impossibilité d'une science universelle (De la création de l'ordre dans l'humanité). Paolo Pastori parle de la “dialectique sérielle” de Proudhon, qu'il oppose à la dialectique hégélienne, et rapproche de la dialectique crocienne des instincts. Cette dialectique sérielle confirme Proudhon dans son refus de toute analyse réductionniste. L'existence sociale ne se ramène pas a un référent unique, universel et déterminant. La sociologie proudhonienne, que Sorel reprendra à son compte, est une « sociologie de la composition » (division du travail et organisation, reconnaissance des économies rurales et industrielles, fonctions centrales et décentralisation).
Cet aspect de la pensée Proudhon/Sorel est opposé aux tendances à l'unidimensionnalité de la société capitaliste. L'économie libérale qui est sa forme historique, confond ensuite liberté et libre concurrence, créant « une nouvelle féodalité anti-organique et anti-politique ». Proudhon n'est pas ennemi de l'initiative individuelle. Il soumet celle-ci à sa théorie des séries. À savoir : le moment subjectif de l'initiative individuelle, et celui, objectif, de la soumission aux fins collectives du peuple.
L'apologie concomitante du monde rural constitue, chez les socialistes français, une véritable critique de « la réduction économiste de la réalité humaine » (Idée générale de la Révolution). Mais cette apologie ne doit pas être confondue avec un quelconque attachement réactionnaire au monde paysan. L'idéologie socialiste de Proudhon défend la production agricole sans lui coller des valeurs de droite, telles que le fit l'État français entre 1940 et 1944. La terre et l'industrie sont 2 facteurs de travail et de production reliées par un système englobant de fédérations. Et la révolution est « le refus de la réduction d'un ordre social pluridimensionnel à la seule finalité économique » (P. Pastori, op. cit.).
La révolution n'est pas un simple mouvement de destruction et de contestation d'une classe (la Révolution française est le mouvement de la bourgeoisie trop à l'étroit dans une société traditionnelle où les valeurs dominantes sont celles de l'aristocratie — valeurs sociales — et de l'État monarchique — valeurs du politique). Contre cette idée dévoyée de la révolution, les socialistes français (Proudhon et Sorel) ont une conception révolutionnaire de l'équilibre. La synthèse par le haut (le dépassement) de valeurs en apparence seulement contradictoires : individualité et communauté, propriété privée et intérêt public.
En ce qui concerne, par ex., la propriété, le socialisme s'oppose à la fois à son élimination radicale (communisme) et à son maintien en l'état. La bourgeoisie nie la signification sociale de la propriété. La propriété socialiste la reconnaît. D'où, chez ces penseurs, une valorisation constante de la JUSTICE, valeur pivot de la nouvelle société envisagée. Et, chez Proudhon, puis Sorel, le développement d'un discours fédéraliste, antiéconomique et anti-bourgeois (les socialistes parlementaires sont compris dans cette dernière catégorie).
Séduisante discipline marxiste et rigorisme déterministe
On doit remarquer que Sorel reste dans une position critique vis-à-vis de l'œuvre de Proudhon, qu'il accuse de tendances à un « esprit de système ». « L'ontologisation » de la Justice est le fondement philosophique de l'apologie de l'équilibre. Au-delà de cette critique, Sorel reste néanmoins un élève fidèle du proudhonisme. Il rejoint Proudhon dans sa réflexion sur la liberté, qui est le nœud gordien de l'éthique socialiste. Il y a chez Sorel un attachement souvent proche de l'inconscience aux valeurs “libertaires” du “socialisme utopique”. Cette méfiance et cette inconscience expliquent, pour une part, l'adhésion au socialisme “déterministe” de Sorel. Face à l'individualisme bourgeois, Sorel se tourne vers un socialisme radical, un socialisme de combat. Le marxisme représente alors chez Sorel un germe d'ordre face au chaos créé par le capitalisme de la bourgeoisie. Le monde de la production sous-tend alors cette révolution culturelle réclamée par Sorel. Sorel est partisan d'une raison pratico-politique, doublée d'une conception historiciste.
À partir de 1896, Sorel suit une évolution qui l'éloigne de cette raison déterministe. Sa critique philosophique du positivisme s'étend à un discours politique où la “raison absolue” tient le rôle souverain. Il y a, écrit P. Pastori, « une rupture radicale avec le rigide schéma matérialiste du marxisme orthodoxe ». Et, en 1898, Sorel revient plus sérieusement vers Proudhon : il écrit alors L'avenir socialiste des syndicats. La révolution qui instaure la dictature du prolétariat est rejetée par Sorel. Il accuse ce projet de masquer la dictature des intellectuels. Derrière la conception finaliste et proprement “apocalyptique” de la révolution prolétarienne, entendue au sens marxiste, on reconnaît sans peine une tyrannie économico-intellectuelle, une idéocratie despotique. Et Sorel propose au prolétariat un premier acte révolutionnaire : rejeter définitivement la dictature des intellectuels, qui reproduit la discipline externe du capitalisme. À la place, il faut instaurer une discipline interne, que Sorel qualifiera de “morale”. Enfin, en 1903, Sorel, selon l'opinion de Pastori, rejoint une fois pour toutes Proudhon, quittant les terrains dangereux du marxisme orthodoxe. Il écrit alors son Introduction à l'économie moderne.
Sur 2 points surtout, Sorel est proudhonien : il faut conserver la propriété privée, qui est une garantie sérieuse de la liberté des citoyens. Cette propriété sociale est réelle face à la forme bourgeoise de “propriété abstraite” où le propriétaire du moyen de production n'est pas le producteur. Second point : restaurer l'idéal qui animait l'antiquité romaine d'une « compénétration harmonieuse des intérêts individuels, familiaux et sociaux ». Sorel propose aussi un ordre juridique bien loin de tout « rationalisme politique ». Il réclame l'apparition de nouvelles « autorités sociales ». Enfin, il donne à l’État un rôle de médiateur et une fonction d'initiative.
Le mythe : outil spirituel de mobilisation
Sorel développe d'autre part une théorie des mythes sociaux. Le mythe est la synthèse nécessaire entre la raison et « ce qui n'est pas rationnel ». Le mythe est une traduction symbolique du réel, qui autorise et favorise une mobilisation totale des masses. En ce sens, le mythe est le contraire du rationalisme intellectuel, par ex. celui des marxistes. Sans contester cette “raison des choses” dont parlait Proudhon et les “pesanteurs objectives” qui en découlent, Sorel retient le mythe comme outil spirituel de mobilisation. L'ordre social et ses dépendances idéologiques (comme le droit) sont fondés sur une conception commune du monde, une vision du social et du politique qui ne se réduisent pas à un pur discours rationnel. L'ordre est le résultat conjoint de cet ensemble d'images (le mythe) et d'une volonté populaire (la mobilisation).
Cette position sera à nouveau l'objet d'une révision provoquée par la “révolution dreyfusienne” de 1905-1908. Pour Pastori, il y a un retour à une conception “dichotomique” : Sorel est partagé entre la relation continue raison/irrationnel et la rupture révolutionnaire comme explosion totale et irrationnelle. On trouve ce partage dans ses écrits réunis sous le titre de Réflexions sur la violence. Sorel distingue la grève générale syndicaliste (création d'un nouvel ordre) et la grève générale politique (nous préférons dire : politico-partitocratique), c'est-à-dire exploitée et dirigée par les politicards sociaux-parlementaires. La révolution est un élan créateur, que la grève informe et qui consiste en une critique totale de l'ordre existant. La figure du héros révolutionnaire se dégage : le syndicaliste est le guerrier vertueux de cette révolution, mû par des valeurs de sacrifice, du désir de surpassement. Sorel analyse certaines institutions traditionnelles comme exemplaires d'une structure révolutionnaire : ainsi l'Église catholique, à la fois acteur séculier et dont les membres sont voués à un absolu. Idéalisme transcendant et action directe et permanente sur l'histoire sont les 2 qualités d'un parti de la révolution. En 1910, Sorel écrit de l’Église qu'elle est une élite.
C'est aussi l'époque où Sorel réfléchit sur les questions du droit romain et des institutions historiques qui composèrent l'ordre social antique. À savoir et principalement le patriarcat. Il distingue 3 sources de l'esprit juridique : la guerre, la famille, la propriété. La guerre est une des dimensions de la dialectique des relations sociales. Et la révolution doit utiliser à son profit cette pluralité des relations sociales, non point au nom d'un finalisme catastrophique (révolution finale du marxisme orthodoxe), mais pour le rétablissement de cette « justice supplétive », fondement de l'ordre juridique. Sorel exclut de tout compromis le domaine des relations avec la partie de la bourgeoisie qui « réduit tout à l’utile économique ». D'où une certaine fascination pour la révolution bolchévique, qui n'est pas le résidu d'un quelconque attachement idéologique au marxisme, mais une reconnaissance de la révolution totale en actes. Peut-être est-ce aussi un désir de bien démarquer sa pensée de ce social-réformisme qu'il exécrait par dessus tout (Sorel parle du « socialisme hyper-juridique de nos docteurs en haute politique réformiste », in Introduction à l'économie moderne, cité par Marc Rives : À propos de Sorel et Proudhon in Cahiers G. Sorel n°1, 1983).
II. Socialisme et violence
Sorel est un grand penseur non pas tant pour ses œuvres que par l'originalité de ses réflexions et la “marginalité” de ses positions. Qui fut Sorel ? Un traditionaliste, un marxiste, un dreyfusard, un champion du syndicalisme révolutionnaire, un nationalisme volontariste ou un léniniste de cœur et d'esprit ? Certains hommes sont rétifs à toute classification. Les étiquettes ne parviennent pas à les maintenir dans une case et les maîtres en rangement ont des difficultés insurmontables à “normaliser” ce type d'hommes. Certains chercheurs se sont pourtant essayés à mieux cerner Sorel. Citons pour mémoire : Georges Sorel, Der revolutionäre Konservatismus de Michael Freund (Klostermann, 1972) ; Notre maître G. Sorel de Pierre Andreu (1982) ; enfin : Georges Sorel : het einde van een mythe, J. de Kadt (1938).
Pour Claude Polin, la question est claire : un homme qui fut tout à tour un admirateur de Marx, Péguy, Lénine et Le Play, Proudhon, Nietzsche, Renan, James, Maurras et Bergson, Hegel et Mussolini, etc. fut-il “brouillon” ? Sa réponse est tout aussi directe : il s'agit là d'un chaos apparent qui cache une logique hors des sentiers battus par la pensée universitaire. Sorel est l'homme des intuitions. Il est en même temps celui du refus total des systèmes de pensée, que beaucoup de ses contemporains voulaient imposer comme “horizons indépassables de leur temps” (exemples du comtisme et du marxisme). Cette liberté de pensée, ce désir de ne pas enfermer sa réflexion sur le monde et la société dans un cadre idéologique figé et mécanique, Sorel l’a exprimé dans un de ces ouvrages les plus forts : Réflexions sur la violence (1906).
Dans son ouvrage sur la “droite révolutionnaire”, suivi de Ni droite, ni gauche, l'historien Z. Sternhell intitule un de ses chapitres : « La révolution des moralistes ». Sorel est donné dans ce chapitre comme l'un des représentants les plus remarquables de ce courant “moraliste”. Face au révisionnisme libéral de Bernstein et de Jaurès, attachés aux valeurs libérales traditionnelles (à propos de ces valeurs, Lafargue parlait de « grues métaphysiques », cité par Sternhell p.81), les “moralistes” sont les hommes du refus de tout compromis déshonorant : compromis avec les valeurs de la société bourgeoise, compromis avec le matérialisme sous toutes ses formes, c'est-à-dire : marxiste, bourgeois (on retrouve ce même sentiment dans d'autres groupements européens de notre époque : Congrès de Hoppenheim (1928), Congrès du Parti Ouvrier Belge (manifeste du 3 juillet 1940), où De Man évoque une révolution spirituelle et éthique devant les congressistes). Ce “socialisme éthique”, on le retrouve à l'origine de ce mythe de la violence.
Violence, prolétariat et grève générale
Il est tout d'abord utile de ne pas confondre la “violence” sorélienne avec les formes physiques d'agressivité que nos sociétés modernes nous exposent. La notion de violence chez Sorel se conjugue avec 2 autres notions toutes aussi essentielles : celle de “prolétariat” (le monopoleur de cette violence) et celle de “grève générale”, qui est l'arme de la révolution. Il y a en effet une liaison intime entre la grève générale et l'exercice de la violence. La grève générale est l'expression privilégiée et unique dans l'histoire contemporaine de la violence du prolétariat. C'est, écrit Sorel, un « acte de guerre », semblable à celui d'une armée en campagne. La grève générale est un acte de guerre, ce qui implique qu'elle en possède les mêmes caractéristiques. Notamment qu'elle se produit sans haine et sans esprit de vengeance. Sorel écrit : « En guerre, on ne tue pas les vaincus ».
L'emploi effectif et actualisé de la violence physique n'est pas consubstantiel à la violence de la grève générale. Cette violence est une sorte de “démonstration militaire” de la force prolétarienne. La mort d'autrui n'est qu'un accident de la violence, ce n'est pas son essence. Sorel oppose la violence militaire bourgeoise et la violence guerrière prolétarienne limitée (les travaux des historiens démographes démontrent tout au contraire le caractère beaucoup plus sacrificateur et sanglant des guerres non-conventionnelles, dites “guerres atomiques”, par rapport aux guerres traditionnelles). La violence de Sorel est donc une attitude, une attitude de détermination face à l'adversaire. La violence est une idée qui favorise la mobilisation et l'action qui en découle. Sorel écrit aussi : « Nous avons à agir ».
Cette optique explique aussi le mépris sorélien de la classe des intellectuels, incapables de toute action offensive, ignorant du terrain des luttes. A contrario, on peut remarquer que ces mêmes intellectuels, qui refusent le contact de la réalité avec le réel, sont des dirigeants sanguinaires. Leur “violence” d'intellectuels au pouvoir (Sorel pense peut-être à la révolution de 1791 et à la répression de 1870) est erratique, cruelle, terroriste. La violence qu'ils exercent est pathologique. Elle traduit leur impuissance à réunir les masses autour de leurs valeurs. La violence sorélienne est tout à l'opposé de cette violence — on pense à la violence des jacobins de 1791, à la violence léniniste de la NEP contre les paysans d'Ukraine, etc. — parce qu'elle a pleine conscience de sa dignité, de sa générosité. Sorel se réfère à une violence guerrière qui, comme chez Clausewitz, est la marque d'une volonté. La violence est une manifestation de détermination, de fermeté dans ses objectifs et son idéal.
Cette idée de “violence créatrice” débouche sur un mythe historique chez Sorel : la grève générale. La violence volontariste est une idée qui doit se poser comme acte historique. L'idée anime une volonté et le mythe médiatise le rapport entre le réel (la grève générale) et l'idée. Le mythe, écrit Sorel, est la réalisation d'espoirs en actions, non pas au service d'une doctrine, parce que les doctrines et les systèmes sont des spéculations intellectuelles hors du champ de faction et de l'intérêt des prolétaires. La violence est la doctrine en actes, elle est volonté pure et non représentation pensée. L'idée de la grève générale est « une organisation d'images », un instinct collectif et un sentiment général qui manifeste la guerre du socialisme moderne contre la société bourgeoise. Et Sorel revient à cette notion d'intuition, qui n'est pas réductible à un classement clair, précis, bref mécanique, d'idées alignées et normalisées. La violence est, chez Sorel, proche de l'idée bergsonienne. Polin écrit : « Dans la violence, le mythe devient ce qu'il est ». La notion de confusion entre le devenir et l'intuition joue le même rôle chez nos 2 auteurs.
Le syndicalisme révolutionnaire s'oppose au social-réformisme
La violence est enfin la matrice d'un socialisme prolétarien. Le socialisme de Sorel né de cette violence n'est pas un social-réformisme. Sorel fait confiance au syndicalisme révolutionnaire pour bâtir ce socialisme. Le syndicat est ce faisceau des forces vives du prolétariat. Le socialisme de Sorel refuse le socialisme du rêve ou de l'éloquence parlementaire, celui des partis et des intellectuels qui les mènent à des songeries creuses. Citons encore Sorel : « Le syndicat : tout l'avenir du socialisme réside dans le développement autonome des syndicats ouvriers » (Matériaux d'une théorie du prolétariat). Et Polin note avec justesse que le syndicat est dans l'idée sorélienne le « Cogito du prolétariat ».
Sorel considère le syndicat comme la cheville de la révolution. Les groupements naturels du prolétariat sont les syndicats. Ils sont le creuset de sa volonté manifestée de libération. Le syndicat, qui exclut les intellectuels et les parlementaires, est une communauté de combat authentique. Sorel dit d'ailleurs aux marxistes que le vrai marxiste est celui qui comprend que le marxisme est inutile aux masses ouvrières. Le syndicat agit par lui-même, pour ceux qui sont ses membres. Il ne suit pas les programmes des partis et des professionnels de la pensée. Ces derniers, que Sorel appelle « les docteurs de la petite science », eurent à l'égard de ce jugement une réaction corporatiste dont Sorel se moqua. Sorel renvoie dos à dos les intellectuels des partis bourgeois et les intellectuels qui se prétendent prolétaires. Il dénonce leur nature proprement parasitaire. L'utopie de leurs discours est réactionnaire. L'intellectuel bloque le mouvement révolutionnaire et aliène la pensée des travailleurs. La révolution est pensée en actes. La révolution des intellectuels est pure image.
Mais il ne faut pas pour autant confondre “action violente” et “action pour action”. Sorel, précise Polin, n'est pas un penseur nihiliste. L'agitation n'est pas la révolution. La violence ne se limite pas à une série de secousses. La violence engendre des actions que Sorel nomme « actions épiques ». L'épopée révolutionnaire n'est pas négativiste, elle est une néguentropie sociale. La violence est la forme la plus haute de l'action, parce qu'elle a pour finalité de CRÉER. En ce sens, elle est responsabilisation des acteurs, noblesse des combattants, dépassement de soi-même. Elle éveille « le sentiment du sublime [et] fait apparaître au premier rang l'orgueil de l'homme libre » (Réflexions…). On peut rapprocher cet aspect créateur, proprement faustien de la violence, des valeurs nouvelles du “philosophe au marteau” de Sils-Maria.
La violence est un moyen de créer, elle n'est pas une fin en soi. Cette créativité l'investit d'une valeur sans pareil. Et elle est au service du socialisme puisque celui-ci veut, selon le mot fameux de Marx, transformer le monde et non plus seulement le comprendre. Le socialisme est une idée neuve pense Sorel. Il a cette jeunesse qui refuse les programmes et les idées claires et distinctes. Enserré dans un discours, il perd toute vitalité. Il devient vieux, identique à ses adversaires. Le socialisme est une idée en actes, c'est un produit spontané. Il est évident que ce socialisme-là n'a que peu de rapport avec les partis sociaux-démocrates actuellement existants dans les “démocraties occidentales”. Le seul commun dénominateur est ce nom de “socialisme”. Quant au reste...
Un socialisme étranger au monde des sophistes, des économistes et des calculateurs
Nous avons rappelé l'hypothèse de Sternhell selon laquelle Sorel est un penseur de la “Révolution moraliste”. Polin le rappelle, Sorel est un « pessimiste par tempérament ». Ainsi pour lui, le progrès traduit avant tout une notion bourgeoise. Il est contre Hegel et pense que « la nature humaine cherche toujours à s'échapper vers la décadence ». L'homme est soumis à la loi éternelle du combat. Il doit éviter les obstacles que lui oppose la nature et sa nature elle-même (veulerie, lâcheté, médiocrité, etc.). Le grand danger de l'entropie guette l'homme. Sorel écrit : « Il est vraisemblable que les collectivités soient attirées vers un magma assez compliqué et dont la base serait le désordre ». La violence révèle alors cette énergie créatrice qui combat l'entropie.
Sorel est un philosophe de l'énergie. L'homme, pense Sorel, se satisfait d'un sentiment de lutte. Dans cette optique, l'effort est plus que positif, recherché comme une fin en soi. La violence donne à l'homme une énergie salvatrice qui le retient d'être médiocre (Polin compare l'énergie sorélienne exprimée par la violence au thumos stoïcien). L'homme, par la violence émergée de son individualité créatrice, rejoint ultimement la morale. La violence est la forme permanente de la morale. La morale est donc une lutte contre l'entropie appauvrissante. On peut encore se référer à Nietzsche. La nouvelle table de morale du philosophe allemand est proche des valeurs de lutte et de dépassement que Sorel réclame des ouvriers.
Morale égale chez Sorel à sacrifice de soi, abnégation, héroïsme, désintéressement, effort. L'ouvrier est le guerrier romain, le conquérant du XXe siècle ; il doit posséder les qualités morales qui l'ennoblissent et lui assurent sa supériorité face à la bourgeoisie. Sorel parle avec sympathie de cette race d'hommes « qui considère la vie comme une lutte et non comme un plaisir ». Ses maîtres-mots sont : énergie personnelle, énergie créatrice, énergie agissante. Ce type d'homme est élève du guerrier grec. Il refuse le monde des intellectuels qui l'affaiblit. Comme E. Burke, il est étranger au monde des sophistes, des économistes et des calculateurs. Et Sorel va plus loin quand il écrit : « Le sublime est mort dans la bourgeoisie » et ce sublime est l'apanage de la violence dans l'histoire. C'est la source de la morale révolutionnaire. Le syndicat renoue avec un monde de la morale, donc du sublime et de l'héroïsme. C'est un lieu, une école de moralisation collective. Le syndicat est autonome et sa morale est une conception du monde totale.
Mais Sorel est un apôtre de la violence parce qu'il croit dans la figure nouvelle du Travailleur. Sorel identifie pour nous le travail. Il récuse la dichotomie guerre/travail d'Auguste Comte. Le travail est une œuvre créatrice qui ne se plie pas au fond aux calculs sordides des capitalistes. Le travail est désintéressé. Comme la violence. La grève générale est aussi un acte libre de toute recherche de profits matériels. De même, Polin ressent la notion du travail comme une lutte à part entière. Le travail est, dans l'intuition de Sorel, un acte prométhéen. Le travail n'est pas seulement action de transformation sur les choses, il rétro-agit sur soi-même et la collectivité tout entière. La violence ennoblit la conscience du travail ; en d'autres termes, elle donne forme à l'œuvre de création et de transformation.
Le travail, qui n'est pas un simple “facteur de production” comme le prétendent les penseurs (?) et les économistes de l'école libérale, ni une source de profit pour le travailleur et de plus-values pour les entrepreneurs comme le croient les marxistes stricto sensu, est une forme sublimée de création. Il est bien évident que la violence sorélienne est une qualité qui est propre au monde des producteurs ; la réduction de la violence à une domination de l'homme par l'homme est le contraire de cette violence prolétarienne de Sorel. Sorel ajoute même qu'au cœur du travail lui-même, on trouve la violence comme moteur intime. Les notions sont ainsi reliées entre elles : Travail, Violence, Morale. Et le socialisme est ensuite le résultat de cette « vertu qui naît » (Réflexions...). Le travail est une lutte, où le producteur est soulevé par une violence absolue, et dont découle l’acte créateur historiquement.
La violence, antidote aux bassesses d'âme
Pour Sorel, il est évident que cette émergence du socialisme de la violence se fera au détriment du vieux monde bourgeois. Si la violence est une notion positive parce que créatrice, il faut qu'elle s'attende à des oppositions farouches. Sorel se propose de délimiter le territoire du conflit et de situer l'ennemi en face. La civilisation, c'est l'ennemi n°1 du socialisme naissant, ennemi qui s'appuie sur 2 autres instances du vieux monde : la démocratie et l'État. Les troupes qui défendent ces citadelles sont variées et quelquefois ennemies en apparence : c'est le camp de la bourgeoisie (libéraux, radicaux, partisans du capitalisme pur et dur, droite conservatrice) et des pseudo-socialistes (les membres responsables des partis réformistes, la “gauche” démocratique, les progressistes de toutes tendances).
Derrière ces abstractions (démocratie, civilisation, État), Sorel combat inlassablement les mêmes valeurs communes aux idéologies de la médiocrité. Il y a chez Sorel le sens de la guerre culturelle, du combat des valeurs. Il ne croit pas aux étiquettes que le discours bourgeois aime attribuer aux acteurs de son jeu. Les mots dans le jeu politique ne sont souvent que des apparences. Sorel cherche à fouiller les racines des discours. Être “socialiste” ne signifie rien si on n'est pas conscient d'une conception du monde en rupture avec la société marchande. Paresse, bassesse, hypocrisie, incompétence, veulerie, sont des traits communs aux partis officiels.
La violence sorélienne est en effet très consciente de l'enjeu réel et historique de la lutte. Les non-valeurs, qui asservissent les producteurs et lui ôtent toute liberté, sont concentrées dans la conception économique de l'homme, que les maurrassiens ont appelé “l'économisme”. Les principes de cet économisme sont au nombre de 2 : la croyance au progrès matériel, la réduction de l'homme à des valeurs matérialistes. L'homme bénéficie en même temps que le confort matériel d’un “confort” intellectuel. L’homme est un énorme estomac, destiné à la soumission sociale et politique. La société de consommation est alors le plus grand camp de normalisation intellectuelle. On peut penser que la violence sorélienne aurait été en en état de rupture avec le monde occidental, et tout ce que ce monde charrie derrière lui. De la même façon, il aurait du mal à se reconnaître dans certaines critiques progressistes de la société de consommation, dont le fondement réside dans une exigence encore plus grande de confort. La philosophie du bonheur est anti-sorélienne et Marcuse serait considéré par Sorel comme un cas typique d'utopisme bourgeois. L'homme qui réclame la fin du travail, qui refuse la lutte, qui conteste la guerre sociale, cet homme que nos philosophes des années 70 appellent de tous leurs vœux, n'a que de très lointains rapports avec le producteur à la mentalité guerrière des Réflexions sur la violence.
Les illusions du progrès
Quant au “progrès”, Sorel a senti le besoin de lui consacrer un ouvrage entier tant il lui a semblé que ce concept était un fleuron de la mentalité bourgeoise. Il s'agit des Illusions du progrès. L'illusion suprême d'un paradis terrestre retrouvé à la fin des temps provoque chez Sorel une réaction épidermique. Le pessimisme sorélien est la conclusion d'un constat : l'homme ne change pas fondamentalement. Sorel approuve les actes de progrès matériels mais il s'agit chez lui d'une admiration pour la “créativité” dont ces actes sont les manifestations. De la même façon, il croit au prolétariat non pas comme Marx croyait à la “classe élue de l'histoire” mais parce qu'il constate que la bourgeoisie n'a plus l'énergie de mener la lutte éternelle.
L'histoire est pour Sorel une succession d'énergies manifestées dans des groupes restreints. Le capitaine d'industrie est une figure positive. Ce n'est plus qu'une idée à son époque. En outre, les valeurs marchandes sont des valeurs de dégénérescence. Partir en guerre contre la société moderne (entendez marchande) est un point commun de Sorel et de Maurras. La haine du bourgeois, écrit Polin, est un point de rencontre entre l'Action Française et Sorel. C'est une classe sans volonté, sans honneur, sans dignité. Le régime démocratique lui convient parce qu'il conserve, non parce qu'il est source de création. Sorel parle durement de la bourgeoisie puisqu'il constate chez elle « une dégradation du sentiment de l'honneur ».
Cette démocratie, Sorel la vitupère, il écrit : « (la démocratie) est le charlatanisme de chefs ambitieux et avides » (Réflexions…). Peu importe que cette démocratie soit conservatrice ou populaire, elle conserve et favorise la même décadence. Les socialistes démocrates sont des « politiciens épiciers, démagogues, charlatans, industriels de l’intellect ». En outre, non contents de maintenir le peuple sous un régime oppressif (où sont les libertés des ouvriers travaillant 16 heures/jour, 6 jours/7 ?). La démocratie établit le règne de l’argent. C’est une tyrannie, une tyrannie ploutocratique, dirigée par des hommes d’argent, qui veulent préserver leurs intérêts propres. Sorel écrit : « Il est probable que leurs intérêts sont les seuls mobiles de leurs actions ». Quant aux responsables de l'Internationale Ouvrière, Sorel les dénonce comme des apprentis dictateurs. Leur objectif est l'instauration d'une « dictature démagogique ».
Sorel ne veut pas d'un socialisme d'État. Il manifeste dans sa critique de l'État des tendances anarchisantes, fort peu compatibles avec la dictature d'État du prolétariat désirée par les marxistes. L'État (même socialiste) est un « État postiche », porteur d'une « merveilleuse servitude ». L'État démocratique s'achève dans l'histoire avec les massacres de septembre. Et ce que C. Polin appelle, comme Sorel, « le cortège idéologique » de la démocratie (droits de l'homme, humanitarisme, charité, pacifisme, etc.) ne change rien au caractère oppressif de ce régime. Sorel est l’auteur d'une phrase célèbre sur la démocratie : « La démocratie est la dictature de l'incapacité » (Réflexions…). Deux mots nous frappent : la dictature, l'incapacité.
La critique anti-démocratique de Sorel ne doit pas être confondue avec l'idéologie réactionnaire du courant autoritaire ni avec le discours conservateur de l'Ordre-pour-l'Ordre. D'ailleurs, on voit bien chez Sorel un rejet des 2 camps : le camp de la bourgeoisie, où la lâcheté domine, et celui du social-réformisme mené par la corruption. Sorel croit en la lutte des classes. Ce qui le rend irréductible aux étiquettes conservatrices et social-démocrates. La violence qui manifeste cette lutte des classes est aussi un facteur d'énergie en action. Comme Pareto, il croit que la lutte des classes accouche de nouvelles élites sur les cadavres des classes déchues. La paix sociale est pour Sorel l'état d'entropie sociale absolu. Pourtant, Sorel ne peut être marxiste parce qu'il n'adhère pas à la vision finaliste du monde de Marx. La lutte est une activité normale de l'humanité. Elle n'a pas de sens, si ce n'est celui de faire circuler les élites dans l'histoire. En résumé, la violence est porteuse d'un projet de création en devenir infini, porteuse d'une conception morale de la vie, source d'une organisation des producteurs.
III. Conclusions
Dans son introduction aux Réflexions, Sorel écrit : « Je ne suis ni professeur, ni vulgarisateur, ni aspirant chef de parti ; je suis un autodidacte qui présente à quelques personnes les cahiers qui ont servi pour sa propre instruction ». Les Réflexions constituent donc un ensemble de constatations pratiques. Sorel le répète : il ne veut pas faire une œuvre universitaire. C'est plutôt une pédagogie à l'usage des syndicalistes libres, qui sont prêts à recevoir un message révolutionnaire.
La violence sorélienne est la dimension purement morale et créatrice du socialisme de Sorel. Le message de Sorel est que le socialisme n'est pas un programme politique, ni non plus un parti politique. Le socialisme est une révolution morale ; en d’autres termes, le socialisme est d'abord un bouleversement des mentalités. On pourrait parler à la limite de “révolution spirituelle”. Et la violence informe ce brutal changement dans les âmes. Le socialisme sans la violence n’est pas le socialisme. Seule l'utilisation de la violence assure une révolution positive. Sorel ne reconnaît pas dans les événements de la Révolution française une violence créatrice. Il rejette tout ce qui vise à détruire pour le plaisir de détruire. La violence donne au socialisme la marque de sa noblesse. Elle constitue une valeur essentielle de l’organisation progressive et indépendante des producteurs.
Il est certain que, pour nous, le socialisme n’est pas un discours rigide. Nous ne voulons pas reconnaître dans la social-démocratie un régime ou une idéologie socialiste. Le socialisme n’est pas un ersatz bâtard du libéralisme occidental. Les régimes occidentaux qui se réclament aujourd'hui du socialisme sont, à l'exception peut-être de l'Autriche en matière de politique internationale, des compromis honteux, ou “heureux”, de social-libéralisme (à ce sujet, lire dans Le Monde Diplomatique de février 1984, l'article intitulé « Un socialisme français aux couleurs du libéralisme »). Sorel avait pressenti cette involution vers un discours mixte, où socialisme et libéralisme feraient “bon ménage”...
Le socialisme de Sorel n'est pas un compromis. Il se présente comme une révolution culturelle. Son objectif n'est pas de gérer le capitalisme par un nouveau partage du pouvoir (quelles différences entre un technocrate de gauche et de droite ?) mais de poser les vraies valeurs de la révolution. La violence est un garant de la fidélité aux valeurs révolutionnaires. Il ne s'agit pas de casser des vitrines des grands magasins ni de pratiquer une violence terroriste. La vraie violence consiste à renverser les tabous. Il faut dénoncer les blocages intellectuels de l'Occident. Il ne faut pas hésiter à remettre en cause le système. Voilà la vraie violence de Sorel : autonomie intellectuelle... Alors, Sorel, une alternative radicale ?...
► Ange Sampieru, Orientations n°11, 1989.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Contre toute sortie de l’histoire, celle de la résignation de peuples dépouillés de toute dimension historique ou bien celles des utopies, Sorel fait du mythe une force mobilisatrice. Pour lui, comme auparavant pour Donoso Cortès, la “classe qui discute” ne crée pas l'histoire : elle la freine et l'ankylose. Dénonçant toute forme de réformisme libéral et démocratique, la “violence” sorélienne ne se montre que pour ne pas servir : affirmatrice, elle est avant tout cet agir politique mû par des nécessités intérieures qui ont un caractère d’organisation, ce qui veut dire que les actes politiques se rattachent au besoin de donner une cohérence à un groupe ou à une société sans la tutelle d’un quelconque pouvoir ou État. Si son langage est celui de l’énergie, c’est celui de l’énergie créatrice qu’on retrouve au sein du travail productif, cette énergie qui lutte contre l’entropie, que cette dernière se manifestât dans l’individualisme politique, dans les constructions des Lumières ou ses survivances totalitaires. Si elle a une identité de nature avec le travail, c’est en ce que ce dernier et ce qu’il implique de désintéressement impliquent la plus haute morale : « la violence est une morale de producteurs, mais de producteur d’humanité, et la créativité n’est rien d’autre que la productivité prolétarienne » (L. Soubise). Si cette “violence” pure et purificatrice peut se rapprocher du réalisme héroïque ou du nihilisme actif de Jünger, il ne s’agit en rien pour elle d’être porté par les circonstances (car celles-ci ne portent que ceux qui savent les reconnaître), mais, avec une âme de navigateur, de tracer le premier la route qu’on va suivre afin d’être au cœur du réel. Tel un faucon gardant son altitude au sein du cyclone, la figure de l’anarque nous rappelle que, même si les rêves sublimes alternent dans la nécessité avec les réalités sordides, la lutte en elle-même est signe de grandeur et que rien n’est jamais perdu : « La poésie est plus avant que la connaissance. Même si les hommes vivent dans les affres de l’angoisse apocalyptique, il y a toujours une conscience, une sapience supérieure à la contrainte de l’Histoire ».

Le mécanisme de l'illusion : Sorel, Jünger et le mythe
 Dans son ouvrage Réflexions sur la violence, G. Sorel écrivait :
Dans son ouvrage Réflexions sur la violence, G. Sorel écrivait :
« Nous savons très bien que les historiens du futur ne manqueront pas de trouver que notre pensée a été pleine d'illusions puisque ils observeront derrière eux un monde déjà révolu. Au contraire, nous devons œuvrer, et personne ne saurait nous dire aujourd'hui ce que les historiens connaîtront ; personne ne pourrait nous fournir le moyen de modifier nos images motrices afin d'éviter leurs critiques. »
Aujourd'hui nous pourrions donner de ces quelques lignes une interprétation triomphaliste et nous limiter à admirer la foi profonde et la passion politique qui anime leur auteur. Pourtant il n'y a rien là dedans de cet aveugle fanatisme qui anime les sectaires et rien de cette irritante imperméabilité au doute qui rend médiocres les prophètes. Par contre, on pourrait peut-être percevoir dans ces propos un peu de « cette trempe d'âme qui pourrait supporter même l'effondrement de tout espoir » et qui constitue, pour Max Weber, la caractéristique principale d'un individu très singulier : l'homme qui a la vocation pour la politique.
Les “images motrices” forcent les hommes à l'action
Seul un homme de ce genre, face à une réalité qui refuse tenacement de s'adapter à ses espoirs, face à un mystérieux mécanisme qui fait que chaque action provoque dans le monde des conséquences que celui qui a agi ne voulait (1) et ne prévoyait pas, pourra s'exclamer : « Aucune importance, on continue ! ». De la même façon, dans le passage cité, Sorel est parfaitement conscient que ces “images motrices”, ces mythes, seront, dans l'avenir, considérés comme illusion. Mais malgré cela, il s'approprie la devise « aucune importance, on continue ! » et il dit : « aucune importance, même s'il ne s'agit que d'illusions, nous devons œuvrer ! »
« Nous devons œuvrer politiquement » : les Réflexions sur la violence contribuèrent sûrement et de façon concrète à donner une nouvelle forme et une nouvelle vigueur aux espoirs révolutionnaires du prolétariat. En recevant l'héritage de Bakounine et de Proudhon, et surtout en adhérant avec conviction aux thèses de la philosophie bergsonienne, Sorel s'éloigne du rationalisme de Marx et construit une théorie du mythe qui est en même temps une philosophie de la vie concrète. Pour lui, ce que la vie exprime de plus valable et de plus noble ne dérive pas de la froide dictature de la raison mais se révèle dans les situations exceptionnelles, quand les hommes, possédés par les grandes images mythiques, participent à une lutte. Seuls les peuples ou les groupes sociaux prêts à embrasser vigoureusement la foi par le biais d'un mythe peuvent avoir une mission historique.
C'est dans la disponibilité au mythe que se trouve le secret de l'action, des héroïsmes et de l'enthousiasme. Les exemples de la grandiose efficacité du mythe sont, pour Sorel, l'idée de l'honneur et d'une glorieuse réputation pour le peuple grec, l'attente du Jugement Dernier dans le christianisme primitif, la foi dans la “vertu” et dans la liberté révolutionnaire pendant la Révolution française et l'enthousiasme nationaliste dans la lutte des Allemands pour l'indépendance en 1813. Pour ce que Sorel peut observer de son époque, la disponibilité au mythe ne se prête certes pas à une bourgeoisie hantée par l'argent et par la propriété, bâtisseuse d'une société dominée par le scepticisme et le relativisme, à une bourgeoisie qui place une confiance ingénue dans les infinies discussions du parlementarisme.
La “clase discutidora” ne porte pas de mythe en elle
Ce n'est pas la clase discutidora (classe parlementaire), comme Donoso Cortès l'avait dénommée, qui peut être porteuse d'un mythe : seules les masses du prolétariat industriel révèlent un pouvoir de mobilisation autour d'un mythe politique. Le mythe ne peut pas être théorisé sur le papier par des intellectuels ou par des hommes de lettres mais est immanent à la vie concrète, à la foi instinctive des masses qui embrassent la cause du socialisme : c'est le mythe de la grève générale. D'après Sorel, ce que la grève générale signifie réellement et objectivement dans la situation politique n'a aucune importance : ce qui compte, c’est la foi que le prolétariat lui accorde, et les effets, provoqués par une telle foi, dans la dynamique de la lutte politique.
Le mythe n'est pas l'utopie
Sorel distingue très clairement le mythe de l'utopie. L'utopie, pour lui, n'est que le produit usé d'une pensée rationaliste et comme telle peut, tout au plus, souhaiter des “réformes” dans un futur plus ou moins proche. L'utopie se laisse décomposer et reconstituer dans ses diverses parties, en démontrant ainsi sa nature de construction mécanique et artificielle. Au contraire, chaque mythe, et par conséquent le mythe de la grève générale, doit être accepté ou refusé dans sa totalité. Il n'alimente pas l'espoir d'une lente et graduelle transformation de “l'instant” ; il ne trace pas non plus, avec une admirable perfection, les caractères d'une société future : le mythe de la grève générale agit au présent et maintient vive chez le prolétariat la tension palpitante pour le combat décisif avec la bourgeoisie, pour l'immense catastrophe finale.
Dans l'interprétation de Carl Schmitt (2), l'affirmation par Sorel de la théorie du mythe démontre que, aux alentours des années vingt, la confiance rationaliste dans le système parlementaire avait perdu de sa force et de son évidence. Dans l'organisation relativiste/libérale, chaque opinion doit avoir le même espace et la même légitimité, et puisqu'il n'existe pas de critère pour décider de manière absolue ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, il s'avère nécessaire de discuter chaque problème et, après la discussion, de se soumettre à un compromis.
La faiblesse du relativisme libéral
Comme l'exposait Donoso Cortès vers le milieu du siècle dernier, « le principal intérêt du libéralisme est de ne jamais arriver au jour des négations radicales ou des affirmations souveraines. Et pour que cela n'arrive point, en se servant de la discussion, le libéralisme confond les principes et répand le scepticisme, puisqu'il sait fort bien qu'un peuple, qui écoute continuellement la voix des sophistes, est confronté sans cesse au pour et au contre de toute chose, finit par ne plus savoir en quoi croire et par se demander si la vérité et l'erreur, le juste et l'injuste, l'honnêteté et l'infamie sont des contraires ou bien sont une même chose observée à partir de points de vue différents. Mais une période aussi angoissante, continue Donoso Cortès, est toujours de brève durée. L'homme est né pour agir et la discussion éternelle est contraire à la nature humaine, puisqu'elle est “ennemie des œuvres”. Le jour viendra où les peuples, poussés par leur penchant le plus violent, envahiront les rues et les places pour demander résolument Barabbas ou Jésus en précipitant dans la poussière les chaires des sophistes » (in Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme, 1851).
À un siècle de distance, malgré ces paroles, substantiellement prophétiques et dûment confirmées par les faits, Hans Kelsen, dans son essai Absolutisme et relativisme dans la philosophie et dans la politique (1948), répétait que les promesses théorétiques de la démocratie moderne sont inclues dans le relativisme philosophique, tandis que les conceptions antidémocratiques trouvent leur pendant, en philosophie, dans la foi en une valeur absolue ! (3)
Mettons à part la nature problématique et le caractère superficiel d'un tel parallèle entre philosophie et politique, parallèle qui néglige d'emblée toute vraie réflexion sur les caractéristiques qu'une “forme politique bien fondée” doit présenter... Parce que même si l'on en parle à un niveau seulement abstrait, l'idée d'une forme politique qui se vante de son propre relativisme est un peu singulière... Il faut dire, en revanche, que la confiance dans le relativisme, que montre ce grand juriste, ne rend pas un bon service aux conceptions démocratiques qui, à l'ère des sociétés de masse ou des sociétés complexes, se trouvent en difficulté précisément pour concilier, d'une part, le maintien d'une définition minimale de procédure (qui est donc relativiste) de la démocratie, avec, d'autre part, l'exigence désespérée de préserver un minimum d'homogénéité sociale, politique et culturelle qui permette la survie et la stabilité à cette même démocratie (4).
Sorel, le nationalisme russe et le bolchevisme
Selon Sorel, des profondeurs de l'instinct vital authentique d'un groupe animé par la foi dans le mythe, peut surgir une impulsion. Impulsion, qu'à la façon de Carl Schmitt, on peut définir “d'orgueilleuse décision morale”, laquelle efface les préoccupations relativistes. Une bonne partie des mouvements politiques qui, pendant les années 20 et 30, déchaînèrent une lutte à outrance contre les démocraties libérales, comptaient sur l'adhésion de masses possédées par des mythes, dont la charge, simultanément destructrice et dévastatrice, fut, sans aucun doute, déterminante.
Il est encore intéressant d'observer cette théorie sorélienne du mythe, analysée par un penseur se proclamant, à l'époque, socialiste et internationaliste tout en désignant le mythe de la grève générale comme multiplicateur des énergies du prolétariat. Cette théorie du mythe peut, en réalité, servir à comprendre les succès de toutes les luttes pour l'affirmation nationale et de tous les mouvements qui ont combattu animés par un sentiment nationaliste ou, du moins, leur extraordinaire énergie.
D'ailleurs, les autres exemples de mythe que Sorel cite, outre celui de la grève générale, paraissent indiquer que le mythe de la nation en particulier possède une extraordinaire efficacité politique. Et, dans l'Appendice, ajouté en 1919 aux Réflexions, Sorel, en faisant l'apologie de Lénine, dit que l'emploi de la violence a porté les Bolchéviques au pouvoir ou, du moins, à redonner à la Russie sa conscience nationale.
Un voyageur français, que Sorel cite, écrivait en 1839 :
« Ou la Russie n'accomplira pas ce qui nous paraît sa destinée, ou Moscou redeviendra un jour la capitale de l'empire. Si je voyais jamais le trône de Russie majestueusement replacé sur sa véritable base, je dirais : la nation slave, triomphant, par un juste orgueil, de la vanité de ses guides, vit enfin de sa propre vie ». Et voilà que, sous la direction de Lénine, qui réunit en lui les capacités d'homme d'État de Pierre le Grand et le sentiment national de Nicolas I, les Bolchéviques ont redonné à Moscou le titre de capitale de la Russie, conclut Sorel, et leur bolchévisme est russe et moscovite. Avec un certain bien-fondé, Schmitt pouvait souligner que « dans la bouche d'un marxiste internationaliste, ceci est un éloge surprenant puisqu'il démontre que l'énergie du mythe national est plus grande que l'énergie du mythe de la lutte des classes » (in Die geistesgeschichtliche Lage…).
Il est presque superflu de rappeler le fameux discours que Mussolini prononça à Naples en octobre 1922, un peu avant la marche sur Rome, dans lequel le mythe de la nation était exalté et opposé au socialisme, défini comme une mythologie inférieure. Pour les écrivains anarchistes tels que Bakounine ou Proudhon, les péroraisons contre l'uniformité centralisatrice de l'État moderne, contre la bureaucratie, l'armée, contre toute forme d'autorité, tant politique que métaphysique, allaient de pair avec l'exaltation d'une sorte de vitalisme libertaire, dont la plénitude instinctive ne pouvait être sacrifiée à l'autel d'aucun pouvoir.
De l'anarchisme à “l'autorité nouvelle”
Même chez Sorel survivent des influences anarchiques de ce genre. Mais cela ne fait pas de doute que l'adhésion au mythe politique fait surgir, dans cette « plénitude instinctive de la vie concrète », une nouvelle sensibilité à l'ordre, la discipline et la hiérarchie. La prétendue liberté de l'anarchiste, dans l'adhésion fidéiste au mythe, peut se muer en un nouveau lien solide, encore plus fort que les liens anciens de l'Autorité contre laquelle lutte l'anarchiste. L'obéissance aux chefs de celui qui se bat, possédé par un mythe, est à peu près inconditionnelle.
Et la nouvelle forme politique, la nouvelle grande “Autorité”, que la lutte installe, obtient d'autant plus de consensus que sont puissantes ses capacités mythopoïétiques (id est de formation du mythe) ; le recours aux mythes est d'autant plus continu, plus obsessionnel, qu'il faut tenir les masses en état de mobilisation permanente. Voilà un résultat quelque peu paradoxal qui confirme cependant que l'on peut en réalité faire abstraction de certaines lois de la coercition politique.
Georges Sorel participa activement aux luttes politiques de son temps mais il n’œuvra pas seulement en tant qu'agitateur. En analysant la théorie du mythe, en fait, il accomplissait un travail scientifique et décrivait une loi de l'action politique. « Faire de la science veut dire, avant tout, savoir quelles sont les forces existantes dans le monde, écrit-il, et se mettre en condition de les utiliser en raisonnant d'après expérience. C'est pour cette raison que je dis qu'en acceptant l'idée de la grève générale, en sachant parfaitement qu'il s'agit d'un mythe, nous œuvrons exactement à la façon d'un physicien moderne, qui a pleine confiance dans sa science tout en sachant que dans l'avenir elle sera considérée comme dépassée ». Il ne s'agit pas ici d'une déclaration de meeting, ni des propos d'un agitateur de foules : Sorel sait que la capacité de mobilisation, due au mythe, est indépendante de tout jugement “objectif” qui porte sur sa valeur heuristique, parce que, en fait, une telle réflexion entraînerait la mort du mythe.
Observateur lucide et fervent partisan
Il y a ici une étrange et surprenante synthèse de 2 attitudes qu'il est difficile, en vérité, de concilier : on sait parfaitement que l'idée de grève générale est un mythe, une idée que la postérité jugera “illusoire”, mais on n'hésite pas à le faire lourdement valoir dans le déroulement pratique de la lutte politique. « Nous devons œuvrer », dit Sorel, comme nous l'avons vu au début du présent exposé. Il est un observateur lucide des faits et des théories et sait les décrire avec réalisme. Mais, en même temps, il reste un fervent participant à ces mêmes dynamiques politiques dont il a révélé une des plus importantes arcanes.
Il serait injuste de le considérer comme cynique : Sorel a cru à ses propres mythes en les considérant comme tels. Ce n'est certainement pas chose courante. Ayant désormais dépassé l'âge de 70 ans, il est en mesure de lancer une puissante invocation qui prouve que sa foi est intacte : « maudites soient les démocraties ploutocratiques qui affament la Russie ! Je ne suis qu'un vieillard dont l'existence est à la merci de minimes accidents mais puissé-je, avant de descendre dans la tombe, voir humilier les orgueilleuses démocraties bourgeoises, aujourd'hui cyniquement triomphantes ». Il n'y a pas de doute : Sorel avait la “vocation” politique.
L'expérience de Sorel nous paraît en effet singulière, non seulement pour la richesse globale de sa pensée qui constitue une intéressante convergence de tendances et de courants apparemment éloignés les uns des autres et contradictoires, mais aussi pour cette capacité qu'il possède de concilier la connaissance lucide de la réalité politique avec la disponibilité à l'action fidéiste, au cœur de cette même réalité. Presque jamais, si l'on analyse les penseurs décisifs dans l'histoire de la pensée politique, il n'est donné d'observer chez eux une telle absence de problématisation des rapports entre connaissance et action.
Dans le cadre de la politique active, quel individu, ni saint ni héros, peut afficher à la fois une sagesse profonde et une foi profonde ? Une connaissance approfondie des arcanes de la politique, en fait, produit souvent le scepticisme. Ce scepticisme n'arrêtera peut-être pas l'action mais il enlèvera à l'action même son caractère fidéiste, la privera de son élan idéal : parce que, à ce stade, il s'agira seulement de mettre en fonction un mécanisme dont l'efficacité est prouvée déjà par l'expérience. Même le mythe politique peut se révéler comme un mécanisme aux effets suffisamment sûrs. Celui qui en connaît le mode de fonctionnement pourra l'activer et, dans les coulisses de ce beau spectacle, son visage se contractera en un rictus : la grimace douloureuse du cynisme.
Deux routes se tracent, en effet, pour celui qui connaît ou croit connaître les arcanes de la politique : la première route est celle de l'abstention, de la non-action et de la simple observation des faits, désenchantée comme celle d'un entomologiste ou souffrante comme celle du poète qui admire la primitivité instinctive de la vie qui se déroule devant ses yeux, mais qui est conscient d’être trop “savant” pour pouvoir y participer de façon innocente. La seconde route est celle de la pure politique de puissance, de l'usage sans discrimination de la force et de la ruse pour se maintenir au pouvoir ou pour le conquérir.
Le cynique et le pouvoir
Chez le démagogue et chez l'agitateur de masses, qui luttent pour arriver au pouvoir, on peut observer une disponibilité d'âme cynique et sans scrupules, sinon parfois une bonne dose de cruauté. Celui qui est déjà au pouvoir pourra aussi faire preuve d’une certaine cruauté mais aux degrés les plus hauts de la conscience. Le cynisme du souverain aura ainsi des effets moins sanguinaires, il sera, pour ainsi dire, un cynisme “décadent”. La conscience de la relativité et de l'inanité de tout effort est ici trop importante. Au moment de la relève de la garde, le cynique, s'il a sauvé sa vie, s'éloignera du pouvoir avec une certaine tranquillité d'esprit. S'il le pouvait, il dirait à son successeur triomphant que le monde n'est rien d'autre que le lieu où toutes les espérances nés du cœur font naufrage.
Ce profond désespoir intérieur, cette image d'un monde sans lumière, est typique de tous les penseurs qui ont d'abord fréquenté intensément le monde de l'activisme politique puis qui ont analysé froidement et enfin compris sa rude logique. Que l'on pense au Prince de Machiavel et aux durs conseils qu'il contient : des légions de moralistes ont, pendant des siècles, poussé de hauts cris à propos de son “scandaleux cynisme”. Mais, comme on peut le noter, Machiavel analyse ici l'individu singulier dans sa situation d'absolue solitude :
« Dans la brève densité du Prince, tout s'échappe, oscille et tremble, écrit G. Capograssi, dans l'absence absolue de tout point à partir duquel l'esprit pratique puisse apaiser ses exigences et se débarrasser de son erreur empirique et utilitaire. C'est une humanité en proie aux diktats épouvantables d'une bataille, avec ses phases offensives et défensives, une humanité qui n'a pas d'autre alternative que de changer sans répit de position et de transformer toute chose en arme. Tous les moyens sont permis : les valeurs humaines et éthiques n'existent pas encore dans le monde de Machiavel, dont la réalité est un ensemble de choses décousues que chacun manie et utilise pour atteindre ses propres buts » (5).
Les passions mènent le monde
Voilà, en apparence, les résultats d'une observation désenchantée du monde de la politique et de la connaissance de ses mystères. Machiavel fut un excellent conseiller : mais serait-il possible de l'imaginer dans le rôle du souverain ou du démagogue ? Vraisemblablement pas, puisque dans cette descente dans l'Abgrund, aux abîmes du nihilisme politique, l'esprit humain paraît encore garder une dernière possibilité de défense : sortir de l'action, comme nous venons de le dire, et se contenter de la simple observation.
« Redoutable paradoxe du diplomatique, écrit Régis Debray dans La puissance et les rêves (Gal., p. 261), comment à la fois se tenir à distance des névroses ambiantes et des passions du jour sans jamais oublier que “les passions mènent le monde” et que les temps forts de l'histoire sont ceux où des hommes meurent pour une idée ? ». Dès que l'incrédulité professionnelle du spécialiste le conduit à négliger chez les autres la force motrice des croyances (c'est-à-dire des appartenances collectives dont elles sont l'empreinte individuelle), le stratège, affirme Debray, déchoit en conférencier et l'agnosticisme des forts se replie vers ce scepticisme mondain, ce relativisme fatigué et frivole qui conduit tant de diplomates et de politiciens à subir comme des aveugles l'histoire se faisant par d'autres aveugles, mais qui ont la foi.
Debray — cela lui arrive souvent — a mis le doigt sur la plaie. Son œuvre est, en France, un excellent exemple de transgression des lieux commun et des schémas idéologiques qu'il repousse pour essayer de nouvelles synthèses et emprunter des chemins inexplorés. Pourtant, sa tentative de concilier la puissance et les rêves va se révéler problématique. La politique de puissance assume la « force motrice des croyances », dans leur signification proprement littérale, à la façon d'un mécanisme que l'on active et dont on peut se servir. Les croyances ne sont plus des “valeurs”, leur signification et leur importance résident simplement dans le fait d'être des “moyens” pour atteindre un but. L'usage du mythe reconnu comme arcanum dans la politique, permettra, peut-être, de rejoindre la puissance mais, alors, où sont restés les rêves ?
Les mystères des grandes politiques
Il est bien vrai qu'à chaque grande politique appartient un mystère. Ce n'est guère consolant, parce que l'idée que nous pouvons nous faire aujourd'hui des mystères politiques n'a rien de mystique et encore moins de mythique ou d'irrationnel. La conscience des arcana peut sûrement fonder une hiérarchie puisque toute secte d'initiés aux ésotérismes politiques pourra regarder de haut les “hommes communs”, ceux qui “ne savent pas”. Mais il s'agira d'une hiérarchie purement matérielle, presque d'un despotisme secret, où il ne survit rien du charisme ni rien de la capacité à se faire une “représentation visuelle” d'une quelconque transcendance (6). Et ceci parce que, depuis le début de l'époque moderne, l'arcanum politique a montré, avec une obscène évidence, son caractère artificiel, sa nature de moyen technique, pratique, pour la conservation ou la conquête du pouvoir. Comme le fait remarquer Schmitt, à l'origine même de l'État moderne, il y une orientation vers le rationalisme et la technicité (in La dictature, Seuil, 2000).
 C'est d'une technique pratique que l'État moderne est né historiquement. Par réflexe théorétique, la doctrine de la “raison d'État” est née. Elle est une maxime sociologique et politique, tirée des nécessités imposées par le maintien et par l'extension du pouvoir politique et elle se situe donc au-dessus de toute considération sur le “juste” et “l'injuste”. Dans l'interprétation historique de Meinecke, la “raison d'État” apparaissait encore dans son aspect rassurant de conciliation entre cratos et ethos, entre, d'une part, un agir déterminé par l'instant du pouvoir et, d'autre part, un agir déterminé par une responsabilité morale (in L'idée de raison d'État dans l'histoire des temps modernes [1924], Droz, 1973).
C'est d'une technique pratique que l'État moderne est né historiquement. Par réflexe théorétique, la doctrine de la “raison d'État” est née. Elle est une maxime sociologique et politique, tirée des nécessités imposées par le maintien et par l'extension du pouvoir politique et elle se situe donc au-dessus de toute considération sur le “juste” et “l'injuste”. Dans l'interprétation historique de Meinecke, la “raison d'État” apparaissait encore dans son aspect rassurant de conciliation entre cratos et ethos, entre, d'une part, un agir déterminé par l'instant du pouvoir et, d'autre part, un agir déterminé par une responsabilité morale (in L'idée de raison d'État dans l'histoire des temps modernes [1924], Droz, 1973).
Une analyse moins fourvoyante nous dit qu'à un niveau encore plus élevé, au-dessus des conceptions de “raison d'État” et de “salut public”, lesquelles se prêtent, à cause de leur obscurité, à des interprétations moralisantes, on trouve dans la littérature politique contemporaine, lorsqu'elle évoque la naissance de l'État moderne, une autre conception : celle de l'arcanum politique. Au départ de cette conception, le politique se développe en tant que science sous l'aspect d'une doctrine secrète. « Mais le concept d'arcanum en politique et en diplomatie, même quand il se rapporte aux secrets d'État, n'est pas plus ou moins mystique que la conception moderne de secret d'entreprise ou d'affaires » (Schmitt, La dictature). L'usage qu'on faisait de ce concept à l'époque, révèle la signification purement technique de l'arcanum : ce n'est qu'un secret de fabrication.
 Il va de soi que l'usage des métaphores mécaniques et techniques, qui renvoient à une artificialité générale et immanente de tout l'univers politique, n'est ni innocent ni fortuit. Il révèle, au contraire, aux origines de l'ère de l'État moderne et de l'État moderne lui-même, un problème philosophique de fond, qui nous apparaît considérable, puisqu'il implique et explique bon nombre de situations que l'on a abordées plus haut. Des études récentes — et on peut rappeler ici les noms de Roman Schnur et, en Italie, d'Emmanuele Castrucci — ont interrogé la situation intellectuelle des XVIe et XVIIe siècles en Europe, en mettant en évidence des filons de pensée, constamment laissés dans l'ombre par l'enquête idéaliste des XIXe et XXe siècles, ancrée dans les dilemmes du jusnaturalisme et de l'historicisme. L'image qui jaillit de ces recherches est celle de l'intellectuel libertin, vu dans une ambiance culturelle et politique que l'on qualifie du mot de “maniérisme”.
Il va de soi que l'usage des métaphores mécaniques et techniques, qui renvoient à une artificialité générale et immanente de tout l'univers politique, n'est ni innocent ni fortuit. Il révèle, au contraire, aux origines de l'ère de l'État moderne et de l'État moderne lui-même, un problème philosophique de fond, qui nous apparaît considérable, puisqu'il implique et explique bon nombre de situations que l'on a abordées plus haut. Des études récentes — et on peut rappeler ici les noms de Roman Schnur et, en Italie, d'Emmanuele Castrucci — ont interrogé la situation intellectuelle des XVIe et XVIIe siècles en Europe, en mettant en évidence des filons de pensée, constamment laissés dans l'ombre par l'enquête idéaliste des XIXe et XXe siècles, ancrée dans les dilemmes du jusnaturalisme et de l'historicisme. L'image qui jaillit de ces recherches est celle de l'intellectuel libertin, vu dans une ambiance culturelle et politique que l'on qualifie du mot de “maniérisme”.
Le maniérisme
Pourquoi tout ceci nous intéresse-t-il ? Avant tout parce que dans la sensibilité maniériste et baroque prédomine une allégorie désespérée du “vide”, de la précarité du monde historicopolitique. Dans cette précarité, l'homme est lié à l'existence terrestre et il est son prisonnier, sans voie de sortie :
« la sensibilité européenne du maniérisme et du baroque ne permet aucun signe d'espoir au-delà du profane et ramène constamment à la condition de départ, écrit Castrucci, à la réalité, c'est-à-dire, à un monde réglé par les seuls rapports de force et par la capacité résolutive des décisions politiques du souverain » (7).
L'affirmation de la pensée décisionniste dans la théorie politique des XVIe et XVIIe siècles signale l'avènement de la théorisation nihiliste-libertine : le décisionnisme, en fait, survient seulement là où le “principe espérance” a disparu, où toute tension révolutionnaire généreuse et agitée a manqué et où aucune valeur suprasensible ne donne plus d'illusions à l'homme historique en agitant devant lui l'espoir de la libération.
Mais qui est donc l'intellectuel libertin ? Il fait partie d'une élite qui a pu réfléchir sur l'épouvantable déchaînement des guerres de religion et qui a dû être saisie d'horreur face aux abîmes de chaos et de violence dans lesquels la foi en des valeurs a conduit les hommes. Il a donc mûri un “scepticisme relativiste” qui théorise jusqu'au bout la désillusion vis-à-vis des valeurs mais en même temps se rend compte que les valeurs, même si elles sont rendues indémontrables et sont épurées de toute aura traditionaliste, continuent toujours à faciliter l'intégration sociale, comme autant de mythes politiques. Mais l'ordre qui en découle est un ordre purement conventionnel — c'est exactement la « tentative d'un ordre maniériste », d'après l'expression de Schnur — qui essaie de concilier la suspension subjectiviste des valeurs et la nécessité d'un ordre institutionnel. L'intellectuel libertin s'oriente vers une explication mécaniciste des lois qui président aux catégories du politique.
L'utilisation de l'“arcanum”
Les élites politiques — auteurs et utilisateurs du savoir/pouvoir qui permet le gouvernement des masses — « devinent la présence, au fond de l’existence de l’existence de l'homme, de forces occultes et très puissantes qui constituent les véritables principes d'origine d’une anthropologie politique. La soif de plaisir, la volonté de puissance, dans l'ensemble de leurs articulations ambiguës et multiples, apparaissent comme un noyau irrationnel, irréductible à toute forme conceptuelle, mais, par contre, riche en renvois vers le territoire inexploré du mythe politique. Cet esprit irrationnel doit être contrôlé et dirigé par des hommes armés de critères d'action rationnels par rapport au but. L'usage du mythe à des fins politiques est d'ailleurs exclusivement instrumental, émancipé par la valeur et dirigé vers la satisfaction de la volonté qui veut la puissance » (7). L'usage de l'arcanum politique est donc un moyen technique/pratique pour essayer d'assurer un ordre conventionnel et artificiel, et le mythe politique est l'instrument le plus efficace pour atteindre ce but. Dans son for intérieur, le maniériste politique vit pourtant de la valeur qu'il a déjà largement dépassée : mais « son sourire est sans joie, car Behemoth peut l'emporter aussi » (7).
Il ne peut en effet ressentir de la joie, celui qui a enlevé sa signification au monde. Beaucoup des “apprentis sorciers” qui se sont dévoués pour atteindre ce but risquent de devoir verser par la suite des larmes amères parce que, au-dessus de cet univers politique artificiel, au-dessus de cette pure mécanique mise en marche uniquement pour des fonctions de contrôle, est suspendue la possibilité — voire la probabilité — de l'auto-dissolution. Et il ne peut y avoir aucune complaisance de la part de celui qui doit prendre acte de cette situation, caractérisée par l'absence radicale de fondement et par l'artificialité inscrite dans les origines mêmes de l'histoire de la modernité politique. Mais aucune connaissance éthique ingénue, aucune “nostalgie humaniste résiduelle”, ne sont des refuges possibles, d'autant plus pour l'activiste ou l'homme politique qui projette et espère retrouver un sens dans le monde.
« Nous devons œuvrer », disait Sorel. Si l'on veut répéter ces paroles, et sans être ni des saints ni des héros, en essayant même d'oublier les vociférations et les malhonnêtetés propres à un certain type de “vocation” pour la politique, on doit assumer jusqu'au bout les noyaux cruciaux de “cette” modernité (8).
On vient d'évoquer le maniériste politique. Cette figure vivait dans le contexte historique et politique de l'absolutisme, c'est-à-dire dans un ordre qui nous paraît profondément lié aux métaphores mécanicistes, qui trouveront par après leur expression accomplie dans la construction hobbesienne du Léviathan. C’est là une donnée intéressante parce qu’un mécanisme ne peut jamais être totalitaire :
« C’est quelque chose d’extérieur, que l’on peut utiliser pour obtenir des citoyens une obéissance extérieure, sans que leur intériorité ne soit touchée, sans que leur conscience ne soit éprouvée » (9).
À ce stade de notre exposé apparaît une lecture possible, qui distingue, tant sur le plan historique que sur le plan théorique, l'absolutisme du totalitarisme, puisque ce denier “isme” paraît mû, en général, par une instance unanimisante, qui ne tient pas compte de la libre manifestation de la conscience dans la sphère intérieure. Comme on le devine déjà dans Sorel, le mythe politique, dans sa capacité de mobilisation, imprègne une collectivité de façon globale : avec lui s'évaporent les individualités ; une issue différente ne serait pas possible. Possédant un degré maximal de conscience, le maniériste politique, malgré son désespoir, dispose d'un avantage : une grande liberté intérieure par rapport à ce qu'il a créé lui-même. Il se soumet extérieurement mais sa conscience possède une autonomie totale.
L'Anarque de Jünger
Même sans vouloir forcer de manière excessive le parallèle, il se rapproche sensiblement d'une autre figure, celle de l'Anarque de Jünger. En effet, nous avons jusqu'ici parlé de normes et des tristes impasses auxquelles conduisent les persistances pernicieuses de la norme. Et si l'on cherche maintenant une possibilité de transgression face à toutes les lourdes régularités, face aux lois dont on observe l'immuable répétition dans l'univers politique, l'Anarque présente, peut-être, un formidable exemple de liberté et d'autonomie. Presque sous l'influence d'une conjonction astrale favorable, l'Anarque paraît en mesure de réamorcer le jeu, de se projeter vers d'autres solutions, jusqu'alors inconcevables, solutions qui seraient aussi des issues : elles permettraient de sortir des blocages paralysants et désespérants nés du rapport entre conscience et action politique.
« Neutralité intérieure. On y participe quand et si on en a envie. Si dans l'omnibus, il n'y a plus de confort, on descend » (10). L'Anarque connait en profondeur le pouvoir et la politique. Dans la ville imaginaire d'Eumeswil, il dispose même de l'extraordinaire Luminar, pour étudier chaque manifestation de l'histoire, même la plus cachée. L'Anarque, en tant qu'historien, peut analyser le pouvoir et la politique en direct, puisqu'il dépend directement du Condor, le tyran qui a renversé les tribuns et qui règne sur Eumeswil. En tant qu'Anarque, il n'est pas contre l'autorité, même s'il croit ne pas en avoir besoin, puisqu'il a une idée bien précise de la grandeur. Historien, tout l'intéresse, même s'il sait que peu de choses changent. Les drapeaux sont importants pour lui, mais sans signification.
« Je les ai déjà vus tantôt hissés, tantôt baissés, dit Martin Venator, comme les feuilles de mai et de novembre (...) On continuera : fêter le 1er Mai, mais avec une interprétation différente. D'autres portraits seront affichés en tête des cortèges. »
L'Anarque n'est pas l'adversaire du monarque ; il est son pendant
Pour l'Anarque, peu de choses changent. Il porte un uniforme, en partie comme une veste, en partie comme une cape mimétique. Et cet uniforme couvre sa liberté intérieure qu'il saura objectiver dans chaque transition. Tout ceci le différencie de l'anarchiste qui, objectivement privé de liberté, sera l'objet de crises furieuses tant qu'on ne l’enfermera pas dans une camisole de force encore plus rigide. L'anarchiste est l'antagoniste du monarque dont il médite l'anéantissement. Il frappera la personne mais il renforcera la succession. Dans le mot “anarchisme”, le suffixe “-isme” a donc une signification restrictive, puisqu'il accroît la volonté mais réduit la substance. L'Anarque, par contre, n'est pas l'antagoniste du monarque mais la personne la plus éloignée de lui. Il n'est pas son adversaire mais son pendant.
« Le monarque veut dominer beaucoup de monde. En fait, il veut dominer tout le monde. L'Anarque ne veut dominer que lui-même. Cela lui permet d'entretenir un rapport objectif, tout empreint de scepticisme, avec le pouvoir, dont il laisse défiler devant lui les images et figures, avec, bien sûr, de l'indifférence dans le cœur. Dans son for intérieur, néanmoins, il n'est ni impassible ni dépourvu de passion stoïque. »
Martin (ou Manuel) Venator est le serviteur du Condor qui est le tyran : le Condor a sa fonction, comme l'Anarque a la sienne : « Nous avons tous les deux la possibilité de nous retirer à l'intérieur de notre substance qui est l'élément humain dans sa singularité spécifique. » L'Anarque se considère comme l'égal du tyran parce qu'il peut le tuer quand il le veut et ceci est la seule et unique forme d'égalité qu'il admet. Le pouvoir de le gracier est naturellement sien aussi.
L'Anarque et le maniériste
La liberté de l'Anarque dépasse aussi celle du maniériste politique. Avant tout, parce que l'Anarque est serein même si sa sérénité est songeuse. Par contre, le maniériste politique est prisonnier de sa conscience désespérée même quand, loin de la malhonnêteté du pouvoir, il pourra se livrer à des méditations où la liberté sera confite dans la mélancolie. Ce qui fait toute la différence, c'est que le scepticisme du maniériste est fatigué et résigné, même s'il n'est pas dépourvu de grandeur tragique. Le scepticisme de l'Anarque, lui, est relié, en fait, à une « disponibilité toujours intacte », ce qui n'est pas simplement une jolie formule mais aussi le signe d'un destin.
« Je suis Anarque dans l'espace ; dans le temps, je suis méta-historien, dit Martin. Donc je ne suis engagé ni avec le présent politique ni avec la tradition, je suis comme une page blanche, je suis puissance et ouvert en toute direction. » Comme historien, il est sceptique, mais comme Anarque, il est sur ses gardes. « Ma liberté personnelle est un avantage secondaire, dit-il. Au-delà du temps, je suis prêt à la Grande Rencontre, à l'irruption de l'Absolu dans le temps. C'est là que l'histoire et la science trouvent leur fin. »
Le maniériste politique n'est, en toute vraisemblance, concerné que par “son” seul Pouvoir, même si, en certaines circonstances, il peut s'en éloigner. Il disparaîtra avec lui. Pas l'Anarque : chaque lieu n'est, pour lui, qu'un lieu de passage, sa liberté est totale, même face à l'obligation de se donner une limite. Pour le temps d'intervalle, pour les “en attendant”, c'est-à-dire dans les intermèdes entre 2 dominations, il possède un refuge qui n'est pas uniquement intérieur. À la façon du muscadin, l'Anarque a bâti son repaire loin de la ville. Là-bas, il pourra disparaître pendant qu’il faudra.
L'Anarque et le pouvoir
Son rapport avec le pouvoir n'est pas seulement de nature sceptique, mais est aussi ouvert aux suggestions de la magie. Au “bar de nuit”, il écoute les dialogues des puissants et, quand l’heure est tardive et que la fatigue s'installe, leurs figures, leurs silhouettes se découpent, hiératiques, plus nettes, dans un maintien presque sacré. « Je voyais leurs visages se durcir comme dans le rite sacrificateur. Il se formait ensuite une aura de mystère. » Très certainement, il s'agit ici, comme parfois chez Jünger, d'une pure fascination esthétique. Mais il est vraiment très symptomatique que, dans le calme et l'indifférence absolue de l'Anarque, survient quelquefois une sorte d'impatience nerveuse, une inquiétude fébrile. Tout compte fait, c'est là le contrepoids à sa disponibilité toujours intacte, c'est une sorte de péage qui est dû, mais l'Anarque semble penser que cela en vaut la peine.
L'entrée en scène de l'anarchiste/nihiliste conforte la société et renforce son unité. L'Anarque, lui, reconnaît au fond de son intimité l'imperfection fondamentale de l'État et de la société. C'est pour cela que cette position peut s'avérer plus dangereuse pour lui. L'État et la société suscitent sa répulsion mais il sait toutefois que « des temps et des lieux peuvent se présenter où l'harmonie invisible transparaît dans l'harmonie visible. Cela se constate surtout dans l'œuvre d'art. Dans ce cas, dit l'Anarque, il est encore possible de servir dans la joie ». Mais, en général, l'Anarque fait preuve de circonspection et d'une prudence hors pair dans ses rapports avec le pouvoir. Il cultive un penchant instinctif pour les normes, parce qu'elles lui évitent de trop réfléchir, du moins aux choses superflues. Il se fera difficilement apprécier et les puissants seront toujours contents de ses services, mais de façon discrète, modérée.
L'Anarque, les dieux, la religion
L'Anarque peut aussi devenir “excessif” : cela arrive quand l'inquiétude survient à nouveau. Ses prétentions deviennent alors exorbitantes. Par ex. en matière de religion. Certes, pour lui, le terme est usé et corrompu. Religio, comme on le sait, se rattache à “lien” et c'est justement cela que refuse l'Anarque. Il ne veut rien savoir des divinités et des rumeurs qui les concernent, sinon en tant qu'historien. En tant qu'Anarque, il demande davantage. « Le fait que les dieux se soient montrés, non seulement dans la préhistoire, mais aussi à la fin de l'époque historique, explique-t-il, n'est pas à mettre en doute. Ils ont participé à nos banquets et à nos luttes. » Mais voilà la requête totale : « Qu'apporte à l'affamé la splendeur des festins d'antan ? Que rapporte au pauvre le tintement des pièces d'or qu'il perçoit à travers le mur du temps ? C'est la présence qu'il faut exiger. »
Ce jeu de relance, que joue l'Anarque, nous apparaît parfois surprenant. La cité imaginaire d'Eumeswil advient dans un temps, où toute chose semble être définitivement passée. Passée, l'ère chrétienne. Passé, l'État mondial. Passée, l'époque des “grands incendies”. Chaque temps réel et chaque temps possible sont révolus. Historien, Martin le sait bien : « ... je suis convaincu de l'inadéquation, ou, mieux, de l'inutilité de tout effort ; j'admets qu'y contribue aussi l'hypersatiété des temps les plus récents. Le catalogue des possibles paraît épuisé. Les grandes idées sont consommées par la répétition : on ne peut plus rien en tirer. ». C'est là un problème qui renforce la douleur de l'historien : la faillite des idéaux se fracassant contre l'esprit du temps, qui les dégradent en illusions.
De ce point de vue, il faudrait renoncer alors aux exigences excessives, apaiser cette disponibilité faite d'inquiétude. « Dans une telle situation, la tentation d'invoquer les dieux est très forte et il y a alors grand mérite à y résister », reconnaît l'Anarque. Parce qu'Eumeswil semble se poser comme un lieu d'observation privilégiée pour attendre une récapitulation définitive et concluante et ainsi préparer l'opération “fin du temps”. L'Anarque suivra les puissants dans le “recours aux forêts”. Cette métaphore indique sans doute que la fin est nécessaire ou bien elle suggère la voie des révélations occultes, permettant de rêver à un monde au visage autre, d’y rêver à la façon des dieux. Le “recours à la forêt” indique peut-être aussi ce passage qui est la mort, ou le retour au chaos, ou un simple passage sans limitation. Il est probablement inutile de chercher un “message”. Et même, s’il parvenait à le cerner, ce message, l’Anarque l’aurait déjà dépassé. Tandis que nous resterions ici, à chercher comment diable il serait possible d’œuvrer, et sur quel mode.
► Nicolò Zanin, Orientations n°11, 1989. (extrait de la revue italienne Trasgressioni n°2, 1986. Tr. fr. : A. Coletti)
◘ Notes :
- Cf. Jules Monnerot, Les lois du tragique, PUF, 1969. Monnerot écrit, en rappelant Jaspers : « Le type d'action qui ainsi échappe à l'agent alors qu'il importerait qu'elle ne lui échappât point, c'est l'action tragique. L'hétérotélie, lorsque les conséquences des décisions voulues entraînent une catastrophe pour l'agent, et non la plupart du temps pour lui seul, c'est le tragique », p. 10.
- C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus : « La théorie du mythe est la manifestation la plus forte qui prouve que le rationalisme relatif de la pensée parlementaire a perdu son évidence. » [tr. fr. in Parlementarisme et démocratie, Seuil, 1988]
- Pour Kelsen, Ponce Pilate eut la figure pouvant le mieux symboliser l'attitude relativiste qui est à la base de la démocratie. Face au Christ qui se présente « pour rendre témoignage à la vérité », Ponce Pilate demande : “Qu’est-ce que la vérité ?”. Et parce que lui, Pilate, le sceptique relativiste, ne sait ce qu'est la vérité, l'absolue vérité en laquelle croit l'homme qui est devant lui, il s'en remet, en toute bonne conscience, à la procédure démocratique et laisse la décision au vote populaire. Cf. aussi La polémique entre H. Kelsen et C. Schmitt sur la justice constitutionnelle, N. Zanon, in Annuaire international de justice constitutionnelle n°V, 1989, p. 177 sq.
- Il m'apparaît assez imprudent de résumer en quelques lignes une question aussi décisive et fondamentale. Récemment est parue une défense de la “démocratie sans valeurs” : c'est l'ouvrage de Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Einaudi, Torino, 1984. La démocratie est perçue ici comme modalité structurelle et réglementation procédurière : elle trouve sa justification en un relativisme politique radical qui ne connaît aucun absolu mais seulement des formes entre lesquelles les diverses valeurs admises peuvent louvoyer. On peut ajouter que la “démocratie sans valeurs” est conceptuellement liée au développement du Rechtsstaat, c'est-à-dire d'un État qui vit dans le droit mais ne reconnaît aucun droit ou, mieux, d'un État qui ne peut lui donner aucune définition matérielle ni aucun contenu et ne peut que lui attribuer des connotations en termes de mécanisme juridique. Ainsi, la “démocratie sans valeurs” et l'État de droit acceptent le principe de n'être que le cadre juridique qui cherche à déterminer et à circonscrire un champ de rencontre, un terrain de contradiction et de contraste. La “démocratie sans valeurs” et l'État de droit se posent, en d'autres mots, comme les règles du jeu. Aux antipodes de cette conception, se trouve le Carl Schmitt qui écrit la Verfassungslehre : pour lui, la démocratie signifie essentiellement l'homogénéité politique du peuple, dont la cohésion fonde un organisme politique basé sur l'exclusion de l'autre, de tout ce qui, politiquement, ne relève pas de tel peuple. L'antithèse formel/substantiel qui se trouve sous-jacente dans le rapport entre, d'une part, la démocratie comprise comme ensemble de règles de jeu et, d'autre part, la démocratie comprise comme homogénéité politique, peut être parfaitement considérée comme un problème encore actuel.
- Cité par E. Castrucci, Ordine convenzionale e pensiero decisionista, Giuffrè, Milano, 1981, p. 37.
- Sur le concept de Repräsentation, voir C. Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form, Theatiner Verlag, München, 1925. Dans cet essai, [réédité chez Klett Cotta, Stuttgart, 1984], l’A. soutient la thèse que l'Église est forma politica au sens le plus éminent, c'est-à-dire est un ordre dans lequel la souveraineté apparaît visible, “représentée”, comme complexio oppositorum, comme institution (aussi au sens juridique) qui donne forme aux contraires et conserve inaltéré la racine théologique de la transcendance.
- in Storia delle idee e dottrina decisionistica, essai d’introduction à : R. Schnur, Individualismo e assolutismo, Giuffrè, 1979, p. IV.
- Cf. Peppe Nanni, Destini del politico in Diorama Letterario n°76, nov. 1984, p.11-16.
- R. Schnur, Individualismo e assolutismo, p. 87. Tr. it. de Individualismus und Absolutismus : Zur politischen Theorie vor Thomas Hobbes, Berlin 1963.
- E. Jünger, Eumeswil. Toutes les citations qui suivent sont tirées de ce livre. Les pages n’ont pas été mentionnées non seulement pour ne pas alourdir la lecture mais surtout parce que c’est inopportun. Certaines phrases de cet auteur n’appartiennent en effet pas à telle ou telle page mais bien plutôt à des états particuliers de la conscience, accessibles uniquement à ceux s’en montrant disponibles.
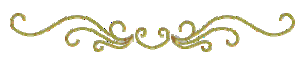
pièce-jointe :
 Pour présenter l’œuvre en apparence hétérogène de l’écrivain politique Georges Sorel (1847-1922), nous livrons ici un portrait intellectuel par Julien Freund. La vie de G. Sorel présente peu d'aspects remarquables. Né le 2 novembre 1847 à Cherbourg, dans une vieille famille normande à laquelle appartenait aussi l'historien Albert Sorel, son cousin, il fit ses études au lycée de Cherbourg, puis au lycée Rodin, à Paris, et à l'école Polytechnique. Il avait 23 ans lors de l'effondrement de 1870-1871, qui semble l'avoir beaucoup marqué. (Il écrivit par la suite une préface pour une traduction, jamais parue, de La Réforme intellectuelle et morale, le seul livre de Renan qu'il ait vraiment apprécié). Il fit une carrière d'ingénieur des Ponts et Chaussées. Existence paisible s'il en fut. Sorel a 40 ans quand il rédige ses premiers écrits théoriques ; il en a 61 lorsque paraissent ses Réflexions sur la violence – le plus célèbre, sinon le plus important de ses ouvrages. De son parcours on retrouve une philosophie de la technique (il garde la marque de l’homo faber, de l’homme qui agit sur la matière) et un moraliste rigoureux ayant en horreur le relâchement des mœurs et exigeant le sublime, cette tension de l’âme qui fait accomplir les grandes choses, les hautes actions.
Pour présenter l’œuvre en apparence hétérogène de l’écrivain politique Georges Sorel (1847-1922), nous livrons ici un portrait intellectuel par Julien Freund. La vie de G. Sorel présente peu d'aspects remarquables. Né le 2 novembre 1847 à Cherbourg, dans une vieille famille normande à laquelle appartenait aussi l'historien Albert Sorel, son cousin, il fit ses études au lycée de Cherbourg, puis au lycée Rodin, à Paris, et à l'école Polytechnique. Il avait 23 ans lors de l'effondrement de 1870-1871, qui semble l'avoir beaucoup marqué. (Il écrivit par la suite une préface pour une traduction, jamais parue, de La Réforme intellectuelle et morale, le seul livre de Renan qu'il ait vraiment apprécié). Il fit une carrière d'ingénieur des Ponts et Chaussées. Existence paisible s'il en fut. Sorel a 40 ans quand il rédige ses premiers écrits théoriques ; il en a 61 lorsque paraissent ses Réflexions sur la violence – le plus célèbre, sinon le plus important de ses ouvrages. De son parcours on retrouve une philosophie de la technique (il garde la marque de l’homo faber, de l’homme qui agit sur la matière) et un moraliste rigoureux ayant en horreur le relâchement des mœurs et exigeant le sublime, cette tension de l’âme qui fait accomplir les grandes choses, les hautes actions.
Sorel restera en fait dans l'histoire des idées comme le fondateur en politique de la notion de mythe – « réseau de significations » et « dispositif d'élucidation qui nous aide à percevoir notre propre histoire » (Jules Monnerot, « Georges Sorel ou l'introduction aux mythes modernes » in Inquisitions, Corti, 1974). C'est en 1903, dans l'Introduction à l'économie moderne, que le mot, avec tout son sens, apparaît pour la première fois dans son œuvre. Et c'est alors que Sorel commence à énoncer sa « théorie des mythes sociaux ».
Le mythe est une croyance créée par l'homme, souvent liée à la question des origines (il s'agit de motiver l'action par une généalogie exemplaire), qui naît d'un choc psychologique. Il ne renvoie donc pas au passé – comme l'avaient cru les “primitivistes” – mais à l'éternel. Il ne s’agit donc pas d’une utopie, invention intellectuelle d’institutions imaginaires, constituant un modèle social qui permet, par comparaison, de juger la société existante. Ce n’est pas non plus une prédiction plus ou moins approchée de l’avenir.
En fait le recours au mythe répond au paradoxe de l’homme qui ne peut agir sans sortir du présent, sans raisonner sur cet avenir qui semble échapper à sa raison. Conformément à la philosophie anti-intellectualiste de Bergson, le mythe se donne comme un ensemble lié non d’idées mais d’images motrices, capables d’évoquer en bloc et par la seule intuition, avant toute analyse réfléchie, tous les sentiments correspondants à une action projetée. Le mythe ne nous éclaire donc pas sur ce qui a eu lieu, mais sur ce qui se produira, sur ce que l'on cherche à produire. S'il est fécond, s'il répond à la demande collective, s'il est accepté par la société tout entière, ou par une fraction importante de celle-ci, alors il se renouvelle de lui-même : sa socialisation va de pair avec sa sacralisation. Le mythe se situe par-delà le vrai et le faux, le bien et le mal, le juste et l'injuste. Il est seulement fécond ou il ne l'est pas. Il a ou il n'a pas une valeur opératoire, il détermine une activité socio-psychologique ou il ne la détermine pas.
Il ne saurait donc être réfuté, mais seulement approuvé ou réprouvé. C'est la raison, entre autres, pour laquelle Georges Sorel se garde bien de “réfuter” le marxisme (dont il dénonce cependant le réductionnisme implicite et la prétention à prévoir l’avenir de manière scientifique) et préfère en souligner la puissance mythique – jusques et y compris dans certains aspects douteux, dont la force imaginative et symbolique demeure réelle –, pour démontrer qu'il ne se veut “scientifique” que dans la mesure, précisément, où la “science” constitue un mythe de son époque : le marxisme est “mythique” dans l'instant même qu'il se veut “scientifique”. La grève générale est ce mythe dont a besoin le syndicalisme révolutionnaire engagé franchement contre la société moderne, c'est-à-dire une organisation d’images capables d’évoquer instinctivement, chez les prolétaires européens, tous les sentiments qui correspondent aux diverses manifestations de cette guerre. Sorel compare ce mythe à la « bataille napoléonienne » qui écraserait définitivement l’adversaire, « issue catastrophisque des conflits internationaux ».
Le vrai problème, pour Sorel, n'est donc pas tant de « trouver des préceptes ou même des exemples, mais de mettre en action des forces capables de rendre la conduite conforme aux préceptes et aux exemples » (introduction au Système historique de Renan). « Sorel, écrit Jules Monnerot, cherche la source collective, donc individuelle (il admet intuitivement et implicitement l'immanence réciproque du social et de l'individuel), des motivations psychologiques qui sont invincibles à un moment historique donné, invincibles dans l'événement ». Considérant qu'il y a un lien, dans toute collectivité, entre la qualité des actes et l'intensité des croyances, Sorel, au contraire de Pareto, ne voit pas dans ces croyances un résidu irrationnel dont il faudrait se débarrasser, mais au contraire un moteur que l'on doit rechercher.
Il étudie alors les conditions propres à faire naître l'enthousiasme collectif. Il aspire au sublime : « Il n'est pas de borne assignable à l'intensité avec laquelle le sublime peut s'emparer de nous. Ce qui signifie qu'une fin est sublime quand, eu égard à cette fin, le risque suprême n'est pas pris en compte » (Monnerot). Il en résulte que la volonté de se dépasser soi-même est indissociable du refus d'un paradigme de sécurité, et qu'à l'inverse, la prédominance, au sein d'une société, des valeurs de sécurité garantit l'impossibilité d'un tel dépassement. La décadence commence là où le sublime est absent. Or, dit Sorel, la société européenne est ainsi faite qu'elle décline sitôt qu'elle ne se dépasse plus. Ce qui l'amène à identifier comme relevant d'un même phénomène historique l'avènement du scientisme, la mort du sacré et la disparition des aristocraties liées au peuple : « Le sublime est mort dans la bourgeoisie. »
L’apologie de la violence, entendue comme force politique destructive d’un ordre social, est seule à même de remédier à la décadence des mœurs. Cette violence, que condamne la démocratie qui s’efforce de l’éliminer, ne peut naître pour Sorel à son époque que du conflit ouvert entre un prolétariat révolutionnaire, armée de l’idée-mythe de la grève générale, et une bourgeoisie à laquelle cette lutte redonnera peut-être son ancienne énergie. La critique du compromis démocratique et parlementaire, qui ne tend vers aucune conclusion politique précise, aura une action souterraine profonde en ce qu’elle inspirera le bolchevisme de Lénine et le fascisme de Mussolini. Les esprits les plus réactionnaires comme les plus révolutionnaires peuvent se réclamer de Sorel : mais son opposition au libéralisme démocratique est irréductible. De plus, Sorel n’est soucieux que du sublime et de l’existence individuelle et n’a cure d’allégeance à l’autorité de l’État, produit néfaste de l’idéologie bourgeoise (“statolâtrie”) et “grande machine” haïssable. Nulle idéologie de l’Etat donc chez ce penseur visant au fonds à faire l’improbable synthèse, plus ou moins hégélienne, du marxisme et du proudhonisme.
La réception de Sorel va par-delà ces visissitudes historiques. Significatif à cet égard est l'ouvrage de Michel Charzat, G. Sorel et la révolution au XXe siècle (Hachette, 1977), que l'on peut comparer utilement au grand livre de Michael Freund, G. Sorel, der revolutionäre Konservatismus (Klostermann, Frankfurt/M., 1932 et 1972). Cette ambiguïté, qui n'en est pas une, est révélatrice. Elle confirme que Georges Sorel, précurseur du socialisme français, tout en étant l'adepte de ces qualités aristocratiques et militaires qu'il nomme les “vertus quiritaires”, est probablement le plus grand théoricien politique français depuis la fin du XIXe siècle. Nos apprentis anarques puiseront là matière à œuvrer.

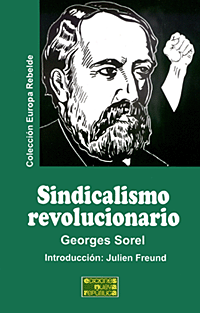 ◘ UNE INTERPRÉTATION DE GEORGES SOREL
◘ UNE INTERPRÉTATION DE GEORGES SOREL
On aurait pu s'attendre de nos jours à une sorte de résurrection, ou du moins à une redécouverte, de Georges Sorel, encore que ses principaux ouvrages continuent d'être lus. En effet, différents aspects de sa pensée auraient dû séduire ceux qui se considèrent actuellement comme les porteurs d'une pensée radicale. À une époque où l'on ne cesse de justifier la violence, son apologie de la violence aurait dû lui valoir le plus grand succès. À une époque où l'on méprise l'histoire pour exalter l'utopie, sa théorie du mythe aurait dû lui valoir la plus grande considération de la part des jeunes lecteurs. À une époque enfin où l'on préconise l'anarchisme, le refus de l'autorité, sa conception de l'anarcho-syndicalisme aurait dû lui attirer les plus grandes sympathies. De plus, n'est-il pas, comme la plupart des leaders actuels des mouvements gauchistes, un bourgeois qui s'est mis au service du prolétariat ouvrier ? Or, en dépit de tous ces aspects de sa pensée qui auraient dû lui valoir une nouvelle faveur, Sorel reste pour ainsi dire un méconnu à notre époque, et parfois il est même rejeté par les théoriciens du gauchisme en vogue. Ce sont Marx et Freud qui apparaissent principalement comme les références des contestataires. S'agit-il d'un paradoxe ? Ou bien y a-t-il dans les écrits de Sorel d'autres aspects qui gênent et peut-être même rebutent les tenants d'une idéologie qui, à de nombreux égards, est pourtant proche de ses analyses ?
C'est à cette question que je voudrais répondre au cours de cet exposé qui essaiera de tenir compte à la fois de la personnalité et de l'œuvre de Sorel, sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui une biographie intellectuelle. La philosophie de Sorel est au fond plus déconcertante qu'originale : tantôt il dissocie des notions qu'on a l'habitude de rassembler, tantôt il en associe d'autres que d'ordinaire on sépare. À force de jouer avec les contraires, il en est arrivé à être souvent le contraire de lui-même. Tour à tour il a défendu des conceptions qu'il avait rejetées, et critiqué celles qu'il avait à un moment donné approuvées. On peut donc se demander à bon droit s'il y a effectivement une doctrine sorélienne. En général, quand Sorel prenait parti, il le faisait sans nuances. On comprend que, dans ces conditions, des courants de pensée diamétralement opposés peuvent de nos jours se réclamer de lui, aussi bien les révolutionnaires que les conservateurs.
Au fil des années, et souvent en même temps, il a allié une même admiration pour des auteurs ou des acteurs politiques aux vues nettement divergentes. Au début de sa carrière d'écrivain, il manifestait une même sympathie pour Tocqueville et Proudhon, pour Renan et Le Play. Par la suite, en même temps qu'il s'enthousiasmait pour Karl Marx, il s'engouait pour Bergson. Il aimait Taine et Nietzsche. Il préférait parmi les socialistes Guesde à Jaurès, mais également Eduard Bernstein à Kautsky. Il exaltait l'action anarcho-syndicaliste de Pelloutier, mais il avait aussi des accointances avec Georges Valois et l'Action française.
À la fin de sa vie — il est mort en 1922 —, il s'est enflammé à la fois pour la révolution soviétique et Lénine, et pour le mouvement fasciste et Mussolini. On pourrait prolonger la liste de ces contrastes. En Italie, par ex., son amitié allait aussi bien au marxiste Labriola qu'au sociologue Pareto et au philosophe Benedetto Croce. On ne saurait donc s'étonner si un certain nombre d'interprètes ou de commentateurs de son œuvre en apprécient telle partie et passent sous silence telle autre. Je ne mentionnerai qu'un exemple typique, celui de G. Goriély, l'auteur du Pluralisme dramatique de Georges Sorel (1962). Celui-ci considère essentiellement la période socialiste de Sorel et arrête son analyse aux Réflexions sur la violence, en négligeant ainsi le rapprochement avec l'Action française et l'apologie de Lénine, sous prétexte qu' « il s'y rencontre tant de bizarres et même absurdes fixations passionnelles, que seul un dépit devenu inexorable peut expliquer un accès subit d'antisémitisme, un enthousiasme curieusement déchaîné par la guerre... Plutôt que de communiquer au lecteur l'irritation, l'ennui ou le découragement éprouvés au contact de certains textes, nous avons préféré arrêter aux Réflexions sur la violence le détail de nos analyses. »
trois options fondamentales
Sorel fut un être plein de contrastes : c'est comme tel qu'il faut le comprendre. Sans doute chaque interprète est-il libre de préférer, au nom d'un parti-pris arbitraire et subjectif, tel aspect de son œuvre plutôt que tel autre ; il n'effacera pas pour autant l'ambiguïté de ses positions ni les incompatibilités de certains de ses écrits.
Le fait historique est, par ex., que Sorel fut pendant un certain temps un adepte du marxisme révolutionnaire et son introducteur en France et en Italie contre les tendances parlementaristes de la sociale-démocratie, sans s'indigner cependant contre l'opportunisme de Millerand, qui accepta de faire partie du ministère bourgeois de Waldeck-Rousseau, et que par après il adopta une position qu'on peut qualifier de révisionniste, dans son ouvrage La décomposition du marxisme, au point de faire la critique la plus sévère du fondement même du marxisme, en tout cas du Capital, à savoir la théorie de la plus-value.
Il fut l'ami de Péguy et comme lui il magnifia la grandeur de la mystique, mais il fit également connaître en France William James et son pragmatisme. On n'en finirait pas d'énumérer les disparités et les inconséquences de ses attitudes et de ses opinions. Et pourtant, malgré ces flottements et ces équivoques, on rencontre à travers toute son œuvre un certain nombre de constantes et de positions sur lesquelles il n'a jamais transigé. C'est à la lumière de ces quelques idées de base, qu'on retrouve dans tous ses écrits, qu'il faut saisir ce qu'on peut appeler ses variations. Elles se laissent réduire à trois options fondamentales.
La première de ces constantes est l'antidémocratisme. On peut le suivre à la trace depuis ses premiers écrits, comme La mort de Socrate, jusqu'aux derniers, comme le Pour Lénine. On ne saurait cependant le ranger parmi les adeptes de la dictature, car s'il a cru pendant quelque temps à la dictature du prolétariat, lorsqu'il découvrit l'œuvre de Marx, très rapidement son libéralisme anarchiste et sa conception pluraliste du monde reprirent le dessus. À son avis, les chefs de la dictature du prolétariat finiront par tomber dans l'ornière commune : ils diviseront la société « en maîtres et en asservis » ; comme tous les politiciens, ils essaieront de profiter des avantages acquis, et au nom du prolétariat ils établiront « l'état de siège dans la société conquise » (1).
Sorel ne croit ni à la démocratie parlementaire, refuge du charlatanisme politique, de la démagogie d'épiciers et de l'hypocrisie des intellectuels, ni à la démocratie socialiste, qui risque d'être pire que la démocratie parlementaire, parce qu'elle est capable d'entraîner les masses dans la servitude, sous la bannière d'idéaux comme l'égalité ou le gouvernement par l'ensemble des citoyens, fiction qui est « le dernier mot de la science démocratique » (L'avenir socialiste des syndicats). Il n'a pas davantage confiance dans une démocratie syndicale, car il est probable qu'elle deviendrait étatiste comme n'importe quelle autre forme de démocratie. Aussi n'a-t-il que mépris pour les divers courants qui, à son époque, ont essayé de proposer des solutions de réforme de la démocratie, tels le solidarisme de Léon Bourgeois ou le coopératisme de l'économiste Charles Gide.
On comprend aisément dans ces conditions les variations dans ses sympathies, qui allaient à des doctrines aussi opposées que le bolchevisme, le fascisme ou l'Action française, et à des hommes aussi divergents que Pelloutier, Lénine et Mussolini. Ce qui l'intéressait dans tous ces cas, c'est qu'on y menait une action extra-parlementaire proche de l'antidémocratisme qui l'animait lui-même. C'est pour les mêmes raisons qu'il a été l'ami du sociologue Pareto, autre libéral antidémocrate, qu'il a pris parti pour Guesde contre Jaurès, estimant que le premier était plus libéral et plus tolérant que le second, en dépit des apparences. Il lui importait peu qu'un homme fût classé politiquement à gauche ou à droite, il méritait une considération particulière du moment qu'il était un antidémocrate !
Comment expliquer cet antidémocratisme ? Il me semble qu'il faille le mettre directement en relation avec 2 autres aspects de sa pensée, tout aussi permanents. Tout d'abord sa conception de l'ouvrier et du devenir du prolétariat. Sorel ne croit ni au capitalisme universel ni au prolétariat universel, puisqu'il s'agit de figures historiques qui, comme telles, n'ont rien d'absolu. Ce ne sont que des spéculations d'intellectuels qui raisonnent dans l'abstrait, au sens où l'intellectuel moderne se donne « la profession de penser pour le prolétariat » (RSF).
Il négocie ainsi à son profit la notion de conscience de classe. Du fait que l'intellectuel est en marge de la production, il entend résoudre abstraitement et a priori les problèmes de la répartition — donc du profit — indépendamment des conditions concrètes et de l'évolution de la production. Qu'on le veuille ou non, le capitalisme a introduit dans notre univers le phénomène de la productivité, sans lequel le socialisme perd toute signification. Le socialisme n'est pas né de lui-même ; il est une conséquence du mode de production capitaliste. L'économie restera prisonnière pour un temps historiquement indéterminable de cette orientation.
Par conséquent, le socialisme reste tributaire du capitalisme, en dépit des utopies socialistes qui veulent résoudre abstraitement le problème de la répartition, indépendamment des conditions concrètes de la production. En tout cas, ce n'est pas en inversant simplement les conditions historiques du capitalisme qu'on parviendra à rendre crédible le socialisme. Il faut vivre, ce qui signifie qu'il faut produire. La technique ne saurait remplacer en tout la volonté humaine. De même que le compagnonnage fut l'organisation des producteurs dans un système économique déterminé, le syndicat est l'organisation typique d'un autre système économique, à la fois capitaliste et socialiste. L'important est de comprendre les possibilités que le syndicalisme offre à la classe ouvrière. Tout le reste n'est que de la politique, dont se gave la rhétorique révolutionnaire qui s'apitoie sur les misères et contradictions engendrées par le capitalisme. Si le socialisme se complaît dans ce sentimentalisme et l'utopie de la répartition, il ne pourra que sombrer dans d'autres misères et d'autres contradictions.
Le rôle du syndicat est de faire valoir les droits des producteurs. C'est là le sens du combat de Sorel. C'est en assumant pleinement sa situation de producteur que l'ouvrier deviendra aussi un véritable combattant. « Sans cette création capitaliste de la matière d'un monde nouveau, le socialisme devient une folle rêverie » (Le système historique de Renan). Seul celui-là deviendra un bon combattant dans la lutte sociale qui sera un bon ouvrier. Celui qui sabote son métier sabotera également le syndicat et le socialisme. Avec des ouvriers qui ne cherchent qu'à jouir dans un nouveau système de répartition, on ne mènera pas une lutte sociale efficace. C'est pourquoi Sorel refuse l'utopie égalitaire, parce que la lutte est fondée par principe sur l'inégalité. L'ouvrier ne parviendra à conquérir ses droits de producteur que s'il devient un bon ouvrier, à l'image du soldat de Napoléon qui a participé à la gloire, parce qu'il fut un bon grognard. Autrement dit, avec des ouvriers mous, on ne peut faire qu'une révolution molle. La démocratie est le régime qui, sous les prétextes d'une répartition idéale, habitue les ouvriers à renoncer à la lutte pour la mollesse.
Au fond, Sorel a appliqué au socialisme une idée qu'on trouve déjà dans ses premiers écrits, alors qu'il n'avait pas encore découvert le socialisme. Citons ce passage de La mort de Socrate, à propos de la démocratie : « De tous les gouvernements, le plus mauvais est celui où la richesse et les capacités se partagent le pouvoir. Les préjugés de la plupart de nos historiens contre la noblesse leur ont fait fermer les yeux sur les vices des constitutions ploutocratiques. Dans ce régime, l'orgueil de la race n'existe plus : il faut arriver et, une fois la timbale décrochée, peu de gens s'occupent des moyens employés. Le succès justifie tout ; pas une idée morale ; c'est l'idéal des Anglais. Le vice de ce gouvernement repose sur l'application du principe de l'échange : les hommes ne comptent pas ; il n'y a que des valeurs en présence. La prédominance des idées économiques a donc non seulement pour effet d'obscurcir la loi morale, mais aussi de corrompre les principes politiques. »
Devenu socialiste, Sorel répétera la même idée. C'est ainsi qu'il écrira :
« La démocratie constitue un danger pour l'avenir du prolétariat, dès qu'elle occupe le premier rang dans les préoccupations ouvrières ; car la démocratie mêle les classes et, par suite, tend à faire considérer les idées de métier comme étant indignes d'occuper l'homme éclairé » (Introduction à l'économie moderne).
Par conséquent, la démocratisation affaiblit la lutte de classes, et elle fait perdre à l'ouvrier le sens de son métier et de son statut de producteur et de créateur. Aussi, « le grand danger qui menace le syndicalisme serait toute tentative d'imiter la démocratie ; il vaut mieux, pour lui, savoir se contenter, pendant un certain temps, d'organisations faibles et chaotiques, que de tomber sous la domination des syndicats qui copieraient les formes politiques de la bourgeoisie » (RSF).
le règne de la médiocrité
En second lieu, il faut mettre cet antidémocratisme de Sorel en relation avec ses vues sur la décadence. Le phénomène de la décadence n'a cessé de préoccuper Sorel. On peut même considérer, suivant la suggestion de Pierre Cauvin, que les principales œuvres de Sorel se préoccupent d'un problème de décadence. Le système historique de Renan a pour objet la décadence du judaïsme et l'avènement du christianisme ; Le procès de Socrate s'interroge sur le déclin du monde grec ; La ruine du monde antique pose le problème de la décadence de Rome ; Les illusions du progrès posent la question du déclin de la bourgeoisie ; les Réflexions sur la violence et La décomposition du marxisme (2) s'attaquent à un problème moderne, celui de la dégénérescence de la sociale-démocratie et de la révolution prolétarienne. À bien considérer les choses, la démocratie est pour Sorel le régime qui accélère le processus de décrépitude d'une civilisation.
Encore faut-il ne pas se méprendre sur le sens qu'il donne à la notion de décadence. Elle peut susciter des hommes et des mouvements d'exception au même titre que l'ascension d'un peuple vers son apogée. La montée comme la descente donnent lieu à des luttes, mais en des sens différents. La lutte dans la phase ascendante ignore l'égalité et la démocratie, du fait que des élites rivalisent pour promouvoir dans un contexte de puissance le but indéterminé d'une nation ou d'un continent. Dans la phase décadente, on se bat pour la répartition, c'est-à-dire pour l'égalité sous tous les points de vue. C'est le combat pour la jouissance et la répartition des biens acquis. Certes, la phase ascendante peut commencer par l'idée égalitaire et communautaire, à l'exemple de la communauté des premiers chrétiens, mais très rapidement elle fait triompher le principe de la hiérarchie. La phase décadente, au contraire, invoque l'idéal démocratique qui renonce à la création et à la production pour la jouissance d'un profit immédiat. On pourrait dire que chacun veut s'émanciper en sacrifiant la liberté. C'est le sens de la citation que Sorel fait du livre d'Amédée Thierry sur Alaric, le barbare qui avait saccagé Rome au début du Ve siècle : « Des étrangers ont été salués d'amis et de libérateurs... Ils avaient égorgé nos soldats, brisé notre drapeau, amoindri et humilié la France ; et nous avons proclamé, jusqu'à la tribune nationale, qu'ils étaient plus Français que nous » (La ruine du monde antique).
En vertu de son principe, la démocratie en arrive à proclamer non seulement l'égalité entre les citoyens d'un même peuple, mais aussi l'égalité entre les peuples, de sorte qu'elle conduit à la ruine une nation ou une classe, en raison d'une clémence inconsidérée, parce qu'elle prétend à l'universalité. « Je doute, écrit Sorel, que les grands prôneurs de l'évolutionnisme social sachent parfaitement de quoi ils veulent parler » (Introduction à l'économie moderne). Il serait trop long d'analyser ici un des ouvrages fondamentaux de Sorel, Les illusions du progrès (Rivière, 1908), qui met justement en question les possibilités d'une libération humaine par les voies de la démocratie.
Que signifie la décadence pour Sorel ? Le règne de la médiocrité. En général l'humanité se complaît dans la médiocrité, et elle n'en sort périodiquement que sous l'action d'un grand personnage ou d'un mouvement puissant qui donne aux hommes l'occasion de se dépasser et de s'élever au sublime. D'où son admiration pour les hommes d'exception, comme Napoléon, mais aussi Pelloutier, Mussolini, Lénine. La grève générale peut être un de ces mouvements puissants qui arrachera l'ouvrier à l'anonymat de la masse et lui permettra de retrouver son individualité dans le feu de l'action. Parlant des guerres de liberté de la Révolution française, où chaque soldat se considérait comme un personnage qui apportait quelque chose d'essentiel dans la bataille, Sorel continue :
« Le même esprit se retrouve dans les groupes ouvriers qui sont passionnés pour la grève générale ; ces groupes se représentent, en effet, la révolution comme un immense soulèvement qu'on peut encore qualifier d'individualiste : chacun marchant avec le plus d'ardeur possible, opérant pour son compte, ne se préoccupant guère de subordonner sa conduite à un grand plan d'ensemble savamment combiné » (RSF).
La démocratie est un régime décadent parce qu'elle flatte la tendance à la médiocrité, en brisant les élans de l'homme et en le détournant des actions sublimes.
une continuelle création
La seconde constante de l'œuvre de Sorel est son anti-scientisme. Cela ne veut pas dire que Sorel négligeait la science ou qu'il la dépréciait. Sa première éducation fut scientifique, puisqu'il fut élève de l'école Polytechnique et que, par la suite, il fit une carrière d'ingénieur des Ponts et Chaussées. Il a même consacré plusieurs ouvrages au problème de la science, pour en comprendre les mécanismes, pour la situer dans l'ordre général de la connaissance (3). Ce qu'il refusait, c'est ce qu'avec Péguy il appelait la « petite science », c'est-à-dire les constructions imaginaires à prétention scientifique, mais sans aucune base sérieuse. À la différence de beaucoup d'esprits de son époque, il ne voyait pas dans la science l'activité déterminante qui régénérerait l'humanité, parce qu'elle permettrait de résoudre tous les problèmes, aussi bien ceux de la paix que de la justice ou de la liberté, ou encore du bonheur. Ces problèmes n'ont de sens que dans l'action pratique et quotidienne, au prix de luttes et de conflits. À vouloir les résoudre par la connaissance, on s'égare dans les utopies.
« Le monde, disait Sorel, marche en dépit des théoriciens. » Il faisait une distinction nette entre les problèmes que la connaissance et la science peuvent résoudre et ceux qui relèvent de l'action, car, dans ce dernier cas, les solutions apportées sont perpétuellement provisoires, du fait que les données changent avec chaque génération ; ils font donc l'objet d'une continuelle création, non sans passion. Sorel écrivait dans un article de la Revue de métaphysique et de morale, en 1911 : « Ce qu'il y a de vraiment fondamental dans tout devenir, c'est l'état de tension passionnée que l'on rencontre dans les âmes » (cité par Goriély, op. cit., p. 156). On comprend sans peine pourquoi il a tant admiré Bergson, philosophe de la vie créatrice.
Cet anti-scientisme explique un certain nombre d'attitudes et de prises de position de Sorel. Tout d'abord, il refuse de voir dans les progrès de la science la condition d'un progrès de l'humanité. Aussi est-il opposé aux théories évolutionnistes en matière sociale : « L'évolutionnisme social n'est qu'une caricature de la science naturelle. » Il fut également un farouche adversaire du modernisme, c'est-à-dire de la tendance de certains exégètes catholiques de son époque à expliquer la religion par la science. Sorel fut sans aucun doute un anti-clérical. S'il lui arrivait de polémiquer contre certaines décisions de l'Église, en particulier contre la politique du pape Léon XIII, exprimée dans l'encyclique Rerum novarum, il ne manifestait aucun mépris pour la religion, sachant souligner les mérites de l'Église dans certaines occasions, appréciant l'importance de la mystique. Ce n'est cependant pas le lieu de faire une analyse des nombreuses études de Sorel sur le phénomène religieux.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'acceptait pas le primat qu'on accordait à son époque à la science, dans les domaines qui échappent à sa juridiction. C'est pour cette raison que, malgré la vénération qu'il portait à Marx, il n'a pas pu supporter certaines de ses prétentions scientistes. Il a non seulement émis des réserves à propos du socialisme scientifique d'Engels, mais aussi à propos du matérialisme historique. Dans une lettre à Benedetto Croce, du 19 octobre 1900, il écrit :
« Au fond, le matérialisme historique ne serait-il pas une des lubies d'Engels ? Marx aurait indiqué une voie, Engels aurait prétendu transformer cette indication en théorie, et il l'a fait avec le dogmatisme pédant et parfois burlesque de l'écolier ; puis est venu Bebel, qui a élevé la cuistrerie à la hauteur d'un principe » (4).
Il considérait également comme scientiste le fait d'expliquer en dernière analyse tous les phénomènes sociaux par l'économie ; aussi a-t-il rejeté l'idée que le développement de la production, aidé par les progrès de la technique, pourrait un jour résoudre les contradictions humaines.
Sorel fut l'un des rares esprits de son temps à ne pas condamner la métaphysique, précisément parce qu'elle pose des questions inévitables, qui ne sont pas du ressort de la science. C'est une illusion de croire que la science pourrait supplanter la métaphysique. Au contraire, l'interrogation métaphysique reste fondamentale, même en ce qui concerne la réflexion sur la science. Aussi Sorel n'a-t-il pas hésité à parler du « jugement souverain de la métaphysique » (Questions de morale). Évidemment, il ne pouvait de ce fait qu'être un adversaire du positivisme, en particulier sous la forme qu'a développée Durkheim. Il refusait catégoriquement la validité d'une sociologie qui se construirait sur le modèle des sciences de la nature.
On lui a reproché son antirationalisme. Une chose est certaine : il fut un adversaire farouche de l'intellectualisme, qui n'est qu'une forme dérivée du scientisme. Son commerce avec Bergson ne pouvait que confirmer cette orientation. Rappelons seulement la définition qu'il a donnée de l'intellectuel :
« Les intellectuels ne sont pas, comme on le dit souvent, des hommes qui pensent : ce sont les gens qui font profession de penser et qui prélèvent un salaire aristocratique en raison de la noblesse de cette profession » (RSF).
Sous prétexte de changer le monde, ils ne savent que construire des utopies. Sorel, le théoricien du mythe, était farouchement hostile à l'utopie, qui n'est qu'une représentation artificielle. Le mythe, par contre, est « au fond identique aux convictions d'un groupe », il est « l'expression de ces convictions en langage de mouvement » (ibid.). Une révolution qui veut se faire au nom des utopies d'intellectuels est d'avance vouée à l'échec, parce que l'utopie n'engendre pas l'héroïsme indispensable à une telle entreprise.
Si l'on a qualifié Sorel d'anti-rationaliste, c'est principalement à cause de sa théorie du mythe et de son apologie de la violence. Que faut-il en penser ? En bon disciple de Renan et de Taine, il n'a jamais nié le rôle déterminant de la raison dans le développement de l'humanité. N'a-t-il pas écrit : « Si l'homme perd quelque chose de sa confiance dans la certitude scientifique, il perd en même temps beaucoup de sa confiance dans la certitude morale » (QM). Une pareille phrase — et l'on pourrait en citer d'autres — ne saurait sortir de la plume d'un adversaire de la raison. Mais reconnaître la part de la raison ne signifie pas qu'il faille souscrire aux excès du rationalisme. Les attaques de Sorel sont justement dirigées contre le rationalisme idéaliste du scientisme et du positivisme, qui cherche à réduire le réel à un simple processus rationnel. D'où par ex. son hostilité au protestantisme libéral, qui ne voit dans la religion qu'un simple acte de raison.
D'autres valeurs que purement rationnelles sont en jeu dans l'existence, et à les nier on précipite l'être humain dans la détresse de la médiocrité et de la décadence. Que nous le voulions ou non, l'homme est également animé par des forces irrationnelles, ou du moins non rationnelles, et il faut leur faire une place dans la vie. Elles sont à la base de l'héroïsme, du sublime, de la gloire, mais aussi du dévouement, de l'esprit de sacrifice, notions sans lesquelles la morale n'est que du verbiage. Il y a en l'homme un besoin de mystique, comme aussi de renoncement et d'ascèse. Ce n'est pas glorifier le pur instinct que de reconnaître ces besoins. Et Sorel de préciser, dans ses RSF :
« Je n'ai jamais eu pour la haine créatrice l'admiration que lui a vouée Jaurès ; je ne ressens point pour les guillotineurs les mêmes indulgences que lui ; j'ai horreur de toute mesure qui frappe le vaincu sous un déguisement judiciaire. La guerre faite au grand jour, sans aucune atténuation hypocrite, en vue de la ruine d'un ennemi irréconciliable, exclut toutes les abominations qui ont déshonoré la révolution bourgeoise du XVIIIe siècle. »
C'est Jaurès qui passe pour un bon démocrate socialiste, dévoué à l'idéal rationaliste et à la paix, et pourtant, dans son histoire de la Révolution française, il n'hésite pas à faire l'éloge des terroristes qui agissaient en dehors de « l'immédiate tendresse humaine et de la pitié ». Si Sorel préconise la violence, ce n'est pas la violence nue et irréfléchie, ni surtout la terreur. Le fait même qu'il voyait dans l'ouvrier avant tout un producteur, qui se bat par respect pour son travail, exclut l'appel à une violence qui ne serait que simple sabotage.
C'est en analysant la troisième constante de la pensée de Sorel qu'il sera possible de mieux comprendre ce que ce dernier entendait par “violence”. Cette troisième constante consiste dans la priorité donnée par Sorel à l'éthique. Les titres des chapitres des RSF sont déjà suggestifs à cet égard : La moralité de la violence ou La morale des producteurs. Si Sorel a voué une si grande admiration au prolétariat, c'est parce qu'il croyait y trouver, non sans une certaine illusion — il l'avoua à la fin de sa vie —, les vertus de courage, d'énergie et d'héroïsme, dont la bourgeoisie avait fait preuve durant son ascension. S'il est devenu socialiste, ce ne fut point par sentimentalisme ou pour suivre une mode, mais par une décision lucide, parce qu'il pensait que le socialisme était la doctrine qui permettrait d'échapper à la dégénérescence morale qui affecte la société. La bourgeoisie ne fait preuve que de lâcheté et de poltronnerie, et l'on « pourrait se demander, écrit-il, si toute la haute morale des grands penseurs contemporains ne serait pas fondée sur une dégradation du sentiment de l'honneur. »
seul le sublime est moral
S'il condamne la démocratie, c'est pour des raisons plus morales que politiques : elle est un facteur de dissolution des mœurs à cause de l'humanitarisme dont elle se réclame. Elle se fait le champion du pacifisme et tend ainsi à amollir les âmes, mais elle devient cruelle et brutale, au-delà de toute violence, à la manière des lâches, dès qu'elle est mise en danger. À force de dégrader le sentiment de noblesse et de courage, elle en arrive à démoraliser les êtres, du fait même qu'elle finit par discréditer le travail. Avant même de devenir socialiste, Sorel condamnait déjà l'oisiveté dans La mort de Socrate, un de ses premiers ouvrages : « Dans les classes sociales qui ne travaillent pas, dans celles notamment qui, à la mode athénienne, vivent du pouvoir, la démoralisation est extrême. »
La déconsidération du travail, c'est-à-dire de la production, de la création et de l'énergie, constitue à ses yeux une profanation de la dignité de l'homme, car elle finit par l'installer dans une sorte de servitude spirituelle. L'homme ne vaut que par l'effort et la lutte, la lutte des classes étant de nos jours le moment vivant qui doit lui permettre de renouer avec les traditions de l'héroïsme, de la générosité et des formes chevaleresques d'autrefois. Les hautes convictions morales, écrit Sorel, « dépendent d'un état de guerre auquel les hommes acceptent de participer et qui se traduit en mythes précis. Dans les pays catholiques, les moines soutiennent le combat contre le prince du mal qui triomphe dans le monde et voudrait les soumettre à ses volontés ; dans les pays protestants, de petites sectes exaltées jouent le rôle de monastères. Ce sont des champs de bataille qui permettent à la morale chrétienne de se maintenir, avec ce caractère de sublime qui fascine tant d'âmes encore aujourd'hui, et lui donne assez de lustre pour entraîner dans la société quelques pâles imitations » (RSF). Le héros moral, on le trouve chez Homère, chez les soldats des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Il peut resurgir chez l'ouvrier utilisant la violence morale dans la grève générale. Seule le sublime est finalement moral, ainsi que Sorel le suggère par ses attaques contre la bourgeoisie défaillante : « Le sublime est mort dans la bourgeoisie et celle-ci est donc condamnée à ne plus avoir de morale. »
L'éthique pénètre toute sa conception du socialisme. Ce n'est pas uniquement par opposition à la démocratie parlementaire qu'il vitupère le socialisme politique de Jaurès, mais aussi à cause de sa faiblesse morale. « En dernière analyse, écrit-il, le socialisme est une métaphysique des mœurs » (Le pragmatisme in Bulletin de la Société française de philosophie, 1907, p. 103). Il n'est nullement une école du bonheur, mais une conduite de la vie, une manière de retrouver le sens de l'honneur, de la noblesse d'âme, de l’héroïsme et du sublime (termes qui reviennent sans cesse sous sa plume), dans une vie passionnante de luttes. « Ce qu'on appelle le but final n'existe que pour notre vie intérieure (..) il n'est pas en dehors de nous ; il est dans notre propre cœur » (L'éthique du socialisme in RMM, 1899, p. 297). Cette éthique, Sorel la conçoit selon le schéma classique de la pureté des mœurs et des vertus domestiques, sous la forme d'une morale sexuelle, d'une morale de la famille et d'une morale du travail. Dans la préface à l'édition française de l'ouvrage de Coleijanni, Le socialisme (Giard et Briére, 1900), il n'hésite pas à préciser sa pensée, quitte à choquer les avant-gardistes : « Nous pouvons affirmer que le monde ne deviendra plus juste que dans la mesure où il deviendra plus chaste. »
La lutte des classes, et plus spécialement le mythe de la grève générale, constituent un genre d'entreprises propices à la régénération morale, car les âmes peuvent s'y raffermir à l'image des héros de l'âge homérique ou de l'âge napoléonien. On commettrait un lourd contresens, si on interprétait la notion de grève générale de Sorel dans un sens politique. Rien n'est plus contraire à ses intentions, ainsi qu'il le précise dans le chapitre V des RSF. Une grève politique ne peut que se plier aux lois de la politique, ce qui exige une centralisation des syndicats pour peser sur le rapport des forces à l'intérieur de l'État, une soumission à la volonté des dirigeants des partis et la procédure des négociations et des compromis.
Aussi Sorel est-il l'adversaire déclaré de la démocratisation syndicale, qui n'est qu'une autre manière de les politiser. Il ne s'agit pas d’instaurer un autre équilibre au sein de l'État ni de modifier le régime. Le but de la grève générale est social, ce qui signifie pour Sorel une rééducation morale de l'homme par une transformation radicale de la société. Le problème n'est donc pas de conquérir l'État ou de préparer cette conquête, mais de tracer une voie nouvelle pour l'avenir, sous la catégorie de la « catastrophe totale » (RSF). Pour Sorel, la notion de catastrophe a la valeur d'une idée régulatrice de l'action humaine en ce sens qu'elle doit aider à ramasser les énergies. Les collectivités sont comme attirées par la décadence, ce qui veut dire que le désordre général entraîne la dissolution des mœurs, la paresse, la veulerie et la médiocrité. La violence est l'instance chaotique qui permet à l'homme de se redresser.
Sorel conçoit donc la violence comme un instrument de l'éthique, qui donne au socialisme « une valeur morale si haute et une si grande loyauté ». Il ne faut pas la confondre avec la brutalité bestiale, ni avec la rage destructrice, ni avec la haine aveugle : elle est l'expression d'une volonté consciente des prolétaires qui traduisent leurs idées en actes. « Il ne s'agit pas ici de justifier les violents mais de savoir quel rôle appartient à la violence des masses ouvrières dans le socialisme contemporain ». Ce rôle, il le définit en termes militaires, et non en termes diplomatiques. Sans cesse, il revient à l'acte belliqueux, pour donner une image de l'action révolutionnaire de la grève générale. D’où son mépris pour le socialisme diplomatique, fondé sur la ruse et les compromissions. La violence qu'il préconise est celle de l'audace du soldat, capable de se sacrifier au service de la collectivité et de sa transformation éthique.
Si jamais le révolutionnaire n'était pas capable de l'audace décrite dans les épopées, il vaudrait mieux tirer un trait sur la révolution. C'est parce qu'il avait le sens de la décadence que Sorel ne fut jamais nihiliste. Aussi condamne-t-il le terrorisme, qui n'est que lâcheté dans l'anonymat. Ce n'est que dans l'acte militaire que l’être humain a quelque chance de se dépasser.
On reproche à Sorel son pessimisme, mais en réalité il est l'homme qui fait confiance à l'homme. Parlant du prolétariat, il déclare :
« Tout peut être sauvé si, par la violence, il parvient à reconsolider la division en classes et à rendre à la bourgeoisie quelque chose de son énergie ; c'est là le grand but vers lequel doit être dirigée toute la pensée des hommes qui ne sont pas hypnotisés par les événements du jour, mais qui songent aux conditions du lendemain. La violence prolétarienne, exercée comme une manifestation pure et simple du sentiment de lutte des classes, apparaît ainsi comme une chose très belle et très héroïque ; elle est au service des intérêts primordiaux de la civilisation ; elle n'est peut-être pas la méthode la plus appropriée pour obtenir des avantages matériels immédiats, mais elle peut sauver le monde de la barbarie. À ceux qui accusent les syndicalistes d’être obtus et de grossiers personnages, nous avons le droit de demander compte de la décadence économique à laquelle ils travaillent. Saluons les révolutionnaires comme les Grecs saluèrent les héros spartiates qui défendirent les Thermopyles et contribuèrent à maintenir la lumières dans le monde antique. »
le “révolutionnaire conservateur”
Ce que Sorel veut dire au fond, c'est que la morale n'est pas, en dépit d'un préjugé religieusement contemporain, une affaire de niaiserie, de sentiment de culpabilité humanitariste, ni de pleurnicherie sur les vicissitudes humaines. Du moment qu'elle s'éprouve dans des actes, elle exige la force de caractère individuelle, le sens de la responsabilité et du courage collectif, justement parce qu'elle violente ainsi les excuses intellectuelles, qu'il appelle casuistiques et laxistes. D’où aussi son opposition à la philosophie des Lumières, qui n'a vu dans la violence qu'un acte de barbarie.
On comprend mieux ainsi l'acte de foi qui clôt les pages de la première éd. des RSF :
« Je m’arrête ici parce qu'il me semble que j'ai accompli la tâche que je m'étais imposée ; j'ai établi, en effet, que la violence prolétarienne a une tout autre signification historique que celle que lui attribuent les savants superficiels et les politiciens ; dans la ruine totale des institutions et des mœurs, il reste quelque chose de puissant, de neuf, d'intact, c'est ce qui constitue, à proprement parler, l'âme du prolétariat révolutionnaire ; et cela ne sera pas entraîné dans la déchéance générale des valeurs morales, si les travailleurs ont assez d'énergie pour barrer le chemin aux corrupteurs bourgeois, en répondant à leurs avances par la brutalité la plus intelligible... Le lien que j'avais signalé, au début de ces recherches, entre le socialisme et la violence prolétarienne, nous apparaît maintenant dans toute sa force. C'est à la violence que le socialisme doit les hautes valeurs morales par lesquelles il apporte le salut au monde moderne. »
Très rapidement, après la disparition de Pelloutier, l'âme du syndicalisme révolutionnaire, mort à l'âge de 34 ans, Sorel a senti que ses espoirs étaient ruinés. Le syndicalisme allait glisser désormais vers la politique. Désespérément, il a cherché une incarnation proche de ses conceptions dans l'Action française, dans le bolchevisme et dans le fascisme. Sa propre mort lui a épargné de nouvelles déceptions. J’espère cependant que le portrait intellectuel que j'ai essayé de tracer permet d'apporter des éléments de réponse à la question posée au départ. On pourra, certes, me reprocher de n'avoir abordé qu'incidemment et par allusion les grands thèmes de la pensée de Sorel : la violence, le mythe, la grève générale. Il ne m'a pas semblé utile d'exposer une fois de plus, de façon érudite, une doctrine qu'on pourra lire dans tous les manuels et traités documentés de science politique.
Mon propos vise uniquement à faire mieux comprendre ces thèmes connus en les mettant en rapport avec les convictions personnelles de Sorel et l'esprit de sa philosophie. Je pense que mon homonyme, Michael Freund, a trés bien résumé l'esprit de sa pensée, dans le titre de l'ouvrage qu'il lui a consacré : Der revolutionäre Konservatismus (Klostermann, Frankfurt/M., 1932). Ces 2 termes apparemment contradictoires de conservatisme et de révolution s'appliquent parfaitement à Sorel. Toutefois, pour ma propre gouverne, il faut leur donner une signification quelque peu différente de leur usage ordinaire. Parce que Sorel pose le problème de l'homme et de la société, comme on dit, en termes de décadence, sa véritable question ne peut être que celle de la survie. Nous avons tendance à tomber dans les illusions du progrès, du bonheur et du confort, et, brusquement, le développement même nous confronte au vieux problème de la survie, c'est-à-dire de la conservation de l’être. Sorel n'a guère songé au conservatisme politique, sinon accessoirement. La révolution qu'il préconisait doit être considérée, elle aussi, dans cette optique : elle est dans certaines conditions un moyen d'assurer la survie.
Nous l'avons dit, pour Sorel, le but final ne peut être qu'interne et personnel : il ne saurait être collectif. Il n'y a pas de bonheur collectif, du moment que l'homme est un être condamné à la lutte, donc en attente par désir de l'infini. L'avenir humain reste imprévisible et aucune doctrine intellectuelle ne peut le prédéterminer. Pour pouvoir affronter cet avenir inconnu, la condition élémentaire est celle de la conservation. Nous croyons dans les vertus de l'abondance ; celle-ci suscite d'autres raretés. Sorel n'aimait pas Descartes mais il aurait pu trouver chez lui une remarquable définition de la conservation : elle est, lit-on dans la 4ème méditation, une création perpétuelle. L'homme meurt et, par conséquent, ne se conserve plus dès que ses cellules ne se régénèrent plus. La question est de savoir si l'on peut appliquer ce processus à la vie des sociétés. Dans certaines conditions, la révolution est un moyen d'assurer la conservation. Est-elle le seul ? Sorel semble le croire. Il en arrive même à romantiser la révolution. En tout cas, c'est sur ce point que, à mon avis, devrait porter tout débat sur la philosophie de Sorel.
► Julien Freund, Nouvelle École n°35, 1979.
◘ Notes :
- Sur tous ces points, cf. entre autres les Réflexions sur la violence, nouvelle éd., Rivière, 1972, p. 214.
- Cf. Pierre Cauvin, La notion de décadence chez Oswald Spengler et Georges Sorel, thèse, Institut de sociologie de Strasbourg, 1971, p. 217.
- Not. L'ancienne et la nouvelle métaphysique, réédité sous le titre de D'Aristote à Marx (Rivière, 1935), Les préoccupations métaphysiques des physiciens modernes dans la Revue de métaphysique et de morale (1905), mais aussi des articles sur la géométrie, sur la cause en physique, etc.
- Cf. les lettres de Sorel à Croce, dans la revue Critica, 1927-1930.

◘ Lectures :
- Bibliographie (par A. de Benoist)
- Nouvelle École n°57 (2007)
- Les Cahiers du Cercle Proudhon n°1
- Les Racines du fascisme italien : Sorel et le sorelisme
- Bibliographie générale des droites françaises (Vol. 2)
- Naissance du mythe moderne (W. Gianinazzi, MSH, 2006). Étude sur le contexte et les enjeux de la réévaluation du mythe qui s'est produite au début du XXe siècle à travers l'œuvre du philosophe et sociologue G. Sorel. En étudiant la société de son temps, celui-ci s'est fait à la fois censeur et promoteur du mythe moderne. Nourri de ses lectures de Platon, Vico, Marx et Renan, il engagea le dialogue avec Bergson, Ribot, Le Bon et Durkheim. ♦ Les premières lignes, extrait de l'introduction Sous l'étoile d'André Gorz, prophète du présent : « Pour avoir été identifié comme le promoteur du mythe moderne au XXe s., G. Sorel (1847-1922) est un écrivain célèbre, mais maudit. Son destin de penseur politique aurait été probablement différent s'il avait choisi de porter au pinacle non pas le mythe, mais la catégorie jumelle de l'utopie qui, nonobstant les expérimentations vacillantes qui la ternirent au cours du XIXe s., conserve un meilleur crédit. Toujours est-il que sa réflexion reste stimulante par la persistance des questionnements qu'elle posa en rapport avec l'avènement de sociétés démocratiques de masse qui demeurent les nôtres par-delà les lugubres épisodes du XXe s. Mais la réputation de cet auteur est assurément sulfureuse. Le plus souvent, son œuvre a été jugée inclassable – tout comme son itinéraire a été perçu comme fluctuant pour ne pas dire contradictoire. C'est que, figure d'intellectuel atypique s'il en fut, cet autodidacte, publivore et polygraphe insatiable, s'échina à varier les angles d'attaque hors des sentiers battus. Aussi est-il répertorié comme un penseur autant libéral, au sens anti-démocratique du XIXe s., que révolutionnaire et anti-bourgeois, et à la fois proudhonien, marxiste et partisan du syndicalisme dit d'action directe. Pas seulement. Il est des parts d'ombre qu'une critique parfois rapide a peu éclairées quand elle ne les a pas projetées. On sait que, dreyfusard convaincu, Sorel laissa poindre, à mesure de sa déception pour la génération dreyfusienne, un antisémitisme à base anti-intellectuelle, quoique ni systématique ni embrigadé. On lui imputa aussi des connivences avec l'Action française vers les années 1909-1910, mais l'aversion partagée pour les mœurs parlementaires ne signifiait pas qu'il reconnaissait aux monarchistes d'autres solutions de rechange que celle apolitique de la régénération morale. »
