Spengler
Les matrices préhistoriques des civilisations antiques dans l'œuvre posthume de Spengler :
Atlantis, Kasch et Turan
 Généralement, les morphologies de cultures et de civilisations proposées par Spengler dans son ouvrage le plus célèbre, Le Déclin de l'Occident, sont les seules à être connues. Pourtant, ses positions ont changé après l'édition de cette somme. Le germaniste italien Domenico Conte en fait état dans son ouvrage récent sur Spengler [Catene di civiltà : Studi su Spengler, ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, 394 p. ; du même auteur : Introduzione a Spengler, Laterza, 1997]. En effet, une étude plus approfondie des textes posthumes édités par Anton Mirko Koktanek, not. Frühzeit der Weltgeschichte, qui rassemble les fragments d'une œuvre projetée mais jamais achevée, L'épopée de l'Homme.
Généralement, les morphologies de cultures et de civilisations proposées par Spengler dans son ouvrage le plus célèbre, Le Déclin de l'Occident, sont les seules à être connues. Pourtant, ses positions ont changé après l'édition de cette somme. Le germaniste italien Domenico Conte en fait état dans son ouvrage récent sur Spengler [Catene di civiltà : Studi su Spengler, ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, 394 p. ; du même auteur : Introduzione a Spengler, Laterza, 1997]. En effet, une étude plus approfondie des textes posthumes édités par Anton Mirko Koktanek, not. Frühzeit der Weltgeschichte, qui rassemble les fragments d'une œuvre projetée mais jamais achevée, L'épopée de l'Homme.
Dans la phase de ses réflexions qui a immédiatement suivi la parution du Déclin de l'Occident, Spengler distinguait 4 stades dans l'histoire de l'humanité, qu'il désignait tout simplement par les 4 premières lettres de l'alphabet : a, b, c et d. Le stade “a” aurait ainsi duré une centaine de milliers d'années, aurait recouvert le paléolithique inférieur et accompagné les premières phases de l'hominisation. C'est au cours de ce stade qu'apparaît l'importance de la “main” pour l'homme. C'est, pour Spengler, l'âge du Granit.
Le stade “b” aurait duré une dizaine de milliers d'années et se situerait au paléolithique inférieur, entre 20.000 et 7.000/6.000 av. n. è. C'est au cours de cet âge que naît la notion de vie intérieure ; apparaît « alors la véritable âme, inconnue des hommes du stade “a” tout comme elle est inconnue du nouveau-né ». C'est à partir de ce moment-là de son histoire que l'homme « est capable de produire des traces/souvenirs » et de comprendre le phénomène de la mort. Pour Spengler, c'est l'âge du Cristal. Les stades “a” et “b” sont anorganiques.
Le stade “c” a une durée de 3.500 années : il commence avec le néolithique, à partir du VIe millénaire et se poursuit jusqu'au IIIe. C'est le stade où la pensée commence à s'articuler sur le langage et où les réalisations techniques les plus complexes deviennent possibles. Naissent alors les « cultures » dont les structures sont de type « amibien ». Le stade “d” est celui de « l'histoire mondiale » au sens conventionnel du terme. C'est celui des « grandes civilisations », dont chacune dure environ 1.000 ans. Ces civilisations ont des structures de type “végétal”. Les stades “c” et “d” sont organiques.
Spengler préférait cette classification psychologique-morphologique aux classifications imposées par les directeurs de musée qui subdivisaient les ères préhistoriques et historiques selon les matériaux utilisés pour la fabrication d'outils (pierre, bronze, fer). Spengler rejette aussi, à la suite de cette classification psychologique-morphologique, les visions trop évolutionnistes de l'histoire humaine : celles-ci, trop tributaires des idéaux faibles du XVIIIe siècle, induisaient l'idée « d'une transformation lente, flegmatique » du donné naturel, qui était peut-être évidente pour l'Anglais (du XVIIIe), mais incompatible avec la nature.
L'évolution, pour Spengler, se fait à coup de catastrophes, d'irruptions soudaines, de mutations inattendues. « L'histoire du monde procède de catastrophes en catastrophes, sans se soucier de savoir si nous sommes en mesure de les comprendre. Aujourd'hui, avec H. de Vries, nous les appelons « mutations ». Il s'agit d'une transformation interne, qui affecte à l'improviste tous les exemplaires d'une espèce, sans “causes”, naturellement, comme pour toutes les choses dans la réalité. Tel est le rythme mystérieux du réel » (L'homme et la technique). Il n'y a donc pas d'évolution lente mais des transformations brusques, « épocales ». Natura facit saltus.
Trois cultures-amibes
Dans le stade “c”, où émergent véritablement les matrices de la civilisation humaine, Spengler distingue 3 « cultures-amibes » : Atlantis, Kasch et Turan. Cette terminologie n'apparaît que dans ses écrits posthumes et dans ses lettres. Les matrices civilisationnelles sont « amibes », et non « plantes », parce que les amibes sont mobiles, ne sont pas ancrées dans une terre précise. L'amibe est un organisme qui émet continuellement ses pseudopodes dans sa périphérie, en changeant sans cesse de forme. Ensuite, l'amibe se subdivise justement à la façon des amibes, produisant de nouvelles individualités qui s'éloignent de l'amibe-mère. Cette analogie implique que l'on ne peut pas délimiter avec précision le territoire d'une civilisation du stade “c”, parce que ses émanations de mode amibien peuvent être fort dispersées dans l'espace, fort éloignées de l'amibe-mère.
« Atlantis » est « l'Ouest » et s'étend de l'Irlande à l'Égypte. « Kasch » est le « Sud-Est », une région comprise entre l'Inde et la Mer Rouge. « Turan » est le « Nord », s'étendant de l'Europe centrale à la Chine. Spengler, explique Conte, a choisi cette terminologie rappelant d'« anciens noms mythologiques » afin de ne pas les confondre avec des espaces historiques ultérieurs, de type « végétal », bien situés et circonscrits dans la géographie, alors qu'eux-mêmes sont dispersés et non localisables précisément.
Spengler ne croit pas au mythe platonicien de l'Atlantide, en un continent englouti, mais constate qu'un ensemble de sédiments civilisationnels sont repérables à l'Ouest, de l'Irlande à l'Égypte. « Kasch » est un nom que l'on retrouve dans l'Ancien Testament pour désigner le territoire de l'antique Nubie, région habitée par les Kaschites. Mais Spengler place la culture-amibe « Kasch » plus à l'Est, dans une région s'articulant entre le Turkestan, la Perse et l'Inde, sans doute en s'inspirant de l'anthropologue Frobenius. Quant à « Turan », c'est le « Nord », le haut-plateau touranique, qu'il pensait être le berceau des langues indo-européennes et ouralo-altaïques. C'est de là que sont parties les migrations de peuples « nordiques » (il n'y a nulle connotation racialisante chez Spengler) qui ont déboulé sur l'Europe, l'Inde et la Chine.
Atlantis : chaude et mobile ; Kasch : tropicale et repue
Atlantis, Kasch et Turan sont des cultures porteuses de principes morphologiques, émergeant principalement dans les sphères de la religion et des arts. La religiosité d'Atlantis est « chaude et mobile », centrée sur le culte des morts et sur la prééminence de la sphère ultra-tellurique. Les formes de sépultures, note Conte, témoignent du rapport intense avec le monde des morts : les tombes accusent toujours un fort relief, ou sont monumentales ; les défunts sont embaumés et momifiés ; on leur laisse ou apporte de la nourriture. Ce rapport obsessionnel avec la chaîne des ancêtres porte Spengler à théoriser la présence d'un principe « généalogique ». Les expressions artistiques d'Atlantis, ajoute Conte, sont centrées sur les constructions de pierre, gigantesques dans la mesure du possible, faites pour l'éternité, signes d'un sentiment de la vie qui n'est pas tourné vers un dépassement héroïque des limites, mais vers une sorte de « complaisance inerte ».
Kasch développe une religion « tropicale » et « repue ». Le problème de la vie ultra-tellurique est appréhendé avec une angoisse nettement moindre que dans Atlantis, car, dans la culture-amibe de Kasch domine une mathématique du cosmos (dont Babylone sera l'expression la plus grandiose), où les choses sont d'avance « rigidement déterminées ». La vie d'après la mort suscite l'indifférence. Si Atlantis est une « culture des tombes », en Kasch, les tombes n'ont aucune signification. On y vit et on y procrée mais on y oublie les morts. Le symbole central de Kasch est le temple, d'où les prêtres scrutent la mathématique céleste. Si en Atlantis domine le principe généalogique, si les dieux et les déesses d'Atlantis sont père, mère, fils, fille, en Kasch, les divinités sont des astres. Y domine un principe cosmologique.
Turan : la civilisation des héros
Turan est la civilisation des héros, animée par une religiosité “froide”, axée sur le sens mystérieux de l'existence. La nature y est emplie de puissances impersonnelles. Pour la culture-amibe de Turan, la vie est un champ de bataille : « pour l'homme de ce Nord (Achille, Siegfried), écrit Spengler, seule compte la vie avant la mort, la lutte contre le destin ». Le rapport hommes/divin n'est plus un rapport de dépendance : « la prostration cesse, la tête reste droite et haute ; il y a “moi” (homme) et vous (les dieux) ».
Les fils sont appelés à garder la mémoire de leurs pères mais ne laissent pas de nourriture à leurs cadavres. Pas d'embaumement ni de momification dans cette culture, mais incinération : les corps disparaissent, sont cachés dans des sépultures souterraines sans relief ou dispersés aux quatre vents. Seul demeure le sang du défunt, qui coule dans les veines de ses descendants. Turan est donc une culture sans architecture, où temples et sépultures n'ont pas d'importance et où seul compte un sens terrestre de l'existence. L'homme vit seul, confronté à lui-même, dans sa maison de bois ou de torchis ou dans sa tente de nomade.
Le char de combat
Spengler porte toute sa sympathie à cette culture-amibe de Turan, dont les porteurs aiment la vie aventureuse, sont animés par une volonté implaccable, sont violents et dépourvus de sentimentalité vaine. Ils sont des « hommes de faits ». Les divers peuples de Turan ne sont pas liés par des liens de sang, ni par une langue commune. Spengler n'a cure des recherches archéologiques et linguistiques visant à retrouver la patrie originelle des Indo-Européens ou à reconstituer la langue-source de tous les idiomes indo-européens actuels : le lien qui unit les peuples de Turan est technique, c'est l'utilisation du char de combat.
Dans une conférence prononcée à Munich le 6 février 1934, et intitulée Der Streitwagen und seine Bedeutung für den Gang der Weltgeschichte (Le char de combat et sa signification pour le cours de l'histoire mondiale), Spengler explique que cette arme constitue la clef pour comprendre l'histoire du second millénaire av. JC. C'est, dit-il, la première arme complexe : il faut un char (à 2 roues et non un chariot à 4 roues moins mobile), un animal domestiqué et attelé, une préparation minutieuse du guerrier qui frappera désormais ses ennemis de haut en bas. Avec le char naît un type d'homme nouveau. Le char de combat est une invention révolutionnaire sur le plan militaire, mais aussi le principe formateur d'une humanité nouvelle. Les guerriers deviennent professionnels, tant les techiques qu'ils sont appelés à manier sont complexes, et se rassemblent au sein d'une caste qui aime le risque et l'aventure ; ils font de la guerre le sens de leur vie.
L'arrivée de ces castes de « charistes » impétueux bouleversent l'ordre de cette très haute antiquité : en Grèce, ils bousculent les Achéiens, s'installent à Mycène ; en Égypte, ce sont les Hyksos qui déferlent. Plus à l'Est, les Cassites se jettent sur Babylone. En Inde, les Aryens déboulent dans le sous-continent, « détruisent les cités » et s'installent sur les débris des civilisations dites de Mohenjo Daro et d'Harappa. En Chine, les Tchou arrivent au nord, montés sur leurs chars, comme leurs homologues grecs et hyksos.
À partir de 1.200, les principes guerriers règnent en Chine, en Inde et dans le monde antique de la Méditerranée. Les Hyksos et les Kassites détruisent les 2 plus vieilles civilisations du Sud. Émergent alors 3 nouvelles civilisations portées par les « charistes dominateurs » : la civilisation greco-romaine, la civilisation aryenne d'Inde et la civilisation chinoise issue des Tchou. Ces nouvelles civilisations, dont le principe est venu du Nord, de Turan, sont « plus viriles et énergiques que celles nées sur les rives du Nil et de l'Euphrate ». Mais les guerriers charistes succomberont aux séductions du Sud amollissant, déplore Spengler.
Un substrat héroïque commun
Cette théorie, Spengler l'a élaborée en accord avec le sinologue Gustav Haloun : il y a eu quasi simultanéité entre les invasions de Grèce, des Hyksos, de l'Inde et de la Chine. Tous 2 estiment donc qu'il y a un substrat commun, guerrier et chariste, aux civilisations méditerranéenne, indienne et chinoise. Celui-ci est « héroïque », comme le prouve les armes de Turan. Elles sont différentes de celles d'Atlantis : ce sont, outre le char, l'épée ou la hache, impliquant des duels entre combattants, alors qu'en Atlantis, les armes sont l'arc et la flèche, que Spengler juge « viles » car elles permettent d'éviter la confrontation physique directe avec l'adversaire, « de le regarder droit dans les yeux ».
Dans la mythologie grecque, estime Spengler, arc et flèches sont autant d'indices d'un passé et d'influences pré-helléniques : Apollon-archer est originaire d'Asie Mineure, Artémis est libyque, tout comme Héraklès, etc. Le javelot est également “atlante”, tandis que la lance de choc est « touranique ». Pour comprendre ces époques éloignées, l'étude des armes est plus instructive que celle des ustensiles de cuisine ou des bijoux, conclut Spengler.
L'âme touranique dérive aussi d'un climat particulier et d'un paysage hostile : l'homme doit lutter sans cesse contre les éléments, devient ainsi plus dur, plus froid et plus hivernal. L'homme n'est pas seulement le produit d'une « chaîne généalogique », il l'est tout autant d'un « paysage ». La rigueur climatique développe la « force de l'âme ». Les tropiques amolissent les caractères, les rapprochent d'une nature perçue comme plus maternante, favorisent les valeurs féminines.
Les écrits tardifs de Spengler et sa correspondance indiquent donc que ses positions ont changé après la parution du Déclin de l'Occident, où il survalorisait la civilisation faustienne, au détriment not. de la civilisation antique. La focalisation de sa pensée sur le « char de combat » donne une dimension nouvelle à sa vision de l'histoire : l'homme grec et l'homme romain, l'homme indien-aryen et l'homme chinois, retrouvent tous grâce à ses yeux.
La momification des pharaons était considérée dans Le Déclin de l'Occident, comme l'expression égyptienne d'une volonté de durée, qu'il opposait à l'oubli impliqué par l'incinération indienne. Plus tard, la momification « atlante » déchoit à ses yeux au rang d'une obsession de l'au-delà, signalant une incapacité à affronter la vie terrestre. L'incinération « touranique », en revanche, indique alors une volonté de concentrer ses efforts sur la vie réelle.
Un changement d'optique dicté par les circonstances ?
La conception polycentrique, relativiste, non-eurocentrique et non-évolutionniste de l'histoire chez le Spengler du Déclin de l'Occident a fasciné des chercheurs et des anthropologues n'appartenant pas aux milieux de la droite allemande, not. Alfred Kroeber ou Ruth Benedict. L'insistance sur le rôle historique majeur des castes de charistes de combat donne à l'œuvre tardive de Spengler une dimension plus guerrière, plus violente, plus mobile que ne recelait pas encore son Déclin.
Doit-on attribuer ce changement de perspective à la situation de l'Allemagne vaincue, qui cherche à s'allier avec la jeune URSS (dans une perspective eurasienne-touranienne ?), avec l'Inde en révolte contre la Grande-Bretagne (qu'il incluait auparavant dans la « civilisation faustienne », à laquelle il donnera ensuite beaucoup moins d'importance), avec la Chine des « grands chefs de guerre », parfois armés et encadrés par des officiers allemands ?
Spengler, par le biais de sa conférence, a-t-il cherché à donner une mythologie commune aux officiers ou aux révolutionnaires allemands, russes, chinois, mongols, indiens, afin de forger une prochaine fraternité d'arme, tout comme les “eurasistes” russes tentaient de donner à la nouvelle Russie soviétique une mythologie similaire, impliquant la réconciliation des Turco-Touraniens et des Slaves ? La valorisation radicale du corps-à-corps « touranique » est-elle un écho au culte de « l'assaut » que l'on retrouvait dans le « nationalisme soldatique », not. celui des frères Jünger et de Schauwecker ?
Enfin, pourquoi n'a-t-il rien écrit sur les Scythes, peuples de guerriers intrépides, maîtres des techniques équestres, qui fascinaient les Russes et sans doute, parmi eux, les théoriciens de l'eurasisme ? Dernière question : le peu d'insistance sur les facteurs raciaux dans ce Spengler tardif est-il dû à un sentiment rancunier à l'égard des cousins anglais qui avaient trahi la solidarité germanique et à une mythologie nouvelle, où les peuples cavaliers du continent, toutes ethnies confondues (Mongols, Turco-Touraniens, descendants des Scythes, Cosaques et uhlans germaniques), devaient conjuguer leurs efforts contre les civilisations corrompues de l'Ouest et du Sud et contre les thalassocraties anglo-saxonnes ? Les parallèles évident entre la mise en exergue du “char de combat” et certaines thèses de L'homme et la technique, ne sont-ils pas une concession à l'idéologie futuriste ambiante, dans la mesure où elle donne une explication technique et non plus religieuse à la culture-amibe touranienne ? Autant de thèmes que l'histoire des idées devra clarifier en profondeur...
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies européennes n°21, 1996.

Le rapport Evola/Spengler
 « Je traduisis de l’allemand, à la demande de l’éditeur Longanesi (…) le volumineux et célèbre ouvrage d’Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident. Cela me donna l’occasion de préciser, dans une introduction, le sens et les limites de cette œuvre qui, en son temps, avait connu une renommée mondiale ». C’est par ces mots que commence la série de paragraphes critiques à l’égard de Spengler, qu’Evola a écrit dans Le Chemin du Cinabre (p. 177).
« Je traduisis de l’allemand, à la demande de l’éditeur Longanesi (…) le volumineux et célèbre ouvrage d’Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident. Cela me donna l’occasion de préciser, dans une introduction, le sens et les limites de cette œuvre qui, en son temps, avait connu une renommée mondiale ». C’est par ces mots que commence la série de paragraphes critiques à l’égard de Spengler, qu’Evola a écrit dans Le Chemin du Cinabre (p. 177).
Evola rend hommage au philosophe allemand parce qu’il a repoussé les « lubies progressistes et historicistes », en montrant que le stade atteint par notre civilisation au lendemain de la Première Guerre mondiale n’était pas un sommet, mais, au contraire, était de nature « crépusculaire ». D’où Evola reconnaît que Spengler, surtout grâce au succès de son livre, a permis de dépasser la conception linéaire et évolutive de l’histoire. Spengler décrit l’opposition entre Kultur et Zivilisation, « le premier terme désignant, pour lui, les formes ou phases d’une civilisation de caractère qualitatif, organique, différencié et vivant, le second les formes d’une civilisation de caractère rationaliste, urbain, mécaniciste, informe, sans âme » (p.178).
Evola admire la description négative que donne Spengler de la Zivilisation, mais critique l’absence d’une définition cohérente de la Kultur, parce que, dit-il, le philosophe allemand demeure prisonnier de certains schèmes intellectuels propres à la modernité. « Le sens de la dimension métaphysique ou de la transcendance, qui représente l’essentiel dans toute vraie Kultur, lui a fait défaut totalement » (p. 179). Evola reproche également à Spengler son pluralisme ; pour l’auteur du Déclin de l’Occident, les civilisations sont nombreuses, distinctes et discontinues les unes par rapport aux autres, constituant chacune une unité fermée. Pour Evola, cette conception ne vaut que pour les aspects extérieurs et épisodiques des différentes civilisations. Au contraire, poursuit-il, il faut reconnaître, au-delà de la pluralité des formes de civilisation, des civilisations (ou phases de civilisation) de type “moderne”, opposées à des civilisations (ou phases de civilisation) de type “traditionnel”. Il n’y a pluralité qu’en surface ; au fond, il y a l’opposition fondamentale entre modernité et Tradition.
Ensuite, Evola reproche à Spengler d’être influencé par le vitalisme post-romantique allemand et par les écoles “irrationalistes”, qui trouveront en Klages leur exposant le plus radical et le plus complet. La valorisation du vécu ne sert à rien, explique Evola, si ce vécu n’est pas éclairé par une compréhension authentique du monde des origines. Donc le plongeon dans l’existentialité, dans la Vie, exigé par Klages, Bäumler ou Krieck, peut se révéler dangereux et enclencher un processus régressif (on constatera que la critique évolienne se démarque des interprétations allemandes, exactement selon les mêmes critères que nous avons mis en exergue en parlant de la réception de l’œuvre de Bachofen).
Ce vitalisme conduit Spengler, pense Evola, à énoncer « des choses à faire blêmir » sur le bouddhisme, le taoïsme et le stoïcisme, sur la civilisation gréco-romaine (qui, pour Spengler, ne serait qu’une civilisation de la « corporéité »). Enfin, Evola n’admet pas la valorisation spenglérienne de l’« homme faustien », figure née au moment des grandes découvertes, de la Renaissance et de l’humanisme ; par cette détermination temporelle, l’homme faustien est porté vers l’horizontalité plutôt que vers la verticalité. Sur le césarisme, phénomène politique de l’ère des masses, Evola partage le même jugement négatif que Spengler.
Les pages consacrées à Spengler dans Le chemin du Cinabre sont donc très critiques ; Evola conclut même que l’influence de Spengler sur sa pensée a été nulle. Tel n’est pas l’avis d’un analyste des œuvres de Spengler et d’Evola, Attilio Cucchi (in « Evola, la Tradizione e Spengler », Orion n°89, 1992). Pour Cucchi, Spengler a influencé Evola, not. dans sa critique de la notion d’« Occident » : en affirmant que la civilisation occidentale n’est pas la civilisation, la seule civilisation qui soit, Spengler la relativise, comme Guénon la condamne. Evola, lecteur attentif de Spengler et de Guénon, va combiner éléments de critique spenglériens et éléments de critique guénoniens. Spengler affirme que la culture occidentale faustienne, qui a commencé au Xe siècle, décline, bascule dans la Zivilisation, ce qui contribue à figer, assécher et tuer son énergie intérieure. L’Amérique connaît déjà ce stade final de Zivilisation technicienne et dé-ruralisée.
C’est sur cette critique spenglérienne de la Zivilisation qu’Evola développera plus tard sa critique du bolchévisme et de l’américanisme : si la Zivilisation est crépusculaire chez Spengler, l’Amérique est l’extrême-Occident pour Guénon, c’est-à-dire l’irreligion poussée jusqu’à ses conséquences ultimes. Chez Evola, indubitablement, les arguments spenglériens et guénoniens se combinent, même si, en bout de course, c’est l’option guénonienne qui prend le dessus, surtout en 1957, quand paraît l’édition du Déclin de l’Occident chez Longanesi, avec une préface d’Evola. En revanche, la critique spenglérienne du césarisme politique se retrouve, parfois mot pour mot, dans Le fascisme vu de droite et Les Hommes au milieu des ruines.
Le préfacier de l’édition allemande de ce dernier livre (Menschen inmitten von Ruinen, Hohenrain, Tübingen, 1991), le Dr. H.T. Hansen, confirme les vues de Cucchi : plusieurs idées de Spengler se retrouvent en filigrane dans Les Hommes au milieu des ruines, not. l’idée que l’État est la forme intérieure, l’« être-en-forme » de la nation ; l’idée que le déclin se mesure au fait que l’homme faustien est devenu l’esclave de sa création ; la machine le pousse sur une voie, où il ne connaîtra plus jamais le repos et d’où il ne pourra jamais plus rebrousser chemin. Fébrilité et fuite en avant sont des caractéristiques du monde moderne (”faustien” pour Spengler) que condamnent avec la même vigueur Guénon et Evola.
Dans Les Années décisives (1933), Spengler critique le césarisme (en clair : le national-socialisme hitlérien), comme issu du titanisme démocratique. Evola préfacera la traduction italienne de cet ouvrage, après une lecture très attentive. Enfin, le « style prussien », exalté par Spengler, correspond, dit le Dr. H.T. Hansen, à l’idée évolienne de l’« ordre aristocratique de la vie, hiérarchisé selon les prestations ». Quant à la prééminence nécessaire de la grande politique sur l’économie, l’idée se retrouve chez les 2 auteurs. L’influence de Spengler sur Evola n’a pas été nulle, contrairement à ce que ce dernier affirme dans Le chemin du Cinabre.
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies européennes n°21, 1996.
***
- En attente de numérisation : Wilhelm Duden, "Spengler aujourd'hui" / Gerd-Klaus Kaltenbrunner, "Oswald Spengler et l'idée de déclin" / Armin Mohler, "Hommage à Oswald Spengler" / Robert Steuckers, "Quoi de neuf ? Oswald Spengler !" : Orientations n°1.
- Défis postmodernes : entre Faust et Narcisse (RS)

Oswald Spengler et l’âge des “Césars”
Fonctionnaires globaux, négociants libre-échangistes, milliardaires : les questions essentielles posées par Spengler et ses sombres prophéties sont d’une étonnante actualité
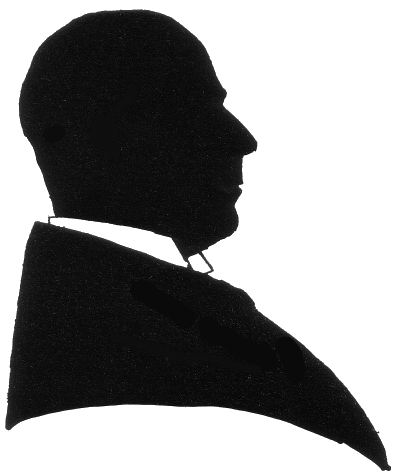 Il y a 75 ans, le 8 mai 1936, Oswald Spengler, philosophe des cultures et esprit universel, est mort. Si l’on lit aujourd’hui les pronostics qu’il a formulés en 1918 pour la fin du XXe siècle, on est frappé de découvrir ce que ce penseur isolé a entrevu, seul, dans son cabinet d’études, alors que le siècle venait à peine de commencer et que l’Allemagne était encore un sujet souverain sur l’échiquier mondial et dans l’histoire vivante, qui était en train de se faire.
Il y a 75 ans, le 8 mai 1936, Oswald Spengler, philosophe des cultures et esprit universel, est mort. Si l’on lit aujourd’hui les pronostics qu’il a formulés en 1918 pour la fin du XXe siècle, on est frappé de découvrir ce que ce penseur isolé a entrevu, seul, dans son cabinet d’études, alors que le siècle venait à peine de commencer et que l’Allemagne était encore un sujet souverain sur l’échiquier mondial et dans l’histoire vivante, qui était en train de se faire.
L’épopée monumentale de Spengler, son Déclin de l’Occident, dont le premier volume était paru en 1918, a fait d’edmblée de ce savant isolé et sans chaire une célébrité internationale. Malgré le titre du livre, qui est clair mais peut aisément induire en erreur, Spengler ne se préoccupait pas seulement du déclin de l’Occident. Plus précisément, il analysait les dernières étapes de la civilisation occidentale et réfléchissait à son “accomplissement” ; selon lui, cet “accomplissement” aurait lieu dans le futur. C’est pourquoi il a développé une théorie grandiose sur le devenir de la culture, de l’histoire, de l’art et des sciences.
Pour élaborer cette théorie, il rompt avec le schéma classique qui divise le temps historique entre une antiquité, un moyen âge et des temps modernes et veut inaugurer rien moins qu’une “révolution copernicienne” dans les sciences historiques. Les cultures, pour Spengler, sont des organismes supra-personnels, nés d’idées matricielles et primordiales (Urideen) auxquelles ils demeurent fidèles dans toutes leurs formes et expressions, que ce soit en art, en diplomatie, en politique ou en économie. Mais lorsque le temps de ces organismes est révolu, ceux-ci se figent, se rigidifient et tombent en déliquescence.
Sur le plan de sa conception de la science, Spengler se réclame de Gœthe : « Une forme forgée / façonnée (geprägt), qui se développe en vivant » (Geprägte Form, die lebend sich entwickelt). Dans le germe d’une plante se trouve déjà tout le devenir ultérieur de cette plante : selon la même analogie, l’Uridee (l’idée matricielle et primordiale) de la culture occidentale a émergé il y a 1.000 ans en Europe ; celle de la culture antique, il y a environ 3.000 ans dans l’espace méditerranéen. Toutes les cultures ont un passé ancien, primordial, qui est villageois et religieux, puis elle développent l’équivalent de notre gothique, de notre renaissance, de notre baroque et de nos époques tardives et (hyper)-urbanisées ; ces dernières époques, Spengler les qualifie de “civilisation”. Le symbole originel (Ursymbol) de la culture occidentale est pour Spengler la dynamique illimitée des forces, des puissances et de l’espace, comme on le perçoit dans les cathédrales gothiques, dans le calcul différentiel, dans l’imprimerie, dans les symphonies de Beethoven, dans les armes capables de frapper loin et dans les explorations et conquêtes des Vikings. La culture chinoise a, elle aussi, construit des navires capables d’affronter la haute mer ainsi que la poudre à canon, mais elle avait une autre “âme”. L’idée matricielle et primordiale de la Chine, c’est pour Spengler, le « sentier » (der Pfad). Jamais la culture chinoise n’a imaginé de conquérir la planète.
Dans toutes les cultures, on trouve la juxtaposition d’une volonté de puissance et d’un espace spirituel et religieux, qui se repère d’abord dans l’opposition entre aristocratie et hiérocratie (entre la classe aristocratique et les prêtres), ensuite dans l’opposition politique / économie ou celle qu’il y a entre philosophie et sciences. Et, en fin de compte, au moment où elles atteignent leur point d’accomplissement, les civilisations sombrent dans ce que Spengler appelle la Spätzeit, « l’ère tardive », où règne une « seconde religiosité » (eine zweite Religiosität). Les masses sortent alors du flux de l’histoire et se vautrent dans le cycle répétitif et éternel de la nature : elles ne mènent plus qu’une existence simple.
La Spätzeit des masses scelle aussi la fin de la démocratie, elle-même phase tardive dans toutes les cultures. C’est à ce moment-là que commence l’ère du césarisme. Il n’y a alors « plus de problèmes politiques. On se débrouille avec les situations et les pouvoirs qui sont en place (...). Déjà au temps de César les strates convenables et honnêtes de la population ne se préoccupaient plus des élections. (...) À la place des armées permanentes, on a vu apparaître progressivement des armées de métier (...). À la place des millions, on a à nouveau eu affaire aux “centaines de milliers” (...) ». Pourtant, Spengler est très éloigné de toute position déterministe : « À la surface des événements mondiaux règne toutefois l’imprévu (...). Personne n’avait pu envisager l’émergence de Mohammed et le déferlement de l’islam et personne n’avait prévu, à la chute de Robespierre, l’avènement de Napoléon ».
La guerre dans la phase finale de la civilisation occidentale
La vie d’Oswald Spengler peut se raconter en peu de mots : né en 1880 à Blankenburg dans le Harz, il a eu une enfance malheureuse ; le mariage de ses parents n’avait pas été un mariage heureux : il n’a généré que problèmes ; trop de femmes difficiles dans une famille où il était le seul garçon ; il a fréquenté les “Fondations Francke” à Halle ; il n’avait pas d’amis : il lisait, il méditait, il élaborait ses visions. Il était loin du monde. Ses études couvrent un vaste champs d’investigation : il voulait devenir professeur et a abordé la physique, les sciences de la nature, la philosophie, l’histoire... Et était aussi un autodidacte accompli. « Il n’y avait aucune personnalité à laquelle je pouvais me référer ». Il ne fréquentait que rarement les salles de conférence ou de cours. Il a abandonné la carrière d’enseignant dès qu’un héritage lui a permis de mener une existence indépendante et modeste. Il n’eut que de très rares amis et levait de temps à autre une fille dans la rue. On ne s’étonnera dès lors pas que Spengler ait choisi comme deuxième mentor, après Gœthe, ce célibataire ultra-sensible que fut Friedrich Nietzsche. Celui-ci exercera une profonde influence sur l’auteur du “déclin de l’Occident” : « De Gœthe, j’ai repris la méthode ; de Nietzsche, les questions ».
L’influence politique de Spengler ne s’est déployée que sur peu d’années. Dans Preussentum und Sozialismus (Prussianité et socialisme), un livre paru en 1919, il esquisse la différence qui existe entre l’esprit allemand et l’esprit anglais, une différence qui s’avère fondamentale pour comprendre la « phase tardive » du monde occidental. Pour Spengler, il faut le rappeler, les cultures n’ont rien d’homogène : partout, en leur sein, on repère une dialectique entre forces et contre-forces, lequelles sont toujours suscitées par la volonté de puissance que manifeste toute forme de vie. Pour Spengler, ce qui est spécifiquement allemand, ou prussien, ce sont les idées de communauté, de devoir et de solidarité, assorties du primat du politique ; ces idées ont été façonnées, au fil du temps, par les Chevaliers de l’Ordre Teutonique, qui colonisèrent l’espace prussien au moyen âge. Ce qui est spécifiquement anglais, c’est le primat de la richesse matérielle, c’est la liberté de rafler du butin et c’est l’idéal du Non-État, inspiré par les Vikings et les pirates de la Manche.
« C’est ainsi que s’opposent aujourd’hui deux grands principes économiques : le Viking a donné à terme le libre-échangiste ; le Chevalier teutonique a donné le fonctionnaire administratif. Il n’y a pas de réconciliation possible entre ces deux attitudes et toutes deux ne reconnaissent aucune limite à leur volonté, elles ne croiront avoir atteint leur but que lorsque le monde entier sera soumis à leur idee ; il y aura donc la guerre jusqu’à ce que l’une de ces deux idées aura totalement vaincu ».
Cette opposition irréconciliable implique de poser la question décisive : laquelle de ces deux idées dominera la phase finale de la civilisation occidentale ?
« L’économie planétaire prendra-t-elle la forme d’une exploitation générale et totale de la planète ou impliquera-t-elle l’organisation totale du monde ? Les Césars de cet imperium futur seront-ils des milliardaires ou des fonctionnaires globaux ? (...) la population du monde sera-t-elle l’objet de la politique de trusts ou l’objet de la politique d’hommes, tels qu’ils sont évoqués à la fin du Second Faust de Gœthe ? ».
Lorsque, armés du savoir dont nous disposons aujourd’hui, nous jetons un regard rétrospectif sur ces questions soulevées jadis par Spengler, lorsque nous constatons que les lobbies imposent des lois, pour qu’elles servent leurs propres intérêts économiques, lorsque nous voyons les hommes politiques entrer au service de consortiums, lorsque des fonds quelconques, de pension ou de logement, avides comme des sauterelles affamées, ruinent des pans entiers de l’industrie, lorsque nous constatons que le patrimoine génétique se voit désormais privatisé et, enfin, lorsque toutes les initiatives publiques se réduisent comme peau de chagrin, les questions posées par Spengler regagnent une formidable pertinence et accusent une cruelle actualité. En effet, les nouveaux dominateurs du monde sont des milliardaires et les hommes politiques ne sont plus que des pions ou des figures marginalisées.
Spengler a rejeté les propositions de Goebbels
Spengler espérait que le Reich allemand allait retrouver sa vigueur et sa fonction, comme l’atteste son écrit de 1924, Neubau des Deutschen Reiches (Pour une reconstruction du Reich allemand). Dans cet écrit, il exprimait son désir de voir « la partie la plus valable du monde allemand des travailleurs s’unir aux meilleurs porteurs du sentiment d’État vieux-prussien (...) pour réaliser ensemble une démocratisation au sens prussien du terme, en soudant leurs efforts communs par une adhésion déterminée au sentiment du devoir ». Spengler utilise souvent le terme “Rasse” (race) dans cet écrit. Mais ce terme, chez lui, signifie « mode de comportement avéré, qui va de soi sans remise en question aucune » ; en fait, c’est ce que nous appelerions aujourd’hui une “culture d’organisation” (Organisationskultur). Spengler rejetait nettement la théorie folciste (völkisch) de la race. Lorsqu’il parlait de “race”, il entendait « la race que l’on possédait, et non pas la race à laquelle on appartient. La première relève de l’éthique, la seconde de la zoologie ».
À la fin des années 20, Spengler se retire du monde et adopte la vie du savant sans chaire. Il ne reprendra la parole qu’en 1933, en publiant Jahre der Entscheidung (Années décisives). En quelques mois, le livre atteint les ventes exceptionnelles de 160.000 exemplaires. On le considère à juste titre comme le manifeste de la résistance conservatrice.
Spengler lance un avertissement : « Nous ne vivons pas une époque où il y a lieu de s’enthousiasmer ou de triompher (...). Des fanatiques exagèrent des idées justes au point de procéder à la propre annulation de celles-ci. Ce qui promettait grandeur au départ, se termine en tragédie ou en comédie ». Goebbels a demandé à Spengler de collaborer à ses publications : il refuse. Il s’enfonce dans la solitude. Il avait déjà conçu un second volume aux Années décisives mais il ne le couche pas sur le papier car, dit-il, « je n’écris pas pour me faire interdire ».
Au début du XXIe siècle, l’esprit viking semble avoir définitivement triompher de l’esprit d’ordre. Le monde entier et ses patrimoines culturels sont de plus en plus considérés comme des propriétés privées. La conscience du devoir, la conscience d’appartenir à une histoire, les multiples formes de loyauté, le sens de la communauté, le sentiment d’appartenir à un État sont houspillés hors des cœurs et des esprits au bénéfice d’une liberté que l’on pose comme sans limites, comme dépourvue d’histoire et uniquement vouée à la jouissance. La politique est devenue une marchandise que l’on achète. Le savoir de l’humanité est entreposé sur le site “Google”, qui s’en est généralement emparé de manière illégitime ; la conquête de l’espace n’est plus qu’un amusement privé.
Mais :
« Le temps n’autorise pas qu’on le retourne ; il n’y aurait d’ailleurs aucune sagesse dans un quelconque retournement du temps comme il n’y a pas de renoncement qui serait indice d’intelligence. Nous sommes nés à cette époque-ci et nous devons courageusement emprunter le chemin qui nous a été tracé (...). Il faut se maintenir, tenir bon, comme ce soldat romain, dont on a retrouvé les ossements devant une porte de Pompéi ; cet homme est mort, parce qu’au moment de l’éruption du Vésuve, on n’a pas pensé à le relever. Ça, c’est de la grandeur. Cette fin honnête est la seule chose qu’on ne peut pas retirer à un homme ».
Et nous ? Nous qui croyons à l’État et au sens de la communauté, nous qui sentons au-dessus de nous la présence d’un ciel étoilé et au-dedans de nous la présence de la loi morale, nous qui aimons les symphonies de Beethoven et les paysages de Caspar David Friedrich, va-t-on nous octroyer une fin digne ? On peut le supposer. S’il doit en être ainsi, qu’il en soit ainsi.
► Max Otte. (article paru dans Junge Freiheit n°19/2011)
• Max Otte est professeur d’économie (économie de l’entreprise) à Worms en Allemagne. Dans son ouvrage Der Crash kommt (Le crash arrive), il a annoncé très exactement, dès 2006, l’éclatement de la crise financière qui nous a frappés en 2008 et dont les conséquences sont loin d’avoir été éliminées.

Pièces-jointes :
Le regard historique
« Oswald Spengler se moque des historiens professionnels, qui restent à la surface des choses et s'imaginent pouvoir déceler des causes et des effets. L'histoire ne saurait être comprise avec les outils du rationalisme. Il faut le coup d'œil de l'aigle, celui d'un Shakespeare, d'un Gœthe, d'un Nietzsche. Cette vision, qu'il nomme “physionomique”, déroule un paysage grandiose et déroutant. L'idée que l'histoire se développe sur un mode plus ou moins linéaire, allant de l'Antiquité aux Temps modernes, est une illusion née de l'ego dérisoire de l'homme occidental. Pour Spengler, au contraire, l'histoire connaît les cycles d'un organisme vivant, de la naissance à la maturité puis à la vieillesse et la mort. Ces cycles se retrouvent et se répètent, d'une “haute culture” à l'autre. » (O. Postel-Vinay)
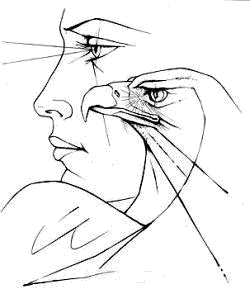 (Le regard historique) veut dire qu’on est celui qui connaît, le connaisseur supérieur, assuré et froid. Mille années de pensée et de recherche historiques ont étalé à nos yeux un trésor incommensurable, non de savoir — cela n’aurait guère d’importance — mais d’expériences. Ce sont là des expériences vitales, en un sens tout nouveau, à condition qu’on les conçoive comme telles dans une perspective pareille à celle que je viens d’esquisser.
(Le regard historique) veut dire qu’on est celui qui connaît, le connaisseur supérieur, assuré et froid. Mille années de pensée et de recherche historiques ont étalé à nos yeux un trésor incommensurable, non de savoir — cela n’aurait guère d’importance — mais d’expériences. Ce sont là des expériences vitales, en un sens tout nouveau, à condition qu’on les conçoive comme telles dans une perspective pareille à celle que je viens d’esquisser.
Jusqu’à présent, nous avons vu — et les Allemands plus encore que les autres nations — dans le passé des modèles qu’il s’agirait de reproduire dans la vie. Mais il n’y a pas de modèles. Il n’y a que des exemples et des exemples de la manière dont la vie de l’individu, de peuples entiers, de cultures entières, se développe, atteint son achèvement, va sur son déclin, des relations du caractère et de la situation concrète, du rythme et de la durée. Nous ne voyons pas comment nous aussi, nous devons agir, mais bien comment s’est passé un quelque chose qui nous enseigne comment, à partir de nos conditions propres, naîtront nos propres résultats.
Jusqu’à présent, bien des connaisseurs de l’âme humaine le savaient, mais ne le savaient qu’en rapport avec les disciples, les subordonnés, les collaborateurs, et bien des hommes d’État à l’esprit subtil, mais seulement par rapport à leur temps, ses personnalités et ses nations. Le grand art consistait à manipuler les forces de la vie, en démasquant leurs possibilités et en prévoyant leurs mutations. C’est ainsi qu’on dominait autrui. C’est ainsi qu’on devenait soi-même destin.
Aujourd’hui, nous pouvons prévoir celui de la totalité de notre propre culture, à des siècles de distance, comme s’il s’agissait d’un être dont nous perçons à jour les profondeurs ultimes. Nous savons bien que tout fait est un hasard, imprévu et imprévisible, mais, avec devant nous l’image des autres cultures, nous savons de science tout aussi certaine que le cours et l’esprit de l’avenir ne sont pas un hasard, pas plus chez l’individu que dans la vie d’une culture, que, certes, la libre décision de l’homme agissant peut les mener, par une voie royale, jusqu’à l’achèvement, ou les mettre en péril, les faire avorter, les détruire, mais sans en pouvoir détourner le sens ni la direction. Ce qui permet de concevoir pour la première fois une éducation, au sens le plus vaste du terme, un discernement des possibilités internes et une fixation des tâches, un entraînement de l’individu et de générations entières en vue de ces tâches, circonscrites au moyen de la vue prospective de faits futurs et non en vertu de quelconques abstractions “idéales”.
Pour la première fois, nous percevons, comme un fait, que toute la littérature des “vérités” idéales, toutes ces inspirations, ces projets, ces solutions nobles, bien intentionnés, imbéciles, tous ces livres, tous ces tracts et tous ces discours sont une manifestation utile, telle que l’ont connue toutes les autres cultures aux époques correspondantes à la nôtre, pour l’oublier bientôt, et dont tout l’effet a consisté à permettre à de petits érudits, dans un coin quelconque, de composer ensuite un livre sur le sujet. Et c’est pourquoi, répétons-le : pour qui se contente de la contemplation, il peut bien y avoir des vérités ; pour la vie, il n’y a pas de vérités, rien que des faits.
► O. Spengler, extrait des Écrits historiques et philosophiques, Copernic, 1979.

PHILOSOPHES MÉCONNUS :
Oswald Spengler : Le « Copernic de l'Histoire »
Le penseur conservateur allemand a anticipé nombre de nos conceptions actuelles
 L'Allemand Oswald Spengler (1880-1936) pâtit, de nos jours, d'une réputation détestable. Parce que Hitler lui reprit, non sans les schématiser, plusieurs de ses idées forces, l'auteur du Déclin de l'Occident passe pour un “infréquentable”. Certains colportent même encore la fausse légende, selon laquelle il aurait été un des premiers adhérents du NSDAP, le parti nazi. Or, si Spengler éprouva effectivement, au début, une relative sympathie pour le mouvement représenté par le nazisme, il s'en détourna radicalement après 1933, et traitait, en privé, Hitler de « rêveur funeste » et de « tête creuse ». On ne trouve, en outre, aucune trace dans son œuvre d'un quelconque racisme biologique, ni des préjugés en cours, à son époque, sur les Juifs.
L'Allemand Oswald Spengler (1880-1936) pâtit, de nos jours, d'une réputation détestable. Parce que Hitler lui reprit, non sans les schématiser, plusieurs de ses idées forces, l'auteur du Déclin de l'Occident passe pour un “infréquentable”. Certains colportent même encore la fausse légende, selon laquelle il aurait été un des premiers adhérents du NSDAP, le parti nazi. Or, si Spengler éprouva effectivement, au début, une relative sympathie pour le mouvement représenté par le nazisme, il s'en détourna radicalement après 1933, et traitait, en privé, Hitler de « rêveur funeste » et de « tête creuse ». On ne trouve, en outre, aucune trace dans son œuvre d'un quelconque racisme biologique, ni des préjugés en cours, à son époque, sur les Juifs.
Adversaire résolu de la République de Weimar, ce n'était, il est vrai, pas vraiment un démocrate. Appartenant à la génération de la guerre de 14-18, cet essayiste indépendant fut de ceux à prôner, dans les années 20, avec Ernst Jünger et Moeller van der Bruck, la recherche d'une “troisième voie”. Rejetant aussi bien le libéralisme anglais que le bolchevisme russe, celle-ci résidait, selon lui, dans l'instauration d'un “socialisme prussien”, soit dans l'enrégimentement de l'Allemagne au service d'un État national fort, sinon “total”. Considéré, par ailleurs, comme un des pères spirituels de la Révolution conservatrice, il opposait, à la “société” prosaïque issue de la “civilisation”, la force de la “communauté du peuple” rassemblée autour de ses valeurs historiques fondamentales, la Kultur.
C'est ce qui l'amena à agiter, dans son monumental best-seller en 2 tomes, paru en 1918-1922 et vendu à 600.000 exemplaires, le spectre d'un « déclin de l'Occident » : parce qu'il s'était coupé de ses valeurs, celui-ci avait, soutenait-il, « épuisé les possibilités de son développement ». Une réflexion qui mésestimait le renouvellement apporté par la modernité, mais qui reposait sur des postulats tout sauf ineptes. En particulier, celui que nous ne pouvons sortir des partis pris fondamentaux, qui, aussi bien par le langage que par la logique que nous utilisons, “fondent” notre culture, et nous avec. Quoiqu'on puisse en contester les conclusions, les conceptions de Spengler partaient donc d'un raisonnement rigoureux. Et un penseur est-il responsable de l'usage que font de ses thèses certains de ses lecteurs ?
C'est toute la question que posent Spengler et son Déclin de l'Occident. Ample fresque brassant des aperçus sur les sciences, l'histoire et les arts de toutes les époques, le livre dépasse de loin l'étroite mentalité “décadentiste”, à laquelle ceux qui ne l'ont pas lu s'acharnent à le réduire. Certes, bien des pages en sont devenues illisibles. Et n'y manquent ni les concepts fumeux ni l'érudition approximative. En même temps, cet ouvrage un peu monstrueux et inégal fourmille d'extraordinaires intuitions parfois très visionnaires.
L'idée, développée par Spengler dans le premier tome du Déclin, qu'à la base de notre science dite “objective” gisent des concepts non tirés de l'expérience et donc proprement métaphysiques, tels ceux de force ou de masse, rejoint l'analyse que fera plus tard Michel Foucault, dans Les Mots et les Choses, des « épistémè » * changeantes des diverses époques. Sa réflexion sur la signification de l'apparition de la perspective en peinture anticipe la thèse, désormais classique, d'Erwin Panofski (La Perspective comme forme symbolique), sur le côté “construit”, arbitraire, de celle-ci : là où nous voyons une “avancée” par rapport à une représentation en 2 dimensions, il n'y aurait que l'expression d'une autre « vision du monde ». Quant à l'opposition, inspirée de Nietzsche, qu'il traçait entre une pensée antique “apollinienne”, ne s'attachant qu'à ce qui est clairement circonscrit, et un esprit occidental “faustien”, marqué par la quête folle de l'illimité, on la retrouvera, développée, à la fin des années 50, dans le chef-d'œuvre de philosophie des sciences d'Alexandre Koyré, qui taira d'ailleurs prudemment son origine, Du monde clos à l'univers infini.
Le « Copernic de l'Histoire », ainsi qu'il aimait à s'appeler de façon pompeuse, parce qu'à l'ancienne vision « ptolémaïque » d'une histoire universelle centrée sur l'Occident et ordonnée par un vecteur de progrès, il entendait substituer une autre, respectueuse du développement singulier des grandes cultures concurrentes à partir de leurs normes propres, pourrait même passer pour un des plus sûrs ancêtres des structuralistes. Il fut, en effet, le premier à avancer que les civilisations forment des “systèmes” cohérents, dont tous les éléments entretiennent entre eux des liens de nécessité.
Son idée, enfin, que tout ensemble culturel prend ses racines dans une « image symbolique originelle », accessible aux seuls individus de cette culture, parce que relevant de leur “fonds mythique” peut sembler étrange et ouvrir la porte à la notion honnie de “choc des civilisations” ; elle mérite néanmoins un examen. Elle pourrait nous faire comprendre que, lorsque nous interprétons les grands concepts des autres cultures, nous péchons souvent, parfois à notre insu, par “occidentalo-centrisme”. La traduction des valeurs d'une culture en celles d'une autre, que nous assurons toujours possible, trouve, autrement dit, peut-être sa limite dans l'irréductibilité de leurs socles symboliques. Les relations aujourd'hui si tendues entre l'Occident et l'Islam ne s'expliquent-elles pas, en partie du moins, par cette difficulté, dont il nous arrange de nier l'existence ?
Si l'on peut critiquer Spengler pour son relativisme, il nous introduit, en bref, à des interrogations parmi les plus vitales qui se posent à nous. Wittgenstein, qui le relut sa vie entière, le voyait bien ainsi. Il parlait du Déclin de l'Occident comme d'un « vaste capharnaüm d'hypothèses en tout genre », certaines dépassées ou aberrantes, d'autres, au contraire, éclairantes et fécondes. De combien d'ouvrages, loués par ceux-là mêmes qui le rejettent pour de fausses raisons politico-morales, pourrait-on en dire autant ?
► Patrice Bollon, Le Figaro (18 août 2005).
[ * nota bene : Un des fils directeurs qui parcourt l'œuvre de Foucault concerne les questions suivantes : comment un savoir peut-il se constituer à une époque et en un lieu déterminés ? Quels rapports pensée, vérité et histoire entretiennent-elles entre elles ? Foucault nomme épistémè les cadres de pensée qui forment le soubassement des discours sur le savoir, au sein d’une communauté humaine à une période donnée. Ceux-ci aident à mettre en relief la configuration du savoir articulé au pouvoir]

Considérations sur Spengler
« Mais, parmi les auteurs méconnus ou sous-estimés qui m'ont impressionné, je dois avouer un coup de cœur pour Oswald Spengler, et plus particulièrement pour son grand livre, Le Déclin de l'Occident. Dans ce gros traité, ce philosophe allemand du début du XXe siècle développe toute une théorie de l'Histoire. Selon Spengler, les cultures ne sont pas le fruit d'une longue évolution divisible en périodes. Au contraire, l'Histoire n'est qu'une suite de cultures différentes qui naissent, vivent et meurent, comme des organismes biologiques. Leur existence est constituée de cycles, qui se répètent et qu'il faut repérer afin de prédire l'avenir. Il n'y a aucune interdépendance d'une culture sur l'autre. Et le stade ultime de développement, le dépérissement, est ce qu'Oswald Spengler appelle la civilisation, dont il tente de déterminer les traits caractéristiques, notamment dans la création artistique. » (Gus Van Sant)
« Car finalement, au terme d'une succession réglée de siècles, toute culture devient civilisation. Ce qui était vivant devient rigide et froid. Les espaces intérieurs de l'âme s'extériorisent dans la réalité corporelle, la vie au sens de Maître Eckhart devient vie au sens d'économie politique, la puissance des idées devient impérialisme » (Prussianité et Socialisme, VIII)
◘ Le rapport culture/civilisation
 La triple opposition culture-âme-vie / civilisation-intellect-raison rebondit chez O. Spengler (Le Déclin de l'Occident, 1918-1922). Celui-ci traite en effet de la culture aussi bien que des cultures. En outre, il pose, entre “culture” et “civilisation”, un rapport non plus seulement conceptuel, mais de filiation (c-à-d. génétique) et même de finalité. Entre les grandes cultures historiques (il en distingue 8), Spengler constate, non de superficielles analogies, mais bien des “homologies” au sens biologique du terme. Il affirme : « Les cultures sont des organismes ; l'histoire universelle est leur biographie générale ». Une culture se définit comme l'ensemble des manifestations humaines à une série de moments donnés dans l'histoire (à cet égard, Spengler n'est pas très éloigné de la définition moderne du couple culture/nature).
La triple opposition culture-âme-vie / civilisation-intellect-raison rebondit chez O. Spengler (Le Déclin de l'Occident, 1918-1922). Celui-ci traite en effet de la culture aussi bien que des cultures. En outre, il pose, entre “culture” et “civilisation”, un rapport non plus seulement conceptuel, mais de filiation (c-à-d. génétique) et même de finalité. Entre les grandes cultures historiques (il en distingue 8), Spengler constate, non de superficielles analogies, mais bien des “homologies” au sens biologique du terme. Il affirme : « Les cultures sont des organismes ; l'histoire universelle est leur biographie générale ». Une culture se définit comme l'ensemble des manifestations humaines à une série de moments donnés dans l'histoire (à cet égard, Spengler n'est pas très éloigné de la définition moderne du couple culture/nature).
Cette conception est à la fois diachronique et synchronique. Diachronique : toute culture passe par les mêmes étapes, à la façon d'un organisme qui naît, grandit, atteint sa maturité, décline et meurt. Synchronique : on constate d'une culture à l'autre, et, au sein d'une même culture, entre ses différentes formes (artistiques, guerrières, scientifiques, étatiques, etc.), une « affinité profonde entre les figures politiques et artistiques, entre les intuitions religieuses et techniques, entre la mathématique, la musique et la plastique, entre les formes économiques et celles de la connaissance ».
« J'appelle contemporains, écrit Spengler, deux faits historiques qui, chacun dans sa culture, se manifestent exactement dans la même situation relative et qui ont par conséquent un sens exactement correspondant ». Et de signaler « la profonde interdépendance psychique entre les théories physico-chimiques les plus modernes et les représentations mythologiques ancestrales des Germains ; la concordance parfaite entre le style de la tragédie, la technique dynamique et la circulation monétaire de nos jours ; l'identité d'abord bizarre, puis évidente, entre la perspective de la peinture à l'huile, l'imprimerie, le système de crédit, les armes à feu, la musique contrapontique, et d'autre part, entre la statue nue, la polis, la monnaie grecque d'argent, en tant qu'expressions diverses d'un seul et même principe psychique... »
Dans une telle perspective, les civilisations ne sont que les formes ultimes, décadentes, des cultures ; elles n'en sont que le dernier moment, celui qui précède la fin. « La civilisation est le destin inéluctable de toute culture » écrit Spengler. M. Tazerout précise : « La culture a pour fin la civilisation et la civilisation ne possède pas d'autre finalité que la mort, qui était impliquée dans sa naissance puisque chaque civilisation tue sa culture comme le ver à soie ronge son cocon avant d'en sortir » (op. cit.). L'opposition entre les 2 notions n'est donc pas seulement “spatiale” mais aussi “temporelle”. L'évolution de l'humanité n'a pas de sens ni de but : c'est seulement au sein des cultures particulières que des buts peuvent être distingués et appréciés. Les périodes de plus haute culture (de véritable culture) sont celles de la naissance, de la croissance et de la maturité. À ce moment-là, la sève de l'invention et de l'innovation à l'intérieur de la tradition initiale se manifeste avec une irrésistible énergie.
Au contraire, le nom de “civilisation” doit être réservé à la période finale, au moment où, par déperdition de l'énergie d'origine, l'entropie commence à gagner l'organisme, où le progrès scientifique et technologique prend le pas sur les créations spirituelles, où ces créations elles-mêmes disparaissent peu à peu, où les arts et la littérature deviennent des passe-temps ou des excitants sociaux (panem et circenses), où les artistes se perdent en subtiles variations dans le déjà-vu sans jamais retrouver de nouvelles sources d'inspiration, où la mode sécrète les nostalgies les plus baroques, les fantaisies les plus exotiques, où se produisent les pseudomorphoses, c-à-d. les mélanges de culture, où seules les valeurs marchandes, quantifiables, sont partout reconnues, où l'argent symbole abstrait de l'interchangeable, comme le disait Simmel, domine toutes choses, où la morale de l'« efficacité » devient pur alibi, facilite toutes les trahisons (sans même, à terme, être efficace), où le souci de sécurité prime toute autre préoccupation, où les structures s’effondrent, où les autorités sont remises en cause, où le plus grand nombre aspire à l'homogénéité sociale et à la réduction des différences, où la société perd son caractère organique et sa “souplesse”, tandis que disparaît tout ce que les ancêtres ont créé de vigoureux et de grand, que tout se matérialise et se pétrifie, et que, bientôt, tout éclate et se dissout.
Spengler oppose donc la notion organique de “culture” à l’abstraction de la “civilisation”, la seconde étant comme la cristallisation (au sens de matérialisation) de la première. La culture est alors la manifestation originale/originelle, libre et spirituelle, d'une communauté historique de vie ; la civilisation, la manifestation d'ordre intellectuel et impersonnel qui aboutit au machinisme et à la mécanisation totale de la vie humaine. Entre les cultures, il y a à la fois discontinuité (principe spatial inter-culturel) et irréversibilité (principe temporel intra-culturel).
« Une culture, explique Spengler, naît au moment où une grande âme se réveille, se détache de l'état psychique primaire d'éternelle enfance humaine (...) Une culture meurt quand l'âme a réalisé la somme entière de ses possibilités sous la forme de peuples, de langues, de doctrines religieuses, d'arts, d'États, de sciences, et qu'elle retourne à l'état psychique primaire... Quand le but est atteint et l'idée achevée, que la quantité totale des possibilités intérieures s'est réalisée au-dehors, la culture se fige brusquement, elle meurt, son sang coule, ses forces se brisent : elle devient civilisation. »
► A. de Benoist, extrait de Les idées à l'endroit (ch. 6), 1979.

♦ Œuvres ♦
• Le Déclin de l'Occident
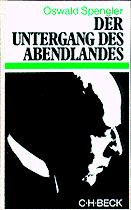 Le Déclin de l'Occident est un livre dont on parle plus qu'on ne le lit. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au cours des dix dernières années qui suivirent la Première Guerre Mondiale, l'ouvrage principal de Spengler était lu et discuté par les intellectuels les plus éminents d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'Amérique. Aujourd'hui, une nouvelle génération de lecteurs découvre à son tour l'homme et l'œuvre qui captivèrent l'imagination de l'intelligentsia entre 1918 et 1928.
Le Déclin de l'Occident est un livre dont on parle plus qu'on ne le lit. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au cours des dix dernières années qui suivirent la Première Guerre Mondiale, l'ouvrage principal de Spengler était lu et discuté par les intellectuels les plus éminents d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'Amérique. Aujourd'hui, une nouvelle génération de lecteurs découvre à son tour l'homme et l'œuvre qui captivèrent l'imagination de l'intelligentsia entre 1918 et 1928.
La biographie de Spengler tient en quelques lignes. O. Spengler naquit à Blankenburg, en Allemagne, le 29 mai 1880. Son père était un technicien des mines, devenu plus tard un petit employé des postes. Peu après sa naissance, la famille Spengler alla s'installer à Halle, où le jeune Oswald passa sa jeunesse. Après avoir fréquenté les universités de Munich et de Berlin, il retourna à l'université de Halle où il obtint son doctorat en 1903. À cette époque, il s'intéressait surtout aux mathématiques et aux sciences naturelles, mais aussi à la philosophie, comme en témoigne sa dissertation de doctorat consacrée à Héraclite.
D'abord nommé professeur à Saarbrücken, puis à Düsseldorf, on lui confia en 1908 un poste dans un Realgymnasium de Hambourg, où il enseigna les sciences, l'histoire et la géographie. En 1910, Spengler demanda et obtint un congé qui lui permit de quitter l'enseignement. Il ne devait jamais y revenir. Il passa tout le reste de son existence à Munich, à lire et à écrire sur l'histoire et la philosophie. II vécut grâce à un petit revenu personnel, hérité de sa mère. Du fait de sa myopie et de l'état de son cœur, Spengler ne fut jamais appelé au service militaire. Il mourut à Munich le 8 mai 1936 d'un accident cardiaque, et fut enterré là par ses sœurs.
Le Déclin de l'Occident n'est pas une œuvre de recherche historique ; c'est une philosophie spéculative de l’histoire. La cible principale des attaques de Spengler est la prétendue conception linéaire de l'histoire, interprétation qui, à son avis, donne une place privilégiée à la culture de l'Europe occidentale et de l'Amérique. Les partisans de cette conception soutiennent que l'histoire de l'humanité est l'histoire d'un progrès continu, aboutissant à l'élimination de la pauvreté et de la maladie grâce aux techniques scientifiques, et à la résolution de l’instabilité politique par la démocratie mondiale. C'est une conception de l'histoire qu'acceptent sans mot dire la plupart des Américains et nombre d'Européens.
Mais, pour Spengler, cette conception est à la fois “provinciale” et erronée. Il lui substitue donc une conception cyclique de l'histoire, dans laquelle les unités historiques individuelles sont des cultures séparées et distinctes, possédant chacune un cycle de vie spécifique, semblable aux cycles biologiques des organismes vivants, et dont aucune n'est sur aucun plan supérieure aux autres.
Chaque culture connaît une période de naissance, de croissance, de maturité et de déclin, ou, si l'on préfère, un printemps, un été, un automne et un hiver. Parvenue à maturité, chaque culture a une “âme” ou caractère particulier, qui se manifeste aussi bien dans l'art, la littérature, la philosophie, la politique ou la science. Chaque culture apparaît indépendamment et se développe dans un isolement total par rapport aux autres cultures. Chaque culture, à sa naissance, se voit assigner une période de temps bien précise avant sa mort. Toutes les cultures sont identiques du point de vue morphologique, exactement comme les organismes humains sont morphologiquement les mêmes ; à chaque phase, par ex., de la culture classique grecque et romaine correspond une phase de la culture américaine et ouest-européenne.
Et c'est parce que nous savons quelles sont les phases du développement de la culture classique grecque et romaine que nous pouvons aussi savoir où notre propre culture en est aujourd'hui, et que nous pouvons prévoir avec une certaine exactitude où elle en sera d'ici à une centaine d'années, voire à quel moment elle mourra. Spengler, pour sa part, pense que l'Occident se meurt déjà. Quoique certaines précisions devraient encore être apportées, voilà pour l'essentiel le thème de l'interprétation faite par Spengler de l'histoire du monde.
Spengler était complètement inconnu au moment où fut publié le premier volume du Déclin de l'Occident, c'est-à-dire en 1918. Pourtant, la première édition fut presque épuisée du jour au lendemain. Il y en eut une seconde, puis une troisième. Dans les dix années qui suivirent plus de 100.000 exemplaires furent vendus. L'ouvrage fut traduit en français, en espagnol, en italien, en russe, en arabe et en anglais. À elles seules, les ventes de la traduction anglaise atteignirent plus de 25.000 exemplaires dans la période qui précéda la Seconde Guerre Mondiale, et l'on en est aujourd'hui à la cinquième édition. Ce succès remporté par un obscur professeur d'école supérieure allemande ne manque pas d'intriguer.
Il faut évidemment distinguer les réactions du grand public et celles des historiens et des philosophes de profession. Bien des lecteurs “ordinaires” furent attirés par le livre de Spengler pour des raisons psychologiques plus que pour des raisons logiques. Certains furent tout simplement heureux d’être au fait d'une découverte nouvelle et excitante. Certains furent favorablement impressionnés par l’atmosphère de mystère qui s'ajoutait à la difficulté de lire et de comprendre ce professeur de philosophie allemand qui semblait avoir résolu les énigmes de l'histoire du monde. D'autres voulaient savoir ce que l'avenir leur réservait.
D'autres encore espéraient trouver l'explication du grand conflit qui venait de déchirer le monde occidental tout entier ; les Allemands, en particulier, voyaient dans l'ouvrage de Spengler une explication rationnelle de la défaite qu'ils avaient subie, et prenaient comme une consolation le fait que tous les peuples européens fussent ensemble sur le même bateau en perdition. Et puis il y avait le pessimisme de l'auteur. Certains étaient fascinés par ce qu'ils pensaient être le pessimisme général de sa conception de la vie. En fait, de tels thèmes ne sont pas ceux qui comptent le plus dans l'œuvre de Spengler, mais, à l'époque, le grand public en était rarement conscient.
Cet accueil enthousiaste contraste avec l'hostilité presque unanime manifestée par les universitaires. À propos de William James, on a dit que les psychologues le considéraient comme un bon philosophe tandis que les philosophes le prenaient pour un bon psychologue. Que ce soit exact ou non, il n'est pas exagéré de dire, en ce qui concerne Spengler, que la plupart des historiens et des philosophes le considéraient à la fois comme un mauvais historien et comme un mauvais philosophe. On lui reprocha d'avoir voulu chercher dans l'histoire de fausses analogies biologiques. On lui reprocha d'avoir énoncé des faits erronés à propos de presque toutes les cultures dont il avait traité. On lui reprocha de donner dans le spéculatif et l'irrationnel, c'est-à-dire de ne pas être un “scientifique”. Il fut aussi attaqué pour son déterminisme historique, doctrine que rejetaient pratiquement tous les philosophes de son temps.
Spengler, bien entendu, était en mesure de réfuter ces objections et ne manqua pas de se défendre. Si les cultures se comportent comme des organismes, ce n'est certainement pas abuser de la comparaison que de les considérer effectivement comme tels ; c'est au contraire, tout simplement, décrire les cultures telles qu'elles sont. Quant à l'accusation que certaines de ses données étaient inexactes, Spengler la traita par le mépris. Quelle est l'œuvre historique ou philosophique qui n'a pas fait l'objet de telles critiques ? Se tromper sur tel ou tel détail n'invalide en rien, de toute façon, le genre d'interprétation générale de l'histoire présentée dans le livre. Spengler se rendit aussi volontiers à l'accusation qu'on lui faisait de n’être pas “scientifique”. Il entendait faire sienne la raison spéculative et intuitive du métaphysicien, non la raison inductive et discursive de l'historien scientiste ou positiviste (ce que même un critique aussi attentif que R. G. Collingwood n'a pas réalisé). Enfin, en ce qui concerne le déterminisme, Spengler insista sur le fait que le cycle de vie de chaque culture était déterminé, mais que l'action de tel ou tel individu ne l'était pas.
Comme H. Stuart Hughes l'a fait remarquer dans un excellent petit ouvrage sur Spengler, l'année 1919 fut “l'année de Spengler”. En l'espace de quelques années, l’intérêt manifesté par le grand public commença à décroître. Vers 1924, la controverse universitaire était pratiquement éteinte. Le déclin de Spengler fut aussi rapide que son ascension l'avait été. Il n'en publia pas moins plusieurs autres livres, mais aucun ne fut accueilli avec la même attention que Le Déclin de l'Occident.
Parmi les plus importants, il faut mentionner un recueil d'essais comprenant Prussianisme et socialisme (1919), La reconstruction de l'empire allemand (1924), L'homme et la technique (1931) et Années décisives (1933). Ce dernier essai fut le plus controversé des 4 et entraîna la censure officielle de Spengler par les nazis. Spengler publia encore une série de courts articles historiques dans un journal académique, Le monde en tant qu'histoire. L'édition allemande de ses pensées (Gedanken) fut publiée après sa mort, en 1941, par le Dr Hildegard Kornhardt, nièce et exécuteur testamentaire de Spengler. Elle comprend des extraits de la plupart des œuvres parues à ce jour, y compris Le Déclin de l'Occident, et quelques citations extraites de textes inédits.
► William Debbins (prof. au Cornell College, US), préface à l'édition américaine des pensées de Spengler (Aphorisms, GH Regnery Co., Chicago, 1967), tr. fr. : A. de Benoist, Nouvelle École n°33, 1979.

• Les Années décisives
Oswald Spengler a mis l’Europe face à son propre destin. Avec la force des « idées sans parole », il a indiqué à l’homme européen les directions de marche pour l’avenir, tout en le mettant en garde contre un aveuglement intellectuel et politique qui, à la longue, le rendrait esclave d’empires non encore nés, inconnus de lui.
 « Nous vivons une ère fatale » écrivait Spengler. Et qui donc, en 1933, pensait que ces paroles prononcées par un sévère professeur de Munich, déjà célébré comme “prophète” du déclin de l’Occident, se révéleraient peu de temps après si appropriées à la situation politique mondiale en général et à celle de l’Europe en particulier ? Personne, sauf peut-être ces « nouveaux Césars » que Spengler avait vu venir sur la scène de la Grosspolittk internationale, et qui avaient cru faire coïncider cette « ère fatale » avec leur entrée dans un monde qu’ils ambitionnaient de changer profondément, radicalement, inaugurant l’ère de la « politique intégrale », selon la célèbre définition de Carl Schmitt.
« Nous vivons une ère fatale » écrivait Spengler. Et qui donc, en 1933, pensait que ces paroles prononcées par un sévère professeur de Munich, déjà célébré comme “prophète” du déclin de l’Occident, se révéleraient peu de temps après si appropriées à la situation politique mondiale en général et à celle de l’Europe en particulier ? Personne, sauf peut-être ces « nouveaux Césars » que Spengler avait vu venir sur la scène de la Grosspolittk internationale, et qui avaient cru faire coïncider cette « ère fatale » avec leur entrée dans un monde qu’ils ambitionnaient de changer profondément, radicalement, inaugurant l’ère de la « politique intégrale », selon la célèbre définition de Carl Schmitt.
Mais ce n’est pas seulement aux « nouveaux Césars » que Spengler avait voulu s’adresser, dans les années 30, et son but n’était certainement pas d’en devenir le conseiller. O. Spengler a voulu faire et voulu dire beaucoup plus que cela. Il a exhorté l’homme européen a adhérer à une Weltanschauung tout à fait particulière, qui n’est ni celle de l’homme américain, ni celle de l’homme bolchevique ; qui n’accorde aucun crédit aux mythes de l'économisme, du mercantilisme ou du collectivisme ; qui se fait histoire dans un continuel devenir, telle que l’homme faustien réussit à la prendre entre ses mains et à la jeter avec la force d’un authentique défi contre tout et contre tous.
Le risque, bien sûr, c’est la catastrophe, mais aussi la possibilité de la totale résurrection. Il n’y a pas de juste milieu. N’offrant ni perspectives idéales pour l’avenir, ni programmes pour leur réalisation, Spengler décrit en des termes sans équivoque l’horizon politique dans lequel l’homme européen se trouve malgré lui obligé de vivre et d’agir. Et il le fait avec un livre, dans un moment particulier de l’histoire allemande. Le titre est plus qu’éloquent : Années décisives ; le moment extrêmement délicat : en plein dans le climat d’effervescence de la révolution de janvier-mars 1933. Il est né d’une conférence que Spengler avait prononcée en 1930 à Hambourg, et à travers laquelle il n’avait guère trouvé de compréhension. C’est peut-être la raison qui l’avait poussé, en novembre 1932, à entreprendre le travail qui allait devenir Années décisives.
Ce livre, qui contribua à consolider sa réputation, lui procura d’autres ennemis : 100.000 exemplaires furent vendus en 3 mois, mais cela ne l’empêcha pas d’être attaqué, et parfois, violemment, par les nazis, à cause de certaines allusions ayant trait à leur récente prise de pouvoir. Tandis que Mussolini, lui, accueillait avec enthousiasme la parution de Jahre der Entscheidung et le faisait traduire l’année suivante par un professeur de l’université de Pavie, Beonio Brocchieri, on le lisait en Allemagne avec autant de suspicion que de curiosité. La raison et/ou les raisons ? Dans son excellent essai consacré à Spengler (Ombre sull’Occidente, Volpe, Rome, 1973), Adriano Romualdi écrivait :
« On avait eu la Nuit des Longs Couteaux. Spengler aurait dû se réjouir parce que Hitler avait fait ce qu’il recommandait aux nouveaux Césars dans Années décisives : se débarrasser de leurs prétoriens. Mais la purge du 30 juin n’avait pas épargné non plus le camp des conservateurs. Des amis de Spengler, comme Edgar Jung, von Kahr, le compositeur Willy Schmidt (confondu avec une personne homonyme), avaient été tués. Sur la couverture des Politischen Schriften parus en 1932, trônait une phrase de Jung, justement, qui saluait en Spengler le plus grand écrivain politique de l’Allemagne. Désormais, une telle présentation et une telle signature étaient compromettantes ».
Et la jeunesse ? Elle lui réserva beaucoup de déceptions. Face à un livre comme Années décisives, qui ne faisait aucune concession à la standardisation hitlérienne et qui était non pas un texte de combat, mais une tentative d’explication révolutionnaire conservatrice, les jeunes générations allemandes opposèrent un net refus, aveuglées qu’elles étaient par le régime à peine installé. Pour elles, l’année décisive était déjà venue ; il ne pouvait y en avoir d’autres : l’horizon présent de l’Allemagne et de l’Europe excluait une quelconque autre perspective. Le mythe du Dritte Reich les absorbait totalement : ils n’auraient su se préoccuper des « horizons politiques » spenglériens.
Naturellement l’auteur du Déclin de l’Occident fut pesamment contesté. Même la sœur de Nietzsche lui exprima ses regrets pour les positions « peu nationales-socialistes » contenues dans Années décisives, tandis que Günther-Grundel, auteur de La mission de la nouvelle génération, se disait indigné de ce que le nom d’Adolf Hitler ne fût pas prononcé une seule fois dans le livre, Spengler prouvant par là qu’il tenait le Führer « pour quantité négligeable »... Tout cela n’était d’ailleurs pas tout à fait exact, mais la déception d’O. Spengler avait été à la mesure de ses espoirs, comme en témoigne clairement le premier paragraphe de l’avant-propos :
« Personne ne pouvait désirer la révolution nationale de cette année avec plus d’ardeur que moi. Je haïssais, dès le premier jour, l’ignoble révolution de 1918 comme une trahison des éléments inférieurs de notre peuple envers ceux qui, jeunes et forts, se sont levés en 1914 parce qu’ils voulaient et pouvaient avoir un avenir » (p. 29).
Aux mensonges et aux calomnies, Spengler ne devait dédaigneusement opposer aucune réponse. Ses pensées étaient déjà ailleurs : elles naviguaient vers des mondes lointains, éloignés des contingences politiques. Elles étaient tournées vers la préhistoire, la découverte de la tradition primordiale de l’homme européen, pour lequel et autour duquel il aurait voulu élaborer une philosophie cohérente. Les Urfragen (écrits posthumes recueillis et rassemblés organiquement par le professeur Anton Koktanek, disparu prématurément depuis peu) révèlent cette intention. Et Spengler ne parla plus de la suite qu’il avait promis de donner aux Années décisives. Les notes restèrent dans son tiroir, certainement chargées de pessimisme quant au futur de l’Allemagne et d’anxiété quant au rôle que serait sans doute appelée à jouer l’Union soviétique quelques années plus tard...
Pour O. Spengler, l’ère fatale coïncide avec l’époque forte que l’Europe a commencé à vivre après la Première Guerre mondiale, mais il ne se fait pas d’illusions sur la volonté des hommes destinés à participer nécessairement, qu’ils le veuillent ou non, aux transformations dramatiques que le temps réclame.
« L’époque est immense, écrit Spengler dans Années décisives, mais les hommes n’en sont que plus petits. Ils ne peuvent plus supporter de tragédies, ni sur la scène, ni dans la vie. Soucieux et fatigués, ils ne veulent que le happy end des stupides romans de chemin de fer. Mais le destin, qui les a jetés au milieu de ces années, les saisit au collet, et en fait ce qui doit être fait, qu’ils le veuillent ou non. La lâche sécurité de la fin du dernier siècle est finie. La vie de danger, la vraie vie de l’histoire entre de nouveau dans ses droits. Tout est devenu instable. Actuellement, seuls comptent les hommes qui osent, qui ont le courage de voir et de prendre les choses comme elles sont. Le temps viendra — non, il est venu ! — où il n’y aura plus de place pour les âmes tendres ni pour l’idéal des faibles » (p. 53).
Quel est cet « idéal des faibles » pour Spengler ? Il est double : idéologie et religion de larmes. La première est le piteux mensonge de l’utopie comme défense contre la réalité, surtout quand celle-ci est tragique et difficile à affronter. La seconde, en substance, complète la première en ce qu’elle se déploie plus largement, qu’elle prend de la vigueur et s’impose de façon autoritaire quand les âmes faibles, devenues lâches et vieilles, ressentent le besoin de se réfugier en quelque chose qui leur donne confiance, qui les endorme dans l’oubli. Pour Spengler, la religion des larmes est avant tout la religion chrétienne, qui incarne et comprend la « douleur universelle » des hommes, en leur promettant le salut éternel.
Spengler s’élève avec vigueur contre ces « maladies de l’esprit », en écrivant que l’histoire est fondamentalement tragique, brisée par le destin, et qu’elle doit être vécue comme telle, sous peine de sortir précisément de l’histoire. Voilà la nature de l’homme faustien, dont Spengler se réclame si fréquemment, même dans son œuvre politique. Il sait que la lutte est la plus ancienne réalité de la vie, qu’elle est la vie elle-même : et même le plus déterminé des pacifistes ne réussira jamais à l’extirper de l’âme humaine.
Et à la place des pacifistes, Spengler voit venir ceux qui restaureront les droits éternels de la Grosspolitik, considérée comme art du possible, comme l’art d’utiliser ceux qui connaissent la réalité et de gouverner le monde par la force, ainsi que le fait, comme le dit Spengler, tout bon cavalier : par la pression des cuisses. Mais ce sont d’autres continents, d’autres puissances qui sont aujourd’hui là et qui donnent une leçon de Realpolitik à tous ceux qui, en Europe, n’ont pas cru opportun d’écouter Spengler, qui se sont réfugiés dans une assurance contre le destin, et qui feignent la mort face à la vie, dans le happy end d’une existence vide et anonyme : ce sont les autres qui ont jeté les dés du destin de l’Europe, et ils s’en sont réparti les habits. Mais les années décisives n’ont pas encore pris fin. Peut-être en vivons-nous les dernières, inconsciemment, et il se peut que l’Europe ait encore un avenir...
► Gennaro Malgieri, éléments n°35, 1980. Recension : Oswald Spengler, Années décisives, Copernic, 256 p.

analyse
À propos d'une réédition : L'homme et la technique.
Considérations inactuelles sur les dernières œuvres de Spengler.
 Il y a des signes révélateurs. En s’efforçant d’imposer à une pensée dite d’avant-garde une “lecture” de Marx, Althusser (Pour Marx, Maspéro) nous ramène un siècle en arrière, sans même s'en apercevoir. La religion du progrès se confond en effet, dans sa réalité la plus profonde, avec la volonté d'arrêter l'Histoire sur un « instant dernier ». Et de son point de vue, Althusser a raison : Marx est effectivement l'aboutissement, ou du moins amorce-t-il l'aboutissement de la pensée égalitariste occidentale fondée par le christianisme. Ainsi, dans la mesure même où l'humanité contemporaine se déclare égalitariste en majorité, la pensée « moderne » est-elle condamnée à la rumination perpétuelle de Marx, et nos sociétés à répéter, en une sorte de jeu tragi-comique, les vicissitudes du XIXe siècle, et tout spécialement celles du XIXe siècle allemand.
Il y a des signes révélateurs. En s’efforçant d’imposer à une pensée dite d’avant-garde une “lecture” de Marx, Althusser (Pour Marx, Maspéro) nous ramène un siècle en arrière, sans même s'en apercevoir. La religion du progrès se confond en effet, dans sa réalité la plus profonde, avec la volonté d'arrêter l'Histoire sur un « instant dernier ». Et de son point de vue, Althusser a raison : Marx est effectivement l'aboutissement, ou du moins amorce-t-il l'aboutissement de la pensée égalitariste occidentale fondée par le christianisme. Ainsi, dans la mesure même où l'humanité contemporaine se déclare égalitariste en majorité, la pensée « moderne » est-elle condamnée à la rumination perpétuelle de Marx, et nos sociétés à répéter, en une sorte de jeu tragi-comique, les vicissitudes du XIXe siècle, et tout spécialement celles du XIXe siècle allemand.
Le siècle dernier nous a pourtant légué une autre pensée, qui se situe, elle, au-delà de Marx, au-delà du discours bimillénaire de l'égalitarisme. L'œuvre phiiosophique de Nietzsche, l'œuvre artistique et métapolitique de Richard Wagner ont inauguré cette pensée nouvelle, la seule qui puisse se dire véritablement révolutionnaire puisqu'elle représente, dans la perspective cyclique de l'Histoire, le retour d'une première origine complètement oubliée, donc perdue, et par conséquent jamais donnée, mais aussi, dans la perspective linéaire, le dépassement, l'ouverture vers une destinée exaltante inconnue.
Cette pensée, du fait qu'elle est Urdenken, pensée originelle, s'exprime sous des formes qui relèvent du mythe et, génératrice de mythes dans sa jeunesse historique, invite à une véritable création, nous fait accepter consciemment la possibilité d'une mutation de l'homme. Non-égalitariste, anti-égalitariste, elle est aujourd'hui mise au ben ou, lorsque cela s'avère impossible, délibérément abandonnée aux falsifications et aux interprétations abusives. Mais il est évident que notre époque ne pourra s'en tenir à Marx, à la simple répétition d'un instant dépassé, et qu'elle cherche à renouer déjà, plus ou moins consciemment, avec l'« ouverture » située dans le prolongement de la pensée de Nietzche et Wagner. On ne sera donc pas surpris outre-mesure par la parution d'une traduction française de L'Homme et la technique [Der Mensch und die Technik, 1931] d'O. Spengler, chez un éditeur (Gallimard) et dans une collection (Idées) qui se sont surtout faits, jusqu'ici, le véhicule de courants d'idées bien différents.
En couverture, une notice de présentation attire d'ailleurs l'attention du lecteur sur le fait que Spengler « tente de montrer que les privilèges dont jouissent les Blancs vont leur être ravis par les peuples du Tiers-monde, qui se serviront de la technique camme d'une arme contre la civilisation occidentale ». Quos deus vult perdere... [expression latine tirée des Fragments d'Euripide : Quos Deus vult perdere, prius dementat = celui que le Dieu veut perdre, il commence par le rendre fou.] Pessimiste, Spengler affirme en effet que la civilisation occidentale est fatalement condamnée. Pourtant, il ne nous invite point à renoncer, à accepter passivement une déchéance considérée comme inévitable, mais tout au contraire à tenir bon, « tenir, à l'exemple de ce soldat romain dont le squelette a été retrouvé devant une porte de Pompéi et qui, durant l'éruption du Vésuve, mourut à son poste parce qu'on avait omis de venir le relever ».
ceux qui assument le déclin
Pensée mythique, l'œuvre de Spengler prend toute son importante, non pas dans les énoncés immédiats que lui impose la forme logique, obligatoirement logique, de son discours, mais dans la position qu'il assume devant l'Histoìre, dans les jugements de valeur qui fondent sa vision. Cela ne veut pas dire que sa prophétie soit fausse. L'instant d'où il nous parle, tout au contraire, reste inexorablement ouvert sur le déclin de l'Occident. Mais l'attitude qu'il propose, si elle comporte le sacrifice héroïque de l'« occidental » qui est en nous, est aussi la garantie d'une aurore nouvelle concernant ce qui, en nous, est déjà au-delà de l'« Occident égalitaire ».
Spengler lui-même ne cesse de rappeler que sa pensée se situe rigoureusement dans le cadre nietzschéen, ne veut que répondre à la Fragestellung, à la problématique posée par Nietzsche. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue ici : c'est le fait que Spengler, à l'intérieur de ce cadre et placé devant cette problématique, n'assume et ne veut assumer conformément à son tempérament « prussien » que la prospective restreinte du moment vécu par lui, c'est-à-dire ces 3 premières décennies du XXe siècle qui, dans la vision millénaire de Nietzsche, ne représentent que le début d'un nihilisme européen où gît la condition sine qua non de la mutation de l'homme au surhomme. Nietzsche avait écrit : « J'aime celui qui vit pour connaître, et veut connaître pour que le surhomme soit. Et qui, partant, veut son propre déclin (Untergang) ». Spengler a sciemment voulu être de ces hommes, nécessaires, qui assument le déclin.
Dans l'œuvre de Spengler, L'Homme et la technique correspond au début d'un aboutissement de sa pensée, lequel est très mal connu puisqu'il est surtout resté à l'état d'esquisse et de fragments publiés depuis 1966, en 2 volumes, par l'éditeur CH Beek (Urfragen : Problèmes des origines ; Frühzeit der Weltgeschichte : Premier temps de l'histoire universelle). Au premier abord, la vision que Spengler développe dans L'Homme et la technique peut surprendre ceux qui ne connaissent de lui que son Déclin de l'Occident. Il s'agit d'une vision « universelle », apparemment contradictoire par rapport à la vision anti-universaliste du Déclin, et qui propose plusieurs histoires spécifiques, chacune d'entre elles étant le fait d'une Hochkultur (grande « culture ») très particulière, expression d'un type d'homme faisant pour ainsi dire espèce-à-part. Mais cotte contradiction n'est qu'apparente. Spengler englobe clairement la première vision dans la seconde, l'inachèvement de l'englobement proposé n'étant dû qu'à l'inachèvement de l'ensemble de l'œuvre.
deux caractérisations
Selon le “second” Spengler, depuis ses origines, l'humanité a connu 4 grandes « mutations ». Son histoire est donc constituée par 4 moments essentiels : a, b, c, d. Mais Spengler ne précise pas toujours très nettement sa pensée, et ces 4 moments semblent parfois se réduire à trois seulement. C'est le cas précisément dans L'Homme et la technique, dont nous savons maintenant (grâce à l'édition des œuvres posthumes chez C. H. Beck) qu'il constitue la première esquisse d'une pensée en voie de développement.
Dans ses Dispositions pour les “Urfragen”, Spengler caractérisait ainsi les 4 moments fondamentaux de l'Histoire :
- a) Libération des contraintes de l'espèce/ apparition des races/ formation du type humain/ émergence de la conscience (Bewusstwerdung) ;
- b) Crístallisations de population de faible densité en complexes locaux/à partir de - 15.000, baricentres culturels possédant leur champ d'action bien défini ;
- c) « Cultures particulières » (Einzelkulturen ; Spengler emploie le terme de Kultur par opposition à celui de Zivilisation) dispersées dans un monde où l'homme s'est partout répandu/ « Amèbes » de structure organique à partir de – 5000 ;
- d) Hochkulturen (grandes « cultures ») avec « périodes de vie » (Lebenslaufe) pleinement formées vers - 3000/ transformations des cultures dynamiques en civilisations figées (« les fellahs comme ruines »).
Ce découpage est postérieur à celui de L'Homme et la technique en 3 périodes, qu'on peut résumer ainsi :
- 1) Origine de l'homme/la main et l'outil/ Schauen und Ahnen (formule que l'on pourrait traduire par « capacité d'anticipation, de vision divinatrice ») ;
- 2) Langage et entreprise, celle-ci étant « l'action collective concertée »/ Sprechen und Denken, langue et pensée ;
- 3) Dernier temps : avènement et dissolution de la culture machiniste.
Il est difficile de situer les 2 caractérisations l'une par rapport à l'autre. À première vue, elles paraissent se recouvrir : le moment 1 correspond, plus ou moins exactement, aux moments a et b, le moment 2 à la phase c et aux Hochkulturen de la phase d (voir Le Déclin de l’Occident), le moment 3 ne recouvrant que la phase ultime (de civilisation) de la culture faustienne occidentale. D'un autre côté, la correspondance n'est pas parfaite, car les perspectives sont différentes. Tout cela n'a d'ailleurs qu'une importance secondaire par rapport à l'essentiel : la finalité résolument anti-égalitariste de l'œuvre de Spengler.
C'est pourquoi il est tout à fait inutile d'épiloguer sur certaines idées, dues au « langage scientifique » de l'époque de rédaction. Le fait, par ex., que Spengler mette en rapport l'« humanisation » et l'apparition du binôme main-outil, ne nous dit riera de sa conception de l'homme. Il faut donc porter notre regard ailleurs, là où l'auteur situe explicitement la valeur de l'homme par rapport au non-humain. Or Spengler est très clair, et très nietzschéen, sur ce point. L'homme, affirme-t-il, est « un animal de proie », mais un animal sui generis, generis unici, puisqu'il est le seul qui se soit « affranchi des contraintes de l'espèce ».
L'homme peut être considéré comme tel lorsqu'à côté d’« un instinct de l'espèce se perpétuant toujours en pleine force », « la pensée et l'action réfléchie se détachent et prennent leur autonomie par rapport à l'espèce ». Chaque homme (il s'agit ici de l'homme-créateur) est une espèce à lui seul. L'âme de l'homme des origines « est plus profonde et passionnée que celle de n'importe quel autre animal » ; elle « se cantonne dans une attitude d'opposition intransigeante envers le monde entier, dont son propre pouvoir créateur l'a exclue ».
Spengler ajoute : « Et cette âme va constamment de l'avant, dans une séparation toujours plus accentuée d'avec toute la Nature. Les armes des bêtes de proie sont naturelles, mais le poing armé de l'homme, avec son arme artificiellement fabriquée, imaginée et choisie, ne l'est pas. Ici commence l'art en tant que concept antinomique de la nature. Ici aussi commence la tragédie de l'homme : car des deux, la Nature est la plus forte... La lutte contre la Nature est sans espoir ; et pourtant, elle sera poursuivie jusqu'à la fin ».
l’homme contre la nature
Il découle clairernent de ce qui précède que, pour Spengler, l’Histoire est fondée sur la révolte de l'homme contre la Nature, révolte toute entière contenue, déjà, dans son affranchissement des contraintes de l'espèce. C'est cette affirmation qui est fondamentale. En revanche, on peut, et l'on doit, considérer comme insuffisante l'explication donnée par Spengler de la cause de cet affranchissement (l'apparition du binôme main-outil), attitude d'autant plus légitime que Spengler fut le premier à douter de son « explication », pour n'y voir, très souvent, qu'une cause parmi d'autres, ou la condition matérielle préalable mais non suffisante de l'hominisation.
En fait, comme le montrent ses écrits posthumes, Spengler fut préoccupé jusqu'à sa mort par le problème des origines de l'homme, par ce « premier moment » qu'il réussissait à deviner grâce à l'intuition fulgurante de son génie poétique, mais qui toujours échappait à ses efforts philosophiques. Dans L'Homme et la technique, la description de ce « premier moment » reste vague. Spengler nous parle de l’âme de ce premier homme « solitaire », affranchi des contraintes de l'espèce, mais sans jamais préciser les formes concrètes de cet affranchissement ; il fait état d'une « opposition totale » entre l'homme et la Nature, mais sans jamais indiquer par rapport à quelle Nature l'homme des origines se définit concrétement par son action, quel est l'objet concret de sa lutte et de sa domination.
À nos yeux, il s'agit là d'une limitation inconsciemment voulue par Spengler lui-même, puisque c'est elle qui lui permet d'arrêter sa vision tragique de l'histoire, de « tenir bon » dans un présent restreint qu'il assume totalement. Conséquence inévitable, les éléments constituant l'ensemble de la définition de l'humain, au lieu d'être tous placés au moment du début de l'histoire, vont se trouver distribués dans toutes les phases indiquées plus haut. Car il est bien vrai que la révolte de l'homme contre la Nature ne petit être que catastrophíque. Mais si cette révolte se trouve déjà, toute entière, au premier moment de l'histoire, dès le « premier acte historique », alors la destinée tragique de l'homme doit se retrouver, toute entière elle aussi, à chaque moment, comme portée par une volonté d'histoire éternellement réaffirmée, éternellement vouée dans le même geste à l'épopée de la création et à la catastrophe finale qui s'inscrit logiquement dans la réalisation du but.
Au contraire, si la catastrophe n'est pas présente dès le premier moment, elle devient le propre d'un moment final, et c'est une parabole qui mène l'histoire à la tragédie dernière. Spengler veut la destinée tragique de l’humanité, mais, par un immense orgueil prométhéen, il ne revendique l'expérience et la passion de cette tragédie que pour sa civilisation, pour l'homme faustien, c'est-à-dire pour « les Vikings de l'esprit ». Il exprime implicitement cette opinion, peut-être sans s'en rendre compte, dans un passage dont les contradictions et les manques sont pleins de signification.
« La culture faustienne, celle de l'Ouest européen, écrit-il, n'est probablement pas la dernière, mais elle est certainement la plus puissante, la plus véhémente et, conséquence du conflit intérieur entre son intellectualité compréhensive et son manque d'harmonie spirituelle, de toutes la plus tragique. Il est concevable qu'un épigone quelconque vienne à lui succéder (une culture peut voir le jour quelque part dans les plaines, entre la Vistule et l'Amour) dans le prochain millénaire. Mais c'est ici, dans notre culture à nous, que le combat entre la Nature et l'homme (dont la destinée historique l'a conduit à se dresser contre elle) s'achève une fois pour toutes ».
La contradiction est très nette. Si la destinée historique de l'homme s'accomplit dans sa révolte contre la Nature, et si sette révolte doit s'achever dans notre culture faustienne, alors c'est avec elle aussi que l'histoire entière s'achèvera. Que serait donc cet « épigone », cette « culture entre la Vistule et l'Amour », sinon le retour de l'homme dans la Nature, sa retombée dans les contraintes de l'espèce, c'est-à-dire sa ré-animalisation ? Une histoire après l’histoire n'est plus de l'histoire.
Revenons-en au deuxième moment décrit dans L’Homme et la technique, pour y relever les éléments appartenant de droit, contra Spengler, à la définition originelle de l'homme. Le premier est le « langage », qui intervient averc ce que nous appelons maintenant la « révolution néolithique ». Pour Spengler, le solitaire du premier moment, s'il disposait de mots et de gestes, ne possédait pas encore de langage au sens propre (ni grammaire, ni syntaxe). Le langage n'apparaît, en effet, que dans la mesure où il est objectivement imposé par l'« action collective concertée » (l'entreprise), dont les premières manifestations sont l'agriculture et l'élevage. Là encore, nous ne discuterons pas cette affirmation « conjoncturelle », et ferons plutôt porter notre attention sur la façon dont Spengler voit cet élément constitutif.
le problème de l'aliénation
Spengler fait une distinction fondamentale, dans l'entreprise, entre « création-planification » et « exécution », entre les créateurs-nés, qui sont les seuls vrais successeurs des solitaires du moment précédent, et les exécutants, les meneurs et les menés. Citant le Faust de Gœthe, il indique même qu'à ses yeux les menés ne sont que l'outil dans la main pensante des créateurs-nés :
« Quand à mon char
Ma fortune attelle six coursiers,
Leurs membres ne sont-ils pas miens ?
Et n'est-ce pas moi qui foule
Comme l'éclair la piste glorieuse ?
Les vingt-quatre membres sont miens.
Et mienne toutes les forces que j'ai unies. »
[« Wenn ich sechs Hengste zahlen kann, / Sind ihre Kräfte nicht die meine ? / Ich renne zu und bin ein rechter Mann, / Als hätt' ich vierundzwanzig Beine. » - Faust I, 4. Szene (Studierzimmer) / Mephistopheles. Trad. Nerval (1828) : « Si tu possèdes six chevaux, leurs forces ne sont-elles pas les tiennes ? tu les montes, et te voici, homme ordinaire, comme si tu avais 24 jambes ».]
L'homme domestique donc la nature, mais l'homme-créateur domestique aussi l'hommeme-né, qui est un morceau de Nature. On retrouve ici la distinction que fait Nietzsche entre Herrenmenschen et « esclaves », mais avec une précision essentielle : l'« esclave» ne relève pas tant de l'humain véritable, de l'humain historique, que de la Nature, à la fois instrument et objet de l'entreprise des créateurs. Le problème de l'alíénation, qui tourmente fort freudiens et marxistes, reçoit ici l'éclaírage qui peut en permettre la solution : l'aliénation est la nécessaire contrepartie de l'expansion du « créateur », animal de proie affranchi des contraintes de l'espèce, quand il organise et s'approprie en tant qu'outils et instruments, mais aussi comme partie de son corps, les hommes-menés qui sont, eux, partie intégrante de la Nature. Seul peut être libre l'homme qui s'exprime en créant. L'aliénation ne concerne jamais l'homme véritable, celui qui devient tel dans la mesure où il crée, mais seulement l'homme qui reste dans la Nature sans pouvoir s’en affranchir, et ne constitue dès lors qu'une espèce quelconque parmi les autres. Le fait historique par excellence n'est pas l'aliénation, mais le contraire de l'aliénation, c'est-à-dire l'appropriation de toute Nature, humaine y compris, par l'homme-créateur.
Considérant que les binômes langage-entreprise et meneurs-menés ne sont pas des éléments originels, Spengler associe l'avènement de la machine et le déclin des hommes-créateurs. Les créateurs, en effet, n'ont jamais vu dans la technique qu'un simple moyen. lls ont toujours voulu l'effort de création plus que le bénéfice de la création, la chasse plus que la proie. Mais la machine, une fois créée, paralyse l’inspiration créatrice. « La pensée faustienne commence à ressentir la nausée des machines » ; « une lassitude se propage, une sorte de pacifisme dans la lutte contre la Nature (se généralise), la fuite du chef-né devant la machine est commencée ».
Parallèlement, les menés « se mutinent contre leur destinée, contre la machine, contre la vie standardisée, contre tout et contre rien ». Une époque de masses se dessine, « mais la masse n'est rien de plus qu'un résidu négatif (spécifiquement, la négation du concept d'organisation) et non point quelque chose de viable en soi » ; « une armée sans officiers n'est jamais qu'une horde d'humains, désordonnée et inutile ». En outre, il y a eu « trahison de la technique » de la part des Blancs : ils l’ont donnée aux peuples de couleur, et ceux-ci en feront fatalement une arme contre eux, avant de la laisser tomber en ruines.
Poussés jusque dans le détail, la prévision splenglérienne appliquée à notre époque est impressionnante d’exactitude. Comme celle de Nietzsche, elle ridiculise les prophéties “scientifiques”, mais toujours fausses, d’un Karl Marx. Pourtant Splengler ne sait pas, ne veut pas savoir, d'où vient son pouvoir d'anticipation. C'est ce qui l'amène à voir dans la machine la cause du déclin de l'Occident et, par là même, de toute l'humanité historique. Tout en faisant la part de l'époque à laquelle ce texte fut rédigé, nous ne partagerons pas son point de vue.
La civilisation occidentale est condamnée, non pas à cause du progrès technique, mais parce que l'utopie égalitariste qui l'inspire depuis 2.000 ans est entrée en contradiction avec les exigences des sociétés modernes. Acquis à cette utopie, l'homme européen n'est plus en condition d'assumer la destinée du monde, d'être le « créateur » d'un avenir nouveau. Mais c'est aussi en Europe, et seulement en Europe, qu'une nouvelle mutation reste possible, que le refus de l'égalitarisme et du retour à l'espèce s'est manifesté, et se manifeste encore, au-delà de ce qui furent Bien et Mal durant 2 millénaires de « décadence » spirituelle. La pensée de Spengler est une manifestation de ce refus.
le « socialisme prussien »
Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici quelle fut l'attitude de Spengler à l'égard du national-socialisme hitlérien. Elle fut franchement hostile, et parfois venimeuse, même si cette hostilité se situait à l'intérieur de la dialectique anti-égalitaire (dans sa Konservative Revolution, Armin Mohler place Spengler parmi les « trotskystes du national-socialísme »). Dans les écrits posthumes de l'auteur du Déclin, les allusions à la « stupidité » de certaines idées nationales-socialistes, sont fréquentes. Il se moque notamment de la notion de race, soulignant, contrairement à ce que l'on professait au NSDAP, que « race se confond toujours avec sélection, élite », et qu'elle est donc « le fait d'une classe », non d'un peuple.
Ses réticences furent celles d'un social-aristocrate, partisan du « socialisme prussien », qui voyait dans le national-socialisme un mouvement de masse « démocratique » et plébéien. Il rejoignait là l'opinion des autres tenants de la Konservative Revolution, pour qui la “révolution anti-égalitaire” ne pouvait être le fait que d'une élite solitaire, résolument coupée des masses, et qui reprochèrent violemment à Hitler de s’être mis au service de la plèbe lorsqu'aux lendemains de la tragique expérience de novembre 1924, il décida, avec le NSDAP, de faire des masses son outil.
► Giorgio Locchi, Nouvelle École n°13, 1969.

Crise ou déclin de l'Occident ?
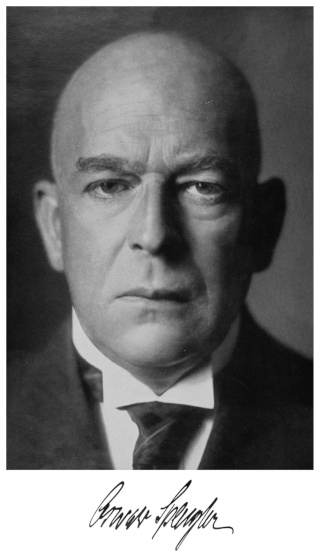 Le Déclin de l'Occident d'Oswald Spengler publié en Allemagne en 1918 et 1922 (la traduction française date de 1931), y remporta « le plus grand succès qu'un livre de philosophie historique ait connu (...) depuis Gibbon » (1). L'histoire y était, en effet, traditionnellement confinée dans les universités, où elle faisait l'objet de monographies savantes dont l’érudition, le pédantisme et la technicité ne pouvaient que rebuter le grand public. Très critique à l’égard des méthodes universitaires, Spengler présentait au contraire à celui-ci une vaste fresque historique, écrite avec talent par un poète et un visionnaire, capable de mettre à sa portée son immense culture et de lui faire partager sa passion pour l'Histoire ; et qui, de plus, traitant de thèmes en vogue dans les années 20, répondait admirablement à ses préoccupations.
Le Déclin de l'Occident d'Oswald Spengler publié en Allemagne en 1918 et 1922 (la traduction française date de 1931), y remporta « le plus grand succès qu'un livre de philosophie historique ait connu (...) depuis Gibbon » (1). L'histoire y était, en effet, traditionnellement confinée dans les universités, où elle faisait l'objet de monographies savantes dont l’érudition, le pédantisme et la technicité ne pouvaient que rebuter le grand public. Très critique à l’égard des méthodes universitaires, Spengler présentait au contraire à celui-ci une vaste fresque historique, écrite avec talent par un poète et un visionnaire, capable de mettre à sa portée son immense culture et de lui faire partager sa passion pour l'Histoire ; et qui, de plus, traitant de thèmes en vogue dans les années 20, répondait admirablement à ses préoccupations.
Les historiens de profession, en revanche, non seulement en Allemagne mais également à l'étranger — et plus particulièrement en France (2) — se montrèrent scandalisés par le non-conformisme et le manque de sérieux d’un auteur qui avait l'audace de traiter d'un sujet aussi ambitieux, sans faire partie du sérail (Spengler avait fait des études de sciences naturelles), et, qui plus est, en se moquant des méthodes et des conventions universitaires. Les libéraux et les marxistes (qui n'admettaient pas sa critique de l'idée de progrès et son mépris pour la démocratie et/ou l’économie), ainsi que les chrétiens (hostiles à une philosophie déterministe méconnaissant la primauté et la liberté de la personne) se rangèrent également du côté des détracteurs de Spengler.
Les nazis (3) qui, dans les années 20, avaient partagé l'engouement de leurs compatriotes pour Le Déclin de l'Occident, dans lequel ils retrouvaient des thèmes qui leur étaient chers — nous y reviendrons plus loin — se montrèrent beaucoup plus réservés au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient du pouvoir, le fatalisme et le pessimisme de l'auteur se révélant difficilement compatibles avec l'idéologie d'un parti qui prétendait changer l'Allemagne et le monde et s'efforçait pour cela d'obtenir l'adhésion et la collaboration enthousiastes des masses. La rupture intervint peu après la prise du pouvoir, les vainqueurs ne pouvant pardonner à Spengler les critiques acerbes qu'il leur avait adressées dans son dernier ouvrage, Les Années décisives (1933), où il écrivait not. : « Ce qui promettait au début de grandes choses, finit dans la tragédie ou la comédie » (4).
Malgré les réticences ou l'hostilité de ces différents milieux, Le Déclin de l'Occident eut un grand retentissement sur l'intelligentsia européenne de l'entre-deux-guerres, inspirant not. à P. Valéry sa fameuse apostrophe : « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles » (5). Le redressement et l'essor spectaculaires des pays occidentaux, au cours des Trente Glorieuses, ainsi que le discrédit des philosophies de l'histoire héritées du XIXe siècle, ont contribué à détourner le public de cette œuvre pourtant importante. Aussi nous a-t-il semblé opportun de lui consacrer un article, dans la mesure où la crise actuelle révèle rétrospectivement la pertinence, voire le caractère prophétique du diagnostic effectué au début du siècle par Spengler.
Pour en convaincre nos lecteurs, nous n'insisterons pas sur sa philosophie déterministe et organiciste, qui apparaît aujourd'hui comme l'aspect le plus contestable de sa pensée, préférant centrer notre exposé sur sa description des symptômes du déclin de la culture occidentale, afin de les confronter à l'analyse fédéraliste de la crise. Cependant, il nous paraît nécessaire, au préalable, de définir les grandes lignes de la méthode qu'il utilise pour ses recherches, ainsi que les concepts-clés sur lesquels elle s'appuie.
I. Prolégomènes méthodologiques
◘ 1. Une “morphologie de l'histoire universelle”
Le Déclin de l'Occident a pour sous-titre : Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle (6). Spengler insiste sur l'originalité d'une telle entreprise. Jusque-là, sous le couvert d'histoire universelle, on brossait une fresque « ptolémaïque » de l'univers : des « millénaires d'histoire la plus grandiose et des cultures gigantesques » gravitaient autour de l'axe immobile de l'Europe occidentale, éclairés par la lumière de ce « soleil central » ; aussi expédiait-on l'étude de ces cultures satellites en quelques pages ou chapitres, pour se consacrer à la seule qui soit vraiment importante, la nôtre. Cette conception européocentriste s'articulait sur un schéma temporel à la fois simpliste et faux : “Antiquité — Moyen-Âge — Temps modernes”, schéma inspiré par la croyance au progrès, à l'unité et à la continuité des cultures, et qui tendait à prouver la suprématie de la civilisation occidentale (I, 28, 216).
Ayant consacré lui-même des années de son existence à étudier les grandes cultures (gréco-latine, égyptienne, chinoise, indienne, arabe, mexicaine et occidentale), Spengler affirme leur hétérogénéité fondamentale et la discontinuité de l'histoire (I, 176 ; II, 7). Il lui semble pourtant que celle-ci comporte « un nombre de formes phénoménales limité, que les âges, les époques, les situations se renouvellent par type » (I, 16). C'est à partir de cette intuition qu'il conçoit son projet ambitieux. Accordant à chaque culture sa spécificité et une importance égale, renonçant à l'histoire linéaire et chronologique, qui débouche sur une juxtaposition de monographies, il choisit une méthode comparative, de caractère symchro-diachronique, afin d'étudier les cultures les unes par rapport aux autres, en confrontant perpétuellement les différentes étapes de leur développement et leurs réalisations caractéristiques (artistiques, philosophiques, politiques, etc.).
Dans une première partie, intitulée Forme et réalité, il se penche sur le « langage formel des grandes cultures » (système des nombres, conception de l'histoire et du cosmos, production artistique, philosophique et scientifique) pour en dégager « les fondements d'une symbolique ». Celle-ci est recherchée à la fois dans les rapports existant entre ces différents langages à l'intérieur d'une même culture (par ex. entre le système des nombres, l'organisation économique et les rites mortuaires de l'ancienne Égypte) et les rapports qui peuvent être établis entre chacun de ces langages et les cultures qui l'ont utilisé (par ex. entre le drame antique et la tragédie classique, ou entre l'architecture des pyramides et celle des églises gothiques). Dans une 2ème partie intitulée Perspectives sur l'histoire universelle, il part « des faits de la vie réelle » (tels que les villes, les peuples, l'État, les classes sociales, l'argent et la machine) afin de tirer de l'étude des pratiques humaines des enseignements permettant de mieux assumer l'avenir qui nous est réservé (I, 62).
◘ 2. Définition des concepts : culture et civilisation
Se réclamant de la conception organiciste de l'Univers des romantiques allemands, not. de Gœthe (I, 37, 60), Spengler définit la culture comme « la langue par laquelle une âme peut dire ce qu'elle ressent », comme le « corps mortel et périssable de cette âme, rendue sensible dans les faits et les œuvres » (I, 178). On peut donc dire que, grosso modo, il appelle culture ce qu'on désigne en français par le terme de civilisation, c-à-d. la société envisagée dans ses différents aspects politiques, économiques, sociaux et culturels. C'est le sens que nous donnons nous-mêmes à ce terme, considérant la culture comme l'un des secteurs constitutifs d'une civilisation. Les cultures étant assimilées par Spengler à des organismes (I, 112), leur évolution parcourt les mêmes phases que celle de l’être humain : « chacune a son enfance, sa jeunesse, sa maturité et sa vieillesse » (I, 115) ; phases qui équivalent également aux 4 saisons de la nature.
De plus, chaque culture et chacune des étapes de son développement « a une durée déterminée, toujours la même » : sa longévité est approximativement de mille ans ; celle-ci se décompose à son tour en périodes tricentenaires (c'est le temps que durent le baroque et l'ionique, la plastique attique, la mécanique galiléenne ou le contrepoint), qui comportent elles-mêmes des cycles de 50 ans — la durée de 2 générations — correspondant au « rythme du devenir politique, social, artistique » (I, 117). Spengler se rallie autrement dit à la théorie des cycles, formulée à la même époque par les économistes, mais dont il étend la validité à la société toute entière. Les cultures comportent toutes un nombre limité d'expressions nouvelles : quand « la quantité totale des possibilités intérieures s'est réalisée au dehors, la culture se fige brusquement (...). Ses forces se brisent — elle devient civilisation » (I, 114). Si bien que « chaque culture a sa propre civilisation » qui représente son « destin inévitable ».
Envisagée dans cette perspective, « la civilisation pure, en tant que fait historique, consiste dans une exploitation graduelle des formes devenues anorganiques et mortes ». Elle constitue autrement dit l'expression ultime et pétrifiée d'une culture. Spengler précise, à titre d'exemple, que « le passage de la culture à la civilisation s'accomplit dans l'antiquité au IVe siècle, en Occident au XIXe siècle » (I, 43-44). De plus, il souligne incidemment le fait trop souvent négligé par ses critiques, que le déclin de l'Occident, dont les « premiers symptômes » sont d’ores et déjà perceptibles, ne se produira qu'« aux premiers siècles du prochain millénaire » (I, 114).
Il est donc beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la pertinence de ses prévisions. Nous verrons d'ailleurs qu'il semble parfois les oublier lui-même quand il analyse les manifestations actuelles de ce déclin futur. L’ambiguïté provient du fait qu'il existe logiquement pour lui 2 déclins, bien qu'il n'ait pas formulé clairement cette idée : d'abord celui des cultures puis celui des civilisations qui leur succèdent. Or, ce qu'il prétend lui-même étudier, ce n'est pas le déclin de l'Occident (comme le suggère malencontreusement le titre de son ouvrage), mais le « déclin de la culture européenne d'Occident, répandue aujourd'hui sur toute la surface du globe » (I, 62), déclin achevé au XIXe s. ; ainsi que les caractéristiques de la civilisation établie sur ses décombres. Il y a donc lieu de regretter le manque de rigueur dont Spengler fait preuve dans la définition des concepts et des postulats utilisés pour ses recherches. Les termes de crise et de déclin prêtent également à confusion.
Crise et déclin
Spengler ne distingue pas, comme nous le faisons, crise et décadence ; 2 allusions à la « grande crise du présent » (I, 46, 60) permettent toutefois de penser que, tout en faisant implicitement cette distinction, il a négligé de la formuler. Le déclin étant pour lui la « fin qui menace toutes les cultures vivantes », et à laquelle elles ne sauraient échapper, lui apparaît comme un accomplissement plutôt que comme un naufrage ou une catastrophe (7) ; en tant que tel, il doit être accueilli avec lucidité et courage, ou mieux encore avec l'enthousiasme que devrait susciter l'amor fati (I, 114).
Contrairement à Spengler, nous estimons nécessaire d'éviter la confusion, fréquente de nos jours, entre crise et déclin. Pour faire comprendre ce que signifie le terme de crise, appliqué à une société, nous partirons des postulats suivants.
Toute société constitue un système, c'est-à-dire un ensemble de structures (i), fonctions (ii), normes (iii) et forces (iv) liées par des rapports complexes d'interdépendance assurant, en temps normal, son « équilibre ». Équilibre qui n'est pas statique mais dynamique, dans la mesure où les systèmes sociaux sont dotés des propriétés de tous les organes vivants, c'est-à-dire des facultés d'auto-conservation (i), d'auto-apprentissage (ii), d'auto-régulation (iii) et d'auto-transformation (iv) (8). L'équilibre, par-là même, est nécessairement précaire, de même d'ailleurs que le déséquilibre : ils représentent des tendances plutôt que des États. En vérité, le seul « équilibre » positif, souhaitable, fécond, est un déséquilibre maîtrisé.
Les réflexions qui précédent, not. la dernière, sont d'une importance décisive, car elles révèlent la nature essentiellement conflictuelle de toute société : les heurts (i), les antagonismes (ii), les conflits (iii), voire les conflits maîtrisés (iv), constituent la trame de l'histoire et le moteur de l'évolution. De sorte que le déséquilibre — d'aucuns disent le “chaos” (9) — est la condition de tout progrès, dans la mesure où il peut être contrôlé et dominé. L'équilibre n'est rien d'autre que la maîtrise du déséquilibre antérieur, et son orientation positive.
Une crise se manifeste lorsqu'un système qui tendait vers l'équilibre, commence à tendre vers le déséquilibre, parce qu'il se trouve confronté à un problème important, d'origine interne ou externe et de nature diverse (religieux, culturel, économique, géo-climatique ou autre) qu'il ne parvient pas à résoudre. Il convient néanmoins de distinguer entre crises mineures, provoquées par des difficultés localisées qui peuvent être résolues par des réformes permettant de rétablir et améliorer l'équilibre compromis ; et crises majeures qui atteignent la société dans son ensemble. Une crise majeure met celle-ci en demeure de choisir entre 2 solutions extrêmes : l'une négative, consistant à subir avec résignation les maux qui l'accablent, à s'abandonner aux déterminismes qui, tôt ou tard, entraîneront son éclatement et sa disparition ; l'autre positive, qui implique une transformation globale des structures existantes, autrement dit, une révolution.
Le déclin ou la décadence ne s'installent que lorsqu'une crise majeure se prolonge et s'aggrave, et qu'on persiste à vouloir en venir à bout par des réformes localisées, qui s’avèrent insuffisantes et inefficaces, au lieu d'adopter les mesures révolutionnaires qui s'imposent. Ils ne présentent pas un caractère nécessaire et ne deviennent irréversibles qu'en raison du manque de lucidité, de compétence et de courage des élites. C'est ainsi que, dans les années 80, les États-Unis ayant pris conscience du déclin qui les menaçait (10), ont réussi à opérer, en une dizaine d'années, un redressement spectaculaire, auquel personne ne s'attendait, du moins sur le plan économique. Il reste à espérer qu’après avoir renoué avec la croissance, ils ne négligeront pas la réforme des autres secteurs (not. celle de l'enseignement public, qui conditionne l'avenir d'un pays) ; faute de quoi, les risques de déclin ne manqueront pas de resurgir.
La crise de la civilisation occidentale — et non son déclin — commence, nous semble-t-il, aux alentours du XIVe s., et s'oriente aujourd'hui seulement vers son paroxysme (11).
Âmes apollinienne, magique et faustienne
Tout en affirmant l'hétérogénéité des cultures et leur originalité foncière, Spengler admet, nous l'avons dit, l'existence de certaines constantes (dans les formes, les époques, les situations) sur lesquelles il se fonde pour distinguer 3 types fondamentaux, dont la parenté procède d'une communauté d'âme : l'âme apollinienne caractérise la culture antique (gréco-romaine) ; l'âme magique, la culture arabe ; l'âme faustienne, la culture occidentale depuis le Xe s. Cette dernière apparaît diamétralement opposée à l'âme apollinienne qu'il définit par le sens de la mesure et de la finitude, la tendance à préférer la contemplation à l'action, à subir le destin plutôt qu'à prétendre en modifier le cours, et à vivre hors de soi-même dans un éternel présent.
L'âme faustienne, au contraire, implique le refus des limites et l'aspiration à l'infini, la démesure et la volonté de puissance, le goût de l'action conjugué à celui de l'introspection, la conscience du temps, de l'histoire et de la valeur irremplaçable de la personne. À l'idéal antique du désintérêt à l'égard du monde, de l'ataraxie et de la tolérance, l'Occident oppose l'ambition de conquérir, dominer et changer l'homme et le monde, « la propension à ériger sa morale personnelle en vérité générale » et à « l'imposer à l'humanité », propension qui conduit au fanatisme et à l'inquisition. Prenant le contre-pied de la sagesse épicurienne du carpe diem, il exalte « l’être agissant, luttant, triomphant » de ses imperfections et des difficultés extérieures. Ces différentes composantes de l'âme faustienne ont incité les Occidentaux à étendre leur civilisation sur toute la surface du globe, ce qui ne s'est produit pour aucune autre culture (I, 179 sq., 295, 302, 322-326, 345, 393).
◘ 3. Une méthode comparative et synchro-diachronique
Condamnant l'histoire chronologique, linéaire et européocentrique, ainsi que la philosophie du progrès qui la sous-tend, convaincu de l'hétérogénéité, de la discontinuité et de l'équivalence des grandes cultures, Spengler professe un relativisme généralisé. Il affirme sans ambages que « les vérités immuables » et les « connaissances éternelles » n'existent pas, que « pour des hommes différents, il y a des vérités différentes » (I, 37). Partout et toujours, en effet, les penseurs ont tendance à considérer les vérités qu'ils découvrent comme seules et universellement valables, sans s'aviser du fait que « toute idée vit dans un univers historique, dont elle partage par conséquent le destin général de la caducité » (I, 53).
Aussi conteste-t-il la thèse du formalisme kantien, que Lévi-Strauss reprendra à son compte un demi-siècle plus tard : « la constance de la structure de l'esprit, (...), est une illusion », l'histoire visible offrant « plus d'un style du connaître » ; prenant donc par avance le contre-pied de la méthode structuraliste, il n'hésite pas à affirmer que « la nature dernière des choses ne peut être déduite de leur constance, mais uniquement de leur variété » (I, 70). Formule contestable, d'une part, parce qu'elle contredit le relativisme de l'auteur lui-même (la « nature dernière des choses » n'est-elle pas, d’après lui, inaccessible ?) et sa propre pratique (il ne s'interdit pas, nous l'avons vu, de procéder à des généralisations) ; d'autre part, parce qu'elle oppose dés termes qui sont en réalité interdépendants.
Le relativisme affiche par Spengler l'incite à dénoncer la prétention de l'Histoire à constituer une science. Elle se distingue en effet fondamentalement des sciences de la nature qui traitent du mécanique et de l'étendue — et dont l'objectif est de découvrir des lois et des rapports de causalité, de caractère quantitatif. À ce savoir qu'il appelle « systématique », il oppose la connaissance « de l'organique, de l'histoire et de la vie », connaissance d'ordre qualitatif, qu'il désigne par le terme de « physionomique » (I, 108). L'histoire doit donc abandonner la recherche des causes aux sciences de la nature, et se contenter de « laisser parler les choses, (...) de sentir le destin qui les dirige et d'en observer les métamorphoses, le fondement de ce destin ne ressortissant pas à l'intelligence de l'homme » qui ne peut accéder, dans le meilleur des cas, qu'à « des formes sans cause ni fin, des formes d’être pur, qui servent de fondement à l'image changeante de la nature » (II, 35). La recherche historique représente à la rigueur une « pré-science », dans la mesure où elle commence par « rassembler, classer, éclaircir les matériaux ». Elle s'apparente ensuite à la poésie plutôt qu'à la science, étant donné qu'elle n'implique pas seulement « un travail », mais « une création » (I, 104-109) qui requière des aptitudes et une méthode foncièrement différentes de celles de la science.
Rejetant tout esprit de système (12), toute prétention scientifique, Spengler opte donc délibérément pour une recréation poétique du passé qui, prenant appui sur les documents et les données disponibles, s'efforce de mettre en lumière les « formes » dans lesquelles s'incarnent l'âme et le destin des sociétés. Bien qu'il ne précise pas ses sources, il est probable qu'il a emprunté ce concept à l'école allemande de la Gestalt — ou psychologie de la Forme — qui prend son essor dans les premières années du XXe siècle et considère les faits psychiques comme des unités organiques dont les éléments sont interdépendants.
La « morphologie de l'histoire », inaugurée par Spengler, suppose « une sorte de sensibilité intérieure, difficile à décrire » et « innée », un « regard perspectif », un « tact physionomique » capable de percevoir « la forme et la logique intérieures » du vivant, « d'extraire d'un visage une vie entière, de l'image d'une époque la destinée de peuples entiers, sans arbitraire, sans “système” » ; et de découvrir les « affinités » qui peuvent exister « entre les formes d'art plastique et guerrières ou administratives » ou « entre les figures politiques et mathématiques » au sein d'une même culture (I, 59, 109-111, 122, 161). Ainsi conçue, l'histoire exige une méthode nouvelle, fondée sur la comparaison et la capacité à conjuguer synchronie et diachronie.
Les historiens ont toujours eu recours à des comparaisons, mais celles-ci restaient fragmentaires et arbitraires, fondées sur l'intuition plutôt que sur des principes cohérents (I, 16-17), et sur la ressemblance extérieure qui se révèle souvent trompeuse (I, 39). Il y a, en effet, « dans l'histoire des hommes, comme en zoologie et botanique, des phénomènes qui se ressemblent à s'y tromper sans avoir la moindre parenté intérieure (...) et d'autres qui en dépit de leur très grande différence extérieure expriment des choses identiques ». On compare souvent, par ex., des conquérants comme Alexandre, César et Napoléon. La comparaison entre Alexandre et Napoléon, est seule pertinente : tous 2 sont inspirés par un grand projet politique et opèrent le passage de la culture à la civilisation, alors que César incarne le triomphe de la force et des instincts primaires, qui caractérise la fin des civilisations (I, 50).
Spengler emprunte à la biologie le concept d'homologie des organes qui désigne leur « équivalence morphologique » et celui d'analogie « qui concerne l'équivalence des fonctions ». Sont créations homologues, par ex., le bouddhisme hindou et le stoïcisme romain, « voix séniles » de vieux univers, ayant en commun le mépris de l'action et de l'énergie organisatrice (I, 139) ; analogues en revanche sont le mouvement dionysien et la Réforme, considérés tous 2 comme une « insurrection ethnique collective contre les grandes formes du passé » (I, 119). Le traducteur de Spengler insiste dans son Introduction sur le fait que l'étude de 8 cultures lui a montré partout « une évolution parallèle, homologue et non analogue » (II, 8).
L'homologie des phénomènes historiques incite Spengler à considérer comme simultanés (I, 38) ou “contemporains” « deux faits historiques qui, chacun dans sa culture, se manifestent exactement dans la même situation — relative — et ont par conséquent un sens exactement correspondant (...). L'ionique et le baroque sont nés en même temps (...). La Réforme, le puritanisme et surtout le passage à la civilisation apparaissent dans toutes les cultures à la même époque. Cette époque porte dans l'antiquité les noms de Philippe et d'Alexandre ; en Occident, l'événement correspondant apparaît sous la forme de la Révolution ou de Napoléon » (I, 119). Pour résumer et illustrer les résultats de ces considérations, Spengler a élaboré un tableau synoptique qui présente horizontalement les époques spirituelles, esthétiques et politiques “contemporaines” des cultures étudiées, et verticalement les étapes (printemps, été, automne, hiver) de leur évolution (I, 63).
La méthode suivie — qu'il compare lui-même à celle de la paléontologie —, doit permettre non seulement d'éclairer le passé, mais aussi de reconstituer des époques ou des cultures inconnues, éteintes depuis longtemps, et de prévoir l'avenir, les grandes cultures dont nous connaissons l'histoire intégrale, nous indiquant la ou les phases ultérieures de notre propre évolution étant donné l'homologie qui caractérise le développement des sociétés (I, 120).
Conscient, bien avant Michel Foucault, du fait que le discours historique appartient lui-même à l'histoire, Spengler en déduit l'impossibilité d'une histoire objective. Mais loin de s'en plaindre, il estime au contraire que la subjectivité de l'historien est un facteur positif : « la connaissance experte des hommes n'exclut pas, elle exige même que nos jugements portent une nuance trés marquée d'équation personnelle » (I, 30). L'histoire étant en effet proche de la poésie, ce sont les dons de l'historien qui conditionnent avant tout la qualité de ses travaux. La science elle-même n'allait lias tarder à découvrir que la prétendue objectivité n'existe pas dans les sciences de la nature, ni même dans les sciences dites exactes, la personnalité de l'observateur et les conditions dans lesquelles il effectue ses expériences intervenant nécessairement sur les résultats qu'il obtient.
Si bien que Spengler, après avoir été considéré avec suspicion par ses pairs pour son interprétation subjective et romantique de l'histoire, fait aujourd'hui figure de précurseur, et pas seulement sur ce chapitre ! En effet, certaines de ses intuitions ont révélé leur fécondité un demi-siècle plus tard. Son intérêt pour les “formes” qui révèlent la structure logique des phénomènes étudiés, a frayé la voie au structuralisme ; son refus de l'esprit de système, incapable d'appréhender la logique du vivant, et sa quête d'une méthode adaptée à cet objectif, font de lui l'un des promoteurs de l'analyse systémique ; enfin, en affirmant la discontinuité de l'histoire et l'hétérogénéité fondamentale des cultures, il a inspiré tout un courant de la pensée contemporaine, dont le sociologue G. Gurvitch se fait l’interprète quand il dénonce « l'illusion de la continuité et de la comparabilité entre les types de structures globales [autrement dit les civilisation] qui restent, en réalité, irréductibles » (13).
On peut certes reprocher à Spengler sa conception naïve de l'homologie et de l'analogie, fondée sur le postulat erroné d'une similitude entre la société et l'organisme biologique. Il n'en a pas moins senti la nécessité de dépasser la ressemblance apparente pour découvrir les affinités structurelles qui peuvent exister entre des civilisations dont il reconnaît par ailleurs l'hétérogénéité fondamentale. La science de son époque n'ayant pas encore élaboré les instruments qui permettent de réaliser cet objectif, il a dû en définitive s'en remettre à son intuition, à ce « tact physionomique » indéfinissable, qu'il possédait à coup sûr, mais qui ne saurait garantir la validité des conclusions. La méthode structurale et l'analyse systémique permettent aujourd'hui de procéder de manière plus rigoureuse, en opérant non sur des faits, en soi incommensurables, mais sur les structures de ces faits, c-à-d. sur les rapports plus ou moins invariants qu'il est possible d'établir entre eux, en recourant à différents procédés (analyse conceptuelle, construction de modèles, formalisation, etc.) (14).
La théorie fédéraliste des crises, bien qu'elle ne doive rien à la pensée de Spengler et récuse sa philosophie de l'Histoire, recoupe néanmoins certaines des thèses du Déclin de l'Occident, non seulement dans l'analyse des symptômes, mais également sur le plan méthodologique, la méthode analectique et synchro-diachronique qu'elle utilise (15) présentant des points communs avec sa « morphologie historique comparée », bien qu'elle exploite les découvertes récentes de l'analyse systémique que Spengler ne pouvait connaître, mais qu'il a brillamment anticipées. Nous n'insisterons pas sur ce sujet qui risque de rebuter le lecteur, afin d'examiner dans les pages qui suivent les symptômes qui lui paraissent caractériser le déclin des sociétés.
II. Les symptômes essentiels du déclin
Soucieux de respecter l'économie de la pensée de Spengler, nous commencerons par les symptômes culturels du déclin auxquels il consacre les plus longs développements (les 6 chapitres de son premier volume et 2 chapitres du second), pour aborder ensuite, comme il le fait, ses aspects politiques, sociaux et économiques qui sont traités plus rapidement dans 3 chapitres du second volume.
◘ 1. Secteur culturel
A – manque de créativité
Pour Spengler, chaque culture est caractérisée par un style original, et un seul, « qu'il s'agisse de celui des arts, des religions, des idées, ou du style de la vie même ». « Les styles ne se succèdent pas comme des vagues ou des pulsations » : le roman, le gothique, le baroque, le rococo, sont autant de phases d'un même style, autant d'expressions différentes de la jeunesse et de la maturité du monde occidental (I, 201).
• A – 1) Fin du “grand style”
Le passage de la culture à la civilisation se signale par l'extinction du « grand style », qui fait place à la mode et au goût. La mode commande désormais la succession et l'alternance des genres de peinture, des procédés littéraires, des formes anciennes ou modernes, indigènes ou exotiques : « la nécessité intérieure manque (...) L'art s'industrialise dans toute son étendue, en architecture et en musique, dans la poésie comme au théâtre ». Il devient « décoratif » (I, 193, 284).
« L'art vivant » étant défini comme « harmonie parfaite entre le vouloir, le devoir et le pouvoir, évidence du but et inconscience des moyens de réalisation, unité de l'art et de la culture », l'art décadent présente les caractéristiques inverses : les artistes contemporains « sont obligés de vouloir ce qu'ils ne peuvent plus, de travailler, de calculer, de combiner avec l'intellect, là où l'instinct discipliné est mort » (I, 280-281). N'étant plus capables de créer, ils sont condamnés à imiter indéfiniment les œuvres de leurs prédécesseurs ou à s'adonner laborieusement à toutes sortes d'expérimentations (I, 203, 278).
Cependant, quand il s'agit de déterminer à quelle époque les arts dégénèrent, Spengler affirme tantôt que « les possibilités architectoniques » de la peinture et de la musique « sont épuisées depuis cent ans » (I, 52), c-à-d. depuis le début du XIXe s. ; tantôt que « la peinture à l'huile s'est éteinte à la fin du XVIIe siècle » (I, 276) et que la musique finit avec le Tristan de Wagner (I, 279), autrement dit en 1859. De plus, après avoir critiqué sévèrement l'impressionnisme, il hésite ensuite à l'inclure dans sa condamnation de l'art moderne et conclut prudemment : « ce qui se fabrique aujourd'hui en art est de l'impuissance et du mensonge, aussi bien dans la musique post-wagnérienne que dans la peinture postérieure à Manet, à Cézanne, à Leibl et à Menzl » (I, 282).
Des jugements aussi péremptoires prouvent le conservatisme de Spengler, son manque d’ouverture aux formes d’expression nouvelles, l'époque où il écrit étant particulièrement féconde, not. sur le plan artistique où les courants les plus divers — symbolisme, expressionnisme, pointillisme, fauvisme, art nouveau —, fleurissent et se succèdent à un rythme sans précédent. L'erreur qu'il commet en condamnant sans appel toute tentative d'innovation, de nombreux intellectuels, avant lui et après lui, s'en sont rendus coupables. La polémique engagée récemment par Mare Fumaroli, Jean Clair, Jean Baudrillard et Kostas Mavrakis au sujet de l'art contemporain, dans différentes publications (Le Figaro, l’Événement du Jeudi, Libération, la revue Krisis), témoigne d'une imprudence similaire (16). Le temps se chargeant généralement de distinguer, dans la production d'une époque, le bon grain de l'ivraie, il vaut mieux s'abstenir de vouer aux gémonies ce qu'on ne comprend pas ou n'apprécie pas. Il nous semble en tout cas que notre siècle ne manifeste guère, dans ce domaine, les symptômes caractéristiques des périodes de décadence, où tradition et conservation tendent à l'emporter sur la création et où triomphent l'académisme, le formalisme et l'éclectisme, même si certaines de ces tendances se font jour. Aucune époque antérieure n'a fait preuve d'une telle fièvre d'innovation ; si celle-ci fléchit dans les dernières décennies, il semble prématuré d'en déduire que l'art est dans une impasse et d’une totale nullité.
• A – 2 ) Épuisement de la philosophie
Dans le domaine philosophique, Spengler déplore également l'épuisement de la métaphysique et de l'éthique (comme dans l'antiquité entre 350 et 250) après Wagner et Nietzsche. Depuis leur disparition, il n'y a plus qu'« une philosophie professorale des professeurs de philosophie » (expression empruntée à Schopenhauer), qui étant « sans prise ni emprise sur la réalité, ne sera jamais une philosophie de premier rang ». Le « socialisme éthique » (que Spengler distingue du « socialisme économique », c-à-d. du marxisme) (17), après une période de « grandeur passionnée », vers le milieu du XIXe s., s'est dégradé à son tour en « pratique des questions économiques du jour » (I, 53, 337, 351-357). Pour Spengler, en effet, les grands philosophes ont toujours cherché à conjuguer la pensée et l'action, en assumant des responsabilités dans la société dans laquelle ils vivaient si bien que leur démission récente, le fait qu'ils renoncent à se battre pour leurs idées, témoigne du peu d'importance qu'ils accordent eux-mêmes à celles-ci.
Aussi prévoit-il qu'« on finira par abandonner (...) la croyance aux théories en général » (II, 418). N'est-ce pas ce qui se passe à notre époque, où le discrédit des idéologies et — il faut bien le reconnaître — l'absence de maître à penser d'envergure, incitent nos dirigeants à se réfugier dans un pragmatisme borné et inefficace ?
Nous ne pouvons que lui donner raison sur ce chapitre ; en revanche, l'idéal du philosophe engagé, s'il tend effectivement à disparaître au XIXe s., s'affirme à nouveau dans la seconde moitié du XXe s., avec les philosophies personnaliste et existentialiste. De plus, la métaphysique et l'éthique, dont Spengler annonçait la disparition, bien que battues en brèche par le néopositivisme logique des écoles de Cambridge et de Vienne et par le structuralisme, continuent à inspirer les recherches des penseurs contemporains, not. de ceux qui se réclament peu ou prou de l'existentialisme heideggerien ou du personnalisme, comme E. Lévinas, Ph. Cormier, Ch. Taylor, H. Jonas, J. Rawls ou J. Habermas, malgré la tendance de la plupart d'entre eux à privilégier les problèmes politiques ou socioculturels (ce qui prouve qu'ils n'ont pas renoncé à agir sur la société, comme Spengler le reprochait aux philosophes de la fin du XIXe s.).
• A – 3 ) La science cède le pas à la technique
Dans toutes les cultures déclinantes, « la passion épistémologique cède le pas au besoin pratique » (I, 337), ce qui veut dire que la recherche scientifique tend à reculer au profit du développement technique. Phénomène que Spengler croit discerner à l'époque où il écrit : « dans la physique comme dans la chimie, en biologie comme en mathématique, les grands maîtres sont morts et nous vivons aujourd'hui le decrescendo des brillants imitateurs qui classent, collectionnent et achèvent, comme les Alexandrins de l'époque romaine » (I, 407). Et pourtant, dans les premières décennies du XXe siècle, la science connaît un renouveau remarquable, not. dans le domaine des mathématiques, de la physique et de la chimie où la théorie de la relativité d'Einstein (1905-1919), les recherches sur l'atome et la radioactivité de Rutherford et la théorie des quanta formulée par M. Plank en 1900, puis développée par N. Bohr (1913) et par W. Heisenberg, bouleversent les conceptions et les méthodes scientifiques (18).
Cependant, comme dans le domaine de l'art, Spengler, moins sensible au renouveau extraordinaire qui s'esquisse qu'à l'effondrement de toutes les certitudes antérieures et à la fragilité des théories multiples et contradictoires qui fleurissent sur leurs décombres, n'hésite pas à affirmer que « le grand style de la représentation a fait place à une sorte d'industrie de la fabrication des hypothèses » (I, 402). Poète visionnaire, plutôt qu'esprit scientifique, c'est la fin du monde, « le crépuscule des dieux », « symbole de l'âme faustienne », qu'il voit se profiler derrière la doctrine de l'entropie, « conception dernière et irréligieuse du mythe » (I, 406).
La technique et le machinisme inspirent à Spengler des sentiments contradictoires. Il ne peut s’empêcher d'éprouver une certaine admiration devant leurs réalisations, reconnaissant que la « passion faustienne » de dominer le monde « a changé l'image de la surface du globe », qui offre désormais un « spectacle d'une telle grandeur », que l'humanité future y verra probablement la caractéristique la plus frappante de notre civilisation. Il va même jusqu'à reconnaître qu'elle est loin d'avoir exploité toutes les possibilités dont la technologie est porteuse (19). Néanmoins, influencé conjointement par la fable de l'apprenti sorcier imaginée par Gœthe, il déplore le fait que l'homme soit devenu « l'esclave de ses œuvres » et ait saccagé la nature jusqu'à l'épuisement de ses ressources. Aussi n'hésite-t-il pas à qualifier la machine de « diabolique », dans la mesure où son inventeur, grisé par ses succès, se prend désormais pour un dieu et prétend régir le monde à la place de son Créateur (II, 461-464). Spengler entame ainsi le procès de la technique, que poursuivront avec le même aveuglement Heidegger, Ellul et les adeptes de la deep ecology.
L'art, la philosophie et la science étant moribonds dans une civilisation en proie au scepticisme, le seul domaine dans lequel l'Occident puisse encore s'illustrer (il bénéficie en effet d'un sens de l'histoire dont les cultures antérieures étaient dépourvues) est, si l'on en croit Spengler, celui de la « morphologie historique comparée », dont il a lui-même frayé la voie, et qui représente « le dernier grand œuvre » réservé à la pensée faustienne (II, 34 ; I, 57, 70, 160).
On doit donc reconnaître qu'il n'a pas été capable de percevoir le renouveau extraordinaire qui s'effectuait à son époque dans le domaine des arts, des lettres (dont il ne dit pas grand-chose), des idées et des sciences. Les jugements sévères qu'il prononce nous paraissent s'appliquer avec plus de pertinence aux dernières décennies du XXe s. qu'à ses débuts. On peut en effet constater de nos jours un certain fléchissement de la créativité — plus ou moins marqué selon les pays — dans le domaine de la culture des élites ; mais il est difficile de savoir s'il sera temporaire ou définitif, et s'il s'explique par la concurrence des média audiovisuels et de la culture de masse ou par l'épuisement des genres et des styles traditionnels. Cependant, les sciences et les techniques semblent échapper jusque-là à ce déclin, bien que les restrictions budgétaires imposées par la crise économique, et les craintes inspirées par les dangers d'un progrès incontrôlé, risquent désormais d'entraver leur essor (20).
Faut-il en conclure que Spengler a été un piètre observateur de la société dans laquelle il vivait, soit que son conservatisme lui donne des œillères, soit que ses dons de visionnaire le rendent plus sensible aux évolutions de longue durée qu'aux réalités présentes ? Ce fut le cas, semble-t-il, pour Custine dont on a pu dire qu'il avait admirablement décrit, un siècle à l'avance, la société soviétique, plutôt que la société tsariste du XIXe s. On peut dire néanmoins, à la décharge de Spengler, qu'il manquait du recul nécessaire pour pouvoir juger avec pertinence de la fécondité d'innovations et de découvertes dont l’intérêt et la validité restaient à prouver.
B. Recul de la foi, puis “seconde religiosité”
« La religion étant l'essence de chaque culture, l'irréligion est celle de toute civilisation » (I, 341), caractérisée par les progrès de l'athéisme. Celui-ci conduit tôt ou tard au nihilisme (I, 334), la foi dans la science et les idéologies qui remplace la religion des premiers âges, finissant par s'effondrer à son tour.
Quand la civilisation s'installe dans sa forme définitive, on voit apparaître sur les décombres des idéaux rationalistes, « une religiosité nouvelle et résignée, qui s’élève de la misère de l'âme et du tourment de la conscience, qui renonce à fonder un nouvel au-delà, qui cherche le mystère au lieu des concepts tranchés » (II, 419). Cette « seconde religiosité », expression de la foi naïve et spontanée des masses tend à ranimer d'anciennes croyances populaires, à en emprunter d'autres à l'étranger et à les amalgamer dans des cultes syncrétiques, reposant sur des structures fixes (communautés de tous ordres, sectes, églises) « qui sont toujours des répétitions figées des formes vivantes du passé ». C'est le cas des religions à mystères hellénistiques, des sectes taoïstes de la Chine des Han, des couvents du Studion et d'Athos, à la fin de l'empire byzantin. Cette seconde religiosité trouve son expression ultime dans les « religions de fellah », « primitives de part en part, tels les cultes animaux de la 26ème dynastie égyptienne » ; figées dans un dogmatisme et un ritualisme qui entravent leur évolution, elles se perpétuent pendant des siècles, comme le montrent les exemples de la religion d'État en Chine ou de l'Islam dans l'Orient actuel (II, 285-290).
C. Crise des valeurs
L'athéisme provoquant un « bouleversement de toutes les valeurs », comme l'avait bien vu Nietzsche, la morale instinctive et indiscutée qui prévalait jusque-là « se mue en problème » et revêt une importance d'autant plus grande que la métaphysique dépérit. Le besoin se fait sentir d'une « morale pratique destinée à régler la vie, parce que celle-ci ne peut plus se régler elle-même ». Si bien qu'à la « morale tragique » de la culture, succède la « morale plébéienne » de la civilisation, fondée sur la « saine raison humaine » et une morne résignation. La morale tragique « connaît et comprend le poids de l’être, mais elle en tire le sentiment d'orgueil pour le supporter. Ainsi sentaient Eschyle, Shakespeare et les penseurs de la philosophie brahmanique, ainsi Dante et le catholicisme germanique (...). La morale plébéienne d'Épicure et de la Stoa, des sectes bouddhistes du XIXe siècle en Occident, prépare un plan de bataille pour esquiver le destin, par la prévoyance, l'humanité, la paix universelle, le bonheur du plus grand nombre » (I, 337-338).
Bien que certaines propositions ou formules de Spengler soient contestables, son analyse se trouve dans l'ensemble confirmée par l'évolution actuelle de la civilisation occidentale : remise en question et recul de la foi et de la morale chrétiennes, qui orientaient le comportement des générations passées et donnaient un sens à leur vie ; déclin du positivisme scientiste et des idéologies qui, depuis le XVIIIe s., jouaient le rôle de croyances de substitution ; progression de pseudo-valeurs matérialistes et hédonistes (le bien-être et le bonheur par la consommation et la possession, le sexe et le loisir) et prolifération de cultes et de mythes compensateurs : idolâtrie de la nature ou du cosmos, mythologie des “olympiens” (stars de cinéma, champions, famille royales, explorateurs, artistes célèbres, etc.), culte du “moi” (importance accordée à l'apparence et aux performances physiques, ainsi qu'à la réussite professionnelle et sociale), vogue croissante des sectes et des sagesses et morales orientales, alors qu'en Extrême-Orient, c'est au contraire le christianisme qui progresse.
Si bien que nos contemporains, lassés du laxisme effréné et de ses conséquences désastreuses (développement de la criminalité, de la délinquance, de l'usage des drogues et des troubles psychiques de tous ordres), ressentent désormais la nécessité de restaurer les anciennes valeurs, en rétablissant les cours de morale, de savoir-vivre et d'instruction civique, dans les écoles, voire dans les entreprises. Bref, on assiste à un retour de la morale plébéienne (qualifiée généralement de bourgeoise !), qui, procédant d'un christianisme sclérosé et sécularisé, apparaît effectivement formaliste, conformiste et mesquine en regard des enseignements des grandes figures du catholicisme (“Aime et fais ce que tu voudras”), mais qui s’avère néanmoins préférable à la loi de la jungle à laquelle on est en train de revenir.
◘ 2. Secteur politique
A. Du féodalisme au “Césarisme”
« L'histoire de grand style commence dans chaque culture par l'État féodal, qui n’est pas l’État au sens futur du mot, mais l’organisation de la vie totale par rapport à un ordre » (II, 340-341) — la noblesse —, qui représente « l'ordre proprement dit, la quintessence de la race (21) et du sang » (II, 308). Aussi Spengler considère-t-il que « l'État le plus solide est celui où la noblesse, ou la tradition créée par elle, sont entièrement mises au service de la chose publique générale » (II, 338). La réalité coïncidant rarement avec cet idéal, l'État féodal n'a qu'une existence éphémère : il est rapidement miné par les conflits intérieurs (entre la noblesse et le clergé, la couronne et ses vassaux, etc.) ou extérieurs (not. guerre de Cent ans), ainsi que par l'émergence des nations qui vont promouvoir « l'idée d'État proprement dit » en faisant perdre à celui-ci le caractère organique qu'il avait à l'origine (II, 342). Le concept de nation finissant par l'emporter sur celui d'ordre, on assiste à la formation de l'État absolu, qui permet d'atteindre « à une hauteur de la forme politique, qui ne pouvait plus dés lors être dépassée » (II, 355, 360) mais qui n'a réussi à s'imposer que pendant un siècle et demi, l'État parvenant à « dompter le sang des premiers ordres » (noblesse et clergé) pour les mettre entièrement à son service (II, 369-370).
Le Tiers-État, qui constitue un « non-ordre » — il conteste en effet la légitimité de tous les ordres — (II, 306), réussit progressivement à imposer son idéal d'égalité — « dissolvant, socialement niveleur » — et de liberté — tout aussi négatif, dans la mesure où il implique le refus de la tradition et des « grands symboles contraignants de la culture » (II, 326-329, 414). La bourgeoisie qui accède au pouvoir et représente les « puissances de l'esprit et de l'argent » opposées à celles du sang et de la tradition, substitue l'organisé à l'organique et le parti à l'ordre : c'est le moment où la culture devient civilisation, où les révolutions bourgeoises remplacent la « tradition vivante », incarnée par la noblesse, ainsi que les symboles et les valeurs transcendantes qui informaient et guidaient la société, par de vulgaires intérêts matériels ; « la grande politique » qui visait à « rendre la guerre presque superflue » grâce à une diplomatie active, intelligente et efficace (II, 311, 367, 401, 405), disparaît à son tour. Le régime parlementaire et pseudo-démocratique qui succède à l'État absolu, est en réalité dirigé, manipulé et exploité par les partis politiques, mus par la volonté de puissance et l'appât du gain ; sombrant dans la ploutocratie et discrédité, il s'engage, depuis la Première Guerre mondiale, « sur la voie du déclin complet » (II, 371, 417).
L'épopée napoléonienne ouvre l’ère des « États batailleurs » (par analogie avec celle des “royaumes combattants” que la Chine a connue de - 480 à 230) et de l'impérialisme qui, par ses « combats gigantesques », va frayer la voie au « césarisme » (III, 385, 396). Celui-ci, mettant fin à la « politique de l'esprit et de l'argent » marque « le retour d'un monde, achevé dans sa forme, au primitif, au cosmique anhistorique » : « les puissances du sang, les instincts primaires végétatifs de toute vie, la force corporelle non interrompue, rentrent dans leur ancien pouvoir. La race réapparaît, pure et irrésistible : succès du plus fort et le reste comme butin. Elle s'empare du gouvernement du monde, et l'empire des livres et des problèmes se dessèche et tombe dans l'oubli. Dorénavant, les destins héroïques de style préhistorique redeviennent possibles » (II, 399-400).
Pour parvenir à cette fin, l'argent représente une arme décisive, permettant d'acheter la presse, qui constitue un formidable moyen de propagande et de pression. Qu'est-ce en effet que la vérité ? « Pour la foule, c'est ce qu'elle lit et entend constamment » ; quant à la « vérité publique du moment, qui seule importe dans le monde réel des actions et des succès, (elle) est aujourd'hui un produit de la presse » (II, 426). Parmi les droits essentiels que les sociétés dites démocratiques se targuent d'instaurer, la liberté de pensée est un des plus prisés ; mais il s’avère aussi illusoire que le droit de libre disposition du peuple : « Jadis, on n'avait pas le droit de penser librement ; aujourd'hui on a ce droit, mais on ne peut plus l'exercer ». Bien qu'il soit permis à chacun de penser ou de dire ce qu'il veut, la presse peut refuser de divulguer les opinions qu'elle ne juge pas opportun de faire connaître à ses lecteurs. Or cette « effrayante censure du silence » s’avère plus redoutable que les autodafés allumés par certains dictateurs pour y brûler les livres jugés dangereux, dans la mesure où la population qui la subit en ignore l'existence (II, 427).
« La dictature des chefs de partis » prenant appui sur « la dictature de la presse », les élections apparaissent désormais comme une vaste « comédie », organisée par l'argent « dans l’intérêt de ceux qui le possèdent ». Les Parlements eux-mêmes, jouent un rôle fictif, étant destinés à faire oublier que le pouvoir réel est détenu par des groupes de pression plus ou moins occultes : « Comme la royauté anglaise au XIXe s., [ils] deviendront peu à peu au XXe s. un spectacle féerique et vide » (II, 385, 428-429). Aussi Spengler prévoit-il que « la démocratie de demain passera sous la puissance de ceux auxquels obéit la parole imprimée et qui disposeront absolument des peuples », une « campagne de presse » leur permettant de « continuer (ou préparer) la guerre » sans en avoir l'air et sans coup férir (II, 425, 427). Mais il prévoit également que tôt ou tard, cette démocratie fictive et corrompue deviendra insupportable et sera balayée par le césarisme qui fera à nouveau appel aux « moyens originaires de la force sanglante » (II, 429).
La critique du système partisan et électoral, du parlementarisme et de la corruption des régimes démocratiques représente presque un lieu commun jusqu'à la Seconde Guerre mondiale : formulée par Proudhon, dès le milieu du XIXe s., elle est reprise par Roberto Michels (dans son livre sur les Partis politiques publié en 1911), par Péguy, puis par les “non-conformistes des années 30”, et not. par les fédéralistes personnalistes qui, depuis, la poursuivent inlassablement dans les colonnes de cette revue et ne se contentent pas de déplorer comme Spengler le caractère inorganique du suffrage universel, mais proposent un certain nombres de mesures susceptibles d'y remédier (22). Les régimes fascistes qui prennent leur essor dans les années 20 et 30, ont profité du discrédit dont la démocratie faisait l'objet pour la liquider, comme l'avait prévu Spengler. Mais ces régimes n'ont eu qu'une durée éphémère, du moins en Occident, et la démocratie, malgré tous ses défauts a fini par s'imposer et par faire l'objet d'un large consensus, dans la mesure où elle bénéficie d'une supériorité incontestable par rapport aux modes de gouvernement autoritaires et totalitaires qui prétendaient la remplacer.
Par ailleurs, Spengler a tendance à surestimer le pouvoir de la presse et à sous estimer les capacités de résistance de ses lecteurs aux tentatives d'endoctrinement qu'ils subissent. Les études récentes faites sur les media audiovisuels (qui n'existaient pas à son époque et dont l'impact sur les masses a pu paraître encore plus puissant que celui de la presse) prouvent en effet que leur influence sur le public n'est pas aussi décisive qu'on pouvait l'imaginer, même sous les régimes totalitaires dont la propagande, omniprésente, n'est pas contrebalancée par d'autres sources d'informations. Cependant Spengler a justement dénoncé le caractère pernicieux de la « censure du silence » qui sévit de manière occulte dans les démocraties dites libérales, empêchant systématiquement les courants de pensée marginaux ou oppositionnels de s'exprimer (les fédéralistes, not., n'ont pas cessé d'en être victimes) (23).
C. Impérialisme, pacifisme
Spengler voit dans l'impérialisme une caractéristique essentielle des civilisations qui cherchent à compenser leur manque de créativité, de foi et de vie intérieure par une « activité extensive pure », « l'homme cultivé » ayant « son énergie dirigée en dedans, le civilisé en dehors » : « Impérialisme est civilisation pure (...). La tendance expansive est une fatalité, quelque chose de démoniaque et de fantastique, empoignant l'homme tardif » (I, 49, 56). Quelques décennies plus tard, Schumpeter proposera la définition suivante de l'impérialisme : « disposition, dépourvue d'objectifs, que manifeste un État à l'expansion par la force, au-delà de toute limite définissable » (24). Définition qui paraît proche de celle de Spengler : en soulignant le caractère irrationnel et compulsif des guerres de conquête, ils prennent tous 2 le contre-pied de la théorie marxiste qui voit dans l'impérialisme “le stade suprême du capitalisme” en quête de nouveaux marchés. Cependant, ce qui les sépare, c'est que Spengler impute la responsabilité de l'impérialisme à la psychologie de l'homme tardif, alors que Schumpeter a compris qu'il est inhérent à l'État.
L'impérialisme apparaît comme le « symbole typique de la fin ». Spengler précise toutefois que l'Occident est loin d’être parvenu à ce stade ultime : Cecil Rhodes n'est-il pas « le premier précurseur d'un type césarique occidental dont l'heure n'a pas encore sonné » (I, 49) ? Il s'oppose ainsi à la thèse défendue par la plupart des historiens qui situent l'apogée de l'impérialisme à la fin du XIXe siècle, sans se donner pour autant la peine d'expliquer son point de vue. On peut le justifier a posteriori en supposant qu'il pressentait, plus ou moins confusément, que l'Europe deviendrait bientôt le champ de bataille et d'affrontement de grandes puissances impérialistes qui tenteraient de lui imposer leur hégémonie ; et que l'échec du IIIe Reich permettrait à l'Union Soviétique de constituer un nouvel empire beaucoup plus redoutable que les anciens et lointains empires coloniaux, et de faire peser sur la planète la menace d'une conflagration mondiale. Spengler prévoyait en effet que le socialisme, tout en condamnant l'impérialisme, y succomberait à son tour un jour ou l'autre, n'étant pas, en dépit des apparences, « un système de la compassion, de l'humanité, de la paix et de la sollicitude, mais de la volonté de puissance » (I, 49, 344).
S'appuyant sur l'exemple de l'Empire romain, il souligne le caractère négatif de l'impérialisme « dû non à une surmesure de puissance (...) mais à un manque de résistance » chez ses adversaires, l'Orient renonçant progressivement à son ancienne liberté (I, 48). De plus, la pax romana qui succède à la période impérialiste, ne lui paraît pas aussi bénéfique qu'on l'affirme habituellement, exposant « une population informe, de centaines de millions d'habitants » à devenir l'enjeu de la volonté de puissance de quelques petites bandes de guerriers. Si bien que « cette paix a coûté aux pacifiques des sacrifices qui éclipsent ceux de la bataille de Cannes » (II, 171). D'autre part, pour obtenir la soumission des populations assujetties et sans ressources, la politique dégradante du panem et circenses a été pratiquée à grande échelle dans les villes, habituant ses bénéficiaires à la dépendance, à la passivité et à l'irresponsabilité. N'est-ce pas la preuve la plus convaincante de la dégénérescence des civilisations, qu'elles finissent par préférer l'esclavage à la mort ? (II, 170-171)
Aussi Spengler dénonce-t-il vigoureusement les dangers du pacifisme qui fleurit en Occident, sur les décombres de la Première Guerre mondiale : « la paix du monde (...) implique le renoncement privé de la très grande majorité à la guerre, mais par-là même aussi le consentement inavoué de cette majorité à devenir la proie des autres qui, eux, n'ont pas renoncé » (II, 403) ; en réalité, elle « n'a jamais été autre chose que l'esclavage de toute une humanité sous le règne d'un petit nombre de natures fortes résolues à dominer » (II, 406). De plus, « les guerres à l'époque de la paix mondiale » loin de disparaître, deviennent « des guerres privées plus terribles que toutes les guerres d'États, parce qu'elles sont informes » (II, 402-403). C'est ce que l'on constate de nos jours, où les guerres étatiques sont remplacées par des guerres civiles (religieuses, inter-ethniques, d'indépendance, etc.) qui, faisant fi des règles et des usages que les États étaient tenus de respecter, prennent les populations en otage et multiplient impunément les massacres et les atrocités ?
Sur ce chapitre également, les fédéralistes partagent le point de vue de Spengler, proclamant dès les années 30 : « Ni le mensonge impérialiste, ni la démission pacifiste » (25). Mais contrairement à lui, ils ont compris que le développement hypertrophique de l'État et de la bureaucratie qui le sert — phénomène dont l'auteur du Déclin de l'Occident ne s'est pas avisé — constitue l'un des facteurs décisifs de la crise de la civilisation occidentale, étant à l'origine de cette crise (qui s'est déclenchée et a progressé en même temps que lui) et not. de l'impérialisme.
Envisagé dans cette perspective, le « césarisme » — si tant est qu'on puisse l'identifier au fascisme, voire au totalitarisme — ne représente pas un retour aux vertus et à la politique des temps barbares, comme le suggère Spengler, mais l'aboutissement logique du processus séculaire de croissance et de renforcement de l'État et de son emprise sur la société.
◘ 3. Secteur social
A. Déstructuration de l'espace sociologique, massification et prolétarisation
Le passage de la culture à la civilisation se caractérise par l'effacement des ordres traditionnels au profit des castes et des masses. Les premières se constituent dès la période tardive des cultures : castes sacerdotales de Thèbes, guerrières de Libye, brahmanes ou mandarins de l'Inde ou de la Chine, qui représentent une expression caricaturale et figée des ordres, dont elles perpétuent les privilèges, tout en affichant un souverain mépris pour le reste de la société. Ce phénomène précède et accompagne l’avènement des « peuples de fellahs » (« dont les Égyptiens de l'époque romaine sont l'exemple le plus célèbre ») (II, 155, 305). Spengler n'ayant pas pris la peine de s'expliquer plus amplement sur ce sujet, on en est réduit à des conjectures : il désigne probablement par le terme de castes les anciennes élites (not. les fonctionnaires des bureaucraties étatiques) qui, perdant progressivement leur dynamisme et leur créativité, réussissent à préserver leur pouvoir, leurs prérogatives et leur statut. Quant au « fellahisme définitif » qui caractérise la phase terminale des civilisations, on verra plus loin qu'il est lié à la « non-prolificité » des couches supérieures de la population.
Les masses déracinées rassemblent des membres déchus de « tous les ordres et de toutes les classes » (II, 369), qui, privés de revenus et d'emploi et rompant tous liens sociaux sont condamnés au « nomadisme des villes mondiales » et à la prolétarisation. Elles représentent « l'informe absolu, qui poursuit avec haine chaque espèce de forme, toutes les différences de rang, la propriété constituée, le savoir constitué » ; dépossédées de leur passé et dépourvues d'avenir, elles incarnent la « non-histoire », « la fin, le radical néant » (II, 330-331). Leur intervention donne aux événements « le pouvoir destructeur qui distingue, par ex., la Révolution française de la Révolution anglaise » (II, 369).
Spengler est un des premiers à développer ce thème qui sera ensuite repris et exploité avec le succès que l'on sait par Ortega y Gasset (La révolte des masses, 1930), Toynbee et H. Arendt, sans oublier les “non-conformistes des années 30”. Thème qui resurgit de nos jours, avec une acuité particulière, mais que l'on désigne désormais par le terme d'exclusion.
B. Triomphe de la ville cosmopolite
Le symbole par excellence des civilisations, c'est la « ville mondiale », ville « géante », « abstraite » et « artificielle » conjuguant une forme en échiquier et un « entassement anorganique, donc illimité » — à la fois horizontal et vertical — qui témoignent de la substitution de l’intelligence à « l'expérience inconsciente de la vie », de la privation d'âme provoquée par l'irréligion, de la méconnaissance des traditions, de la primauté des valeurs matérielles et de l'argent — l'abstraction par excellence — et du triomphe du cosmopolitisme sur le patriotisme. Dans le monde antique, ce type d'habitat est inauguré en 441 par Hippodamos de Milet ; en Occident, le plan de Washington datant de 1791, en offre le premier exemple. Les mégapoles représentent un pôle d'attraction pour les masses déracinées de toutes origines, qui espèrent y trouver des moyens de subsistance ; pour les commerçants et les hommes d'affaires, attirés par les possibilités de profit sans précédent offertes par un aussi vaste marché ; ainsi que pour les intellectuels et les esthètes qui ont besoin de stimulations extérieures pour compenser leur manque de créativité.
Le cadre de vie inhumain des grandes cités sécrète l'ennui de vivre et un besoin effréné de distractions, guère plus relevées que les jeux du cirque, et qui sont l’antithèse du « jeu authentique » et de la « joie de vivre ». Il s'agit là, pour Spengler, d'une évolution fatale et irréversible : « Le paysannat a enfanté un jour le marché, la ville rurale et les a nourris du meilleur de son sang. Maintenant, la ville géante, insatiable, suce la campagne, lui réclame sans cesse de nouveaux flots d'hommes qu'elle dévore, jusqu'à mourir elle-même exsangue dans un désert inhabité », tandis que le cœur du citadin s'étant déprit de la campagne, n'est plus capable de s'y intéresser à nouveau (I, 45 ; II, 93-96). L'auteur de ces lignes ne prévoyait donc pas le mouvement de retour à la nature qui, depuis des décennies, pousse de plus en plus les citadins, excédés par les désagréments de la vie urbaine, à s'évader, aussi souvent que possible, dans leurs résidences secondaires et à y passer leurs vacances puis leurs années de retraite ; non plus que les politiques récentes qui visent à repeupler les campagnes en y développant des activités nouvelles (artisanales, touristiques, écologiques, etc.).
C. Chute démographique
« L'homme-cerveau des villes cosmopolites » ayant perdu sa créativité, est voué à la stérilité ; stérilité qui se manifeste sur le plan physiologique par une moindre prolificité. Alors que la fécondité est naturelle et spontanée dans les cultures en expansion, la restriction des naissances devient systématique dans les mégapoles où sévissent l'individualisme, l’égoïsme et le refus des traditions et des contraintes. Le phénomène peut s'observer dans toutes les civilisations déclinantes du passé, comme dans la nôtre. Il va de pair avec l'émancipation des femmes, qui refusent les servitudes de la maternité, pour devenir indépendantes et développer leur personnalité si bien qu'elles ont désormais des “conflits psychiques” au lieu d’enfants. Progressivement, le fléau de la dépopulation gagne la province et la campagne, où seuls « le sang primitif (…), mais dépouillé de ses éléments prometteurs et sains » continue à se reproduire. Ainsi apparaît « le type du fellah », caractéristique des fins de civilisation (I, 342 ; 11, 97, 100).
Le phénomène de dénatalité dénoncé par Spengler est incontestable, du moins dans le monde occidental ; en effet, les pays du Tiers et du Quart monde souffrent au contraire d'une natalité excessive qui compromet leur développement, bien qu'un certain nombre d'entre eux réussissent progressivement à la réduire. Aussi n'a-t-il pas tort d'attirer l'attention sur le fait que les peuple “civilisés” risquent d’être supplantés, tôt ou tard par les « peuples de fellah », en raison du déséquilibre de leurs taux respectifs de reproduction. N'est-ce pas ce qui s'est passé sous le Bas-Empire romain ? Il commet cependant l'erreur, comme pour les autres symptômes qu'il diagnostique avec pertinence, de considérer ce risque comme inéluctable, alors qu'il peut être évité par des efforts conjugués des uns et des autres pour corriger ce déséquilibre. Les démographes et les historiens contemporains, not. A. Sauvy et P. Chaunu, n'ont pas manqué d'en souligner la gravité et de tirer la sonnette d'alarme pour inciter leurs contemporains à assumer leurs responsabilités, avant qu'il ne soit trop tard.
Néanmoins, l'analyse que fait Spengler de ce phénomène nous paraît trop succincte. Il oublie de mentionner le rôle joué par le recul de la pratique religieuse et par la crise des valeurs, ainsi que par le manque de confiance dans l'avenir, qui pouvaient déjà être observés à son époque ; en revanche, il pouvait difficilement prévoir, au début du siècle, que la diminution des naissances se trouverait aggravée, après la Seconde Guerre mondiale, par la généralisation du travail féminin et par l'élévation spectaculaire du niveau de vie, et par-là même des exigences relatives à l'éducation des enfants. Il n'en a pas moins été l'un des premiers à mettre en lumière un des symptômes les plus inquiétants pour l'avenir de notre civilisation.
◘ 4. Secteur économique
Les considérations de Spengler sur l'économie, qui n'occupent que 30 pages à la fin de son ouvrage, représentent sa partie la plus faible. Ce que n'ont pas manqué de lui reprocher les “nouveaux historiens” — comme L. Fèbvre et F. Braudel — qui, sous l'influence du marxisme, se sont efforcés de développer l'histoire économique et sociale, longtemps sacrifiée à l'histoire politique.
A. Mondialisation de l'économie et dictature de l'argent
Les grandes cultures, affirme Spengler, donnent la primauté au « vouloir politique et religieux ». Ce n'est qu'avec l’avènement des civilisations que l'économie, se substituant à la grande politique, tend à occuper la première place : « le bonheur du plus grand nombre, le plaisir et la commodité, le panem et circenses remplacent désormais les objectifs transcendants qui donnaient un sens à la vie ». Hostile à la fois au libéralisme et au marxisme, comme les “non-conformistes des années 30”, il prétend exposer « une conception économique nouvelle, allemande, au delà du capitalisme et du socialisme » (II, 432-434) ; formule que les nazis reprendront à leur compte, mais qui reste pour eux un thème de propagande, auquel ils renonceront d'ailleurs rapidement, leur politique de réarmement les incitant à rechercher l'appui et la collaboration de la haute finance et de la grande industrie. Justifiant son manque d’intérêt pour l'économie par le caractère encore rudimentaire d'une science promise à un brillant avenir — en quoi il ne s'est pas trompé — Spengler se contente d'esquisser les grandes lignes de l'évolution économiques des sociétés, au lieu du programme qu'il avait annoncé.
Les civilisation donnant une place prépondérante aux grandes villes et au commerce, tendent à instaurer une économie mondiale, fondée sur une organisation de plus en plus poussée et méthodique de la production et des échanges et un développement sans précédent de la haute finance, des banques et des bourses, celles-ci s'efforcent de promouvoir une “économie conquérante” en menant une lutte acharnée contre “l'économie productive” afin de lui imposer leur hégémonie. Les détenteurs de capitaux, corrompant, comme déjà dit, les institutions démocratiques et la presse, instaurent le règne de la ploutocratie. Cependant, tôt ou tard, le césarisme y mettre fin et rétablira la primauté du politique sur l'économique (II, 431-467).
Le pouvoir occulte, abusif et pernicieux de l'argent dans la société actuelle avait été dénoncé, avant Spengler, par les moralistes, les marxistes et les socialistes, Péguy notamment avait consacré 2 cahiers à ce thème en 1913 (26). En l'exploitant à son tour, Spengler n'innove donc pas ; mais il a le mérite de le traiter avec vigueur et de lui donner la place importante qu'il mérite. Serait-il plus original quand il fait allusion à la “mondialisation” de l'économie, dont on nous rebat les oreilles depuis quelques temps ? Il ne fallait pas être grand clerc pour s'en aviser, comme il le souligne lui-même, le phénomène étant engagé « depuis 150 ans » au moins (II, 431) et n'ayant fait que s'accélérer et s'amplifier récemment. Ce que nombre de nos contemporains ont tendance à oublier — comme ils négligent le fait que les pays européens, effectuant la majorité de leurs échanges au sein de la Communauté, ne subissent pas de plein fouet la concurrence internationale — : il semble donc qu'en imputant à la "mondialisation" la responsabilité de la crise économique actuelle, ils évitent par-là même de s'interroger plus avant sur ses causes. En revanche Spengler fait preuve d'une clairvoyance indéniable quand il prévoit le rôle décisif joué actuellement par la spéculation financière au détriment de l'économie productive. Mais il s'est trompé en imaginant que les régimes fascistes mettraient fin à « la dictature de l'argent », qui n'a fait que s'aggraver tandis qu'ils n'ont eu eux-mêmes qu'une durée éphémère.
CONCLUSIONS
Parvenus au terme de notre investigation, il convient d'en faire le bilan. La plus grave erreur commise par Spengler, est de n'avoir pas su prévoir le renouveau culturel qui s'effectuait à l'époque où il écrivait, et de n'avoir pas compris que le refus de la tradition, des certitudes acquises et des modes de pensée et de création artistique et musicale, qui avaient prévalu pendant des siècles, loin de signifier que la philosophie, les sciences, l'art et la musique avaient épuisé leurs possibilités d'expression, témoignait au contraire de leur vitalité et de capacités de renouvellement remarquables.
Cependant, si on applique son jugement aux dernières décennies du siècle, il gagne en pertinence, si bien qu'il semble avoir été doté d'une plus grande perspicacité pour prévoir l'avenir que pour observer la réalité contemporaine. Pourtant, il n'a pas su anticiper les aspects les importants de la crise actuelle de la culture : inadaptation croissante de l'enseignement public, dictature de l'idéologie dominante, éclatement de la culture en 2 courants hétérogènes — une culture traditionnelle élitaire et une culture de masse, nouvel “opium du peuple” qui, loin de démocratiser la culture, la dégrade en loisir. Mais on ne saurait le lui reprocher, étant donné que ces phénomènes ne sont apparus qu’après la Seconde Guerre mondiale.
Plus sensible aux inconvénients et aux dangers de la technique qu'à ses apports positifs, il a méconnu les progrès extraordinaires qui devaient en résulter, progrès qui prouvent que la créativité des occidentaux n'est pas atteinte, et permettent par conséquent d'espérer qu'ils sauront résoudre les difficultés dans lesquelles ils se débattent et conjurer le déclin qui les menace. En revanche, Spengler a bien saisi l'importance de la crise de la foi et des valeurs qui affecte notre civilisation et compromet sa survie, dans la mesure où elle atteint les raisons de vivre et d'espérer de nos contemporains.
Accordant lui-même un rôle capital au politique, il a fait preuve d'une clairvoyance indéniable sur ce chapitre, comprenant que l'impérialisme n'avait pas encore atteint son apogée, que le pacifisme des démocraties occidentales ne pouvait qu'encourager les visées expansionnistes et le bellicisme de leurs adversaires, et que la corruption et le discrédit des régimes parlementaires, prétendus démocratiques, feraient le lit du fascisme. Il s'est néanmoins illusionné sur la nature des régimes, qui relèvent de cette catégorie, comme sur les dates de leur apparition et sur leur durée, ayant tendance à leur prêter toutes les vertus dont il déplorait la disparition et une longévité qui leur a été heureusement refusée. Mais les démocraties occidentales n'ont-elles pas commis la même erreur à l'égard du communisme soviétique, dont personne, semble-t-il, n'avait prévu qu'il s'effondrerait aussi rapidement ?
Sur le plan social, Spengler insiste surtout sur l'urbanisation accélérée, la désertification des campagnes et la croissance anarchique des mégapoles, sans envisager pour autant que cette tendance puisse un jour ou l'autre s'inverser, à cause de désagréments croissants de la vie urbaine et des conséquences catastrophiques d'une telle politique sur l'environnement. Il a eu également raison d'attirer l'attention sur le fait que la diminution des naissances n'assurant plus le renouvellement de la population, la civilisation occidentale risquait de s'éteindre et d’être balayée par les peuples plus prolifiques.
Si Spengler évoque les problèmes de déracinement et de nomadisme, de massification et de prolétarisation, il n'a pas poussé l'analyse jusqu'à ses conséquences ultimes qu'étudiera Toynbee : affaiblissement du consensus (le prolétariat intérieur contestant le pouvoir abusif des élites dirigeantes), puis schisme social (révolte et sécession de classes sociales et de communautés jusque-là solidaires, qui n'hésitent pas à s'unir au prolétariat extérieur pour renverser un régime qui leur est devenu odieux). La théorie fédéraliste des crises accorde elle-même une importance primordiale à ces symptômes.
N'ayant fait qu'esquisser l'étude des transformations économiques qui s’opèrent dans les civilisations, Spengler se contente de dénoncer la dictature de l'argent qui mine progressivement les institutions (politiques, culturelles et judiciaires), ainsi que la progression inquiétante de l'économie spéculative au détriment de l'économie productive. Mais il ne dit rien des crises qui Jalonnent le développement du capitalisme — ni (les troubles qui les qui accompagnent (inflation, chômage, récession, etc.) — bien qu'ils n'aient pas épargné ses contemporains.
Force est donc de reconnaître que, dans l'ensemble, Spengler a envisagé avec clairvoyance l'évolution de la société occidentale et les dangers qui la guettaient, ses intuitions prophétiques compensant en quelque sorte les lacunes et les erreurs que nous avons relevées, et témoignant a posteriori de la pertinence de la méthode comparative qu'il inaugure. On peut toutefois regretter qu'en raison de son anti-intellectualisme et de son anti-scientisme, il ne se soit guère préoccupé de la doter de moyens d'investigations rigoureux, estimant à tort qu'une vaste culture, une longue familiarité avec l'histoire et ses dons de visionnaire suffisaient à garantir la validité de sa pratique.
Quant à la thèse qu'il défend, nous ne la partageons pas, estimant qu'il est encore trop tôt pour parler de déclin — en raison not. des progrès considérables que l'on continue d'observer dans le domaine des sciences et des techniques —, mais que la crise majeure à laquelle notre civilisation se trouve confrontée, atteignant aujourd'hui son paroxysme, celle-ci risque de s'engager sur la voie du déclin, si elle ne se décide pas à opérer les changements révolutionnaires qui peuvent seuls la tirer du mauvais pas dans lequel elle se trouve.
Nous n'en reconnaissons pas moins à Spengler le mérite d'avoir frayé la voie, avec J. Burckhardt (27), à l'histoire comparée des civilisations qui sera ensuite brillamment illustrée par A. Toynbee, J. Pirenne, G. Dumézil, P. Sorokin et N. Elias ; entreprise difficile et semée d'embùches (28), mais riche d'enseignements et qui devrait aider nos contemporains à affronter le présent et l'avenir avec une conscience plus claire de leurs responsabilités. Malheureusement les travaux des historiens et sociologues que nous avons cités, outre qu'ils sont souvent d'un accès difficile, ne portent pas tous sur la crise de la société occidentale, ne débouchent pas nécessairement sur une théorie des crises et ne proposent généralement aucune solution aux maux qu'ils décrivent. De plus, ceux qui traitent explicitement des crises ou du déclin des civilisations, s'inspirent d'une philosophie de l'histoire et de postulats tout aussi contestables que ceux de Spengler.
Sorokin, par ex., se réclame comme lui d'une vision cyclique de l'histoire, qui privilégie les facteurs culturels : réduisant la diversité des cultures à 3 types de base — sensualiste, spiritualiste, idéaliste —, dont l'ordre de succession est immuable, il soutient que la civilisation occidentale, entrée pour la troisième fois dans l'Histoire, dans une phase “sensualiste”, depuis le XVe s., souffre désormais d'une crise très grave, dont elle ne pourra sortir qu'en revenant aux valeurs spiritualistes, dont elle s'est détachée (29). Quant à Toynbee qui est pourtant le plus proche de nos thèses, il établit un rapport nécessaire entre l'effondrement des civilisations et la naissance des religions universalistes (30). Ne voyant l'un et l'autre pas d'autre issue que dans un renouveau spirituel, on comprend qu'ils ne se soient pas préoccupés de chercher des solutions aux maux de ce bas-monde.
Le personnalime-fédéralisme prétend remédier à ces insuffisances et à ces lacunes. Conscients, des les années trente, que les sociétés occidentales subissaient une crise grave et de longue durée, et soucieux de leur épargner les épreuves douloureuses dont ils pressentaient l'approche, les penseurs de L'Ordre Nouveau se sont rendus compte que pour prouver la pertinence de leur diagnostic, il était nécessaire d'étudier les épisodes similaires auxquels plusieurs grandes civilisations du passé avaient succombé. Cette réflexion approfondie sur l'histoire devait leur permettre de construire une théorie générale des crises, à la lumière de laquelle il soit possible d'identifier leurs symptômes et de chercher les moyens d'y remédier. Depuis plus d'un demi-siècle, contre vents et marées, les fédéralistes poursuivent cette enquête, s'étant donnés pour objectif d'aider l'humanité à surmonter la crise, désormais planétaire, à laquelle elle se trouve confrontée. Aussi sont-ils les seuls, à notre connaissance, à proposer une doctrine et un programme d'action global et cohérent, conçus en fonction de cet objectif et d'une théorie des crises qui garantisse à la fois la pertinence du diagnostic et l'efficacité des solutions envisagées.
L'expérience prouve, malheureusement, que les hommes ont une fâcheuse tendance à ignorer ou supprimer les prophètes de malheur qui troublent leur quiétude, et à reproduire avec obstination les erreurs des générations précédentes. Mais, convaincus que l’espèce humaine est perfectible, nous gardons l'espoir que nos contemporains finiront par entendre la voix de la raison et par comprendre la nécessité de se mobiliser avant qu'il ne soit trop tard, au lieu de confier leur destin à des dirigeants inconscients dont la politique à courte vue et à court terme les entraîne, tête baissée, vers l'abîme.
► Mireille Marc-Lipiansky, L’Europe en formation n°306-307, 1997, p. 47-79.
• Notes :
-
L. Fèbvre, Deux philosophies opportunistes de l'histoire : de Spengler à Toynbee, article paru dans la Revue de Métaphysique et de Morale en 1936 ; figure dans Combats pour l'Histoire, A. Colin, 1992, pp. 120-126. Nous empruntons à cet article certaines précisions concernant l'accueil réservé au Déclin de l'Occident ; cf. également la préface d'A. de Benoist aux Écrits historiques et philosophiques de Spengler (Copernic, 1980).
-
L’article cité de L. Fèbvre et celui de F. Braudel (dans Écrits sur l'Histoire, Flam., 1969, pp. 262-273) témoignent de la méfiance et de l'hostilité des historiens français, non seulement à l'égard de Spengler, mais aussi de Toynbee qui s’était engagé dans une entreprise similaire.
-
L. Fèbvre laisse entendre dans l'article déjà cité (p. 124) que Spengler aurait été un des premiers adhérents du national-socialisme (sic).
-
Cité par J. Freund dans La Décadence, Sirey, 1984, p.218.
-
P. Valéry, La Crise de l'Esprit in Variétés I, Gal., 1919. L'influence du Déclin de l'Occident est particulièrement évidente dans A Study of History d'A. Toynbee (Londres, 1934) ainsi que dans La fin de la Renaissance (1919) et Le Nouveau Moyen-Âge (1924) de N. Berdiaev (Yncapress, Paris, 1924 ; L'Âge d'homme, 1985)
-
Nous nous référons à l'édition française du Déclin de l'Occident, 2 vol, Gal., coll. Bibliothèque des idées, 1948, 1976 ; les chiffres romains entre parenthèses renvoient aux tomes I ou II et les chiffres arabes qui suivent aux pages de l'édition de 1976.
-
cf. O. Spengler, Écrits historiques et philosophiques, p. 30.
-
cf J. Piaget, Le structuralisme, PUF, coll. Que sais-je ?, 1968, pp. 6-16.
-
cf. Stuart A. Kauffman, The Origins of Order – Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, 1993.
-
Deux ouvrages ont joué un rôle essentiel dans cette prise de conscience salutaire : Paul Kennedy, The rise and fall of the Great Powers, Random House, New-York, 1987 ; Allan Bloom, The Closing of the American mind. How Higher Education has failed Democracy and impoverished the souls of today's students, Simon and Schuster, New-York, 1987.
-
cf. M. Marc-Lipiansky, Crises et Crise, Presse d'Europe, Nice, 1997.
-
cf. Écrits …, p. 31.
-
Cité par P. Braudel (dans Écrits sur l'histoire, p. 301) qui laisse entendre qu'il partage lui-même ce point de vue.
-
cf. M. Marc-Lipiansky, Le structuralisme de Lévi-Strauss, Pavot, Paris, 1973 ; La théorie des systèmes à la lumière du fédéralisme in L'Europe en formation n° 263, print. 1986.
-
cf. M. Marc-Lipiansky, La méthodologie fédéraliste, pp. 7-10, Presses d'Europe, Paris-Nice, 1980.
-
L’édition du Monde du 15/02/1997 rend compte de cette polémique à laquelle est consacrée une page entière.
-
cf. Écrits …, p. 13.
-
cf A. Marc, « Dialogue avec la science » in L'Europe en formation n°273, autom-hiv. 1988.
-
cf. Écrits …, p. 39.
-
Cf M. Marc-Lipiansky, La révolution technologique in L'Europe en formation n° 302, hiv. 1996.
-
Spengler précise qu'il n'emploie pas le terme de race au sens physiologique que lui donne la science et que, pour lui, l'expression “avoir de la race” désigne « quelque chose de cosmique et de dirigé, une harmonie sentie du destin, une marche et une allure égale dans l’être historique » (II, 150-151).
-
Cf. A. Marc, Civilisation en sursis (La Colombe, 1955), pp. 170-187 ; La démocratie contre le peuple in L'Europe en formation, mai-juin 1981 ; F. Kinsky, Crise de la démocratie in L'Europe en formation n°271, print. 1988 ; M Marc-Lipiansky, Esquisse d'une économie fédéraliste, Presses d'Europe, 1993 ; Crises et Crise, Presse d'Europe, 1997, pp 28-29 : Faillite de la “stato-démocratie”.
-
J'ai moi-même dénoncé ce phénomène dans mon article sur le totalitarisme in L'Europe en formation, n°280, hiv. 1990, pp. 90-94.
-
Impérialisme et classes sociales, Flam., 1984, p. 44.
-
L’Ordre Nouveau, n°9, mars 1934, p. 27.
-
cf. L'Argent et L'Argent (suite), où il dénonce le triomphe de “l'Argent-Roi”.
-
Considérations sur l'Histoire universelle (1905).
-
Elle exige en effet une vaste culture, un labeur acharné et expose ceux qui ont le courage de s’y engager aux critiques acerbes des spécialistes qui ne leur pardonnent pas d’oser s’immiscer sur le territoire exigu qu’ils ont défriché toute leur vie !
-
Cf. P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics (1941) ; ouvrage partiellement traduit en fr. in Comment la civilisation se transforme, Librairie M. Rivière, 1964.
-
cf A. Toynbee, L'Histoire, Elsevier-Séquoia, Paris-Brux., 1975 (version revue, corrigée et illustrée de la 1ère éd. abrégée, publiée chez Gal. en 1951). L’A. a commencé à écrire A Study of History en 1920 et à le publier en 1923. Nous en rendons compte dans Crises et Crise, pp. 15-24.

◘ Présentation du texte : Publié en Allemagne au sortir de la guerre (1918-22), Le Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler fit grand bruit tant en Europe qu’aux États-Unis. Il compte parmi les livres les plus marquants du XXe siècle. Aujourd’hui encore, il reste plus que jamais d’actualité, comme nous l’explique Julius Evola dans un petit ouvrage [L’Europe ou le déclin de l’Occident, Perrin & Perrin, 45 p.] récemment publié par un jeune et courageux éditeur.
L’Europe ou le déclin de l’Occident rassemble 3 textes : Spengler, publié dans Vita italiana (1936), Le déclin de l’Occident, préface à l’édition italienne de l’ouvrage (1957), et L’Europe ou la conjuration du déclin ?, paru dans Europa Nazione (1951). Dans les 2 premiers articles, Evola analyse la somme spenglerienne en montrant que la « morphologie de l’histoire mondiale » se fonde sur « l’analogie organique ». Pour lui, le phénomène primaire de l’histoire, l’Urphänomen de Gœthe, « est constitué de cultures conçues comme des organismes qui, bien que d’ordre supérieur et de caractère supra-individuel, ont une durée de vie finie et présentent des phases bien déterminées de développement : comme les organismes proprement dits, les cultures ont une jeunesse, une période de maturité, de floraison, puis une vieillesse suivie d’un déclin et d’une fin ».
Il y a chez Spengler une nette distinction et opposition entre Kultur et Zivilisation. La première renvoie à un enracinement spirituel-culturel que les peuples traduisent historiquement par une qualité de vie organique ; la seconde, dans la phase crépusculaire de chaque fin de cycle, se définit aujourd’hui par la technicisation et la commercialisation des rapports humains dont le « symbole est la métropole, la ville cosmopolite tentaculaire » (Evola). À la verticalité de la Culture d’hier et de demain s’oppose l’horizontalité de la Civilisation d’aujourd’hui. Après avoir rendu hommage au grand penseur allemand, Evola reste cependant insatisfait de cette conception, trop prisonnière à ses yeux d’un vitalisme faustien laïc autant que moderne et d’un pessimisme biologico-historique incapacitant. Le déterminisme “naturaliste” de Spengler se trouve contredit, selon Evola, par les « éléments spirituels et transcendants qui sont à la base de toute grande culture ». La cyclologie traditionnelle, notamment issue de la matrice indo-européenne, satisfait mieux sa conception à la fois métaphysique et historique.
 Le troisième article du recueil se réfère à l’ouvrage d’Ulick Varange (1917-1960), alias Francis Parker Yockey, intitulé Imperium et paru en 1948. Pour Evola, Varange, en s’inspirant du concept spenglerien de culture, a justement montré la nécessité de l’unité européenne. Au-delà des organisations mondiales (ONU), des pseudo-fédérations technomarchandes (CE), des démocraties libérales (menées par les États-Unis), du communisme (alors dirigé par l’Union soviétique) et du nationalisme, un nouveau principe d’autorité doit naître : l’Empire. Il s’agit pour Evola de concilier autorité et liberté, unité politico-spirituelle et diversité populaire :
Le troisième article du recueil se réfère à l’ouvrage d’Ulick Varange (1917-1960), alias Francis Parker Yockey, intitulé Imperium et paru en 1948. Pour Evola, Varange, en s’inspirant du concept spenglerien de culture, a justement montré la nécessité de l’unité européenne. Au-delà des organisations mondiales (ONU), des pseudo-fédérations technomarchandes (CE), des démocraties libérales (menées par les États-Unis), du communisme (alors dirigé par l’Union soviétique) et du nationalisme, un nouveau principe d’autorité doit naître : l’Empire. Il s’agit pour Evola de concilier autorité et liberté, unité politico-spirituelle et diversité populaire :
« Une véritable unité ne peut être que de type organique et pour elle, le schéma est bien connu : il est celui qui se réalisa dans l’espace européen médiéval. Il reprend aussi bien l’unité que la multiplicité et se concrétise dans un système de participations hiérarchiques. Il faut dépasser le nationalisme, absolutisation schismatique du particulier, pour passer au concept naturel de nationalité. À l’intérieur de chaque espace national devra avoir lieu ensuite un processus d’intégration qui coordonne les forces dans une structure hiérarchique et stabilise l’ordre fondé sur un principe central de souveraineté et d’autorité ».
Fédérer plutôt qu’unifier, différencier plutôt que centraliser, telle est la tâche que nous recommande Evola afin de renouer avec la Grande Politique : celle qui intègre le Devenir dans l’Être. (Arnaud Guyot-Jeannin, éléments n°90)

L’Europe ou la conjuration du déclin ?
 L'exigence d'une unité européenne se fait aujourd'hui vive sur notre continent. Jusqu’à présent, ce sont des facteurs négatifs qui l'ont surtout alimentée : on veut s'unir pour se défendre, et cela pas tant pour un motif issu de quelque chose de positif et de préexistant, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix face à la pression menaçante d’intérêts non européens. Vu les circonstances, on ne voit pas très bien quelle serait la forme interne d'une véritable unité européenne.
L'exigence d'une unité européenne se fait aujourd'hui vive sur notre continent. Jusqu’à présent, ce sont des facteurs négatifs qui l'ont surtout alimentée : on veut s'unir pour se défendre, et cela pas tant pour un motif issu de quelque chose de positif et de préexistant, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix face à la pression menaçante d’intérêts non européens. Vu les circonstances, on ne voit pas très bien quelle serait la forme interne d'une véritable unité européenne.
Pour l'instant, il semble que l'on n'aille pas au-delà d'un projet de coalition ou de fédération, qui en tant que telle aura toujours un caractère extrinsèque, hybride plutôt qu'organique et donc aussi contingent. Une unité vraiment organique pourrait se concevoir sur la base d'une force venant de l'intérieur et d'en haut, propre à une vision, une culture et une tradition commune. Voulant affronter le problème européen en ces termes, il apparaît à chacun combien la situation est difficile et combien de facteurs problématiques nous interdisent de nous raccrocher à un facile optimisme.
Beaucoup se sont déjà penchés sur ces aspects du problème européen. À cet égard, l'œuvre de Ulrik Varange (1917-1960), intitulée Imperium (Westpress, 1948) est significative. C'est d'elle que nous pouvons partir pour un examen approfondi des difficultés évoquées.
Varange ne défend pas la thèse de l'unité européenne en termes purement politiques. Il part d'une philosophie générale de l'histoire et de la culture se référant à O. Spengler. On connaît la conception de Spengler. Varange s'en inspire quand il considère le monde européen à la manière d'un organisme de culture muni d'une vie autonome, développant son idée selon un destin propre. En outre, il le suit quand il constate que la phase cyclique dans laquelle se trouve l'Europe est désormais celle de la civilisation.
Mais à la différence de Spengler qui, au moins en un premier temps, et par référence à elle, avait lancé l’expression déclin de l'Occident, Varange cherche à permuter le négatif en positif, à voir le bon côté des choses et évoque ces forces nouvelles qui obéiraient à un impératif de renaissance et à des valeurs irréductibles au matérialisme et au rationalisme. Le développement cyclique, au-delà des ruines du monde d'hier et de la culture du XIXe siècle, conduirait l'Europe vers une ère nouvelle de politique absolue, de supranationalité, d'autorité, et donc aussi d'Imperium. Suivre cet impératif biologique hors de l'époque de civilisation ou bien mourir serait l'alternative pour l'Europe.
Suivant cet ordre d'idées, appartiendraient à l'idéologie du passé non seulement la conception scientiste et matérialiste de l'univers, mais aussi le libéralisme et la démocratie, le communisme et l'ONU, les États pluralistes et le particularisme national. L'impératif historique consisterait à réaliser l'Europe comme une unité de nation-culture-race-État, selon un principe rajeuni d'autorité et de nouvelles discriminations précises entre amis et ennemis, entre monde familier et monde barbare.
Il est bon d'évoquer ce que Varange entend par pathologie de la culture. Une culture peut voir son organisme entravé dans ses lois naturelles par un processus de distorsion quand des éléments extérieurs en détournent les énergies de l'intérieur, visant des actions et des fins sans relation avec son exigence vitale mais qui font le jeu de ces forces externes. Ceci trouve une application directe dans le domaine des guerres, la véritable alternative n'étant pas, d’après Varange, entre guerre et paix, mais entre les guerres utiles et nécessaires à une culture et celles qui altèrent, voire désagrègent cette culture.
Le second cas est celui où l'on ne se bat plus contre un ennemi réel qui menace biologiquement l'organisme matériel et spirituel de sa culture mais quand la guerre éclate à l'intérieur d'une culture, comme il est advenu en Occident lors des 2 conflagrations mondiales. Des chefs d'État ont alors préféré la ruine de l'Europe et l’assujettissement fatal de leurs patries à des peuples barbares d'Orient et d'Occident plutôt que de coopérer à une Europe neuve qui tendait à dépasser le monde du XIXe siècle et à se réorganiser sous de nouveaux symboles d'autorité et de société. L'effet fatal est désormais bien visible : la victoire n'a pas été celle d'un pays européen sur un autre, mais bien celle de l'anti-Europe d'Asie et d'Amérique sur l'Europe elle-même.
Cette accusation atteint spécifiquement l'Angleterre mais Varange l'étend aussi aux États-Unis, retenant que leur politique interventionniste, développée sous l'effet d'une distorsion de culture, poursuivait des buts sans lien organique avec les nécessités vitales des nations.
Les choses allant s'accélérant pour l'Occident, il s'agit de reconnaître l'impératif biologique qui correspond à la phase de son cycle : dépasser l'émiettement des États et faire naître l'unité d'une nation-État européenne, formant un bloc contre l'anti-Europe.
Le devoir est, dans un premier temps, interne et spirituel. L'Europe doit se débarrasser des traîtres, des parasites, des déviationnistes. Il faut que la culture européenne se désintoxique des résidus de conceptions matérialistes, économistes, égalitaires et rationalistes du XIXe siècle. Dans un second temps, l'unité culturelle de l'Europe devra trouver son expression dans une unité politique pondante, quitte à entamer des guerres civiles ou des luttes contre les puissances qui veulent tenir l'Europe sous leur contrôle.
Fédérations, unions douanières et autres mesures économiques ne peuvent constituer des solutions ; c'est d'un impératif interne que viendra l'unité et qui doit être réalisé quand bien même il pourrait apparaître désavantageux économiquement, le critère économique n'étant plus la dernière instance dans l’ère nouvelle. Dans un troisième temps, pourra se poser le problème de l'espace nécessaire à la surpopulation de la nation européenne, dont Varange voit la meilleure solution dans une percée vers l'Orient, où, sous le masque communiste, se concentre et s'organise la puissance de races séculairement hostiles à la culture occidentale.
Pour nos objectifs, en ce qui concerne Varange, cela peut suffire. Le symbole fondamental invoqué par lui est celui de l'Imperium et d'un nouveau principe d'autorité. Toutefois, nous ne pensons pas qu'il voie clairement ce qu'un tel symbole implique, s'il est assumé comme il doit l’être. Il n'aperçoit pas le décalage qu'il y a entre ce symbole et tout ce qui appartient à la phase poussée de civilisation d'une culture, dans notre cas de la civilisation européenne.
Varange doit être suivi quand il accuse d'insuffisance les solutions fédéralistes et simplement économiques du problème européen. Comme nous l'avons déjà dit, une véritable unité ne peut être que de type organique, et pour elle le schéma est bien connu, il est celui qui se réalisa déjà dans l’espace européen médiéval. Il reprend aussi bien l'unité que la multiplicité et se concrétise dans un système de participations hiérarchiques. Il faut dépasser le nationalisme, absolutisation schismatique du particulier, pour passer au concept naturel de nationalité.
À l'intérieur de chaque espace national devra avoir lieu ensuite un processus d'intégration qui coordonne les forces dans une structure hiérarchique et stabilise l'ordre fondé sur un principe central de souveraineté et d'autorité. La même chose devra ensuite se répéter dans l'espace européen général : les nations, unités partielles organiques, graviterons selon un unum quod non est pars (Dante), c'est-à-dire selon un principe d'autorité hiérarchiquement supérieur à chacune d'entre elles.
Ce principe, pour être viable, devra nécessairement dépasser le milieu politique au sens étroit, se fonder et se légitimer sur une idée, une tradition et même un pouvoir spirituel. Alors adviendra l'Imperium, l'unité organique virile et libre de toutes les idéologies niveleuses, libérales, démocratiques, chauvines, collectivistes, de telle sorte qu'elle puisse se détacher aussi bien de l'Orient que de l'Occident, c'est-à-dire de 2 blocs, qui, comme les branches d'une seule tenaille, se referment sur nous.
Ainsi la prémisse d'un développement de ce genre n'est pas la dissolution des nations dans une nation unique, en une espèce de substance sociale européenne homogène, mais bien l'intégration hiérarchique de chaque nation. La véritable unité, non pas mixte mais organique, se réalise non pas par la base, mais au sommet. Détruite l'hybris nationaliste qui accompagne toujours les moments démagogiques, collectivistes et schismatiques, une unification virtuelle pourra se continuer au-delà de nations hiérarchisées, laissant à celles-ci leur individualité naturelle et leur forme.
Et ainsi tout serait en ordre. Le mal est pourtant que le cadre naturel d'une pareille réalisation est celui d'un monde qui se trouve en phase de culture et non de civilisation. Des écrivains comme Varange mélangent les choses qui appartiennent à des plans distincts, tombant dans l'équivoque qu'encourut en son temps Mussolini lui-même.
Mussolini, sans connaître l'œuvre capitale de Spengler, avait lu de lui Années décisives et fut marqué par les pronostics d'un nouveau césarisme. Dans ce livre, il ne se rendit pas compte du lieu qui, selon Spengler, se prête à des formes de ce genre dans le cycle des cultures : c'est quand s'effondre le monde des traditions, quand la Kultur a disparu au profit de la Zivilisation, quand les valeurs qualitatives sont tombées et que l'élément informe des masses prend le dessus et seulement alors, dans la phase automnale ou crépusculaire d'un cycle, que les nations aussi disparaissent au profit de grands agrégats supranationaux sous le signe d'un pseudo-césarisme, d'un pouvoir personnel centralisé, en soi informe, sans approbation supérieure. Ceci n'est qu'une image déformée et inversée de l'Imperium au sens traditionnel et original ; il ne s'agit pas d'empire, tout au plus de cet impérialisme qui représente chez Spengler le dernier soubresaut d'une culture mourante, à la suite de quoi une autre émergera, différente, sans lien de continuité avec la précédente.
Maintenant, quand Varange parle de l'époque nouvelle de la politique absolue et des blocs qui, une fois absorbées les nations d'une même culture dans un seul organisme, devraient avoir comme ultimes critères la discrimination existentielle amis-ennemis (reprise par Carl Schmitt, qui avait défini en ces termes l'essence moderne de l'unité purement politique) et l'impératif biologique, il reste prisonnier de la civilisation et des processus totalitaires plutôt subnationaux que supranationaux, dont la réalisation la plus récente et cohérente fut le stalinisme.
Il est clair que si l'unité européenne devait se réaliser de cette manière, par sa seule vertu l'Europe pourrait résister et se réaffirmer biologiquement contre les puissances impérialistes extra-européennes, mais au même moment elle abdiquerait intérieurement, il en serait fini de l'Europe proprement dite, de la tradition européenne, elle serait devenue un fac-similé de ses adversaires, ramenée sur le terrain d'une lutte dictée par cette vile volonté d'existence et de puissance, en attendant que les facteurs généraux de désintégration propres à la culture techno-mécaniste se fassent sentir. C'est plus ou moins le pronostic que fait Burnham quand il considère les issues possibles de ce qu'il nomme la révolution managériale en cours (The managerial Revolution, New York, 1941).
Quelles sont les autres prospectives ouvertes ? Difficile à dire. Quant aux nations, chacune d'elles peut maintenir sa propre individualité et la dignité d'un tout partiel organique, ou bien se soumettre à un ordre supérieur, seulement dans les 2 conjonctures évoquées : celle, extrinsèque et non contraignante, qui se définit en termes d'utilité matérielle et de nécessité externe, ou celle où sera reconnue par la nation une autorité réellement supérieure et que ne peut s'accaparer par hégémonie aucune nation particulière. Où trouver un point de référence à tout cela ? On parle volontiers de tradition, de culture européenne, d'Europe comme organisme autonome, mais à bien considérer les choses aujourd'hui et à les mesurer à l'échelle des valeurs absolues, on voit bien qu'il ne s'agit rien de plus que de slogans et de belles phrases.
Au plan supérieur, l'âme de l'Europe supranationale devra être religieuse : non pas abstraitement, mais par référence à une autorité spirituelle précise et positive. Aujourd'hui, même en faisant abstraction de la sécularisation et de la laïcisation générale de l'Europe, il n'existe sur notre continent rien de semblable. Le catholicisme n'est pas la confession de toutes les nations européennes. Partir du christianisme générique serait trop peu, trop incorporel et uniforme, non exclusivement européen et donc non monopolisable par la culture européenne. De plus, on peut douter de la possibilité de concilier christianisme et métaphysique de l'Empire : le conflit médiéval entre les 2 pouvoirs, compris dans ses véritables termes, nous le montre.
Laissons-là ce registre et passons au plan culturel. Peut-on parler aujourd'hui d'une culture artistique européenne différenciée qui se maintiendrait dans ses expressions variées et syntones comme une culture des seules nations européennes ? De nouveau, il serait hasardeux de répondre affirmativement et la raison en a été montrée par Steding dans Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur. Cette raison réside en ce qu'il nomme la neutralisation de la culture : une culture divergeante de l'idée politique commune, une culture privée, transitoire et pourtant cosmopolite, désaxée, suggestive, antiarchitecturale, neutre et anonyme dans ses aspects scientistes et positivistes. Mettre cela sur le compte d'une pathologie de la culture, d'une action externe et porteuse de distorsions, comme le veut Varange, signifie penser de façon simpliste.
En général, où peut-on trouver aujourd'hui, en phase de civilisation, une base culturelle suffisamment différenciée pour pouvoir sérieusement nous opposer à l'autre, le barbare, comme on a pu le faire par le passé dans le cas de précédents espaces impériaux ? Il faudrait pousser très loin, pour en venir là, le travail de désintoxication et de réintégration, car si nous pouvons juger à juste titre barbares et antieuropéens certains aspects de la culture nord-américaine, il ne faut pas perdre de vue tout ce qui, en elle, représente le développement extrême de tendances et de maux qui se firent d'abord jour en Europe. C'est là que réside justement la raison de la faible immunité de l'Europe par rapport à elle.
Aujourd'hui, nous en sommes réduits à un tel point que, quand on parle de tradition, on tombe dans l'équivoque. Depuis longtemps déjà, l’Occident ne sait plus ce qu'est la tradition au sens le plus haut, l'esprit anti-traditionnel et l'esprit occidental ne faisant qu'un depuis la Renaissance. La tradition au sens intégral est une catégorie qui appartient à une époque que Vico appellerait l'âge héroïque, où une seule force ayant des racines métaphysiques se manifeste dans les coutumes comme dans le culte, dans le droit, le mythe, la création artistique et dans chaque domaine particulier de l'existence. Où peut-on constater aujourd'hui une survivance de la tradition prise en ce sens ? Et en particulier de la tradition européenne, grande, unanime et non pas paysanne et folklorique ? C'est seulement dans le totalitarisme niveleur que l'on a pu, à la rigueur, lire des tendances à l'unité politico-culturelle absolue. Concrètement, la tradition européenne a pour contenu aujourd'hui les seules interprétations privées et plus ou moins divergentes d'intellectuels à la mode.
De cela et d'autres considérations du même genre, on arrive à une conclusion fondamentale : l'unité supranationale aux traits positifs et organiques est impossible en période de civilisation. Dans une telle période, on peut concevoir, au maximum, la fusion des nations dans un bloc informe de puissances, dans lequel le principe politique est l'ultime instance et subordonne tout facteur moral et spirituel : monde tellurique de la révolution mondiale (Keyserling) ou monde de la politique absolue sous le signe d'un impératif biologique (Varange), ou nouveaux complexes totalitaires entre les mains des managers (Bunnham), selon ce qui sera pressenti par une majorité d'États. Une unité construite sur la tradition serait quelque chose de bien différent.
Devrons-nous conclure négativement notre bilan et nous contenter d'une idée plus modeste, fédéraliste, sociale ou sociétale ? Cela n'est pas sûr car une fois constatée l’antithèse, il suffirait de s'orienter en conséquence. S'il est absurde de vouloir poursuivre notre idéal dans le cadre d'une civilisation (il en sortirait déformé et inversé) le dépassement de tout ce qui est civilisation doit être le point de départ de toute initiative de reconstruction. Civilisation équivaut à monde moderne et sans se faire d'illusion, on doit reconnaître que du monde moderne, de son matérialisme, de son économisme, de son rationalisme et d'autres facteurs involutifs et dissolvants, l'Europe est éminemment responsable.
Premièrement, devrait avoir lieu un renouveau spirituel, éveillant de nouvelles formes de sensibilité et d’intérêt, un nouveau style interne et une nouvelle orientation fondamentale et homogène de l'esprit. À cet égard, on doit se rendre compte qu'il ne suffit pas comme le préconise Varange, de dépasser la vision de la vie du XIXe siècle dans ses différents aspects, car cette vision n'était elle-même que le résultat de causes plus lointaines. Ensuite, sur l'interprétation biologisante de Spengler, on doit émettre des réserves précises, surtout quand Varange prédit une remontée fatale, annoncée par les symptômes les plus variés. D'un autre côté, on ne peut pas non plus s'appuyer sur les mouvements révolutionnaires et rénovateurs d'hier, car les tendances contrastées qu'ils renfermaient et qui auraient pu aboutir positivement ont été étouffées par les défaites militaires.
Cependant la crise du principe d'autorité me semble être la difficulté la plus grave car seule une telle autorité peut conduire, à l'intérieur d'une nation, à dépasser individualisme et socialisme, et dans un espace européen, à réduire l'hybris nationaliste, les orgueils sacrés et la crispation des souverainetés étatiques par des voies différentes que celles de la nécessité et des intérêts conjoncturels. Si quelque chose est propre à la tradition occidentale, c'est l'union spontanée d'hommes libres et fiers de servir un chef digne de ce nom.
Pour une unité européenne vraie, nous ne saurons concevoir que la répétition en grand de quelque chose d’héroïque, et non l'inauguration d'un “parlement” ou d'un fac-similé de société par actions. De tout cela résulte clairement l'erreur de l'agnostique en politique qui admet une idée européenne se réduisant à une sorte de commun dénominateur informe : il faudrait un centre de cristallisation et la forme du tout ne peut pas ne pas se refléter dans les parties. Sur un fond qui soit non de civilisation mais de tradition, une institution bien faite ne peut être qu'organique et hiérarchique. À l'unité supranationale, nous nous rapprocherons d'autant plus dans les unités partielles, nationales, que l'on procédera à une intégration en ce sens.
Le fait qu'à l'extérieur, de multiples facteurs nous font désormais sentir que pour l'Europe faire bloc est désormais une question de vie ou de mort, doit nous conduire à reconnaître le double problème à résoudre pour donner à cette Europe nouvelle une base solide : d'un côté dépasser graduellement tout ce qui nous relie à la civilisation, de l'autre, trouver une espèce de métaphysique qui puisse justifier une idée qu'elle soit nationale ou supranationale et européenne, de pure autorité.
Le double problème appelle un double impératif. Il est à voir combien d'hommes seront encore debout au milieu des ruines pour comprendre et assumer cette tâche.
► Julius Evola, Europa Nazione, 1951. (tr. fr. Rémi Perrin)
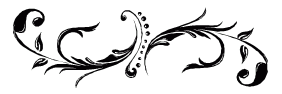
PENSÉES SUR LE DESTIN
1
La vie a un but. C'est l'accomplissement de ce qui a été posé lorsqu'elle fut engendrée.
2
Le premier fait auquel est confronté l'homme, comme à un destin inéluctable, et ce que nulle pensée ne peut comprendre, ni nul ne peut vouloir modifier, c'est le temps et le lieu de sa naissance : chacun est, lorsqu'il vient au monde, inséré dans un peuple, une religion, un état, un temps, une culture. Mais ce fait implique déjà la presque totalité des décisions.
3
Nous sommes hommes d'un siècle, d'une nation, d'un cercle, d'un type. Telles sont les conditions nécessaires à l'intérieur desquelles nous pouvons conférer à l'existence un sens et une profondeur, être des agissants, fût-ce même agissant par le verbe. Plus nous remplissons ces limites qui nous sont données, et plus notre action s'étend au loin. Platon était Athénien, César était Romain, Gœthe était Allemand : ils l'étaient entièrement et avant tout ; telle fut la condition même de leur empreinte dans l'histoire universelle.
4
De par sa naissance, l'individu reçoit sa nature et un cercle de tâches possibles, à l'intérieur duquel le libre-arbitre existe légitimement. Ce que peut ou veut sa nature, ce que lui permet ou lui interdit sa naissance, c'est cela qui trace, pour tout homme, un cercle de bonheur ou de détresse, de grandeur ou de lâcheté, de tragique ou de grotesque, qui seul donne un contenu à sa vie et, entre autres choses, tranche la question de savoir si elle a, en rapport avec l'ensemble de la vie, et par conséquent pour quelque aspect de l'histoire, une signification, ou si elle n'en a pas.
5
Le destin, c'est déjà : où, quand, sous quelle forme on vient au monde, en quelle année, dans quel peuple, dans laquelle de ses couches ; mais aussi, avec quel corps et quelle âme : malade, traînant une lourde hérédité, infirme, avec quelles dispositions innées.
Les tragédies des individus résultent de la contradiction entre ces destins internes et les destins extérieurs. C'est la manière dont chacun en vient à bout qui marque son rang : fièrement, lâchement, de manière vile, avec grandeur, à soi-même sa propre loi, ou sans loi.
6
La jeunesse seule a un avenir et est avenir... Quiconque... s'élance, emporté par le débordement de ses forces, vers un quelque chose, celui-là n'a pas besoin de se référer à quelque fin ni quelque utilité pratique. Il sent qu'il est lui-même le sens de ce qui doit advenir. Telle était la croyance en l'étoile qui n'a jamais abandonné César ni Napoléon ni non plus aucun des grands actifs d'autre nature, et, malgré toute la mélancolie des jeunes années, c'est ce qu'il y a au plus profond de toute enfance, dans toutes les générations, tous les peuples, toutes les cultures doués de jeunesse.
7
Ce que nous faisons, il faut que nous le fassions. Notre volonté libre, c'est là le destin.
8
Le libre-arbitre n'est pas un fait, mais un sentiment.
9
Tout acte est un destin qui se déguise en un vouloir.
10
Peu importe, pour l'être vivant, qu'il croie ou non au libre-arbitre. Les conséquences qu'il en tire, c'est cela qui compte — car c'est à cela qu'on reconnaît s'il est ou non une âme faible. Tout est prédestiné : donc, cette grande tâche m'est prédestinée.
11
L'individu est libre. Il fait ce qu'il veut. Mais justement : le grand individu veut ce que veut le temps - à savoir : le temps qui vient.
12
L'homme qui importe vit de telle manière que son existence soit un sacrifice à son idée.
Le sens que l'on donne à sa propre vie est un témoignage de respect envers soi-même.
13
Le créateur se sent libre. En tout acte est contenue la liberté. Tout acte, même celui qui échoue, est, de par son essence, une victoire de la volonté libre.
14
Lorsqu'une grande situation historique est donnée, le premier venu occupe la place ; qu'elle ne le soit pas, et le plus grand des hommes lui-même ne peut trouver sa place.
Les grands hommes sont donc autre chose que les personnalités historiques.
15
Parmi les personnalités qui meuvent le monde, il ne se trouve que très peu de génies, et parmi les génies, rares sont ceux qui ont mû le monde : le plus souvent, c'étaient des personnalités de rang bien inférieur que le hasard a mises à leur place.
16
L'amertume la plus profonde, dans la vie, c'est de devoir dire qu'on n'est pas à la hauteur d'une tâche, qu'on n'est pas un grand savant, un grand soldat, un grand artiste. Mais la dignité intérieure exige cet aveu.
17
C'est la souffrance seule qui révèle le rang d'un être humain : sous les coups du destin, dans la détresse, sur les ruines de ses plans et de ses espoirs.
18
Il est des hommes indignes d'une grande souffrance.
19
Le caractère d'un peuple est la résultante de ses destins. Ce n'est ni le pays, ni le climat, ni le ciel et la mer, ni non plus la race et le sang qui, en dernière analyse, le font naître. Tout cela n'est que la matière que les coups de la réalité historique forgent en forme.
Dans l'histoire, ce sont les souffrances, plus que les réussites, qui modèlent le caractère.
20
On n'échappe pas au destin en fermant les yeux, en le niant, en luttant contre lui, en le fuyant. Ce ne sont là que d'autres manières de l'accomplir. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
21
Ce que tout événement a d'unique, d'irrévocable, de définitif, telle est la forme sous laquelle le destin apparaît à l'œil de l'homme.
22
Le hasard, c'est l'épiphanie du destin qui semble absurde à la pensée humaine, qui ne rentre pas dans « des systèmes ».
23
« Tout est hasard » et « tout est nécessité », ces deux maximes ont le même sens. L'histoire entière, et tout en elle, est hasard et est nécessaire.
24
L'existence éphémère, le surgissement et l'effacement, telle est la forme de toute réalité, des étoiles, dont le destin échappe à nos calculs, jusqu'au grouillement passager qui couvre notre planète.
25
L'évolution implique l'achèvement — toute évolution a son début, tout achèvement est une fin —, la jeunesse implique la sénilité, le surgissement contient l'effacement, comme la vie fait de la mort.
26
Une fois qu'un être humain a une grande tâche à remplir, nul malheur ne peut l'atteindre, tant qu'il n'a pas accompli ce à quoi il est destiné.
27
Je ne crois pas qu'un homme vraiment important, au cours de sa vie, se signale jamais par quelque hasard grossier, par exemple en gagnant le gros lot. Cela n'a lieu que dans une existence qui, de toute manière, est fondée sur le vide. Le destin ne commet pas de telles méprises, et du reste, tout grand homme en a le sentiment. Il est « à l'épreuve des balles », aussi longtemps qu'il est, lui et son œuvre, indispensable. Nietzsche devenue millionnaire au casino de Monte-Carlo, ou Gœthe paralysé par un accident de voiture — c'est impossible.
28
Rien de ce qui fut jamais un fait ne peut se révoquer. Après une mutation politique décisive... tous sont contraints de progresser dans cette direction, qu'ils l'aient ou non voulu. Ce serait lâcheté et courte vue que de dire non. Ce que l'individu ne veut pas faire, l'histoire le fera au moyen de lui.
29
L'éthique est la forme intérieure de l'être en acte. On ne la choisit pas, on n'en a même pas conscience, on l'exécute seulement. Cela vaut déjà des animaux. Là où, chez l'être vivant, est une volonté, là est aussi un éthos.
Quant à l'éthique de sa vie, on ne la choisit pas. On est, en tant qu'individu, et du seul fait de sa naissance, intégré à elle. On l'accomplit ou on ne l'accomplit pas. Dans l'un de ces cas, on est représentant de sa manière d'être intime ; dans l'autre, un hasard sans valeur.
30
Cette vie qui nous est donnée, cette réalité ambiante en laquelle nous place le destin, les remplir du plus haut contenu possible, vivre de manière à pouvoir être fiers de nous-mêmes, agir de manière telle qu'il survive quelque chose de nous, dans cette réalité qui marche vers son terme, telle est notre tâche.
31
Lorsqu'un immense malheur fond sur un homme, c'est alors que se montre ce qu'il y avait en lui de fort et de bon. Lorsque le destin écrase un peuple, c'est alors qu'il manifeste la grandeur ou la petitesse de son âme. Seul, l'extrême péril exclut toute erreur quant au rang historique d'une nation.
PENSÉES SUR L'ÂME HUMAINE
68
Il n'existe pas d'« homme en soi », comme le prétendent les bavardages des philosophes, mais rien que des hommes d'un certain temps, en un certain lieu, d'une certaine race, pourvus d'une autre nature personnelle qui s'impose ou bien succombe dans son combat contre un monde donné, tandis que l'univers, dans sa divine insouciance, subsiste immuable à l'entour. Cette lutte, c'est la vie.
69
L'image qu'on se fait aujourd'hui de l'homme primitif est une caricature. L'homme des villes, dans son arrogance, considère l'intelligence comme le suprême trésor — et non l'astuce paysanne, mais l'intelligence des hommes de lettres — et se figure l'homme primitif sous l'aspect d'un crétin, velu (parce que de nos jours, on est rasé), balourd, grossier, à la démarche pesante. Lui étant objet de dégoût, le singe lui apparaît comme un modèle approprié pour cette image de l'homme, si bien que le premier imbécile venu sent combien il s'est développé depuis lors.
70
L'homme n'est pas un simple d'esprit, « naturellement bon » et bête, ni un demi-primate pourvu de tendances à la technique, tel que l'a décrit Haeckel et que Gabriel Max l'a peint... Au contraire, la tactique de son existence est celle d'une superbe, courageuse et astucieuse bête de proie. Il vit en attaquant, en tuant et en détruisant. Il veut être maître depuis qu'il existe.
71
Le fauve est la forme la plus haute de l'existence qui se meut librement. Cela représente un maximum de liberté à l'égard des autres et pour soi-même, de responsabilité envers soi-même, de solitude, un degré extrême de contrainte à s'affirmer par le combat, la victoire, la destruction. Ce qui confère au type humain son haut rang, c'est qu'il est un fauve.
72
Je ne « rabaisse pas l'homme au niveau de la bête » ; j'abolis le mépris du regard que l'homme jette sur la bête. Plantes et bêtes sont aussi nobles que l'homme. C'est à partir de son éthos propre — celui d'un fauve orgueilleux — que l'homme estime ou méprise d'autres êtres et les qualifie de supérieurs ou d'inférieurs, de vils, de nobles, d'orgueilleux, d'ennemis, de parasites, de vermine. Toute une symbolique s'est épanouie à partir de l'âme humaine. Toute espèce animale reflète un trait secret de cette âme.
73
Le rang de la vie est fonction de sa force, de la « volonté » ou de quelque nom qu'on l'appelle. L'expression de la volonté, c'est l'acte.
74
La volonté est l'instinct de vie, pénétré de spiritualité.
75
Pour l'essentiel, la volonté est identique à la force vitale. Les hommes sans race sont sans volonté.
76
Plus on a de « race », et plus on a de soi-même un sentiment résolu. On peut sacrifier son moi à une cause, mais volontairement. C'est la contrainte qui tue l'être noble et qui plaît à l'être vil, parce qu'il cherche à échapper au moi.
77
Qu'est-ce que le contraire de l'âme d'un lion ? L'âme d'une vache. Les herbivores substituent à la force de l'âme individuelle le grand nombre, le troupeau, le sentiment et l'acte communs aux masses.
78
C'est la peur qui agglomère les « mois » en « nous », qui produit la suppression de l'individualité. L'homme supérieur, de race robuste, veut, quant à lui, être « moi » et non pas « nous ».
79
Moins on a besoin d'autrui, plus on a de puissance.
80
La vie des animaux qui se meuvent librement est lutte, et rien d'autre, et la tactique de la vie, sa supériorité ou son infériorité à l'égard d'« autrui », que ce soit la nature vivante ou inanimée, est ce qui décide de l'histoire de cette vie, du point de savoir si son destin est de souffrir l'histoire imposée par d'autres, ou d'être soi-même histoire pour d'autres.
81
L'homme fait l'histoire, la femme est histoire.
Féminine, cette première histoire, éternelle, maternelle, végétale... cette histoire sans culture de la suite des générations, qui jamais ne se modifie, qui s'étend à travers l'existence de toutes les espèces animales et humaines, à travers toutes les cultures isolées et éphémères, d'un cours paisible et régulier. Si l'on s'y reporte en esprit, elle signifie la même chose que la vie elle-même.
82
Quoi qu'il puisse être d'autre — l'héritier de générations — l'homme n'en est pas moins un produit et une expression de sa contrée, s'adaptant à elle, s'affirmant contre elle ; car il se nourrit de la terre à laquelle il fait retour... Le destin de la terre — mourir sous la neige et la glace, se réveiller au printemps, fouettée par la pluie et la tempête, inondée, dévastée — se reflète aussi dans l'être propre de l'homme, qui en souffre et s'y oppose. C'est la dureté de ce destin d'être né ici qui a modelé la force de l'âme.
83
Fouir et labourer, c'est vouloir, non piller la nature, mais la modifier. Planter, ce n'est pas dérober quelque chose, mais l'engendrer. Mais on devient soimême plante, ce faisant, autrement dit : paysan. On s'enracine dans le sol qu'on cultive.
84
L'histoire universelle a été faite par dès ethnies mobiles ; non par une paysannerie sédentaire, mais contre elle. La liberté de la plaine, la liberté de la mer ont produit les créateurs des peuples et des États et les grands hommes d'action. La paysannerie subit l'histoire, qui passe au-dessus d'elle ; ce sont le cavalier et le navigateur qui la font.
85
Tout ce que font les animaux demeure dans le cadre de l'action de leur espèce, sans en enrichir la vie. Mais l'homme, l'animal créateur, a étalé à travers le monde une richesse de pensée et d'acte ingénieux qui lui donnent le droit d'appeler sa brève histoire l'« histoire universelle » et de considérer ce qui l'entoure comme l'« humanité », avec tout le reste de la nature pour arrière-plan, pour objet et pour moyen.
86
Il n'y a rien qui caractérise mieux la différence entre l'activité animale et l'acte humain que l'allumage du feu. On voit — cause et effet — comment naît la flamme. Bien des animaux, eux aussi, le voient. Mais l'homme est seul à concevoir... un procédé capable de la produire. Nul autre acte ne donne une telle impression de vertu créatrice. C'est l'acte même de Prométhée.
87
Qu'est-ce que l'âme ? Question déjà trop abstraite. Qu'est-ce que l'âme d'un fauve ? C'est ainsi qu'il faut poser la question. Car la plupart des esprits voient l'« âme » en l'examinant à part du caractère de l'être vivant, de ses instincts et de ses pulsions quotidiens, « en soi ».
88
Séparer le corps et l'âme, c'est montrer qu'on n'a ni l'un, ni l'autre.
89
Une âme, tout le monde l'a. Mais la personnalité — l'âme véritablement importante — est rare.
90
La compréhension se manifeste dans le fait que les choses quotidiennes et toutes simples prennent tout d'un coup une allure mystérieuse et vous oppressent. Ainsi la mort, quand on comprend qu'un jour viendra où elle se saisira de vous-même. Donc, comprendre la nécessité de sa propre mort ; c'est là plus que l'angoisse des bêtes à l'agonie, qui voient bien le danger, mais non la conséquence qu'il entraîne pour la vie.
91
Qu'on ait une âme, on ne le remarque qu'au moment où elle vous fait souffrir. Chacun devrait s'en souvenir, en repensant à son enfance.
C'est seulement cette expérience, et avec elle le fait d'observation qu'à la mort d'autrui, « la vie s'en va », qui a créé la croyance à l'âme.
92
C'est de la rencontre avec le Toi que naît l'éveil de la conscience d'un Moi. Le mot « Moi » est donc la notation du fait qu'il existe un pont jeté vers un autre être.
93
Le langage ne lie pas seulement deux êtres éveillés — l'éveil de deux êtres humains — mais maintient aussi la distance entre eux.
94
En compagnie d'un feu, l'homme ne se sent jamais seul. La flamme peut être une compagnie.
95
« Conscience » et remords sont des formes de l'angoisse. L'homme courageux a « bonne conscience ». Ce qu'il fait est bon.
96
L'animal, lui aussi, pose des questions. On n'interroge pas qu'en paroles, mais aussi en actes. Un animal examine l'objet, le roule, appuie dessus, le déchiquète — telle est la nature de l'interrogation que l'homme, être tardif, se borne à traduire en mots. Mais il est des questions pratiques et des questions théoriques. C'est seulement de l'interrogation théorique que relève le mot.
97
Vivre, c'est agir et souffrir. Plus un homme sait de choses, et plus profonde est la peine de son âme.
98
La souffrance est la grande éducatrice, la bienfaitrice de l'humanité. C'est par elle qu'elle a mûri. C'est d'elle qu'elle a appris l'orgueil, la gloire, la bravoure, le respect. Venir à bout du malheur, ou fuir devant lui — c'est ce choix qui sépare les natures nobles des natures viles. Car ce qui suit immédiatement la souffrance — la souffrance esquivée —, c'est le vide.
99
Le bonheur, c'est l'inespéré, le rare, l'invraisemblable, l'éphémère, ce dont on jouit à l'aveuglette. Il y a eu, parmi les hommes, d'autant plus de bonheur qu'ils ont moins médité sur son essence et le droit au bonheur.
100
Pour l'homme, ce qui suit l'espérance réalisée, c'est l'ennui. Pour l'animal, qui n'espère point, mais désire, il n'en est pas ainsi. Car l'espoir implique la représentation d'un but.
101
Oisif, l'animal s'endort ; oisif, l'homme médite.
102
On peut définir l'intelligence pratique comme celle de l'attaque — puisqu'on s'attaque aussi aux situations difficiles : éclaireur, marin, tireur.
103
La tension intellectuelle ne connaît... qu'une forme de repos, celle qui caractérise les métropoles : la détente, la « distraction ». Le jeu véritable, la joie de vivre, le plaisir, l'ivresse... ne sont plus du tout saisis selon leur essence. Mais la relève d'un travail intellectuel pratique d'extrême intensité par son contraire, la niaiserie consciemment recherchée, la relève de la tension de l'esprit par celle, physique, du sport, de la tension physique par celle, sensuelle, du « plaisir » et celle, intellectuelle, de l'« excitant » que sont le jeu et le pari, la substitution, à la logique pure du travail quotidien, d'une mystique consciemment savourée — tout cela se répète, dans toutes les métropoles de toutes les civilisations.
104
L'humour pardonne. La satire méprise. L'esprit n'est que jeu intellectuel.
105
Il n'y a de cruauté qu'entre êtres de culture : c'est la souffrance consciemment infligée.
106
L'homme de culture seul est cruel. Il faut, pour cela, l'âme imprégnée d'esprit, consciente de la souffrance d'autrui, et qui l'accroît pour son propre plaisir, ou la partage. Cruauté et pitié sont liées entre elles. Un animal n'est pas cruel, ne comprenant pas, ne vivant pas la souffrance d'autrui.
107
Les animaux et les hommes de nature ne sont ni pervers, ni ne débrident leurs instincts. Leur éros est en harmonie rythmique avec le cosmos... C'est seulement la culture, l'artificiel, qui a fait de l'érotisme un problème, un déchaînement de la concupiscence.
108
La haine... suppose que l'on estime l'adversaire. Elle comporte un certain aveu d'égalité de rang spirituel. Quant aux êtres inférieurs à vous, on les méprise. Les êtres qui ont eux-mêmes l'âme basse sont envieux.
109
Le respect de l'adversaire est orgueilleux. L'envie veut le ravaler au niveau de votre propre petitesse.
110
Le contraire de noble, ce n'est pas pauvre, mais vil.
111
La conscience de la communauté et la conscience du troupeau sont choses bien différentes — l'une sacrifie le moi, tandis que l'autre recherche, faute de moi, la chaleur du contact.
112
La proximité, si elle n'est nécessaire, engendre la haine.
113
Toutes les grandes inventions, toutes les grandes entreprises proviennent du plaisir de vaincre que recherchent les âmes fortes. Elles sont expression de la personnalité, non du goût de l'utile.
114
Les passions asservissent.
115
La lâcheté aveugle.
116
L'héroïsme n'affronte pas seulement des ennemis concrets, mais aussi des états de l'âme.
117
L'amour et la passion exigent le visage, en tant que centre de la personnalité. On n'aime que quelqu'un dont le visage est ineffaçable.
118
L'adolescent sait tout. L'homme fait doute de tout. Seul, le vieillard parvient à cette certitude qu'il ne sait rien.
119
Tout acte modifie l'âme de celui qui agit.
120
Pour s'enthousiasmer, il suffit d'être humain ; pour se résigner, il faut être viril.
► Oswald Spengler, Nouvelle École n°33, 1979. (traduction : Henri Plard)
Note : Les aphorismes ci-dessus sont extraits des ouvrages suivants : Le Déclin de l'Occident (aphorismes 1, 6, 50, 80, 83, 92, 103, 119), Années décisives (28, 110, 115), L'homme et la technique (24, 25, 68, 70, 71, 77, 79, 81, 85, 86, 108, 113), Preussentum und Sozialismus (3, 20, 30), Pessimismus ? (2, 4, 21), Politische Pflichten der deutschen Jugend (114), Neubau des deutschen Reiches (31), Vom deutschen Volkscharakter (19), avant-propos aux Politische Schriften (20), Zum weltgeschichtliche des 2. vorchristlichen Jahrtausends (84), écrits posthumes (5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 116, 117, 118, 120).

◘ LIENS :
- Biographie (blog thiboniste)
- Bibliographie
- An Introduction to his life & ideas
- Jünger & Spengler
- Karl Kraus & Spengler
- Rosenzweig & Spengler
- Gabrielle Roy & Spengler
- Critique de Heidegger envers la morphologie des cultures
- Oswald Spengler (Encyclopédie de L'Agora) cf. La conception de Spengler
- Déclin de l'Occident ou débâcle de l'Europe ?
- La vengeance de Spengler
- Spengler l'infréquenté [JL Evard, bien que traducteur et documentaliste doué, est intéressant en ce qu'il montre également – à son insu – ce qu'il en est d'une certaine réception de Spengler. Voué à la manie comparatiste comme nombre d'auto-proclamés historiens des idées qui sont de fait des (bien souvent mauvais) idéologues masqués (avec l'habituel souci d'objectivité comme cache-sexe d'une dépolitisation égotiste), il ne peut saisir ce qu'implique vértablement l'intempestivité (Unzeitgemäss) au sens nietzschéen, à savoir en quoi un enjeu civilisationnel fait historicité (bien qu'ayant pourtant traduit un court texte de G. Simmel dans la RMM rappelant la nécessité de construire un cadre historique pour contextualiser et expliciter son approche). L'auteur des Années décisives n'est pas interrogé quant à ce que recèle sa stratégie d'écriture, autrement dit sa volonté de destin devant rompre avec la logique d'un Occident malade en stade final, mais est momifié comme vieux réactionnaire atrabilaire prussien (en somme une icône néo-droitière), échappant de peu aux déjà menés procès inquisitoriaux estampillant de préfascisme, comme du temps de l'Allemagne années 50, Jünger pourtant en prise avec la question du nihilisme ou bien Klages mu par un romantisme antiticapitaliste faisant chair avec le cauchemar de l'histoire et en prise avec la question de l'aliénation posée vivement par un processus d'industrialisation déshumanisant, conforté alors par le mythe du Progrès.]
- Divers articles (plusieurs langues) (autres)
- Aphorismes
- Articles en anglais
- Propos sur le pacifisme
◘ OUVRAGES CRITIQUES :
- Irrationalisme et humanisme : critique d'une idéologie impérialiste (T. Schwarz)
- Essai sur l'anti-progressisme, H. Kauffman, ch. VIII, Paris, thèse de 1936
- Oswald Spengler (H. S. Hughes)
- Oswald Spengler : Témoin de son temps, G. Merlio, 2 vol. (issus de sa thèse), Akad. V., Stuttgart, 1982
- Cahiers Science & Vie n°109
- Urkultur n°10
- « Spengler, Marx, Heidegger : penser la technique », A. de Benoist in Nouvelle École n°42
- Nouvelle École n°59/60 (2011) [éditorial]
