Déclin
Le déclin comme destin
 En apparence l’erreur d’Oswald Spengler fut immense : il annonçait pour le XXe siècle le déclin de l’Occident, alors que nous assistons tout au contraire à l’assomption de la civilisation occidentale, à l’occidentalisation de la Terre, à la généralisation de cet “Occident” auto-instauré comme culture du genre humain, dont, suprême paradoxe, les nations néo-industrielles de l’Orient constitueront peut-être d’ici peu l’avant-garde. En apparence toujours, c’est au déclin de l’Europe que nous sommes conviés. Montée en puissance de l’Occident et perte de substance de l’Europe : les 2 phénomènes sont sans doute liés, l’un entraînant l’autre. Tout se passe comme si, après avoir accouché de l’Occident, répandu aujourd’hui sur toute la planète, l’Europe épuisée entrait dans un nouvel âge sombre.
En apparence l’erreur d’Oswald Spengler fut immense : il annonçait pour le XXe siècle le déclin de l’Occident, alors que nous assistons tout au contraire à l’assomption de la civilisation occidentale, à l’occidentalisation de la Terre, à la généralisation de cet “Occident” auto-instauré comme culture du genre humain, dont, suprême paradoxe, les nations néo-industrielles de l’Orient constitueront peut-être d’ici peu l’avant-garde. En apparence toujours, c’est au déclin de l’Europe que nous sommes conviés. Montée en puissance de l’Occident et perte de substance de l’Europe : les 2 phénomènes sont sans doute liés, l’un entraînant l’autre. Tout se passe comme si, après avoir accouché de l’Occident, répandu aujourd’hui sur toute la planète, l’Europe épuisée entrait dans un nouvel âge sombre.
La thèse ici présentée sera simple : l’Occident n’est pas en déclin — il est au contraire en expansion — mais il est le déclin. Et il l’est depuis ses fondements, depuis son décollage idéologique au XVIIIe siècle. L’Europe, quant à elle, n’est qu’en décadence. Déjà, parle l’étymologie : l’“Occident” est le lieu où le soleil se couche. Et, dans son essence, la civilisation occidentale, apparent mouvement ascendant, se confond en réalité avec une métaphysique du déclin, un dépérissement du principe solaire qui, superficiellement, semble la fonder. Ce déclin intrinsèque qui est la loi de l’Occident n’est pourtant pas facile à déceler tant il est empreint de paradoxes.
• Premier paradoxe : alors que l’idéologie occidentale entre dans son déclin – déclin des théories progressistes, révolutionnaires, démocratistes, etc. – la civilisation occidentale connaît, même sur le plan politique, une expansion irrésistible de ses régimes économiques et politiques, qu’ils soient socialistes ou capitalistes, au détriment des traditions locales de souveraineté et de culture.
• Deuxième paradoxe : alors que l’Europe semble entamer, hélas, en tant qu’ensemble continental, un dépérissement dans un nombre impressionnant de domaines, l’Occident qui constitue, pour Abellio comme pour Heidegger, le fils métaphysique et géopolitique de cette Europe, explose à l’échelle de la planète entière.
• Troisième paradoxe : alors qu’au sein même de notre culture, nous vivons l’implosion du sens, le déclin des grandes valeurs constituantes, l’effondrement des ressorts spirituels, nous assistons en même temps à la montée en puissance de la partie matérielle de notre culture, de sa “forme”, c’est-à-dire de ses manifestations technologiques et scientifiques qui sont en passe de détenir le règne absolu de la Terre. La civilisation technique et économique qui, partie d’Europe et d’Amérique du Nord, gagne la planète entière, ne peut pas sérieusement être confondue avec un fait de “décadence”. Les historiens nous ont montré, par ex., que la fameuse “décadence de l’Empire Romain”, trop souvent et à tort comparée avec notre situation, s’accompagnait d’une régression des “formes” de civilisation : techniques, institutions, villes, infrastructures, échanges, etc. Toujours de plus en plus de routes, d’usines, d’avions, d’écoles, d’hôpitaux, de livres, de pollution et d’êtres humains. Troisième paradoxe : plus la “structure” explose, moins ses assises idéologiques et morales semblent assurées. On assiste en parallèle à une explosion des formes de civilisation, et à une implosion des valeurs, des idéologies et surtout de tous les fondements moraux et spirituels qui confèrent un “sens” englobant aux sociétés.
• Quatrième paradoxe : si l’on se contente même de considérer le secteur de la pure économie, on observe une crise des mécanismes mondiaux de libre-échange commerciaux et monétaires, mais en même temps une irrésistible progression des technologies et de l’organisation commerciale et scientifique de l’humanité.
• Cinquième paradoxe : à l’heure où l’effondrement des taux de fécondité partout dans le monde (commencé en France au XVIIIe siècle et dans le Tiers-monde ces dernières années) n’a encore donné lieu à la dénatalité que dans les seuls pays industriels, la population mondiale, du fait d’une loi arithmétique simple à saisir, continue de croître à un rythme exponentiel [1].
Ces 5 paradoxes sont inquiétants. Au lieu de vivre des déclins globaux et linéaires comme les autres civilisations qui nous ont précédés, nous subissons ce que l’on pourrait nommer un “déclin emboîté dans une expansion”. Comme si la civilisation occidentale était une machine devenue folle, son centre implose tandis que sa périphérie explose. L’Europe régresse, l’Occident se répand. Le sens disparaît, les formes croissent. Le “sang” s’évapore, mais les veines se ramifient en réseaux de plus en plus vides. De moins en moins de cerveau, mais de plus en plus de corps et de muscles. De moins en moins d’humanité, mais de plus en plus d’hommes. De moins en moins de cultures, mais de plus en plus de civilisation. Tout cela ressemble étrangement à une prolifération cancéreuse. Un cancer, en effet, c’est le déclin de la différenciation qualitative des cellules au profit du triomphe de la reproduction quantitative.
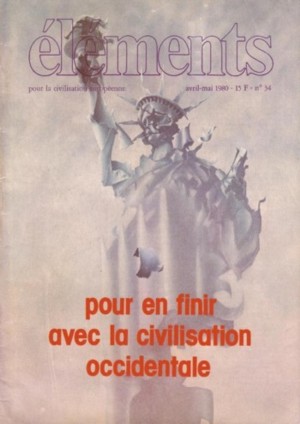 La logique profonde de l’Occident, à travers l’égalitarisme social, la conversion de toutes les cultures aux mêmes modèles politiques et économiques, à travers la rationalisation de l’existence que ne peuvent même pas éviter les régimes qui, dans leurs doctrines, la combattent, c’est depuis ses fondements la réduction de l’organique au mécanique. Le suprême paradoxe de l’Occident, c’est que son assomption est, sous l’apparence de la croissance et de la juvénilité, une entropie, c’est-à-dire une homogénéisation croissante des formes de vie et de civilisation. Or, la seule forme véritable du déclin, comme nous l’enseignent l’astrophysique et la biologie, c’est précisément l’entropie : croissance cancéreuse des cellules indifférenciées ou, selon le deuxième principe de la thermodynamique, déperdition d’énergie par homogénéisation. De ce point de vue, l’essence de l’Occident, c’est le déclin, puisque sa raison d’être est l’uniformisation des formes-de-vie humaines. Et l’essence du “progrès”, c’est l’entropie. La multiplication explosive des technologies vient masquer ce déclin à ses propres protagonistes, exactement comme, dans le processus tragique de rémission des cancéreux, la prolifération des cellules indifférenciées donne, pour quelque temps, l’illusion de la santé et de la croissance organique. L’Occident est un vieillard qui se prend pour un adolescent.
La logique profonde de l’Occident, à travers l’égalitarisme social, la conversion de toutes les cultures aux mêmes modèles politiques et économiques, à travers la rationalisation de l’existence que ne peuvent même pas éviter les régimes qui, dans leurs doctrines, la combattent, c’est depuis ses fondements la réduction de l’organique au mécanique. Le suprême paradoxe de l’Occident, c’est que son assomption est, sous l’apparence de la croissance et de la juvénilité, une entropie, c’est-à-dire une homogénéisation croissante des formes de vie et de civilisation. Or, la seule forme véritable du déclin, comme nous l’enseignent l’astrophysique et la biologie, c’est précisément l’entropie : croissance cancéreuse des cellules indifférenciées ou, selon le deuxième principe de la thermodynamique, déperdition d’énergie par homogénéisation. De ce point de vue, l’essence de l’Occident, c’est le déclin, puisque sa raison d’être est l’uniformisation des formes-de-vie humaines. Et l’essence du “progrès”, c’est l’entropie. La multiplication explosive des technologies vient masquer ce déclin à ses propres protagonistes, exactement comme, dans le processus tragique de rémission des cancéreux, la prolifération des cellules indifférenciées donne, pour quelque temps, l’illusion de la santé et de la croissance organique. L’Occident est un vieillard qui se prend pour un adolescent.
Mais, dans la mesure où cette civilisation occidentale entre dans son “troisième âge”, connaît à la fois un triomphe de ses formes, de ses quantités, de son expansion statistique et géographique mais un épuisement de son sens, de son idéologie, de ses valeurs, on peut se demander si elle n’est pas au bord de la résolution de ce déclin qu’elle porte en elle. Hypothèse : ce serait toute la Terre alors qui entrerait dans le temps du déclin, puisque, pour la première fois, toute une civilisation l’unifie, une civilisation minée de l’intérieur. La civilisation occidentale ressemble aux arbres de Paris : ils continuent à pousser alors même qu’ils sont rongés.
On peut considérer que l’uniformisation de la Terre entière sous la loi d’une seule civilisation – politique, économique et culturelle – est un processus bio-cybernétique, puisqu’il s’agit, comme le montrèrent Lupasco et Nicolescu, d’une homogénéisation d’énergies. Pour l’instant cette entropie est “expansive” ; elle sera un jour, comme toute entropie dans sa phase n°2, implosive. Et n’allons pas croire, comme l’imagine Lévi-Strauss, que de « nouvelles différences » et de nouvelles hétérogénéités puissent surgir au sein d’une civilisation mondiale devenue occidentale [2]. Il ne s’agirait que de spécificités superficielles, des folklores ou des « variantes ».
Et, dans la mesure où cette accession historique de l’humanité à une seule et même civilisation occidentale, démocratique, prospère, individualiste et égalitaire constitue le projet des idéologies du Progrès depuis plus d’un siècle, qu’elles soient socialistes ou libérales, ne doit-on pas se demander si l’idée même de Progrès ne serait pas la figure centrale du Déclin ? La matière et l’essence du Progrès, c’est l’accès de tous les hommes à la même condition et à la même morale sociale, réputée universelle. En ce sens, les doctrines progressistes, sécularisant les religions monothéistes de la vérité révélée, entament un processus de fin de l’histoire, de fin des histoires de chaque peuple. Nous entrevoyons cette fin de l’histoire aujourd’hui : statu quo planétaire par la menace thermonucléaire, condominium soviéto-américain sur le monde qui gèle les indépendances nationales, “gestion” techno-économique et financière d’une économie mondiale qui uniformise les modes de production et de consommation, etc. On ne cesse de dire, après Alvin Toffler, que nous entrons dans la « troisième révolution industrielle » ; c’est vrai, mais ne perdons pas de vue néanmoins cet étonnant paradoxe : au fantastique bouleversement des formes socio-économiques correspond la glaciation des formes politiques et « historiques ». Nous vivons une “mutation immobile”. Tout vibre (technologies, rapports sociaux et économiques) mais rien ne « bouge » (géopolitique) ; ou plutôt rien ne bouge encore. Et, comme la conscience historique, les idées et les valeurs, elles aussi, congèlent.
Derrière son triomphe, la civilisation occidentale voit aujourd’hui son ressort brisé : ses mythes fondateurs et ses idéologies dépérissent et se sclérosent. Le progressisme, l’égalitarisme, le scientisme, le socialisme ont désenchanté leurs partisans et ne mobilisent plus les énergies. Les modèles politiques d’une civilisation quantitative, tout entière fondée sur l’économie, ont produit à l’Est le totalitarisme tyrannique, à l’Ouest le totalitarisme doux et despotique de la société de consommation prévu par Tocqueville, et dans le Tiers-monde, l’ethnocide et le paupérisme de masse, ce dernier masqué par la triste mystique du “développement”.
Devenues anti-révolutionnaires, les idéologies occidentales, à l’image de cette civilisation néo-primitive qu’elles représentent, convergent aujourd’hui dans un social-libéralisme tiède, cynique, sans projet, gestionnaire, inessentiel, rassemblé autour de la vulgate académique des “Droits de l’Homme”, dont Claude Polin a bien montré l’inanité et l’inefficacité [3]. Privée de toute transcendance, organisée dans son principe autour du rejet de toute référence au spirituel, la civilisation occidentale est l’organisation technico-rationnelle de l’athéisme. Or, mutilée de ses dieux, quels qu’ils soient, une culture humaine se condamne à terme, même si par ailleurs brille l’éclat de Mammon, même si l’accumulation technologique, la progression nominale des revenus ou les « progrès de la justice sociale » donnent l’illusion de la vitalité.
Mais cette ascension de l’économie et de la technique, au nom de quoi la prendre pour une amélioration ? Il est facile de démontrer, par ex., que les processus mentaux de la société de consommation, même du point de vue de l’intelligence gnoso-praxique et technicienne, ne sont pas nécessairement plus élaborés que ceux des sociétés traditionnelles. La société technicienne voit, concrètement, décliner l’incorporation de « spirituel » (Evola) ou d’« être » (Heidegger), et même peut-être aussi d’intelligence dans ses formes de vie [4]. Et, paradoxalement, puisque le monde, contrairement aux vues chrétiennes n’est pas dualiste mais associe dans une apparente contradiction ce qu’il y a de plus immatériel et ce qu’il y a de plus biologique dans la même unité organique et vitaliste, il n’est pas étonnant qu’au déclin spirituel corresponde aussi le déclin de l’esprit de lignage, le déclin démographique. Conscience biologique et conscience spirituelle sont liées. La séparation opérée par le dualisme chrétien entre Dieu et le monde a profondément marqué la civilisation occidentale, rompant avec l’unité du transcendant et de l’immanent de la tradition hellénique. Pénétrant l’inconscient collectif et les formes de civilisation, ce dualisme a progressivement donné lieu à un désenchantement et à une désacralisation du monde, à une civilisation schizophrène : d’où les séparations mutilantes entre l’État-Père-et-Juge et la société, entre la Loi et le peuple, entre les rationalités du libéralisme et du socialisme et l’élan vital « aveugle » (mais donc clairvoyant parce qu’« obscur ») des civilisations, entre l’individu érigé en monade et ses communautés, entre la légitimité apparente de l’Occident, c’est-à-dire cette « démocratie » dont tous (tyrans compris) se réclament sans en percevoir le sens, et les aspirations réelles des populations, entre la Technique figure dominante du temps, et l’idéologie.
Ces 2 derniers points méritent des précisions. Le divorce entre la Technique, aujourd’hui prosaïque et désenchantée et l’idéologie fut souvent mal compris, notamment par Spengler et Jünger. Ce n’est pas, selon nous, la Technique qui constitue la cause du matérialisme, de l’uniformisme et de la déspiritualisation de l’Occident ; mais c’est l’idéologie occidentale elle-même qui a fait de cette Technique le moteur de sa logique mortifère. La Technique est désenchantée et non désenchantement dans son essence. La raison en est ce divorce entre l’essence de la Technique qui est, comme le vit Heidegger, poétique, lyrique, faustienne, donc spirituelle et « artistique », et les idéologies dominantes en Occident qui n’assignent à cette Technique que le prosaïsme mécanique de la domestication par le bien-être et la finalisent comme « technologie du bonheur individuel ». Si la fusée Ariane ne fait pas rêver alors qu’elle le devrait, qu’elle devrait représenter pour notre imaginaire la « transfiguration des dieux », c’est parce que sa finalité est la retransmission des émissions de télévision, c’est-à-dire l’expression du « banal » le plus plat.
 Et lorsque Gilbert Durand en appelle à la renaissance des ombres de l’imaginaire, seules capables peut-être d’affronter le désenchantement de la techno-société de consommation, ce n’est pas dans la consommation du passé, dans les musées, dans les études, dans les nostalgies, dans les mythes mis en fiches informatiques qu’elles pourront être retrouvées. C’est paradoxalement dans la contemplation brute des ordinateurs eux-mêmes, dans les fusées et les centrales, bref dans une Technique qui porte en elle le plus grand potentiel de rêve que l’humanité ait pu trouver et qui est aujourd’hui neutralisée, déconnectée, par des idéologies et des modèles sociaux tout entiers dominés par la petitesse domestique et la froide logique comptable des bureaucraties.
Et lorsque Gilbert Durand en appelle à la renaissance des ombres de l’imaginaire, seules capables peut-être d’affronter le désenchantement de la techno-société de consommation, ce n’est pas dans la consommation du passé, dans les musées, dans les études, dans les nostalgies, dans les mythes mis en fiches informatiques qu’elles pourront être retrouvées. C’est paradoxalement dans la contemplation brute des ordinateurs eux-mêmes, dans les fusées et les centrales, bref dans une Technique qui porte en elle le plus grand potentiel de rêve que l’humanité ait pu trouver et qui est aujourd’hui neutralisée, déconnectée, par des idéologies et des modèles sociaux tout entiers dominés par la petitesse domestique et la froide logique comptable des bureaucraties.
La deuxième conséquence grave du dualisme occidental porte sur le divorce entre le régime politique officiel (la fameuse « démocratie ») et la manière dont ce régime est concrètement ressenti, est socialement vécu par les prétendus « citoyens ». Nous ne pouvons ici qu’énumérer sans les développer les effets de ce divorce : non-représentativité radicale de la classe politique, toute-puissance des féodalités minoritaires (corporations syndicales, médias, réseaux bancaires, corps technocratiques), simulacre de participation électorale des citoyens au pouvoir par le caractère inessentiel des enjeux des scrutins, volonté constante des partis politiques de détourner à leur profit l’opinion réelle du peuple, etc. Plus que jamais, l’opposition entre pays réel et pays légal demeure la règle.
Fondé sur la souveraineté du peuple, l’Occident l’établit moins encore que les sociétés traditionnelles tant décriées comme tyranniques. Dans cette affaire, le plus grave n’est pas l’absence de « démocratie » (mieux vaudrait à tout prendre un pouvoir qui reconnaisse officiellement l’impossibilité de la démocratie et qui fonde la souveraineté sur – par ex. – une autocratie sacralisée) mais la schizophrénie endémique, le mensonge permanent d’un système de pouvoir qui, à l’Est comme en Occident, tire sa légitimité d’un principe (le Peuple souverain) qui non seulement n’est pas appliqué, mais dont la principale préoccupation des classes dirigeantes est d’en interdire l’application. En effet, que craignent et que combattent le plus les partis, les syndicats, les grands corps, les médias progressistes (et en URSS le PCUS) sinon la démocratie directe, sinon le césarisme référendaire où l’avis brutal du peuple s’exprime sans ambages ? Et pourquoi redoutent-ils tant ce peuple ? Parce qu’ils savent bien que dans ses profondeurs l’humanisme, l’égalitarisme éclairé, le cosmopolitisme déraciné n’ont pas de prise. Ils savent qu’au sein du peuple « ignorant », livré à lui-même sans l’encadrement des « élites » syndicales, partitocratiques et journalistiques, vivent toujours des valeurs et des aspirations qui ne correspondent pas à ce que les scribes, les technocrates, les politiciens et les prêtres attendent.
Ceux-là, qui tiennent la position d’« élites européennes » mais qui n’en ont pas la carrure, en proie au vide intellectuel et idéologique, se rallient comme à une bouée de sauvetage à la vulgate occidentale. La « droite » et la « gauche » politique font converger leurs discours appauvris dans le même atlantisme socio-libéral. Avec impudence, la gauche française, après l’échec prévisible de son « socialisme », accomplit les funérailles discrètes de celui-ci et se nomme porte-parole du capitalisme et de l’individualisme, abandonnant définitivement tout discours révolutionnaire. Ainsi naît, sur le plan idéologique comme sur le terrain politicien, une « gauche-droite », nouveau parti unique des démocraties occidentales, qui communie dans l’atlantisme, la défense de l’Occident (thème jadis des crypto-fascistes), le reaganisme, la philosophie sommaire des Droits de l’Homme et le conservatisme.
Cette « gauche-droite » idéologique et politique ne se caractérise pas seulement par son occidentalisme mais par sa dérive anti-européenne masquée par un anti-soviétisme primaire et un discours apparemment pro-européen. Il s’agit de nier toute spécificité et toute indépendance à l’Europe en la désignant comme simple zone (et comme bouclier) de l’Occident atlantique [5].
Or il se trouve que, pour la première fois sans doute dans son histoire, l’Europe n’a plus les intérêts de l’Occident (culturels, géopolitiques et économiques) et qu’un découplage de l’Europe et de l’Occident américanomorphe est devenu nécessaire. C’est précisément parce qu’elle participe exclusivement de la civilisation occidentale — qui fut jadis européenne mais qui ne l’est plus — que l’Europe est entrée en décadence. Les figures de la décadence européenne sont connues. Rappelons-les pour mémoire : cette civilisation qui est toujours virtuellement la plus dense et la plus puissante de la Terre, gît, comme Gulliver enchaîné, démembrée par le condominium soviéto-américain. Privée d’indépendance politique, futur champ clos d’un affrontement entre les 2 Super-Gros, l’Europe vit avec la perspective de son génocide nucléaire. Le « jour d’après » ne concerne pas, en réalité, nos 2 protecteurs. Victime d’une guerre économique qui la désindustrialise, en proie au centre à la colonisation et à l’occupation et, à l’ouest, à la déculturation et à l’exploitation, l’Europe est également en chute démographique. Dans tous les domaines, après avoir explosé, l’Europe, comme un trou noir, implose. Elle entre, comme après la chute de Rome, dans un nouvel âge sombre.
Mais la décadence européenne est moins grave et n’apparaît pas de même nature que le « déclin explosif » qui porte l’Occident. Ce dernier, répétons-le, est le déclin ; il porte en lui le dépérissement de toutes choses. Le déclin d’un organisme est sans rémission, parce qu’il touche ses fondements et son principe. L’Occident a un principe, abstrait, c’est l’idéologie (américanisme ou soviétisme, tous deux sécularisations du christianisme). Or l’Europe n’est pas un principe, mais un peuple, une civilisation, une histoire, de nature vivante et organique et non pas mécanique. En ce sens l’Europe n’est qu’en décadence. Elle traverse un âge sombre dont elle peut se remettre. Elle est malade et peut se guérir par auto-métamorphose, alors que l’Occident est inguérissable parce qu’il ne peut pas se métamorphoser, parce qu’il obéit à une logique linéaire, ignorant tout polymorphisme.

Comme le formule l’historien Robert Steuckers, l’Occident américain est l’alliance de l’Ingénieur et du Prédicateur ; l’Occident soviétique est l’alliance de l’Ingénieur et de l’Idéologue. Or l’Idéologue et le Prédicateur perdent, en ce moment même, leur légitimité, leur mystique, leur enchantement. Le travail de l’Ingénieur, qui n’était fondé que sur la corde raide de leurs discours et qui continue, pour un temps encore, par effet inertiel, son processus, est condamné à terme parce qu’il n’est plus alimenté. L’Europe, en revanche, est l’alliance de l’Ingénieur et de l’Historien. Le discours de ce dernier, irrationnel, fondé sur les profondeurs de l’imaginaire, peut sans doute entrer en crise comme aujourd’hui, mais il est inépuisable parce qu’il peut se régénérer selon le principe dionysiaque de perpétuelle efflorescence. L’Europe n’est que provisoirement liée au discours occidental. Ses « principes de vie » sont multiples : un peuple ne doit pas son existence, à l’inverse de l’Occident américain ou soviétique, à un mécanisme idéologique, à une légitimité « politique » qu’il faut sans cesse justifier, ou, pire encore, à la logique quantitative de l’économie. Pour survivre, un vrai peuple – cas de l’Europe et de nombreuses civilisations du « Tiers-monde » – n’a rien « à prouver ». L’Occident, lui, doit sans cesse « prouver » ; or, c’est précisément ce qu’il ne peut plus faire…
La décadence de l’Europe est liée aux effets de la civilisation occidentale, qu’il s’agisse de l’américanisme et du soviétisme. Mais, paradoxalement, le déclin déjà commencé de cette civilisation, même si dans un premier temps paraît être la cause de la décadence européenne, sera, dans un second mouvement, la condition d’une régénération de la culture européenne. La condition d’une renaissance européenne doit être trouvée dans une auto-métamorphose comme notre histoire en connut plusieurs : abandon des idéologies occidentales et naissance de nouveaux fondements que nous ne connaissons pas encore, qui ne peuvent être qu’irrationnels et spirituels, et qui, eux aussi, n’auront qu’un temps. Mais la civilisation normalisée, ayant transformé en morale prosaïque et réglementaire ses propres principes spirituels fondateurs, ne laisse plus d’espace à la création de valeurs mobilisatrices. Le narcissisme devient la destinée d’individus qui s’isolent dans le présentisme face à une société devenue autonome, dont les normes n’ont d’autres fins qu’elles-mêmes. Dans ces conditions, peut-on considérer comme un « retour du sens », comme une réponse spontanée de la société aux structures normalisatrices, les multiples manifestations contemporaines qui, dans leurs « explosions », font apparemment échec à la transparence rationnelle des discours et à la froideur des mécanismes techno-économiques ?
Les phénomènes récents de libéralisation des mœurs, l’inventivité des groupes qui viennent en « décalage » où la sociologie pense découvrir de nouveaux types de rapports humains, le mouvement diffus de réenracinement culturel qui semble annoncer un réveil des cultures populaires contre la culture marchande de masse, etc., tout cela augure-t-il un renouveau d’un « paganisme social » contre la normalisation des États-Providence ? Ou bien n’assistons-nous pas à la naissance de « soupapes de sécurité », comme des porosités dans le corps de la norme par où s’échapperaient, en quantités programmées, des énergies virtuellement dangereuses qui se verraient récupérées et neutralisées, transformées en « distractions », reproduites comme « loisirs » ? Il est difficile de répondre.
Cependant on ne peut s’empêcher de noter que notre époque voit coexister 2 phénomènes inverses, l’un de renforcement des normes techno-économiques, l’autre de libération des morales privées. L’hétéronomie sociale répond à l’autonomisation des règles non-économiques d’existence. Ce parallélisme, qui n’est pas forcément un hasard, nous incite à considérer très attentivement la fonction des mouvements de libération et d’innovation des mœurs, sans cependant négliger les espoirs qu’ils peuvent aussi susciter. Quoiqu’il en soit, pour répondre à ce désir de normalité, devenue normalisation effective, où nous enferme l’idéologie occidentale, je suis enclin à fonder plus d’espoir sur les peuples que sur les sociétés, ces peuples que mettent en branle non pas des « vibrations » de mœurs mais des mouvements de l’histoire. Or l’Europe, avant d’être une société, n’est-elle pas d’abord un peuple ? Paradoxalement, la chance de l’Europe réside peut-être dans sa vieillesse qui peut se transformer en jeunesse : l’Europe touchée la première par la civilisation occidentale, réagira peut-être la première contre elle. En ce cas, la décadence serait un facteur d’anti-déclin, et la sénescence, un facteur d’expérience et de rajeunissement : revenus de tout, désenchantés, les néo-européens des jeunes générations qui, dans leur « docte ignorance », ne veulent même plus savoir ce que politique, démocratie, égalité, Droits de l’Homme, développement, etc. signifient, qui ne croient plus dans le prométhéisme vulgaire des mystiques socialistes ou capitalistes, reviennent, du fait de cette apparente dépolitisation, aux choses essentielles : « nous ne voulons pas mourir, avec notre peuple, écrasés par une guerre atomique en Europe dont les enjeux ne sont pas les nôtres ; nous ne voulons pas nous « engager » auprès d’une droite ou d’une gauche, d’un occidentalisme ou d’un soviétisme qui ne sont que les visages faussement antagonistes du même totalitarisme ». Ce discours est fréquent dans la jeunesse. Tant mieux ; c’est celui de l’« Anarque » d’Ernst Jünger. C’est un discours révolutionnaire et engagé sous des apparences de désengagement et d’incivisme. C’est l’attitude des neutralistes allemands qui n’expriment nullement une démission, mais une prodigieuse énergie, l’éternelle ruse du peuple qui sait qu’on peut se relever d’un « régime politique » mais pas d’un holocauste.
La renaissance arborescente, rusée ou inconsciente, des vitalités populaires de toutes natures contre l’ordre froid des planificateurs ou des libéraux, des centralisateurs ou des décentralisateurs, des politiciens, des « humanistes », des prêtres, des professeurs, des socialismes, des libéralismes, des fascismes – et même des « anarchismes »… – contre les règlements, les réseaux, les programmes et les circuits, contre l’égalité et l’inégalité, la justice et la tyrannie, la liberté et l’oppression, la démocratie et le despotisme, la société permissive ou le totalitarisme, bref contre tous ces faux contraires, ces fausses fenêtres des idéologies occidentales dont le dessein commun est, comme jadis Moïse, d’imposer leur Loi contre la vie et le réel, cette renaissance donc, constitue aujourd’hui, notamment dans les jeunes générations, la principale force de l’anti-déclin. En dehors des États et des institutions officielles des pays occidentaux qui sont devenus aujourd’hui des forces de dépérissement, il faut parler d’une résistance populaire. Résistance aux décadences, au social-étatisme, aux plats pré-cuisinés des angélismes humanitaires et des croyances progressistes, résistance de la sagesse dionysienne face à la folie prométhéenne des niveleurs, résistance multiforme dont l’indifférence croissante envers la politique n’est qu’un aspect.
Ce vitalisme social n’est pas un désengagement, mais un engagement. Dans un monde où tout ce qui se veut légitime et institué en appelle au narcissisme de masse, au travail aliéné, au présentisme, au machinisme, au déracinement, de nouvelles énergies apparaissent spontanément et, malgré les pressions des pouvoirs et des pédagogies, osent « faire de la musique sans solfège ». Fils de la décadence, les néo-européens, nouveaux barbares, ne connaissent même plus la vulgate du moralisme humanitaire occidental. C’est là l’effet pervers — et de notre point de vue positif — du déclin de l’éducation culturelle en Europe : sous prétexte d’égalité et d’universalisme, l’idéologie dominante a négligé l’enseignement de la culture élitaire. Mais elle a jeté le bébé avec l’eau du bain. Les jeunes générations se retrouvent peut-être déculturées, privées de mémoire, ce qui était le but recherché par les professeurs de déracinement, mais également — ce qui est sans doute un événement considérable — libérées de la scholastique et des tabous des idéologies mortifères de l’Occident. Les grands concepts sacrés (Égalité, Démocratie, Politique, Liberté, Économie, Développement, etc.), responsables du déclin, flottent désormais comme des corps morts dans le panthéon mental des jeunes générations.
De deux choses l’une alors : ou bien cette fin radicale de la « culture classique » (à laquelle appartiennent malgré tout toutes les catégories politiques actuelles et toute la mystique égalitaire de l’Occident) ne donnera lieu qu’au vide et à l’immersion dans le néo-primitivisme, ou bien elle laissera surgir le fond assaini du psychisme européen, le fond issu de notre « instinct grec ». Au diagnostic apparemment pessimiste de « fin de l’histoire » qui semble toucher les Européens, on peut objecter sans doute qu’à l’étage du quotidien, de l’intensité de la vie des sociétés, les « histoires » continuent de dérouler leurs stratégies et qu’il ne faut pas jouer les Cassandre. Mais, privées de la dimension « historiale » (et non pas « politique » puisque « politique », « individualisme » et « fin de l’histoire » vont ensemble) de leur existence, démunies de perspective souveraine, les sociétés européennes pourraient-elles mêmes encore connaître dans leurs dynamiques privées et quotidiennes, dans l’énergie secrète du peuple, « des » histoires, des aventures, des pulsions créatrices ?
Nul ne peut répondre. Deux repères positifs, 2 puissants facteurs de régénération peuvent néanmoins être définis au sein même de la décadence. Premier repère : le foisonnement dionysiaque de nouveaux comportements sociaux parallèles, sécessionnistes, sensuels, liés à une renaissance contemporaine de l’esthétique européenne, qui biaisent les institutions, les savoirs institués, les réseaux technocratiques, et que la sociologie de Maffelosi met en lumière, constituent à la fois le signe que la moralité réglementée, que le bourgeoisisme technomorphe de la civilisation occidentale (c’est-à-dire du déclin) butent sur l’inertie du peuple, mais aussi qu’on assiste à un regain de l’imaginaire, de l’irrationnel, de forces quotidiennes inconscientes de leur puissance. Ces forces sont celles qui donnent aux nations de grands artistes, de grands entrepreneurs. Comme la graine pendant l’hiver, nous devons coûte que coûte espérer que germent les énergies de la société civile. Demain, elles peuvent être fécondées par une souveraineté à venir, si le Destin qui ne reste jamais longtemps muet le décide.
Deuxième repère. À ce facteur de régénération intérieure, vient s’ajouter un motif possible de régénération extérieure. Il s’agit paradoxalement du grand « risque » de voir la civilisation progressiste et mondiale de l’Occident sombrer dans la crise géante. Le déclin latent deviendrait, au sens de Thom, catastrophe. En effet, à la période actuelle d’auto-résolution des crises par une fuite technologique en avant, à la macro-stabilité du système occidental, peut fort bien succéder une déstabilisation assez brutale. Nous nous dirigeons de fait vers une fin de siècle où vont converger des évolutions dont le parallélisme est pour l’instant facteur de « croissance » (cancéreuse) mais dont la rencontre, et la fusion, risquent d’être la cause d’un déséquilibre géant et planétaire. Ces « lignes évolutives » sont : les déséquilibres économiques croissants provoqués par le « développement » néo-colonial du Tiers-Monde, les effets cumulés du gel géostratégique (statu quo) imposé par les superpuissances combiné avec la sophistication et la densification des armements hyperdestructifs, la continuation de la déchéance de la démocratie à l’Ouest comme à l’Est, l’écart démographique Nord-Sud qui se creuse, l’écart population-ressources dans les pays pauvres, la montée des forces d’auto-affirmation nationales et religieuses dans le Tiers-monde parallèle au renforcement d’une technostructure mondiale, etc.
Notre temps est dominé par la menace d’un « point de rupture » qui se profile à l’horizon de la fin du XXe siècle, où l’humanité pléthorique se heurtera à des défis convergents à la fois alimentaires, écologiques, géopolitiques, etc. Or, aucune société traditionnelle ne peut les résoudre. Le retour à un modèle « holiste » et anti-technique de civilisation est impossible. Sommes-nous condamnés à la normalité occidentale ? L’ambiguïté de la modernité se reconnaît à ce qu’elle s’instaure comme seul remède des maux qu’elle a suscités. Pourtant, et pour ne donner que l’exemple de l’économie, il serait intéressant de prêter l’oreille à des nouvelles doctrines qui tentent de résoudre cette contradiction ; elles nous semblent bien plus originales que l’imposture intellectuelle du retour d’Adam Smith sous le visage publicitaire des « nouveaux économistes ».
Ces nouvelles doctrines auxquelles je fais allusion, défendues en France par François Perroux, André Grjebine, François Partant, etc., préconisent l’abandon, non pas de l’industrie et de la technologie, mais de la norme universelle d’un marché et d’un système d’échange et de production planétaires. Elles se prononcent pour la construction progressive de zones « autocentrées », où les unités culturelles, politiques, économiques et géopolitiques se recouvriraient, où le productivisme marchand, le contenu des « besoins » humains, et la place de l’économique dans la société seraient repensés de fond en comble. Il s’agit, en quelque sorte, de penser une modernité qui ne soit plus mondialement normative.
Brutale ou progressive, la vraie crise est devant nous. Ou bien elle débouche sur le déclin définitif, le baiser des mégatonnes, le grand soleil nucléaire qui peut fort bien illuminer la fin de ce siècle du feu de l’holocauste des vertébrés supérieurs, ou bien, en-dehors de cette perspective à la fois terrifiante et très esthétique, la civilisation occidentale, butant sur cette « convergence des évolutions », ne pourra plus physiquement continuer à fonctionner. Faute de l’avoir envisagé sereinement, nous serions alors contraints d’organiser, au bord du tombeau, l’autarcie économique, la post-démocratie, bref de nouveaux principes politiques de vie en société. Ces principes ne seraient certainement plus ceux du progressisme occidental. Chaque région du monde improviserait sa solution…
Alors, pour éviter une telle improvisation, il appartient peut-être aux intellectuels éclairés, ceux qui aujourd’hui échappent aux grandes dogmatiques ridées de l’humanisme, du libéralisme, du socialisme, etc., de réfléchir à ces nouveaux principes, à des valeurs post-modernes capables de prendre le relais de cette longue procession d’illusions qui se confondent aujourd’hui avec le déclin et qui forment encore, hélas, le corps de cette vulgate occidentale qui tient lieu de savoir aux élites européennes.
► Texte extrait de la brochure de Guillaume Faye, L’Occident comme déclin, 1985.
• Notes :
[1] Cf. sur ce point, Alain Girard, L’homme et le nombre des hommes, PUF, 1984.
[2] Claude Lévi-Strauss, Paroles données, Calmann-Lévy, 1984.
[3] Claude Polin, L’esprit totalitaire, Sirey.
[4] Julius Evola, Les hommes au milieu des ruines, Trédaniel, 1984.
[5] Cf. à ce propos, Laurent Joffrin, La gauche en voie de disparition, Seuil, 1984.

pièces-jointes :
Sur la décadence, terme il est vrai « tout de pourpre et d’ors » (Verlaine) tant il frappe les imaginaires, Lyotard confiait que « l’idée de la décadence de l’Occident fait partie de son langage culturel. L’Occident s’est toujours plu à imaginer sa propre mort » (Le paroxyste indifférent). C’est là juste réplique à ceux y cherchant alibi à ce que Bergson nomme une morale fermée mais c’est un peu vite oublier la possibilité d’une morale ouverte : la philosophie de la vie à l’œuvre dans le pessimisme culturel par ex., bien qu’attachée à l’ancienne mentalité de la Modernité, a été une des grandes forces libératrices à l’égard des préjugés du XIXe siècle et dont toute la portée de la contribution reste encore difficile à apprécier aujourd’hui. La situation extrême où se trouve l’Europe de nos jours et les autres peuples à plus long terme se trouve non tant dans les méfaits du progressisme que dans la sortie de l’histoire, no man’s land que guettent les rapaces du nouvel ordre mondial en extension. « Inverser le processus, voilà bien un travail de Romain » rappelait le rex imperator Auguste. Voilà l’éthique des Européens de l’avenir.
La décadence, sujet ancien !
 Dans l'un de ses derniers ouvrages, Montherlant résumait d'une façon saisissante l'évolution que notre civilisation, en quelques siècles, a subie. Il fut un temps, dit-il, où l'on donnait en spectacle, aux enfants des hommes de bien, des ilotes ivres, afin que ces enfants sussent ce qu'il convenait de ne pas être. Puis on en est arrivé au moment où, à ces mêmes enfants, on montrait toujours des ilotes ivres, mais cette fois pour leur donner l'exemple de ce qu'ils devraient être. Nous en sommes à l'époque où des ilotes montrent à leurs enfants les derniers hommes de bien, en leur disant que c'est ce qu'il ne faut pas qu'ils soient. C'est cela une société en déclin.
Dans l'un de ses derniers ouvrages, Montherlant résumait d'une façon saisissante l'évolution que notre civilisation, en quelques siècles, a subie. Il fut un temps, dit-il, où l'on donnait en spectacle, aux enfants des hommes de bien, des ilotes ivres, afin que ces enfants sussent ce qu'il convenait de ne pas être. Puis on en est arrivé au moment où, à ces mêmes enfants, on montrait toujours des ilotes ivres, mais cette fois pour leur donner l'exemple de ce qu'ils devraient être. Nous en sommes à l'époque où des ilotes montrent à leurs enfants les derniers hommes de bien, en leur disant que c'est ce qu'il ne faut pas qu'ils soient. C'est cela une société en déclin.
La décadence ! Sujet ancien. « La chute des civilisations est le plus frappant et en même temps le plus obscur de tous les phénomènes de l'histoire. En effrayant l'esprit, ce malheur réserve quelque chose de si mystérieux et de si grandiose que le penseur ne se lasse pas de le considérer, de l’étudier, de tourner autour de son secret. » Ainsi commence le célèbre Essai de Gobineau.
C'est en effet une réalité, un fait qui frappe l'esprit, qui heurte notre sensibilité, contre lequel nous voudrions protester et qui, pourtant, s'impose à nous, c'est un fait que les civilisations sont mortelles. Qu'il vient un moment où, pour des raisons souvent difficiles à bien comprendre, et plus encore à analyser, les grandes cultures cessent peu à peu de grandir et de se développer, semblent au contraire, épuisées au point de ne jamais retrouver un second souille, vieillissent, fléchissent et meurent. Mais la mort des civilisations est comme les autres morts : il en est de plusieurs sortes. Certaines meurent d'extinction, d'autres d'épuisement, certaines d'ennui peut-être. Quelques-unes seulement de mort violente. Il n'est pas exagéré de dire qu'il en est qui se suicident (sur ordre, parfois, lorsqu'on les a subtilement convaincues de le faire). Aucune, en tout cas, ne disparaît de cette manière idéale qu'évoquait Montherlant : « Heureux ceux qui meurent sans papotages et sans pleuraisons, dans la sainte solitude où meurent les bêtes et les soldats au fond d'un lointain trou d'obus ».
Les causes de la décadence ne sont pas toujours évidentes
Les causes, de ce fait, sont diverses. Ce peut être la conquête, la fatigue, le laisser-aller, la dissolution, le mélange. Le monde gréco-latin avait établi cette doctrine que les Etats, les peuples et les civilisations périssent essentiellement par le luxe, la mollesse, la mauvaise administration, la corruption des mœurs et le fanatisme. Mais ce ne sont là que des symptômes secondaires, qui n'apparaissent que lorsque le mal est déjà là. Car une société qui s'abîme dans le luxe, un citoyen qui se déclare hors d'état de porter les armes, un administrateur qui hésite à faire son devoir voire qui ne le fait plus du tout, des mœurs qui se dissolvent, les fanatismes, les irrationalités qui s'étendent, tous ces phénomènes sont des conséquences : ni plus ni moins. Il est difficile d'isoler une cause pour en faire un facteur explicatif global. Et même il arrive que ce qui est une cause de déclin chez les uns peut être ailleurs, sur une autre échelle de valeurs, une cause de succès.
L’esprit du siècle a changé
Et puis, il faut tenir compte de l'épuisement du sang. Jamais, peut-être, autant que maintenant nous n'avons pu constater les terribles effets de cette affreuse guerre civile européenne que fut la Grande Guerre de 1914-1918. La France, et non seulement la France, mais tous les pays en présence ont été, durant ces 4 années tragiques, véritablement saignés (1). Nous réalisons maintenant que la France du début du siècle était encore une France gauloise, une France où les paysans à tête ronde, cheveux blonds et grosses moustaches étaient encore la majorité, où ils constituaient comme une sorte de réserve biologique, garantissant ainsi une possibilité de renouveau qui était la plus importante des promesses faites à notre pays. Or cette promesse n'a pas été tenue parce que les meilleurs, quel que fût l'étendard sous lequel ils se battaient, ont été fauchés à grands coups de néant. La France franque avait commencé à mourir entre 1789 et 1793. La France gauloise, elle, a dû commencer à disparaître entre 1914 et 1918. Et ces vides qui n'ont jamais été comblés nous pèsent cruellement. La Grande Guerre, nous le savons tous, fut la fin d'une époque. Ce fut la dernière fois que se trouvèrent face à face, dans des tranchées, des hommes qui professaient les mêmes vertus et faisaient preuve du même type d'énergie.
Les sources d'une infiltration progressive
Toutes ces causes de déclin que je viens d'énumérer sont donc bien également des effets. Elles réagissent l'une sur l'autre, de la même façon qu'aujourd'hui la drogue est à la fois la cause d'un certain état d'esprit et la conséquence d'une époque qui produit la drogue, et multiplie les drogués... On a l'impression, plus simplement, qu'il vient un moment où le moteur qui porte l'axe de la civilisation, où ce moteur est cassé. Ou plutôt, où nul carburant ne vient plus l'alimenter. Alors le moteur continue à tourner. Mais il tourne à vide désormais, dans un vacarme assourdissant, et c’est de ce bruit que naît l’illusion qu’il tourne à plein régime.
Les choses, en général, vont lentement. Il serait vain de dater à 10, 20 ou 30 ans, au gré des convenances ou des passions, les sources d'un état d'esprit qui s'est introduit subtilement en la demeure. L'institution d'un véritable mandarinat marxiste dans l'Université, pour ne citer que cet exemple, est l'aboutissement d'un lent travail, entrepris notamment par ces braves instituteurs de la IIIe République, serviteurs dévoués de leur pays [« hussards noirs de la République » dira Péguy], grands admirateurs de l'Empire, fidèles au combat contre les prétentions cléricales, mais qui étaient aussi les fils spirituels de Rousseau, c'est-à-dire les enfants du rêve et de l'illusion. De même, qu'un corps comme l'Église, qui fut, jusque dans ses excès, pendant des siècles l'exemple de la fermeté, de la certitude et de la continuité, soit aujourd’hui agité de convulsions intérieures et ravagé par le doute, cela ne doit surprendre qu'à demi.
Car il faut connaître la patiente infiltration qui s'est opérée dans ce corps aujourd'hui malade, et qui, progressivement, c'est le cas de le dire, a remonté le courant de la hiérarchie [cf. à ce sujet le roman policier La soutane rouge de Peyrefitte, 1983]. La décadence, en vérité, a des origines lointaines. Si lointaines que l'on perdrait son temps à les situer à un endroit précis de l'Histoire, tant il est vrai qu'en fin de compte, parce que telle est la vie, tout pouvoir commence de se perdre du jour où il est conquis. Mais, s'il est impossible de dire quand le déclin a commencé, du moins peut-on signaler au passage quelques-uns des symptômes qui en sont les manifestations principales.
Les symptômes révélateurs du déclin
Pour M. Jean Cau, l'une des caractéristiques des époques décadentes est que tout y est codifié. Même et surtout ce qui ne devrait pas l’être. Parce que les sources naturelles, celles qui devraient couler d’elles-mêmes, sont taries. « Dans la fourmilière, écrit-il, nul n'a d'honneur. Il y a seulement des règles de fonctionnement. Des lois. Moins la morale est l'affaire de chacun, et plus se multiplient les lois. Et je dirai même que le nombre des lois est inversement proportionnel au sentiment de l'honneur de ceux qui les subissent ». Et puis il y a la médiocrité et la bassesse. Non pas le bien ou le mal, qui tous deux peuvent s'exercer d'une façon puissante. Mais l'abaissement. Le monde romain, dit Montherlant, « savait reconnaître la grandeur, que le monde le monde moderne ne voit pas, bafoue quand il la voit, et place et exalte où elle n'est pas. Quand un peuple a la haine de toute grandeur, que son chef se garde bien d'en prononcer le mot ! N'eût-il rien fait pour la grandeur, ce mot serait encore trop ! Le peuple s'en ferait une pierre, le jour qu'il le voudra lapider » (Le Treizième César). Les sociétés en déclin correspondent à l'apogée matérialisant, pétrifiant et solidifiant du dernier état de l'illusion égalitaire. Ces sociétés n'ont plus de chefs. Elles ne veulent plus en avoir. Elles feignent de croire que tout le monde peut désormais prétendre au titre de chef. En d'autres termes, tout le monde veut diriger. Mais personne ne veut obéir. La décadence, si l'on veut, ce sont des puces qui s'agitent en se demandant à quoi peuvent bien servir les lions.
Que recouvre aujourd'hui le mot art ?
Mais le domaine dans lequel l'épuisement se manifeste de la façon la plus nette est peut-être celui de la création artistique et des manifestations culturelles. Lorsqu'on ne peut plus créer, on se contente d'en "rajouter" à l'intérieur ou par rapport à ce que les autres ont déjà créé. On affine, on déforme, on tarabiscote, on feint de considérer les règles classiques comme périmées, puis on redécouvre la valeur et l’intérêt de ce qu'on avait déclaré "périmé". Cela donne, dans la meilleure des hypothèses, le style hellénistique par rapport au style grec. À l'époque moderne, le style nouille, le Jugend Stil et le kitsch. Dans l'Antiquité, le temps des silènes, des bacchanales et des graeculi. Les statuettes de Tanagra. Plus tard, la fin du gothique flamboyant, etc. Tout cela est encore beau. Mais, déjà, les sources du renouvellement sont épuisées. La puissance est partie.
Dans la préface de l'ouvrage intitulé Imperium, le philosophe américain Francis Parker Yockey écrit : « L'originalité à tout prix est un effet de la décadence, et la décadence est grosse de barbarie ». On retrouve les mêmes observations dans le Déclin de l'Occident. Oswald Spengler y écrit ce qui suit : « Ce qui marque le déclin de la force créatrice, c’est l'absence de forme et de mesure nécessaires à l'artiste pour produire une œuvre qui ait encore de la rondeur et de l'ensemble... » Plus loin, Spengler dit encore : « Ce qui se fabrique aujourd'hui en fait d'art est de l'impuissance et du mensonge (...). On a beau parcourir toutes les expositions, tous les concerts, tous les théâtres, on ne rencontrera que des industriels de l'art et de bruyants badauds qui se plaisent apporter sur le marché quelque chose dont ils sentent depuis longtemps, intérieurement, l’inutilité ». Ces lignes ont été écrites en 1917 : elles ont une valeur et une portée qui les rendent singulièrement urgentes aujourd’hui.
Une conception erronée de l’histoire
Les thèses de Spengler, que je viens de citer, sont connues. Le fait que les grandes cultures, à l'image des organismes individuels qu'elles contiennent, et qui sont eux-mêmes autant de petits univers insérés dans le macrocosme, grandissent, mûrissent, atteignent leur apogée, vieillissent et meurent, ne signifie évidemment pas que l'idée d'histoire universelle ne puisse pas être prise en considération (2). Mais parler d'histoire universelle voire d'histoire de l'humanité, revient simplement à signaler que les cultures ne se développent pas d'une façon isolée. Qu'il y a, qu'il y eut toujours entre elles des contacts et des relations, et que ceux-ci exercèrent leur influence sur le développement de chacune de ces civilisations, cela ne signifie pas, bien entendu, que l'Histoire se déroule en tous lieux au même rythme, ni surtout dans la même direction.
Le fait même que les civilisations naissent et déclinent, qu'il y ait, si je puis dire, des hauts et des bas dans l'Histoire montre combien la conceptions linéaire de l'Histoire, cette conception que les théologiens, les théoriciens marxistes, les psychanalystes freudiens, les scoliastes du structuralisme lévi-straussien s'accordent à développer, combien cette conception est profondément erronée. À la base des théories de l’Histoire unilinéaire, je ne le rappelle que pour mémoire, on retrouve toujours l'égocentrisme culturel et l'irrationalité. Il s'agit chaque fois d'un illuminé (ou d'un groupe d’illuminés), qui considère sa propre histoire comme le début et l'aboutissement de l'univers, entend réduire l'un à l'autre en asservissant les esprits, et prétend en quelque sorte assimiler le Retour à la Terre promise à la plongée dans l’espèce, l'entrée au Paradis, l'Âge d'or, la société sans classes et le Jugement dernier. À cette conception de l'Histoire, nous en opposons une autre, elle, parfaitement en accord avec la complexité et les perspectives multiples du devenir historique. Ce sera une conception cyclique, ou pour mieux dire discontinue, de l'Histoire, où les processus viendront remplacer les événements, et où la notion de destinée prendra la place de la simple causalité.
La contestation des premiers chrétiens
Il faut, à vrai dire, une certaine naïveté voire une certaine mauvaise foi, pour voir dans la Rome de Hildebrand, de Charles V ou d'Alexandre VI la suite "logique" de la Rome de César, de Flaminius et de Sylla. Je cite à dessein l'exemple romain. Car c'est un exemple qui nous obsède et n'a cessé d'obséder les historiens de tous les temps. Le parallèle a souvent été dressé entre le Bas-Empire d'hier et celui d'aujourd'hui (3). Tout recommence, en effet. Et, sinon de la même manière, du moins d'une manière analogue.
Dans son essai, désormais classique, sur le Christianisme antique [Flam., 1928], Charles Guignebert fait la remarque suivante : « Les chrétiens des premiers âges croyaient la fin du monde imminente et ils la désiraient ; tout naturellement, ils se détachaient des soucis et des devoirs de la vie terrestre et, dans leur cœur, l'amour de la Jérusalem céleste faisait grand tort à celui de la patrie romaine ». Les contestataires chrétiens, par ex., se déclaraient objecteurs de conscience. C'était leur façon à eux d’opposer à la guerre l'amour (du prochain) et, d'une façon plus générale, de se désolidariser de l'impérialisme romain. « La même vie ne peut pas être due à Dieu et à César, écrivait Tertullien. Et nous ne pouvons admettre comme licite l'état de soldat puisque le Seigneur n'a pas permis qu'on se serve une seule fois de l'épée ». L'Église, ultérieurement, n'en eut pas moins de multiples occasions de recourir à l'épée.
Les chrétiens, on le sait, refusaient aussi d'obéir aux dirigeants de l’État. « Pouvons-nous prêter un serment aux hommes, demandait encore Tertullien, nous qui avons prêté serment à Dieu ? » Tout comme aujourd'hui l'on récuse les "tribunaux bourgeois", saint Paul, dans la Première Épître aux Corinthiens, récuse les tribunaux de Rome. « Quand vous avez des litiges, s'exclame-t-il, vous allez prendre comme juges des gens que l'Église méprise ! Quelle honte, en vérité ! » Tertullien, toujours lui, est le premier à utiliser un argument qui sera, après lui, abondamment repris, lorsqu'il déclare : « On n'est point tenu de respecter une loi injuste ! » Le mot, qui semble aujourd'hui passé dans les mœurs, vaut que l'on s'y arrête. Ne serait-ce que pour lui opposer cette maxime des samouraï, souvent citée par Montherlant : « On est tenu de respecter toutes les promesses que l'on a faites, même lorsqu'on les a faites à un chien ».
Une autre conception du bonheur
Aux yeux des contestataires de la Rome ancienne, toute la société est corrompue. L'argent est mauvais. Le temps consacré aux loisirs (otium) est trop long. Ce que les Romains considèrent comme des vertus devient, aux yeux de leurs critiques, autant d'inexpiables défauts. Et les évangélistes jettent l’anathème sur cet univers païen qui ne manquera pas de succomber à ses "contradictions internes". Dans cette Apocalypse que l'on devrait peut-être relire plus souvent, Jean dénonce en termes clairs la ville de Rome : « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires et portant 7 têtes et 10 cornes (...). Les 7 têtes, ce sont les 7 collines sur lesquelles la femme est assise... Et cette femme-là, c'est la Grande Cité, celle qui règne sur les rois de la terre... À la mesure de son faste et de son luxe, qu'on lui donne tourments et malheurs ».
Les Romains, même ceux du Bas-Empire, avaient grand mal à comprendre que leur bonheur absolu, celui de l'humanité tout entière, pût passer par la destruction du bien, du beau et de tout ce qui insuffle grandeur. Marc-Aurèle, sceptique, disait : « Ce qui n'est pas bon pour l'essaim n'est pas bon pour l'abeille ». En d'autres termes, une morale qui aboutit à la destruction d'une société équilibrée ne peut être celle qui convient à chaque homme pris isolément.
« L'État, conclut Charles Guignebert, ne s'avisa guère qu'au courant du IIe siècle du péril social que semblait receler le christianisme ; mais il se mit alors à le considérer comme une sorte d'anarchisme. Ce furent les meilleurs princes, les plus attachés aux devoirs de leur dignité et, comme nous dirions (aujourd'hui), les plus patriotes qui se montrèrent les ennemis les plus acharnés des églises chrétiennes ». Sans porter à lui seul, bien entendu, la responsabilité de la chute de Rome, le christianisme naissant s'en trouva donc plutôt bien, en utilisa les péripéties à son profit et, le cas échéant, accéléra le processus.
La Jérusalem céleste des contestataires d'aujourd'hui, celle qu'ils appellent de leurs vœux dans les catacombes et les égouts, les fumeries et les sex-shops, c'est la société sans contraintes, la ville du plaisir immodéré, la cité où toutes les rues seront en pente, où le désordre triomphera de cette suprême "injustice" qu'est l'ordonnancement d'une société normale, où la lutte contre la rareté ne sera qu'une affaire d'« organisation sociale », et où la création d'utilités économiques se fera automatiquement par les soins de la Providence sociale, du hasard et de la nécessité, ou de leur sainte trinité.
Le monde des contestataires d'aujourd'hui
Car il est bien certain qu'à une époque où le courage s'évalue surtout au nombre de manifestes que l'on a pu signer, tandis que la virilité s'exprime de préférence en chevaux-vapeur, on peut considérer que ce socialisme est la « religion mondaine des esclaves d'aujourd’hui ». Ce qui frappe, en effet, c'est la pauvreté de l'actuelle contestation. Ses créations sont pauvres. Son imagination, censée prendre le pouvoir, est pauvre. Ses propositions sont pauvres. Son conformisme, par contre, est grand. Les contestataires, dans toutes les modes du moment, se sentent comme chez eux. En sécurité. Ils s’y noient dans la voluptueuse absurdité de leurs propres jargons.
Gœthe disait qu'il avait la « manie de la réalité ». C'est évidemment une manie qui se perd beaucoup aujourd'hui. Les contestataires, pourrait-on dire, ne voient le monde que de la façon qu'ils se le représentent, et surtout tout de la façon dont ils se représentent eux-mêmes. Car ils ne voient que leur monde à eux, et pas l'univers qui entoure ce monde et qui, dans une certaine mesure, l'explique et le contient. Ils s'imaginent qu'en agissant comme ils pensent, ils agiront justement. Et c'est pourquoi leurs révoltes finissent sur d'intenses déceptions. Ils se soucient, à vrai dire, assez peu du lendemain. Ils ignorent les lois de l'économie. Ils se soucient aussi fort peu de celles de la politique. Pour eux, la société qui délimite leur horizon est mauvaise dans sa globalité. La science est mauvaise. La technique est mauvaise. Les lois naturelles sont mauvaises. L'ordre est mauvais. Quant à savoir ce qui peut venir après, peu importe. Il faut d'abord détruire, disent-ils. Ainsi attendent-ils la fin du monde et le Jugement dernier. Tout cela se double d'un masochisme étrange, et d'une négation de soi.
L'éternel refrain de l'antibourgeoisie
L'une des raisons qui incitent les intellectuels à sympathiser avec les théories marxistes est, comme on le sait, le thème antibourgeois. Or, la plupart de ces intellectuels sont eux-mêmes des bourgeois et des fils de bourgeois. Ils sont toujours prêts, d'ailleurs, à louer un nouveau Maître, pourvu qu'il soit fort. Aragon a chanté le Guépéou avec des accents poétiques que Tertullien lui-même n'avait pas imaginés. Il a aussi chanté Staline, comme ses disciples chantent les mérites de la Chine ou de Cuba. D'une façon très générale, plus la contestation se déclara déclare antiautoritaire, plus elle frémit d'enthousiasme devant les défilés militaires du Tiers-Monde, le stakhanovisme cubain et les milices de Pékin. Cela ne signifie pas, bien sûr, que la que la société actuelle soit parfaite ni qu'elle réponde à tous nos vœux. Mais encore faut-il savoir où situer une juste contestation.
Ce qu'il y a de remarquable, en effet, dans la contestation actuelle, c'est qu'elle ne fait aucune fait aucun effort pour sortir du système qu'elle prétend critiquer. Elle lui fournit même, de par sa critique, une échappatoire et une alternative. Le contestataire s'oppose au "petit-bourgeois", comme le fils s'oppose au père : c'est un conflit de générations. Les uns et les autres se situent dans la même perspective, dans le même univers mental, dans la même dialectique égalitaire. Ils ne se séparent que sur la façon de réaliser, plus ou moins honnêtement, avec plus ou moins d'hypocrisie, en se souciant plus ou moins de leurs intérêts personnels, la même morale et les mêmes valeurs de déclin.
On peut être "antibourgeois". Mais il faut s'entendre sur les mots. Lorsque nous parlons, pour en faire la critique, du monde "bourgeois", nous n'entendons pas faire allusion à la société libérale, capitaliste et consommante à quoi se réduit la civilisation occidentale et développée dans laquelle nous vivons. Plus exactement, nous ne nous référons pas à la bourgeoisie en tant que classe économique, mais bien à sa contrepartie du point de vue des valeurs. « Il existe, écrit Julius Evola, un monde intellectuel, un art, une manière d’être, une conception générale de l'existence qui a pris forme à partir du XVIIIe siècle parallèlement à la révolution du Tiers Etat, et qui apparaît aujourd'hui comme quelque chose de fade, de vide et de périmé ».
Pour une reprise des valeurs aristocratiques
 Mais il y a 2 façons de prendre position et de dépasser les valeurs mercantiles et bourgeoises. On peut les dépasser ou bien par le bas ou bien par le haut. Le dépassement par le bas équivaut tout simplement à une nouvelle régression. C'est le dépassement auquel nous convie l'actuelle contestation, et c'est pourquoi, vis-à-vis de celle-ci, nous n'hésitons pas à dire que mieux vaut encore l'état des choses en place.
Mais il y a 2 façons de prendre position et de dépasser les valeurs mercantiles et bourgeoises. On peut les dépasser ou bien par le bas ou bien par le haut. Le dépassement par le bas équivaut tout simplement à une nouvelle régression. C'est le dépassement auquel nous convie l'actuelle contestation, et c'est pourquoi, vis-à-vis de celle-ci, nous n'hésitons pas à dire que mieux vaut encore l'état des choses en place.
« Il existe pourtant, ajoute Evola, une autre possibilité, orientée cette fois vers le haut... Cette seconde possibilité est liée à une reprise des valeurs héroïques et aristocratiques, assumées d'une façon naturelle et claire, sans rhétorique ni grandiloquence. Dans le passé, le monde romain et romano-germanique en ont déjà fourni des exemples typiques. On peut garder ses distances vis-à-vis de tout ce qui n'est qu'humain et surtout subjectif, on peut mépriser le conformisme bourgeois, son petit égoïsme et son petit moralisme, on peut épouser un style d'impersonnalité active, aimer ce qui est qui est essentiel et réel au sens supérieur, dégagé des brumes de la sentimentalité et des structures intellectualistes, on peut se consacrer à une démystification radicale, tout cela en se tenant debout, en ressentant l'évidence de ce qui, dans la vie, va au-delà de la vie, et en en tirant des règles précises pour l'action et le comportement » (Les Hommes au milieu des ruines). Il s'agit de procéder, comme Nietzsche nous l'a demandé, à une véritable « transmutation des valeurs ». Il s'agit de cristalliser un type humain et, en accord avec ce type, de conférer un ton spécifique à une société donnée.
L'avenir de la culture occidentale
Francis Parker Yockey, dans Imperium, avait énoncé une loi qu'il appelait la « loi de constance du pouvoir ». Il estimait qu'au sein d'un ensemble social, d'une nation, d'une civilisation la quantité de Pouvoir, de puissance et d'énergie restait en fin de compte pratiquement constante pour une population donnée. C'est-à-dire que toute quantité d'énergie devait se retrouver automatiquement portée au crédit d'un autre individu ou d'un autre groupe d'individus. Cette loi semble à peu prés vérifiée, dans ses grandes lignes du moins. Ce qui fait la faiblesse des uns fait la force des autres. Les victoires se nourrissent des défaites. Et le déclin des cultures vieillissantes ne fait qu'accélérer la montée de celles qui grandissent.
Spengler tirait de ses travaux des conclusions de nature pessimiste. C'est du moins ce que l'on en a dit, l'esprit du temps taxant toujours de pessimisme le réalisme et la lucidité. Gobineau, qu'il ne s'agit évidemment pas de prendre au pied de la lettre, mais qui eut le mérite de s'intéresser parmi les premiers à cette question du déclin, n'était pas moins réservé. Son Essai s'achève sur la plus désespérée des interrogations. « La religion elle-même, écrit-il, ne nous a pas promis l'éternité. La science, en nous montrant que nous avons commencé, semble toujours nous assurer que nous devons finir. Il n'y a donc ni lieu de s'étonner ni de s'émouvoir en trouvant une confirmation de plus d'un fait qui ne pouvait passer pour douteux. La prévision attristante, ce n'est pas la mort, c'est la certitude de n'y arriver que dégradés ; et peut-être même cette honte réservée à nos descendants nous pourrait-elle laisser insensibles si nous n'éprouvions, par une secrète horreur, que les mains rapaces de la destinée sont déjà posées sur nous ».
Ceux qui réprouvent l'esprit du temps
 Oswald Spengler, en profond accord avec lui-même, ne propose guère que des images, des exemples héroïques et muets (4). Mais d'autres ont été plus loin dans le refus. Le 25 novembre 1970, l'écrivain Mishima, ancien lieutenant de l'armée impériale japonaise, se donnait seppuku à Tokyo pour porter témoignage. Il réprouvait l'esprit de son temps. Le 21 septembre 1972, l'écrivain Henry de Montherlant, ancien engagé volontaire de la Grande Guerre, se donnait la mort d'une façon exemplaire. Mettant ainsi le point d'orgue à une œuvre destinée à dominer les esprits des meilleurs. Lui aussi, il l'a répété cent fois, réprouvait l'esprit de son temps.
Oswald Spengler, en profond accord avec lui-même, ne propose guère que des images, des exemples héroïques et muets (4). Mais d'autres ont été plus loin dans le refus. Le 25 novembre 1970, l'écrivain Mishima, ancien lieutenant de l'armée impériale japonaise, se donnait seppuku à Tokyo pour porter témoignage. Il réprouvait l'esprit de son temps. Le 21 septembre 1972, l'écrivain Henry de Montherlant, ancien engagé volontaire de la Grande Guerre, se donnait la mort d'une façon exemplaire. Mettant ainsi le point d'orgue à une œuvre destinée à dominer les esprits des meilleurs. Lui aussi, il l'a répété cent fois, réprouvait l'esprit de son temps.
On peut se poser la question : qu'est-ce que c'est que cette société où les hommes de bien, ceux qui sont grands, mais qui n'ont pas le goût de l'action, ne peuvent exprimer leur réprobation d'une manière à leur mesure qu'en se donnant la mort de cette façon ? Dans l'ancienne Chine, il arrivait que l'intendant d'un roi ou bien encore le précepteur d'un prince, en désaccord avec telle ou telle décision de son souverain, lui adressât des reproches, puis se suicidât aux fins de donner à ces reproches un peu plus de poids. C'est là, sans doute, une belle leçon de comportement. Mais une leçon qui exige un certain répondant. Car, dans le temps ancien, le souverain tenait compte de l'avertissement : il inclinait à penser qu'un avis auquel son auteur joignait sa mort en guise de carte de visite méritait qu'on y prêtât quelque attention. Qui prendrait garde aujourd'hui à un avis exprimé de cette manière ? Fort peu de gens, nous nous en doutons.
Si l'on veut déceler, dans le processus déjà avancé du déclin qui menace, une faille suffisante à bloquer le mécanisme ; si l'on veut efficacement mesurer et peser les chances vraisemblablement petites qui peuvent nous être chichement dispensées, il importe d’être à la fois bien conscient de l'importance de l'enjeu, de l'étendue du terrain où cet enjeu doit être disputé et, d'autre part, fermement décidé à utiliser toutes les possibilités susceptibles de passer effectivement à notre portée. Quand il s'agit d'Histoire, le sens des aiguilles de la montre essentielle ne se modifie pas, chacun peut s'en douter, avec de bons sentiments et des vœux pieux. Il y faut une autorité. « Cyrus, Thésée et Romulus, a-t-on pu écrire, n'auraient pu faire longtemps observer leurs constitutions, s'ils avaient été désarmés ». Nietzsche a dit : « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Par les temps qui courent, c'est une parole a méditer. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'il existe en Histoire une sorte de balancier, au jeu duquel se sont toujours alternés les influences et les courants dominants. Plus la balance penche aujourd'hui d'un côté, plus elle penchera de l'autre demain.
Et enfin, cette dernière parole, de Montherlant toujours, mais qui est, elle, déjà plus ancienne : « Plus l’honnêteté est menacée, plus elle nous impose ; plus il y a de vilenies autour d'elle, plus elle resplendit, comme ces lumières du soir dans les villes, allumées quand il fait jour encore, mais qui n'éclairent que quand la nuit est tombée ». Quelles sont donc aujourd'hui les lumières de la ville ? Quelles sont les lumières allumées en plein jour et que, pour cette raison, personne ne voit encore briller, mais qui, le soir, une fois la nuit tombée, illumineront l’espace autour d'elles ? Quelles sont ces lumières qui ne devront pas cesser de briller dans le noir, jusqu'à ce que vienne le matin ?
► Alain de Benoist, Question de n°3, avril 1974.
• Notes :
-
L’empreinte que ce conflit exerça sur les d’Annunzio, les Jünger et les Montherlant est, à elle seule, des plus révélatrices.
-
Spengler développa d’ailleurs, par la suite, des vues très originales dans cette direction, en particulier dans ses derniers essais.
-
Il est significatif que lorsque Montherlant voulut dire à ses contemporains ce qu'il pensait de notre époque, c'est vers Rome qu'il se retourna pour écrire un livre intitulé Le Treizième César.
-
C'est le soldat romain mort à Pompéi dont il donne l'exemple, ce soldat qu'on a retrouvé enseveli sous les cendres, debout et en armes, et qui est reste là, tout simplement par ce qu'on avait oublié de venir le relever.

Propos sur la décadence
 Il y a bien des manières de lâcher les lions dans Rome pendant que l'ennemi extérieur guette aux frontières et que l'ennemi intérieur pourrit et paralyse tout ce qui restait de force saine dans le pays. On fait une grande opération de bascule qui amène en haut ce qui était en bas, et en bas ce qui était en haut. On crée ou on tolère une supermode, où s'engouffre cette masse. Elle s'y engouffre parce qu'elle est sans personnalité, et parce qu'elle est lâche, deux conditions pour qu'une mode prenne. Grâce à la supermode, on mène cette masse où l'on veut, c'est-à-dire à sa destruction.
Il y a bien des manières de lâcher les lions dans Rome pendant que l'ennemi extérieur guette aux frontières et que l'ennemi intérieur pourrit et paralyse tout ce qui restait de force saine dans le pays. On fait une grande opération de bascule qui amène en haut ce qui était en bas, et en bas ce qui était en haut. On crée ou on tolère une supermode, où s'engouffre cette masse. Elle s'y engouffre parce qu'elle est sans personnalité, et parce qu'elle est lâche, deux conditions pour qu'une mode prenne. Grâce à la supermode, on mène cette masse où l'on veut, c'est-à-dire à sa destruction.
Car nous penchons trop à croire que le treizième César ne sait pas ce qu'il fait, alors qu'il le sait très bien, et, sous les apparences d'une action hurluberlue, poursuit méthodiquement un dessein affreux. Celui qui a vu une fois cette grande masse amorphe, qui pense, dit et fait à l'instar, et qu'on mène à sa perte, envoûtée par cet "instar", inconsciente qu'on l'y mène, furieuse contre qui lui montre qu'on l'y mène, celui-là peut dire qu'il a vu l'enfer. L'homme qui fait une chose parce que ça se fait, je le connais bien : il a un visage de damné. Il n'y a pas de fosse chez Dante pour les grégaires, mais j'en ajoute une, pour eux.
Le treizième César, qui a détruit soit peuple, est satisfait : quand un prince veut "faire de l'Histoire", il la fait toujours sur le dos de ses compatriotes ; un prince n'entre jamais mieux dans l'Histoire que par ses crimes. Néron brûle Rome pour qu'on parle de lui, et on a parlé de lui. Ensuite, il arrive que les lions dévorent celui qui les a lâchés. Ce qui petit se dire aussi : qui a ouvert l'égout périra par l'égout.
► Montherlant, extrait du Treizième César (Gallimard, 1970).

Problème de la décadence
Ceux qui rejettent le mythe progressiste et évolutionniste, qui est d'ailleurs, désormais, largement entamé ; ceux aussi qui, se référant à des valeurs supérieures et interprétant l'histoire, du moins l'histoire la plus récente, y constatent une direction involutive, ceux-là se trouvent confrontés au “problème de la décadence”. Si l'évolutionnisme repose sur une impossibilité logique, le plus ne pouvant pas dériver du moins, ni le supérieur de l'inférieur, une difficulté analogue semble se présenter lorsqu'on veut expliquer l'involution. Comment est-il possible que ce qui est supérieur dégénère, comment expliquer qu'on puisse perdre un certain niveau de spiritualité et de culture ?
La solution ne serait pas compliquée si l'on pouvait se contenter de simples analogies : l'homme sain peut tomber malade, le vertueux peut devenir vicieux, une loi naturelle qui ne surprend personne fait que tout organisme, après la naissance, la croissance et la plénitude vitale, vieillit, s'affaiblit et meurt. Mais c'est là une constatation, non une explication, même si l'on admet qu'il existe une analogie complète entre ces 2 ordres : chose dont il est permis de douter lorsqu'il s'agit des civilisations et des organisations politico-sociales, étant donné qu'ici la volonté humaine et sa marge de liberté jouent un rôle très différent de celui qu'elles ont dans les phénomènes naturels.
Cette objection se heurte donc aussi à la théorie d'Oswald Spengler, laquelle reprend précisément l'analogie offerte par la réalité organique, en affirmant qu'à l'égal de tout organisme, chaque culture connaît une phase aurorale, une phase de plein épanouissement, puis un vieillissement automnal, une sclérose et, enfin, la mort et la dissolution.
Ce cycle irait des formes originelles organiques, spirituelles et héroïques propres à ce que Spengler appelle Kultur, aux formes matérialisées, inorganiques, massifiées et sans âme propres à ce qu'il nomme Zivilisation. Cette théorie reprend partiellement celle, d'inspiration traditionnelle, qui concerne les “lois cycliques” ; celles-ci, cependant, se rapportent à un domaine beaucoup plus vaste, incluant le plan métaphysique, et qui peut nous aider à approfondir le problème envisagé ici. La théorie de Spengler offre effectivement un début d'explication, car il est question de la manifestation d'une force qui, peu à peu, s'épuise — à la manière, pour prendre une image banale mais appropriée, de la force injectée dans un piston, force qui provoque un mouvement expansif, lequel se ralentit progressivement et prend fin, à moins que se produise une nouvelle injection (qui donnerait lieu, dans notre cas, à un nouveau cycle). En particulier, il faut retenir l'idée que, sur le plan de la réalité humaine, la force en question devrait être comprise essentiellement comme une force organisatrice supérieure, qui relie des forces inférieures et leur imprime une forme. Lorsque la tension originelle s'affaiblit, ces forces se détachent et prennent le dessus peu à peu, donnant lieu à des phénomènes de dissolution.
Cette vue peut être utilisée dans le cadre spécifique à l'intérieur duquel nous entendons limiter, ici, le problème de la décadence. Notre point de départ, proche de celui de Spengler, c'est un dualisme des types de civilisation, et par conséquent un dualisme des formes étatiques. Il y a, d'un côté, les civilisations traditionnelles, différentes entre elles par la forme et par tout ce qui est dû à des facteurs contingents, mais identiques dans leur principe : ce sont les civilisations où des forces et des valeurs spirituelles, supra-individuelles, constituent l'axe, le suprême point de référence pour l'organisation générale, la formation et la justification de toute réalité subordonnée.
Il y a, d'un autre côté, la civilisation de type moderne, identique à l'antitradition, produit de facteurs purement humains, terrestres, individualistes et collectivistes, complet développement de tout le potentiel d'une vie séparée de ce qui est au-delà de la vie. La décadence apparaît comme le sens de l'histoire, en ceci qu'on constate, au sein de l'histoire, la disparition des civilisations de type “traditionnel” et l'avènement de plus en plus précis, général, planétaire, d'une nouvelle civilisation commune de type “moderne”. Le problème spécifique qui est posé, c'est donc de savoir comment cela a été possible. Réduisons un peu le champ d'étude et considérons ce qui se rapporte précisément à une structure hiérarchique et au principe d'autorité, puisque, au fond, c'est bien là que se trouve la clé de tout le reste. Dans le cas des hiérarchies traditionnelles et de l'action formatrice dont on a parlé plus haut par référence aux lois cycliques, on doit, à titre de prémisse, rejeter l'idée que le facteur fondamental et exclusif de ces hiérarchies a été une sorte d'imposition, de contrôle direct et de domination violente, fût-ce de ce qu'on estime supérieur, sur ce qui est inférieur. Tout cela mis à part, il faut accorder un poids décisif à une action spirituelle. C'est ainsi qu'on a pu parler, traditionnellement, d'un “agir sans agir”, et qu'on a employé le symbolisme du “moteur immobile” (au sens aristotélicien) et du “pôle”, de l'axe immuable autour duquel s'effectue tout mouvement ordonné des forces soumises. On a souligné l'attribut “olympien” de l'autorité et de la souveraineté véritables, leur façon de s'affirmer directement, non par la violence mais par la seule présence. Enfin, on a parfois utilisé l'image de l'aimant qui, nous le verrons, fournit la clé de tout le problème examiné ici. La conception de l'origine violente de tout ordre hiérarchique et étatique, conception chère à l'historiographie et à l'idéologie de gauche, doit être repoussée, en tant que conception grossière, fausse ou, du moins, incomplète.
D'une manière générale, il est absurde de croire que les représentants d'une véritable autorité spirituelle et de la tradition se mirent à courir derrière les hommes pour les empoigner et fixer chacun d'eux à sa place, au nom d'un intérêt direct à créer et à maintenir des rapports hiérarchiques afin que ces représentants apparaissent, visiblement aussi, comme des chefs. En réalité, la base fondamentale de toute hiérarchie normale et traditionnelle, ce n'est pas la simple soumission, mais l'adhésion et l'acceptation de la part de l'inférieur. Ce n'est pas le supérieur qui a besoin de l'inférieur, mais celui-ci qui a besoin de celui-là ; ce n'est pas le chef qui a besoin du troupeau, mais le troupeau qui a besoin d'un chef.
L'essence de la hiérarchie réside dans le fait que chez certains êtres vit, sous la forme d'une présence et d'une réalité en acte, ce qui, chez les autres, n'existe que comme aspiration confuse, pressentiment, tendance, de sorte que ces derniers sont fatalement attirés par les premiers, auxquels ils se soumettent de façon naturelle. Mais par là, ils se soumettent moins à quelque chose d'extérieur qu'à leur “Moi” le plus vrai. C'est là le secret de toute capacité de se sacrifier immédiatement, de tout héroïsme lucide, de tout dévouement libre et viril dans l'univers des anciennes hiérarchies — et, d'autre part, le secret d'un prestige, d'une autorité, d'une calme puissance, d'une influence que même le tyran le mieux armé n'aurait jamais pu s'assurer.
Reconnaître cela, c'est aussi voir sous un autre éclaIrage non seulement le problème de la décadence, mais celui de la possibilité, en général, de tout bouleversement subversif. N'a-t-on pas entendu répéter que si une révolution a triomphé, c'était bien la preuve que les anciens chefs étaient faibles et que l'ancienne classe dirigeante était dégénérée ? Cela peut avoir été vrai dans certains cas, mais la formule n'en est pas moins unilatérale. On pourrait certainement penser à cela dans le cas de chiens sauvages tenus en laisse, mais qui à la fin emportent tout ; cela prouverait évidemment que les mains qui retenaient ces animaux ne sont pas, ou ne sont plus, assez fortes. Mais il en va autrement si l'on conteste l'origine exclusivement violente de l'État vraI, et lorsque le point de départ est la hiérarchie dont nous venons d'indiquer le fondement le plus important. Une telle hierarchie ne peut être renversée que dans un seul cas; lorsque l'individu déchoit, lorsqu'il utilise sa liberté fondamentale pour priver sa vie de toute justification supérieure et se constituer lui-même comme une sorte de tronçon. Alors les contacts sont fatalement interrompus, la tension qui unifiait l'organisme traditionnel et qui faisait du processus politique la contrepartie d'un processus d'élévation et d'intégration de l'individu, de réalisation de potentialités supérieures latentes, se relâche ; alors chaque force vacille sur son orbite, pour finir — après éventuellement une vaine tentative de remplacer la tradition perdue par des constructions rationalistes ou utilitaires — par s'en détacher. Les sommets peuvent encore rester purs et intacts, mais le reste, qui était auparavant comme suspendu à eux, deviendra semblable à une avalanche, laquelle, avec un mouvement tout d'abord imperceptible puis accéléré, la stabilité ayant disparu, tombera toujours plus bas, jusqu'au fond, jusqu'au nivellement de la vallée : libéralisme, socialisme, collectivisme de masse, communisme.
Tel est le mystère de la décadence dans le cadre restreint auquel nous avons borné nos considérations ; tel est le mystère de toute révolution subversive. Le révolutionnaire a commencé par tuer en soi-même la hiérarchie, se privant ainsi des possibilités auxquelles correspondait le fondement intérieur de l'ordre, qu'il va ensuite abattre aussi sur le plan extérieur. Sans une destruction intérieure préliminaire, il n'y a pas de révolution — au sens d'une subversion antihiérarchique et antitraditionnelle — possible. Et puisque cette phase préliminaire échappe à l'observateur superficiel, au myope qui ne sait voir et juger que les “faits”, on a ainsi coutume de considérer les révolutions comme des phénomènes irrationnels ou de ne les expliquer que par des facteurs matériels et sociaux, alors que ceux-ci n'ont eu, dans chaque civilisation normale, qu'une fonction secondaire et subordonnée.
Quand la mythologie catholique (mitologia cattolica) met la chute de l'homme primordial et la “révolte des anges” en rapport avec le libre arbitre, elle se réfère, au fond, au même principe explicatif. Il s'agit du terrible pouvoir, dont dispose l'homme, d'utiliser la liberté dans le sens d'une destruction spirituelle, pour repousser tout ce qui peut lui assurer une dignité plus haute. C'est là une décision métaphysique, dont tout le courant qui serpente dans l'histoire, sous les différentes formes d'apparition de l'esprit antitraditionnel, révolutionnaire, individualiste, humaniste, laïc et enfin “moderne”, n'est que la manifestation et, pour ainsi dire, la phénoménologie. Cette décision est la cause première, active et déterminante, dans le mystère de la décadence, de la destruction des formes traditionnelles.
Dès lors qu'on a compris cela, on est également sur le point de pénétrer la signification de vieilles traditions, plutôt énigmatiques, relatives à des chefs qui, dans une certaine mesure, existent déjà, n'ayant jamais cessé d'être, et qui peuvent être retrouvés (eux-mêmes, ou bien leurs “demeures”) grâce à des actions décrites de plusieurs façons, mais présentant toujours un caractère symbolique ; leur recherche équivaut en effet à une réintégration, à la création d'une certaine attitude dont la vertu est analogue aux qualités essentielles qui font qu'un métal donné sent pour ainsi dire immédiatement l'aimant, le découvre, s'oriente et se meut irrésistiblement vers lui. Nous nous limiterons à cette indication, laissant à qui le voudra le soin de l'approfondir.
Mais, à considérer les temps présents, on ne peut éprouver qu'un profond pessimisme. Même si de vrais chefs apparaissaient, aujourd'hui ils ne seraient pas reconnus, à moins de cacher leur qualité et de se présenter essentiellement comme des démagogues et des agitateurs de mythes sociaux. C'est aussi pour cette raison que l'époque des monarchies a pris fin, tandis que précédemment, pour que l'ordre subsistât, même le simple symbole pouvait suffire, puisqu'il n'était pas nécessaire que celui qui l'incarnait fût toujours, en tant qu'homme, à la hauteur de ce symbole.
► Julius Evola, Explorations (1974), Pardès, 1989.

Historicité humaine et dépassement de l'histoire
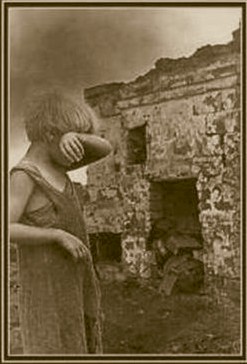 Faut-il penser la temporalité historique comme décadence et la temporalité existentielle comme déchéance ? Telle est la question qu'il est nécessaire d'examiner avant de pouvoir parler d'un dépassement de l'histoire qui aurait lieu au sein même de l'historicité. Or il convient, pour répondre, d'esquisser une démarche qui consiste à voir dans le déroulement de l'histoire humaine la mise en œuvre de l'historicité de l'homme universel et à suspendre tout jugement à ce qui n'est pas d'ordre historique. En effet il est un peu facile de parler de décadence comme d'une calamité actuelle, sans même savoir par rapport à quoi on juge. Ce n'est pas parce que l'histoire humaine n'est pas faite seulement d'actions généreuses, voire héroïques, qu'on peut parler de décadence aujourd'hui.
Faut-il penser la temporalité historique comme décadence et la temporalité existentielle comme déchéance ? Telle est la question qu'il est nécessaire d'examiner avant de pouvoir parler d'un dépassement de l'histoire qui aurait lieu au sein même de l'historicité. Or il convient, pour répondre, d'esquisser une démarche qui consiste à voir dans le déroulement de l'histoire humaine la mise en œuvre de l'historicité de l'homme universel et à suspendre tout jugement à ce qui n'est pas d'ordre historique. En effet il est un peu facile de parler de décadence comme d'une calamité actuelle, sans même savoir par rapport à quoi on juge. Ce n'est pas parce que l'histoire humaine n'est pas faite seulement d'actions généreuses, voire héroïques, qu'on peut parler de décadence aujourd'hui.
Pour parler d'une décadence historique dans les années 1970-1990, il faut savoir ce qu'on entend par décadence. La disjonction des notions de décadence et de déchéance nous invite à suspendre tout jugement éthique : alors que la notion de déchéance a un aspect moral, celle de décadence ne devrait pas en avoir. L'une et l'autre s'originent étymologiquement à la racine latine de tomber : c'est la chute qui est l'image fondatrice. Elles supposent donc un lieu d'origine, d'où l'on tombe. Et la question pourrait alors se formuler ainsi : les éléments de décadence historique témoignent-ils d'une déchéance ontologique ? Le fait que l'on puisse repérer dans l'histoire des éléments de décadence a-t-il sa raison d'être dans la condition humaine elle-même en tant que Condition déchue ?
Le problème de la décadence est posé aujourd'hui dans le contexte de la crise de la notion de progrès. Le XIXe siècle a cru à un progrès continu dans tous les domaines. Le schéma du progrès dans L'éducation du genre humain de Lessing (texte symbolisant fort bien au demeurant l'esprit des Lumières allemandes) envisage l'humanité comme un être humain, avec l'enfance (où le besoin de la révélation se fait sentir) et l'âge adulte (où la raison suffit). Curieusement, il n'y a pas de vieillissement, pas de vieillesse et pas de mort.
De même chez Fichte (cf. La destination du savant, 2ème conférence) qui admet que l'humanité est encore dans l'enfance, le progrès est à l'infini : l'humanité se caractérise par sa perfectibilité, et l'on ne voit pas de bornes à cette dernière. Condorcet, dans son Esquisse d'un tableau historique des progrès de l’esprit humain (très exactement contemporain des Conférences sur la destination du savant de 1794, prononcées par Fichte à Iéna lors de son arrivée triomphale à l'université) ne dit pas autre chose : la dixième époque est le triomphe de la perfectibilité qui n'est pas seulement celle de la société mais celle des facultés humaines elles-mêmes.
Le concept de décadence et celui de progrès
L'époque actuelle n'admet plus cette confiance en un progrès général. Elle est sensible au problème du vieillissement des cultures, des civilisations. La notion même de modernité, nettement formulée chez Baudelaire, est associée à la notion de décadence : le modèle du dandy, celui de l'esthète décadent sont présents dès la mi-course du XIXe s. Aujourd'hui, après 2 guerres mondiales et les manifestations de barbarie les plus caractérisées chez des peuples de civilisation très haute, après la course à l'enrichissement et la visée matérialiste des peuples les plus développés, la civilisation témoigne d'une crise générale des valeurs sociales et individuelles. Un nihilisme sommaire admettra implicitement qu'il n'y a pas de progrès du tout, que la technique dans son ensemble est plus négative que positive, que l'homme moderne a joué les apprentis-sorciers et s'est pris à son propre piège, et qu'enfin nous vivons dans une ère post-moderne, où la culture a perdu son sens. Nihilisme, après-culture, post-modernité, tels sont les thèmes qui s'opposent de façon antithétique à la foi naïve au progrès.
Dirais-je qu'ils me laissent aussi sceptiques que les premiers ? Si la philosophie est d'abord prise de distance et réflexion, je crois qu'elle devrait nous servir à éviter les attitudes naïves un peu exaltées. Ce qui frappe d'abord, c'est que l'idée d'un progrès absolu et celle d'une décadence absolue s'annulent d'elles-mêmes. Il ne peut y avoir dans l'histoire que des progrès et des décadences limitées, ne serait-ce que parce qu'ils sont historiques, donc relatifs et non absolus. L'illusion de la conscience moderne est d'absolutiser sa propre décadence : André Malraux écrit, dans La corde et les souris qu’« aucune époque n'aura su comme celle-ci qu'elle était provisoire, qu'elle marquait la fin d'un monde : pour nous, c'est tous les matins l'entrée d'Alaric à Rome ». Cette conscience apocalyptique consiste en fait à développer la tendance qui était présente dans la philosophie progressiste de l'histoire : si tout événement humain n'a de sens qu'historique, tout échec est nécessairement absolu ; la décadence absolutisée devient fin de la civilisation en général.
Le « jugement de décadence » comporte des satisfactions dans le fait qu'il semble une attitude d'extrême lucidité : et c'est se donner une importance que de se voir emporté par la décadence. Le sens pratique ou apocalyptique de la décadence est un refus radical de toute aventure, de tout héroïsme, au profit de la délectation subtile à savourer sa morosité. Cette conscience de la décadence repose sur les faits suivants : la société moderne développée est une société d'abondance pour autant que les besoins vitaux sont satisfaits, et exalte la sexualité. Abondance matérielle et sexualisation sont les signes de la décadence actuelle : le puritanisme moralisant et austère y voit les figures du pourrissement social. Ceci est tout à fait superficiel : faudra-t-il dire que Victor Hugo est plus décadent que Léonard de Vinci ? Le génie consommateur de femmes et l'autre génie, dont on ne sait s'il eut jamais un rapport sexuel avec qui que ce soit, ne semblent ni l'un ni l'autre des décadents. À un niveau plus sérieux, on peut parler d'épuisement du sens, d'éparpillement du sens et, enfin, et surtout, d'inefficacité du sens... À l'efficacité révolutionnaire de celui qui construit héroïquement un monde nouveau s'oppose la désinvolture désabusée du décadent qui sait d'avance qu'il ne pourra réaliser ses meilleures idées.
Critères internes et critères externes de la décadence
L'attitude réflexive pose 2 questions : au nom de quoi parler de décadence ? Et comment pense-t-on les phénomènes de décadence par rapport au cours général de l'histoire ? La première question est celle des critères au nom desquels on juge la décadence. On peut distinguer des critères externes et des critères internes. Les premiers sont les plus simples : on juge que notre époque ou telle autre est décadente par rapport à un modèle idéal. Dans la République, Platon propose un modèle qui est la Cité pure, par rapport auquel on peut juger des cités existantes. Ceci suppose une transcendance des valeurs sur lesquelles le tissu social s'édifie ; aucun jugement interne de l'histoire par l'histoire n'est possible.
Mais par rapport à ce modèle idéal, toute société réelle sera nécessairement décadente. Et la notion même de décadence perd de sa validité ; car il n'y a plus que des degrés plus ou moins grands d'impureté par rapport à la pureté idéale. Plus fréquemment, le critère de la décadence est le passé idéalisé : car ceci nous ramène à la dimension historique. Les transformations sociales sont jugées par rapport à un état antérieur, plus ou moins absolutisé ; au niveau mythique, ceci se trouve dans le schème de l'âge d'or (Fichte reproche à Rousseau d'y avoir cru) où l'origine est valorisée, mais on le retrouve dans l'attitude commune (la déploration sur la baisse du niveau scolaire par les enseignants en est un bon exemple). On peut dire qu'on a affaire ici à une illusion rétrospective caractérisée. L'idéalisation du passé tient au mouvement spontané de la conscience qui résiste à la nouveauté et refuse de s'y adapter.
Les critères internes de la décadence sont le fait de juger que l'histoire peut atteindre des sommets et aussi des abîmes. Les sommets sont les périodes où la culture fait effet de civilisation, c'est-à-dire où la société vit en accord avec ses formes culturelles, non seulement celles des arts, mais encore celles des coutumes, des métiers, etc. Ce ne sont pas des époques où il y a moins de crimes, moins de violence, moins de guerre. Cc sont des époques rares d'équilibre entre ce qui est hérité et ce qui est créatif dans la vie sociale. Les foyers de civilisation y sont actifs : ainsi le XIIe siècle de notre ère, avant lui, le siècle de Périclés, après lui, celui de Louis XIV. À cet égard, on pourrait dresser un schéma mythique reposant sur 3 âges fort différents de ceux de Vico : l’âge primitif qui se caractérise par l'énergie, l’âge classique, caractérisé par l'équilibre, l’âge décadent, caractérisé par l'esthétisme.
C'est dans les critères internes de la décadence qu'il faut ranger les analyses de Cioran que j'ai étudiées dans L’illusion historique et l'espérance céleste (Berg, p. 125-130). Les symptômes de la décadence selon Cioran tiennent à la multiplicité et à l'absence de forme. La lucidité tue l'esprit d'aventure, la conscience, trop sollicitée, tombe à l'informe, la société n'est plus créatrice de mythes : elle n'est plus capable que de concepts, elle dégrade les mythes en concepts. On a un magnifique exemple de décadence dans le structuralisme : seule une société décadente peut faire passer pour une « philosophie du concept à l'état pur » des jeux de concepts, une combinatoire, en un mot des structures. Ce qui est créateur, c'est l'élan qui produit ces concepts. Et si l'on pose la question : qu'est-ce qui, dans ces structures, donne sens à ma vie ?, on vous répondra que cette question n'a pas de sens. C'est le summum de la décadence : mettre entre parenthèses la vérité, le sens, au profit de l'étude désintéressée du jeu des structures...
De même à propos de la poésie, on étudiera le thème de l'exil dans la poésie de Saint-John Perse, mais celui qui demandera : d'où vient la singulière puissance de l'image de l'exil sur l'âme humaine ?, celui-là n'obtiendra pas de réponse. De même en théologie, on démythologise ; de même, en mystique, on parle plus du langage mystique, de la Fable mystique [allusion à un titre d'ouvrage de Michel de Certeau] que de l'expérience mystique elle-même. Tout ce qui a sens, tout ce qui est vécu étant mis entre parenthèses, restent les structures. On pense aux cigales dont parle Platon dans le Phèdre (258 E-259 D) : les décadents conceptuels sont comme ces hommes qui, ayant reçu des Muses le don du chant, se mirent à chanter tant et si bien qu'ils en oublièrent le boire et le manger, et devinrent le peuple des cigales. Ainsi, il me semble que les critères internes de la décadence nous forcent à reconnaître l'inégalité des attitudes et des époques dans l'histoire.
Si nous tentons maintenant de répondre à la seconde question : comment pouvons-nous penser cette décadence, une fois que nous nous sommes assurés que les critères internes sont seuls acceptables ? Il nous semble qu'il n'y a que 2 façons de le faire, selon qu'on adopte un schéma continuiste ou un schéma discontinuiste de l'histoire. Du côté de la continuité, 2 images sont possibles : celle du cycle, et celle des ondulations. Le temps cyclique de la République de Platon implique la décadence ; il est précisé encore dans le Politique comme un temps inversé, la rotation du monde abandonné à lui-même impliquant les cycles de la régression. Le schéma peut se compliquer si l'on admet la spirale comme cycle de cycles, selon la suggestion de Proclus. Mais le cycle implique toujours, comme les ondulations, l'alternance rythmique de la décadence et de la remontée : telles sont les cadences de la décadence. La différence est que le schéma ondulatoire reste pris dans une conception linéaire du temps historique, alors que le schéma cyclique appartient à une conception circulaire de l'histoire. Il y a un fatalisme immanent à ces schémas qui baigne d'une poésie tragique l'idée de décadence.
 Les schémas discontinuistes sont dialectiques au sens fort. On a assimilé très abusivement dialectique et foi au progrès, ou dialectique et historicisme. En fait le schéma dialectique hégélien est suspendu à une dialectique purement intemporelle, qui est celle des idées pures, dont le mouvement est déployé dans la Logique. C'est parce qu'il y a un devenir intemporel des Idées qu'il peut y avoir une dialectique de l’Esprit. J'ai montré dans Platon et l’idéalisme allemand combien est grande la dette de Hegel à l'égard du Sophiste et du Parménide de Platon.
Les schémas discontinuistes sont dialectiques au sens fort. On a assimilé très abusivement dialectique et foi au progrès, ou dialectique et historicisme. En fait le schéma dialectique hégélien est suspendu à une dialectique purement intemporelle, qui est celle des idées pures, dont le mouvement est déployé dans la Logique. C'est parce qu'il y a un devenir intemporel des Idées qu'il peut y avoir une dialectique de l’Esprit. J'ai montré dans Platon et l’idéalisme allemand combien est grande la dette de Hegel à l'égard du Sophiste et du Parménide de Platon.
Dans la dialectique hégélienne, la notion de décadence est perpétuelle, mais sans cesse dépassée : c'est le négatif sans lequel il n'y aurait pas de dialectique. L'essentiel sur la philosophie de l'histoire est dit par Hegel dans l'introduction de son cours sur la Philosophie de l'histoire, au passage intitulé Der Verlauf der Entwicklung. « Le temps est le négatif dans le sensible ; la pensée est la même négativité, mais la plus intérieure, la forme infinie même, en laquelle se dissout (aufgelöst wird) tout ce qui est en général, et d'abord l'être fini, la figure déterminée » (La Raison dans l'histoire, coll. 10/18, p. 209). Ainsi c'est la dissolution dans l'infinité de l'absolu qui est la forme hégélienne et dialectique de la décadence.
L'enfer serait qu'une culture ou une civilisation déterminée soit l'Absolu, ce qui est impensable. Du fait même qu'une culture ou une civilisation est déterminée, elle est promise à la dissolution, comme dans la danse des Bacchantes où il n'est personne qui ne soit ivre. Hegel poursuit : « Le Temps est bien l'élément corrosif du négatif, mais l’Esprit est du même coup ceci, à savoir qu'il dissout tout contenu déterminé. Il est l’Universel, l’Illimité, la Forme infinie la plus intérieure, et il vient à bout de tout ce qui est limité ».
La dissolution, ou décadence de chaque culture, de chaque civilisation, est nécessaire du fait même que l’Esprit ne s'identifie à aucune de ses formes. Assimiler une civilisation à la civilisation, c'est pêcher contre l’Esprit, pour autant que c'est le limiter, le figer et lui faire perdre son universalité. Un Esprit nouveau surgit de la dissolution de la forme précédente. Seule la philosophie peut voir ce que chaque civilisation contient d'universel, et cette tâche consiste à « rendre gloire à Dieu » : voir ce qui est absolu dans chaque œuvre de l’Esprit est « die Verherrlichung Gottes », alors qu'au contraire absolutiser une civilisation particulière est nier Dieu (Ibidem, p.213).
On retrouve cette démarche dans la pensée contemporaine, chez Bergson et chez Georg Simmel. La décadence est chez le premier la retombée en inertie de l'élan vital : il n'y a point d'élan qui ne retombe, et c'est l'élan lui-même qui se suscite ses propres obstacles. Le réel est dialectique par nature. Et on retrouve la corrélation nécessaire entre élan et chute, considérée par Bergson au niveau du Tout. Au niveau social, la thèse de Georg Simmel est exactement correspondante : la sociologie a pour objet l'étude, non des contenus sociaux (étudiés par quantité d'autres disciplines), mais des formes sociales, par lesquelles les individus se groupent et s'associent dans une société.
Les groupes sociaux ont une permanence et une identité propre qui survit au milieu du flux perpétuel des individus. Simmel précise l'intuition hégélienne de la continuité de l’Esprit universel : biologiquement, l'homme se reproduit en toute saison, et le nombre des nouveaux-nés dans le groupe est inférieur à celui du groupe existant. De sorte qu'il y a un « renouvellement lent et progressif du groupe qui en fait l'immortalité » (Comment les formes sociales se maintiennent in Sociologie et Épistémologie, PUF, p. 177).
Tout se passe comme si, dans l'ordre économique et dans l'ordre politique, la stabilité sociale et l'autoconservation de la société tendaient à s'inscrire dans les formes supra-individuelles, soustraites aux caprices des individus et dès lors érigées en symbole de l'unité sociale (en Grande-Bretagne, les 2 Chambres, les syndicats...). La décadence provient de ce que les organisations supra-individuelles ne peuvent pas toujours se constituer en organes et restent alors identiques à la somme de leurs membres. Elle provient aussi de ce que les organes supra-individuels s'individualisent si bien qu'ils se prennent pour le tout social ou du moins prétendent à une autonomie totale (Ibidem, p.189).
Les formes de la décadence sont les suivantes : tendance à l'autonomie destructrice, conservatisme réflexe et radical du groupe qui se sent menacé. Et au fond Georg Simmel ne fait qu'appliquer au domaine social la thèse générale de Hegel au sujet du rapport de l’Esprit universel aux formes particulières de l’Esprit du monde : « L’unité sociale est l’élément constant qui persiste identique à soi-même, alors que les formes particulières qu'elle reçoit et les rapports qu’elle soutient avec les intérêts sociaux sont infiniment mobiles ; et cette constance est d'autant plus accusée que cette mobilité est plus grande ». La décadence d'une forme sociale vient de sa rigidité, mais plus une forme sociale est souple et adaptative, plus elle persiste. La société ne vit que du dépérissement des formes sociales trop rigides ou de la transformation des formes sociales souples.
Il résulte clairement de toute cette analyse que la décadence historique, si elle est vue à travers des critères internes, apparaît comme une nécessité aussi inéluctable que relative. Il convient absolument de désarmer toute tentative d'absolutiser la décadence de telle ou telle période. Est-ce une philosophie sans tragique ? Au contraire une philosophie qui sait intégrer le tragique comprend la nécessité des conflits et des décadences, mais elle aide l'homme à trouver les moyens de dépasser les conflits et de recréer des formes sociales neuves. L'ouverture de l'avenir à l'espérance humaine ne s'opère que par une juste compréhension du négatif, conflit et décadence.
La déchéance humaine
 Faut-il dire que l'expérience du conflit ou la décadence de certaines périodes de l'histoire, de certaines civilisations sont des faits superficiels ? Certainement pas. Et la notion de déchéance nous incite à poser la question : qu'en est-il de l'homme, s'il est vrai que l'histoire humaine est faite de conflits et connaît des périodes de décadence nombreuses ? L'absolutisation de la décadence au niveau ontologique signifie la déchéance morale de l'être humain. C'est la notion de péché originel contre laquelle s'insurge justement Nicolas Berdiaev dans Le sens de la création. Tout ce qui est limité, erroné, fautif en l'homme renvoie, selon une théologie chrétienne traditionnelle, à un péché d'origine qui est à la fois un acte historique de déchéance morale et une expression de la déchéance ontologique de l'homme.
Faut-il dire que l'expérience du conflit ou la décadence de certaines périodes de l'histoire, de certaines civilisations sont des faits superficiels ? Certainement pas. Et la notion de déchéance nous incite à poser la question : qu'en est-il de l'homme, s'il est vrai que l'histoire humaine est faite de conflits et connaît des périodes de décadence nombreuses ? L'absolutisation de la décadence au niveau ontologique signifie la déchéance morale de l'être humain. C'est la notion de péché originel contre laquelle s'insurge justement Nicolas Berdiaev dans Le sens de la création. Tout ce qui est limité, erroné, fautif en l'homme renvoie, selon une théologie chrétienne traditionnelle, à un péché d'origine qui est à la fois un acte historique de déchéance morale et une expression de la déchéance ontologique de l'homme.
La déchéance éthico-ontologique que symbolise le péché originel est un schéma commode d'explication des faiblesses de l'homme et des possibilités qui restent inscrites dans la nature humaine. Ainsi à propos de l'amour, la théologie de saint Bernard explique fort bien que tout amour humain commence par l'égoïsme, qu'il y a chez l'homme un amour naturel de soi. Comment dés lors un amour désintéressé de Dieu est-il possible pour l'homme ? La réponse est : « Avant la chute, l'homme sait naturellement qu'il doit aimer Dieu et comment il doit l'aimer ; après la chute il l'a oublié et doit le réapprendre » (É. Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, Vrin, p. 276). Ainsi on opposera en l'homme 2 natures, la nature originelle, disposée à l'amour désintéressé, et la nature déchue, disposée à l'amour qui se referme sur soi-même. Abandonner la nature déchue suppose l'intervention d'une grâce surnaturelle, divine.
En fait, comme l'a vu Berdiaev, cette doctrine de la nature déchue de l'homme conduit à transformer l'amour chrétien en une disposition humanitaire exsangue d'où tout désir disparaît, car il faut renoncer à tout ce qui est conséquence du péché originel. D'où l'idée qu'il vaut mieux briser son cœur que d'aimer. En fait la notion de déchéance ontologique par le péché originel aboutit à douter des forces créatrices en l'homme. Dire l'homme déchu en raison d'une chute historique et ontologique, c'est abandonner l'homme au niveau le plus bas du monde ; c'est faire de son être-au-monde un être coupable d'une faute qu'il n'a pas commise. Ainsi ce qui était un schéma commode d'explication des faiblesses et des mérites de l'homme, les unes rapportées à la nature déchue et les autres à la nature originelle, devient une doctrine d'esclavage hostile à toute libération créatrice.
À cet égard, le complexe d'Œdipe dans la psychanalyse commune, joue de la même façon que le péché originel : c'est une faute antérieure, non commise, qui pèse sur l'homme et finit par justifier son peu d'énergie créatrice, en raison de la lourde fatalité qui pèse sur le destin non maîtrisé de nos pulsions. Que la cure psychanalytique ait pour but exactement l'inverse, c'est-à-dire une redistribution des cartes et une plus grande liberté, ne fait aucun doute. Mais notre société actuelle a besoin de succédanés du péché originel.
On peut dire clairement maintenant que si la décadence est conçue comme un état et non comme une étape, alors il faut concevoir toute chute humaine comme un état de déchéance : le péché originel, le complexe d'Œdipe entraînent des états, une nature déchue. Et c'est ce qui ne saurait être accepté dans cette idée de déchéance, outre son aspect éthique ou psychologique (selon le cas). En effet, si la décadence n'est pas un état mais une étape dans l'histoire, a-t-on encore le droit de parler de déchéance humaine ?
Un pas important est fait par Heidegger dans Sein und Zeit avec le thème de la Verfallenheit, que de Waehlens traduit par « déchéance » et Beaufret par « déclin » (Emmanuel Martineau traduit « échéance » (!) ; on consultera aussi, avec une extrême prudence, la traduction Vezin parue chez Gallimard). Je préfère garder pour l'instant l'image de la chute à cause des riches connotations mélancoliques et biologiques du déclin. Heidegger insiste sur le fait que « la déchéance de l'être-là ne doit pas être conçue comme la chute à partir d'un état originel plus pur et plus haut. Car de celui-ci nous n'avons, sur le plan ontique, aucune expérience, mais encore, sur le plan ontologique, aucune possibilité ni aucun fil directeur pour l'interpréter » (§ 38).
Ce serait une erreur de vouloir expliquer par cette déchéance les seules limitations ou défauts de l'existence. En fait, déchéance désigne un mode existentiel de l'être-dans-le-monde, qui s'atteste dans le phénomène de la chute. Il faut noter que ce mode existentiel n'est pas présenté comme un état pur et simple : Heidegger utilise de préférence le terme « Verfallen », qui est l'acte de tomber, substantivé à la manière de la langue allemande. Et il faut aussi noter que cette déchéance n'est rattachée à aucune faute particulière ; Heidegger la voit dans le bavardage, la curiosité, l'ambiguïté, qui ne sont pas des fautes mais des signes de l'inauthenticité. L'analyse heideggérienne du Verfallen n'est donc pas une simple sécularisation du thème du péché originel : il n'y a pas de péché, pas de culpabilité, et il n'y a pas d'état originel. Il y a là une simple description phénoménologique de l'existence inauthentique qui est la nôtre.
« L'être-là est d'emblée toujours déjà tombé et déchu dans le monde, par lui-même en tant que pouvoir-être-soi-même en propre ». La déchéance thématise ce fait d'être inapproprié (Uneigentlichkeit) à ce qui nous est le plus propre. Et c'est bien là ce qui importe, et qui a son écho dans l'histoire humaine en général avec les longues périodes de décadence que l'on connaît. Heidegger a su reconnaître dans la déchéance « une structure ontologique essentielle » de l'être-là, qui n'a rien d'un aspect nocturne de notre âme pour la raison qu'elle s'inscrit dans la quotidienneté de tous les jours.
L'inadéquation de l'homme à lui-même
 À cet égard, la notion de déchéance et celle de déclin ne sont pas vraiment satisfaisantes pour dire cette inadéquation de ce que nous vivons à ce que nous sommes en propre. Déchéance a le tort d'évoquer une chute ponctuelle et, en français, une connotation morale qui fausse le problème. On songe à l'émouvant tableau de Botticelli, La femme abandonnée [ci-contre].
À cet égard, la notion de déchéance et celle de déclin ne sont pas vraiment satisfaisantes pour dire cette inadéquation de ce que nous vivons à ce que nous sommes en propre. Déchéance a le tort d'évoquer une chute ponctuelle et, en français, une connotation morale qui fausse le problème. On songe à l'émouvant tableau de Botticelli, La femme abandonnée [ci-contre].
Déclin contient une métaphore naturelle implicite : le déclin est le vieillissement qui rapproche les plantes et les êtres en général du sol. Beaufret a bien montré, dans son texte sur Heidegger et la pensée du déclin combien le « déclinal » s'oppose au « germinal » ou à l' « auroral » : les Grecs sont les « matinaux » de la pensée et nous en sommes les « déclinants » (Dialogue avec Heidegger, t. III, p. 153-180). Mais le défaut de cette belle image du déclin est de reposer sur le schéma de l'alternance naturelle : l'automne décline mais le mystère printanier fera tout renaître. On pense à l'admirable poème de Lamartine L'Occident qui contraste avec l'Hymne au Matin du même, mais qui est une réussite esthétique prouvant l'affinité intérieure du poète avec les valeurs déclinantes :
Et l'astre qui tombait de nuage en nuage
Suspendait sur les flots un orbe sans rayon,
Puis plongeait la moitié de sa sanglante image,
Comme un navire en feu qui sombre à l'horizon ;
Et dans mon âme aussi pâlissant à mesure,
Tous les bruits d'ici-bas tombaient avec le jour
Et quelque chose en moi, comme dans la nature,
Pleurait, priait, souffrait, bénissait tour à tour
Malheureusement on ne peut écarter facilement les connotations des images mélancoliques ou moralisantes. Et ce que Berdiaev propose, c'est-à-dire l'épanouissement de l'acte créateur comme victoire et affranchissement, n'apparaît pas à l'horizon heideggérien. Heidegger ayant très justement noté la désappropriation existentielle de ce qui nous est le plus propre, montre comment la conscience se temporalise à partir de l'avenir. Mais l'avenir dont il s'agit est celui de la mort : la finitude, qui est le fin mot de la déchéance humaine, a pour limite radicale la mort. Or qu'importe l'avenir s'il n'est pas ouvert à nos forces créatrices ? Y a-t-il une fatalité nouvelle à se penser comme déclinant ?
À cet égard, je pense que la notion, ou l'image, de l'exil est préférable à celles de déchéance ou de déclin. Que l'historicité soit exil signifie que le lieu où nous vivons n'est pas celui qui nous est approprié. Et cette image locale doit être intériorisée : en nous-mêmes le lieu où nous vivons n'est pas celui de notre véritable moi. Notre expérience humaine se hiérarchise psychologiquement en degrés de tension ou d'extension plus ou moins grands. Aucune création véritable n'est possible sans concentration du moi vers son intériorité profonde. On associe généralement l'idée d'exil au désir de fuite hors de ce monde, qu'on trouve au passage chez Platon et chez les gnostiques. La réflexion sur les textes d’Henry Corbin amène à penser que l'exil et la fuite n'ont rien à voir. Si nous comprenons la condition d'exil de l'historicité humaine, nous n'avons pas besoin d'invoquer 2 natures, mais simplement un éloignement par rapport à ce qui nous est le plus propre et un cheminement pour le retrouver.
L'exil ne signifie pas que nous ayons reçu une nature mauvaise : nous sommes exilés de notre vrai moi signifie que nous sommes en continuelle extension, ou dispersion, ou distension. Notre malaise, ce que Heidegger nomme notre inauthenticité, vient de là. Le poète Hölderlin se dit « en proie à la patrie » dans Andenken : c'est traduire l'expérience de l'exil comme une structure fondamentale de l'existence humaine. Mais le mérite essentiel de l'image de l'exil me semble d'indiquer la nécessité d'un voyage, d'un cheminement qui sera l'aventure créatrice qui nous appelle. La conscience de l'exil est l'invitation au voyage : le sens intérieur de ceci est d'aller chercher son vrai moi. Ce vrai moi est fini et absolu à la fois : c'est ce qu'on peut nommer intériorité, ce que Sohravardî appelle l'Ange de moi-même, ce que l'Apocalypse de saint Jean appelle le caillou blanc sur lequel est inscrit un nom que Dieu seul connaît.
Mais alors, comment retrouver l'histoire et la décadence ? Si la dimension d'exil nous convie au voyage spirituel dans la verticalité, qu'en est-il de la dimension horizontale ou historique ? D'abord, c'est seulement par l'effort de concentration vers mon vrai moi, effort qui échappe à toute documentation historique, que je peux trouver et libérer en moi les forces créatrices qui me sont données. Car je peux alors d'une part éliminer l'accessoire, d'autre part lutter contre tous les innombrables obstacles intérieurs et extérieurs qui s'opposent à une démarche créatrice. L'inauthenticité n'est ni un carcan ni une fatalité pour autant que je la reconnaisse comme telle. En outre, je peux historiquement éprouver des expériences de caractère exceptionnel par rapport auxquelles les autres se relativisent : c'est le cas de l'amour ou du sacrifice, quelles que soient les doctrines qui essaient de le cacher. Enfin, il y a des acquis de l'histoire : les œuvres humaines ne sont pas également périssables, même si elles sont toutes fragiles et destructibles.
À cet égard, la notion d'exil me semble rendre compte du tragique de l'existence humaine : tragique dans le conflit entre le vrai moi et le moi superficiel ou l'authentique et l'inauthentique ; tragique entre l'élan créateur et l'inertie ou la répétition ; tragique enfin entre le résultat de l'acte créateur, l'œuvre, et l'élan qui l'a portée. Et ceci ne vaut pas pour les génies, mais pour tout homme : aucun de nos actes ne peut être posé qui ne soit du même coup coupé du processus qui l'a mené à être, et en quelque sorte dénaturé. Mais ce tragique n'apporte pas de désespoir, car je peux assumer pleinement l'historicité de ma condition et l'histoire humaine, si j'ai clairement conscience que je dois les envisager à partir de la dimension supra-historique.
L'histoire des efforts des hommes n'est pas nulle et non avenue. Je dois la transmuer en hiéro-histoire. C'est ce que fait Hugo en transformant l'histoire en légende. L'histoire connaît des périodes de décadence qui peuvent être en même temps des périodes de progrès ; mais elle est susceptible de laisser transparaître plus ou moins clairement l’Esprit. Autrement dit, je peux reconnaître, dans l'histoire des hommes, mon vrai moi spirituel et constituer ainsi une histoire de l’Esprit. C'est la tâche que Hegel assigne au philosophe : exhausser l'essentiel de l'histoire humaine au niveau de l’Esprit Absolu. Ce qui est exactement l'inverse du nivellement historique. Hegel dit que « les moments que l’Esprit paraît avoir derrière lui, il les a aussi dans sa profondeur». L’Esprit se connaît lui-même en s'approfondissant dans le présent. C'est cette coïncidence des niveaux en profondeur et vers la présence avec les périodes historiques qui est la transmutation de l'histoire en «épopée mystique » pour reprendre la belle expression d’Henry Corbin.
Ainsi pouvons-nous comprendre pourquoi il y a correspondance entre décadence et déchéance. Vladimir Jankélévitch écrit : « La décadence, c'est le souci de l'homme et c'est le drame de l'homme transposé dans la nature à travers ce medium qu'on appelle une civilisation » (RMM, 1959, p. 358). Cette transposition spontanée, nous l'éclairons en une démarche d'approfondissement en soi-même qui n'est pas une abolition de l'histoire au profit d'un éternel retour du même. C'est au contraire la temporalité du retour à l'origine. Il resterait à déployer, dans leurs articulations difficiles, la correspondance hiérarchique entre les niveaux de profondeur du moi (1) et les niveaux de la temporalité existentielle d'une part, et entre les niveaux de profondeur de l’Esprit et ceux de l'histoire d'autre part. C'est la grande tâche de symbolisation d'une métaphysique actuelle.
Dépasser l'histoire
Même pour celui qui admet qu'il n'y a pas de philosophie au sens plein et fort du mot sans métaphysique, il n'est pas possible d'échapper au problème de l'histoire. Car même si l'exigence d'absolu est acceptée et reconnue sous la forme individualiste d'une revendication pour la liberté humaine présente au départ de la philosophie fichtéenne — à laquelle s'impose une référence théorique — la question de l'histoire n'est pas éludée. Même si l'on admet que les œuvres d'art passent au travers des siècles, que l'expérience religieuse n'est pas entièrement conditionnée par le cours historique du monde, que le propre de la réflexion philosophique est d'instaurer des dialogues anachroniques, comme celui de Hegel avec Platon, le problème de l'histoire ne peut pas paraître réglé, achevé, c'est-à-dire éliminé. Le dépassement de l'histoire ne peut pas être une suppression de l'histoire.
C'est pourquoi j'ai employé l'expression d’illusion historique dans le titre d'un modeste essai philosophique (L’illusion historique et l’espérance céleste), pour désigner le fait que l'histoire survive à sa dénonciation comme illusion : ce qui nous trompe, c'est de tout penser selon l'ordre de la succession chronologique et historique, selon une vision journalistique du monde ; mais la dimension historique de l'homme, nul n'en fera l'économie. Malraux écrit à propos de Gide que la différence entre les écrivains de sa génération et ceux de l'âge de Gide est que les plus jeunes ont « rencontré l'histoire » : il pense à la révolution chinoise, à la guerre d'Espagne, au nazisme. Mais il pense aussi à cette idée d'un humanisme intemporel qui était admis comme évident par les écrivains de la génération de Gide. Rencontrer l'histoire, c'est agir dans le champ historique et c'est rencontrer la diversité. S'il y a un dépassement possible de l'historique, ce n'est pas sans prise en compte de l'histoire même : la question est de voir en quoi la reconnaissance de l'histoire n'implique pas le relativisme sceptique où est tombé plus d'un.
La première question est : pourquoi l'homme n'est-il pas esprit pur, s'il est vrai qu'il est liberté individuelle ? Et on ne peut y répondre que par l'analyse de l'historicité comme enracinement historique de l'homme.
La deuxème question est : pourquoi la diversité des cultures ? Pourquoi l'universalité de l’Esprit n'est-elle pas claire et manifeste en tous domaines comme en mathématiques ? Le rationalisme épistémologique éludé la question. Si la communication est possible, même si elle est difficile, il y a un universel d'une autre sorte que celui de l'abstraction pure.
Enfin une troisième question : quel statut accorder à la notion de modernité ? C'est la question de la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire d'une périodisation rendue nécessaire par le besoin que nous avons de nous situer ontologiquement. Nous vivons actuellement dans le contexte d'une crise de la notion de progrès, la progression du savoir n'étant plus considérée comme de soi civilisatrice. De là les phrases de Malraux : la science n'est nullement normative ; le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. De là aussi les revalorisations du quotidien comme chez Maffesoli, avec la Conquête du présent. Je ne peux essayer d'aborder que la première de ces 3 questions.
Une phrase de Raymond Aron dans Dimensions de la conscience historique servira de point de départ. À la fin d'une étude écrite en 1946 pour la Chamber's Encyclopœdia, on trouve cette phrase : « Privé de Cosmos et d'histoire l'homme se trouve rejeté vers l'unique relation avec Dieu ». Et l'existentialisme, athée ou chrétien, théorise cette relation. L'homme est privé de cosmos en ce sens qu'il ne cherche plus le sens de sa vie dans l'ordre cosmique (comme par ex. Platon dans le Timée) ; l'homme est privé d'histoire en ce sens qu'il ne croit plus que l'histoire apportera la réponse à tous les problèmes de l'humanité comme on pouvait le faire au XIXe s. (par ex. Marx, ou Spengler, ou même encore Toynbee). L'ordre cosmique, l'ordre historique sont ébranlés. Dès lors ne reste que le problème individuel de la foi en Dieu.
Je dois dire que cette analyse correspond assez bien à l'idée qui guide Henry Corbin vers Heidegger (qu'il fut le premier à traduire en français) et vers l'Islam iranien. Si le sens de la vie n'est ni dans les étoiles et leur harmonie fascinante, ni dans la nécessité historique qui agira volens nolens, reste à interroger le Da-sein humain, l'être-là ni subjectif ni psychologique, et en quoi la croyance implique un Da-sein particulier. La gnose ismaélienne et les grands philosophes de l'Islam iranien, en particulier Sohravardî et Mollâ Sâdrâ Shirâzî, nous offrent une description phénoménologique du mode d'être particulier de l'existence croyante sous la forme d'une véritable philosophie de la Résurrection. Si l'homme n'est pas être-pour-la-mort, mais être-appelé-à-se-relever-de-la-mort, qu'en résulte-t-il pour son appréhension de l'existence même ?
Cependant, en lisant cette belle phrase de Raymond Aron, on peut penser : s'il est vrai que la relation à Dieu est expérience radicalement subjective d'une foi irréductible à tout dogmatisme théologique, ne faut-il pas reconnaître que de cette relation découle une réappropriation de l'histoire et du cosmos ? À propos du cosmos, je dirai que l'écologie me paraît très significative d'une forme religieuse d'appréhension du monde. Elle est popularisée sous la forme plate d'un hygiénisme antipollution (comme si la nature ne polluait pas, alors que l'industrie seule polluerait ; or les marécages sont un phénomène naturel), ou encore sous la forme d'une science presque physique que se sont appropriés les agronomes au nom d'une distinction entre énergies naturelles et énergies non naturelles.
Or là encore, malheureusement, le concept d'énergie n'est pas employé dans le même sens par les physiciens et par les écologistes. L'écologie peut donc se travestir en idéologie politique, agronomique ou naturiste ; mais en son fond, elle est la résurgence d'un besoin pour l'homme de se situer dans l'ordre naturel, ne cherchant à préserver cet ordre que pour garder un sens à sa vie, dans un rapport inconscient entre microcosme et macrocosme : l'ordre de la nature cosmique garantissant l'ordre harmonique de la « nature humaine ». La théorie vraie de l'écologie serait celle qui montrerait, à partir de la relation à Dieu, comment le inonde peut devenir le miroir de l'homme. L'illusion des écologistes est de chercher dans le cosmos objectif la clé d'une vérité qui est subjective. Mais la démarche inverse semble parfaitement justifiée : le Moi doit lire dans le Non-Moi sa propre image, pour autant qu'il se sait comme non autosuffisant.
À propos de l'histoire, la même conversion est à faire. D'abord il faut noter la relativité de toute connaissance historique, liée au fait que l'homme est à la fois sujet et objet de l'histoire et que l'historien ne peut pas prétendre à un détachement radical. Il semble qu'il y ait là l'une des sources de la difficulté du dialogue entre historiens et philosophes. Le relativisme historique ne signifie pas l'absence de valeur de la recherche historique orientée en fonction des questions actuelles pour les hommes de ce temps.
Aron écrit : « L'existence humaine vécue est riche des mêmes significations, des mêmes équivoques fécondes que la connaissance historique ». La question théorique fondamentale est de savoir si on explique l'histoire par l'individu ou l'individu par l'histoire. Cette seconde solution est inévitablement celle d'un déterminisme historique qui nie toute liberté ; l'histoire est la cause de tout ce qui advient à l'individu humain. Mais la première solution n'est solidement établie que si on l'a confrontée au risque du monadisme ontologique radical, dont elle a peine à se déprendre, ou d'un individualisme systématique.
Je suis tout à fait d'accord avec Foucault pour dénoncer une idée générale de l'homme qui n'explique rien ; cette idée trouve son expression dans l'affirmation plate, incolore et impuissante des « droits de l'homme », dans un monde où les conflits sanglants ne cessent de renaître. Fichte dit bien qu'il faut au savant 3 formes de connaissance : la première est philosophique et porte sur les besoins et tendances de l'homme, la deuxième est historique et porte sur l'évolution des sociétés, de l'humanité, la troisième est dite philosophico-historique et consiste à appliquer la connaissance de l'homme à l'époque actuelle. Sous cette forme un peu scolaire se dit quelque chose d'essentiel : l'histoire ne s'explique pas par elle-même ; elle peut constituer des rationalités locales, mais elle sélectionne les faits en fonction de centres d'intérêt qui n'ont pas leur justification dans l'histoire elle-même.
De l'historicité
 C'est pourquoi il faut passer de l'histoire à l'historicité pour comprendre l'histoire même. Le concept heideggérien d'historial a le mérite de tenter de rendre compte du problème ici posé : l'historialité du Da-sein est une structure de la réalité humaine « en proie à la patrie » (Hölderlin) ; elle est cosmogonique, fondatrice de l'historicité du monde. Ce qui me retient ici d'adhérer à cette pensée est la notion du « Destin » par laquelle Heidegger passe de la problématique du Da-sein à l'histoire de l'être comme destin de la pensée occidentale. Et ce destin est déclin, et oubli, comme le destin du Da-sein marqué par le souci est en définitive la mort. Même si l'historialité de l'homme doit vaincre l'inauthenticité historique du bavardage quotidien, elle reste enfermée dans les étroites limites d'une mort inéluctable. L'historialité est enracinement authentique d'un être qui se temporalise par l'avenir, mais cet avenir est déterminé à l'avance comme clos.
C'est pourquoi il faut passer de l'histoire à l'historicité pour comprendre l'histoire même. Le concept heideggérien d'historial a le mérite de tenter de rendre compte du problème ici posé : l'historialité du Da-sein est une structure de la réalité humaine « en proie à la patrie » (Hölderlin) ; elle est cosmogonique, fondatrice de l'historicité du monde. Ce qui me retient ici d'adhérer à cette pensée est la notion du « Destin » par laquelle Heidegger passe de la problématique du Da-sein à l'histoire de l'être comme destin de la pensée occidentale. Et ce destin est déclin, et oubli, comme le destin du Da-sein marqué par le souci est en définitive la mort. Même si l'historialité de l'homme doit vaincre l'inauthenticité historique du bavardage quotidien, elle reste enfermée dans les étroites limites d'une mort inéluctable. L'historialité est enracinement authentique d'un être qui se temporalise par l'avenir, mais cet avenir est déterminé à l'avance comme clos.
Certes la position heideggérienne, au moins dans Sein und Zeit, marque légitimement la disjonction complète entre l'aboutissement ultime du devenir historique (célébré par les philosophes de l'histoire) et l'accomplissement de la vocation humaine. Mais celle-ci ne me semble se déployer que si l'homme n'est pas limité à un Da-sein dont les catégories seraient closes, mais s'il est conçu, selon la belle expression fichtéenne, comme « concept idéal ». En ce sens que l'homme n'est jamais égal à lui-même, que la capacité et la nécessité d'un dépassement lui sont toujours présentes. Faut-il donc, pour concevoir l'historicité comme dépassement, revenir à la foi au progrès d'un Fichte ou d'un Condorcet ? Ce serait revenir à l'histoire pour comprendre l'homme. Il faut au contraire comprendre l'ensemble des catégories de l'existence humaine sous ce concept global de l'exil que j'ai déjà particuliérement mis en valeur pour exprimer le décalage entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être.
Ici, comme en bien d'autres points, tout dépend de la réminiscence. C'est la théorie que nous n'avons jamais fini de comprendre pour nous expliquer à nous-mêmes notre propre recherche. Il ne s'agit pas seulement d'une présentation chronologique du problème du savoir, qui référerait (artificiellement) notre savoir actuel à un passé immémorial, analogue au transcendantal kantien. Eu égard au problème de l'historicité, la réminiscence signifie que notre expérience est nécessairement historique, mais n'est pas seulement historique. Ce que nous vivons nous permet de remonter à ce que nous sommes : Platon use de l'image de la chute dans le Phédre. Mais le schème de la chute a le défaut de renvoyer comme à une faute originelle (que Berdiaev désigne avec juste raison comme doctrine d'asservissement : chacun devrait payer le prix d'un péché d'origine et se contenter de servir comme un esclave en cette vie).
Or la réminiscence n'est pas un mythe d'origine au sens temporel. Elle est une approche de la différence radicale entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. En ceci consiste l'exil de la condition humaine. Cet exil n'est pas le résultat d'une condamnation, mais la situation qui nous rend inadéquat à nous-mêmes. Or le lieu de notre enracinement n'est ni un passé historique (comme le croient à tort toutes les idéologies passéistes), ni un statut dont nous serions déchus. Ce lieu est au contraire celui d'une espérance dans un avenir anhistorique. Nous n'en avons jamais fini de nous approprier nous-mêmes : la réminiscence nous montre que notre moi n'a pas sa source en lui-même, que nous sommes toujours en situation d'héritier.
Définir la conscience comme intentionnalité est l'illusion par excellence, corrélative de l'illusion historique. Il est certes vrai que c'est une illusion foncière de vouloir expliquer la vie individuelle par le cours du développement historique. Mais c'est une illusion inverse de mettre entre parenthèses le legs du passé dans la compréhension de la conscience. La réflexion initiale sur la conscience du temps suggère que la conscience ne se définit pas par l'intentionnalité ; le temps est précisément ce qui déborde la conscience, ce qui l'investit. Schelling parlait à ce sujet d'immémorial, pour montrer spéculativement que la conscience n'a pas en elle-même son propre fondement. De cette grandiose recherche inachevée sur la liberté humaine et sur les âges du monde, il reste ceci de fermement établi : dans la conscience, le temps n'est pas seulement ce qu'elle vise à partir d'un présent ponctuel.
Mais le caractère non-intentionnel du passé qui pousse la conscience en avant, comme le dit Bergson, ne signifie pas que la conscience est passive. Non-intentionnalité n'équivaut pas à passivité. La conscience est active dans les zones qui échappent à sa visée lucide. Non-intentionnalité n'équivaut pas non plus à objectivité, et mettre en évidence l'activité non-intentionnelle de la conscience, par la présence active en elle du passé non reconnu comme tel, mais cependant efficace, ne signifie pas du tout expliquer la conscience par les rythmes temporels du cosmos. Il ne faut pas croire que l'illusion historicisante ou l'illusion cosmique soient les seules qui dénaturent le problème du temps. Une conception purement universaliste et abstraite de la conscience peut aller jusqu'à supprimer le facteur individuel de la conscience, à ne plus y voir qu'une pure visée : or cette abolition du vécu individuel est la définition même de la mort. Elle ne peut produire que des systèmes de mort, fussent-ils des systèmes rationnels !
Comprenons bien que la réminiscence n'est pas célébration du passé comme tel. Il ne s'agit pas de faire mémoire pour faire mémoire, mais d'opérer l’Er-innerung [re-souvenir] dont parle Hegel, la récollection intériorisante de nous-mêmes. Cette récollection, Henry Corbin, dans son cours inédit sur La notion d'herméneutique chez Hamann, la désigne comme retour « au phénomène originel [...] or ce phénomène originel, c'est bien la coexistence de passé et avenir comme présent, telle que l'histoire ne peut jamais être considérée comme passé pur et simple ». De l’Er-innerung dépend l'interprétation qui sera faite d'un passé qui prendra sens par l'avenir dans le présent.
Ainsi notre conscience d'être en exil peut nous faire comprendre et ce qui nous est donné et ce que nous sommes. Elle ne s'associera pas à un volontarisme prométhéen ni à une description de la pratique conforme à l'analyse kantienne de la Critique de la raison pratique. Il ne s'agira pas davantage de sacrifier le présent pour des récompenses futures, des consolations dans l'au-delà. L’espérance de l'homme ne peut, sans falsification majeure, être objectivée, chosifiée. Elle y perdrait sa fragilité, qui fait sa validité.
 Se réapproprier soi-même ne peut se faire que dans la profondeur du présent. Nous ne vivons pas toute notre existence au même niveau. Mais nous pouvons approfondir notre réalité en concentrant notre vie sur notre moi le plus profond, ou la dilater dans les menues besognes quotidiennes. La présentation bergsonienne des Données immédiates de la conscience et la dialectique de la concentration et de la dilatation semblent foncièrement justes. Mais il faut les compléter : l'approfondissement du présent débouche sur les questions ultimes de l'historicité.
Se réapproprier soi-même ne peut se faire que dans la profondeur du présent. Nous ne vivons pas toute notre existence au même niveau. Mais nous pouvons approfondir notre réalité en concentrant notre vie sur notre moi le plus profond, ou la dilater dans les menues besognes quotidiennes. La présentation bergsonienne des Données immédiates de la conscience et la dialectique de la concentration et de la dilatation semblent foncièrement justes. Mais il faut les compléter : l'approfondissement du présent débouche sur les questions ultimes de l'historicité.
Ces questions sont les suivantes :
• 1) où l'homme est-il le plus individuel, s'il est vrai que l'individualisation maximale est le degré suprême de la concentration ? Réponse : dans l'expérience religieuse ;
• 2) où l'homme est-il le plus créateur, s'il est vrai que la création est la production où l'individu se reconnaît et s'exprime le plus ? Réponse : dans l'art ;
• 3) où l'homme est-il le plus conscient de lui-même, s'il est vrai que l'appropriation de soi par soi peut donner sens à sa vie ? Réponse : dans la philosophie.
[...]
► Jean-Luc Vieillard-Baron, Le problème du temps, sept études, ch. VII, Vrin, 1995, p. 151-170. Une première version de ce texte se trouve dans : Cahiers de l'imaginaire n°8 : Autour de Roger Caillois (L'Harmattan, 1992).
1. Cette idée fondamentale, qui montre que nous ne jouons pas notre vie à un seul et même niveau, a été le point de départ d'un des chefs-d'œuvre de Bergson, Matière et mémoire. Mais, avec la différence entre les niveaux de conscience, reprenant celle des niveaux de Profondeur du moi dans l'Essai sur les données immédiates de la conscience, Bergson a désigné un problème plus qu'il ne l'a résolu. Les œuvres de Bergson impliquent une critique de la société, superficielle selon l'Essai, méchante selon Le rire, mécanique selon Les deux sources de la morale et de la religion. Mais elles ne montrent pas clairement comment on peut échapper à la vie sociale sans pouvoir s'y soustraire, et passer d'un niveau de conscience à l'autre.
Cf. aussi Ontologie & décadence de Hegel à Heidegger (AL Kelkel)