EMPIRE

L'Empire est pour nous à la fois un mythe à régénérer et à appliquer à l'Europe à partir des exemples macédonien, romain, germanique, et une philosophie politique et géopolitique. Mais nous n'entendons pas en faire une utopie en la réduisant à une description institutionnelle ou à un programme. Notre vision impériale comporte 3 axes :
1) L'Empire unifie autour de la fonction première de toute société équilibrée, la fonction de souveraineté, ce qui relève de l'essence du politique et de la conscience historique, donc du destin ; pour le reste, il préserve la diversité de toutes les autres fonctions, des institutions, etc., qui n'ont pas d'incidence directe dans ces deux domaines. L'Empire fédère mais n'homogénéise pas, au contraire de la "Nation".
2) En deuxième lieu, son existence ne se justifie que par la recherche de la puissance et de la grandeur culturelles et historiques des peuples qu'il rassemble en une communauté politique. En revanche, ce qui relève du bien-être et du "social" regarde les institutions propres des peuples mais pas l'instance impériale.
3) En troisième lieu, puiqu'il est, selon nous, par nature ouvert sur le monde, prêt à y jouer un rôle à la mesure de sa puissance et non exclusif des autres entités politiques ou culturelles, l'Empire est universel mais non universaliste, car les peuples qui le constituent, dans notre conception tout au moins, n'ont pas de vocation à s'étendre à toute la Terre, ni territorialement ni ethniquement. En ce sens, l'Empire n'est pas républicain, au sens français ou américain, et se distingue du système occidental actuel qui entend, au contraire, inclure et homogénéiser tous les peuples. Empire ne signifie pasimpérialisme. L'Empire, selon notre conception, n'inclut et ne prend en charge le destin que des seuls peuples qui peuvent, historiquement, ethniquement et culturellement, se dire et se sentir parties de la même communauté. Nous pensons que ce "sentiment" est historialement fondé à surgir en Europe, Est et Ouest unis/réunis. Une Europe dont les "nations-États", au sens des idéologies actuellement dominantes, ne nous paraissent pas légitimes. En effet, à nos yeux, seule une Europe impériale structurée par le maillage des régions ethniques nous semble, à terme, viable et donc légitime. Historiquement, la notion d'Empire a toujours eu contre elle, d'une part, le pouvoir théocratique et le pouvoir marchand (l'un et l'autre foncièrement cosmopolites), et d'autre part, le principe de l'État-Nation dont la logique est fondamentalement sécessionniste, centralisatrice, homogénéisante et réductrice, et dont l'esprit très "provincial" génère le chauvinisme de bête à cornes. Cette idée impériale, nous voulons aujourd'hui la reprendre à notre compte, en lui donnant le sens de mouvement que lui conférait déjà Moeller van den Bruck.
À lire : Qu'est-ce qu'un empire ? (P. Richardot) – L'idée d'Empire (AdB)

La Notion d'Empire, de Rome à nos jours
(avec un appendice sur la "subsidiarité")
Dans la mémoire européenne, souvent confuse voire inconsciente, l'Empire romain demeure la quintessence de l'ordre. Il apparaît comme une victoire sur le chaos, inséparable de la pax romana. Le fait d'avoir maintenu la paix à l'intérieur des limes et d'avoir confiné la guerre sur des marches lointaines (Parthes, Maures, Germains, Daces) pendant plusieurs siècles, pour notre inconscient, est une preuve d'excellence. Même s'il est difficile de donner une définition universelle du terme d'Empire — l'Empire romain n'étant pas comparable à l'Empire inca, l'Empire de Gengis Khan à l'Autriche-Hongrie des Habsbourgs — Maurice Duverger s'est efforcé de souligner quelques caractéristiques des Empires qui se sont succédé sur la scène de l'histoire (dans son introduction au livre du Centre d'analyse comparative des systèmes politiques, Le concept d'Empire, PUF, 1980) :
D'abord, comme l'avait déjà remarqué le linguiste français Gabriel Gérard en 1718, l'Empire est un « État vaste et composé de plusieurs peuples », par opposition au royaume, poursuit Duverger, moins étendu et reposant sur « l'unité de la nation dont il est formé ». De cette définition, nous pouvons déduire, avec Duverger, 3 éléments :
- a) L'empire est monarchique, le pouvoir suprême est assumé par un seul titulaire, désigné par voie d'hérédité et présentant un caractère sacré (une fonction sacerdotale).
- b) L'étendue du territoire constitue un critère fondamental des empires, sans que l'on ne puisse donner de mesure précise. La grandeur du territoire est ici subjective.
- c) L'Empire est toujours composé de plusieurs peuples, sa grandeur territoriale impliquant d'office la diversité culturelle. Selon Karl Werner, « un royaume, c'est un pays ; un empire, c'est un monde ».
« Dans tout ensemble impérial, l'organisation des peuples est aussi variée que l'organisation de l'espace. Elle oscille partout entre deux exigences contraires et complémentaires : celle de la diversité, celle de l'unité » (Duverger, op. cit.). « Les Perses ont soumis plusieurs peuples, mais ils ont respecté leurs particularités : leur règne peut donc être assimilé à un empire » (Hegel). Par nature, les Empires sont donc plurinationaux. Ils réunissent plusieurs ethnies, plusieurs communautés, plusieurs cultures, autrefois séparées, toujours distinctes. Leur assemblage, au sein de la structure impériale, peut prendre plusieurs formes. Pour maintenir cet ensemble hétérogène, il faut que le pouvoir unitaire, celui du titulaire unique, apporte des avantages aux peuples englobés et que chacun conserve son identité. Le pouvoir doit donc à la fois centraliser et tolérer l'autonomie : centraliser pour éviter la sécession des pouvoirs locaux (féodaux) et tolérer l'autonomie pour maintenir langues, cultures et mœurs des peuples, pour que ceux-ci ne se sentent pas opprimés.
Il faut enfin, ajoute Duverger, que chaque communauté et chaque individu aient conscience qu'ils gagnent à demeurer dans l'ensemble impérial au lieu de vivre séparément. Tâche éminemment difficile qui souligne la fragilité des édifices impériaux : Rome a su maintenir un tel équilibre pendant des siècles, d'où la nostalgie de cet ordre jusqu'à nos jours. Les imperfections de l'administration romaine ont été certes fort nombreuses, surtout en période de déclin, mais ces dysfonctionnements étaient préférables au chaos. Les élites ont accepté la centralisation et ont modelé leur comportement sur celui du centre, les masses rurales ont conservé leurs mœurs intactes pratiquement jusqu'à la rupture des agrégats ruraux, due à la Révolution industrielle (avec la parenthèse noire des procès de sorcelleries).
Duverger signale aussi l'une des faiblesses de l'Empire, surtout si l'on souhaite en réactualiser les principes de pluralisme : la notion de fermeture, symbolisée éloquemment par la Muraille de Chine ou le Mur d'Hadrien. L'Empire se conçoit comme un ordre, entouré d'un chaos menaçant, niant par là même que les autres puissent posséder eux-mêmes leur ordre ou qu'il ait quelque valeur. Chaque empire s'affirme plus ou moins comme le monde essentiel, entouré de mondes périphériques réduits à des quantités négligeables. L'hégémonie universelle concerne seulement « l'univers qui vaut quelque chose ». Rejeté dans les ténèbres extérieures, le reste est une menace dont il faut se protéger.
Dans la plupart des empires non européens, l'avènement de l'empire équivaut au remplacement des dieux locaux par un dieu universel. Le modèle romain fait figure d'exception : il ne remplace pas les dieux locaux, il les intègre dans son propre panthéon. Le culte de l'imperator s'est développé après coup, comme moyen d'établir une relative unité de croyance parmi les peuples divers dont les dieux entraient au Panthéon dans un syncrétisme tolérant. Cette République de divinités locales n'impliquaient pas de croisades extérieures puisque toutes les formes du sacré pouvaient coexister.
Quand s'effondre l'Empire romain, surtout à cause de sa décadence, le territoire de l'Empire est morcellé, divisé en de multiples royaumes germaniques (Francs, Suèbes, Wisigoths, Burgondes, Ostrogoths, Alamans, Bavarois, etc.) qui s'unissent certes contre les Huns (ennemi extérieur) mais finissent par se combattre entre eux, avant de sombrer à leur tour dans la décadence (les "rois fainéants") ou de s'évanouir sous la domination islamique (Wisigoths, Vandales). De la chute de Rome au Ve siècle à l'avènement des Maires du Palais et de Charlemagne, l'Europe, du moins sa portion occidentale, connaît un nouveau chaos, que le christianisme seul s'avère incapable de maîtriser.
De l'Empire d'Occident, face à un Empire d'Orient moins durement étrillé, ne demeurait intacte qu'une Romania italienne, réduite à une partie seulement de la péninsule. Cette Romania ne pouvait prétendre au statut d'Empire, vu son exigüité ; territoriale et son extrême faiblesse militaire. Face à elle, l'Empire d'Orient, désormais "byzantin", parfois appelé "grec" et un Regnum Francorum territorialement compact, militairement puissant, pour lequel, d'ailleurs, la dignité impériale n'aurait pu être qu'un colifichet inutile, un simple titre honorifique. À la Romania, il ne reste plus que le prestige défunt et passé de l'Urbs, la Ville initiale de l'histoire impériale, la civitas de l'origine qui s'est étendue à l'Orbis romanus. Le citoyen romain dans l'Empire signale son appartenance à cet Orbis, tout en conservant sa natio (natione Syrus, natione Gallus, natione Germanicus, etc.) et sa patria, appartenance à telle ou telle ville de l'ensemble constitué par l'Orbis. Mais la notion d'Empire reste liée à une ville : Rome ou Byzance, si bien que les premiers rois germaniques (Odoacre, Théodoric) après la chute de Rome reconnaissent comme Empereur le monarque qui siège à Constantinople.
Si la Romania italienne conservait symboliquement la Ville, Rome, symbole le plus tangible de l'Empire, légitimité concrète, elle manquait singulièrement d'assises territoriales. Face à Byzance, face à la tentative de reconquête de Justinien, la Romania et Rome, pour restaurer leur éclat, pour être de nouveau les premières au centre de l'Orbis, devaient très naturellement tourner leur regard vers le roi des Francs (et des Lombards qu'il venait de vaincre), Charles. Mais les lètes francs, fiers, n'avaient pas envie de devenir de simples appendices d'une minuscule Romania dépourvue de gloire militaire. Entretemps, le Pape rompt avec l'Empereur d'Orient. Le Saint-Siège, écrit Pirenne, jusqu'alors orienté vers Constantinople, se tourne résolument vers l'Occident et, afin, de reconquérir à la chrétienté ses positions perdues, commence à organiser l'évangélisation des peuples 'barbares' du continent. L'objectif est clair : se donner à l'Ouest les bases d'une puissance, pour ne plus tomber sous la coupe de l'Empereur d'Orient. Plus tard, l'Église ne voudra plus se trouver sous la coupe d'un Empereur d'Occident.
Le Regnum Francorum aurait parfaitement pu devenir un empire seul, sans Rome, mais Rome ne pouvait plus redevenir un centre crédible sans la masse territoriale franque. De là, la nécessité de déployer une propagande flatteuse, décrivant en latin, seule langue administrative du Regnum Francorum (y compris chez les notaires, les refendarii civils et laïques), les Francs comme le nouveau "peuple élu de Dieu", Charlemagne comme le "Nouveau Constantin" avant même qu'il ne soit couronné officiellement Empereur (dès 778 par Hadrien Ier), comme un "Nouveau David" (ce qui laisse penser qu'une opposition existait à l'époque entre les partisans de "l'idéologie davidique" et ceux de "l'idéologie constantinienne", plus romaine que "nationale"). Avant de devenir Empereur à Rome et par la grâce du Pape, Charlemagne pouvait donc se considérer comme un "nouveau David", égal de l'Empereur d'Orient. Ce qui ne semblait poser aucun problème aux nobles francs ou germaniques.
Devenir Empereur de la Romania posait problème à Charlemagne avant 800, année de son couronnement. Certes, devenir Empereur romano-chrétien était intéressant et glorieux mais comment y parvenir quand la base effective du pouvoir est franque et germanique. Les sources nous renseignent sur l'évolution : Charlemagne n'est pas Imperator Romanorum mais Romanum imperium gubernans qui est per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum. Sa nouvelle dignité ne devait absolument pas entamer ou restreindre l'éclat du royaume des Francs, son titre de Rex Francorum demeurant l'essentiel. Aix-la-Chapelle, imitée de Byzance mais perçue comme "Anti-Constantinople", reste la capitale réelle de l'Empire.
Mais l'Église pense que l'Empereur est comme la lune : il ne reçoit sa lumière que du "vrai" empereur, le Pape. À la suite de Charlemagne, se crée un parti de l'unité, qui veut surmonter l'obstacle de la dualité franco-romaine. Louis le Pieux, successeur de son père, sera surnommé Hludowicus imperator augustus, sans qu'on ne parle plus de Francs ou de Romains. L'Empire est un et comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France et les États du Bénélux actuels. Mais, le droit franc ne connaissait pas le droit de primogéniture : à la mort de Louis le Pieux, l'Empire est partagé entre ses descendants en dépit du titre impérial porté par Lothaire Ier seul. Suivent plusieurs décennies de déclin, au bout desquels s'affirment deux royaumes, celui de l'Ouest, qui deviendra la France, et celui de l'Est, qui deviendra le Saint-Empire ou, plus tard, la sphère d'influence allemande en Europe.
Harcelée par les peuples extérieures, par l'avance des Slaves non convertis en direction de l'Elbe (après l'élimination des Saxons par Charlemagne en 782 et la dispersion des survivants dans l'Empire, comme en témoignent les Sasseville, Sassenagues, Sachsenhausen, etc.), les raids sarazins et scandinaves, les assauts des Hongrois, l'Europe retombe dans le chaos. Il faut la poigne d'un Arnoulf de Carinthie pour rétablir un semblant d'ordre. Il est nommé Empereur. Mais il faudra attendre la victoire du roi saxon Othon Ier en 955 contre les Hongrois, pour retrouver une magnificence impériale et une paix relative. Le 2 février 962, en la Basilique Saint-Pierre de Rome, le souverain germanique, plus précisément saxon (et non plus franc), Othon Ier, est couronné empereur par le Pape. L'Empire n'est plus peppinide-carolingien-franc mais allemand et saxon. Il devient le "Saint-Empire".
En 911 en effet, la couronne impériale a échappé à la descendance de Charlemagne pour passer aux Saxons (est-ce une vengeance pour Werden ?), Henri Ier l'Oiseleur (919-936), puis Othon (936-973). Comme Charlemagne, Othon est un chef de guerre victorieux, élu et couronné pour défendre l'œcumène par l'épée. L'Empereur, en ce sens, est l'avoué de la Chrétienté, son protecteur. Plus que Charlemagne, Othon incarne le caractère militaire de la dignité impériale. Il dominera la papauté et subordonnera entièrement l'élection papale à l'aval de l'Empereur. Certaines sources mentionnent d'ailleurs que le Pape n'a fait qu'entériner un fait accompli : les soldats qui venaient d'emporter la décision à Lechfeld contre les Hongrois avaient proclamé leur chef Empereur, dans le droit fil des traditions de la Germanie antique, en se référant au "charisme victorieux" (Heil) qui fonde et sanctifie le pouvoir suprême.
En hissant ce chef saxon à la dignité impériale, le Pape opère le fameuse translatio Imperii ad Germanos (et non plus ad Francos). L'Empereur devra être de race germanique et non plus seulement d'ethnie franque. Un "peuple impérial" se charge dès lors de la politique, laissant intactes les identités des autres : le règne des othoniens élargira l'œcumène franc/européen à la Pologne et à la Hongrie (Bassin danubien — Royaume des Avars). Les othoniens dominent véritablement la Papauté, nomment les évêques comme simples administrateurs des provinces d'Empire. Mais le pouvoir de ces "rois allemands", théoriquement titulaires de la dignité impériale, va s'estomper très vite : Othon II et Othon III accèdent au trône trop jeunes, sans avoir été véritablement formés ni par l'école ni par la vie ou la guerre.
Othon II, manipulé par le Pape, engage le combat avec les Sarazins en Italie du Sud et subit une cuisante défaite à Cotrone en 982. Son fils Othon III commence mal : il veut également restaurer un pouvoir militaire en Méditerranée qu'il est incapable de tenir, faute de flotte. Mais il nomme un Pape allemand, Grégoire V, qui périra empoisonné par les Romains qui ne veulent qu'un Pape italien. Othon III ne se laisse pas intimider ; le Pape suivant est également allemand : Gerbert d'Aurillac (Alaman d'Alsace) qui coiffe la tiare sous le nom de Sylvestre II. Les barons et les évêques allemands finissent pas lui refuser troupes et crédits et le chroniqueur Thietmar de Merseburg pose ce jugement sévère sur le jeune empereur idéaliste : « Par jeu enfantin, il tenta de restaurer Rome dans la gloire de sa dignitié de jadis ». Othon III voulait fixer sa résidence à Rome et avait pris le titre de Servus Apostolorum (Esclave des Apôtres).
Les "rois allemands" ne pèseront plus très lourd devant l'Église après l'an 1002, dans la foulée des croisades, par la contre-offensive théocratique, où les Papes vont s'enhardir et contester aux Empereurs le droit de nommer les évêques, donc de gouverner leurs terres par des hommes de leur choix. Grégoire VII impose le Dictatus Papae, par lequel, entre moultes autres choses, le roi n'est plus perçu que comme Vicarius Dei, y compris le "Rex Teutonicorum" auquel revient prioritairement le titre d'Empereur. La querelle des Investitures commence pour le malheur de l'Europe, avec la menace d'excommunication adressée à Henri IV (consommée en 1076). Les vassaux de l'Empereur sont encouragés à la désobéissance, de même que les villes bourgeoises (les "ligues lombardes"), ce qui vide de substance politique tout le centre de l'Europe, de Brême à Marseille, de Hambourg à Rome et de Dantzig à Venise.
Par ailleurs, les croisades expédient au loin les éléments les plus dynamiques de la chevalerie, l'Inquisition traque toute déviance intellectuelle et les sectes commencent à prospérer, promouvant un dualisme radical (Concile des hérétiques de St. Félix de Caraman, 1167) et un idéal de pauvreté mis en équation avec une « complétude de l'âme » (Vaudois). En acceptant l'humiliation de Canossa (1077), l'Empereur Henri IV sauve certes son Empire mais provisoirement : il met un terme à la furie vengeresse du Pape romain qui a soudoyé les princes rebelles. Mort excommunié, on lui refuse une sépulture, mais le simple peuple le reconnait comme son chef, l'enterre et répend sur sa pauvre tombe des graines de blé, symbole de ressurection dans la tradition paysanne/païenne des Germains : la cause de l'Empereur apparaissait donc plus juste aux humbles qu'aux puissants.
Frédéric Ier Barberousse tente de redresser la barre, d'abord en aidant le Pape contre le peuple de Rome révolté et les Normands du Sud. L'Empereur ne mate que les Romains. Il s'ensuivra six campagnes en Italie et le grand schisme, sans qu'aucune solution ne soit apportée. Son petit-fils Frédéric II Hohenstaufen, sorte de surdoué, très tôt orphelin de père et de mère, virtuose des techniques de combat, intellectuel formé à toutes les disciplines, doté de la bosse des langues vivantes et mortes, se verra refuser d'abord la dignité impériale par l'autocrate Innocent III : « C'est au Guelfe que revient la Couronne car aucun Pape ne peut aimer un Staufer ! » Ce que le Pape craint par-dessus tout c'est l'union des Deux-Siciles (Italie du Sud) et l'Empire germano-italien, union qui coincerait les États pontificaux entre deux entités géopolitiques dominées par une seule autorité. Frédéric II a d'autres plans, avant même de devenir Empereur : au départ de la Sicile, reconstituer, avec l'appui d'une chevalerie allemande, espagnole et normande, l'œcumène romano-méditerranéen.
Son projet était de dégager la Méditerranée de la tutelle musulmane, d'ouvrir le commerce et l'industrie en les couplant à l'atelier rhénan-germanique. C'est la raison de ses croisades, qui sont purement géopolitiques et non religieuses : la chrétienté doit demeurer, l'islam également, ainsi que les autres religions, pour autant qu'elles apportent des éclairages nouveaux à la connaissance. En ce sens, Frédéric II redevient "romain", par un tolérance objective, ne cherchant que la rentabilité pragmatique, qui n'exclut pas le respect pieux des valeurs religieuses : cet Empereur qui ne cesse de hanter les grands esprits (Brion, Benoist-Méchin, Kantorowicz, de Stefano, Horst, etc.) est protéiforme, esprit libre et défenseur du dogme chrétien, souverain féodal en Allemagne et prince despotique en Sicile ; il réceptionne tout en sa personne, synthétise et met au service de son projet politique. Dans la conception hiérarchique des êtres et des fins terrestres que se faisait Frédéric II, l'Empire constituait le sommet, l'exemple impassable pour tous les autres ordres inférieurs de la nature. De même, l'Empereur, également au sommet de cette hiérarchie par la vertu de sa titulature, doit être un exemple pour tous les princes du monde, non pas en vertu de son hérédité, mais de sa supériorité intellectuelle, de sa connaissance ou de ses connaissances.
Les vertus impériales sont justice, vérité, miséricorde et constance :
- La justice, fondement même de l'État, constitue la vertu essentielle du souverain. Elle est le reflet de la fidélité du souverain envers Dieu, à qui il doit rendre compte des talents qu'il a reçus. Cette justice n'est pas purement idéale, immobile et désincarnée (métaphysique au mauvais sens du terme) : pour Frédéric II, elle doit être à l'image du Dieu incarné (donc chrétien) c'est-à-dire opérante. Dieu permet au glaive de l'Empereur, du chef de guerre, de vaincre parce qu'il veut lui donner l'occasion de faire descendre la justice idéale dans le monde. La colère de l'Empereur, dans cette optique, est noble et féconde, comme celle du lion, terrible pour les ennemis de la justice, clémente pour les pauvres et les vaincus.
- La constance, autre vertu cardinale de l'Empereur, reflète la fidélité à l'ordre naturel de Dieu, aux lois de l'univers qui sont éternelles.
- La fidélité est la vertu des sujets comme la justice est la vertu principale de l'Empereur. L'Empereur obéit à Dieu en incarnant la justice, les sujets obéissent à l'Empereur pour lui permettre de réaliser cette justice. Toute rébellion envers l'Empereur est assimilée à de la "superstition", car elle n'est pas seulement une révolte contre Dieu et contre l'Empereur mais aussi contre la nature même du monde, contre l'essence de la nature, contre les lois de la conscience.
- La notion de miséricorde nous renvoie à l'amitié qui a unit Frédéric II à Saint-François d'Assise. Frédéric ne s'oppose pas à la chrétienté et à la papauté, en tant qu'institutions. Elles doivent subsister. Mais les Papes ont refusé de donner à l'Empereur ce qui revient à l'Empereur. Ils ont abandonné leur magistère spirituel qui est de dispenser de la miséricorde. François d'Assise et les frères mineurs, en faisant vœu de pauvreté, contrairement aux Papes simoniaques, rétablissent la vérité chrétienne et la miséricorde, en acceptant humblement l'ordre du monde. Lors de leur rencontre en Apulie, Frédéric II dira au "Poverello" : « François, avec toi se trouve le vrai Dieu et son Verbe dans ta bouche est vrai, en toi il a dévoilé sa grandeur et sa puissance ». L'Église possède dans ce sens un rôle social, caritatif, non politique, qui contribue à préserver, dans son "créneau", l'ordre du monde, l'harmonie, la stabilité. Le "péché originel" dans l'optique non-conformiste de Frédéric II est dès lors l'absence de lois, l'arbitraire, l'incapacité à 'éthiciser' la vie publique par fringale irraisonnée de pouvoir, de possession.
L'échec du redressement de Frédéric II a sanctionné encore davantage le chaos en Europe centrale. L'Empire qui est potentiellement facteur d'ordre n'a plus pu l'être pleinement. Ce qui a conduit à la catastrophe de 1648, où le morcellement et la division a été savamment entretenue par les puissances voisines, en premier lieu par la France de Louis XIV. Les autonomies, apanages de la conception impériale, du moins en théorie, disparaissent complètement sous les coups de boutoir du centralisme royal français ou espagnol. Le "droit de résistance", héritage germanique et fondement réel des droits de l'homme, est progressivement houspillé hors des consciences pour être remplacé par une théorie jusnaturaliste et abstraite des droits de l'homme, qui est toujours en vigueur aujourd'hui.
Toute notion d'Empire aujourd'hui doit reposer sur les quatre vertus de Frédéric II Hohenstaufen : justice, vérité, miséricorde et constance. L'idée de justice doit se concrétiser aujourd'hui par la notion de subsidiarité, donnant à chaque catégorie de citoyens, à chaque communauté religieuse ou culturelle, professionnelle ou autre, le droit à l'autonomie, afin de ne pas mutiler un pan du réel. La notion de vérité passe par une revalorisation de la "connaissance", de la "sapience" et d'un respect des lois naturelles. La miséricorde passe par une charte sociale exemplaire pour le reste de la planète. La notion de constance doit nous conduire vers une fusion du savoir scientifique et de la vision politique, de la connaissance et de la pratique politicienne quotidienne.
Nul ne nous indique mieux les pistes à suivre que Sigrid Hunke, dans sa persepective "unitarienne" et européo-centrée : affirmer l'identité européenne, c'est développer une religiosité unitaire dans son fonds, polymorphe dans ses manifestations ; contre l'ancrage dans nos esprits du mythe biblique du péché originel, elle nous demande de réétudier la théologie de Pélagius, l'ennemi irlandais d'Augustin. L'Europe, c'est une perception de la nature comme épiphanie du divin : de Scot Erigène à Giordano Bruno et à Gœthe. L'Europe, c'est également une mystique du devenir et de l'action : d'Héraclite, à Maître Eckhart et à Fichte. L'Europe, c'est une vision du cosmos où l'on constate l'inégalité factuelle de ce qui est égal en dignité ainsi qu'une infinie pluralité de centres, comme nous l'enseigne Nicolas de Cues.
Sur ces bases philosophiques se dégageront une nouvelle anthropologie, une nouvelle vision de l'homme, impliquant la responsabilité (le principe "responsabilité") pour l'autre, pour l'écosystème, parce que l'homme n'est plus un pécheur mais un collaborateur de Dieu et un miles imperii, un soldat de l'Empire. Le travail n'est plus malédiction ou aliénation mais bénédiction et octroi d'un surplus de sens au monde. La technique est service à l'homme, à autrui.
Par ailleurs, le principe de "subsidiarité", tant évoqué dans l'Europe actuelle mais si peu mis en pratique, renoue avec un respect impérial des entités locales, des spécificités multiples que recèle le monde vaste et diversifié. Le Prof. Chantal Millon-Delsol constate que le retour de cette idée est due à 3 facteurs :
- La construction de l'Europe, espace vaste et multiculturel, qui doit forcément trouver un mode de gestion qui tiennent compte de cette diversité tout en permettant d'articuler l'ensemble harmonieusement. Les recettes royales-centralistes et jacobines s'avérant obsolètes.
- La chute du totalitarisme communiste a montré l'inanité des "systèmes" monolithiques.
- Le chômage remet en cause le providentialisme d'État à l'Ouest, en raison de l'appauvrissement du secteur public et du déficit de citoyenneté. « Trop secouru, l'enfant demeure immature ; privé d'aide, il va devenir une brute ou un idiot ».
Mais, ajoute C. Millon-Delsol, l'avènement d'une Europe subsidiaire passe par une condition sociologique primordiale : la volonté d'autonomie et d'initiative des acteurs sociaux, ce qui suppose que ceux-ci n'aient pas été préalablement brisés par le totalitarisme ou infantilisés par un État paternel (solidarité solitaire par le biais de la fiscalité ; redéfinition du partage des tâches). Notre tâche dans ce défi historique, donner harmonie à un grand espace pluriculturel, passe par une revalorisation des valeurs que nous avons évoquées ici en vrac au sein de structures associatives, préparant une citoyenneté nouvelle et active, une milice sapientiale.
► Robert Steuckers (conférence prononcée à la tribune du "Cercle Hélios", Île-de-France, 1995).
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sur le “modèle impérial” pour l’Europe de demain
◘ Réponse de Robert Steuckers à un étudiant dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude (mai 1998).
• En ce qui concerne la construction européenne, Alain de Benoist affirme préférer le modèle impérial comme mode de construction politique. Et vous, même, animateur de “Synergies européennes” ?
 Mon option est également “impériale”. Mais il faut s’entendre sur le mot. Les termes “imperium”, “empire”, “impérial” revêtent dans le langage quotidien des acceptions très différentes et parfois contradictoires. Je tiens tout de suite à dire que, pour moi, le terme “empire” ne signifie nullement ce mixte de militarisme et d’idéologie conquérante que l’on trouve dans les phases décadentes de la République romaine et dans le césarisme qui les a suivies, dans l’empire hellénistique d’Alexandre, dans le bonapartisme napoléonien ou dans l’hitlérisme. Ainsi que dans l’impérialisme économique de l’Angleterre victorienne ou des États-Unis après 1945.
Mon option est également “impériale”. Mais il faut s’entendre sur le mot. Les termes “imperium”, “empire”, “impérial” revêtent dans le langage quotidien des acceptions très différentes et parfois contradictoires. Je tiens tout de suite à dire que, pour moi, le terme “empire” ne signifie nullement ce mixte de militarisme et d’idéologie conquérante que l’on trouve dans les phases décadentes de la République romaine et dans le césarisme qui les a suivies, dans l’empire hellénistique d’Alexandre, dans le bonapartisme napoléonien ou dans l’hitlérisme. Ainsi que dans l’impérialisme économique de l’Angleterre victorienne ou des États-Unis après 1945.
Pour moi, l’empire idéal est un espace vaste et multiethnique/multiculturel, de dimensions continentales (p. ex. l’Europe), où règne, en droit constitutionnel, le principe de subsidiarité, donnant à chaque entité territoriale, à chaque communauté linguistique ou ethnique, à chaque classe sociale ou corps de métier, à chaque strate organisée de la société (ordre des médecins, des architectes, des pharmaciens, etc., universités), la liberté de s’auto-administrer en toute autonomie, sans subir des interventions de l’instance hiérarchique la plus élevée ou d’une instance établie dans une capitale lointaine.
La subsidiarité valorise la proximité et l’identité des gouvernants et des gouvernés. La théorie de la subsidiarité a été énoncée par des auteurs comme Althusius, Gierke, Riehl, etc. (cf. NdSE n°17). La théorie de la subsidiarité est une option politique très présente dans l’espace géographique de l’Europe catholique et baroque (de la Flandre à la Bavière, l’Italie du Nord, la Hongrie, l’Autriche et la Croatie). Elle est un héritage du Saint-Empire médiéval et baroque.
Deux difficultés surgissent quand on manipule les notions d’empire et de subsidiarité dans l’orbite des nouvelles droites francophones.
Premièrement, Paris et la France ne font pas partie des espaces catholiques et baroques que je viens de mentionner. L’idée d’un empire bienveillant, garantissant le rapprochement systématique des gouvernants et des gouvernés, y est étrangère et y rencontre la plupart du temps une incompréhension inquiétante, bien que de très brillants universitaires français aient abordé avec brio cette question (Alexandre Marc, Guy Héraud, Chantal Millon-Delsol, Stéphane Pierré-Caps, etc. cf. NdSE n°17 & n°29). Ces auteurs constituent pour nous des références essentielles.
En dépit de ses efforts méritoires, de Benoist n’a pas pu dissiper l’ambiguïté existant entre la notion impériale, romaine et germanique du Saint-Empire et la notion militariste et bonapartiste dominante en France. C’est une ambiguité et une contradiction de plus dans la ND française. Alain de Benoist a toujours vivement regretté le désintérêt en France pour cette notion bienveillante de l’empire, mais a écarté de son entourage tous les hommes qui la défendaient pour s’entourer de personnages bizarres qui ne comprenaient strictement rien du tout à cette vision impériale, pluraliste et plastique de la politique ou qui s’y opposait carrément avec une rage et une obstination féroces (Philippe de Saint-Robert).
En Belgique, où la logique fédéraliste travaille le monde politique depuis des décennies, la logique de la subsidiarité et de la représentation de la societas civilis dans tous ses aspects (syndicats, mutuelles, associations professionnelles) doit présider toute réorientation idéologique. La logique de la subsidiarité et du fédéralisme sont présentes, bien que de façon incohérente et désordonnée, dans la culture politique et dans les réflexes populaires : elles doivent déboucher sur un corpus théorique cohérent puis sur une pratique politique cohérente, appelée à corriger les effets pervers et les dysfonctionnements qui rendent problématique la bonne marche de notre société (fédéralisme incomplet, survivances de structures incompatibles avec un fédéralisme cohérent, emprise des partis sur les corps intermédiaires de la société, surplombage des décisions par les états-majors des partis, dérives mafieuses de la partitocratie, verzuiling- pillarisation, etc.).
Dans le contexte belge, flamand comme wallon, ainsi que dans tous les contextes issus du Saint-Empire, la reprise mécanique, pure et simple du débat français est impossible : l’égalitarisme-nivelleur a fait moins de ravage en Belgique (et dans le reste du Saint-Empire) qu’en France, les différences qui innervent la société ont subsisté et se sont organisées, hélas le plus souvent selon des schémas inopportuns. Cette organisation des corps intermédaires est une bonne chose en soi : ce qu’il faut corriger, c’est leurs vices de fonctionnement. Telle doit être la tâche politique majeure. La notion d’égalité des pairs (et tous les citoyens sont pairs devant le droit et devant leurs droits et leurs devoirs constitutionnels) ne saurait être battue en brèche par un discours purement idéologique, où l’on absolutise l’attitude anti-égalitaire, jusqu’à l’absurde.
Deuxièmement, affirmer l’idée impériale contre les autres modèles de constitutions ou d’États implique un travail au niveau du droit. Une option politique de ce type implique de proposer des modèles susceptibles de fonctionner dans le consensus et sans heurts. De tels modèles existent forcément dans la réalité ou ont existé dans l’histoire, car proposer des modèles inexistants ou purement construits participerait d’une démarche utopique. Il n’y a nulle trace d’un tel travail dans l’histoire de la “nouvelle droite” parisienne. Une des raisons de la rupture entre le GRECE — instance qui a incarné les premières phases de l’existence de la ND en France — et “Synergies Européennes” — qui entend proposer des modèles cohérents pour tous les pays d’Europe à l’heure de l’unification européenne — réside précisément dans l’absence de modélisations concrétisables de la part du GRECE, où ces matières ont été systématiquement délaissées au profit de nébuleux engouements esthétiques sans grande consistance. À terme, l’UE devra à l’évidence se doter d’une constitution cohérente reposant sur les principes de droit qui régissent
- a) la confédération helvétique,
- b) les constitutions fédérales allemandes, autrichiennes et belges,
- c) les structures de représentation des minorités ethniques (Danois au Schleswig, Sorabes en Lusace, Slovènes en Carinthie, Allemands en Wallonie orientale, etc.), qui devront être généralisées dans toute l’Europe,
- d) la conception espagnole d’un État asymétrique de communautés autonomes,
- e) les principes théoriques qui se profilent derrière la devolution britannique (Écosse, Pays de Galles),
- f) les recherches des fédéralistes européens (Marc, Héraud, MacDougall, Peeters, etc.), que ceux-ci se soient situés à droite ou à gauche sur l’échiquier politique (nous avons le souci de mêler étroitement les applications traditionnelles du principe de subsidiarité et les projets militants et prospectifs du filon proudhonien de la gauche européenne).
Certes, l’exposé de ces doctrines juridiques et constitutionnelles ne suscite pas les enthousiasmes du grand public. Néanmoins, on ne peut pas faire l’impasse sur la question du droit constitutionnel de la future Europe, quand on prétend étudier les ressorts de la civilisation européenne dans le but de la sauver d’un certain naufrage. Je pense qu’il faut marteler et répéter à intervalles réguliers les argumentaires fédéralistes et subsidiaristes et montrer l’excellence des modèles constitutionnels que je viens de mentionner par rapport à ceux qui ont cru bon de se débarrasser des “organismes symbiotiques” et des “corps intermédaires” (cf. Bodin) de la societas civilis (Althusius ; cf. NdSE n°17) pour construire fébrilement une version ou une autre de la “Cité géométrique” (Gusdorf). Au seuil du IIIe millénaire, le retour à des formes d’organismes symbiotiques, respectueux des mille et une possibilités de l’homme, n’est possible que par une généralisation des modèles fédéralistes, qui rapprochent les gouvernants des gouvernés.
Le discours un peu vague sur la “société civile”, que l’on entend depuis quatre ou cinq ans en France, restera vague et confus s’il n’est pas étayé par un projet fédéraliste. Il n’y a pas d’organisation cohérente et consensuelle de la société civile sans l’adoption d’un modèle fédéral, si possible basé sur des traditions locales ou tiré d’une continuité précise, à la fois juridique et historique (droits coutumiers locaux, formes historiques de représentation, etc.). On ne peut pas, d’un côté, réclamer la défense de la société civile, et plaider de l’autre pour le maintien d’un modèle jacobin ou géométrique de l’État. Une telle démarche est généralement une escroquerie de la gauche.
Mais on ne peut pas davantage parler des régionalismes en limitant ceux-ci à leurs dimensions culturelles et esthétiques (ou en jouant aux “transgresseurs” et en n’applaudissant que les seules violences civiles ou terroristes des zones à risques en Europe) ou ne suggérant aucun modèle juridique qui permette de sauver globalement (politiquement, économiquement, culturellement, etc.) les différences qui composent et innervent l’Europe.
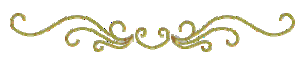
 Discours inaugural de Maître Jure Vujic, secrétaire politique du Mouvement “Minerve” correspondant de “Synergies Européennes” en Croatie
Discours inaugural de Maître Jure Vujic, secrétaire politique du Mouvement “Minerve” correspondant de “Synergies Européennes” en CroatieL'Empire est avant tout une essence spirituelle, une sublime nuance ancrée dans l'honneur et qui s'affirme dans le style et l'allure. Il est le kaléidoscope de nos facultés oniriques et l'expression de nos potentialités virtuelles. L'idée d'Empire implique une réintégration ontologique pour chaque individu, des valeurs aristocratiques qui furent l'épine dorsale de l'histoire.
L'essence impériale invite à la réconciliation avec soi-même, aux retrouvailles avec son fond originel. C'est pourquoi il conviendra pour chacun de nous d'expurger les résidus d'une éducation prophylactique, pour libérer et accroître son propre champ de vision et se projeter hors de soi-même vers l'horizon infini. La libération de nos âmes passera par le rejet inconditionnel de toute forme de cinétisme ambiant pour adopter les dynamiques constantes, charnelles et naturelles de notre dualité intrinsèque, faite de corps et d'esprit, d'Être et de matière. Ainsi restituer l'intégralité de l'être impérial pour l'immerger dans nos âmes supposera de mettre en mouvement en chaque lieu, à chaque instant, ses attributs sacrés qui sont capacité d'appréhension, d'intégration, de captation, d'amour, d'ouverture et de conquête. L'impérialité consiste à dépasser les crispations nationalitaires étriquées et à refuser de se plier à toutes les formes d'idolâtries contemporaines, pour rétablir et reconstruire comme les arcs-boutants d'une cathédrale, le lien d'allégeance impérial, seul à même de consumer les contradictions inhérentes à la nature humaine, et de fédérer organiquement des ethnies, des peuples et des nations différents de par leurs coutumes, leur histoire et leur religion. L'Empire se fera le réceptacle des disparités naturelles et le garant de leur émancipation. Au-delà du constructivisme des idéologies abstraites qui réduisirent les peuples européens durant des siècles à la servilité, l'Empire nous invite à renouer avec le langage tellurique du sol, des vastes steppes, des étendues de forêts vierges, des contrées désertiques, des glacis immaculés et de recourir au ressort humain de l'inaccessible, de la polarité et de l'absolu, seuls antidotes empêchant la sclérose de l'esprit humain.
La pensée impériale est une ligne intérieure qui relie les perspectives obliques des âmes vagabondes vers la centralité. Elle est cette muraille inaccessible à l'existence désincarnée. Elle est en quelque sorte l'incarnation du Verbe éternel. L'Empire est cette puissance motrice qui comble les espaces, il est cet hôte indésirable qui surgit de nulle part, à l'éminente dignité de l'éphémère et qui, pourtant, comme un fluide d'évocation, déploie sa force dans la permanence. L'Empire s'insurge contre la barbarie moderne et odieuse de l'argent, pour rappeler à l'ordre la sainte barbarie de nos ancêtres, fille aînée des déterminismes naturels et historiques. Penser en termes de puissance et d'expansion est le propre de l'impérialité qui nous renvoie sans cesse à l'histoire universelle. La volonté de puissance est à elle seule volonté impériale. Élaborer et promouvoir une grande politique impériale ne pourra se concevoir que sur la base de grands espaces.
L'Europe désarmée, livrée aux convoitises et aux pillages des thalassocraties anglo-saxonnes, repue de richesses perfides et aliénantes, demeure dans l'ombre d'elle-même, dans les ténèbres, dans un monde chtonien qu'elle s'est aménagé au cœur d'une jungle fébrile de consumérisme. L'Europe est dépossédée de son âme, elle reste atteinte d'une calvitie impressionnante, d'une surface d'ivoire, qu'elle ne reconquèrera qu'au prix d'une réappropriation de l'idée de puissance et d'impérialité. L'Europe avance à vitesse d'escargot sur les parois échancrées d'un monde aiguisé où règne la furie collective. Elle retrouvera la liberté de disposer de ses ressources et de l'ensemble de ses forces par la construction d'un bloc continental eurasiatique fédérant les diverses nations européennes constituées, débouchant symétriquement sur la Mer du Nord, la Mer Baltique, la Méditerranée et l'Océan Indien. Pour ce faire, il conviendra de s'affranchir des coquilles hexagonales pusillanimes et étroites et de briser les carcans des États-Nations qui asphyxient les communautés naturelles, et nient les potentialités individuelles.
Aspirer à la puissance, c'est redonner aux peuples européens leur place dans l'histoire universelle. Puissance et domination s'excluent, la première impliquant une responsabilité, un sens du devoir inné et une adhésion volontaire, la seconde se fondant sur la simple force coercitive, vouée à une chute certaine. L'espace déterminant le destin des peuples dans leur étendue, leurs ressources et leur configuration, interpelle leur vocation historique dans le monde. Jordis von Lohausen écrivit que le propre destin des peuples historiques est leur capacité à accéder à la puissance. Les peuples européens auront-ils ce courage? Nul ne le sait. Mais l'avenir appartient à cette nation européenne-Piémont qui aura la volonté politique de trouver prise sur un sol salvateur, de fonder la “Heimat” pour les générations futures et repousser toujours plus loin ses Limes, ses fronts expansifs et ses têtes de pont défensives, pour réaliser cette unité de destin dans l'universel. Alors renaîtra de ses cendres comme le Phénix mythique, l'Empire régénéré, florilège de notre conversion spirituelle. « C'est lui qui rompt la chaîne sur les ruines de l'Ordre ; il chasse au bercail les égarés qu'il fouette vers le droit de toujours où Grand redevient Grand, Maître redevient Maître et la Règle, la Règle ; fixant l'Emblème vrai au drapeau de son peuple, sous l'orage, aux signaux d'honneur de l'aube, il guide la troupe de ses preux vers les œuvres du jour, du jour lucide, où se bâtit le Nouveau Règne » (Stefan George).
► Jure VUJIC.

Nation et nationalisme, Empire et impérialisme, dévolution et grand espace
 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et camarades,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et camarades,
Le thème de notre colloque d'aujourd'hui est à la fois intemporel et actuel.
Actuel parce que le monde est toujours, envers et contre les espoirs des utopistes cosmopolites, un pluriversum de nations, et parce que nous replongerons tout à l'heure à pieds joints dans l'actualité internationale, marquée par le conflit, donc par la pluralité antagonistes des valeurs et des faits nationaux.
Intemporel parce que nous abordons des questions que toutes les générations, les unes après les autres, remettent inlassablement sur le tapis. En traitant de la nation et du nationalisme, de l'Empire et de l'impérialisme, nous touchons aux questions essentielles du politique, donc aux questions essentielles de l'être-homme, puisqu'Aristote déjà définissait l'homme comme un zoon politikon, comme un être ancré dans une polis, dans une cité, dans une nation. Ancrage nécessaire, ancrage incontournable mais ancrage risqué car précisément il accorde tout à la fois profondeur, sens de la durée et équilibre mais provoque aussi l'enfermement, l'auto-satisfaction, l'installation, la stérilité.
Devant le retour en Europe de l'Est et de l'Ouest d'un discours se proclamant nationaliste, il est impératif de comprendre ce double visage que peut prendre le nationalisme, de voir en lui cet avantage et ce risque, cette assurance que procure l'enracinement et ce dérapage qui le fait chavirer dans l'enfermement. Quant à la notion d'empire, elle a désigné au Moyen Âge le Reich centre-européen, sorte d'agence qui apaisait les conflits entre les diverses ethnies et les multiples corps qui le composait ; puis elle a désigné, sous Bonaparte, le militarisme qui tentait d'imposer partout en Europe des modèles constitutionnels marqués par l'individualisme bourgeois, qui méconnaissaient les logiques agrégatrices et communautaires des corps de métier, des « républiques villageoises » et des pays charnels ; ensuite, elle a désigné l'impérialisme marchand et thalassocratique de l'Angleterre, qui visait l'exploitation de colonies par des groupes d'actionnaires, refusant le travail parce que, lecteurs de la Bible, ils voyaient en lui une malédiction divine ; leur aisance, leur oisivité, ils la tiraient des spéculations boursières.
Cette confusion sémantique, qui vaut pour le terme « nation » comme pour le terme «empire», il importe que nous la dissipions. Que nous clarifions le débat. C'est notre tâche car, volontairement, nous parions pour le long terme et nous refusons de descendre directement dans l'arène politicienne qui nous force toujours aux pires compromis. Si nous ne redéfinissons pas nous-mêmes les concepts, si nous ne diffusons pas nos redéfinitions par le biais de nos stratégies éditoriales, personne ne le fera à notre place. Et la confusion qui règne aujourd'hui persistera. Elle persistera dans le chaos et de ce chaos rien de cohérent ne sortira.
Commençons par définir la nation, en nous rappelant ce qu'Aristote nous enseignait à propos du zoon politikon ancré dans sa cité. Le politique, qui est l'activité théorique surplombant toutes les autres activités de l'homme en leur conférant un sens, prend toujours et partout son envol au départ d'un lieu qui est destin. À partir de ce lieu se crée une socialité particulière, étayée par des institutions bien adaptées à ce paysage précis, forcément différentes des institutions en vigueur dans d'autres lieux. Nous avons donc affaire à une socialité institutionnalisée qui procure à sa communauté porteuse autonomie et équilibre, lui assure un fonctionnement optimal et un rayonnement maximal dans son environnement. Le rayonnement élargit l'assise de la socialité, crée le peuple, puis la nation. Mais cette nation, produit d'une évolution partie de l'ethnos originel, se diversifie à outrance au cours de l'évolution historique. En bout de course, nous avons toujours affaire à des nations à dimensions multiples, qui se déploient sur un fond historique soumis à tous les aléas du temps. Toute conception valide de la nation passe par une prise en compte de cette multidimensionalité et de ce devenir. Le peuple est donc une diversité sociologique qu'il faut organiser, notamment par le truchement de l'État.
L'État organise un peuple et le hisse au rang de nation. L'État est projet, plan : il est, vis-à-vis de la concrétude nation, comme l'ébauche de l'architecte par rapport au bâtiment construit, comme la forme par rapport à la matière travaillée. Ce qui implique que l'État n'a pas d'objet s'il n'y a pas, au préalable, la concrétude nation. Toutes les idéologies statolâtriques qui prétendent exclure, amoindrir, juguler, réduire la concrétude, la matière qu'est la nation, sont des sottises théoriques. Le peuple précède l'État mais sans la forme État, il ne devient pas nation, il n'est pas organisé et sombre rapidement dans l'inexistence historique, avant de disparaître de la scène de l'histoire. L'État au service de la concrétude peuple, de la populité génératrice d'institutions spécifiques, n'est pas un concept abstrait mais un concept nécessaire, un concept qui est projet et plan, un projet grâce auquel les élites du peuple affrontent les nécessités vitales. L'État — avec majuscule — organise la totalité du peuple comme l'état — sans majuscule — organise telle ou telle strate de la société et lui confère du sens.
Mais il est des États qui ne sont pas a priori au service du peuple : Dans son célèbre ouvrage sur la définition du peuple (Das eigentliche Volk, 1932), Max Hildebert Boehm nous a parlé des approches monistes du concept État, des approches monistes qui refusent de tenir compte de l'autonomie nécessaires des sphères sociales. Ces États capotent rapidement dans l'abstraction et la coercition stérile parce qu'ils refusent de se ressourcer en permanence dans la socialité populaire, dans la « populité » (Volkheit), de se moduler sur les nécessités rencontrées par les corps sociaux. Cette forme d'État coupée du peuple apparaît vers la fin du Moyen Âge. Elle provoque une rupture catastrophique. L'État se renforce et la socialité se recroqueville. L'État veut se hisser au-dessus du temps et de l'espace. Le projet d'État absolu s'accompagne d'une contestation qui ébauche des utopies, situées généralement sur des îles, elles aussi en dehors du temps et de l'espace. Dès que l'État s'isole de la socialité, il ne l'organise plus, il ne la met plus en forme. Il réprime des autonomies et s'appauvrit du même coup. Quand éclate la révolution, comme en France en 1789, nous n'assistons pas à un retour aux autonomies sociales dynamisantes mais à un simple changement de personnel à la direction de la machine État. Les parvenus remplacent les faisandés au gouvernail du bateau.
C'est à ce moment historique-là, quand la nation concrète a périclité, que nous voyons émerger le nationalisme pervers que nous dénonçons. Le discours des parvenus est nationaliste mais leur but n'est pas la sauvegarde ou la restauration de la nation et de ses autonomies nécessaires, de ses autonomies qui lui permettent de rayonner et de briller de mille feux, de ses autonomies qui ont une dynamique propre qu'aucun décret ne peut régenter sans la meurtrir dangereusement. L'objectif du pouvoir est désormais de faire triompher une idéologie qui refuse de reconnaître les limites spatio-temporelles inhérentes à tout fait de monde, donc à toute nation. Une nation est par définition limitée à un cadre précis. Vouloir agir en dehors de ce cadre est une prétention vouée à l'échec ou génératrice de chaos et d'horreurs, de guerres interminables, de guerre civile universelle.
Les révolutionnaires français se sont servis de la nation française pour faire triompher les préceptes de l'idéologie des Lumières. Ce fut l'échec. Les nationaux-socialistes allemands se sont servis de la nation allemande pour faire triompher l'idéal racial nordiciste, alors que les individus de race nordique sont éparpillés sur l'ensemble de la planète et ne constituent donc pas une concrétude pratique car toute concrétude pratique, organisable, est concentrée sur un espace restreint. Les ultramontains espagnols se sont servis des peuples ibériques pour faire triompher les actions du Vatican sur la planète. Les banquiers britanniques se sont servis des énergies des peuples anglais, écossais, gallois et irlandais pour faire triompher le libre-échangisme et permettre aux boursicotiers de vivre sans travailler et sans agir concrètement en s'abstrayant de toutes les limites propres aux choses de ce monde. Les jésuites polonais ont utilisé les énergies de leur peuple pour faire triompher un messianisme qui servait les desseins de l'Eglise.
Ce dérapage de l'étatisme, puis du nationalisme qui est un étatisme au service d'une abstraction philosophique, d'une philosophade désincarnée, a conduit aux affrontements et aux horreurs de la guerre de Crimée, de la guerre de 1870, de la guerre des Boers, des guerres balkaniques et de la guerre de 1914. Résultat qui condamne les nationalismes qui n'ont pas organisé leur peuple au plein sens du terme et n'ont fait que les mobiliser pour des chimères idéologiques ou des aventures colonialistes. Inversément, cet échec des nationalismes du discours et non de l'action concrète réhabilite les idéaux nationaux qui ont choisi l'auto-centrage, qui ont choisi de peaufiner une socialité adaptée à son cadre spatio-temporel, qui ont privilégié la rentabilisation de ce cadre en refusant le recours facile au lointain qu'était le colonialisme.
Pour sortir de l'impasse où nous ont conduit les folies nationalistes bellogènes, il faut opérer à la fois un retour aux socialités spatio-temporellement déterminées et il faut penser un englobant plus vaste, un conteneur plus spacieux de socialités diverses.
Le Saint-Empire du Moyen Âge a été un conteneur de ce type. En langage moderne, on peut dire qu'il a été, avant son déclin, fédératif et agrégateur, qu'il a empêché que des corps étatiques fermés ne s'installent au cœur de notre continent. La disparition de cette instance politique et sacrée à la suite de la fatale calamité des guerres de religion a provoqué le chaos en Europe, a éclaté l'œkoumène européen médiéval. Sa restauration est donc un postulat de la raison pratique.
À la suite des discours nationalistes fallacieux, il faut réorganiser le système des États européens en évitant justement que les peuples soient mobilisés pour des projets utopiques irréalisables, qu'ils soient isolés du contexte continental pour être mieux préparés par leurs fausses élites aux affrontements avec leurs voisins. Il faut donc réorganiser le continent en ramenant les peuples à leurs justes mesures. Ce retour des limites incontournables doit s'accompagner d'une déconstruction des enfermements stato-nationaux, où les peuples ont été précisément enfermés pour y être éduqués selon les principes de telle ou telle chimère universaliste.
Le retour d'une instance comparable au Saint-Empire mais répondant aux impératifs de notre siècle est un vieux souhait. Constantin Frantz, le célèbre philosophe et politologue allemand du XIXe siècle, parlait d'une «communauté des peuples du couchant», organisée selon un fédéralisme agrégateur, reposant sur des principes diamétralement différent de ceux de la révolution française, destructrice des tissus sociaux concrets par excès de libéralisme économique et de militarisme bonapartiste.
Guillaume de Molinari, économiste français, réclamait à la fin du XIXe siècle la construction d'un « marché commun » incluant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Hollande, la Belgique, le Danemark et la Suisse. Il a soumis ses projets aux autorités françaises et à Bismarck. Lujo Brentano envisage à la même époque une union économique entre l'Autriche-Hongrie et les nouveaux États balkaniques. L'industriel autrichien Alexander von Peez, par un projet d'unification organique de l'Europe, entend répondre aux projets américains de construire l'Union panaméricaine, qui évincera l'Europe d'Amérique latine et amorcera un processus d'« américanisation universelle ».
Gustav Schmoller affirme que toute politique économique européenne sainement comprise ne peut en aucun cas s'enliser dans les aventures coloniales, qui dispersent les énergies, mais doit se replier sur sa base continentale et procéder à grande échelle à une « colonisation intérieure ». Jäckh et Rohrbach théorisent enfin un projet de grande envergure : l'organisation économique de l'Europe selon un axe diagonal Mer du Nord/Golfe Persique. L'objectif de la théorie et de la pratique économiques devait être, pour ces deux économistes des vingt premières années de notre siècle, d'organiser cette ligne, partant de l'embouchure du Rhin à Rotterdam pour s'élancer, via le Main et le Danube, vers la Mer Noire et le Bosphore, puis, par chemin de fer, à travers l'Anatolie et la Syrie, la Mésopotamie et le villayat de Bassorah, aboutir au Golfe Persique. Vous le constatez, on retombe à pieds joints dans l'actualité. Mais, ce projet de Jäckh et de Rohrbach, qu'a-t-il à voir avec le thème de notre colloque ? Que nous enseigne-t-il quant au nationalisme ou à l'impérialisme ?
Beaucoup de choses. En élaborant leurs projets d'organisation continentale en zones germanique, balkanique et turque, les puissances centrales de 1914 réévaluaient le rôle de l'État agrégateur et annonçaient, par la voix du philosophe Meinecke, que l'ère des spéculations politiques racisantes était terminée et qu'il convenait désormais de faire la synthèse entre le cosmopolitisme du XVIIIe siècle et le nationalisme du XIXe siècle dans une nouvelle forme d'État qui serait simultanément supranationale et attentive aux ethnies qu'elle englobe. L'Entente, porteuse des idéaux progressistes de l'ère des Lumières, veut, elle, refaire la carte de l'Europe sur base des nationalités, ce qui a fait surgir, après Versailles, une « zone critique » entre les frontières linguistiques allemande et russe.
Nous découvrons là la clef du problème qui nous préoccupe aujourd'hui : les puissances porteuses des idéaux des Lumières sont précisément celles qui ont encouragé l'apparition de petits États nationaux fermés sur eux-mêmes, agressifs et jaloux de leurs prérogatives. Universalisme et petit-nationalisme marchent la main dans la main. Pourquoi ? Parce que l'entité politique impérialiste par excellence, l'Angleterre, a intérêt à fragmenter la diagonale qui s'élance de Rotterdam aux plages du Koweit. En fragmentant cette diagonale, l'Angleterre et les États-Unis de Wilson brisent la synergie grande-continentale européenne et ottomane de Vienne au Bosphore et de la frontière turque aux rives du Golfe Persique.
Or depuis la chute de Ceaucescu en décembre 1989, tout le cours du Danube est libre, déverrouillé. En 1992, les autorités allemandes inaugureront enfin le canal Main-Danube, permettant aux pousseurs d'emmener leurs cargaisons lourdes de Constantza, port roumain de la Mer Noire, à Rotterdam. Un oléoduc suivant le même tracé va permettre d'acheminer du pétrole irakien jusqu'au cœur industriel de la vieille Europe. Voilà les raisons géopolitiques réelles de la guerre déclenchée par Bush en janvier dernier. Car voici ce que se sont très probablement dit les stratèges des hautes sphères de Washington :
« Si l'Europe est reconstituée dans son axe central Rhin-Main-Danube, elle aura très bientôt la possibilité de reprendre pied en Turquie, où la présence américaine s'avèrera de moins en moins nécessaire vu la déliquescence du bloc soviétique et les troubles qui secouent le Caucase ; si l'Europe reprend pied en Turquie, elle reprendra pied en Mésopotamie. Elle organisera l'Irak laïque et bénéficiera de son pétrole. Si l'Irak s'empare du Koweit et le garde, c'est l'Europe qui finira par en tirer profit. La diagonale sera reconstituée non plus seulement de Rotterdam à Constantza mais du Bosphore à Koweit-City. La Turquie, avec l'appui européen, redeviendra avec l'Irak, pôle arabe, la gardienne du bon ordre au Proche-Orient. Les États-Unis, en phase de récession, seront exclus de cette synergie, qui débordera rapidement en URSS, surtout en Ukraine, pays capable de redevenir, avec un petit coup de pouce, un grenier à blé européen auto-suffisant.
Alors, adieu les achats massifs de blé et de céréales aux États-Unis ! Cette synergie débordera jusqu'en Inde et en Indonésie, marchés de 800 millions et de 120 millions d'âmes, pour aboutir en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un grand mouvement d'unification eurasienne verrait le jour, faisant du même coup déchoir les États-Unis, en mauvaise posture financière, au rang d'une puissance de second rang, condamnée au déclin. Les États-Unis ne seraient plus un pôle d'attraction pour les cerveaux du monde et on risquerait bien de voir s'effectuer une migration en sens inverse : les Asiatiques d'Amérique, qui sont les meilleurs étudiants d'Outre-Atlantique, retourneraient au Japon ou en Chine ; les Euro-Américains s'en iraient faire carrière en Allemagne ou en Italie du Nord ou en Suède. Comment éviter cela ? En reprenant à notre compte la vieille stratégie britannique de fragmentation de la diagonale ! Et où faut-il la fragmenter à moindres frais ? En Irak, pays affaibli par sa longue guerre contre l'Iran, pays détenteur de réserves pétrolières utiles à l'Europe ».
La stratégie anglo-américaine de 1919, visant la fragmentation des Balkans et du Proche-Orient arabe et projetant la partition de la Turquie en plusieurs lambeaux, et la stratégie de Bush qui entend diviser l'Irak en trois républiques distinctes et antagonistes, sont rigoureusement de même essence. L'universalisme libéral-capitaliste, avatar des Lumières, instrumentalise le petit-nationalisme de fermeture pour arriver à asseoir son hégémonie.
Au seuil du XXe siècle comme au seuil du XXIe, la necessité d'élargir les horizons politiques aux dimensions continentales ont été et demeurent nécessaires. Au début de notre siècle, l'impératif d'élargissement était dicté par l'économie. Il était quantitatif. Aujourd'hui, il est encore dicté par l'économie et par les techniques de communications mais il est dicté aussi par l'écologie, par la nécessité d'un mieux-vivre. Il est donc aussi qualitatif. L'irruption au cours de la dernière décennie des coopérations interrégionales non seulement dans le cadre de la CEE mais entre des États appartenant à des regroupements différents ou régis par des systèmes socio-économiques antagonistes, ont signifié l'obsolescence des frontières stato-nationales actuelles.
Les énergies irradiées à partir de diverses régions débordent le cadre désormais exigu des États-Nations. Les pays riverains de l'Adriatique et ceux qui forment, derrière la belle ville de Trieste, leur hinterland traditionnel, ont organisé de concert les synergies qu'ils suscitent. En effet, l'Italie, au nom de la structure stato-nationale née par la double action de Cavour et de Garibaldi, doit-elle renoncé aux possibles qu'avaient jadis concrétisé l'élan vénitien vers la Méditerranée orientale ? La Sarre, la Lorraine et le Luxembourg coopèrent à l'échelon régional. Demain, l'axe Barcelone-Marseille-Turin-Milan fédèrera les énergies des Catalans, des Languedociens, des Provençaux, des Piémontais et des Lombards, en dépit des derniers nostalgiques qui veulent tout régenter au départ de Madrid, Paris ou Rome. Ces coopérations interrégionales sont inéluctables.
Sur le plan de la politologie, Carl Schmitt nous a expliqué que le Grand Espace, la dimension continentale, allait devenir l'instance qui remplacera l'« ordre concret » établi par l'État depuis Philippe le Bel, Philippe II d'Espagne, François I, Richelieu ou Louis XIV. Ce remplacement est inévitable après les gigantesques mutations de l'ère techno-industrielle. Schmitt constate que l'économie a changé d'échelle et que dans le cadre de l'État, figure politique de la modernité, les explosions synergétiques vers la puissance ou la créativité ne sont plus possibles. Le maintien de l'État, de l'État-Nation replié sur lui-même, vidé de l'intérieur par tout un éventail de tiraillements de nature polycratique, ne permet plus une mobilisation holarchique du peuple qu'il n'administre plus que comme un appareil purement instrumental. Sa décadence et son exigüité appellent une autre dimension, non obsolète celle-là : celle du Grand Espace.
Si le Grand Espace est la seule figure viable de la post-modernité, c'est parce qu'on ne peut plus se contenter de l'horizon régional de la patrie charnelle ou de l'horizon supra-régional de l'État-Nation moderne. L'horizon de l'avenir est continental mais diversifié. Pour pouvoir survivre, le Grand Espace doit être innervé par plusieurs logiques de fonctionnement, pensées simultanément, et être animé par plusieurs stratégies vitales concomitantes. Cette pluralité, qui n'exclut nullement la conflictualité, l'agonalité, est précisément ce que veulent mettre en exergue les différentes écoles de la post-modernité.
Cette post-modernité du Grand Espace, animé par une pluralité de logiques de fonctionnement, condamne du même coup les monologiques du passé moderne, les monologiques de ce passatisme qu'est devenue la modernité. Mais elle condamne aussi la logique homogénéisante de l'impérialisme commercial et gangstériste des États-Unis et la monologique frileuse des gardiens du vieil ordre stato-national.
Pour organiser le Grand Espace, de Rotterdam à Constantza ou le long de toute la diagonale qui traverse l'Europe et le Proche-Orient de la Mer du Nord au Koweit, il faut au moins une double logique. D'abord une logique dont un volet réclame la dévolution, le recentrage des énergies populaires européennes sur des territoires plus réduits, parce que ces territoires ne seront alors plus contraints de ne dialoguer qu'avec une seule capitale mais auront la possibilité de multiplier leurs relations interrégionales. Ensuite une logique qui vise l'addition maximale d'énergies en Europe, sur le pourtour de la Méditerranée et au Proche-Orient.
L'adhésion à la nation, en tant qu'ethnie, demeure possible. Le dépassement de cet horizon restreint aussi, dans des limites élargies, celles du Grand Espace. L'ennemi est désigné : il a deux visages selon les circonstances ; il est tantôt universaliste/mondialiste, tantôt petit-nationaliste. Il est toujours l'ennemi de l'instance que Carl Schmitt appelait de ses vœux.
Que faire ? Eh bien, il faut :
- Encourager les logiques de dévolution au sein des États-Nations
- Accepter la pluralité des modes d'organisation sociale en Europe et refuser la mise au pas généralisée que veut nous imposer l'Europe de 1993
- Recomposer la diagonale brisée par les Américains
- Organiser nos sociétés de façons à ce que nos énergies et nos capitaux soient toujours auto-centrés, à quelqu'échelon du territoire que ce soit
- Poursuivre la lutte sur le terrain métapolitique en s'attaquant aux logiques de la désincarnation, avatars de l'idéologie des Lumières.
Pour conclure, je lance mon appel traditionnel aux cerveaux hardis et audacieux, à ceux qui se sentent capables de s'arracher aux torpeurs de la soft-idéologie, aux séductions des pensées abstraites qui méconnaissent limites et enracinements. À tous ceux-là, notre mouvement de pensée ne demande qu'une chose : travailler à la diffusion de toutes les idées qui transgressent les enfermements intellectuels, le prêt-à-penser.
Je vous remercie.
► Robert Steuckers, Communication au XXIVe Colloque du GRECE, Paris, le 24 mars 1991.

L'empire d’Europe : la problématique Imperiale et la construction Européenne

« L'Europe aspire à l'Empire » (Jean-Louis Feuerbach)
PROLÉGOMÈNES
Quiconque connaît l'histoire, sait que les empires ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de l'humanité. Entre 50 et 200 ap. JC, en effet, quatre empires englobaient l'ensemble du monde civilisé : Rome, les Parthes Arsacides, le Kouchan et l'État des Han orientaux formaient un chapelet ininterrompu de la Grande-Bretagne à la Mer de Chine, autour et autour duquel ne vivaient que des barbares.
Ainsi un historien tel que Toynbee, dans sa Grande Aventure de l'Humanité, voulait montrer comment nous sommes peu à peu passés d'une ère des civilisations locales (qui étaient le plus souvent des empires) à un ensemble universel, comment l'œkoumène a fini par recouvrir la terre entière. Il présente d'abord les premières civilisations, isolées et presque sans contact entre elles. Ensuite, il montre comment les empires, en expansion, se touchèrent et donc s'influencèrent mutuellement. Le processus prit de l'ampleur jusqu'aux Temps Modernes au cours desquels toutes les civilisations furent reliées. L'Empire fut donc le principal agent de diffusion des civilisations (1).
Le sociologue et historien Wallerstein, pour sa part, oppose, sur un autre plan, les empires, unifiés politiquement, aux "économies mondes" qui surplombent un ensemble d'États de forces diverses, telle la Méditerranée du VIIe au IIe siècle av. JC avant son unification par Rome ou celui, postérieur mais qui couvrait le même espace, auquel Fernand Braudel consacra son maître ouvrage (XIVe-XVIe ap. JC). Avant les Temps Modernes, la plupart des économies mondes se muèrent soit en empires, soit furent phagocytées par l'un d'eux. Au contraire, le capitalisme, aboutissement des économies-mondes, se maintient depuis 5 siècles parce qu'il s'étend sur la presque totalité du globe : il « se fonde sur la prise en charge constante des pertes économiques par des entités politiques, tandis que le profit économique est distribué à des intérêts "privés" » (2). Le capitalisme surplombe tous les empires existants. Même l'URSS, qui tentait de s'y soustraire, devait en tenir compte. Il en concluait que seule l'instauration d'un empire universel socialiste pourrait mettre fin au capitalisme.
Le terme d'empire descend du mot latin imperium (l'autorité de commandement militaire, fût-ce par coercition que complétait la potestas, l'autorité par la force des valeurs). L'empereur cumulait un certain nombre de pouvoirs auparavant exercés par différents magistrats (les consuls, censeurs, tribuns, et le grand pontife) et octroyés à titre viager. Il était proclamé imperator par les soldats (le peuple en armes). Contrairement à l'imperium proconsulaire, celui de l'empereur était illimité dans le temps et l'espace et n'était subordonné à nul autre. Son pouvoir s'appuyait sur sa clientèle, sa fortune personnelle, le serment d'allégeance et son auctoritas (sa prééminence morale) (3).
Par la suite, lorsque l'hégémonie européenne s'étendit sur l'ensemble du globe, nous attribuâmes le nom d'empire à un certain nombre d'États, contemporains ou passés, qui présentaient des ressemblances avec ce que nous avions connu, à la manière des Grecs qui donnèrent aux dieux étrangers des noms issus de leur panthéon, quitte à commettre quelques imprécisions. Dès lors, certains auteurs distinguent deux sortes d'empires : la lignée européenne qui descend du principat et les "étrangers". En fait, on pourrait également concevoir une lignée chinoise, une lignée des empires mésopotamiens etc...
Mais, délaissant les formes singulières, nous aborderons la figure de l'Empire en tant qu'archétype qui apparaît sans cesse sous des aspects renouvelés depuis l'aube de l'Histoire (4).
TYPOLOGIE
Comme l'historien du droit John Gilissen, nous distinguons deux acceptions du terme Empire : stricto sensu, il s'agit d'une forme de gouvernement dominé par la figure d'un autocrate arborant le titre d'empereur ou un autre équivalent (pharaon, grand khan, roi des rois...) ; lato sensu, l'Empire désigne métaphoriquement tout état vaste et puissant quel que soit son mode de gouvernement. Comme nombre d'empires stricto sensu n'ont pas mérité en permanence au cours de leur durée formelle le titre de grande puissance, il convient de diviser ces États en 3 catégories :
• les empires lato sensu ou grandes puissances ;
• les empires stricto sensu qui furent à un moment ou à un autre de leur histoire des grandes puissances ;
• les empires stricto sensu qui demeurèrent ou devinrent des États petits ou moyens.
En conséquence, nous considérerons par ex. que la Rome républicaine entra dans la première catégorie après la seconde guerre punique et passa dans la deuxième sous Auguste. Quant à l'empire d'Occident finissant, il appartenait au troisième groupe.
À la différence entre empires stricto sensu et lato sensu se surimpose un classement par types dont le nombre et la nature des catégories varient d'un auteur à l'autre. Quoique la typologie des empires nous apparaisse secondaire, nous nous sommes livrés à un jeu logique. Pour notre part, nous procédons par une série d'antinomies : nous opposons les empires terriens ou continentaux aux empires maritimes ; les empires centralisés aux plus lâches ; les empires de longue durée, souvent liés à une dynastie ou une à une succession de dynasties ; aux empires éphémères qui sont le plus souvent l'œuvre de grands conquérants. Il en résulte 8 associations possibles qui dessinent assez précisément les caractéristiques des différentes sortes d'empires :
• 1) terrestre/centralisé/éphémère. Ex. : Napoléon Ier
• 2) terrestre/centralisé/durable. Ex. : Rome du Bas-Empire
• 3) terrestre/décentralisé/éphémère. Ex. : de conquête
• 4) terrestre/décentralisé/durable. Ex. : l'Akkad de Sargon (- 2340), la Rome du Haut Empire
• 5) maritime/centralisé/éphémère. Ex. : le Japon au XXe siècle
• 6) maritime/centralisé/durable. Ex. : Athènes (- 479-404)
• 7) maritime/décentralisé/éphémère. Ex. : empire de Knut le Grand (1013-1033)
• 8) maritime/décentralisé/durable. Ex. : empires espagnols et portugais
Pour plus de précision, nous adjoignons aux classes précédentes 2 sous-catégories. Parmi les empires de conquête, il nous semble qu'il faut distinguer ceux qui furent fondés par des peuples nomades. De même, nous séparerons les empires féodaux, comme celui des Plantagenet, des "terrestres décentralisés durables". Ce classement n'efface pas l'idiosyncrasie des empires, mais il permet d'entrevoir au travers de brumes foisonnantes de l'événementiel les contours imprécis d'une figure pérenne.
NAISSANCE
Les empires se forment le plus souvent sur le modèle fantasmé d'un de leurs prédécesseurs. L'archétype se reproduit dans l'histoire selon le mouvement que Spengler nommait la pseudomorphose. Pour les Européens, la notion d'Empire évoque nécessairement le principat romain. Du principat découle, comme une rivière jaillissant des montagnes, un cours ponctué d'empires (romain, byzantin, carolingien, SERNG, les deux empires bonapartistes, les tsars ; on pourrait également reprendre comme exemple la succession des empires chinois) (5).
L'impérialisme est à la fois un caractère permanent de l'empire et la condition nécessaire de sa naissance. Il se manifeste sous deux formes. La plus courante, et de loin, est la puissance martiale, brutale. Un peuple impose sa domination à ses voisins. Mais, d'autres empires se sont formés plus pacifiquement par une sorte de synoecisme, tel celui de Charles Quint qui est plus le résultat d'une longue théorie d'alliances matrimoniales que de conquêtes.
Évidemment, la volonté de domination ne se réalise pas sans une supériorité, qu'elle soit technologique, organisationnelle, démographique, morale ou autre. Mais ces instruments dépendent à leur tour en partie de l'énergie qui les anime. L'homme invente pour asservir ses congénères ou la Nature. Mais si la volonté de puissance ne le dominait pas lui-même, il ne créerait point. Donc, l'impérialisme engendre les moyens de sa propre réalisation.
Même lorsque l'Empire se constitue par association libre, les volontés de puissance et d'extension n'en demeurent pas moins les prémices nécessaires : les hommes se regroupent pour se protéger mais surtout pour dominer. La présence d'un péril favorise également la formation ou le maintien de l'Empire. Les peuples s'allient pour combattre un ennemi commun, mais surtout, il incite les anciens empires à maintenir et renforcer leur cohésion. En désignant son ennemi, qui sera parfois un autre empire, il se définit négativement, il nomme ce qu'il ne désire pas devenir, il refuse que l'autre intervienne dans son domaine. Soulignons que, contrairement au Grossraum schmittien, l'Empire ne se contente pas de refouler les interventions des puissances extérieures : il s'affirme lui-même prédateur !
Souvent le nom de l'Empire est attaché à celui de son fondateur. Il s'agit le plus souvent d'États dont les limites furent taillées à coup d'épées. Leurs noms évoquent de fantastiques mais brèves épopées. De grandes figures émergent aussi de l'histoire des empires qui se sont formés plus lentement ou qui n'étaient pas des monocraties. En effet, pour perdurer, l'Empire doit constituer une élite de gouvernement qui assure la continuité de sa politique.
Les empires sont souvent formés par des peuples qui ont atteint un moment de "puissance biologique". Cette expression quelque peu romantique recouvre et exprime une conjonction extraordinaire et complexe d'éléments qui firent qu'à un moment, durant l'instant d'une génération, un peuple s'est trouvé doué d'une grande force d'expansion. Une partie de ces causes sont objectivables : une forte démographie, une technologie supérieure, des institutions adaptées à la situation... mais l'essentiel est subjectif et indicible : l'énergie, la foi dans la destinée, la conviction d'une supériorité raciale, culturelle ou religieuse. C'est ainsi que l'on vit le petit peuple macédonien conquérir l'immense empire perse ou quelques centaines de conquistadors abattre les nations Incas et Mayas.
Le besoin d'expansion économique apparaît à notre sens secondaire, car il découle de la volonté de dominer dont l'économique n'est qu'un aspect. Ceux qui ne veulent qu'amasser des richesses se détournent de l'Empire et investissent leurs efforts dans l'économie monde. Rappelons néanmoins que les empires continentaux recherchent l'autarcie ou du moins l'indépendance, tandis que les puissances maritimes développent le libre échange. Dans les deux cas, il s'agit néanmoins d'organismes politiques; au contraire, l'économie monde est économique, elle ne vise pas à gouverner mais à profiter.
EMPIRE ET ÉTAT
L'Empire et l'État sont frères mais ne sont pas jumeaux. L'État comme l'Empire établissent une nette distinction entre l'intérieur et l'extérieur, ils délimitent leurs territoires par des frontières et ne tolèrent aucune ingérence de puissances étrangères. Si l'État est une œuvre de la Raison, l'Empire est le résultat de l'Histoire. L'État centralisateur combat toutes les sphères concurrentes : les libertés locales, les pouvoirs personnels, féodaux ou confessionnels. Il établit une Loi unique, valable en tous lieux qu'il contrôle. Pour l'État, la légalité prime la légitimité. Alors que les querelles de légitimité entrave le fonctionnement normal de l'Empire, elles ne gênent pas la bureaucratie de l'État qui fonctionne sur le mode légal. L'Empire diffère de l'État sur deux autres points essentiels : d'une part, il ne combat les privilèges et les coutumes que dans la mesure ou ils menaceraient son intégrité, s'il établit un droit public uniforme, il laisse aux peuples le choix de leur droit privé ; d'autre part, l'Empire, contrairement à l'État, accepte que son autorité varie en intensité d'une contrée à l'autre (6).
Actuellement, le modèle étatique est suranné et ce pour un ensemble de raisons :
- le mythe de l'État se meurt, il n'est plus animé par la foi des révolutionnaires de 1789 et de leurs successeurs du XIXe siècle
- l'État s'émiette, les sphères de pouvoir et d'intérêt se multiplient
- de ce fait, le contrôle du politique n'appartient plus à l'État, mais bien, à l'extérieur, aux organismes internationaux, aux forces capitalistes et aux grandes puissances ; à l'intérieur, aux partis, aux groupes de pression; par là il perd sa raison d'être
- l'État, dans ce monde sans confins, est devenu une entité trop petite (7).
L'Empire, par définition, ne reconnaît aucune autorité supérieure. Même dans le domaine religieux, il résiste au clergé comme le firent les gibelins. En effet, l'Empire participe aussi du sacré, quand l'empereur n'est pas lui-même dieu ! On attribue à Louis XIV le mot : « L'État, c'est moi ! », un empereur déclarerait : « Dieu, c'est moi ! » L'Empire ne tolère aucune ingérence de puissances étrangères, qu'elles fussent temporelles ou spirituelles, dans ses affaires internes ou sa sphère d'influence (les interventions des USA à Grenade ou au Panama poursuivent cette logique). Mais ce refus de la soumission à une autorité supérieure ou même égale ne suffit pas à légitimer la souveraineté. En effet, comme l'écrivait Julien Freund dans son maître-ouvrage : « est politiquement souveraine non point l'instance qui en principe n'est subordonnée à aucune volonté supérieure, mais celle qui se fait volonté absolue par domination de la concurrence ». En toutes circonstances, mêmes les plus désespérées, l'Empire prétend à la prépotence.
UNIVERSALISME ET CIVILISATION
Il vise l'hégémonie locale voire l'universalisme. Un empire sain veut étendre sans cesse sa domination et son influence. La volonté d'extension se manifeste de deux manières : soit l'empire contrôle un ensemble géographique vaste mais limité, soit il tend à l'universel. Je nommerais cette dernière catégorie "les empires messianiques", car l'idée de conquête mondiale est d'origine chrétienne.
En effet, ce fut l'école stoïque qui développa l'idée de l'universalisme de Rome, mais les philosophes la concevaient comme "l'ensemble de la communauté humaine qui participe à la Raison" (œkoumène), par opposition au monde barbare. En ce sens restreint, l'empire romain était bien universel. L'idée fut renforcée par le christianisme. Au IVe siècle, il y avait identité entre les civilisations romaine et chrétienne. Dieu protégeait l'Empire. Peu sensible à l'universalisme romain, les barbares furent plus réceptifs à l'égard de l'universalisme chrétien. Au Moyen-Âge, la coexistence de l'empire byzantin et d'un empire d'Occident constituait la négation même du principe d'universalisme romain. De plus, les possessions de Charlemagne n'englobèrent jamais l'ensemble des terres chrétiennes, en revanche le Saint Empire Romain de la Nation germanique débordait les limites du défunt empire romain. L'universalisme chrétien, compris comme "l'ensemble des États croyants", n'avait pas d'unité institutionnelle. Quant aux empires chrétiens aucun n'était ancré à Rome. La force de l'idée impériale résidait dans le caractère sacré que conférait l'institution, mais le sacre était octroyé par l'Église, alors qu'auparavant l'Empire était sacré en soi (8). Néanmoins, même s'il (pré)tend à l'universalité, l'Empire est toujours lié à un lieu. Comme tout ordre juridique, il est situé. L'Empire, avant d'être une idée, est un territoire. Sa propension à tracer des frontières en est la marque évidente et visible (9).
De surcroît, l'extension de l'Empire est corrélative à celle d'une civilisation. Nonobstant les peuples nomades qui, s'ils n'étaient pas porteurs d'une civilisation — bien qu'ils détinssent une culture — furent néanmoins les média entre des civilisations dont les frontières n'étaient pas mitoyennes : ainsi, l'empire de Gengis Khan relia l'Europe chrétienne, l'Orient, l'Inde et la Chine. L'Empire plus qu'un État est un état d'esprit. Il se conçoit comme un espace d'ordre et de raison entouré par les barbares. L'imperium permet la conquête, tandis que la potestas assure la conservation des territoires acquis. Si l'Empire impose le plus souvent son emprise par la puissance, il ne se perpétue qu'en incarnant une civilisation. Il se construit autour d'un mythe. Par là même, il fonde son identité et celles de ses peuples. Ainsi naît bientôt une communauté de culture et de destin (10).
L'Empire, qui comprend une multiplicité d'ethnies, est gouverné par une caste qui ne dépend pas du local. Sa bureaucratie est non héréditaire. C'est pourquoi le souverain s'entourait souvent d'eunuques privés de descendance ou d'affranchis entièrement dévoués à leur maître. Même les empires féodaux tentèrent de créer une élite de gouvernement non héréditaire : les premiers fiefs féodaux et les timars turcs ne relevaient pas du patrimoine familial, mais étaient concédés par le souverain en échange de services ; dans l'empire carolingien, le serment vassalique (un lien personnel) renforçait l'allégeance à l'État (plus abstrait) sans s'y substituer (11). Cette élite de gouvernement sera la porteuse de la civilisation impériale.
Enfin, soulignons que le système impérial se concilie difficilement avec la démocratie, surtout parlementaire. Néanmoins, l'Empire n'est pas nécessairement une monocratie, une concentration des pouvoirs suffit (oligarchie, aristocratie, ...).
ESPACE ET DURÉE
Les dimensions de l'Empire sont difficiles à évaluer. Jean Thiriart remarquait que la taille minimale variait selon les époques. Les plus grands se traversaient en 40 à 60 jours de voyage. Le mode de transport détermine alors la grandeur (les messagers de l'empire Han atteignaient les confins de l'empire en 6 semaines, les marins de Charles Quint quelques semaines pour aller aux Amériques). Dès lors, minimum et maximum sont impossibles à fixer : les conquêtes mongoles et les possessions de Charlemagne portent le nom d'empire. Ils semblerait donc qu'il suffît d'être un État plus grand que les autres à une époque et dans une aire donnée pour mériter le titre d'empire.
Du fait de sa taille, l'Empire regroupe des peuplades diverses, ce qui incite le gouvernement au respect des particularités régionales et à la tolérance religieuse (la persécution des chrétiens est due à leur intransigeance et leur arrogance qui menaçaient l'ordre impérial). Mais, par un processus naturel, les cultures locales se déforcent peu à peu au profit d'une civilisation impériale éminente. L'Empire a besoin de s'étendre, mais il doit maintenir une certaine homogénéité : il englobe une multiplicité de peuples, mais ceux-ci doivent partager le plus grand nombre de valeurs communes : idéologiques, religieuses, institutionnelles ou linguistiques...
Évidemment, une unité religieuse, linguistique ou culturelle peut compenser en partie l'aspect composite de l'Empire. La culture impériale appartient souvent à — et est créée par — une élite de gouvernement (culture romaine, confucéisme...). Il existe au sein de l'Empire une tension perpétuelle entre les ethnies et l'État central. L'Empire survit tant qu'il maintient sa cohésion, la région tant qu'elle maintient son identité.
La notion de durée apparaît encore plus difficile à cerner. En effet, d'une part l'Empire se veut éternel; d'autre part, nombre d'empires se sont effondrés quelques années après leur naissance. Il s'agit particulièrement des empires constitués par de grands chefs de guerre et des peuples nomades (Alexandre, Gengis Khan, Tamerlan, Attila... ). La durée, en soi, n'a donc guère d'importance, elle est plus la marque d'une réussite qu'une caractéristique propre à l'Empire. Néanmoins, les lustres déterminent 2 grands types d'empires : ceux qui n'ont pas eu le temps de se structurer et les autres. Certains parleront d'empires avortés, mais leur nombre et leur influence dans l'Histoire nous retiennent de les écarter.
MORT DE L'EMPIRE
D'après Wallerstein, la centralisation fait à la fois sa force et sa faiblesse, car d'une part elle permet d'attirer l'excédent de richesse vers le centre, mais d'autre part elle induit une certaine rigidité, un conservatisme qui peut aller jusqu'au refus de l'évolution technologique. L'appareil bureaucratique, lorsqu'il se sclérose, absorbe une trop grande part des sommes récoltées, le gouvernement perd alors la marge de manœuvre qui lui est nécessaire pour réaliser ses objectifs politiques et stratégiques (12).
Pour Gilissen au contraire, les causes de la décadence de l'Empire sont à peu près les mêmes que celles qui président à leur formation. En premier, il place le « recul de l'agressivité », ou, si l'on préfère, de l'impérialisme. Une suite de défaites militaires résultant d'un recul relatif de la technologie, de dissensions internes, de désordres administratifs ou de l'incapacité des chefs de guerre, conduisent l'Empire vers sa fin. L'Empire mature tend par nature à demeurer sur la défensive. Alors, les conflits internes prennent souvent le pas sur les guerres avec l'extérieur.
Dans le cas des empires formés par rapides conquêtes, c'est souvent la mégalomanie du chef qui entraîne leur ruine ; lorsque l'ambition dépasse les moyens. L'exemple d'Alexandre le Grand est typique. Son père, Philippe, se serait probablement borné à la conquête de l'Anatolie, de la Syrie et peut-être de l'Égypte, mais il n'aurait pas pénétré plus avant dans le cœur de l'empire achénémide. Ce faisant, son empire aurait été moins labile ; il aurait compensé en durée ce qu'il perdait en espace. Mais, de fait, sans cette grande aventure, la culture hellénistique n'aurait pas atteint le bassin de l'Indus.
L'Empire souffre aussi souvent des guerres de succession. Soit l'État en sort affaibli, soit les héritiers se partagent les territoires (Charlemagne). De plus, aucune dynastie n'échappe à la dégénérescence génétique. Certains États pratiquent d'autres modes de succession, mais ils n'arrivent pas toujours à renouveler l'élite dirigeante.
Les peuples soumis se révoltent, soit parce qu'ils craignent que leur culture ne soit éradiquée au profit de la civilisation impériale ou de celle du peuple dominant dans l'Empire, soit parce que l'entretien de l'État central devient trop lourd par rapport aux services qu'il rend (maintien de l'ordre, justice, infrastructure...). L'Empire peut être ressenti comme "ethnicide". L'Autriche-Hongrie et l'empire ottoman n'ont pas réussi l'assimilation des diverses nationalités qui les composaient, chacune des ethnies revendiqua la création d'un État-nation. Les empires coloniaux se sont désagrégés parce que la Métropole les exploitait sans guère de contre-partie (indépendance des États-Unis).
Durant sa phase descendante, l'Empire se féodalise souvent, mais ce n'est pas toujours un signe de décadence ; on a en effet connu des empire féodaux.
Lorsque le peuple dominateur s'affaiblit, sa position privilégiée est contestée ; s'il s'accroche à ses avantages alors qu'il n'est plus capable de remplir ses obligations, l'Empire se désagrégera. Mais, dans nombre d'empires, une certaine assimilation ayant été réalisée, l'ethnie dominante peut être remplacée par une ethnie concurrente ou par une caste cosmopolite entièrement dévouée à la cause de l'État fédéral.
Les désordres dans l'administration sont souvent évoqués comme cause de décadence de l'Empire, mais il nous semble qu'il s'agit plutôt de la conséquence des points précédents. Pareillement, le déclin économique s'explique le plus souvent par un recul technologique, des troubles intérieurs, une mauvaise gestion, un manque de dynamisme et souvent une bipolarisation de la société en une masse de serfs laborieux et quelques grands propriétaires, avec pour conséquence la disparition des hommes libres qui fournissaient les contribuables et les recrues pour l'armée.
EUROPE
L'Europe (13) a toujours été divisée linguistiquement et politiquement, mais elle partage un héritage culturel commun : les civilisations gréco-latine puis chrétienne. Le géographe Pieter Saey, qui a contribué à l'ouvrage collectif consacré aux grands mythes de l'histoire belge sous la direction d'Anne Morelli , refuse à l'Europe le titre de continent. Il conteste également que l'Europe soit un espace culturel unifié, car une culture supranationale resterait à créer. Néanmoins, il décèle quatre mobiles historiques qui ont favorisé l'émergence d'une conscience supranationale : la défense contre les Turcs (motivation qui pourrait revenir au premier plan sous la forme du fondamentalisme islamique), la domination d'une puissance sur les autres (le respect de l'équilibre européen), le maintien de la paix, et le besoin d'un élargissement du marché (qui est insuffisant en soi pour forger une idée européenne). L'auteur conclut : « La définition de celui-ci [l'esprit européen] a varié en fonction des réalités que les auteurs avaient sous les yeux et n'a aucune pérennité. Pas plus que n'ont de continuité dans le temps les diverses définitions de l'Europe historique et géographique » (14). À l'appui de sa thèse, il propose une série de cartes qui dessinent les différentes formes que l'Europe a pu prendre au cours de son histoire. De fait, selon les époques envisagées ou les auteurs choisis, l'Europe change considérablement de taille et de forme : tantôt elle se réduit au monde de la Grèce classique, tantôt elle s'étend au monde chrétien ou englobe la civilisation celte... Par ces remarques, monsieur Saey espère empêcher qu'un mythe européen ne se substitue au mythe national, car il est vraisemblablement adepte de l'universalisme. Sa contribution clôture d'ailleurs l'ouvrage dirigé par Anne Morelli, ce qui n'est pas innocent (15).
Certains ne semblent pas vouloir comprendre que l'Europe et l'Empire sont des concepts dynamiques, qui ne possèdent donc pas de limites définitivement arrêtées. À la mutabilité de l'Europe dans l'espace, nous opposons la permanence de l'idée d'Empire dans le temps. Depuis la déposition de Romulus Augustule, Empire et Europe ne coïncident plus. Notre continent recouvrera sa puissance lorsqu'il aura à nouveau réalisé l'adéquation entre son territoire et sa civilisation.
« L'Empire n'est pas une démocratie » geindront d'autres bonnes âmes... En effet, comme le remarquaient déjà les philosophes des Lumières et les grands juristes du XVIIe siècle, la démocratie ne convient qu'aux petits États. Cela n'empêche pas qu'elle puisse exister au sein de l'Empire, au niveau local. Nous concevons aisément, au centre, un État puissant, aristocratique (au sens étymologique) qui se chargerait de la politique étrangère, de l'armée, des grandes orientations économiques... et, à la périphérie, des régions qui exerceraient les compétences d'enseignement, de culture et assureraient l'administration locale. De plus, comme l'écrivait Jean Thiriart, « La liberté (réelle et non pas formelle) est directement proportionnelle à la puissance de sa patrie ». Les citoyens d'une nation asservie sont des serfs, quelque soit son mode de gouvernement; ils ne sont pas francs si une puissance extérieure leur impose une manière de penser et d'agir.
NOS ENNEMIS
Demandons-nous plutôt, en dehors de toute considération morale, si l'Europe possède les moyens de la grandeur. En gros, nous pouvons avancer que les éléments déterminants sont la force militaire, le potentiel industriel ou la richesse, la population et la superficie. Quand on l'envisage comme un ensemble cohérent, l'Europe détient ces éléments. Seuls deux autres pôles jouissent d'avantages comparables : les États-Unis et le Japon (16) (et encore manque-t-il à ce dernier la superficie). La CEI est hors course pour longtemps et la Chine n'a pas encore atteint un degré de développement suffisant, mais, dans l'avenir, il faudra sans doute compter avec ces deux acteurs de second plan.
L'Empire européen, au sens lato sensu, s'inscrirait logiquement dans la lignée romaine. Plusieurs menaces l'incitent à se former : les barbares (17) musulmans, les barbares mercantiles, et ses deux pôles concurrents. C'est seulement en nommant ses ennemis que l'Europe recouvrera son destin. Les intégristes musulmans ne constituent pas encore un danger sérieux au point de vue militaire, mais ils représentent un facteur de troubles sur la façade sud de l'Europe et à l'intérieur même de ses frontières. Rappelons que les mouvements islamistes sont en partie financés par les États-Unis, notre autre ennemi. Par "barbares mercantiles", nous désignons les spéculateurs internationaux, ceux qui jouent à l'économie casino, contre lesquels l'Europe devra se protéger.
Le Japon a accru son poids en s'associant au sein de l'ASENA aux "petits dragons asiatiques". Mais l'ensemble manque de cohésion politique. On trouve ainsi parmi les membres de l'ASENA le Viet-Nam ex-communiste, qui, effrayé par le réarmement chinois, se cherche des alliés. Les petits pays membres se sont développés plus vite que le Japon qui a ainsi perdu sa prééminence absolue au sein de l'ASENA. Il est probable que le Japon tentera d'étendre son influence vers les steppes russes qui regorgent de matières premières. Il entamera alors une course avec l'Europe et peut-être la Chine dont l'attitude sera déterminante pour l'équilibre de la région. Va-t-elle concurrencer le Japon ou s'allier avec lui ?
Les États-Unis présentent des caractéristiques singulières : ils ne se sont pas constitués au départ d'un groupe de communautés historiques, mais à partir d'un magma d'individus venus des quatre coins du monde. Leur culture résulte de la syncrèse de valeurs importées. Cette culture est considérée comme un objet commercial, un moyen de faire en sorte que l'autre finisse par leur ressembler en achetant leurs produits. Alors que l'Empire cherche la distinction, les États-unis visent l'assimilation. Sa stratégie se confond avec celle de l'économie-monde.
NOTRE PASSÉ ET NOTRE AVENIR
L'Empire est le moyen de surmonter la nation et la région. Il est le seul mythe capable de forger un patriotisme européen. Mais, trop de régionalistes veulent créer de mini-États-nations. Pourtant, le XXIe siècle sera l'ère des grands ensembles. Mais, l'État-nation désire l'égalité, l'uniformité, la centralisation. Il établit une loi unique sur l'ensemble de son territoire. Au contraire, l'Empire ne possède pas une autorité égale dans toutes ses contrées. Certaines régions peuvent bénéficier de statuts particuliers, transitoires ou définitifs. Ainsi, dans l'empire romain, le droit romain se superposait aux droits locaux sans les éliminer. Bien sûr, le droit public était unifié, mais en matières privées, le citoyen recourait selon les cas au droit romain ou au droit local. Les us et coutumes des diverses ethnies étaient ainsi préservés. L'existence de statuts intermédiaires facilite l'intégration de nouveaux pays : certains, qui auraient refusé une intégration immédiate, accepteraient néanmoins une procédure plus douce qui ménagerait une période d'adaptation. Quant à la résolution des conflits ethniques par l'Empire, elle est un devoir et une nécessité. Dans un modèle impérial, la question de l'intervention armée en Yougoslavie ne se serait pas posée. Que cette région soit en bordure de l'Empire ou à l'intérieur, ses légions auraient marché immédiatement.
Nous assistons à un phénomène nouveau : un ensemble d'États-nations tentent de s'unir. Mais l'idéologie libérale pousse vers l'Europe minimale, la confédération ; or l'Empire a besoin d'un centre unificateur, agrégateur, d'un noyau massif.
L'exemple de l'Autriche-Hongrie nous intéresse au premier chef, car il se rapproche par divers aspects de la situation européenne. D'abord par son processus de formation : il s'est constitué par agrégation pacifique d'un ensemble de principautés au fur et à mesure des héritages de la famille Habsbourg. Mais il a éclaté sous la pression des diverses ethnies qui, infestées par l'idéologie libérale, réclamaient la constitution d'États-nations. Durant quelques dizaines d'années, l'Autriche-Hongrie fut même un État bicéphale. La Cisleithanie et la Transleithanie partageaient un souverain commun intronisé deux fois. Mais les deux parties de l'Empire se gouvernaient selon une logique d'État contradictoire avec la notion d'Empire. Il ne s'agissait pas d'un ensemble d'ethnies inféodés à l'empereur, mais d'une confédération de deux États, eux-mêmes peu homogènes. Dans l'un dominaient les Allemands, dans l'autre les Hongrois, mais chacun comprenait de nombreux peuples minoritaires. Les Allemands leur accordaient l'autodétermination, mais eux-mêmes ne disposaient pas d'État propre, tandis que les Hongrois en possédaient un qui regroupait d'autres ethnies dont les droits à l'autonomie n'étaient pas reconnus. En fait, l'Empire aurait très bien pu se perpétuer après la première guerre mondiale si les alliés n'en avaient décidé autrement. L'instauration d'une pax austria aurait empêché nombre de guerres balkaniques. Nous payons encore actuellement les traités de Versailles et de Saint-Germain qui ont divisé l'Europe (18).
La construction européenne passe nécessairement par la destruction des anciens États-nations. Deux processus sont envisageables ; le premier, doux, consisterait en la dévolution progressive de leurs compétences vers l'Europe et les régions ; la seconde, brutale, pourrait survenir si nos politiciens persévèrent dans leur aveuglement : l'éclatement pièce par pièce de la Communauté, comme l'ex-Tchécoscolovaquie.
Qui bâtira cette Europe ? En ce domaine, nos hommes politiques se révèlent, comme souvent, aussi généreux en paroles qu'avares en actes. Nous connaissons une caste de fonctionnaires européens, mais la plupart réclame plus un Grand Marché qu'une Europe politique, une économie-monde plutôt qu'un empire ! De plus, la volonté de reconnaître l'ennemi n'existe pas encore.
Ne comptons pas non plus sur le corps électoral. Les hommes se méfient naturellement du changement et de l'inconnu. Tant qu'ils conserverons quelque espoir dans le système actuel, tant qu'ils ne discerneront pas les causes profondes de la crise et tant qu'ils craindront de perdre les maigres revenus que l'État leur assure encore, ils ne se révolteront pas. Pourtant, ils ne défendront pas non plus ce système dont ils sont mécontents. La révolte ouverte étant, dans leurs esprits, exclue, certains expriment leur désapprobation par le vote. Mais, parmi les mêmes, vous en trouverez peu qui accepteront de signer la liste de présentation de candidats d'une petite liste contestataire ou révolutionnaire. Seuls dans le secret et l'anonymat de l'isoloir, ils osent dévoiler leur sentiment. Malheureusement, un résultat statistique n'a jamais modifié le cours de l'Histoire. De surcroît, aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent de l'Europe que des règlements contraignants, les délocalisations et les regroupements d'entreprises, ainsi que les "plans de convergences budgétaires" en vue de créer la monnaie unique. Rien qui ne soulève l'enthousiasme des foules.
En fait, l'Europe ne se réalisera qu'au bord du gouffre, lorsqu'elle apparaîtra comme le dernier recours. Elle sera une œuvre de l'Histoire et non de la raison. Mais auparavant, un parti, un ordre européen devra se constituer, car le moment venu, les événements se précipiteront à une telle vitesse qu'aucun groupe ne disposera du temps nécessaire à sa structuration. La révolution française offre un bon exemple de la dérive vers le chaos. Un petit groupe résolu et bien organisé peut remporter de grands succès, d'autant plus qu'une majorité sans cesse croissante de la population est apathique. Fourbissons donc nos armes en attendant que survienne le moment propice.
► Frédéric KISTERS
• notes :
1- TOYNBEE (A.), La grande aventure de l'humanité, Payot, 1994 (1er éd. anglaise 1976), 565 p.
2 - WALLERSTEIN (I.), Capitalisme et économie-monde (1460-1640), Paris, 1980, t. I, p. 313.
3 - JACQUES et SCHEID (John), Rome et l'intégration de l'Empire, Paris, 1992 (2è éd.), p. 29-37 et bibliographie p. XXII-XXV (n°246 à 322).
4 - Le présent article doit beaucoup à GILISSEN (John), Les Grands Empires : La notion d'empire dans l'histoire universelle, Bruxelles, éd. de la Librairie encyclopédique, 1973, p. 759-885 (Recueil de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XXXI) qui est la conclusion et la synthèse d'un colloque organisé par la même société en 1971. On trouvera aussi de nombreuses ressemblances entre l'idée d'Empire et le concept Grossraum élaboré par Carl Schmitt : FEUERBACH (Jean-Louis), « La théorie du Grossraum chez Carl Schmitt » dans Complexio oppositorum. Uber Carl Schmitt, éd. Helmuth Quaritsch, Berlin, 1986, p. 401-418. Néanmoins, si tout empire possède un Grossraum, le Grossraum ne se confond pas avec l'Empire, le Grossraum déborde les frontières de l'Empire.
5 - Remarque d'Alain Besançon lors d'un colloque : Le concept d'empire, dir. Maurice Duverger, PUF, 1980, p. 482-483 (Centre d'analyse comparative des systèmes politiques).
FREUND (Julien), L'essence du politique, Paris, 1986 (1ère éd. 1965), p. 558 sq.
6 - FEUERBACH (JL), op. cit., p. 404 ; THIRIART (J.), La grande nation européenne : L'Europe unitaire. Définition du communautarisme européen, S.L., 1964, passim.
7 - FREUND (J.), op. cit., p. 129.
8 - FOLZ (R.), L'idée d'empire en Occident : Du Ve au XIVe siècles, Paris, 1953, 251 p. (Coll. historique).
9 - JL FEUERBACH écrit à ce propos : « Un Grossraum doit en effet d'abord se tailler un espace (...) fédérateur », op. cit., p. 406-407. Sur la notion de frontière dans l’esprit des Romains, on consultera WHITTAKER (CR), Frontiers of the Roman Empire. A Social and Economic Study, Baltimore-londres, 1994, XVI-340 p. et Frontières d’Empire. Nature et significations des frontières romaines, Actes de la table ronde internationale de Nemours, 1992, Nemours, 1993, 157 p. (Mémoires du Musée de la préhistoire d’Ile-de-France, 5).
10 - « L'Empire est (ici) à la fois une communauté de culture et une communauté de destin », THIRIART (J.), La grande nation : L'Europe unitaire. Définition du communautarisme national européen, Bruxelles, Machiavel, 1992 (3è éd.), (nouvelle) thèse 34.
11 - WERNER (KF), L'Empire carolingien et le Saint Empire, dans Le concept d'Empire, dir. M. Duverger, Paris, 1980, p. 151-198.
12 - WALLERSTEIN, op. cit., p. 19-20.
13 - Voir aussi LOHAUSEN (Gal J. von), Reich Europa (L'Empire européen), paru dans Nation Europa, mai-juin 1981 ; traduction et édition française : SAUVEUR (Y.), Jean Thiriart et le national-communautarisme-européen, Charleroi, Machiavel, 1984, p. 213-229.
14 - SAEY (Pieter), Les frontières, l'ancienneté et la nature de l'Europe, dans Les grands mythes de l'histoire de Belgique, de Flandre et de Wallonie, dir. A. Morelli, Bruxelles, EVO, 1995, p. 293-308.
15 - Idem, p. 307-308.
16 - Nous avons déjà eu par ailleurs l’occasion de critiquer l’ouvrage collectif dirigé par A. Morelli : KISTERS (F.), « À propos des "grands mythes de l’histoire de Belgique" d’Anne Morelli. L’histoire manipulée » dans Nation Europe n° 6, 1996, p. 23-25.
17 - KISTERS (F.), « L'Europe dans le monde tripolaire », Vouloir n°1 NS (AS 114/118), 1994, p. 45-53. "Barbare" au sens étranger à l'Empire et à sa civilisation.
18 - BEHAR (P.), L'Autriche-Hongrie, idée d'avenir : permanences géopolitiques de l'Europe centrale et balkanique, Paris, 1991, 187 p. (Le Bon Sens) ; FEJTÖ (François), Requiem pour un empire défunt : histoire de la destruction de l'Autriche-Hongrie, s.l., 1988, 436 p.

SUR LES PRÉMISSES SPIRITUELLES DE L'EMPIRE

Le problème de l'empire, dans son acception la plus haute, est celui d'une organisation supranationale telle que l'unité n'agisse pas dans le sens d'une destruction et d'un nivellement de la multiplicité ethnique et culturelle qu'elle englobe. Ainsi posé, le problème de l'empire admet deux grands types de solution : si la première est d'ordre juridique, la seconde est d'ordre spirituel.
Pour la première, l'unité de l'empire est celle d'une simple organisation politico-administrative, d'une loi générale d'ordre, au sens le plus empirique du terme. Dans cette hypothèse, les qualités, les cultures et les traditions spécifiques des divers peuples réunis au sein de l'empire ne sont pas lésées, du simple fait que vis-à-vis d'elles, ce dernier demeure indifférent et étranger. Ici, la seule chose qui importe à l'empire, c'est la simple organisation politico-administrative de pair avec la pure souveraineté juridique. L'empire se comporte, à l'égard des peuples, exactement comme l'État agnostique libéral se comportait vis-à-vis des particuliers, auxquels il laissait faire ce qu'ils voulaient, sous réserve que certaines lois générales fussent respectées.
À l'époque moderne, un exemple caractéristique d'empire ainsi conçu nous est donné par l'empire britannique. Certains ont voulu (Bryce par ex.) établir une analogie sur de semblables critères, entre l'empire britannique et celui de la Rome antique. Même chez nous, des historiens n'ont pas manqué de tomber dans la même erreur, consistant à considérer dans l'empire romain son seul aspect juridique et politique, et à négliger — ou à tenir pour accessoire — toute prémisse d'ordre supérieur, qu'elle soit spirituelle ou religieuse.
Il n'en est pas moins vrai qu'avec Rome se profile, déjà une organisation impériale du second type, correspondant en d'autres termes, à la seconde solution. Et celle-ci veut que l'unité soit déterminée par quelque chose de spirituellement plus éminent que le particularisme de tout ce qui chez les peuples, se trouve conditionné par l'élément ethnique et naturaliste.
Dans la Rome antique, on eut une réalité de ce genre à double titre. Tout d'abord, en vertu de la présence d'un type unique et d'un idéal unique correspondant au civis romanus, lequel n'était nullement, comme d'aucuns l'imaginent, une pure formule juridique, mais une réalité éthique, un modèle humain ayant une valeur supranationale. En second lieu, Rome posa, à titre de point de référence transcendant, le culte impérial. Le Panthéon romain on le sait, accueillait les symboles de toutes les fois et de toutes les traditions ethnico-spirituelles des races soumises à Rome, que celle-ci respectait et parfois protégeait. Mais cette hospitalité et cette protection avaient pour présupposé et pour condition une "fidélité" (fides) d'ordre supérieur. Au-dessus des symboles religieux rassemblés dans le Panthéon, trônait le symbole de l'Empereur, conçu comme numen, comme être divin : celui-ci incarnait l'unité même, transcendante et spirituelle, de l'empire, car l'empire de la tradition romaine était conçu moins comme une œuvre simplement humaine que comme celle des forces d'en haut. La fidélité à ce symbole était la condition première. Dès lors qu'avait eu lieu le serment de fidélité sous la forme d'un rite sacré, toute foi ou tradition particulière des peuples soumis — dans la mesure où elle ne lésait ni n'offensait l'éthique et la loi générale romaines — était acceptée et respectée.
C’est en ces termes que la Rome antique s'offre à nous comme un exemple d'organisation impériale ayant une valeur éternelle et universelle. En effet, il suffit de substituer aux formes, conditionnées par le temps, d'une solution comme celle-ci, d'autres formes pour balayer toute apparence d'anachronisme — et pour prendre conscience que quiconque voudrait aujourd'hui aborder le problème d'un empire spirituel ne saurait envisager d'autres perspectives.
Ce qui serait effectivement beaucoup plus "anachronique", de nos jours, consisterait à envisager une organisation supranationale fondée sur l'affirmation d'une idée religieuse particulière, fût-elle chrétienne. Nul ne peut raisonnablement considérer comme actuelle, à l'heure qu'il est, l'idée de revenir à un empire de type espagnol, ultracatholique et inquisitorial comme celui de Charles Quint. Mais même si l'on exclut cette forme extrême bien que cohérente, d'autres formules, plus vagues et plus "intellectuelles", d'unité supranationale fondée unilatéralement sur lu religion n'en montrent pas moins, à l'analyse, le même défaut. Dans le cadre d'un vaste ensemble tel que l'empire, on ne peut laisser de côté le fait qu'existent de nombreuses traditions religieuses, la plupart du temps d'une dignité et d'une élévation spirituelle comparables. Si l'empire recourait à la violence pour réaliser son unité, en la fondant sur l'affirmation et la reconnaissance d'une religion au détriment des autres, il est bien clair que nous nous trouverions confrontés à une manifestation de sectarisme plutôt qu'à un universalisme spirituel.
L'exemple impérial qui se profile avec le fascisme semble, du reste, indiquer déjà un dépassement de cette perspective. En effet, dans l'empire fasciste, le catholicisme représente la religion nationale du peuple italien, tandis que l'empire se déclare simultanément protecteur de l'Islam, et qu'il a reconnu et respecte la religion copte également. Qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'avec le fascisme s'affirme l'exigence d'un point de référence qui, déjà, se situe par-delà celui propre à une foi religieuse particulière ? Nous disons "par-delà" et non pas "en dehors de", car il convient de garder à l'esprit que le fascisme possède également une éthique, une spiritualité, un type humain, une aspiration à traduire en termes de volonté dominatrice le sens d'une réalité permanente et universelle. Il ne peut donc s'agir, dans ce cadre, d'un simple respect, indifférent et agnostique, sur le modèle de la première des deux solutions que nous évoquions au départ, mais bien du principe d'une réalisation d'ordre supérieur et "romain".
Ceci reconnu, le problème général des prémisses spirituelles de l'empire consiste à définir le principe en fonction duquel on peut simultanément reconnaître et dépasser toute foi religieuse particulière des nations qui le constituent. Tel est le point fondamental. L'empire au sens vrai, en fait, ne peut exister que s'il est animé par une ferveur spirituelle, une foi, quelque chose qui puise aux mêmes sources spirituelles que celles dont la religion tire sa raison d'être. Si cela fait défaut, on n'aura jamais qu'une création forgée par la violence — "l'impérialisme" —, simple superstructure mécanique et sans âme. C'est pourquoi il est nécessaire de capter — si l'on peut dire — les forces mêmes qui agissent au sein des fois religieuses sans que celles-ci s'en trouvent le moins du monde lésées, mais au contraire intégrées et sublimées. Or, une voie existe pour y parvenir : elle nous est dévoilée par la conception selon laquelle toute tradition spirituelle et toute religion ne représentent que l'expression particulière d'un contenu unique, antérieur et supérieur à chacune de ses diverses expressions. Savoir remonter jusqu'à ce contenu unique et, pour ainsi dire, supertraditionnel, signifierait également disposer d'une base solide pour fonder une unité qui ne détruise pas, mais intègre toute foi particulière, définissant ainsi une "fidélité" impériale, par référence, précisément, à ce contenu d'ordre supérieur. Transcender, selon l'étymologie latine, signifie "dépasser en montant" : toute l’essence du problème est contenue dans ce mot.
Limitons-nous, pour l’instant à ces grandes lignes générales : elles nous serviront de point de départ dans un prochain article pour des considérations qui mettront davantage en lumière la conception développée dans ces colonnes.
► Julius Evola in Essais Politiques, Pardès. Texte de 1937.
