Décisionnisme
 À propos du décisionnisme
À propos du décisionnisme
Le décisionnisme est, comme son nom l'indique, une pensée en termes de décision. Le décisionniste est l'homme politique qui veut décider, aboutir à une décision, c'est-à-dire à un acte de volonté qui a ses ressorts en lui-même et qui est vierge de toute compromission. Le décisionniste, en conséquence, s'oppose à toutes les formes de compromis que permet le libéralisme. Carl Schmitt, catholique et conservateur, est sans nul doute celui qui, parmi les tenants de la Révolution conservatrice, a pensé le décisionnisme de la manière la plus conséquente. Chez les penseurs nationaux-révolutionnaires de la même époque, on trouve également des décisionnistes.
Pour C. Schmitt, ce qui est important, c'est « que dans la simple existence d'une autorité réellement autoritaire, il y ait de la décision, et que toute décision soit valable et valide, car dans les choses les plus essentielles [du politique], il est plus important de savoir que quelqu'un décide, que de savoir comment cette décision est décidée » (1). Il s'agit donc de poser une “décision” en soi, en pleine souveraineté. L'État, à l'époque de C. Schmitt, du moins dans le domaine du politique, est le moyen le plus approprié pour poser de telles décisions ; c'est lui qui incarne la souveraineté qui est, en fait, rien d'autre que le “monopole de la décision” (2). Il s'agit de reconnaître le bien-fondé, l'utilité pratique, l'excellence, de la décision absolue, c'est-à-dire de la décision pure, non raisonnée, qui n'est pas le produit d'une discussion, qui n'a nul besoin de se justifier, qui jaillit du néant (3). L'essence de l'État apparaît ici clairement, parce qu'il est le vecteur premier de la décision, devient de la sorte le moyen le plus précieux pour contrer, à l'intérieur, la guerre civile que déclenchent les idéologies et les intérêts contradictoires. « L'essence de l'État réside en ceci, qu'il y ait [par lui] une décision » (4).
La particularité de Carl Schmitt, dans le cadre de cette Révolution conservatrice mise en exergue par Armin Mohler, c'est, qu'en tant que penseur catholique, il voit toujours Dieu trôner au-dessus de tout. D'où son constat : « Tous les concepts prégnants des doctrines modernes de l'État sont des concepts théologiques sécularisés » (5). Toutefois, le Règne de Dieu n'est pas de ce monde, où c'est l'homme qui gouverne, où c'est l'homme qui est le fondateur des valeurs. Mais comment réalise-t-on concrètement les valeurs, comment établit-on les lois ? Schmitt ne cesse de citer l'Anglais Thomas Hobbes, en acceptant ses théorèmes : Auctoritas, non veritas facit legem (6). L'autorité est la source des lois, car le pouvoir lui en donne la force, c'est elle qui pose les décisions qui génèrent les lois. C'est au départ de cette conception de Hobbes, que la Révolution conservatrice allemande a opté pour les systèmes autoritaires, parce qu'ils éliminent les querelles intérieures et les bannissent de la “communauté organique”.
Chez les nationaux-révolutionnaires, que Mohler classe aussi dans la Révolution conservatrice, il y a donc aussi des décisionnistes. Le concept de décision a fasciné cette gauche non-conformiste, si bien que l'hebdomadaire du mouvement Widerstand (Résistance) d'Ernst Niekisch portait le titre d'Entscheidung (Décision). Ce n'est pas un hasard. Chez Niekisch, par d'arrière-plan théologique, au contraire de Schmitt. Le décisionnisme de Niekisch découle d'une position fondamentaliste absolue. Niekisch exige la “décision permanente”, car l'“idéologie de Widerstand” équivaut à une “protestation allemande” contre le “romanisme”, à une option pour l'Est contre l'Ouest, pour l'éthique prussienne du service contre le libéralisme (7). Cette protestation tous azimuts, incessante, permanente, exige, selon Niekisch, une “nouvelle attitude humaine”, une promptitude à accepter et à supporter un “destin héroïque”. Pour généraliser cette attitude contestatrice permanente, il faut recruter des hommes qui soient “déjà saisis par l'esprit du futur” (8). Niekisch accuse et brocarde l'éternelle indécision allemande : « Il existe une lenteur, une lourdeur, une faiblesse typiquement allemandes, qui, sans cesse, cherche, en louvoyant, à échapper à la décision nécessaire » (9). Mais le devoir éthique de trancher, donc de décider, de prendre littéralement le taureau par les cornes, personne ne peut l'éviter, le refuser.
Sur le plan littéraire, l'exigence de décision se retrouve, à un degré de radicalité encore plus élevé, chez Ernst Jünger, qui, à cette époque, appartenait encore aux cercles nationaux-révolutionnaires, et était une figure de proue du “nouveau nationalisme”. Il écrivait : « C'est pourquoi cette époque exige une vertu entre toutes : celle du décisionnisme. Il s'agit de pouvoir vouloir et de pouvoir croire, sans se référer au contenu que cette volonté et cette foi se donnent » (10). Cet appel de Jünger est un appel à la “décision en soi”. Chez Jünger, la décision est couplée à un désir ardent de nouveauté, au désir d'une révolution, d'où les éléments de nihilisme ne sont pas totalement absents. Chez lui, la décision est toute imprégnée de l'esprit des “orages d'acier” : elle est quasi synonyme de “mobilisation totale”. « Notre espoir repose sur les hommes jeunes, qui souffre de fièvre, parce qu'ils sont dévorés par le pus verdâtre du dégoût, notre espoir repose dans les âmes saisies par la grandezza, dans les âmes que nous voyons errer dans les sinuosités de l'ordre des auges. Notre espoir repose en une révolution qui s'opposerait à la domination du confort, en une révolution visant à détruire le monde des formes, en une révolution qui a besoin d'explosifs pour nettoyer et vider notre espace vital, afin qu'il y ait la place pour une nouvelle hiérarchie » (11).
Le décisionnisme est en tant que tel une méthode, plus exactement une méthode de critique sociale, une méthode finalement assez proche de la théorie critique utilisée par les gauches nouvelles. Mais il peut bien entendu étoffer l'arsenal d'une nouvelle droite, qui devrait en être l'héritière et la continuatrice, car de larges segments de la neue Rechte allemande sont d'ores et déjà influencés par Carl Schmitt. En effet, la critique du déclin du politique à l'ère du libéralisme, formulée par C. Schmitt en 1922, reste d'une étonnante actualité : « Aujourd'hui rien n'est plus moderne que la lutte contre le politique. Les financiers américains, les techniciens de l'industrie, les socialistes marxistes, les révolutionnaires anarcho-syndicalistes, s'unissent pour exiger que soit éliminée la domination immatérielle du politique sur la matérialité de la vie économique. Il ne devrait plus y avoir que des tâches organisationnelles, techniques, économiques et sociologiques, mais il ne pourrait plus y avoir de problèmes politiques. Le mode aujourd'hui dominant de la pensée économico-technique n'est déjà plus capable de percevoir la pertinence d'une idée politique. L'État moderne semble être vraiment devenu ce que Max Weber voyait se dégager de lui : une grande entreprise. En général, [dans ce contexte libéral], on ne comprend une idée politique que lorsque ses tenants sont parvenus à prouver à une certaine catégorie de personnes qu'elles ont un intérêt économique direct et tangible à l'instrumentaliser à leur profit. Si, dans ce cas d'instrumentalisation, le politique disparaît et sombre dans l'économique, ou dans le technique ou l'organisationnel, par ailleurs, il s'épuise dans les intarissables discours ressassant à l'envi les banales généralités que l'on ne cesse d'ânonner sur la “culture” ou sur la “philosophie de l'histoire”, discours définissant au nom de critères esthétiques l'air du temps tantôt comme classique, tantôt comme romantique ou comme baroque, en hypnotisant les “beaux esprits”. Ce basculement dans l'économique ou ce discours [“cultureux”], passe à côté du noyau réalitaire de toute idée politique, de toute décision qui, en tant que décision, est toujours d'une plus haute élévation morale. La signification réelle que revêtent en fait les philosophes de l'État contre-révolutionnaires, réside entièrement dans la dimension conséquente de leur démarche, laquelle repose sur la décision, [baigne dans l'incandescence de la décision]. Ces philosophes contre-révolutionnaires mettent si fort l'accent sur l'instant intense de la décision qu'ils annulent finalement l'idée de légitimité, à partir de laquelle, pourtant, ils avaient amorcé leurs réflexions » (12).
Le déclin du politique découle de l'évitement systématique des décisions. La modernité passe de fait à côté de la décision essentielle, de la décision qui fonde le concept du politique, c'est-à-dire de la décision qui aboutit à la désignation de l'ami et de l'ennemi. « C'est ainsi que Carl Schmitt définit la modernité : elle est oublieuse du politique. Dans cette perspective, le communisme et le capitalisme apparaissent pour ce qu'ils sont : les 2 pôles complémentaires d'une même positivité impolitique, qui constitue le terminus ad quem d'une objectivisation mécaniciste du social, à l'œuvre depuis le XVIIe siècle » (13).
► Jürgen Hatzenbichler, 1995. (tr. fr. : RS)
◘ Notes :
(1) Carl Schmitt, Politische Theologie, Berlin, 1990, p. 20.
(2) Ibid., p.71.
(3) Ibid., p.83.
(4) Ibid., p.71.
(5) Ibid., p.49.
(6) Ibid., p.44.
(7) Ce nom dérive de celui du mensuel Widerstand, dirigé par Niekisch.
(8) cf. Uwe Sauermann, Ernst Niekisch und der revolutinäre Nationalismus, München, 1985, pp. 173 & ss.
(9) Ernst Niekisch, cité par Friedrich KABERMANN, Widerstand und Entscheidung eines deutschen Revolutionärs, Köln, 1973, p. 165.
(10) Ernst Niekisch, Widerstand, Krefeld, 1982, p. 164.
(11) Ernst Jünger, Das abenteurliche Herz - Erste Fassung, Stuttgart, 1987, p. 110.
(12) E. Jünger, ibid., pp. 113 & ss.
(13) C. Schmitt, ibid., pp. 82 & ss.

La décision dans l'œuvre de Carl Schmitt
Carl Schmitt est considéré comme le théoricien par excellence de la décision. L'objet de cet exposé est :
- de définir ce concept de décision, tel qu'il a été formulé par Carl Schmitt ;
- de reconstituer la démarche qui a conduit Carl Schmitt à élaborer ce concept ;
- de replacer cette démarche dans le contexte général de son époque.
Sa théorie de la décision apparaît dans son ouvrage de 1922, Politische Theologie. Ce livre part du principe que toute idée politique, toute théorie politique, dérive de concepts théologiques qui se sont laïcisés au cours de la période de sécularisation qui a suivi la Renaissance, la Réforme, la Contre-Réforme, les guerres de religion.
« auctoritas non veritas facit legem »
À partir de Hobbes, auteur du Leviathan au XVIIe siècle, on neutralise les concepts théologiques et/ou religieux parce qu'ils conduisent à des guerres civiles, qui plongent les royaumes dans un “état de nature” (une loi de la jungle) caractérisée par la guerre de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes appelle “Léviathan” l'État où l'autorité souveraine édicte des lois pour protéger le peuple contre le chaos de la guerre civile. Par conséquent, la source des lois est une autorité, incarnée dans une personne physique, exactement selon l'adage auctoritas non veritas facit legem (c'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi). Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas un principe, une norme, qui précède la décision émanant de l'autorité. Telle est la démarche de Hobbes et de la philosophie politique du XVIIe siècle. C. Schmitt, jeune, s'est enthousiasmé pour cette vision des choses.
Dans une telle perspective, en cas de normalité, l'autorité peut ne pas jouer, mais en cas d'exception, elle doit décider d'agir, de sévir ou de légiférer. L'exception appelle la décision, au nom du principe auctoritas non veritas facit legem. Schmitt écrit à ce sujet : « Dans l'exception, la puissance de la vie réelle perce la croûte d'une mécanique figée dans la répétition ». Schmitt vise dans cette phrase significative, enthousiaste autant que pertinente, les normes, les mécaniques, les rigidités, les procédures routinières, que le républicanisme bourgeois (celui de la IIIe République que dénonçait Sorel et celui de la République de Weimar que dénonçaient les tenants de la Révolution conservatrice) ou le ronron wilhelminien de 1890 à 1914, avaient généralisées.
Restaurer la dimension personnelle du pouvoir
L'idéologie républicaine ou bourgeoise a voulu dépersonnaliser les mécanismes de la politique. La norme a avancé, au détriment de l'incarnation du pouvoir. Schmitt veut donc restaurer la dimension personnelle du pouvoir, car seule cette dimension personnelle est susceptible de faire face rapidement à l'exception (Ausnahme, Ausnahmenzustand, Ernstfall, Grenzfall). Pourquoi ? Parce que la décision est toujours plus rapide que la lente mécanique des procédures. Schmitt s'affirme ainsi un « monarchiste catholique », dont le discours est marqué par le vitalisme, le personnalisme et la théologie. Il n'est pas un fasciste car, pour lui, l'État ne reste qu'un moyen et n'est pas une fin (il finira d'ailleurs par ne plus croire à l'État et par dire que celui-ci n'est plus en tous les cas le véhicule du politique). Il n'est pas un nationaliste non plus car le concept de nation, à ses yeux et à cette époque, est trop proche de la notion de volonté générale chez Rousseau.
Si Schmitt critique les démocraties de son temps, c'est parce qu'elles :
- 1) placent la norme avant la vie ;
- 2) imposent des procédures lentes ;
- 3) retardent la résolution des problèmes par la discussion (reproche essentiellement adressé au parlementarisme) ;
- 4) tentent d'évacuer toute dimension personnelle du pouvoir, donc tout recours au concret, à la vie, etc. qui puisse tempérer et adapter la norme.
Mais la démocratie recourt parfois aux fortes personnalités : qu'on se souvienne de Clémenceau, applaudi par l'Action Française et la Chambre bleu-horizon en France, de Churchill en Angleterre, du pouvoir directorial dans le New Deal et du césarisme reproché à Roosevelt. Si Schmitt, plus tard, a envisagé le recours à la dictature, de forme ponctuelle (selon le modèle romain de Cincinnatus) ou de forme commissariale, c'est pour imaginer un dictateur qui suspend le droit (mais ne le supprime pas), parce qu'il veut incarner temporairement le droit, tant que le droit est ébranlé par une catastrophe ou une guerre civile, pour assurer un retour aussi rapide que possible de ce droit. Le dictateur ou le collège des commissaires se placent momentanément — le temps que dure la situation d'exception — au-dessus du droit car l'existence du droit implique l'existence de l'État, qui garantit le fonctionnement du droit. La dictature selon Schmitt, comme la dictature selon les fascistes, est un scandale pour les libéraux parce que le décideur (en l'occurrence le dictateur) est indépendant vis-à-vis de la norme, de l'idéologie dominante, dont on ne pourrait jamais s'écarter, disent-ils. Schmitt rétorque que le libéralisme-normativisme est néanmoins coercitif, voire plus coercitif que la coercition exercée par une personne mortelle, car il ne tolère justement aucune forme d'indépendance personnalisée à l'égard de la norme, du discours conventionnel, de l'idéologie établie, etc., qui seraient des principes immortels, impassables, appelés à régner en dépit des vicissitudes du réel.
La décision du juge
Pour justifier son personnalisme, Schmitt raisonne au départ d'un exemple très concret dans la pratique juridique quotidienne : la décision du juge. Le juge, avant de prononcer son verdict est face à une dualité, avec, d'une part, le droit (en tant que texte ou tradition) et, d'autre part, la réalité vitale, existentielle, soit le contexte. Le juge est le pont entre la norme (idéelle) et le cas concret. Dans un petit livre, Gesetz und Urteil (La loi et le jugement), Schmitt dit que l'activité du juge, c'est, essentiellement, de rendre le droit, la norme, réel(le), de l'incarner dans les faits. La pratique quotidienne des palais de justice, pratique inévitable, incontournable, contredit l'idéal libéral-normativiste qui rêve que le droit, la norme, s'incarneront tous seuls, sans intermédiaire de chair et de sang. En imaginant, dans l'absolu, que l'on puisse faire l'économie de la personne du juge, on introduit une fiction dans le fonctionnement de la justice, fiction qui croit que sans la subjectivité inévitable du juge, on obtiendra un meilleur droit, plus juste, plus objectif, plus sûr. Mais c'est là une impossibilité pratique. Ce raisonnement, Schmitt le transpose dans la sphère du politique, opérant par là, il faut l'avouer, un raccourci assez audacieux.
La réalisation, la concrétisation, l'incarnation du droit n'est pas automatique ; elle passe par un Vermittler (un intermédiaire, un intercesseur) de chair et de sang, consciemment ou inconsciemment animé par des valeurs ou des sentiments. La légalité passe donc par un charisme inhérent à la fonction de juge. Le juge pose sa décision seul mais il faut qu'elle soit acceptable par ses collègues, ses pairs. Parce qu'il y a inévitablement une césure entre la norme et le cas concret, il faut l'intercession d'une personne qui soit une autorité. La loi/la norme ne peut pas s'incarner toute seule.
Quis judicabit ?
Cette impossibilité constitue une difficulté dans le contexte de l'État libéral, de l'État de droit : ce type d'État veut garantir un droit sûr et objectif, abolir la domination de l'homme par l'homme (dans le sens où le juge domine le “jugé”). Le droit se révèle dans la loi qui, elle, se révèle, dans la personne du juge, dit Schmitt pour contredire l'idéalisme pur et désincarné des libéraux. La question qu'adresse Schmitt aux libéraux est alors la suivante, et elle est très simple : Quis judicabit ? Qui juge ? Qui décide ? Réponse : une personne, une autorité. Cette question et cette réponse, très simples, constituent le démenti le plus flagrant à cette indécrottable espoir libéralo-progressisto-normativiste de voir advenir un droit, une norme, une loi, une constitution, dans le réel, par la seule force de sa qualité juridique, philosophique, idéelle, etc. Schmitt reconstitue la dimension personnelle du droit (puis de la politique) sur base de sa réflexion sur la décision du juge.
Dès lors, la-raison-qui-advient et s'accomplit-d'elle-même et par-la-seule-vertu-de-son-excellence-dans-le-monde-imparfait-de-la-chair-et-des-faits n'est plus, dans la pensée juridique et politique de C. Schmitt, le moteur de l'histoire. Ce moteur n'est plus une abstraction mais une personnalité de chair, de sang et de volonté.
La légalité : une « cage d'acier »
Contemporain de Carl Schmitt, Max Weber, qui est un libéral sceptique, ne croit plus en la bonne fin du mythe rationaliste. Le système rationaliste est devenu un système fermé, qu'il appelait une « cage d'acier ». En 1922, Rudolf Kayser écrit un livre intitulé Zeit ohne Mythos (Une époque sans mythe). Il n'y a plus de mythe, écrit-il, et l'arcanum de la modernité, c'est désormais la légalité. La légalité, sèche et froide, indifférente aux valeurs, remplace le mythe. Schmitt, qui a lu et Weber et Kayser, opère un rapprochement entre la « cage d'acier » et la « légalité » d'où, en vertu de ce rapprochement, la décision est morale aux yeux de Schmitt, puisqu'elle permet d'échapper à la « cage d'acier » de la « légalité ».
Dans les contextes successifs de la longue vie de Carl Schmitt (1888-1985), le décideur a pris 3 visages :
- 1) L'accélarateur (der Beschleuniger) ;
- 2) Le mainteneur (der Aufhalter, der Katechon) ;
- 3) Le normalisateur (der Normalisierer).
Le normalisateur, figure négative chez Schmitt, est celui qui défend la normalité (que l'on peut mettre en parallèle avec la légalité des années 20), normalité qui prend la place de Dieu dans l'imaginaire de nos contemporains. En 1970, Schmitt déclare dans un interview qui restera longtemps impublié : « Le monde entier semble devenir un artifice, que l'homme s'est fabriqué pour lui-même. Nous ne vivons plus à l'Âge du fer, ni bien sûr à l'Âge d'or ou d'argent, mais à l'Âge du plastique, de la matière artificielle ».
1. La phase de l'accélérateur (Beschleuniger) :
La tâche politique de l'accélérateur est d'accroître les potentialités techniques de l'État ou de la nation dans les domaines des armements, des communications, de l'information, des mass-media, parce tout accroissement en ces domaines accroît la puissance de l'État ou du « grand espace » (Großraum), dominé par une puissance hégémonique. C'est précisément en réfléchissant à l'extension spatiale qu'exige l'accélération continue des dynamiques à l'œuvre dans la société allemande des premières décennies de ce siècle que Schmitt a progressivement abandonné la pensée étatique, la pensée en termes d'État, pour accéder à une pensée en termes de grands espaces. L'État national, de type européen, dont la population oscille entre 3 et 80 millions d'habitants, lui est vite apparu insuffisant pour faire face à des colosses démographiques et spatiaux comme les États-Unis ou l'URSS. La dimension étatique, réduite, spatialement circonscrite, était condamnée à la domination des plus grands, des plus vastes, donc à perdre toute forme de souveraineté et à sortir de ce fait de la sphère du politique.
Les motivations de l'accélérateur sont d'ordres économique et technologique. Elles sont futuristes dans leur projectualité. L'ingénieur joue un rôle primordial dans cette vision, et nous retrouvons là les accents d'une certaine composante de la “révolution conservatrice” de l'époque de la République de Weimar, bien mise en exergue par l'historien des idées Jeffrey Herf (nous avons consulté l'édition italienne de son livre, Il modernismo reazionario : Tecnologia, cultura e politica nella Germania di Weimar e del Terzo Reich, Il Mulino, Bologne, 1988). Herf, observateur critique de cette “Révolution conservatrice” weimarienne, évoque un “modernisme réactionnaire”, fourre-tout conceptuel complexe, dans lequel on retrouve pêle-mêle, la vision spenglerienne de l'histoire, le réalisme magique d'Ernst Jünger, la sociologie de Werner Sombart et l'“idéologie des ingénieurs” qui nous intéresse tout particulièrement ici.
Ex cursus : l'idéalisme techniciste allemand
Cette idéologie moderniste, techniciste, que l'on comparera sans doute utilement aux futurismes italien, russe et portugais, prend son élan, nous explique Herf, au départ des visions technocratiques de Walter Rathenau, de certains éléments de l'école du Bauhaus, dans les idées plus anciennes d'Ulrich Wendt, auteur en 1906 de Die Technik als Kulturmacht (La technique comme puissance culturelle). Pour Wendt, la technique n'est pas une manifestation de matérialisme comme le croient les marxistes, mais, au contraire, une manifestation de spiritualité audacieuse qui diffusait l'Esprit (celui de la tradition idéaliste allemande) au sein du peuple. Max Eyth, en 1904, avait déclaré dans Lebendige Kräfte (Forces vivantes) que la technique était avant toute chose une force culturelle qui asservissait la matière plutôt qu'elle ne la servait. Eduard Mayer, en 1906, dans Technik und Kultur, voit dans la technique une expression de la personnalité de l'ingénieur ou de l'inventeur et non le résultat d'intérêts commerciaux. La technique est dès lors un « instinct de transformation », propre à l'essence de l'homme, une « impulsion créatrice » visant la maîtrise du chaos naturel.
En 1912, Julius Schenk, professeur à la Technische Hochschule de Munich, opère une distinction entre l'« économie commerciale », orientée vers le profit, et l'« économie productive », orientée vers l'ingénierie et le travail créateur, indépendamment de toute logique du profit. Il revalorise la « valeur culturelle de la construction ». Ces écrits d'avant 1914 seront exploités, amplifiés et complétés par Manfred Schröter dans les années 30, qui sanctionne ainsi, par ses livres et ses essais, un futurisme allemand, plus discret que son homologue italien, mais plus étayé sur le plan philosophique. Ses collègues et disciples Friedrich Dessauer, Carl Weihe, Eberhard Zschimmer, Viktor Engelhardt, Heinrich Hardenstett, Marvin Holzer, poursuivront ses travaux ou l'inspireront. Ce futurisme des ingénieurs, polytechniciens et philosophes de la technique est à rapprocher de la sociologie moderniste et “révolutionnaire-conservatrice” de Hans Freyer, correspondant occasionnel de Carl Schmitt.
Cet ex-cursus bref et fort incomplet dans le “futurisme” allemand nous permet de comprendre l'option schmittienne en faveur de l'« accélérateur » dans le contexte de l'époque. L'« accélérateur » est donc ce technicien qui crée pour le plaisir de créer et non pour amasser de l'argent, qui accumule de la puissance pour le seul profit du politique et non d'intérêts privés. De Rathenau à Albert Speer, en passant par les ingénieurs de l'industrie aéronautique allemande et le centre de recherches de Peenemünde où œuvrait Werner von Braun, les « accélérateurs » allemands, qu'ils soient démocrates, libéraux, socialistes ou nationaux-socialistes, ont visé une extension de leur puissance, considérée par leurs philosophes comme « idéaliste », à l'ensemble du continent européen. À leur yeux, comme la technique était une puissance gratuite, produit d'un génie naturel et spontané, appelé à se manifester sans entraves, les maîtres politiques de la technique devaient dominer le monde contre les maîtres de l'argent ou les figures des anciens régimes pré-techniques. La technique était une émanation du peuple, au même titre que la poésie. Ce rêve techno-futuriste s'effondre bien entendu en 1945, quand le grand espace européen virtuel, rêvé en France par Drieu, croule en même temps que l'Allemagne hitlérienne. Comme tous ses compatriotes, C. Schmitt tombe de haut. Le fait cruel de la défaite militaire le contraint à modifier son optique.
2. La phase du Katechon :
Carl Schmitt après 1945 n'est plus fasciné par la dynamique industrielle-technique. Il se rend compte qu'elle conduit à une horreur qui est la « dé-localisation totale », le « déracinement planétaire ». Le juriste Schmitt se souvient alors des leçons de Savigny et de Bachofen, pour qui il n'y avait pas de droit sans ancrage dans un sol. L'horreur moderne, dans cette perspective généalogique du droit, c'est l'abolition de tous les loci, les lieux, les enracinements, les im-brications (die Ortungen). Ces dé-localisations, ces Ent-Ortungen, sont dues aux accélarations favorisées par les régimes du XXe siècle, quelle que soit par ailleurs l'idéologie dont ils se réclamaient. Au lendemain de la dernière guerre, Schmitt estime donc qu'il est nécessaire d'opérer un retour aux « ordres élémentaires de nos existences terrestres ». Après le pathos de l'accélération, partagé avec les futuristes italiens, Schmitt développe, par réaction, un pathos du tellurique.
Dans un tel contexte, de retour au tellurique, la figure du décideur n'est plus l'accélérateur mais le katechon, le “mainteneur” qui « va contenir les accélérateurs volontaires ou involontaires qui sont en marche vers une fonctionalisation sans répit ». Le katechon est le dernier pilier d'une société en perdition ; il arrête le chaos, en maintient les vecteurs la tête sous l'eau. Mais cette figure du katechon n'est pourtant pas entièrement nouvelle chez Schmitt : on en perçoit les prémices dans sa valorisation du rôle du Reichspräsident dans la Constitution de Weimar, Reichspräsident qui est le « gardien de la Constitution » (Hüter der Verfassung), ou même celle du Führer Hitler qui, après avoir ordonné la « nuit des longs couteaux » pour éliminer l'aile révolutionnaire et effervescente de son mouvement, apparaît, aux yeux de Schmitt et de bon nombre de conservateurs allemands, comme le « protecteur du droit » contre les forces du chaos révolutionnaire (der Führer schützt das Recht). En effet, selon la logique de Hobbes, que Schmitt a très souvent faite sienne, Röhm et les SA veulent concrétiser par une « seconde révolution » un absolu idéologique, quasi religieux, qui conduira à la guerre civile, horreur absolue. Hitler, dans cette logique, agit en “mainteneur”, en “protecteur du droit”, dans le sens où le droit cesse d'exister dans ce nouvel état de nature qu'est la guerre civile.
Terre, droit et lieu – Tellus, ius et locus
Mais par son retour au tellurique, au lendemain de la défaite du Reich hitlérien, Schmitt retourne au conservatisme implicite qu'il avait tiré de la philosophie de Hobbes ; il abandonne l'idée de « mobilisation totale » qu'il avait un moment partagée avec Ernst Jünger. En 1947, il écrit dans son Glossarium, recueil de ses réflexions philosophiques et de ses fragments épars : « La totalité de la mobilisation consiste en ceci : le moteur immobile de la philosophie aristotélicienne est lui aussi entré en mouvement et s'est mobilisé. À ce moment-là, l'ancienne distinction entre la contemplation (immobile) et l'activité (mobile) cesse d'être pertinente; l'observateur aussi se met à bouger [...]. Alors nous devenons tous des observateurs activistes et des activistes observants. [...] C'est alors que devient pertinente la maxime : celui qui n'est pas en route, n'apprend, n'expérimente rien ».
Cette frénésie, cette mobilité incessante, que les peintres futuristes avaient si bien su croquer sur leurs toiles exaltant la dynamique et la cinétique, nuit à la Terre et au Droit, dit le Schmitt d'après-guerre, car le Droit est lié à la Terre (Das Recht ist erdhaft und auf die Erde bezogen). Le Droit n'existe que parce qu'il y a la Terre. Il n'y a pas de droit sans espace habitable. La Mer, elle, ne connaît pas cette unité de l'espace et du droit, d'ordre et de lieu (Ordnung und Ortung). Elle échappe à toute tentative de codification. Elle est a-sociale ou, plus exactement, “an-œkuménique”, pour reprendre le langage des géopolitologues, notamment celui de Friedrich Ratzel.
Mer, flux et logbooks
La logique de la Mer, constate Schmitt, qui est une logique anglo-saxonne, transforme tout en flux délocalisés : les flux d'argent, de marchandises ou de désirs (véhiculés par l'audio-visuel). Ces flux, déplore toujours Schmitt, recouvrent les « machines impériales ». Il n'y a plus de “Terre” : nous naviguons et nos livres, ceux que nous écrivons, ne sont plus que des “livres de bord” (Logbooks, Logbücher). Le jeune philosophe allemand Friedrich Balke a eu l'heureuse idée de comparer les réflexions de C. Schmitt à celles de Gilles Deleuze et Félix Guattari, consignées not. dans leurs 2 volumes fondateurs : L'Anti-Oedipe et Mille Plateaux. Balke constate d'évidents parallèles entre les réflexions de l'un et des autres : Deleuze et Guattari, en évoquant ces flux modernes, surtout ceux d'après 1945 et de l'américanisation des mœurs, parlent d'une « effusion d'anti-production dans la production », c'est-à-dire de stabilité coagulante dans les flux multiples voire désordonnés qui agitent le monde. Pour notre Carl Schmitt d'après 1945, l'« anti-production », c'est-à-dire le principe de stabilité et d'ordre, c'est le « concept du politique ».
Mais, dans l'effervescence des flux de l'industrialisme ou de la « production » deleuzo-guattarienne, l'État a cédé le pas à la société ; nous vivons sous une imbrication délétère de l'État et de l'économie et nous n'inscrivons plus de “telos” à l'horizon. Il est donc difficile, dans un tel contexte, de manier le « concept du politique », de l'incarner de façon durable dans le réel. Difficulté qui rend impossible un retour à l'État pur, au politique pur, du moins tel qu'on le concevait à l'ère étatique, ère qui s'est étendue de Hobbes à l'effondrement du IIIe Reich, voire à l'échec du gaullisme.
Dé-territorialisations et re-territorialisations
Deleuze & Guattari constatent, eux aussi, que tout retour durable du politique, toute restauration impavide de l'État, à la manière du Léviathan de Hobbes ou de l'État autarcique fermé de Fichte, est désormais impossible, quand tout est « mer », « flux » ou « production ». Et si Schmitt dit que nous naviguons, que nous consignons nos impressions dans des Logbooks, il pourrait s'abandonner au pessimisme du réactionnaire vaincu. Deleuze & Guattari acceptent le principe de la navigation, mais l'interprètent sans pessimisme ni optimisme, comme un éventail de jeux complexes de dé-territorialisations (Ent-Ortungen) et de re-territorialisations (Rück-Ortungen). Ce que le praticien de la politique traduira sans doute par le mot d'ordre suivant : « Il faut re-territorialiser partout où il est possible de re-territorialiser ». Mot d'ordre que je serais personnellement tenté de suivre... Mais, en dépit de la tristesse ressentie par Schmitt, l'État n'est plus la seule forme de re-territorialisation possible. Il y a mille et une possibilités de micro-re-territorialisations, mille et une possibilités d'injecter de l'anti-production dans le flux ininterrompu et ininterrompable de la « production ».
Gianfranco Miglio, disciple et ami de Schmitt, éminence grise de la Lega Nord d'Umberto Bossi en Lombardie, parle d'espaces potentiels de territorialisation plus réduits, comme la région (ou la communauté autonome des constitutionalistes espagnols), où une concentration localisée et circonscrite de politisation, peut tenir partiellement en échec des flux trop audacieux, ou guerroyer, à la mode du partisan, contre cette domination tyrannique de la « production ». Pour étendre leur espace politique, les régions (ou communautés autonomes) peuvent s'unir en confédérations plus ou moins lâches de régions (ou de communautés autonomes), comme dans les initiatives Alpe-Adria, regroupant plusieurs subdivisions étatiques dans les régions alpines et adriatiques, au-delà des États résiduaires qui ne sont plus que des relais pour les « flux » et n'incarnent de ce fait plus le politique, au sens où l'entendait Schmitt.
L'illusion du « prêt-à-territorialiser »
Mais les ersätze de l'État, quels qu'ils soient, recèlent un danger, qu'ont clairement perçu Deleuze et Guattari : les sociétés modernes économisées, nous avertissent-ils, offrent à la consommation de leurs citoyens tous les types de territorialités résiduelles ou artificielles, imaginaires ou symboliques, ou elles les restaurent, afin de coder et d'oblitérer à nouveau les personnes détournées provisoirement des “quantités abstraites”. Le système de la production aurait donc trouvé la parade en re-territorialisant sur mesure, et provisoirement, ceux dont la production, toujours provisoirement, n'aurait plus besoin. Il y a donc en permanence le danger d'un « prêt-à-territorialiser » illusoire, dérivatif. Si cette éventualité apparaît nettement chez Deleuze-Guattari, si elle est explicitée avec un vocabulaire inhabituel et parfois surprenant, qui éveille toutefois toujours notre attention, elle était déjà consciente et présente chez Schmitt : celui-ci, en effet, avait perçu cette déviance potentielle, évidente dans un phénomène comme le New Age par ex. Dans son livre Politische Romantik (1919), il écrivait : « Aucune époque ne peut vivre sans forme, même si elle semble complètement marquée par l'économie. Et si elle ne parvient pas à trouver sa propre forme, elle recourt à mille expédients issus des formes véritables nées en d'autres temps ou chez d'autres peuples, mais pour rejeter immédiatement ces expédients comme inauthentiques ». Bref, des re-territorialisations à la carte, à jeter après, comme des kleenex... Par facilité, Schmitt veut, personnellement, la restauration de la “forme catholique”, en bon héritier et disciple du contre-révolutionnaire espagnol Donoso Cortés.
3. La phase du normalisateur :
La fluidité de la société industrielle actuelle, dont se plaignait Schmitt, est devenue une normalité, qui entend conserver ce jeu de dé-normalisation et de re-normalisation en dehors du principe politique et de toute dynamique de territorialisation. Le normalisateur, troisième figure du décideur chez Schmitt, est celui qui doit empêcher la crise qui conduirait à un retour du politique, à une re-territorialisation de trop longue durée ou définitive. Le normalisateur est donc celui qui prévoit et prévient la crise. Vision qui correspond peu ou prou à celle du sociologue Niklas Luhmann qui explique qu'est souverain, aujourd'hui, celui qui est en mesure, non plus de décréter l'état d'exception, mais, au contraire, d'empêcher que ne survienne l'état d'exception ! Le normalisateur gèle les processus politiques (d'“anti-production”) pour laisser libre cours aux processus économiques (de “production”) ; il censure les discours qui pourraient conduire à une revalorisation du politique, à la restauration des « machines impériales ». Une telle œuvre de rigidification et de censure est le propre de la political correctness, qui structure le « Nouvel Ordre Mondial » (NOM). Nous vivons au sein d'un tel ordre, où s'instaure une quantité d'inversions sémantiques : le NOM est statique, comme l'État de Hobbes avait voulu être statique contre le déchaînement des passions dans la guerre civile ; mais le retour du politique, espéré par Schmitt, bouleverse des flux divers et multiples, dont la quantité est telle qu'elle ne permet aucune intervention globale ou, pire, absorbe toute intervention et la neutralise. Paradoxalement le partisan de l'État, ou de toute autre instance de re-territorialisation, donc d'une forme ou d'une autre de stabilisation, est aujourd'hui un “ébranleur” de flux, un déstabilisateur malgré lui, un déstabilisateur insconscient, surveillé et neutralisé par le normalisateur. Un cercle vicieux à briser ? Sommes-nous là pour ça ?
► Robert Steuckers, Vouloir n°3 nouvelle série, 1995.
◘ Bibliographie :
- Armin ADAM, Rekonstruktion des Politischen : Carl Schmitt und die Krise der Staatlichkeit 1912-1933, VCH/Acta Humaniora, Weinheim, 1992.
- Friedrich BALKE, « Beschleuniger, Aufhalter, Normalisierer. Drei Figuren der politischen Theorie Carl Schmitts », in F. BALKE, E. MÉCHOULAN & B. WAGNER, Zeit des Ereignisses - Ende der Geschichte ?, Wilhelm Fink Verlag, München, 1992 [Nous soulignons la très grande importance de ce texte et soulignons que nos propos en sont fortement tributaires].
- Hasso HOFMANN, Legitimität gegen Legalität : Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, Duncker & Humblot, Berlin, 1992 (2° éd.).
- Matthias KAUFMANN, Recht ohne Regel ? Die philosophischen Prinzipien in Carl Schmitts Staats- und Rechtslehre, Karl Alber Verlag, Freiburg/München, 1988.
- Günter MASCHKE, « Drei Motive im Anti-Liberalismus Carl Schmitts », in Klaus HANSEN & Hans LIETZMANN, Carl Schmitt und die Liberalismuskritik, Leske & Budrich, Leverkusen, 1988.
◘ De Carl Schmitt :
- Positionen und Begriffe, Duncker & Humblot, Berlin, 1988 (2° éd.).
- Die Diktatur, Duncker & Humblot, Berlin, 1978.
- Legalität und Legitimität, Duncker & Humblot, Berlin, 1968 (2°éd.).
- Der Hüter der Verfassung, Duncker & Humblot, Berlin, 1969 (2° éd.).
- Glossarium : Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Duncker & Humblot, 1991.
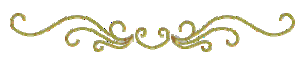
Panajotis Kondylis : Pouvoir et décision
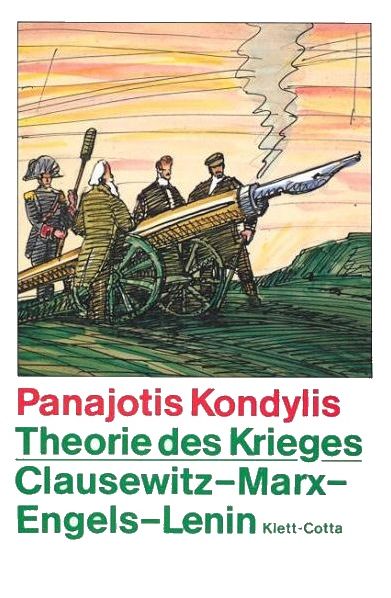 Professeur de philosophie à l’Université de Heidelberg, le regretté Panajotis Kondylis (1943-1998) n'a cessé d'interroger la Modernité. Il appartient à une école de pensée auquel se rattachent Machiavel, Clausewitz, Max Weber. Son apport essentiel est ce qu'il nomme le "décisionnisme descriptif" (la scientificité ayant en effet pour lui plutôt vocation descriptive que prescriptive ou normative). Du point de vue de l'anthropologie politique, il soutient que toutes les idéologies, perceptions et croyances ne sont rien de plus qu'un effort pour doter nos intérêts humains d'une forme normative et d'un caractère objectif, résultant d'une "décision" sur les moyens à employer, nos choix de vie et de société, notre compréhension des rapports de pouvoir.
Professeur de philosophie à l’Université de Heidelberg, le regretté Panajotis Kondylis (1943-1998) n'a cessé d'interroger la Modernité. Il appartient à une école de pensée auquel se rattachent Machiavel, Clausewitz, Max Weber. Son apport essentiel est ce qu'il nomme le "décisionnisme descriptif" (la scientificité ayant en effet pour lui plutôt vocation descriptive que prescriptive ou normative). Du point de vue de l'anthropologie politique, il soutient que toutes les idéologies, perceptions et croyances ne sont rien de plus qu'un effort pour doter nos intérêts humains d'une forme normative et d'un caractère objectif, résultant d'une "décision" sur les moyens à employer, nos choix de vie et de société, notre compréhension des rapports de pouvoir.
Illustration : Couverture de son essai sur la guerre décrite comme pluridimensionnelle historiquement, nécessitant de fait la primauté du politique.
Les livres les plus intéressants de Panajotis Kondylis, décédé en juillet dernier, sont : Geschichte des Konservativismus, Theorie des Krieges, Der Niedergang der bürgerlichen Lebensform et Macht und Entscheidung (Histoire du conservatisme, Théorie de la guerre, Le déclin de la forme vitale bourgeoise et Pouvoir et décision). Dans Pouvoir et décision, Kondylis plaide pour une forme de la pensée qui a été copieusement décriée au cours des dernières décennies, et qui est le fondement de la démarche philosophique de Carl Schmitt. Kondylis justifie l’option de Schmitt en défendant le décisionnisme, tombé dans le discrédit depuis que les penseurs “héroïques” de la “Révolution conservatrice” s’en sont emparé. Dans son ouvrage sur la décision, Kondylis démontre, appuyé sur ses innombrables connaissances, que toutes nos identités collectives et individuelles, y compris leurs expressions philosophiques ou rationnelles les plus élevées, reposent sur un fondement inaliénable qui est toujours une décision initiale, irrationnelle en dernière instance, révélant un rapport ami/ennemi.
 Les idées sont dès lors des armes, qui servent l’objectif biologique de la lutte pour la survie ou pour l’accroissement de ses propres forces. La croissance et l’augmentation volontaire de ses potentialités dépendent étroitement, en fin de compte, de l’impératif de survie, auquel on ne peut se soustraire. Justement, c’est dans les périodes de crise que les individualités et les collectivités reviennent aux racines de leur propre identité, pour se renforcer et maintenir leurs forces. De ce fait, dans la formation des systèmes de pensée identitaires, la logique est un moyen parmi d’autres moyens, mais auquel on peut finalement renoncer.
Les idées sont dès lors des armes, qui servent l’objectif biologique de la lutte pour la survie ou pour l’accroissement de ses propres forces. La croissance et l’augmentation volontaire de ses potentialités dépendent étroitement, en fin de compte, de l’impératif de survie, auquel on ne peut se soustraire. Justement, c’est dans les périodes de crise que les individualités et les collectivités reviennent aux racines de leur propre identité, pour se renforcer et maintenir leurs forces. De ce fait, dans la formation des systèmes de pensée identitaires, la logique est un moyen parmi d’autres moyens, mais auquel on peut finalement renoncer.
Dans les systèmes théologiques, les principes de l’homme-créé-à-l’image-de-Dieu et la faillibilité humaine constituent des contradictions sur le plan logique. De même, dans l’anthropologie de l’émancipation (Aufklärung), on trouve une contradiction : l’homme est une fraction de la nature, et, en même temps, les normes culturelles conditionnent le libre exercice de la volonté. Mais ces contradictions s’évanouissent dès qu’on les considère comme l’expression d’une volonté de pouvoir légitime. Les idées et les formes du savoir ne cherchent pas à “reflèter” la réalité : elles sont bien plutôt des constructions et des interprétations qui servent d’armes dans la confrontation ami/ennemi.
Comme Odo Marquard l’a remarqué : vouloir exprimer des vérités éternelles soustraites au temps est l’illusion majeure de la classe bourgeoise, qui pense qu’elle est au-dessus de toutes les autres classes. Les mythes, les religions et les idéologies sont donc des décisions au niveau de la Weltanschauung, qui assurent la permanence et la stabilité des identités. Souvent, la situation historique fait qu’il devient nécessaire de faire subir aux identités des mutations complètes, parce que la communauté politique ou nationale doit survivre. Le maintien de l’identité est un impératif existentiel que l’on ne peut toutefois pas détacher des circonstances spatio-temporelles. Même si l’identité est une fiction, elle demeure un impératif inaliénable. Si une individualité se rencontrait elle-même en temps que personne, mais dans un état antérieur à celui qu’elle revêt aujourd’hui, elle ne s’identifierait pas nécessairement à elle.
► Holger von Dobeneck (article paru dans Junge Freiheit n°34/1998 ; trad. fr. RS).
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 Hommage à Panajotis Kondylis (1943-1998)
Hommage à Panajotis Kondylis (1943-1998)
Toute fama passe. C’est un adage que Panjotis Kondylis, philosophe grec né en 1943, a médité calmement. Il savait que si son œuvre était publiée d’abord en langue grecque, elle n’aurait guère d’impact. Kondylis s’est demandé s’il devait publier en anglais, en allemand ou en français. Finalement, il s’est décidé pour l’allemand. Aussi, dès cette décision prise, il a passé chaque année de sa vie six mois dans les bibliothèques de Heidelberg, six mois dans sa patrie hellénique.
La vie de Kondylis était celle d’un savant isolé, espèce en voie de totale disparition aujourd’hui. Kondylis était indépendant sur le plan matériel car il était issu d’une famille fortunée. Cette indépendance matérielle garantissait son indépendance d’esprit.
Son premier ouvrage, publié en 1979 et épais de 700 pages était la continuation d’études entamées à Heidelberg (Die Entstehung der Dialektik – Eine Analyse der geistigen Entwicklung von Hölderlin, Schelling und Hegel bis 1802 ; La naissance de la dialectique. Analyse d’une évolution intellectuelle de Hölderlin, Schelling et Hegel jusqu’en 1802). Ensuite, il a publié Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus en 1981 (L’idéologie des Lumières dans le cadre du rationalisme moderne). Kondylis n’interprétait pas les Lumières comme une idéologie découlant des principes de la rationalité (sapere aude) mais comme une réhabilitation de la sensualité. Le livre témoigne d’une immense culture livresque, même s’il apparaît un peu sec dans sa volonté opiniâtre de démontrer une thèse unique. Kondylis n’aimait pas les gris. Son ouvrage le plus connu, édité en 1991, Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform – Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne (Le déclin de la forme de pensée et de vie bourgeoise – La modernité libérale et la postmodernité démocratique de masse), était en fait une analyse du phénomène de la masse, de la société et de la démocratie des masses.
En 1992, parait Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg (Politique planétaire après la Guerre Froide). En 1996, Montesquieu und der Geist der Gesetze (Montesquieu et l’esprit des lois). Mais dans les rangs des divers conservatismes, 2 livres ont surtout mobilisé les attentions : Macht und Entscheidung (Pouvoir et Décision, 1984) et Konservativismus - Geschichtlicher Gehalt und Untergang (Le conservatisme : contenu historique et déclin, 1986). Effectivement, sur le conservatisme, peu de livres ont donné une description aussi fouillée du phénomène. La conclusion de Kondylis, contenue déjà tout entière dans le sous-titre de l’ouvrage, a suscité pas mal de critiques. Kondylis affirmait effectivement : « Le conservatisme est mort. Il est historiquement lié à une époque, celle de la noblesse. Tout ce qui, ultérieurement, s’est donné le nom de “conservatisme”, devrait plus être qualifié de “vieux-libéralisme”, car une telle appelation serait plus exacte. Car ces conservatismes sont dorénavant soumis aux conditionnements de la modernité... ». Mais c’est surtout sa thèse principale qui a été rejetée comme trop “mécanique”, malgré l’admiration de toute sa corporation pour une certaine pertinence de sa démonstration et pour son enquête à travers toutes les sphères culturelles de l’Europe : Kondylis affirmait qu’avec la dissolution des restes de la société civile médiévale, c’est-à-dire avec l’abandon de la féodalité et l’élimination des avantages juridiques et publiques de la noblesse, le conservatisme politique avait factuellement cessé d’exister (*).
Enfin, au moment de sa mort, Kondylis, le réaliste qui méprisait la “lourdeur moralisante”, travaillait à un ouvrage en 3 volumes sur la “socio-ontologie”. Hélas, la Grande Faucheuse l’a emporté le 10 juillet, quelques heures avant qu’il ne quitte Athènes pour se rendre à Heidelberg.
► Hans B. von SOTHEN (hommage paru dans Junge Freiheit n°30/1998 ; tr. fr. RS).
* : « Stefan Breuer contestait en particulier que l’on puisse parler de “conservatisme” ou de “néoconservatisme” pour parler de la RC. Il s’appuyait pour ce faire sur les travaux de P. Kondylis qui, dans un gros ouvrage paru en 1986, avait déclaré que le conservatisme, entré en décadence irréversible dans la deuxième moitié du XIXe siècle, n’avait pas pu se renouveler en Allemagne en raison de ses liens historiques avec l’Ancien Régime. Pour Kondylis, l’élimination progressive de la noblesse, caste porteuse du conservatisme historique, a condamné le conservatisme politique, qui n’a pu se survivre à lui-même qu’en composant avec le libéralisme ou en « esthétisant » certains de ses fondements » (AdB, Entretien sur la RC) Cf. « Mais la prémisse (du reste également partagée par Mohler) selon laquelle la RC est un prolongement du conservatisme a été ébranlé par P. Kondylis. Dans une grande étude comparative sur le conservatisme européen, Kondylis a démontré de façon plausible pourquoi ce phénomène doit être compris de la même manière que la Réforme ou les Lumières : comme un concept concret, lié à une époque historique donnée, et qu'il n'est possible de généraliser qu'au prix d'une désubstantialisation complète. L'histoire du conservatisme, selon sa thèse, « coïncide en bonne partie avec l'histoire de la noblesse, ce qui signifie manifestement que la noblesse, en tant que catégorie traditionnellement (dans le sens wébérien) dominante, devait forcément aussi entraîner la fin du conservatisme ayant une pertinence sociale et une force conceptuelle » (S. Breuer, Anatomie de la RC, p. 6).
◘ lire aussi : Ennemi et décision - Hommage à Panajotis Kondylis (P. Christias)

pièces-jointes sur le décisionnisme :
 Au commencement était l’action, nous dit Gœthe. Et pourtant une action a souvent un début difficilement assignable et un inachèvement presque intrinsèque. Certes on parle d’action d’éclat ou de grande action pour désigner des actes délimitables et assignables mais par action il convient de réserver le sens d’entreprises qui se déploient dans la durée, qui comportent du risque, et qui produisent des effets à la fois voulus et imprévus sur le monde. L’action a nécessairement des initiateurs mais elle n’a pas toujours d’auteurs assignables, car, à travers le temps, les agents se passent de l’un à l’autre le relais. Ainsi, l’action des fondateurs d’ordres religieux ou monastiques se poursuit aujourd’hui, tout comme celle de fondateurs de certains partis ou régime politique. L’action, à la différence de l’œuvre (assignable à un auteur, et par là préservable et transmissible), s’incorpore aux choses du monde, se fond dans une histoire, et s’insère dans un milieu qu’elle transforme. En tant que telle, elle perd ses contours et son individualité. Elle s’amalgame à des institutions ou à une histoire. Autrement dit, une action, état produit par un faisceau de circonstances, ne commence pas sur commande. L’action est certes exécution mais elle n’est rien sans la force amplificatoire du milieu : ce n’est pas la matérialité de l’acte mais son contexte qui en définit la nature et la portée, qui le réduit au geste ou l’érige en action. En ce sens, c’est plutôt l’action qui est commencement, c’est elle qui manifeste ce qu’il en est de la force réelle d’une conviction qui ne tire évidence que de son face-à-face avec l’adversité.
Au commencement était l’action, nous dit Gœthe. Et pourtant une action a souvent un début difficilement assignable et un inachèvement presque intrinsèque. Certes on parle d’action d’éclat ou de grande action pour désigner des actes délimitables et assignables mais par action il convient de réserver le sens d’entreprises qui se déploient dans la durée, qui comportent du risque, et qui produisent des effets à la fois voulus et imprévus sur le monde. L’action a nécessairement des initiateurs mais elle n’a pas toujours d’auteurs assignables, car, à travers le temps, les agents se passent de l’un à l’autre le relais. Ainsi, l’action des fondateurs d’ordres religieux ou monastiques se poursuit aujourd’hui, tout comme celle de fondateurs de certains partis ou régime politique. L’action, à la différence de l’œuvre (assignable à un auteur, et par là préservable et transmissible), s’incorpore aux choses du monde, se fond dans une histoire, et s’insère dans un milieu qu’elle transforme. En tant que telle, elle perd ses contours et son individualité. Elle s’amalgame à des institutions ou à une histoire. Autrement dit, une action, état produit par un faisceau de circonstances, ne commence pas sur commande. L’action est certes exécution mais elle n’est rien sans la force amplificatoire du milieu : ce n’est pas la matérialité de l’acte mais son contexte qui en définit la nature et la portée, qui le réduit au geste ou l’érige en action. En ce sens, c’est plutôt l’action qui est commencement, c’est elle qui manifeste ce qu’il en est de la force réelle d’une conviction qui ne tire évidence que de son face-à-face avec l’adversité.
De là 2 exigences donnant forme à l’action : l’adaptation aux circonstances (évaluation du possible) et la volonté de réaliser un dessein. Si ces dernières sont disjointes, l’action demeure sans efficacité, sans inspiration et sans grâce : sa ligne n’est pas une trajectoire mais une succession de segments brisés. C’est le cas de la plupart de nos actes et de nos gestes ; mal enchaînés, disparates, ils ne s’assemblent pas pour constituer une action. Ce défaut ne tire pas à conséquence pour les particuliers ; il est grave chez les hommes publics. Car le chaos ou l’incohérence qui se trouve en eux se propage, par le biais des institutions sur laquelle ils s’influent. L’action publique n’est dès lors que moyen et non plus fin en soi (Marx considère la "classe dominante" bernée par elle-même en raison de son fétichisme de l’argent ; J. Schumpeter décrit la vie politique des démocraties libérales comme un phénomène concurrentiel de fabrication des représentations de l’opinion). Si l’action a de par nature une incidence sur la vie collective, elle n’est pas que mise en branle de forces en vue d’un résultat, elle s’inscrit dans le dramatique de l’histoire : l’effectivité comporte une dimension éthique qui ne lui est pas ajoutée du dehors mais qui la constitue du dedans.
Ainsi, pour Julien Freund, sociologue et philosophe français qui dans de nombreux ouvrages réévalue les concepts classiques de la pensée politique, c’est la logique de la décision qui circonscrit l’essence du politique. La décision (du lat. decidere : couper, trancher) n’est point seulement cette opération cruciale qui fait d’un projet une action. L’instant décisif est aussi ce point de non-retour, celui à partir duquel le cours des choses devient irréversible. Pour qu’il y ait décision, il faut que cette coupure ait la forme d’une bifurcation, d’un choix : si l’agent est réduit a un comportement unique et nécessaire, on ne parle pas d’action. Voilà pourquoi la décision se distingue de la résolution (intention ou projet dont l’exécution se révèle une obligation) ou de la conviction qui reste un mobile d’ordre intérieur. Elle est risque assumé, invention désirée, inattendu accepté.
À la différence du geste qui peut être répété, la décision d’entrependre prend acte de l’historicité en ce qu’elle est à la fois initiative et effet, conséquence, modification, suite. C’est là la pari de tout grande politique. Avec la formule "L'autorité, non la vérité, fait la loi" (Hobbes), Freund nous donne à comprendre immédiatement en quel sens la décision est un acte d'autorité. En politique, l'objet de la décision n'est pas de trancher entre le vrai et le faux, mais, en présence de plusieurs possibilités, de peser le pour et le contre de ce qui parait le plus opportun par rapport à l'objectif visé. La décision en cela se rattache à un choix de civilisation. Pour nous autres sentinelles des temps à venir, elle est dans cette perspective l’épreuve de feu par lequel l'imperium prend corps et se fait empire.
◘ Ill. : Le nœud gordien était un nœud en écorce de cornouiller et son entrelacement était si complexe que personne ne pouvait le dénouer. Une rumeur prédisant que celui qui arriverait à le dénouer deviendrait le maître de l'Asie se répandit. Alexandre, voyant qu’il n’arrivait pas à le défaire, le trancha en 2 d’un coup d’épée.

QUE VEUT DIRE : PRENDRE UNE DECISION ?
On peut parler de nos jours d'un complot intellectuel contre la notion de décision, comme s'il fallait ranger celle-ci parmi les concepts éthiquement impurs. Du moins en Europe, où l'on a même élevé la non-décision au rang de principe de la cohabitation humaine et de l'avenir, supposé heureux, des sociétés de demain. Le démocratisme régnant, qui préconise comme méthode de gestion des relations entre les hommes la concertation, le dialogue, la contestation et l'autogestion, est le principal responsable de cette dérive, au mépris de l'idée même de démocratie. En effet, la démocratie est une cratie, ce qui signifie étymologiquement la disposition du pouvoir à commander et à décider. En faisant de la capacité de décider une tare, le démocratisme moderne contrevient à la notion de démocratie ; il en est la caricature. La décision est l'attribut de l'autorité, sans laquelle il n'y a ni ordre ni société viable possible. Les universités européennes en font la triste expérience depuis 1965. Elles ont fait du dialogue permanent et de l'absence de décision le principe de leur institution, de sorte que, actuellement, les professeurs et les étudiants ont la nostalgie de l'époque où il était permis de prendre une décision. Malheureusement, habitués à la non-décision, ils ne savent plus comment sortir avec honneur de l'impasse dans laquelle ils se sont engagés imprudemment.
On sait également dans quel guêpier les Anglais se sont fourvoyés, à l'époque du gouvernement du Labour Party, pour s'être pliés au régime de la non-décision, prôné par les trade-unions : l'économie du pays reste au bord de la faillite, et par voie de conséquence le confort des citoyens et le crédit de leur pays en sont affectés. La France est en train de suivre le même chemin sous la houlette du parti socialiste qui, parce qu'il se donne pour règle, selon les propos de Pierre Mauroy, la controverse et la polémique entre les membres du gouvernement, mène une politique incohérente dont l'issue ne peut être que catastrophique. (Et déjà, à force de conciliabules conflictuels, l'économie française est devenue la grande malade de l'Europe). Or, en dépit de tous ces échecs, l'idéologie anti-décisionniste continue à faire des ravages. Elle passe toujours pour la solution de l'avenir. Mais, comme toute idéologie, elle repose sur une absence de réflexion et d'analyse, en l’occurrence sur l'absence d'une analyse de la nature du phénomène de la décision.
La critique des interprétations erronées de la pensée globale de Schmitt, et non la référence à tel ou tel passage particulier, sélectionné pour les besoins d'une idée préconçue, nous aidera à situer le problème de la décision dans le cadre de l'activité humaine en général et, par conséquent, à saisir l'essence de la décision. Schmitt passe urbi et orbi pour l'apôtre d'une politique décisionniste, à la suite de Max Weber. Il serait pour cette raison un auteur particulièrement compromettant. À la vérité, on se méprend sur Schmitt et sur Weber. Dans son ouvrage Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens (1), Schmitt fait une triple distinction entre la pensée purement normativiste, la pensée purement décisionniste et la pensée de l'ordre concret. Si j'ai bien compris le fil conducteur de ce livre, la conception normativiste et la conception décisionniste sont également légitimes, théoriquement, mais la politique empirique, aux prises avec des situations concrètes, ne saurait se satisfaire absolument ni de l'une ni de l'autre. Elle doit en effet savoir coordonner norme et décision dans le cadre de l'ordre concret. Cette coordination est celle des Gegensatzpaaren, wie "ratio" und "voluntas", Objektivität und Subjektivität, unpersönliche Norm und persönnlichen Wille (2).
La raison purement impersonnelle et objective est toute aussi impuissante à maîtriser l'ordre concret que la volonté purement personnelle et subjective. C'est que toute situation concrète est complexe, voire contradictoire. De ce point de vue, on peut dire de l'absence de décision ce que Schmitt dit de l'absence de norme : eine reine, situationslose und typenlose Norm wäre ein juristisches Unding (3). Gouverner un ordre concret exige à la fois des normes et des décisions. Les normes sont nécessaires, parce que toute situation est la résultante de situations antérieures et d'un ordre établi selon des normes, mais les décisions le sont tout autant parce qu'il faut faire face à la nouveauté et à l'imprévu qui ne sont pas contenus dans les normes. De ce fait, du moment que nous vivons dans un contexte social, sans cesse en mouvance, le pur normativisme est à rejeter au même titre que le pur décisionnisme. Cette idée de l'ordre concret est indispensable pour comprendre la notion de décision, non point dans sa pureté théorique et philosophiquement abstraite, mais dans sa réalité sociologique, dans le contexte du développement d'une société donnée et non pas imaginaire.
La décision est un acte de volonté, mais elle n'est pas pure volonté, un fait ou un acte arbitraire et inconditionnel qui inaugurerait un nouveau cours des choses à partir de rien. Personne ne prend une décision pour le simple plaisir de la prendre, mais parce que la situation l'exige. De plus, il faut tenir compte des données et des antécédents de la situation ainsi que du tempérament des hommes auxquels on s'adresse. Admettons que Schmitt soit davantage porté vers le décisionnisme. Il n'est cependant pas un partisan du volontarisme, parce qu'il ne croit pas à l'utopie révolutionnaire. Quelle est donc la différence entre le volontarisme et le décisionnisme ?
Le volontarisme estime que, une fois qu'on a élaboré théoriquement et abstraitement une doctrine considérée comme généreuse et secourable pour toute l'humanité, il suffit d'avoir la volonté de la réaliser, d'y mettre toute sa volonté, indépendamment des circonstances, des conditions et des éventuelles résistances qu'on peut rencontrer, et l'on réussira. Prenons le cas des révolutionnaires marxistes de type léniniste qui raisonnent tous selon ce schéma. Ils estiment que l'émancipation totale du genre humain constitue un projet bienfaisant et avantageux pour l'humanité entière ; de ce fait il faut à tout prix l'actualiser. En conséquence, on démolira l'ancienne société pour créer une sorte de point zéro dans l'histoire à partir duquel on construira la nouvelle société, quelles que soient les réticences morales, quelle que soit l'opinion des hommes et quel que soit le coût, fût-ce l'élimination physique de tous les opposants et même des hésitants. Du moment que la doctrine est bonne en théorie, ça doit marcher en pratique. On ne décide même plus, mais on décrète et ordonne uniquement en fonction de l'a priori doctrinal, sans se soucier de quoi que ce soit d'autre. Le décret prend ainsi l'allure d'un acte intemporel que l'on peut appliquer quel que soit l'espace ou la conjoncture concrète.
Le décisionnisme est d'un tout autre genre. Il ne s'agit plus de prendre une résolution à partir d'un rien, d'une pure idéalité théorique, mais en fonction de la situation donnée, en tenant compte de l'objectif qu'on veut atteindre et des moyens disponibles, sauf que, une fois la décision prise dans ces conditions, on passera à l'exécution sans remettre l'initiative en discussion et sans hésitation inutile qui ne peut que retarder l'application. Il ne s'agit pas seulement de faire preuve de volonté, mais de montrer sa capacité à maîtriser une situation dans les limites des problèmes posés, des difficultés et éventuellement des conflits à résoudre et de la disponibilité des autres appelés à concourir à la réalisation du projet. La décision n'est donc pas close sur elle-même, elle n'est pas un acte de volonté isolé sans relation avec un contexte, mais elle établit une nouvelle orientation, compte tenu des conditions qui ont suscité la situation.
À la différence du révolutionnaire marxiste qui est un pur volontariste, le partisan de la Konservative Revolution par ex. est un décisionniste, parce qu'il ne cherche pas à changer les choses pour elles-mêmes, par amour d'une doctrine, mais parce que les circonstances l'exigent, le cas échéant au prix d'un changement radical. Le décisionniste reconnaît les ambiguïtés et les servitudes d'une situation, le volontariste au contraire est, en tant que révolutionnaire, au fond de lui-même un terroriste, parce qu'il entend changer les choses même sans nécessité, uniquement parce qu'il croit personnellement qu'il faut les modifier, au besoin en imposant ses vues de partisan à tout le monde. Le volontariste est en général un militant qui n'agit pas au sens précis du terme, mais qui fait de l'activisme.
Ce débat sur la différence entre volontarisme et décisionnisme est pour nous d'un double bénéfice. Tout d'abord il nous aide à mieux comprendre la finalité de l'activité politique en général : est-elle au service de la société et de ses membres en vue de trouver la solution la meilleure possible aux problèmes qui se posent au cours du développement social, ou bien n'est-elle qu'au service des désirs arbitraires et utopiques de l'activiste qui trouve une jouissance subjective dans la volonté de bouleverser la société en dehors des difficultés concrètes qui peuvent y surgir ? Nous nous contentons de soulever cette question sans la traiter au fond. En second lieu, ce débat nous fournit les premiers éléments, ainsi qu'une orientation, pour l'analyse du phénomène même de la décision. C'est à l'éclaircissement de cette dernière question que nous allons exclusivement nous attacher.
La volonté, l'autorité et l'objectif commun
La décision est donc un acte de volonté, mais de quel genre ? On peut exercer la volonté de nombreuses façons, mais toutes ne sont pas des décisions. En elle-même la volonté est une disposition de l'homme qui le rend capable d'agir, ce qui veut dire qu'il est en mesure d'échapper au déterminisme aveugle des choses et qu'il peut prendre une initiative qui introduit une césure dans le cours déterminé des choses, qui dès lors se développe autrement que s'il était abandonné à lui-même. C'est en ce sens que l'un des plus grands philosophes français, malheureusement trop peu connu, Maine de Biran, faisait de la volonté une puissance hyperorganique, c'est-à-dire une capacité humaine non soumise aux lois de la psycho-physiologie, précisément parce qu'elle est capable de les transcender. Cette vue de Maine de Biran est, à mon avis, confirmée par le fait que les psychologues ont été capables de construire toutes sortes de tests, d'intelligence, de comportement, de résistance physique, mais qu'ils ont échoué dans l'élaboration de tests de volonté, celle-ci étant capable de briser n'importe quelle batterie de tests. Personne ne soupçonne ce dont un être, jusqu'alors lâche, est capable de faire, alors qu'un être jusqu'alors courageux s'effondre brusquement. Mon expérience des camps de concentration est sur ce point significative, et elle explique pourquoi je ne puis partager les vues de nombre de nos intellectuels patentés qui ne raisonnent sur aucune expérience vécue (4). Il me semble malheureusement que les psychologues n'ont pas pris conscience de la portée de leur impuissance à élaborer des tests de volonté concluants. C'est précisément cette faculté incommensurable, au sens littéral de ce mot, de volonté qu'il faut prendre en compte pour mieux comprendre le phénomène de la décision.
La décision est le genre de volonté qui, par son autorité, engage la volonté des autres dans la voie de l'accomplissement d'un objectif commun. Cette définition comporte 3 points qu'il s'agit maintenant d'expliciter le plus clairement possible.
Tout d'abord, la décision est l'expression d'une volonté qui manifeste une autorité. Par autorité, il faut entendre la compétence d'un homme ou d'un groupement d'hommes (par ex. un gouvernement) dans l'exercice de leur fonction. L'autorité d'un professeur, d'un entrepreneur ou d'un ministre réside en effet dans leur aptitude respective à répondre adéquatement aux exigences de leur mission. Seul un professeur incompétent est contraint de faire preuve d'autoritarisme, faute d'autorité, donc d'avoir recours à des menaces et à des sanctions parce qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Les étudiants se plient sans difficulté à l'autorité d'un professeur qui répond à leur attente, c'est-à-dire à la raison pour laquelle ils fréquentent une salle de cours. On ne demande pas à un professeur de chimie ou de géographie d'être un socialiste ou un réactionnaire, mais d'être compétent dans sa matière. Il en va de même d'un entrepreneur. Son autorité est respectée, à moins d'incidents extérieurs, s'il conduit avec maîtrise son usine, tant du point de vue de la gestion que de l'innovation, de sorte que ses subordonnés trouvent des satisfactions matérielles et spirituelles dans leur travail. Dans le cas contraire, il s'expose à être contesté. Un gouvernement qui, à l'image de l'actuel gouvernement socialiste en France, montre son incompétence dans la conduite des affaires économiques et politiques, perd la confiance des citoyens et du même coup toute autorité, de sorte qu'il est obligé de recourir à des mesures coercitives et autoritaires, par ex. le blocage des salaires et des prix. À force de prendre des décisions incohérentes, il perd son crédit et son autorité. L'autoritarisme est la caricature de l'autorité, par inaptitude à prendre les mesures et les décisions appropriées à une situation donnée.
Qu'on le veuille ou non, l'autorité est indispensable dans la conduite des affaires humaines pour éviter que les actes des hommes ne se développent dans le désordre, le chaos permanent, et dans l'irrégularité. En dépit d'un certain indéterminisme mis à jour par la physique moderne, le monde inerte de la matière n'a pas besoin de décisions, parce qu'il se déroule selon un processus uniforme, réversible et relativement prévisible. Le monde humain, au contraire, est soumis à un processus aléatoire, ce qui veut dire qu'il existe en général une pluralité de solutions simultanément possibles. L'ordre humain obéit à des conventions, à des règles qui sont le produit de décisions. Il est tout à fait vrai que toute règle ou toute décision est en son principe arbitraire, mais il s'agit d'un arbitraire qui nous délivre d'un arbitraire pire et plus ample, celui de la confusion conflictuelle des impulsions individuelles. C'est donc parce que la vie humaine comporte de l'aléatoire qu'il faut prendre des décisions. Celles-ci définissent l'ordre et la direction en vue de maîtriser les contingences des situations.
Ainsi comprise la décision a une double signification : d'une part elle organise les conduites des hommes en les rendant compatibles entre elles, d'autre part elle opère au sein de l'aléatoire un choix entre diverses solutions possibles. Dans le premier cas, la décision est un principe d'organisation, en partie irrationnel dans sa source, qui coordonne et de ce fait rationalise dans toute la mesure du possible les comportements respectifs des êtres. Il s'ensuit que, à cause de cette irrationalité, on ne saurait espérer qu'on puisse un jour rationaliser complètement les conduites humaines. En effet, la rationalisation restera inévitablement relative tant du point de vue de la prévision que de celui de la stratégie qui combine les activités. Dans le second cas, il n'y a de décision que parce qu'il y a précisément un choix à faire. Décision et choix sont conceptuellement liés. Cette notion de choix comporte à son tour 3 conséquences.
Tout d'abord la décision hiérarchise l'activité humaine qu'elle commande, qu'il s'agisse de l'activité politique, technique ou autre, selon l'ordre des urgences et des priorités, cet ordre dépendant d'une appréciation évaluative du cours des choses. En second lieu, il ne saurait tout simplement pas y avoir de décision sans alternative. En effet, là où l'alternative n'existe pas, par ex. dans le monde déterminé de l'inertie, il n'est pas besoin de décider. Cette observation nous permet également d'écarter les pseudo-décisions, telles l'activité par résignation, celle que l'on exécute sous la contrainte, ou encore celle qui n'est qu'une expression ou un prolongement de nos désirs ou instincts. (Il n'arrive que trop souvent que la décision aille à l'encontre de nos préférences !). Enfin, le choix implique par lui-même des sacrifices. Une décision qui porterait au même moment sur tout, sans aucun renoncement, ne serait qu'une prédestination : il n'y aurait plus à prendre de décision là où tout serait décidé d'avance.
Ces explications nous apportent suffisamment de précisions pour mieux comprendre en quel sens la décision est un acte d'autorité. Hobbes en a donné la formulation la plus concise : Auctoritas, non veritas, facit legem [L'autorité, non la vérité, fait la loi]. L'objet de la décision n'est pas de faire un partage entre le vrai et le faux, mais, en présence de plusieurs possibles, de peser le pour et le contre au regard de ce qui paraît le plus opportun. La décision a pour fonction d'instaurer l'ordre ou le processus le plus convenable, compte tenu de la situation, des antécédents et de l'objectif à atteindre, afin que les divers intérêts et opinions puissent coexister, au besoin au détriment de l'un ou de l'autre. Par conséquent, contrairement à un préjugé intellectualiste, il existe une différence essentielle entre l'esprit scientifique et l'esprit de décision.
L'esprit scientifique est un esprit de recherche théorique qui exige une constante vérification des propositions par les faits, en continuité logique avec des propositions antérieures, et qui procède par enchaînement de raisons. L'esprit de décision n'a pas besoin de confirmation par les antécédents ou par les précédents ; il lui importe seulement d'être approuvé, ne serait-ce que tacitement, par ceux auxquels il s'adresse. La science se caractérise par la rectitude théorique des conclusions, la décision par le sens pratique d'une solution. À cet effet, la décision exige de la fermeté, de l'audace, un coup d’œil et le sens de l'à-propos, afin d'agir avec le plus d'habileté et d'efficacité possibles. Elle ne recherche pas l'optimum d'une connaissance, mais le maximum de détermination. La science prend en considération le plus d'éléments ou de facteurs possibles pour porter le jugement le plus exact possible ; la décision procède par option, donc par exclusion de certaines orientations, pour se former le jugement le plus approprié possible au regard de la situation - ce qui ne l'empêche pas de se ménager, s'il le faut, une porte de sortie en cas d'échec. La conclusion d'une mauvaise décision est l'échec et non l'erreur.
Il va de soi que la décision n'exclut pas le savoir. En effet, elle a besoin d'informations pour être la plus appropriée possible. Aussi l'homme appelé à décider consulte-t-il des conseillers, aujourd'hui des experts. Toutefois, l'urgence des problèmes à régler ne peut attendre que l'information soit la plus complète, parce qu'à un moment donné il faut prendre parti pour ne pas aggraver la situation. Il faut donc éviter de croire que la meilleure décision serait celle qui résulterait de la plus grande connaissance. Il arrive même fréquemment qu'il vaut mieux prendre une mauvaise décision que de n'en prendre pas du tout ou tergiverser trop longtemps. En tout cas, on n'apprend pas à décider comme on apprend à devenir sociologue ou physicien. Pour la décision le savoir est un adjuvant, il n'est pas son élément constitutif.
Second point : la décision engage d'autres personnes que celle qui décide. La signification courante du terme l'indique déjà : "décider" veut dire que l'on maîtrise une situation, avec ses données et ses difficultés, et que l'on peut dire aux autres ce qu'il faut faire. Celui qui décide n'est pas en général celui qui exécute, sauf en de rares cas, par ex. celui d'une petite entreprise commerciale ou artisanale, où le patron met lui aussi la main à la pâte. La décision est signe, elle n'est pas elle-même acte. Elle est la puissance qui fait passer les autres à l'acte. De ce fait, elle appelle l'obéissance et la discipline des autres, car sans le passage de l'intention ou du signe à l'acte, une décision reste pur désir ou souhait. Une décision ne s'adresse donc pas à soi-même ; elle communique à autrui ce qui est à accomplir. L'expression "se décider" (sich entscheiden) n'est décision qu'au sens figuré : il s'agit plutôt d'une résolution (sich entschliessen).
Il découle de ce caractère conceptuel 2 conséquences. La première est que la décision est l'œuvre d'un seul ou tout au plus d'une minorité. Le Parlement qui décide de la loi (qu'il n'est pas chargé lui-même d'appliquer) est une minorité, qu'on l'appelle aristocratie des partis ou oligarchie. Une décision peut donc être collective, par ex. celle d'un gouvernement, mais cette collectivité est minoritaire. Cette observation nous amène à faire justice de l'idéologie de la participation, entendue comme collaboration de tous ou de la majorité à la prise de décision. La participation existe seulement du fait que, sans le concours des autres, une décision reste lettre morte. On peut éventuellement aussi envisager la participation sous la forme de la co-gestion ou de commissions consultatives, mais à condition que ces organes ne possèdent pas le pouvoir de décider. La décision collective de la majorité, y compris l'unanimité, si elle est peut-être éthiquement souhaitable, est en pratique funeste, à tout le moins inefficace.
La quasi totalité des essais de démocratie directe ou d'assemblées majoritaires ayant pouvoir de décision ont été des échecs. Une fois le premier enthousiasme passé, ces organismes se disloquent à la suite de nombreuses et d'âpres discussions qui deviennent des prétextes à autant de conflits internes. Il serait trop long de rendre une visite au cimetière des organisations qui étaient fondées sur le principe de la décision commune. Elles ont, dans le meilleur des cas, conduit à l'inertie et à la paralysie, mais le plus souvent elles ont engendré des catastrophes, par ex. lorsque, sous la Révolution française, on avait accordé aux soldats le droit de décider au même titre que les généraux. Les défaites ont vite balayé ces bonnes intentions. L'indécision n'a en général d'autre résultat que de susciter l'insécurité et la perte de confiance. Une décision n'est pas bonne en raison du nombre des participants, mais en vertu de l'autorité et de la détermination de celui qui décide.
La seconde conséquence situe ce que peut être la responsabilité dans une entreprise. Les idéologies actuellement en vogue revendiquent la responsabilité pour tous. Une fois de plus, on peut approuver cette revendication pour des raisons éthiques, mais en pratique on réclame en général sa part de responsabilité pour mieux la fuir. La responsabilité généralisée est une responsabilité diluée, de sorte que personne ne veut en être comptable en cas d'échec. Rappelons le mot du maréchal Joffre, le vainqueur de la bataille de la Marne en 1914, à qui on avait contesté la responsabilité de la victoire : "Si la bataille de la Marne avait été une défaite, disait-il, je sais qui l'on aurait désigné dans ce cas comme responsable". Le sophisme actuel consiste à ne concevoir le concept de responsabilité que comme un pur et simple engagement au nom d'une conviction. Or, dans sa plénitude, la responsabilité exige surtout la prise en charge des conséquences voulues et non voulues.
Il est inutile de répéter ici l'admirable analyse de Max Weber dans Politik als Beruf et ses pages sur l'éthique de responsabilité opposée à l'éthique de conviction. La responsabilité pèse sur les épaules de celui qui décide. On comprend alors qu'il mette en œuvre toute sa force et son intelligence afin de réussir. Lorsque tout le monde est responsable, personne ne l'est plus. Une fois de plus, les universités nous offrent à ce propos l'affligeant spectacle des conséquences de l'indécision du fait de la responsabilité partagée. Dans de nombreux cas, le système universitaire est paralysé par peur : on craint toute initiative parce qu'elle mettrait en cause les droits acquis. Pour garantir ces droits acquis, les syndicats d'enseignants entendent n'accepter que l'avancement à l'ancienneté. Autrement dit, la gérontocratie n'est pas un régime limité aux sociétés d'autrefois ou aux sociétés archaïques ; parce que les syndicats n'acceptent que l'avancement à l'ancienneté, ils constituent les formes modernes de la gérontocratie.
En dernier lieu, la décision porte sur un but commun à un groupe ou à une collectivité, et non sur l'objectif d'un individu isolé. En un sens, ce dernier point est la conséquence du précédent. Toutefois, il importe d'y ajouter les moments nouveaux qui donnent toute sa prégnance à la décision. En effet, la décision implique la capacité de celui à qui il appartient de la prendre, de fixer la voie à suivre et les méthodes qui permettent d'atteindre l'objectif, d'évaluer les moyens nécessaires parmi les ressources disponibles, de définir les tâches respectives de ceux qui sont appelés à participer à l'opération, enfin de prévoir les replis en cas de résistance ou d'insuccès ou éventuellement d'échec total. Il incombe à celui qui décide de définir la stratégie de l'action, de déterminer les normes de l'exécution, mais également d'échafauder les justifications de l'entreprise, aussi bien pour motiver les participants que pour créer une solidarité entre eux. On pourrait élaborer à ce propos toute une philosophie de la décision pour montrer qu'il est très rare que le but final une fois réalisé coïncide parfaitement avec l'intention initiale, soit que les résultats dépassent les espérances, soit qu'ils soient en retrait par rapport aux attentes. Il n'existe en effet de perfection logique d'une décision qu'en idée.
Les problèmes posés par l'exécution
Cette dernière réflexion nous conduit à reconnaître qu'une décision comporte en général dans son déroulement 2 aspects : elle peut être une décision impérative ou ordre (Befehl), ou bien être un arbitrage, les 2 n'étant pas exclusifs l'un de l'autre. La décision impérative écarte la discussion et refuse d'être mise en question, tout le problème consistant dans la transmission correcte de l'ordre du haut en bas de l'échelle, quitte à faire intervenir des sanctions en cas de défaillances. L'ordre impératif est déterminant pour la sauvegarde de l'unité d'action au cours de son développement. L'arbitrage, lui, intervient du fait des obstacles qu'on peut rencontrer et qui suscitent parmi les participants des divergences d'opinions ou d'intérêts, lesquelles peuvent le cas échéant être également utiles à l'exécution ainsi qu'à la stabilité de l'objectif qu'on veut atteindre. Il est certain que l'arbitrage est par lui-même plus fragile que l'ordre impératif, mais en général il est inévitable. En effet, à défaut de pouvoir concilier les désaccords, il ne reste que de trouver un compromis précaire, au moins jusqu'au moment où l'objectif a été atteint. On aurait tort de déprécier l'arbitrage comme une solution de faiblesse : il a l'avantage d'introduire de la souplesse dans le déroulement. Il n'arrive que trop fréquemment, d'ailleurs, qu'un ordre impératif trop rigide contribue à provoquer l'échec. Pour être efficace, il n'est pas bon qu'une décision soit monolithique. La prétention est également un péché dans ce cas.
Ce troisième point nous amène à aborder la question du prolongement de la décision dans l'exécution, sans quoi elle ne serait qu'injonction vide et creuse. Il importe donc de prendre en considération l'application empirique et concrète de la décision si l'on veut comprendre son essence, parce que l'exécution est son accomplissement. En même temps, nous sommes amenés à soulever la délicate question de la difficulté qu'on peut éprouver à prendre une décision.
L'exécution pose des problèmes au moins aussi embarrassants que la prise de la décision. En fait, c'est le contrôle ou la surveillance du déroulement qui en soulève le moins. La principale difficulté provient de ce qu'une décision n'est pas un impératif isolé, qui trancherait une fois pour toutes. Une entreprise, qu'elle soit politique, économique ou autre, réclame une succession de décisions qui sont loin d'être toujours cohérentes entre elles, qui sont parfois même contradictoires. Et pourtant, il faut maintenir au moins en apparence la continuité du dessein. Il arrive qu'une décision qui était bonne au départ ne puisse pas être répétée par la suite, même si les circonstances sont analogues. De toute façon, une première décision retentit sur les autres décisions à prendre, c'est-à-dire qu'elle détermine une ligne de conduite dont l'ordonnateur est plus ou moins prisonnier. Très souvent, ce n'est même pas la première décision à prendre qui est la plus délicate, mais les suivantes, qui forment une chaîne, sans que les unes procèdent nécessairement des précédentes. C'est cependant cette chaîne qui forme la cohésion et la stabilité de l'entreprise dans la fidélité à elle-même, bien que toutes les décisions ne se laissent pas toujours subordonner à une norme identique. Chaque décision constitue une sphère relativement autonome, qui peut le cas échéant déroger aux raisons qui l'ont conditionnée.
Toute décision appelle ainsi d'autres décisions subséquentes ou secondaires, qui peuvent être aussi capitales pour la suite d'une action que la première. Il est, en effet, très rare qu'une action ne soit la conséquence que d'une seule décision. Cette chaîne de décisions, même si elles correspondent à l'intention primitive, fait que l'action achevée répond rarement à l'intégrité du projet initial. Il y a en général un décalage plus ou moins considérable entre le départ et la réalisation finale, cette dernière constituant le moment vraiment décisif, puisque l'on ne sait qu'à cet instant si l'entreprise a été un succès ou un échec. Cet écart inévitable est l'une des raisons de ce qu'une action, même conduite rationnellement, n'obéit pas à une logique au même titre qu'un raisonnement. À tout instant, il faut faire face à l'imprévu et aux impondérables qui résultent de l'action elle-même, ce qui exige un constant effort de celui qui a l'initiative de la décision. Il faut en effet éviter que les décisions secondaires ne dévient par trop outrageusement par rapport à l'intention originaire. (Il n'est pas rare que le résultat de l'action contredise cette intention originaire, au sens de ce que Max Weber a appelé le paradoxe des conséquences).
La décision, garante de l'ordre et de la justice
Nous sommes ici au cœur des principales difficultés. Ce sont en général, en effet, les hésitations dans la prise des décisions subséquentes qui compromettent le succès d'une action. Si correcte et étudiée que soit par ex. la décision d'un commandant en chef du point de vue stratégique, ce sont cependant les décisions secondaires d'ordre tactique qui conduisent à la victoire ou à la défaite. Ce n'est donc pas sans raison que Clausewitz a considéré la tactique comme l'élément essentiel de toute entreprise. Étant donné qu'il faut sans cesse compter avec les circonstances que l'action suscite du fait de son déroulement même, les décisions successives ne se laissent pas déduire des principes de départ ; elles peuvent seulement s'en inspirer. La correspondance des décisions secondaires avec la situation sur le terrain est au moins aussi importante que leur conformité avec la stratégie de départ.
Les difficultés ne surgissent pas seulement entre les décisions plus ou moins autonomes d'une même chaîne, mais aussi au sein d'une même décision. Une fois de plus, c'est Max Weber qui a fait l'analyse de cette problématique (5). Il est possible que l'exécution d'une décision exige, par suite des obstacles rencontrés ou de la résistance qu'elle provoque, le recours à des moyens supplémentaires non prévus, qui mettent en échec le bénéfice escompté de l'action ou bien qui contreviennent à la qualité de la fin attendue ; il est également possible que certaines conséquences subsidiaires (Nebenerfolge) risquent de blesser nos convictions éthiques ou religieuses ; donc de nous mettre en fâcheuse posture vis-à-vis de nous-mêmes, de sorte qu'il peut arriver que nous soyons obligés de renoncer à poursuivre l'action et de revenir sur notre décision initiale ou bien, si nous voulons la poursuivre malgré tout, de lui donner un nouveau sens. Cela signifie qu'une décision n'est jamais à l'abri de nouvelles évaluations ou de réévaluations en cours de route, du fait que des surprises désagréables sont toujours possibles. Il ne serait pas difficile d'agir et de prendre une décision si l'entreprise pratique se développait avec la même logique qu'un raisonnement théorique. Au surplus, nous pouvons prendre notre temps pour mener à bien une recherche théorique, mais les urgences de la vie nous obligent très souvent à prendre une décision rapide, sans autre garantie que celle de notre savoir-faire.
Nous nous contenterons simplement de signaler en passant que la facilité à se décider est une affaire de tempérament. Il y a des personnes qui, par nature, possèdent le don de la décision prompte et efficace, tandis que d'autres hésitent longuement et ont plus de peine à prendre parti, soit par crainte velléitaire, soit par scrupules. Cet aspect de la question relève davantage de la psychologie de la décision que de l'analyse phénoménologique de son essence. Nous ne discuterons pas non plus les autres questions de la délibération avec soi-même, de la motivation et de la détermination, car elles ressortissent elles aussi à la psychologie. Remarquons seulement qu'il n'est pas vrai qu'une longue réflexion soit nécessaire avant toute décision. Bien sûr, cette déclaration d'un homme politique : "Je décide, ensuite je réfléchis" est avant tout un bon mot, mais il semble bien quand même qu'il y ait des êtres qui possèdent la faveur de savoir prendre parti pour ainsi dire par intuition, sans peser longuement le pour et le contre. Et ils savent prendre par instinct la bonne décision, pour réfléchir ensuite sur les meilleurs moyens et les meilleures chances dans l'exécution. Tout cela nous aide à mieux comprendre qu'une décision ne procède pas nécessairement d'une autre. En matière de décision, la stricte causalité constitue plutôt une vue abstraite de l'esprit.
Les principales inhibitions qui paralysent la capacité de décider sont liées à la notion de responsabilité et des risques qu'elle inclut. En fait, il n'y a tout simplement pas de décision sans risque. Aussi la conception qui fait de la décision un parti n'est-elle pas à rejeter. Toute décision comporte d'ailleurs une double responsabilité : envers les autres et envers soi-même. La responsabilité envers les autres va de soi, à la suite de l'analyse que nous avons faite plus haut. Si la notion de décision a de nos jours une presse relativement mauvaise, c'est parce que se répand l'idée qu'aucun homme ne devrait avoir le droit de décider du sort des autres. Toute la propagande pacifiste par ex. s'oriente dans ce sens : chaque être devrait pouvoir décider de lui-même. La conséquence en est la mise en question de la légitimité de l'autorité. Une fois de plus, il faut reconnaître qu'en théorie et du point de vue de l'éthique inconditionnelle, ces vues sont idéalement nobles. En pratique cependant, et suivant le paradoxe des conséquences qui me semble être une règle que l'histoire confirme sans cesse, ces vues aboutissent au résultat inverse de leur magnanimité généreuse.
La décision est sociologiquement un facteur de sécurité. Les diverses expériences des régimes faibles parce que les gouvernements qui se succèdent ne savent pas prendre une décision, en apportent sans cesse de nouvelles attestations. L'absence de décision ou l'indécision suscite la méfiance entre les citoyens et jette la société dans la détresse. En général, le désordre et la discorde qui s'ensuivent produisent en réaction une révolte qui, le cas échéant, peut conduire au renversement du régime. Et pourtant sans cesse renaissent les idées chimériques qui discréditent l'autorité - mais sans cesse aussi les sociétés qui deviennent la proie de ces idées passent ou bien sous la férule d'un pouvoir despotique ou bien sous la coupe de l'oppression étrangère. Tout se passe comme si, depuis des siècles, chaque génération voulait refaire les mêmes erreurs, comme si l'expérience était intransmissible.
Le risque engourdit également la responsabilité envers soi-même. Celui qui décide prend en effet en même temps la responsabilité du succès ou de l'échec. À moins d'être nihiliste, personne n'aime entrer dans la mémoire des hommes comme responsable d'un échec. Il est vrai que l'ambition et l'appétit téméraire du pouvoir estompent le plus souvent les appréhensions et les inquiétudes que peut susciter la charge de lourdes responsabilités. Au demeurant, il est très rare que des angoissés postulent ce genre de charges. Il n'y a pas lieu de le déplorer car, par peur du risque, ils risqueraient de précipiter dans la peur ceux dont ils seraient responsables.
Il reste à tirer la conclusion sociologique de ces analyses. Il n'est évidemment pas souhaitable que ceux qui ne possèdent pas l'esprit de décision parviennent à occuper des postes de responsabilité, mais il n'est pas plus souhaitable qu'on accorde le pouvoir de décision à ceux qui n'ont pas à en assumer la responsabilité. Or, c'est ce qui arrive fréquemment de nos jours, sous le couvert de l'idéologie de la participation, entendue comme Mitbestimmungsrecht. Étant une expression d'autorité, la décision est aussi la garante de l'ordre. Je n'ai pas personnellement la superstition de l'ordre, parce que je sais que tout ordre comporte une part de désordre, sans laquelle il ne serait qu'oppression. L'idéologie actuelle de la participation est funeste parce qu'elle dilue la responsabilité et la décision dans l'égalitarisme d'une multiplicité d'instances décisionnelles qui sont davantage des organismes de revendication que d'autorité. De ce fait, la notion de hiérarchie se trouve ébranlée. Dans toute société, il existe des relations égalitaires et des relations hiérarchiques. L'erreur serait de ne reconnaître exclusivement de validité qu'aux relations égalitaires ou bien aux relations hiérarchiques. La conséquence en est que nous sommes plongés aujourd'hui dans une société éminemment conflictuelle (Konfliktgesellschaft).
Personne ne conteste de nos jours la nécessité d'une pluralité d'instances décisionnelles, du fait de la complexité des actuelles interactions sociales. L'inconvénient n'est pas là. Il provient de ce que, au nom de la démocratisation, on en arrive à récuser l'autorité au profit d'un confusionnisme généralisé. La démocratie est un régime politique, et légitime comme tel. La démocratisation, par contre, cherche à étendre le principe démocratique à des sphères d'activité non politiques, par ex. la pédagogie, l'économie, la religion ou l'art, où précisément il n'a pas sa place, sous peine de politiser ces activités. Il est tout à fait normal que dans une entreprise moderne, il existe plusieurs directions ou instances décisionnelles (direction technique, administrative, commerciale et autres), mais il est également nécessaire qu'il n'existe qu'un seul centre de décision souverain. De même, il existe des activités comme la justice ou le sport, où la décision par arbitrage est primordiale, mais on ne saurait étendre impunément l'arbitrage à toutes les activités humaines, dans lesquelles il convient au contraire de respecter la décision impérative. C'est ce genre de confusion qu'il faut rejeter.
De fait, la grande désolation que constitue la société conflictuelle a sa source dans ce confusionnisme généralisé, où personne ne se retrouve. Dans les démocraties occidentales, on dilue la décision dans l'égalitarisme d'une multiplicité abusive d'instances décisionnelles, au détriment de la hiérarchie nécessaire. C'est la confusion par absence d'ordre. Dans les régimes socialistes totalitaires, on concentre au contraire dans l'activité politique toutes les décisions, y compris celles qui concernent l'économie, l'art, la science et l'idéologie. C'est la confusion par négation de la spécificité de l'ordre propre à chaque activité humaine, au détriment de la compétence. La conséquence la plus grave de l'absence d'esprit de décision par dilution des responsabilités est que l'on perd du même coup le sens du compromis indispensable à toute société ordonnée : le confusionnisme actuel tue le compromis au profit de compromissions aussi stériles qu’écœurantes.
► Julien Freund, Nouvelle École n°41, 1984.
• NOTES :
-
Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg, 1934.
-
Op. cit., p. 24.
-
Ibid., p. 23.
-
Dans les camps, j'ai compris not. une chose très simple : que la capacité de survivre ne dépendait pas de l'intelligence ou de la logique, mais de la force de résistance et de la volonté.
-
En particulier dans son étude Sinn der Wertfreiheit der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Mohr, Tubingen, 1951, pp. 496-497. Remarquons en passant que, s'il existe de très nombreuses théories ou critiques de la connaissance, les théories ou critiques de l'action sont par contre plutôt rares. Ce sont encore Clausewitz et Max Weber qui demeurent les meilleurs théoriciens en cette matière.
◘ À lire :
-
Julien Freund, penseur "machiavélien" de la politique, S. de la Touanne, Harmattan, 2005.
-
Politique et morale, J. Freund in Krisis n°8.
-
La dialectique du droit, J. Freund in Krisis n°26.
*****
> Pièce-jointe 2 : Bruno Mégret, La Flamme, ch. 10, extrait (source).
Si le gouvernement est l'art de décider, alors notre pays n'est plus gouverné. "On peut parler de nos jours d'un complot intellectuel contre la décision, précise d'ailleurs Julien Freund, comme s'il fallait ranger celle-ci parmi les concepts éthiquement impurs". On peut même dire que l'indécision est désormais instituée au cour même de l'appareil d'État. L'administration et les cabinets ministériels en sont devenus les techniciens scrupuleux. Lorsqu'un problème se présente, le conseiller du ministre rédige une note en 3 parties. - 1ère option : ne rien faire. Cette solution est déconseillée : comment l'opinion réagirait-elle devant l'inaction gouvernementale ? - 2ème possibilité : engager un programme d'actions efficaces mais drastiques. Cette proposition est jugée dangereuse, car elle remettrait en cause des situations et des avantages acquis. Que diraient le président et le Premier ministre si des troubles en résultaient ? - 3ème solution : prendre quelques mesures douces. C'est la ligne qui est vivement recommandée et généralement retenue. Elle présente le double avantage de donner l'illusion de l'action sans rien déranger. Mais, alors même que cette mesure est adoptée, chacun sait qu'elle ne résoudra rien. Tout au plus aura-t-on repoussé les échéances de quelques mois ou, au mieux, de quelques années. Ainsi en est-il dans notre pays des interventions gouvernementales : par crainte de provoquer gêne ou trouble, on laisse les événements se dérouler. C'est l'application du vieil adage de la IIIe République finissante: "Il ne s'agit pas de régler les problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent".
*****
> Pièce-jointe 3 : Michel Rocard, Le cœur à l'ouvrage, O. Jacob, 1987, extrait p. 125-126.
L'aptitude à décider est une des composantes essentielles du tempérament politique et une des des conditions de réussite des responsables. La logique voudrait alors que l'analyse de ses décisions passées soit la meilleure lecture des capacités d'un candidat à assumer un mandat. Là encore, cependant, les choses sont moins simples. La décision de court terme, prise par un homme seul, est souvent visible, mais elle est en général de peu d'importance. La véritable décision politique est largement collective, tout simplement parce que la machine politique est complexe. Un maire ne peut construire un équipement que s'il trouve des subventions et des prêts : d'autres que lui ont donc à se prononcer aussi. Le champ d'action propre d'un ministre est étroit : toute décision ample suppose l'accord d'autres départements, Finances souvent, Affaires étrangères de plus en plus (à cause de l'l'important réseau de conventions européennes et internationales dans lequel nous sommes volontairement engagés), Urbanisme s'il faut construire, Santé dès qu'il s'agit de consommateurs, etc. [...]
Il y a tant d'éléments qu'on ne saurait élucider le vrai mystère de la décision politique. Elle se résume rarement à un acte unique. Elle est un parcours du combattant. Rénover un quartier, mettre en place une allocation sociale, assainir le marché de la viticulture, créer le collège unique, doter la France de l'arme nucléaire exigent d'innombrables étapes et autant de combats. Il faut imposer le principe, à ceux qui exécutent tout comme à ceux qui votent ; il faut arracher l'accord de tous les intéressés sur les modalités, convaincre les hésitants, affaiblir les opposants ; il faut quasiment extorquer les multiples actes formels et succesifs qui constituent la décision, surveiller inlassablement son cheminement dans les méndres de la machine d'État ; il faut contrôler la mise en place et les procédures d'exécution. Il faut enfin... une grande patience ou un grand optimisme pour espérer se voir créditer des résultats. Cette lourdeur inévitable de la machinerie publique a pour effet qu'un homme politique conséquent ne peut guère promettre de décider. Mais il peut promettre d'engager fermement la bataille pour aboutir à une décision. Entre les 2, la différence est considérable.