Cau
 J'ai connu Jean Cau par L'Express où il était grand reporter. Comme on vous envoie au front, on l'avait envoyé couvrir la dolce vita à la française. Dans un chapeau ouvrant l'enquête, L'Express expliquait qu'on l'avait choisi, lui plutôt qu'un autre, pour affronter les nuits d'alcool et de débauche, en raison de sa grande santé morale. Il en fallait certes pour ne pas se perdre dans ce monde à la Fellini. Jean Cau, faut-il le dire, en sortit indemne. Plus tard, L'Express – qu'il avait quitté – ne manqua pas de lui reprocher de n'avoir pas céder au vertige de la décadence. Le magazine, pour sa part, en avait fait ses choux gras.
J'ai connu Jean Cau par L'Express où il était grand reporter. Comme on vous envoie au front, on l'avait envoyé couvrir la dolce vita à la française. Dans un chapeau ouvrant l'enquête, L'Express expliquait qu'on l'avait choisi, lui plutôt qu'un autre, pour affronter les nuits d'alcool et de débauche, en raison de sa grande santé morale. Il en fallait certes pour ne pas se perdre dans ce monde à la Fellini. Jean Cau, faut-il le dire, en sortit indemne. Plus tard, L'Express – qu'il avait quitté – ne manqua pas de lui reprocher de n'avoir pas céder au vertige de la décadence. Le magazine, pour sa part, en avait fait ses choux gras.Plus tard, je retrouvai Jean Cau au fil du Meurtre d'un enfant [1965]. Tout homme, tôt ou tard, étrangle son enfance et l'enterre dans son jardin secret. Jean Cau aimait à y retourner et, même, à le retourner. En surgissaient les gamins et les fillettes des Culottes courtes [1988] ou, comme dans Le Meurtre..., l'image effrayante, terrible, fascinante, entrevue sur les routes de l'été 1940, de ce tankiste allemand, torse nu, bronzé, appuyé contre sa machine et coupant une miche de pain avec son poignard. Et le petit Français contemplait, stupéfait, le jeune dieu victorieux un instant apaisé. Et l'enfant Cau, à qui l'on avait dit que l'Allemand était le Mal découvrait que le Mal était beau. Fabuleuse révélation !
Plus tard encore, j'allai écouter Jean Cau aux Grandes conférences catholiques, à Bruxelles, à l'automne 68. On finissait à peine de réparer les rues du Quartier latin et les sociologues s'appliquaient à tirer des leçons de ce qu'on nommait pompeusement les "événements de mai". En attendant le conférencier, les abonnés parlaient à mi-voix de révolution sexuelle et se demandaient si, au fond, les jeunes n'avaient pas raison de vouloir faire l'amour et non la guerre. Ils faillirent tomber de leurs chaises quand Jean Cau mit en pièces ce qu'il appela ce "slogan judéo-chrétien". "Non ! s’exclamait-il. Faites la guerre ! Faites la guerre à vos lâchetés, à votre paresse, à votre inculture, à votre prétention, à votre malheur ! Faites d'abord la guerre et l'amour vous sera donné de surcroît".
Enfin, je rencontrai Jean Cau chez lui, à Paris, dans son antre d'un cinquième étage sans ascenseur qu'il avait acquis avec les droits d'auteur de son prix Goncourt, La pitié de Dieu. Je l'y vis souvent. Chaque fois qu'un de ses nouveaux livres secouait les modes du temps. De ces nombreuses notes enregistrées, j'ai tiré quelques traits qui, me semble-t-il, campent l'homme et l'écrivain et voudraient inviter à (re)découvrir son œuvre.
Jean Cau était promis, écrit-il à "un bel avenir de mouton intellectuel bêlant les utopies moralistes du temps". Ancien secrétaire de Jean-Paul Sartre [de 1947 à 1956], dans les années où celui-ci était proche du parti communiste, journaliste à L'Express, prix Goncourt 1961 pour La pitié de Dieu, il devait faire, c'était sûr, une carrière dans les lettres et les honneurs. À gauche. "Encore faut-il, au long de ses réflexions, pouvoir se supporter en étranglant chaque matin, à l'aube, des lucidités toujours renaissantes", dit-il. Du jour où, selon son expression, il cessa de suivre la Grande Prostituée, c'est-à-dire la Gauche, l'enfant prodige devint voyou, flic, fasciste, et elle organisa autour de ses ouvrages une conspiration de silence rompue seulement, de loin en loin, par l'insulte et l'invective. Jean Cau me raconta longuement cette rupture, encore qu'il s'agisse peut-être plus d'un malentendu doublé d'un abus de confiance. (Jacques Vanden Bemden)
Jean Cau : Mes origines sont humbles. Mon père était ouvrier et ma mère faisait des ménages, et je crois que je suis à Paris un oiseau extraordinairement rare qu'on devrait mettre en cage et montrer dans les foires : le seul intellectuel qui ait des origines vraiment prolétariennes, dont le père n'est pas général, professeur, notaire, médecin, directeur de magasin, petit bourgeois ou ce que vous voudrez. J'ai fait mes études au sein d'un environnement extraordinairement fruste. Mes grands-parents ne parlaient même pas le français ; ils parlaient la langue d'oc. De même, lorsque j'étais enfant, adolescent, mes parents entre eux parlaient la langue d'oc, par fidélité à leur terre, à leurs origines, à leur race, à leurs enfances. Si bien que dans la famille, on était un peu les Siciliens de la France, comme les Siciliens de New York dont les parents et les grands-parents continuent de parler sicilien alors que les enfants parlent américain.
Donc je grandis dans un environnement pauvre, populaire. Je suis un petit garçon et il y a le Front populaire qui fut, comme vous le savez, la grande exaltation de la gauche, et dans le milieu où je vivais, il apparaissait comme une espèce d'aurore. Ensuite, à peine vais-je entrer dans mon âge de garçon qu'éclate la guerre, et il est hors de question, dans ma famille, dans mon milieu, d'avoir une quelconque sympathie pour les Allemands et pour l'occupation, non plus que pour le gouvernement de Vichy. Et je passe ces années incubé dans un milieu où les mots d'ordre de résistance et, simplifions, les mots d'ordre de gauche dominent les esprits. Vient la libération dans laquelle sombre la droite, identifiée à Vichy, à Pétain, à Darlan et même au nazisme.
Quant à moi je décide de préparer l'école normale supérieure parce que je ne savais faire rien d'autre que parler et écrire le français et me débrouiller un peu en latin et en grec. Et me voilà à Paris, à Louis le Grand, dans un milieu qui m'est totalement étranger puisque 99,9 % des khâgneux étaient des fils de petits bourgeois qui cultivaient un sens assez gratuit des idées que je n'avais pas moi. J'étais un Méridional exigeant, assez sec, assez dur, et je croyais à certains idéaux, à certains mythes, à certaines valeurs.
Plus tard, je rencontre Sartre, je deviens son secrétaire et me voilà engagé dans les sections de l'intelligentsia française et je découvre, non sans quelque stupeur, que tous ces intellectuels étaient d'origine bourgeoise mais adoraient et le peuple et la gauche. Tiens, me dis-je, quelle bonne surprise ! Ces gens n'ont jamais vu un ouvrier de leur vie, ils ont des domestiques et des bonnes mais ils sont de gauche. C'était parfait mais je considérais tout cela d'un œil assez critique et même assez narquois. Si bien que si j'ai été un intellectuel de gauche pendant ces années, j'ai été un intellectuel de gauche curieux, sceptique, en alerte et avec un énorme fond d'ironie.
Et puis, peu à peu, j'ai vu de quoi était fait cette espèce d'idéalisme. D'une énorme naïveté et plus encore au niveau des individus, de mes confrères intellectuels, romanciers, philosophes, etc., il s'agissait d'une liquidation de leur propre enfance et les explications de leur adhésion à la gauche auraient parfaitement eu leur place dans un manuel de freudisme à l'usage des populations sous-développées. C'était à qui liquiderait sa classe, sa famille, son passé dont il avait honte et qui lui pesaient. En bref, leur démarche était proprement névrotique et ils allaient au peuple plus par haine de leur classe, par haine de leur famille, par rejet de leur milieu d'origine que par une adhésion profonde, vraie, vivante. Ils allaient au peuple parce qu'ils n'en sortaient. Moi, pourquoi vouliez-vous que j'y allasse puisque j'en sortais et que je le connaissais ce peuple, et que je l'aimais et que j'en étais.
Ensuite, ce fut le fantastique coup de tonnerre du Rapport Krouchtchev. Je savais bien personnellement ce qui se passait en Union soviétique. J'avais lu Trotsky, j'avais lu Souvarine et Balabanov, j'avais même lu les comptes rendus des procès de Moscou de 36 et de 38 et donc les écailles depuis longtemps m'étaient tombées des yeux. Mais c'est une chose d'entendre quelqu'un dire que Dieu n'existe pas et c'en est une autre de l'entendre affirmer par le Pape au balcon de Saint-Pierre, vous comprenez. Lorsque Krouchtchev a proclamé que Pépé Staline n'existait pas mais qu'il avait été l'un des plus abominables tyrans que la terre ait jamais porté, je me suis dit que cela allait réveiller ma fameuse intelligentsia. En quoi je me trompais. Alors vous voyez que l'évolution que l'on me prête de la "gauche" à la "droite" est beaucoup moins sèche, beaucoup moins précise qu'on ne le pense. Je n'ai pas eu une nuit pascalienne où j'ai abjuré mon passé. Cela a été une mise en question assez difficile parfois, parce qu'il faut abandonner des amis, abandonner un milieu, des foules de choses. L'exercice ne va pas sans mal et il y faut un certain courage. Il faut vraiment mettre sa lucidité au-dessus de tout. C'est ce que j'ai essayé de faire.
• Êtes-vous réactionnaire, je veux dire : en réaction, ou conservateur, dans la mesure où il y a quelque chose à conserver de notre civilisation ?
Mais vous n'avez pas d'avenir si vous n'avez pas de passé ! Tout se fait avec de la mémoire, avec de l'histoire, avec des traditions que l'on essaie justement de transmettre, de sauver, de faire revivre. Est-ce que les Corses, les Occitans, les Basques sont réactionnaires parce qu'ils veulent parler basque, corse, etc., et qu'ils veulent vivre au pays, comme ils disent. Voilà, ma foi, qui pourrait passer pour réactionnaire. Il se trouve que maintenant, parce que la gauche peut l'exploiter politiquement, elle dit que ce n'est pas réactionnaire. Eh bien, si ! C'est réactionnaire. Lorsqu'il s'agit de réagir contre certaines modes, contre certains affaissements, contre certaines démissions, louée soit la réaction ! Si l'on me dit, par ex., que les gosses ne doivent pas se droguer, qu'il faut prendre les mesures les plus brutales, qu'il faut rétablir la peine de mort pour les trafiquants de drogue, je suis pour cette saine réaction !
• Où vous situez-vous politiquement ?
Je ne me pose pas cette question. Le matin, au premier café, je ne me demande pas où je me situe politiquement. Je ne me situe nulle part. On me situe. Bien avant Michel Jobert, j'avais dit que je me situais ailleurs. Ailleurs, où ça ? Disons : en liberté. Je ne suis pas un militant. Absolument pas. "Les militants ont en commun avec les éponges, disait Paul Valéry, qu'ils adhèrent". Eh bien, je n'adhère pas. Je suis un aventurier. Je préfère être un voltigeur, un flanc-garde, que marcher dans le gros de la troupe, dans la masse, si vous voulez.
• En présentant l'un de vos livres, L'Agonie de la vieille, vous disiez que si vous l'aviez écrit en espagnol vous l'auriez intitulé Llanto por la democracia (Un sanglot pour la démocratie)...
Il est de plus en plus sec mon sanglot, vous savez !
• ...mais, par ailleurs, vous appelez l'ordre.
Oui parce qu'il me semble que la démocratie est une forme politique qui est en train de crever et que nous allons inéluctablement vers des ordres. Ils seront noirs, ils seront rouges, ils seront blancs, je n'en vois pas bien la couleur, mais je crois que nous sommes condamnés à l'ordre. Ce n'est pas un souhait que j'émets, c'est un diagnostic. Je suis persuadé que, demain, la démocratie devra passer la main. Évidemment, il y a des ordres de mon choix et d'autres qui le sont moins. Il va de soi que je préfère une France gaulliste telle que nous l'avons connue pendant dix ans avec cette espèce de Don Quichotte monarchique qui s'appelait le général de Gaulle à la France d'un quelconque Georges Marchais. Je suis pour le despote éclairé, si vous voulez savoir mon idéal de gouvernement. Et le gaullisme a réussi ce miracle. De Gaulle gouvernait absolument seul, impunément, mais, coup de chance, ce n'était pas une terreur. Mais souhaiter des despotes éclairés dans une Europe en pleine déliquescence, c'est espérer la venue d'un merle blanc. Il se trouve que la France a été gouvernée pendant dix ans par un merle blanc qui portait un képi de général et que je suis heureux d'avoir connu cette époque. Qui aurait dit que nous aurions un nouveau roi dans la France de 58, républicaine, IIIe République, IVe République, cette affreuse république, radicale, socialiste, amateur de congrès, de banquets, de cassoulet et de bannières tricolores tendues sur les bedaines, avec ces espèces de marionnettes qu'étaient les présidents du Conseil. Pourtant nous l'avons eu, notre nouveau roi. Parce que la France est monarchiste, tiens. La France n'est pas démocrate et la France n'est pas républicaine.
• Deux de vos livres – Les Écuries de l'Occident [1973] et La Grande Prostituée [1974] – portent en sous-titre "Traité de morale". Pourquoi ?
Par provocation. Parce que la morale a mauvaise presse. On en est aujourd'hui à l'anti-morale, à l'anti-héros, et je propose, moi, une éthique de la volonté. J'avais d'abord pensé appeler ces livres : "Vertiges et évidences". Des évidences qui n'osent plus être énoncées tant elles sont évidentes et tant leur force est explosive. En même temps, une certaine lucidité évidente conduit à des propos vertigineux, c'est-à-dire de nature à troubler les repos, les conforts, les conformismes et les bonnes consciences à sens unique. J'ai finalement préféré un titre moins abstrait.
Le rôle du moraliste
• Comment définissez-vous la morale et le rôle du moraliste à notre époque ?
La morale est comme une esthétique. Je trouve que ce qui est moral est beau et que ce qui est non moral est laid. Nous vivons une époque qui sacrifie dans tous les domaines à la laideur. À l'abandon, au ricanement, au sarcasme, à la mise en question systématique, à l'avilissement de l'individu et à la déchéance des sociétés. Mon rôle – le rôle de mon écriture –, c'est celui de Cassandre, prophétisant sur les murs de Troie en train de s'écrouler. Ou si on préfère c'est le rôle d'un médecin qui dresserait un diagnostic féroce, sans aucune complaisance. Le rôle du moraliste, c'est de témoigner et de ne pas baisser les bras, de ne pas déserter même si l'armée est en déroute, de rester debout même si tout le monde en ce moment s'agenouille, se met à quatre pattes ou, pis encore, se vautre.
• Des remparts de l'Occident, que voit Cassandre ?
Ce que vous voyez tous les jours. En résumé, nous sommes en train de glisser sur la douce pente de la décadence. Depuis de nombreuses années, nous vivons dans une sorte de volupté de la décadence. Car il y a une volupté de la décadence. Forcément une ascension est toujours plus difficile : il faut avoir des muscles, il faut s'accrocher à la paroi, se plaquer contre la roche, la creuser ; l'air se raréfie parce qu'il devient de plus en plus pur ; on est de plus en plus solitaire parce qu'on se hisse au-dessus de la masse. Au contraire, il est facile de dévaler une pente, de se laisser glisser. Nous avons vécu une période, qu'on a appelée de consommation – et de consommation déchaînée –, pendant laquelle l'Occident tout enlier s'est abandonné à la volupté de la décadence comme à une narcose. Nous sommes confrontés à une crise monétaire et financière aujourd'hui, économique demain, et la décadence risque fort d'être plus brutale et plus contraignante. À partir de cette constatation, tout se dévide comme une pelote de laine et tout s'explique. L'Occident n'a plus de volonté de vie et d'affrontement. Nous assistons partout à une immense démission. Démission des politiques, des intellectuels, des bergers religieux, des pères. L'Occident tout entier démissionne.
Il ne passe pas forcément par une période de décadence : il risque de s'y engloutir ou, en tout cas, de s'absenter de l'histoire pendant des siècles. On a vu des civilisations mortelles comme disait Valéry et bel et bien mortes. Il s'agit de savoir aujourd'hui si l'Occident blanc qui a marché en tête des autres peuples du monde, n'est pas en train de jeter ses armes dans le ruisseau et de se coucher sur le flanc pour mourir. C'est fort possible. Pourquoi un peuple devient-il décadent ? Les causes sont lointaines et nombreuses : morales, religieuses, politiques. Il est évident, par ex., que nous n'avons plus l'idéologie de notre puissance. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre passent pour superindustrialisés et comptent paraît-il parmi les États les plus riches du monde mais aucun d'entre eux n'a plus l'idéologie de sa puissance. En Occident, on voit s'étaler une énorme puissance rutilante, luisante, grasse de millions de voitures, de frigidaires, d'arsenaux nucléaires mais sans la moindre volonté. Voyez les États-Unis d'Amérique, dressés comme un immense colosse dont les parois crâniennes cacheraient un cerveau prodigieusement mou. Il faut que la volonté de vivre, la volonté de puissance, la volonté d'expansion soient d'abord intellectuelles. Il faut qu'elles hantent les motivations d'une société, d'un peuple ou d'un individu. Faute de quoi, les peuples deviennent décadents et les individus esclaves.
Une volonté de tuer les pères...
• Et quand un homme animé de cette volonté veut la communiquer à son peuple, il est rejeté...
• Qui est responsable ?
La démocratie évidemment qui est incapable de manipuler les sociétés industrielles. D'abord la démocratie est toute récente : elle a cent ans. Ensuite, rien ne prouve que la démocratie, importée d'Angleterre comme le whisky et les corn-flakes, soit le régime idéal pour de vieux pays césariens comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Italie ou l'Espagne. Cette idéologie anglaise n'est pas forcément une panacée pour les autres peuples. La démocratie politique n'était possible que lorsque la société ne l'était pas. Lorsque vous aviez une Église hiérarchisée avec son Pape infaillible, ses cardinaux violets, ses évêques rouges, ses curés noirs, avec sa discipline implacable à l'intérieur des villages, des écoles et de la famille sur laquelle régnait le père, bref lorsque l'image sociale du père était intacte et forte, la démocratie politique était possible. Mais quand la démocratie politique prétend se répandre, à la manière qu'on répand des eaux, dans le corps social, c'est fichu. Vous ne pouvez pas introduire la démocratie au lycée, dans la famille, dans les classes maternelles.
La démocratie n'est possible que lorsqu'elle n'existe pas. Dès qu'elle existe et va vers sa logique absolue, elle débouche sur l'anarchie et scelle la mort de la société qui en est atteinte. Rien n'est démocrate : un corps n'est pas démocrate, la nature n'est pas démocrate, une cellule n'est pas démocrate. Une idée, un idéal ou une aspiration peut être démocrate mais une réalité dans sa vérité quotidienne, non. Ou tout se défait et tout finit par exploser. C'est ce qui est en train de nous arriver : nous mourrons de logique. L'Église par ex. se meurt de logique. Elle a pu vivre aussi longtemps qu'elle répandait le message évangélique en rendant à César ce qui lui appartenait et à Dieu ce qui lui appartenait. C'est-à-dire, forcément, au prix d'une certaine hypocrisie qu'impliquent la force des choses et la cohésion des sociétés.
• C'est la démocratie qui à tué Dieu ?
La Révolution française plus exactement. C'est au XVIIIe siècle que s'est produite la chute, quand des esprits forts ont décidé de se passer de Dieu et ont sorti la Raison du placard. La Raison a servi le temps qu'elle a pu, alors on a découvert l'Histoire, puis le Socialisme. Tous avatars laïcs et mondains de Dieu. Aucun des grands témoins du XIXe siècle, Auguste Comte, Michelet, Marx, n'a douté un seul instant de l'Histoire. Tous ont cru que l'Histoire allait désacraliser complètement l'humanité et qu'on pourrait danser la danse du scalp sur le cadavre de Dieu. Et voilà qu'on s'aperçoit seulement que ce n'était pas si simple et que les sociétés qui ont perdu le sens du sacré s'interrogent sur leur raison d'être. Faute de réponse, elles ne savent plus comment fonder la morale et légitimer l'ordre. On a voulu remplacer Dieu par d'autres totalités mais sans transcendance. On a d'abord voulu substituer à Dieu une totalité immanente : la Raison. Ensuite, on a trouvé une justification de l'aventure humaine dans ce qu'on a appelé la rationalité de l'Histoire. Avec la Grande Guerre et surtout la Deuxième Guerre mondiale et l'apparition du stalinisme, du nazisme, des fascismes, etc. la rationalité et le progrès de l'Histoire tels que les avaient imaginés les idéologues du XIXe siècle en ont pris un rude coup. La dernière utopie, c'est le socialisme, une espèce d'harmonie économique, humaniste, culturelle et patati et patata, qui subira le sort de toutes les utopies : elle basculera dans je ne sais trop quoi. C'est toute la question : sur quoi va basculer la mort des utopies ?
• La Révolution française a pourtant été inspirée par des idées nourries de morale chrétienne ?
Naturellement. Tout s'emboîte et se déboîte parfaitement, comme dans ces poupées gigognes russes ; on est passé de Jésus à Rousseau puis aux idéologues du XIXe siècle et aujourd'hui à Georges Marchais, François Mitterrand, qui ne sont rien d'autre que des chrétiens déviés. C'est l'éternelle utopie humanitariste qui se maintient à travers eux. À cette différence que pendant des siècles, le christianisme avait vécu merveilleusement sa contradiction. Il avait su être l'idéologie, la religion, le discours alibi de l'Occident. On allait aux Indes occidentales, en Afrique ou en Asie avec un alibi inattaquable. Le christianisme a été la bonne conscience de l'Occident jusqu'au jour où il a voulu coïncider avec l'acte, que Dieu et César soient un seul et même homme. Cortès était bardé de fer pour aller porter la croix au Mexique. Quelle croix voulez-vous que l'on porte encore quelque part ? Elle est en miettes, la croix ! Et si certains en portent encore les restes, c'est pieds nus, en gémissant que l'Occident a été coupable de les coloniser, de les dépersonnaliser, de leur ôter leur identité.
• Chaque civilisation porte-t-elle à sa naissance les germes de sa destruction ?
En tout cas, elle semble se comporter comme un organisme vivant. On dirait qu'elle a une enfance, une adolescence, une maturité et une sénescence. La sénescence fait parfois illusion parce que rien n'est plus proche du gâtisme que l'infantilisme. Les vieillards sont souvent de grands enfants : ils mangent des bonbons, ils déconnent, ils regardent les petites filles au trou de la serrure. D'où l'illusion qu'on nourrit sur notre société : "Regardez la jeunesse ! Regardez les enfants !". C'est faux : une civilisation est forte non pas quand elle adore ses enfants mais lorsqu'elles honorent ses anciens. De Moïse au général de Gaulle, ça s'est vérifié cent fois : c'est quand les patriarches marchent à sa tête qu'un peuple est fort, pas quand les enfants cassent la vaisselle.
Ajoutez à cela qu'on ne fait plus la guerre. La guerre redistribuait les cartes, nettoyait les valeurs, saignait les peuples comme au XVIIe siècle on saignait les corps trop chargés de venaisons. Dans cette paix continuée, nous sommes obligés d'accumuler des forces énormes, des arsenaux atomiques. Aux États-Unis, en Union Soviétique, en France, en Chine, en Angleterre et, demain, en Inde, en Israël et un peu partout. Des forces si terribles qu'on n'ose plus les employer et que les peuples ne peuvent plus faire craquer les corsets, faire fuser comme naguère leur volonté de puissance. Cette paix armée dans laquelle nous vivons ne permet pas de bouger un pion sans risquer de faire sauter la planète. Autrefois, les Prussiens et les Français pouvaient s'expliquer les armes à la main ; c'est devenu extrêmement difficile sans déclencher le feu nucléaire qui anéantirait tout. La violence comprimée à l'intérieur des nations, des collectivités des sociétés, des villes mêmes, explose en guerre intérieure, en prise d'otages, en meurtres, en attaques à main armée. L'épée ronge le fourreau. Notre violence patine sur place, se dévore elle-même. La violence c'est une guerre intérieure que nous nous menons à nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas la faire l'extérieur. D'où l'énorme, la prodigieuse violence américaine qui n'arrive pas à s'exporter.
Muscles et sains égoïsmes
• Comment extirper le mal, autrement dit comment en sortir ?
Je n'en sais rien. Je crois que nous allons vers une crise économique qui va nous faire beaucoup de bien et que j'appelle de tous mes vœux. Si nous traversons une situation difficile, tragique, peut-être perdrons-nous notre graisse et recouvrerons-nous, en même temps que nos muscles, nos sains égoïsmes. Car ce qui motivera une réaction, ce sera comme toujours l'égoïsme. Si les Occidentaux étaient sensibles aux affronts politiques, il y a longtemps qu'ils auraient réagi mais le jour où ils seront touchés en un point humblement sensible peut-être appelleront-ils la violence des chefs et même des héros.
• Vous passez pour un écrivain anticonformiste et vous avez reçu la Légion d'Honneur du Président Pompidou...
D'abord je ne l'ai pas demandé et si l'on en est arrivé à une telle inquiétude sur les valeurs qu'il faille s'excuser d'avoir la Légion d'honneur, figurez-vous qu'on me nommerait cardinal ou pape que j'accepterais. Pour la même raison que j'ai appelé mes livres "Traités de morale". Par défi et pour montrer qu'il y a des permanences qui même si elles paraissent ridicules font office d'ancres et peuvent peut-être empêcher nos vaisseaux de partir à la dérive. J'ai aussi accepté la Légion d'honneur parce que ça emmerdait mes confrères qui ont dû dire que j'étais vendu et fasciste (car il est entendu désormais que la Légion d'Honneur est une décoration fasciste : évidemment, c'est pas Krivine qui va la recevoir) et ce côté provoquant me séduisait beaucoup. En plus à l'époque où les curés jettent leur soutane aux orties pour danser le rock'n'roll en blue jeans, la Légion d'Honneur est un hochet qui me plaît.
► Vouloir n°105/108, juil-sept. 1993.

 La mort de l'écrivain français Jean Cau (1925-1993) est passée inaperçue chez les contrôleurs médiatiques, zélotes d'une culture qui s'arrête à la tête de cochon symbolique que clouèrent les « barbares », adversaires du Seigneur des mouches de William Golding – qui vient également de mourir –, sans se rendre compte de l'étrange analogie qui existe pourtant entre la dénonciation moralisante de la « barbarie », exprimée de façon si magistrale par le moraliste Golding, et l'ode à l'aventure que n'a jamais cessé d'entonner l'écrivain français, notamment par la bouche du Chevalier de son roman-essai, Le Chevalier, la mort et le diable [1977]. Au-delà de cette ressemblance qu'il y a entre l'écrivain qui se déchire pour que survivent des instincts puissants (Golding), d'une part, et l'imprévisible écrivain français, d'autre part, qui a rejeté la soumission aux lois d'une civilisation gangrénée (Cau), on doit revenir sur l'histoire exemplaire de ce professeur français de philosophie qui a abjuré la pensée rationaliste pour se situer « au-delà du nihilisme », sur le terrain de l'épique, en adoptant une position transgressive dans le royaume de la littérature ; à la fin de ses jours, ce professeur n'allait-il pas se joindre, bon gré, mal gré, à la tendance différencialiste, en compagnie - dans la mesure où ce terme ambigu peut décrire un solitaire - d'idéologues activistes comme Alain de Benoist, Guillaume Faye, Robert Steuckers, Marco Tarchi ainsi que Jean Thiriart (le prophète de la nouvelle Europe) et Giorgio Locchi (qui s'est davantage penché sur les racines des idées politiques capables de se transformer en « mythes d'action») ; Jean Thiriart et Giorgio Locchi sont, eux aussi, récemment décédés.
La mort de l'écrivain français Jean Cau (1925-1993) est passée inaperçue chez les contrôleurs médiatiques, zélotes d'une culture qui s'arrête à la tête de cochon symbolique que clouèrent les « barbares », adversaires du Seigneur des mouches de William Golding – qui vient également de mourir –, sans se rendre compte de l'étrange analogie qui existe pourtant entre la dénonciation moralisante de la « barbarie », exprimée de façon si magistrale par le moraliste Golding, et l'ode à l'aventure que n'a jamais cessé d'entonner l'écrivain français, notamment par la bouche du Chevalier de son roman-essai, Le Chevalier, la mort et le diable [1977]. Au-delà de cette ressemblance qu'il y a entre l'écrivain qui se déchire pour que survivent des instincts puissants (Golding), d'une part, et l'imprévisible écrivain français, d'autre part, qui a rejeté la soumission aux lois d'une civilisation gangrénée (Cau), on doit revenir sur l'histoire exemplaire de ce professeur français de philosophie qui a abjuré la pensée rationaliste pour se situer « au-delà du nihilisme », sur le terrain de l'épique, en adoptant une position transgressive dans le royaume de la littérature ; à la fin de ses jours, ce professeur n'allait-il pas se joindre, bon gré, mal gré, à la tendance différencialiste, en compagnie - dans la mesure où ce terme ambigu peut décrire un solitaire - d'idéologues activistes comme Alain de Benoist, Guillaume Faye, Robert Steuckers, Marco Tarchi ainsi que Jean Thiriart (le prophète de la nouvelle Europe) et Giorgio Locchi (qui s'est davantage penché sur les racines des idées politiques capables de se transformer en « mythes d'action») ; Jean Thiriart et Giorgio Locchi sont, eux aussi, récemment décédés.
Je dois donc me préoccuper d'un écrivain qui a remonté à contre-courant le processus dégénèrescent, caractéristique de l'intelligentsia, processus marqué par l'abandon de positions dures, comme les convictions marxistes, pour embrasser le credo de la religion universelle démo-libérale, à la suite d'une série d'apostasies et d'aggiornamento, par lesquels ces rénégats ont prétendu justifier leur propre effritement intérieur. Cette situation est parallèle, ô coïncidence, à la chute historique des régimes de socialisme réel. Vu dans ce sens, ces faux héritiers de la gauche ont attendu pour changer de train historique, pour abandonner celui dont la locomotive rouge alla s'écraser contre les squalines volantes de la Guerre des Galaxies ; alors ils ont découvert ce qu'ils n'avaient pas vu pendant 60 ans, grâce à leur découverte subite de la splendeur du credo humanitaire, découverte qui leur permettait de sortir de la caverne platonique pour voir, dans la réalité, que les beaux archétypes de la lutte sociale s'étaient transformés en Goulag concentrationnaire, en impasse post-historique. On assista ainsi à la conversion démocratique de tous ceux qui parvinrent, par mille tours de passe-passe, à se convaincre qu'il était absurde, non seulement de croire en ce qu'ils avaient cru, mais également de conserver un label de gauche, alors que l'on avait ramené le drapeau rouge du Kremlin, pour le remplacer par la bannière tricolore russe.
Aussi peut-on dire avec précision que le courage intellectuel de Jean Cau s'est révélé proportionnel à la lâcheté qui domine les intellectuels capitulards de notre époque. Secrétaire particulier de ce requin affecté de strabisme que fut Jean-Paul Sartre, au cours d'une période – 1947 à 1956 – spécialement importante, Cau fut ce garçon qui honorait Les mouches de sa présence, que le cacardage des oies du capitole considérait comme le « fils spirituel » de l'ouvrier, qui fut le témoin des méchancetés de Simone de Beauvoir, un rédacteur de la revue Les Temps Modernes. Cau apparaissait ainsi comme un parfait intellectuel "organique" en puissance ; mais en même temps, il restait un protestataire ; son avenir s'ouvrait, plein de promesses : il allait être adulé du public, puisqu'il s'affichait de gauche, et bénéficier de la reconnaissance des bien-pensants.
Cependant, Cau, au fond de lui-même, était attiré par autre chose que par cette notoriété artificielle que confèrent les idées à la mode. Dans son for intérieur, l'idée d'une rupture ascendante se mettait à germer, germination dangereuse qui ne pouvait que mal se terminer ; Cau courait ainsi le risque qu'impliquent toujours l'insolence dans la folie, la marginalité ou le silence. En faisant joyeusement siens ces trois ingrédients, Jean Cau, dans la meilleure tradition d'un Drieu, d'un Giono, d'un Brasillach, a osé, comme l'aurait fait Joseph de Maistre, mépriser les principes immortels que les marchands d'idées bêtes et toutes faites ont érigé comme on érige un gigantesque néon publicitaire sur le sommet d'une tour commerciale dominant la ville. Cette rupture a conféré à Jean Cau une extrême singularité, qui le rend exceptionnel, à une époque où on a l'habitude de répéter inlassablement les principes de la foi du temps, comme une version post-moderne du catéchisme de Ripalda (lequel était certainement beaucoup plus intéressant, ne fût-ce que comme exercice de mémoire pour les enfants des écoles catholiques).
Cau a obtenu le prix Goncourt pour son roman, La pitié de Dieu. Ce qui lui a permis de se lancer dans un intéressant travail d'auto-destruction de ses convictions premières. Sous un autre angle, on peut considérer cette démarche comme une libération qui régénère et purifie l'esprit. Délibérément, Cau a immolé le buste que lui réservait la littérature établie et qu'il pouvait déjà narcissiquement contempler sur sa cheminée, avec la délectation de l'homme repu. Il avait déjà connu la gloire quand il était un bien-pensant comme les autres ; il avait déjà été une marchandise contrôlée, un étalon du marché, une prostituée qui non seulement se vend mais qui peut aussi discuter avec les clients. Cependant, un malaise fondamental s'est développé dans son âme, une désaffection totale envers son époque, qui l'a conduit à affirmer désespérément une négation salvatrice...
Comment Cau osa-t-il une telle provocation, comment se sépara-t-il de son environnement, comme se reconstruisit-il en tant qu'homme et qu'écrivain ? Il y a ici un mystère que seuls les dieux, ou son ange gardien, pourraient révéler. Au cours de ma carrière de chroniqueur littéraire, chaque fois qu'un de ses livres paraissait et que je le dévorais, je l'ai successivement qualifié d'« écrivain imprévisible », de « génie indéterminable », livré à des « excès titanesques », d'« expérimentateur de poisons », parfaitement conscient de leur nocivité. Tout comme la sortie de Cau hors de l'église laïque a été impensable, on ne pouvait pas imaginer non plus que ses imperturbables vertus se développeraient avec autant de virtuosité et atteindraient cette sublimité littéraire qui fut d'abord très régionale, trop folklorique au goût de beaucoup de lecteurs. Carlo Coccioli, qui a connu l'auteur, l'a qualifiée, cette littérature, de « méridionale ». Mais elle se purifia petit à petit des scories existentialo-parisiennes, et de ces circonstances propre au midi que ne comprennent guère les autres, ceux du Nord et d'ailleurs, pour se forger sur l'enclume d'une indépendance aristocratique, pour s'éloigner définitivement de tous ces médiocres jugements posés par la critique officielle et le mercantilisme niveleur qui n'obéit plus qu'à l'usure.
Sa littérature s'est rénovée de fond en comble et a trouvé son apogée avec ses Sévillanes et avec Le Chevalier, la mort et le diable, qui constitue l'une des plus grandes œuvres de la littérature française contemporaine. Sous forme d'essai, elle atteint la même perfection que Drieu la Rochelle avec son roman Le feu follet. Tout comme Montherlant, Cau s'est senti attiré par les corridas et sans avoir façonné une œuvre de la hauteur des Bestiaires, il a manifesté sa dévotion pour le sang, pour cette fête sanglante qui évoque la transusbstantiation, les mystères de la Crète antique et du culte de Mithra. Cau a également compris, capté, chanté le sens solaire et le sacrifice humain, symbolisés par le cercle lumineux de cette roue recouverte par la cape. Même chose pour le sang du guerrier et de la bête, fusionné dans son essai L'exaltation des taureaux ou La folie de la corrida.
Cette ascension jalonnée d'épreuves signifia, peur Jean Cau, une rupture avec ses propres limites, un dépassement dans un processus alchimique, au sein duquel la vie fusionne avec l'écriture, la plume avec l'épée et la pensée avec l'action intérieure. Lors de ce cheminement, Cau est parvenu à forger un symbole de sa propre transmutation, élevée à l'épreuve de l'honneur et de la chevalerie, que l'on atteint avec la mort pour résister au diable.
La mort de Jean Cau, à 67 ans, est une perte aussi sensible que celle de Jean Thiriart, qui annonça l'unité de l'Europe pour s'apposer au néo-colonialisme culturel de l'“américanosphère”, que celle de Giorgio Locchi, qui étudia le pouvoir irrationnel du mythe dans la culture politique, du mythe qui est pouvoir mobilisateur par excellence, qui est potentiel animique d'une société inspirée par lui, qui recèle le pouvoir d'unir les hommes qui communient en lui et leur confère un sens du sacrifice.
Face à ces morts, il semble que se lève aujourd'hui un signe abominable, la tête de cochon clouée comme dans l'œuvre du civilisé Golding, mais le Chevalier, coiffé de son heaume, recouvre la page vierge de toute écriture et s'enroule dans la prière de sa foi, une foi habillée de fer. Le cavalier de Jean Cau, vainqueur du Diable, sous la protection des révélations de Dürer.
◘ Guevara, Goebbels : une allure
Quand il publia Une Passion pour Che Guevara, Jean Cau fit, une fois de plus, l'unanimité, ou presque, contre lui. On dit, à droite, qu'il renouait avec ses anciennes et coupables amours ; à gauche, on l'accusa de « récupération de cadavre ». La vérité était à la fois plus simple et plus complexe : Cau liquidait un « compte d'admiration » avec un « héros sacrificiel » qui, à 39 ans, était allé mourir, abandonné de tous les appareils, au fond de la jungle bolivienne. Blessé au cours d'un accrochage, Guevara est ramené, tel un trophée, dans un petit village perdu. Parce qu'ils ne savent que faire de leur encombrant prisonnier, les dirigeants boliviens ordonnent son exécution, mais l'homme chargé de cette besogne tarde à tirer.
Il s'appelait Mario Teran, le petit sergent, qui n'arrivait pas à faire feu sur cet homme blessé, désarmé. Alors, dans une bouffée de honte et de colère, Che Guevara l'a injurié : « Fils de pute ! Tue-moi, tue-moi ! ». Et le sergent Teran a vu rouge et a lâché rafale sur rafale. La scène a un côté hidalgo, un côté espagnol qui éclipse totalement la révolution, l'idéologie, on se retrouve en pleine mythologie. Brusquement Che Guevara est un Espagnol en face d'un autre Espagnol et rien ne compte plus que cette permanence qu' un homme doit savoir mourir et qu'un homme doit savoir en tuer un autre. Dans ces instants, la morale devient ce j'aime le plus au monde : une allure. Elle cesse d'être une éthique pour devenir une esthétique : et je vais vous montrer comment on vit, et je vais vous montrer comment on se bat, comment on se sacrifie et comment on meurt. Cela devient très allural, très beau parce qu'il y a une espèce d'élégance qui, même lorsqu'elle est désespérée, conserve la très grande allure des grands actes héroïques. C'est cela qui m'a séduit chez Che Guevara. Qu'il soit de gauche ou de droite m'a peu importé, j'ai trouvé chez lui l'allure et le courage d'un homme et s'il s'était agi d'un héros de droite, il aurait tout aussi bien fait mon affaire. Si je trouvais un manuscrit informe d'un soldat allemand mort sur le front russe et que la matière me passionnait, je serais tout à fait capable d'écrire comment est mort un homme dans d'autres circonstances et dans l'autre camp, si vous voulez. Prenons, par exemple, la mort du Dr. Goebbels. Une mort superbe, une mort de Romain. Voilà quelqu'un qui a cru jusqu'au bout à la justesse de son action. Lorsqu'il a vu se dessiner un monde absolument contraire à tout ce pour quoi il s'était battu, il a décidé de s'absenter de ce monde et d'y soustraire ses propres enfants. Il y a là encore quelque chose d'extraordinairement beau. Évidemment, si l'on est de l'autre bord, on peut trouver cela répugnant, infâme, il tue ses enfants, c'est la bête qui les égorge, etc., etc., mais, de même que pour Che Guevara, il y a là quelque chose devant quoi, à mon avis, il faut s'incliner.
◘ Les masques de François Mitterrand
Dans sa Lettre ouverte aux têtes de chien occidentaux, Jean Cau brossait un portrait sans complaisance de François Mitterrand. S'il lui arrivât de la retoucher, ce ne fut jamais pour adoucir le trait.
Il y a chez Mitterrand une face aventurière que je ne méconnais pas et je vois assez bien à travers le personnage. Je crois que c'est un monsieur ambitieux, extraordinairement ambitieux qui n'a jamais cru une minute au socialisme. Pour lui, cela n'est qu' une parure de langage. Guy Mollet était socialiste, Léon Blum était socialiste, eux oui, mais pas Mitterrand, certainement pas ! Mitterrand est un opportuniste.
Et puis, je n'oublie pas, par admiration pour le Général De Gaulle, la médiocrité des attaques qu'il a portée contre lui, et la somme d'erreurs, de fausses appréciations, de fausses prophéties qu'il a accumulées contre De Gaulle. Mitterrand prétendait que né du coup d'État le régime gaulliste allait sombrer dans Sedan, que De Gaulle était Badinguet, que De Gaulle se livrait à un coup d'État permanent, que De Gaulle était le complice de l'OAS. Mitterand a déversé sur le képi de cet homme illustre un flot de jugements spécieux qui, déjà, situent leur auteur.
Ensuite, que voulez-vous, il y a des actes que je n'arrive pas à oublier et qui me paraissent extraordinairement révélateurs : un jour, Mitterrand a organisé un attentat contre soi-même et a sauté les grilles de l'Observatoire. Tout cela était combiné pour poser Mitterrand en victime et pour fignoler son image. Il y a là quelque chose que je n'arrive pas à déglutir et qui me restera à jamais en travers de la gorge. J'étais à L'Express et je suis allé voir Mitterrand le lendemain de son attentat-bidon. Je lui ai demandé de me raconter cet attentat et il me l'a raconté et il ma menti pendant deux heures d'horloge. Il m'a raconté des blagues et moi je l'ai cru. Je n'ai même pas imaginé qu'il puisse me raconter des blagues. Et l'article est paru dans L'Express et voilà qu'une lettre est arrivée aux journaux qui décrivait les tenants et aboutissants de cet attentat, comment il serait organisé, où la voiture de Mitterrand serait criblée de balles et dans quel massif des jardins de l'Observatoire monsieur Mitterrand se dissimulerait. Vous imaginez la bombe ! Alors je suis allé revoir Mitterrand chez lui, rue Guynemer, et j'ai vu quelqu'un d'absolument décomposé, quasiment au bord du suicide. Et j'ai écrit un deuxième article, en me forçant, en me battant les flancs, pour essayer de le tirer du fond de ce puits. Ces articles, vous pouvez aller les consulter à L'Express et vous verrez comment on m'a menti et comment j'ai dû me contorsionner pour essayer de sauver ce qui pouvait rester de peau sur les os de monsieur Mitterrand. À partir de là cet homme est à jamais marqué pour moi, parce que je l'ai vu avec des masques et que je ne crois pas à ses sincérités, je ne crois pas à son honnêteté. C'est tout. De Gaulle n'aurait pas sauté les grilles de l'Observatoire. Tout s'oublie, hélas ! Il faut croire que Mitterrand est non seulement un extraordinaire avocat des causes auxquelles il ne croit pas mais qu'il est aussi un prodigieux avocat de soi-même. Chapeau ! Avoir fait oublier son saut de haie, faut se lever matin.

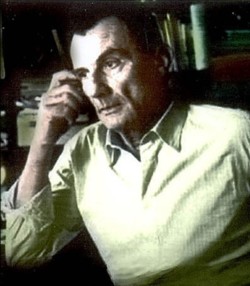 C’est le 18 juin 1993, en plein solstice d’été que Jean Cau nous a quitté pour reposer dans sa terre natale de Carcassonne. Il vit le jour à Bram en 1925, dans cette terre dure et âpre du Lauragais qui façonne les hommes à la serpe d’une rudesse proverbiale. Comme beaucoup, les feux de paris l’attirèrent. À 25 ans, après avoir passé sa licence de philo, il partit à la conquête de la ville des prodiges.
C’est le 18 juin 1993, en plein solstice d’été que Jean Cau nous a quitté pour reposer dans sa terre natale de Carcassonne. Il vit le jour à Bram en 1925, dans cette terre dure et âpre du Lauragais qui façonne les hommes à la serpe d’une rudesse proverbiale. Comme beaucoup, les feux de paris l’attirèrent. À 25 ans, après avoir passé sa licence de philo, il partit à la conquête de la ville des prodiges.
Un drôle de paroissien
Il va rapidement devenir un des légendaires « paroissiens » du tout Paris existentialiste de Saint-Germain-des Prés. En 1947, Jean-Paul Sartre l’engagea comme secrétaire. Près de celui dont il se dira le « fils indocile », Jean Cau participera pendant neuf années à tous les grands débats de la gauche d’alors. On le trouve aux côtés de Simone de Beauvoir, Jean Genet, au cœur de cette fébrile intelligentsia, où la dialectique n’enlève rien au brillant des débats. Il occupe à cette époque, pour travailler, un miniscule bureau rue Bonaparte. Il se rend souvent au théâtre en compagnie de Simone de Beauvoir pour voir répéter les pièces de Jean-Paul Sartre. Il déclarera plus tard : « Je ne luis dois rien mais je lui dois tout ! », il ajoutera « le secrétaire de Sartre ! Jamais titre ne fut plus cocassement porté, jamais patron semblable ne naîtra sous le soleil ».
Les Temps Modernes et le Goncourt
À partir de 1949 il va collaborer à la revue des « temps modernes », il va devenir un écrivain accompli et c’est très justement qu’il recevra en 1961 le prix Goncourt pour son roman La Pitié de Dieu. Comment celui qui avait commencé sa carrière sous les auspices favorables de Jean-Paul Sartre et de France-Observateur [ancêtre du Nouvel Observateur], comment celui qui venait de recevoir le prestigieux prix Goncourt, par un de ces coups de tonnerre, par un courage fou, allait se mettre à dos tout le gratin de la gauche intellectuelle ? Comment Jean Cau est-il devenu un homme de droite ? Lui, aimait à dire qu’il se demandait comment il avait pu être de gauche. Ce paradoxe n’est qu’apparent, en se penchant sur ses racines paysannes et sudistes il affirmait : « c’est moi fils, petit-fils, et arrière petit-fils de serfs qui scande l’éloge de la noblesse ». Ce fut une prise de conscience que de réaliser qu’il appartenait à un autre monde, un monde qui n’était pas gouverné par l’argent, mais par la parole, un monde resté féodal ou seigneurs et serfs étainet précisément du même monde.
L’empreinte de Nietzsche
C’est ce qui le conduira à Nietzsche et à ses affirmations marquées de son sceau « une société inégalitaire produit des élites, une société égalitaire fabrique des malins ». Dès ces premières lignes imprimées, toute la philosophie de Jean Cau y est contenue, et sans qu’il le sache déjà, il ne pouvait pas être de gauche. Ce qu’il reprochera à notre époque est : la lâcheté, la braderie de l’héritage de civilisation légué par nos pères au profit d’un mercantilisme de bas étage, c’est de trahir ce qui a fait notre grandeur et notre force, pire c’est d’en avoir honte et de choisir la voie de l’infantilisation pour fuir les responsabilités. Ce qu’il haïssait le plus dans cette gauche « molle » c’est la légitimation idéologique de l’abaissement.
Retour aux sources
Né sur une terre dure, du côté gris de notre midi qu’il aima avec passion, il fit l’acquisition à deux pas de la mer, d’une bergerie donnant sur l’étang de Bages et de Peyriac de mer qu’il aménagea. On peut voir de ce point de vue imprenable les trains venant de Perpignan qui en rentrant dans Narbonne passe devant la maison de l’autre grand Audois, Charles Trénet qui y repose maintenant.
Sa grande passion pour l’Espagne
Mais la grande passion de Jean, ce fut l’Espagne, celle qui était encore fière et pouilleuse, celle qu’il chanta avec une passion brûlante dans un de ces livres phares : Sévillanes [1987]. Il retrouvait dans les valeurs héroïques du peuple espagnol, la clef de son âme, comme eux, Jean ne pouvait admettre l’amour que comme consubstantiel de la mort. Il aimait à dire que quand on aime la corrida, on ne peut être de gauche, car la corrida est le drame sacré par excellence, la dernière survivance de l’antiquité. Il aimait dans la faena « le temple », cette espèce de douceur nonchalante, qui, dans certains instants de grâce, confère une noblesse indicible recommencée chaque fois, quand l’homme et la bête s’unissent comme dans une danse d’amour et de mort. « Pour moi, quand monte la musique accordée au temple, mon âme (mes ancêtres cathares sont-ils passés par là ?) s’épure pour s’ouvrir à la lumière, ma chair se fait verbe, douce mon endurance et je m’éprouve parfait, lavé de la souillure, car ce à quoi je participe est le bien ».
La solitude du réprouvé
Son cheminement fut exemplaire. Il faut faire preuve d’un courage hors-norme pour après avoir été à la mode, accepter le rôle du réprouvé, affirmer seul contre tous, que la grandeur est mieux que la bassesse, que l’héroïsme est plus honorable que la capitulation, que l’amour est préfèrable à l’érotomanie, que la guerre nécessite des vertus, et surtout que les peuples lâches sont asservis par les peuples braves. La dernière étape de son chemin de croix fut quand il assuma sans peur son nationalisme européen. La sanction ne se fit pas attendre : tous ses amis lui sont tombés dessus ; dès que son nom était prononcé, c’était des cris d’orfraies, dès qu’un de ces livres était publié c’était la chape de plomb du silence de la part des critiques, mais peu importe, il ft preuve d’un talent éclatant, fait de culture et d’ironie, sans parler de son immense contribution au journalisme.
À l’image de Fausto Coppi et de Manolete
C’est pudiquement et silencieusement que ce fils de petites gens du Languedoc, s’en est allé un vendredi de juin, à la veille de sa soixante-huitième année. Il représentait l’archétype du cathare insoumis, lui qui avait le physique de ses deux idoles Fausto Coppi et Manolete, issu comme il aimait à le dire d’une famille et d’un pays maigres, ce qu’il considérait comme une chance. Il était doté d’un orgueil qui le faisait appeler « le loup », en raison de son allure solitaire, il possédait une certaine idée de la France et de l’Europe, à laquelle nous sommes attachés et qui, pour nous comme pour Jean, rien ne peut venir en altérer notre fidélité. Toi, l’amoureux du terroir, de notre hsitoire et de sa grandeur, tu nous as montré la vraie liberté à travers ta vie et ton écriture, tu restes toujours présent dans nos cœurs.
►Jean-Pierre Blanchard, Montségur n°6, nov. 2001.

SA DERNIÈRE CHARGE
 Jean Cau n'est pas parti sans laisser d'adresse... Avant de tirer sa révérence à un monde qui lui inspirait un mépris souriant, il avait confié à des mains amies les manuscrits de ses dernières charges, de ses dernières « embestidas », comme disent les aficionados : Contre-attaques et Composition française sont remplis d'une sainte et joyeuse colère, ainsi que d'une nostalgie bouleversante. Nostalgie d'une civilisation où les mots avaient encore un sens, où les objets avaient du poids, et les hommes un nom. À lire d'urgence. Pour apprendre à résister...
Jean Cau n'est pas parti sans laisser d'adresse... Avant de tirer sa révérence à un monde qui lui inspirait un mépris souriant, il avait confié à des mains amies les manuscrits de ses dernières charges, de ses dernières « embestidas », comme disent les aficionados : Contre-attaques et Composition française sont remplis d'une sainte et joyeuse colère, ainsi que d'une nostalgie bouleversante. Nostalgie d'une civilisation où les mots avaient encore un sens, où les objets avaient du poids, et les hommes un nom. À lire d'urgence. Pour apprendre à résister...
« Comme Jean-Jacques Rousseau – écrit Alain de Benoist –, Jean Cau abandonnait ses enfants à l'Assistance publique. Je veux dire qu'une fois ses livres écrits, leur sort lui devenait indifférent [...]. Il aimait écrire, il ne cherchait pas à paraître. Aux deux sens de ce mot. » (1). Jean Cau était avant tout un homme libre. Les 2 livres qui ont été publiés depuis sa disparition confirment cette attitude tout aristocratique. Confiant le manuscrit de Composition française (Plon, 1993) à Olivier Orban et celui de Contre-attaques à A. de Benoist, il avait dit au premier : « Je ne sais pas ce que ça vaut », et au second : « C'est un texte pour vous, faites-en ce que vous voudrez » ! Superbe élégance d'un Cyrano délaissant les petits papiers du « Mercure François ».
On retrouve la droiture du Gascon dans Contre-attaques, second ouvrage posthume de Jean Cau. Tous les thèmes qui ont nourri ses pamphlets depuis 25 ans y sont réunis. Sévère diagnostic de notre décadence, l'ouvrage se situe entre le testament, la profession de foi et l'épitaphe. Puissant et plein de fraîcheur, c'est un de ses meilleurs livres. Quel plaisir, quelle tristesse aussi, de voir ce picador enfourcher une dernière fois son cheval de bataille en déclarant avec le héros d'Edmond Rostand : « J'aime raréfier sur mes pas les saluts, et m'écrier avec joie : un ennemi de plus. »
L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DES CHOSES
Mi-essai, mi-pamphlet, Contre-attaques s'ouvre sur un Éloge incongru du lourd. « Jean Cau, écrit Gérard Spiteri, qui a toujours pris soin de multiplier les anticorps contre l'obésité intellectuelle, ne parle pas de l'esprit. Il s'en prend avec une ironie féroce à cette légèreté physique et symbolique de notre époque qui a fait du jetable le nec plus ultra de la civilisation » (2). Cet éloge du lourd n'est pas anodin. À partir d'objets courants, c'est à une formidable charge contre la modernité que se livre Jean Cau. « A-t-on réfléchi, écrit-il, à ce que recèle l'acte de jeter, en son sens le plus profond ? Il recèle le mépris. Et si je te jette, rasoir, ce n'est pas parce que tu es vieux mais, mets-toi bien ça dans la tête, parce que tu ne vaux plus rien. Le rasoir Bic ou les briquets Cricket deviennent la remarquable illustration d'une société qui fait l'impasse sur la question du sens. Jetables, ils « ont tué l'amour et détruit la sensibilité puisqu'ils nous ont désappris à être, à quelque chose et partant à quelqu'un, fidèles ». Et, nous dit Jean Cau, essayez de dire : « J'aime mon Cricket » !
Son éloge incongru du lourd ne s'oppose pas tant au léger qu'au mou et à l'éphémère. La force, la durée ont laissé la place à l'immédiat, au jetable. Rien ne tient, rien n'est dur, rien ne dure. La civilisation du « progrès » émousse les sentiments, raccourcit les deuils et ramollit les idées. La société de consommation se charge de fournir perpétuellement des objets neufs, sans histoire, sans mystère et sans âme. L'homme, qui dans un premier temps a fait du monde un objet, s'est ensuite lui-même perdu dans un système d'objets. On aimait, naguère, conserver et transmettre. On estimait en chaque chose la solidité. « Le temps lui aussi, remarque Jean Cau, faisait un long usage et il y avait de la durée partout, dans les fiançailles et les mariages, dans les rêves et les amours. C'était solide. Même la miche de pain que mes bras d'enfant arrivaient à peine à embrasser, tant elle était énorme, durait huit jours et l'acte de jeter du pain relevait des tribunaux sacrés. » Et ce respect disparu, tout ce qui est « vieux » est condamné : « Comme nos sociétés sont en perpétuelle fuite, elles s'allègent pour que leur course soit plus rapide. »
Si Jean Cau se bat, c'est d'abord et avant tout contre un monde envahi par la laideur. « La beauté, écrit encore Spiteri, est la seule divinité à laquelle il ait jamais cru. » Son éthique, sans aucun doute, était avant tout esthétique. Il ne pouvait écrire, par ex., qu'à la main, pour la beauté du geste. L'écriture reste une cérémonie (3). L'encre, le papier, la plume qui court, voilà pour lui une joie physique, palpable : « Je m'ébahis aussi d'être ce moine qui écrit à la main, à l'encre (je préfère ne pas connaître sa composition), sur du papier (même observation), à l'aide d'un lourd stylo à la plume or 18 carats. Mon contemporain se moque en me voyant tracer mes humides sillons [...]. Mon contemporain, lui, écrit (?) à la machine. Soit ! Mais imagine-t-on Racine écrivant Bérénice, toc, toc, toc, à la machine ? [...] Jean, à Patmos – mille regrets ! – n'a pas tapé l'Apocalypse ».
Jean Cau, enfant, n'a connu ni vinyle et nylon, ni Bic et Cricket. Fidèle à sa première jeunesse (4), il se souvient, avec style et pudeur, de l'époque où les objets étaient des trésors et les meneurs de chahut des seigneurs de la guerre, où le sac de billes devenait un butin inestimable et le vieux couteau du père un bien presque sacré. Mais dans Contre-attaques, c'est aussi un Jean Cau orphelin que l'on retrouve, étranger dans un monde peuplé d'anonymes : « Notre prochain n'a plus qu'un prénom. Finie l'époque où le nom renvoyait à l'histoire d'une famille, d'une lignée. Notre voisin ne peut se distinguer ni par ses habitudes, ni par ses vêtements, ni par son travail qui sont semblables aux nôtres ou presque ».
QUE RESTE-T-IL DE SON ESPAGNE ?
Journal de ses rêveries d'écriture, Composition française n'a sans doute pas l'éclat de Contreattaques. Passé maître dans l'art du pamphlet ou de la nouvelle, Jean Cau se livre plus difficilement dans ce genre littéraire qu'il n'avait jamais exploré. Quelques éclairs foudroient pourtant. Que la modernité vienne menacer « son » Espagne (5), et aussitôt renaissent son style et son élan : « Des monstres d'acier jaune, bulldozers, pelleteuses, bétonneuses, tracent des autoroutes. Bientôt, il n'y aura plus de boue, ni de poussière dans ce pays d'Espagne. Déjà, un âne s'y éteint et la mouche et le curé s'y font rares ainsi que l'enfant. Boue, poussière, ânes, mouches, curés et enfants disparus, que resterat-il de mon Espagne ? Le soleil lui-même y est combattu, grâce à l'air conditionné, et, propos inouï ! des Espagnols qui naguère ironisaient sur la mine accablée du touriste s'épongeant et en lequel ils voyaient un vaincu, se plaignent aujourd'hui de la chaleur. »
Ainsi jaillit par intermittence la force imprécatoire du digne héritier d'un Bloy ou d'un Bernanos. Contraint d'affronter une époque sans géants, il s'est battu avec rage contre le mou, le flasque : « Tu as voulu opérer le renversement de toutes les valeurs, dit-il à l'adresse de Nietzsche, mais, ce que tu ne soupçonnais pas, c'est que viendrait un siècle, le XXe en son agonie, où ton courage titanesque serait sans emploi parce qu'il n'y aurait plus de valeurs à renverser. »
► Xavier Marchand, éléments n°80, juin 1994.
◘ Notes :
(1) Contre-attaques, préface d'Alain de Benoist (Le Labyrinthe, 1993).
(2) Gérard Spiteri, « Le roi pêcheur », Le Quotidien de Paris, 5 janvier 1994.
(3) Cf. not. Le Coup de barre (Gal., 1950) et Proust, le chat et moi (La Table ronde, 1984).
(4) Pour bien comprendre « les enfances » de Jean Cau cf. Nouvelles du paradis (Gal., 1980) ou Les Culottes courtes (Le Pré aux clercs, 1988).
(5) Pour retrouver cette Espagne, cf. Le Roman de Carmen (éd. de Fallois, 1990), Sévillanes (Julliard, 1987), Les Oreilles et la queue (Gal., 1990) et La Folie corrida (Gal., 1992).

 Car on est toujours le Pylade de quelque Achille, le Roland d'un Olivier quand on est jeune et ça dure longtemps cette jeunesse entre les hommes, c'est interminable, ça n'en finit pas de s'étirer parce qu'on ne veut pas qu'il meure ce temps des confidences et des fraternités ou l'on allait du même pas, ou l'on bavardait pendant des jours et des nuits de la même voix, ou l'on partageait tout, et même, ça arrivait, les filles. Ou l'on avait comme dit la chanson, un camarade.
Car on est toujours le Pylade de quelque Achille, le Roland d'un Olivier quand on est jeune et ça dure longtemps cette jeunesse entre les hommes, c'est interminable, ça n'en finit pas de s'étirer parce qu'on ne veut pas qu'il meure ce temps des confidences et des fraternités ou l'on allait du même pas, ou l'on bavardait pendant des jours et des nuits de la même voix, ou l'on partageait tout, et même, ça arrivait, les filles. Ou l'on avait comme dit la chanson, un camarade.Et toujours pas de Carbo, de copain, de frère pour lui demander, sans en avoir l'air, d'une voix neutre, comme ça, en buvant un verre, ou en marchant épaule contre épaule, dans la rue : "Drôle d'histoire, non ?" "Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ?". À peu près sûr que Carbo aurait répondu par une plaisanterie et par une plaisanterie certainement énorme. On demande un conseil à son meilleur copain, quand on a l'âge d'un Valentin, en essayant tout de même de l'épater un peu, et l'autre évidemment, nous répond par une plaisanterie, un rire, un calembour. Ce n'est pas qu'il se dérobe, non, mais plutôt parce que ça fait partie d'un jeu très ancien et qu'il y aussi dans l'énormité même que le copain nous balance, à froid ou en riant, peut-être une pudeur. Mais c'est très bien ainsi. Ca remet les pieds sur terre. Ca douche l'émotion et on se remet à être tranquillement un homme au lieu de s'envoler – ô pigeon vole et jeunesse aussi ! – en se prenant au moins pour un albatros.
C'est à coup de bêtises échangées qu'on croit devenir de vrais hommes, c'est à dire rester des enfants. Et cela s'appelle la virilité alors que son vrai nom est si souvent la tendresse. Et si Valentin avait été blessé, et si on avait dû l'amputer d'une jambe, et s'il avait appris cette rude nouvelle à Carbo, celui-ci aurait écrit : "j'espère ma vieille que tu m'a gardé les ongles". Et voilà. Et c'est ça la fraternité imbécile et tendre des hommes. Mais personne ne le sait parce que les adolescents à la voix qui mue à voix basse, parce que les soldats, parce que les joueurs de boules qui s'engueulent sous les platannes, parce que les pêcheurs à la ligne qui se racontent leur dernière prise à gestes fabuleux, parce que les carabins, parce que les grands mômes qui s'envoient des tannées dans les salles de boxe, parce que les nemrod du café du commerce et des voyageurs, parce que Ballu, Ramur, Pérou, le lieutenant Valentin et même N'Doulou, parce que personne ne livre le secret. Mais il y a , dit-on, des femmes douces et rusées qui parfois le devinent. Et les mères, toujours.
► Jean Cau, Le chevalier, la mort et le diable