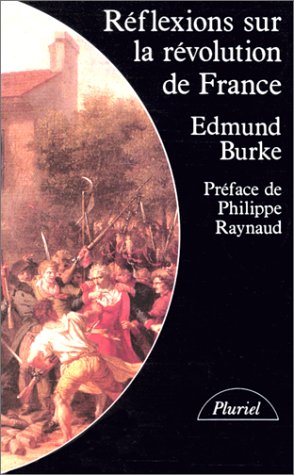Burke
Edmond Burke et la Révolution Française
 Les Réflexions sur la Révolution en France, publiées à Londres le 1er novembre 1790 par Edmund Burke, célèbre parlementaire irlandais, n'ont cessé depuis lors d'irriter la longue suite de nos dirigeants politiques épris de niaiseries démagogiques et accoutumés à endormir l'opinion de mascarades égalitaires dans l'imposture généralisée des “Droits de l'homme et du citoyen”.
Les Réflexions sur la Révolution en France, publiées à Londres le 1er novembre 1790 par Edmund Burke, célèbre parlementaire irlandais, n'ont cessé depuis lors d'irriter la longue suite de nos dirigeants politiques épris de niaiseries démagogiques et accoutumés à endormir l'opinion de mascarades égalitaires dans l'imposture généralisée des “Droits de l'homme et du citoyen”.
À la veille du Bicentenaire dont les fastes dispendieux et grotesques vont encore ajouter au trou sans fond de la Sécurité Sociale et crever un peu plus la misérable vache à lait électorale saignée à blanc par les criminels irresponsables qui, au nom de l'État et pour le bonheur du peuple, osent encore exhiber le bonnet phrygien et se réclamer de la “Carmagnole”, la lecture de Burke, telle une cure d'altitude, est un merveilleux contrepoison.
Félicitons comme ils le méritent le jeune historien Yves Chiron (auquel l'Académie vient de décerner le Prix d'Histoire Eugène Colas) et son éditeur qui rendent enfin accessible au public un ouvrage depuis longtemps introuvable, un auteur dont la liberté d'expression, la vigueur de pensée, la puissance évocatrice et prophétique toujours intacte, réduisent à son abjection et à son néant “l'Événement” dont on nous somme sans répit de célébrer la générosité sublime, la gloire sans pareille, et une grandeur que le monde entier, jusqu'au dernier Botocudo, jusqu'à l'ultime survivant de la terre de Feu et de Rarotonga, ne cesse de nous envier frénétiquement.
Cependant, Yves Chiron note à juste titre dans son étude que « ce qui se passe en 1789-1790 n'est pas un évènement localisé et spécifiquement français : c'est le premier pas vers un désordre généralisé où se profilent la vacance du pouvoir, la disparition des hiérarchies sociales, la remise en question de la propriété — la fin de toute société ».
Plus précisément, c'est la date du 6 octobre 1789 que Burke, contemporain, retient comme signe fatal et révélateur, marqué par le glissement irréversible dans la boue et le sang :
« Dans une nation de galanterie, dans une nation composée d'hommes d'honneur et de chevalerie, je crois que dix mille épées seraient sorties de leurs fourreaux pour la venger (la Reine) même d'un regard qui l'aurait menacée d'une insulte ! Mais le siècle de la chevalerie est passé. Celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé : et la gloire de l'Europe est à jamais éteinte ».
Burke fut le premier à dénoncer l'imposture des “droits de l'homme”
Or, par une sinistre ironie de l'Histoire, il se trouve que la France s'est précipitée dans cet interminable bourbier au moment précis où son prestige était le plus éclatant, son économie en pleine ascension, la qualité de sa civilisation reconnue partout sans conteste. Ainsi que le souligne Yves Chiron, Burke note que les “droits de l'homme” flattent l'égoïsme de l'individu et sont ainsi négateurs, à terme, de la vie sociale. Dans un discours au Parlement (britannique), en février 1790, il s'élève avec violence contre ces droits de l'homme tout juste bons, dit-il, « à inculquer dans l'esprit du peuple un système de destruction en mettant sous sa hache toutes les autorités et en lui remettant le sceptre de l'opinion ».
L'abstraction et la prétention à l'universalisme de ces droits, poursuit Chiron, contredisent trop en Burke l'historien qui n'apprécie rien tant que le respect du particulier, la différence ordonnée et le relativisme qu'enseigne l'Histoire. Il n'aura pas de mots assez durs pour stigmatiser Jean-Jacques Rousseau, “ami du genre humain” dans ses écrits, “théoricien” de la bonne nature de l'homme et qui abandonne les enfants qu'il a eu de sa concubine : « la bienveillance envers l'espèce entière d'une part, et de l'autre le manque absolu d'entrailles pour ceux qui les touchent de près, voilà le caractère des modernes philosophes… ami du genre humain, ennemi de ses propres enfants ».
Un autre paradoxe, et non des moindres, a voulu que les sociétés de pensée, l'anglomanie aveugle et ridicule qui sévissait partout en France alors même que la plupart de nos distingués bonimenteurs de salon ne comprenait un traître mot d'anglais, aient pu répandre l'idée que les changements qui se préparaient seraient à l'image de cette liberté magnifique qui s'offrait Outre-Manche à la vue courte, superficielle et enivrée, d'un peuple d'aristocrates honteux, de sophistes à prétention philosophiques, de concierges donneurs de leçons et de canailles arrogantes.
Logorrhée révolutionnaire et pragmatisme britannique
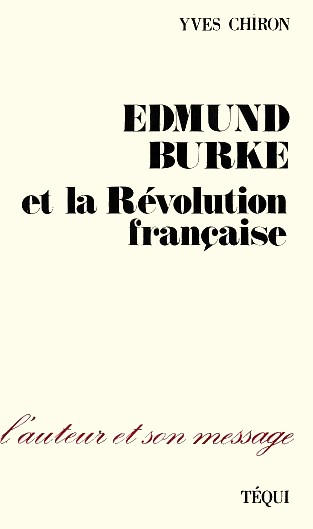 Nul ne s'avisait dans le tumulte emphatique qui remplissait ces pauvres cervelles de débiles et de gredins, de ces “liaisons secrètes” que Chateaubriand a si bien perçues par la suite entre égalité et dictature, et qui la rendent parfaitement incompatible avec la liberté. L'Angleterre, pays de gens pratiques, ne pouvait qu'être aux antipodes de l'imitation “améliorée” que l'on croyait en faire, « et ses grands seigneurs, accourus pour acheter à vil prix le mobilier et les trésors de la Nation vendus à l'encan, n'en revenaient pas de ce vertige de crétinisme et de l'hystérie collective et criminelle emportant follement le malheureux peuple de France vers l'esclavage, la ruine et l'effacement de la scène du monde, au nom de fumées et d'abstractions extravagantes, mensongères et pitoyables ».
Nul ne s'avisait dans le tumulte emphatique qui remplissait ces pauvres cervelles de débiles et de gredins, de ces “liaisons secrètes” que Chateaubriand a si bien perçues par la suite entre égalité et dictature, et qui la rendent parfaitement incompatible avec la liberté. L'Angleterre, pays de gens pratiques, ne pouvait qu'être aux antipodes de l'imitation “améliorée” que l'on croyait en faire, « et ses grands seigneurs, accourus pour acheter à vil prix le mobilier et les trésors de la Nation vendus à l'encan, n'en revenaient pas de ce vertige de crétinisme et de l'hystérie collective et criminelle emportant follement le malheureux peuple de France vers l'esclavage, la ruine et l'effacement de la scène du monde, au nom de fumées et d'abstractions extravagantes, mensongères et pitoyables ».
Quant à la masse du peuple, dit Burke, quand une fois ce malheureux troupeau s'est dispersé, quand ces pauvres brebis se sont soustraites, ne disons pas à la contrainte mais à la protection de l'autorité naturelle et de la subordination légitime, leur sort inévitable est de devenir la proie des imposteurs :
« Je ne peux concevoir — dit-il encore — comment aucun homme peut parvenir à un degré si élevé de présomption que son pays ne lui semble plus qu'une carte blanche sur laquelle il peut griffonner à plaisir. (…) Un vrai politique considérera toujours quel est le meilleur parti que l'on puisse tirer des matériaux existants dans sa patrie. Penchant à conserver, talent d'améliorer, voilà les deux qualités qui me feraient juger de la qualité d'un homme d'État ».
Burke, écrit Chiron, « ne conteste pas que la France d'avant 1789 n'ait eu besoin de réformes, mais était-il d'une nécessité absolue de renverser de fond en comble tout l'édifice et d'en balayer tous les décombres, pour exécuter sur le même sol les plans théoriques d'un édifice expérimental ? Toute la France était d'une opinion différente au commencement de l'année 1789 ». En effet. Et, comme l'exprime si justement la sagesse populaire anglaise, “l'enfant est parti avec l'eau du bain”. L'énigmatique “kunsan-kimpur” [calembour phonétique du vers “qu'un sang impur...”] que nos marmots ont obligation d'ânonner dans nos écoles avec les couplets de l'amphigourique et grotesque “Marseillaise” n'abreuve depuis lurette le plus petit sillon de notre exsangue et ratatiné pré carré. Seuls des politiciens que le sens du ridicule n'étouffe pas vibrent encore de la paupière et des cordes vocales tandis que de leur groin frémissant s'échappe indéfiniment, telle une bave infecte, la creuse et mensongère devise de notre constitution criblée d'emplâtres : “Liberté, égalité, fraternité”.
Céline décrit le résultat...
Céline, si lucide et si imperméable à la rémoulade d'abstractions humanitaires dont résonnent sans trève nos grands tamtams médiatiques, et qui savait son Histoire comme on ne l'enseigne nulle part, a décrit la situation une fois pour toutes dans une des pages les plus saisissantes du Voyage.
« Écoutez-moi bien, camarade, et ne le laissez plus passer sans bien vous pénétrer de son importance, ce signe capital dont resplendissent toutes les hypocrisies meurtrières de notre Société : “L'attendrissement sur le sort, sur la condition du miteux… !” (…) C'est le signe… Il est infaillible. C'est par l'affection que ça commence. (…) Autrefois, la mode fanatique, c'était “Vive Jésus ! Au bûcher les hérétiques !” mais rares et volontaires, après tout, les hérétiques. Tandis que désormais (…) les hommes qui ne veulent ni découdre, ni assassiner personne, les Pacifiques puants, qu'on s'en empare et qu'on les écartèle (…) pour que la Patrie en devienne plus aimée, plus joyeuse et plus douce ! Et s'il y en a là-dedans des immondes qui se refusent à comprendre ces choses sublimes, ils n'ont qu'à aller s'enterrer tout de suite avec les autres, pas tout à fait cependant, mais au fin bout du cimetière sous l'épithète infâmante des lâches sans idéal, car ils auront perdu, ces ignobles, le droit magnifique à un petit bout d'ombre du monument adjudicataire et communal élevé pour les morts convenables dans l'allée du centre, et puis aussi perdu le droit de recueillir un peu de l'écho du Ministre qui viendra ce dimanche encore uriner chez le Préfet et frémir de la gueule au-dessus des tombes après le déjeuner ».
Que l'on me pardonne cette citation un peu longue et d'ailleurs incomplète, mais elle m'a paru comme un prolongement naturel des Réflexions de Burke, tout en évoquant irrésistiblement l'Auguste Président, grand amateur de cimetières, panthéons et nécropoles, qui s'apprête à commémorer en grande pompe et dans l'extase universelle le Bicentenaire de l'incomparable Révolution française.
◘ Yves Chiron, Edmond Burke et la Révolution Française, Téqui, 1988, 185 p.
► Jacques d'Arribehaude, Vouloir n°50-51, 1988. (et : Bulletin célinien n°73, sept. 1988)

La lanterne magique de la contre-révolution (1789-1799)
Historien militaire et écrivain, Jean-Jacques Langendorf (né en 1938) est aujourd'hui maître de recherches à l'Institut de Stratégie Comparée, et directeur d'études associé à l'École Pratique des Hautes Études de Paris. En 1989 paraissaît chez l'éditeur munichois Matthes & Seitz, grâce aux talents de traductrice de son épouse Cornélia, une anthologie des pamphlétaires et théoriciens de la Contre-Révolution : Pamphletisten und Theoretiker der Gegenrevolution, 1789-1795. Pour la première fois étaient portés à la connaissance du public germanophone les écrits de pamphlétaires peu connus. L'auteur avait aimablement accepté à cette occasion d'exposer synthétiquement aux lecteurs francophones de Vouloir sa démarche éditoriale.
 Comme tout mouvement engendre la chaleur, toute révolution engendre une contre-révolution, qui est à la fois réaction armée à ses actes et réponse “idéologique” à ses postulats (1).
Comme tout mouvement engendre la chaleur, toute révolution engendre une contre-révolution, qui est à la fois réaction armée à ses actes et réponse “idéologique” à ses postulats (1).
Déjà face aux premiers tâtonnements “modérés” de la révolution française, les exigences d'une “contre-révolution pacifique” (l'expression est de Barnave) se font jour. Dans ce stade initial de la fermentation, vécu par la plupart comme une étape correctrice et nécessaire des erreurs du passé, on commence à devenir contre-révolutionnaire, lentement, non sans hésitations. À de rares exceptions près (quelques grands aristocrates qui émigrent immédiatement au lendemain du 14 juillet 1789 ou quelques pamphlétaires, Mirabeau-Tonneau constituant le cas le plus marquant), il n'existe pas de contre-révolutionnaire suis generis. On ne naît pas contre-révolutionnaire, on le devient. Tous ceux qui ne tarderont pas à s'ériger en féroces censeurs de la révolution passent d'abord par une phase d'approbation, qu'il s'agisse de Bonald, Maistre, Mallet-Du Pan ou Gentz. Les motivations qui poussent les uns et les autres à rejoindre la contre-révolution et à la servir par les armes ou par la plume sont variées, et elles ne procèdent que rarement d'une froide détermination théorique a priori. On rompt individuellement avec la Révolution en fonction de situations précises qu'elles a engendrées, qu'il s'agisse d'un château brûlé, d'un parent assassiné, d'un privilège aboli, ou, collectivement, lorsqu'il s'agit de la suppression du satut quasi-millénaire du clergé ou, plus rationnellement, du refus total ou partiel des lois sécrétées par l'Assemblée nationale.
Et plus la Révolution dégénèrera, plus le refus se fera massif et global, les ralliements contre-révolutionnaires ne se comptant plus sous la Terreur. Sans même tomber dans le paradoxe, on peut affirmer que tous ceux qui, en France, ont traversé la Révolution l'ont été, quelqu'ait été leur idéologie, contre-révolutionnaire à un moment donné, objectivement ou subjectivement, car il est vrai qu'on est toujours le contre-révolutionnaire de quelqu'un. Dans la nuit du 9 au 10 Thermidor 1794 Robespierre qui a la mâchoire fracassée par un coup de pistolet, agonise sur une table de l'Hôtel de Ville, aura tout le temps d'imaginer qu'il est la victime de la contre-révolution, alors que ceux qui s'apprêtent à le conduire, avec ses amis, à la guillotine, sont convaincus qu'ils vont exécuter un dangereux contre-révolutionnaire. D'ailleurs dans Paris une étrange rumeur circule alors : l'incorruptible aurait eu l'intention de se faire couronner roi. Ultérieurement, sous la plume de gens aussi différents que les Thermidoriens, que les jacobins irréductibles, ou qu'un G. Babeuf, qui aimerait tant que la Révolution, qu'il conçoit angélique, n'ait pas été souillée par la Terreur, le terme contre-révolutionnaire est utilisé pour désigner tout ce qui s'oppose à sa propre idéologie.
Récemment, confrontés à cette inflation de contre-révolutionnaires, certains historiens ont voulu clarifier le concept et le restreindre en lui opposant celui d'anti-révolution. À leurs yeux est anti-révolutionnaire celui qui, rallié à l'idée de progrès incluse dans celle de révolution, n'en accepte pourtant pas tous les aspects. C'est ainsi qu'on constate l'existence de couches populaires, paysans et Lumpenproletariat urbain (surtout dans le sud de la France) qui rejettent ponctuellement, mais violemment, certaines émanations de la révolution (2).
Dans cette nouvelle perspective historique, il serait par conséquent plus légitime de parler, globalement, de résistances à la révolution que de contre-révolution (3).
Il ne peut être question, dans un article limité, d'aller plus avant dans ces subtilités d'école. Si l'on demeure sur le terrain classique, on peut dire qu'un contre-révolutionnaire est celui qui reste attaché à ce qu'il considère comme des conditions d'essence indispensables au fonctionnement même de la société et de l'État : la monarchie et l'Église, le trône et l'autel. À partir de là, il ne verra plus l'épisode révolutionnaire que comme une parenthèse malheureuse qui doit être close (et qui peut l'être) le plus rapidement possible afin de revenir au statu quo ante. C'est en définitive sur cette notion de status quo ante que les divergences entre les contre-révolutionnaires vont se manifester. Pour les uns, on recommence, comme si rien ne s'était produit, pour les autres au contraire, afin de prévenir la réapparition d'une nouvelle parenthèse révolutionnaire, il s'agit d'introduire de très prudentes modifications, qui ouvriraient la porte à un “Ancien régime” certes restauré, mais également régénéré. Mais quoi qu'il en soit, l'idéal réformateur ne s'aventure pas au-delà des limites étroites d'un exécutif monarchiste tout puissant et d'une Église auxquelles les âmes doivent se soumettre impérativement. Ainsi circonscrite, la pensée contre-révolutionnaire peut varier à l'infini. Dans ses formes d'abord. C'est par milliers que l'on compte les libelles et pamphlets (souvent aussi brefs que médiocres) qui réagissent à chaud et épidermiquement aux événements révolutionnaires. Toutefois, nous relevons aussi l'existence de toute une littérature qui veut, en utilisant les arguments de la philosophie, de la métaphysique ou de la théologie, démontrer l'inanité des thèses révolutionnaires.
Toutefois nous relevons aussi l'existence de toute une littérature qui veut, en utilisant les arguments de la philosophie, de la métaphysique ou de la théologie, démontrer l'inanité des thèses révolutionnaires. Et cette littérature souvent profonde et souveraine — nous songeons à Bonald, Maistre, Rivarol ou Chateaubriand — si elle s'en prend à un événement inédit (la Révolution) s'inspire de motifs souvent préexistants, et procède soit d'une sensibilité d'Ancien régime, soit d'une culture “médiévale”. Nous voulons dire par là que les uns se réfèrent à une philosophie “moderne” de l'Absolutisme (telle qu'un Voltaire, par ex., l'incarne), alors que d'autres au contraire, plus tournés vers l'ancien droit de la France et vers ses institutions traditionnelles, considèrent la monarchie sous un angle organique. Et ce sont eux, en définitive, qui incarnent les authentiques réactionnaires.
Au départ la succession d'événements décousus et violents qui, à Paris et en Provence, se situent en amont et en aval de la prise de la Bastille sont perçus, même par les plus conservateurs, comme un orage régénérateur. Travaillés par le déisme, le sensualisme, le matérialisme, abreuvés des leçons de l'Encyclopédie, saoûlés par les palabres de salon, énervés par la nouvelle littérature théâtrale ou romanesque (un Beaumarchais et un Choderlos de Laclos sont les parfaits reflets de l'époque), les beaux esprits sont mûrs pour s'engager fort loin sur la voie de ce qu'ils imaginent être le renouveau. Il va de soi d'ailleurs que la situation matérielle du pays facilite cette effervescence : mauvais impôts, mauvaise gestion, privilèges souvent absurdes, mauvaise organisation, mauvaise politique intérieure et étrangère, la liste est très longue. Mais en tout état de cause, rien, dans ce pays riche, prospère et hautement civilisé, ne justifiait le bouleversement sanglant qu'il allait connaître.
Toutefois la volonté des “philosophes” est implacable : “Du passé faisons table rase”. Au nom de la toute-puissante raison régénératrice, us, coutumes, croyances, traditions les plus vénérables sont traînées dans la boue et les bases du trône et de l'autel sont grignotées par l'infatigable travail d'une armée de rongeurs. Tout d'ailleurs se passe très vite. Il aura fallu moins de cinquante ans, relève le royaliste Balzac, pour détruire le solide tissu français. Cette rapide décomposition est une source inépuisable d'étonnement pour l'historien contemporain. Elle s'explique en partie par une sorte de langueur qui s'est emparée des âmes et des esprits et que Taine, dans des pages admirables, met au compte de la “douceur de vivre”. Le noble n'est plus qu'un petit maître, attaché par une chaîne d'or à la niche de Versailles, le prêtre, un abbé de salon qui fait profession d'athéisme et qui dissimule honteusement son crucifix sous son tablier maçonnique, le philosophe un sophiste ingénieux dans le persiflage.
Les monarchiens et Stanislas de Clermont-Tonnerre
Les débuts de la Révolution voient émerger toute une couche d'esprits libéraux et éclairés qui jugent possible la mise en œuvre de vastes réformes sociales et fiscales, dans le cadre de la monarchie. Attachés au roi, anglophiles convaincus, défendant l'idée de la possibilité d'une Révolution modérée, ces “monarchiens” militent pour le bicaméralisme, la séparation des pouvoirs, tout en demeurant partisans d'un exécutif royal qui s'exprime par le droit de veto réservé au souverain. Mais devant l'impitoyable durcissement de la révolution, leur désillusion ne cesse de s'accroître et bientôt, au lendemain du 6 octobre 1789 (le roi est ramené à Paris par la populace), les “idéologues” du mouvement, les Mounier, Malouet, Lally-Tolendal, exhaleront un “das haben wir nicht gewollt” (nous n'avons pas voulu ça !), alors que tout déjà est consommé.
Rien n'illustre peut-être mieux la trajectoire pathétique des “monarchiens”, engloutis dans la sanglante tempête révolutionnaire, que le destin et les errements — qui sont ceux de toute une époque et de toute une classe — de Stanislas Clermont-Tonnerre. Les fées se sont penchées sur son berceau. Filleul de la reine de France et du roi de Pologne, riche, beau, adulé, âme sensible, il flirte avec toutes les modes de l'époque. Franc-maçon, il admire les Encyclopédistes et Rousseau. Épris d'humanitarisme, il prend la défense des protestants, des comédiens, des juifs et du bourreau. Présidant pour un temps la Constituante, il participe allègrement, selon l'expression de son biographe, « au suicide d'une élite ». Après le 6 octobre — ce 6 octobre qui va marquer le passage des monarchiens à la contre-révolution — il ouvre enfin les yeux, se lançant dans une attaque de grand style contre la Déclaration des Droits de l'Homme et l'œuvre de la Constitutante. Ayant préparé, plus par inconscience que par malignité, comme tant de ses emblables, le lit de la Révolution au nom de la liberté, il en arrive maintenant à écrire que « la liberté est l'unique cause des malheures publics ». Mais l'éveil est trop tardif et l'incendie, qu'il a contribué à allumer, le dévore : il est massacré le 10 août. Plus chanceux, les autres grands noms monarchiens émigreront et, de leur exil, ils deviendront les plus zélés contempteurs de la révolution. Si nous avons mentionné ici Stanislas de Clermont-Tonnerre et les monarchiens, c'est parce que leur cas possède presque une valeur symbolique pour ce que l'on pourrait nommer “l'éveil paresseux” à la contre-révolution, un éveil à la fois tortueux et réticent qui, en passant d'un “oui, mais” à un “non, mais”, finit par aboutir à un non radical alors qu'il est trop tard.
C'est à d'autres, moins aveuglés par les illusions d'un possible “libéralisme” révolutionnaire, à des “gens simples et directs” serait-on tenté de dire, qui ne sont pas prisonniers d'un carcan idéologique que reviendra le mérite d'organiser la première résistance intransigeante à la Révolution.
La ligue des ironistes
Avec Mirabeau-Tonneau (le frère du tribun) (4), Peltier, Suleau, l'abbé Royou et le redoutable abbé Maury, à la carrure de lutteur, se constitue, d'une manière informelle, ce que l'on pourrait nommer “la ligue des ironistes”. Théoriciens, ils ne le sont guère. Ils réagissent à chaud à l'événement en maniant un humour assassin, ils fustigent de leur plume corrosive les hommes nouveaux et leurs gesticulations intellectuelles, tout en se rangeant inconditionnellement derrière le roi. Leurs libelles et journeaux à un sou, qui font pendant à la presse populaire révolutionnaire (L'Ami du Roi de Royou sera interdit le même jour que L'Ami du Peuple du pustuleux Marat) connaissent une grande diffusion, le plus brillant d'entre eux étant sans aucun doute Les Actes des Apôtres de J.G. Peltier. Ces intrépides pamphlétaires ont compris que les révolutionnaires sont totalement dépourvus d'humour (une des premières mesures de l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas été d'interdire le carnaval ?) et que c'est sous cet angle-là qu'il faut les provoquer. Ils payeront d'ailleurs très cher cette opposition : une mort atroce pour Suleau, assassiné le 10 août, la mort par misère physiologique pour Royou, traqué part la police, l'exil pour Mirabeau-Tonneau, Maury et Peltier.
Le Groupe des Genevois
Mais assez rapidement la révolution engendrera un autre courant contre-révolutionnaire, représenté par ce que je nommerais le “groupe des Genevois” (F. d'Ivernois, F.-P. Pictet) que domine de très haut la personnalité de J. Mallet-Du Pan. Ce dernier, fils d'un modeste pasteur, ne faisait pas partie du patriciat qui gouvernait la “Parvulissime” sous l'Ancien Régime. Libéral au départ, et ami des philosophes, il rejoint, au début de la Révolution, les “monarchiens” dont il devient le penseur attitré. Mais, tout en évoluant vers des positions plus extrêmes, il se met au service de la monarchie pour des missions secrètes et est contraint d'émigrer en Suisse. Mallet-Du Pan n'est ni un philosophe, ni un métaphysicien de la contre-révolution. Analyste aigu, il se révèle dans les Correspondances qu'il fournit à divers cours européennes, l'incomparable observateur de la situation et, contrairement à tant d'autres contre-révolutionnaires, il ne se berce d'aucune illusion, en ce qui concerne le pouvoir de réaction de l'aristocratie et de l'émigration. Mais ce qui rend peut-être Mallet-Du Pan unique (avec Ivernois, qui a vécu la même situation), c'est le fait que dans sa jeunesse, il a participé, mais cette fois de l'autre côté de la barricade, à la révolution genevoise de 1782 et qu'il a été contraint de fuir devant le triomphe de la contre-révolution. C'est dire qu'il connait à merveille, “de l'intérieur”, les mécanismes de l'émeute et le caractère des hommes qui en sont le moteur. Contrairement à tant d'autres, il distingue le cheminement que prendra la Révolution. À ses yeux, le vide créé par la disparition de la monarchie a été successivement comblé par la bourgeoisie possédante, puis par la petite bourgeoisie, puis par les non-possédants, enfin par les sans-culottes, chacune de ces classes ayant éliminé celle qui l'a précédée. Et à chaque élimination, la violence monte d'un cran. Mallet-Du Pan est un des rares (avec Rivarol toutefois) qui discerne que tout cela doit logiquement aboutir à la “dictature du sabre”.
Jusque-là en France, la contre-révolution théorique n'était guère sortie de la voie empirique, critiquant coup par coup les innovations des révolutionnaires. Ce fut là essentiellement la tâche des monarchiens, et de la droite parlementaire (S. de Girardin, Mathieu Dumas, Viennot-Vauban) qui combattent les décisions de la Constituante et de la Législative, attaquant, outre la Déclaration des Droits de l'Homme et la constitution, leur politique religieuse, financière, sociale, militaire et étrangère. Mentionnons à ce titre les travaux, souvent fort techniques, d'un N. Bergasse, qui démontre l'inanité de la politique financière de l'Assemblée nationale.
Edmund Burke : premier grand théoricien anti-révolutionnaire
C'est d'Angleterre toutefois que viendra le véritable opus de la contre-révolution. Le 29 novembre 1790, la traduction des Reflections on the Revolution in France d'E. Burke est mise en vente à Paris, où elle connaît un succès foudroyant, qui s'explique par le fait que le public, confronté à cette vaste synthèse, a le sentiment d'enfin mieux comprendre ce qui lui arrive. En dépit de multiples défauts, l'ouvrage de l'Anglo-Irlandais propose une analyse des événements qui les domine de très haut. S'en prenant aux concepts abstraits, donc stériles, mis en œuvre par les nouveaux philosophes de la raison, l'auteur démonte point par point les concepts de droit naturel, de liberté, égalité et fraternité, de souveraineté populaire, de démocratie, du bonheur qui doit devenir le lot de tous.
Il est frappant de constater que la “grande critique” française ou francophone de la révolution se fera, elle, attendre quelques années encore et se manifestera, au fond, alors que tout est joué. Les Considérations sur la nature de la Révolution de France... de Mallet-Du Pan sont publiées en 1793, La défense de l'ordre social contre les principes de la révolution française de l'abbé Duvoisin en 1796 (et dans un tirage confidentiel), comme La Théorie du pouvoir politique et religieux de Bonald, et il faudra attendre 1797 pour pouvoir lire les Considérations sur la France de Maistre, et 1798 l'Essai sur les révolutions de Chateaubriand. En règle générale, on peut dire que les contre-révolutionnaires fournissaient avant Thermidor une œuvre de pamphlétaires, et que c'est seulement après l'extinction de la terreur que leur critique “métaphysique” voit le jour, qui est précisément celle que la postérité retiendra.
La contre-révolution dans ses grandes lignes théoriques
Il ne peut être question, dans le cadre restreint d'un article, de passer systématiquement en revue la pensée des auteurs importants et d'en dresser une sorte de catalogue. Contentons-nous d'esquisser les grandes lignes qui reviennent à satiété chez tous les auteurs contre-révolutionnaires.
♦ 1) La critique la plus générale et la plus répandue relève en premier lieu du simple bon sens et de l'évidence même : privée du trône et de l'autel, la France cesse d'exister, car ils lui sont, pourrait-on dire “consubstantiels”. Il n'existe aucun contre-révolutionnaire, “réactionnaire” ou “progressiste”, qui remette en question ce qui constitue une vérité intangible. Il en découle naturellement qu'une partie importante de la littérature contre-révolutionnaire est consacrée à la défense et à l'illustration du roi, de sa famille et de l'Église opprimée.
♦ 2) L'idéologie, ou la philosohie, qu'invoque la révolution est ressentie comme abstraite et artificielle. Que signifient des notions aussi vagues que Liberté et Égalité ? Où commencent-elles ? Où finissent-elles ? Il n'est pas vrai que les hommes soient nés libres et égaux. La liberté de l'assassin qui s'échappe de prison n'a rien de commun avec celle de l'honnête homme. Il n'existe aucune véritable égalité entre un homme intelligent et un imbécile, entre un fort et un faible, entre celui qui est armé et celui qui ne l'est pas, entre l'enfant né dans un palais et celui né dans une chaumière. Proclamer la liberté ne revient pas à la réaliser et il ne suffit pas d'exprimer une idée pour qu'elle se mette à exister. Quant à la fraternité — et la notion est déjà ambiguë en soi puisqu'elle évoque le premier meurtre de l'histoire humaine — elle relève du domaine de la sentimentalité et ne possède aucun contenu réel. Les révolutionnaires se meuvent dans l'abstrait (5). Ils postulent la toute-puissance d'une raison (et d'une vertu) qui va bientôt revêtir les formes les plus grotesques ou les plus tragiques : assassinat du roi au nom de la raison, déclaration de guerre à l'Europe au nom de la raison, profanation des tombes royales au nom de la raison, dilapidation des biens nationaux au nom de la raison, terreur au nom de la raison, etc. Face à cette usurpation de la raison par la déraison, nombreux seront les théoriciens de la contre-révolution qui se considéreront, eux, comme les authentiques porte-paroles de la raison. Ils se voudront également les seuls véritables réalistes, détenteurs d'une somme d'expériences très anciennes et qui, à ce titre, ont pour devoir de lutter contre l'illusionnisme révolutionnaire, contre les fabriquants en gros d'utopies et contre les marchands de vertu.
♦ 3) La révolution croit au progrès : les révolutionnaires sont convaincus qu'ils sont en mesure de réaliser le bonheur et l'harmonie sur terre grâce à des moyens particuliers qui leur sont propres. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen constitue l'un de ceux-ci et ses articles sont censés baliser la voie qui conduit à la félicité universelle. Mais quoi qu'on en dise, il est impossible de bannir le malheur de la société et le bonheur ne peut être le résultat de décrets et de lois, ou de déclarations d'intention aussi creuses que bien intentionnées. L'évolution d'une humanité entachée par le péché originel ne se fait que dans des soubresauts tragiques, dans les larmes et dans le sang. Il ne suffit pas de ravaler la façade d'un antique édifice, bâti par des générations d'architectes et de maçons, pour modifier sa structure et ses dispositions. Dans le meilleur des cas la Révolution ne sera rien d'autre qu'un badigeon provisoire, dans le pire ses maladresses et son arbitraire infligeront des dommages irréparables à la substance même de l'édifice.
♦ 4) La démocratie est une illusion. Comment croire que des millions d'hommes qui délèguent leur souveraineté, leurs “droits” et leur portion du pouvoir à quelques centaines de députés se trouveront mieux représentés que par un monarque — et ses ministres — qui incarne depuis des siècles les aspirations organiques du pays et dont l'autorité n'est pas fondée sur une quelconque loi écrite (dans le sens que Condorcet donne à ce terme) mais sur la loi divine uniquement. La fragmentation des compétences et des volontés aboutit au nivellement ou, pire encore, à la dictature d'un parti et à l'arbitraire de la tyrannie. Et le fait de prendre une décision à la majorité ne signifie nullement que cette dernière soit bonne. L'arithmétique démocratique, la loi du nombre, n'est pas une valeur positive en soi. Au contraire, elle engendre la médiocrité, impose un lit de Procuste aux aspirations originales. Si par le passé certains ont plaidé en faveur de la démocratie — Rousseau par ex. — c'est parce qu'ils ne l'ont considérée comme applicable qu'à de très petits États, comme la République de Genève. Cette critique de la démocratie a conservé jusqu'à nos jours tout son poids et elle incarne peut-être l'héritage le plus vivant de la pensée contre-révolutionnaire.
♦ 5) Celui qui détruit l'ordre traditionnel (et organique), l'harmonie fondée en définitive sur et en Dieu, provoque la catastrophe. Dès le début de la Révolution, la plupart des contre-révolutionnaires ont discerné qu'elle portait dans son sein ses futurs “dérapages”, comme les nomment pudiquement les historiens libéraux, et qu'elle finirait par engendrer une “catastrophe française” sui generis. Ils reconnaissent d'ailleurs qu'il est difficile de prendre la mesure de son ampleur, car par sa soudaineté et sa violence elle est, comme dit Burke, “étonnante”. Plus la terreur s'étendra, et plus les contre-révolutionnaires se verront confirmés dans leur analyse.
♦ 6) Toutefois certains d'entre eux, comme Maistre, Mallet-Du Pan, Chateaubriand ou Gentz, jugeront que la Révolution possède une incomparable charge d'énergie et ils comprendront qu'elle doit être mesurée à une aune nouvelle. Pour d'autres au contraire, l'arbitraire et la violence de la Révolution ne constituent qu'un bouleversement provisoire — et finalement positif — puisqu'il prépare une restauration régénératrice. C'est ainsi que les théocrates ou de nombreux cléricaux la considèrent comme un élément de la volonté divine, comme le châtiment nécessaire pour l'amollissement et les vices de l'Ancien Régime. Lorsque l'orage aura purifié l'atmosphère, il sera alors possible de fonder une monarchie régénérée, de s'appuyer sur une nouvelle souveraineté fortifiée et renforcée. C'est là, grosso modo, le point de vue de Maistre, alors que d'autres penseurs (Rivarol, Sénac de Meilhan) voient avant tout dans la Révolution un acte cruel et barbare qui a irrémédiablement mis fin à la “douceur de vivre” de l'Ancien Régime. Quant à Bonald — et c'est entre autres ce qui constitue l'originalité de sa position — il situe en dehors du projet divin la Révolution qui devient sinon un non-être, du moins une simple maladie.
♦ 7) Si la dégénérescence des mœurs de la société française en général et de la cour en particulier, ainsi que l'accumulation des abus, sont parfois mentionnés comme causes de la Révolution, il en est toutefois une autre qui est constamment évoquée. Inlassablement, les théoriciens de la contre-révolution soulignent le rôle destructeur exercé par ce qu'ils nomment “la secte”, c'est-à-dire les philosophes. La machine rationaliste qui s'est mise en mouvement dans la première moitié du XVIIIe siècle, se propose de détruire le vieil esprit français et de saper les bases du trône et de l'autel. Cet hydre de la subversion possède mille têtes : le criticisme de Bayle, le sensualisme de Condillac, le naturalisme de Rousseau, l'ironie de Voltaire, la doctrine des physiocrates, le poison distillé par les palabres des salons, les malheureux exemples donnés depuis l'étranger par Frédéric de Prusse ou Joseph II. Le solide bon sens gaulois a été contaminé par tous ces raisonneurs et il est désormais incapable de résister à la contagion.
Certains contre-révolutionnaires iront encore plus loin et tenteront de déceler la cause des causes qui ont conduit à la catastrophe. Il y a ceux qui accusent le duc d'Orléans, Necker ou La Fayette, d'avoir travaillé à la ruine de la monarchie pour satisfaire leurs ambitions personnelles. Il y en a d'autres comme Barruel qui pensent que l'œuvre de sape a été systématiquement organisée par les Francs-Maçons, les Illuminés, les protestants, voire les jansénistes ligués dans un gigantesque complot. Les plus radicaux croient même discerner dans la Révolution proprement dite un épisode tardif et accessoire, tout ayant déjà été joué avec la réforme qui, en sapant l'unité de l'Église et l'autorité du pape, a facilité l'éclosion en Europe du libertinage et de la discorde. Sabatier de Castres fut le penseur contre-révolutionnaire qui développa cette thèse jusqu'à ses conséquences ultimes. Selon lui, il faut rechercher l'origine de la révolution dans l'invention de la poudre, de l'imprimerie, dans les progrès de la médecine, etc. Il en découle que c'est déjà à la fin du Moyen Âge qu'il aurait fallu qu'une pensée et une action contre-révolutionnaires se dévelopassent, afin de barrer la route aux fatales idées nouvelles.
♦ 8) Les contre-révolutionnaires se montrent allergiques à la rhétorique creuse de la Révolution. Leurs sarcasmes s'adressent au style ampoulé et prétentieux des décrets et des discours, au sentimentalisme des déclarations théoriques, à la phraséologie des tribuns qui puise ses ressources autant dans la grandiloquence à l'antique que dans les effusions rousseauistes. Pour eux, celui qui écrit mal, pense mal et ne peut donc prétendre être le créateur d'une société nouvelle. Il serait d'ailleurs possible de constituer une anthologie de la contre-révolution uniquement avec des textes révolutionnaires qui offrent tant d'exemples de délire verbal et d'incontinence stylistique.
♦ 9) Il ne faudra toutefois pas conclure des points sus-mentionnés que la pensée contre-révolutionnaire se cantonna uniquement dans la critique, le sarcasme, ou dans une vision restaurative plus ou moins absolue. P.-H. Beik (6) a eu le mérite de montrer, en son temps, que les contre-révolutionnaires surent répondre également au défi révolutionnaire par des propositions de réformes sociales ou politiques souvent originales (7). Dans cette perspective, la réflexion du Comte de Montlosier, par ex., revêt une importance particulière.
L'Europe élabore la réponse théorique à la Révolution française
Très vite, la Révolution, idéologiquement et matériellement, se proclame conquérante et prétend faire “souffler le vent de la liberté sur l'univers entier”, comme elle l'annonce dans sa logomachie. Devant ses menaces, l'Europe organise sa défense et met sur pied sa réponse. Parmi les ténors de la contre-révolution ce sont — Bonald et Chateaubriand exceptés — des non-Français qui donneront le ton : l'Anglais Burke, le Sardo-Piémontais Maistre, le Genevois Mallet-Du Pan, le Prussien Gentz, les Hannovriens Rehberg et Brandes ou, avec une œuvre rédigée en latin, Braschi, le pape Pie VI. Il va sans dire que la réaction à la Révolution se teinte là de sensibilités, et de préoccupations, nationales. Dans les États allemands, on distingue diverses attitudes : il y a ceux qui, séduits au début, se détourneront avec horreur des excès de la Révolution terroriste. C'est, par ex., le cas d'un Schiller. Il y a également ceux qui, abominant le désordre et la canaille, contemplent l'événement avec une distance et un mépris aristocratiques : c'est le cas de Gœthe. Notons aussi l'existence d'une tendance fortement représentée : les amis de l'Aufklärung qui finissent par condamner les glissements de la Révolution comme contraire aux exigences de la raison. C'est le cas, en Autriche, de J. von Sonnenfels, ou en Allemagne de J.L. Ewald.
Les critiques d'un Rehberg et d'un Brandes, qui subissent l'influence de Burke, possèdent par contre une toute autre dimension. Dans ses Untersuchungen über die französische Revolution (1793) (en fait un recueil de recensions), Rehberg expose que le destin de l'homme, produit d'une histoire complexe, ne peut être arbitrairement et violemment modifié. On ne peut lui imposer une constitution artificielle et il est impossible de remplacer, du jour au lendemain, dans un tour de passe-passe, l'édifice des valeurs traditionnelles par une “déclaration des Droits de l'Homme” surgie du néant. Rien ne fonde en droit la “volonté du peuple” et la bourgeoisie a commis une erreur fatale en s'agenouillant devant la canaille. En même temps il soumet la “revolutiomania” des Allemands à une critique impitoyable, ce qui va lui attirer les foudres des “esprits avancés”, Fichte en tête. Quant à son dioscure Brandes, il est, après avoir défendu des positions “monarchiennes”, obligé de reconnaître — d'un cœur lourd, il est vrai — que chaque pas fait “en avant” par la Révolution, ne signife en réalité qu'un faux progrès, un retour vers la barbarie.
Mais il existe aussi une catégorie d'auteurs qui ont été encore plus incisifs dans leur critique de la Révolution qu'ils éprouvent directement comme une manifestation du mal absolu, comme une rupture de l'ordre divin, comme une souillure infligée à l'harmonie mystique de l'univers : c'est le cas d'un Jung-Stilling, d'un Mathias Claudius et, plus tardivement, d'un Novalis (8).
Comme en France, on assistera en Allemagne à l'éclosion de toute une “littérature de combat” aux prétentions parfois humoristiques, dont souvent les clubistes de Mayence font les frais. Parallèlement on observe aussi la naissance d'une presse contre-révolutionnaire dont émerge le remarquable Revolutions-Almanach de Reichard ou, pour l'Autriche, le Wiener Zeitschrift de A. Hoffmann qui, corrosif et sarcastique, s'inspire des Actes des Apôtres de J.G. Peltier.
C'est toutefois à F. von Gentz que revient la palme du “grand penseur allemand de la contre-révolution”. La lecture de Burke lui ouvre les yeux sur la vraie nature de la Révolution, qu'il avait jugée favorablement dans ses premiers moments. Traducteur inspiré de Burke, de Mallet-Du Pan, et d'autres encore, il pourvoit ses traductions d'abondantes annexes et notes, qui finissent par constituer une œuvre en soi. Comme Mallet-Du Pan, Gentz est un réaliste implacable qui ne se berce d'aucune illusion et ne fait intervenir dans sa réflexion ni considérations morales, ni larmoiements humanitaires. La Révolution est puissante, il s'agit de la combattre et de la détruire afin de rétablir l'équilibre européen. Toutefois les cours continentales auraient tort de surestimer leurs forces. Seule une intervention armée de l'Angleterre pourra modifier le cours des choses. Dans cette perspective, Gentz est un des rares écrivains contre-révolutionnaires qui, dans son œuvre, concède une place centrale à la réflexion militaire.
La Suisse, avec ses 13 républiques oligarchiques, joue un rôle important dans le combat contre la Révolution, tant sur le plan de l'accueil fait aux émigrés que sur celui de la propagation des idées contre-révolutionnaires. Les Suisses, qui s'estiment détenteurs du seul auhentique républicanisme, se détournent avec horreur de l'expérience française, à leurs yeux pervertie et caricaturale. Le massacre de leurs compatriotes à Paris, le 10 août 1792, les touchera au plus profond d'eux-mêmes et suscitera un flot de pamphlets et de libelles contre-révolutionnaires. Il faudra toutefois attendre la Restauration pour que la Suisse, avec le “Bonald bernois”, C.L. von Haller, produise un penseur contre-révolutionnaire et réactionnaire de premier plan. Il convient aussi de relever le rôle joué à Neuchâtel — alors principauté prussienne — par L. Fauche-Borel, “l'imprimeur de la contre-révolution” qui publie, avec des lieux d'édition fictifs, une quantité considérable d'ouvrages importants, dont les Considérations de Maistre.
Dans les États de l'Église, qui ouvrent toutes grandes leurs frontières aux émigrés ecclésiastiques, on relève également une très vive activité intellectuelle, les thèses conspiratives de l'abbé Barruel étant reprises à satiété par les publicistes en soutane. Le pape Pie VI est peut-être le plus convaincant d'entre eux. Non content de dénoncer l'hérésie révolutionnaire dans son bref Aliquantum, il en démonte aussi fort adroitement le mécanisme philosophique (9).
Ce rapide et schématique tour d'horizon n'a eu pour propos que de démontrer l'ampleur prise par la réflexion contre-révolutionnaire dans la décennie 1789-1799. On a toutefois le sentiment que la moisson fut, sur le moment, presque trop abondante pour avoir été complètement engrangée. En effet, il faudra attendre l'ère restaurative (et même au-delà), pour qu'une partie des idées contre-révolutionnaires, dans la mesure où elles esquissent les contours d'une philosophie de la réaction, portent leurs fruits.
Toutefois tous ceux qui ont ardemment lutté pour le relèvement du trône et de l'autel auront, au lendemain de 1815, de bonnes raisons de ressentir une certaine amertume, car la parenthèse révolutionnaire n'a pas été vraiment refermée comme ils l'auraient souhaité et même, aux yeux de beaucoup, n'a pas été refermée du tout. Les uns déplorent que l'inimitable douceur de vivre de l'Ancien Régime se soit irrémédiablement évaporée, alors que d'autres expriment des regrets plus concrets : ils ne retrouvent plus leurs biens et leurs privilèges et, pour les prêtres, leur Église ne sera plus jamais ce qu'elle a été.
Que deviennent les contre-révolutionnaires sous la Restauration ?
Mais il y a pire encore : si les contre-révolutionnaires retrouvent leur roi, ils doivent en même temps s'accomoder d'une constitution. Ce qui est fondamentalement en cause, toutefois, c'est l'écoulement, le cruel écoulement du temps, qui ne peut plus être remonté, c'est ce quart de siècle évanoui qui a vu l'avènement d'une république, la persécution du clergé et de la noblesse, la Terreur avec ses massacres (en soi parfaitement démocratique car dirigée contre tous), l'assassinat d'un roi et d'une reine, la poursuite de guerres incessantes et, enfin, l'avènement d'un des plus singuliers empereurs de l'histoire et de l'humanité. Si restaurer la monarchie s'est avéré possible, il s'est par contre avéré impossible de faire rétrograder les aiguilles du temps, et les contre-révolutionnaires en prendront cruellement conscience lors de la seconde Restauration. D'ailleurs, progressivement, la pensée contre-révolutionnaire de restauratrice deviendra prophylactique : il ne faut pas que la catastrophe révolutionnaire puisse se reproduire et c'est à cette tâche dorénavant qu'un Bonald ou Maistre, devenus ministres en leurs royaumes respectifs, ou un Gentz conseiller de Metternich, s'attèleront. C'est alors que de contre-révolutionnaire leur pensée devient, à proprement parler, réactionnaire puisque l'objet qu'elle se proposait de combattre, la révolution, a (momentanément) disparu (10).
L. Hampson compare la Révolution à un autobus dans lequel beaucoup de monde est monté, et beaucoup descendu (11). On peut en dire autant des contre-révolutionnaires. Sous le Consulat, et surtout sous l'Empire, les défections sont massives, et même un Bonald finira par se rallier. Voilà qui démontre que dès le début du XIXe siècle la contre-révolution n'est plus assurée du bien-fondé absolu de ses exigences et que la revendication de restauration sine qua non de la monarchie s'estompe devant le désir d'ordre, de prospérité et devant le mirage impérial. Alors qu'aux yeux des Anglais (qui ont très largement accueilli les contre-révolutionnaires pourchassés) le général Bonaparte restera jusqu'à sa mort le général Bonaparte, et l'implacable continuateur de la révolution qui ne s'arrête pour eux, qu'à Waterloo, les contre-révolutionnaires théoriciens et practiciens français viennent se blottir au pied du nouveau trône, l'abeille valant dès lors bien le lys, à leurs yeux. Dans une doctrine qui a haussé la fidélité au niveau d'un véritable dogme, une infidélité aussi massive peut surprendre. C'est pourquoi il convient de saluer la constance d'un J.G. Peltier qui, dès le premier jour de la Révolution, resta inébranlablement fidèle à ses idéaux contre-révolutionnaires, sous le Directoire, le Consulat, l'Empire et... à l'époque de la Restauration.
Il n'en demeure pas moins qu'à partir de 1815 la pensée contre-révolutionnaire, bien que privée de son “objet” révolutionnaire par la restauration et trahie dans certaines de ses exigences essentielles (à cette époque, en France, un monarchien de 1789 aurait presque passé pour un ultra) (12) s'engagera sur des voies inédites, de plus en plus souterraines à partir de 1830 et de plus en plus diffuses à partir de 1918. Ses doctrines, constituées entre 1789 et 1799 ne meurent pas, elles se transforment en un terreau fécond qui vivifie, souvent sous des formes inédites, le champ de la pensée politique. Invisibles comme l'oxygène, elle n'en nourrissent pas moins encore pour une bonne part certains courants de la pensée conservatrice et réactionnaire, du romantisme au maurrasisme, en passant par un Proudhon et un Bakounine. Et c'est la raison pour laquelle les rares individus qui se désignent aujourd'hui encore comme contre-révolutionnaires ne désespèrent pas de vivre un jour la Restauration totale et universelle — qui coïncidera avec la vraie révélation du projet de Dieu, selon la formule de l'essayiste colombien ultra-catholique, Nicolás Gómez Dávila : « Lorsqu'un réactionnaire parle d'une “inéluctable restauration”, il convient de ne pas oublier que le réactionnaire compte en millénaires » (13).
► Jean-Jacques Langendorf, Vouloir n°65/67, 1990.
◘ Notes :
1) Nous n'envisageons ici la contre-révolution que sous son aspect théorique, et laissons de côté la contre-révolution en acte (Toulon, Lyon, Vendée, guerres des coalisés contre la Révolution, etc.). Les liens entre la contre-révolution pratique et la théorique ont été extrêmement ténus. Une sorte de pont a toutefois été établi entre les activistes et les théoriciens par des gens comme Antraigues ou Mallet-Du Pan chargés de missions secrètes ou officielles. Si l'on veut pousser les choses à l'extrême, on peut dire que le seul écrivain contre-révolutionnaire qui ait eu une influence directe – d'ailleurs, a contrario – sur les événements fut le marquis de Limon, rédacteur du Manifeste du duc de Brunschwick, ce texte étant en partie à l'origine de la fatale journée du 10 août 1792, qui vit la chute de la monarchie !!!
2) Cf. C. Lucas, Résistances populaires à la révolution dans le Sud-Est, in Mouvements populaires et Conscience sociale (XVIe - XIXe siècles), Actes du colloque de Paris (24-26 mai 1984), 1985, pp. 473-488.
3) C'est précisément le titre choisi par le colloque de Rennes, 17-21 sept. 1985 : Les résistances à la révolution, Paris, 1987.
4) On doit entre autres à Mirabeau-Tonneau une Lanterne magique nationale (Paris, 1790), qui fustige avec humour et cruauté les nouvelles mœurs “parlementaires”, telles qu'elles se développent au sein de la Constituante. C'est cette brochure qui a inspiré le titre de cet article.
5) Lorsque je me promène dans la France actuelle, je ne peux m'empêcher de sourire devant les frontons des Palais de Justice et des prisons ornés de l'inscription “Liberté – Égalité – Fraternité”, alors qu'on devrait lire “Justice” sur les premiers, et “Expiation” sur les seconds.
6) The French Revolution Seen from the Right. Social Theories in Motion, 1789-1799. Transactions of the American Philosophical Society, vol.46, February 1956, PP. 3-122.
7) Nous aurions pu prolonger cette liste presque ad libitum. Ajoutons seulement qu'en défendant la monarchie et l'Église le contre-révolutionnaire a aussi le sentiment de défendre l'universalité contre le patriotisme chauvin, donc particulariste, des révolutionnaires.
8) Le travail de certains historiens contribuera également à nourrir les sentiments contre-révolutionnaires des Allemands. Il convient de mentionner ici les Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die französische Revolution du Suisse C. Girtanner, publication périodique commencée en 1794, en fait une collection de matériaux, qui dévoile impitoyablement les crimes de la Révolution.
9) Si l'Espagne n'apparaît pas dans ce concert contre-révolutionnaire, c'est parce qu'une stricte censure allait jusqu'à interdire toute mention, même négative, de la Révolution.
10) Dans Le vocabulaire politique et social en France de 1861 à 1872 à travers les œuvres des écrivains, les revues et les journaux, Paris, 1962, p.55, J. Dupuis montre qu'à partir de 1869 les termes “contre-révolution / contre-révolutionnaire” cèdent le pas à “réaction” et “réactionnaire”, précisément à une époque où l'ère de la révolution française est considérée comme achevée.
11) N. Hampson, La Contre-Révolution a-t-elle existé ?, in Résistances à la Révolution, op. cit., p. 462.
12) Mais on peut également assister au phénomène inverse. Dans son roman Les mouchoirs rouges de Cholet (Paris, 1984), Michel Ragon montre fort bien comment les Vendéens les plus ardemment contre-révolutionnaires, qui sous la restauration ne cessent d'exiger un retour aux conditions d'avant 1789, seront traités de révolutionnaires par les monarchistes.
13) N. Gómez Dávila, Einsamkeiten, Glossen und Text in einem, Wien, 1987, p. 147.

pièces-jointes :
Les penseurs politiques antimodernistes : Edmund Burke
Ce grand penseur politique naquit à Dublin, le 1er janvier 1729, d'un père protestant et d'une mère catholique. Il fut élevé dans la religion anglicane, à laquelle il resta attaché toute sa vie. Il suivit avec succès de solides études de philosophie et d'histoire, avant d'entreprendre, à Londres, des études de droit. Il créera une association d'étudiants qui est considérée comme la plus ancienne au monde. Il s'intéressera très tôt à la politique et deviendra le secrétaire privé de Lord Rockingam, qui dirigera le gouvernement de 1765 à 1767. Élu à la Chambre, il lutte pour les libertés dans les colonies d'Amérique, aux Indes, en Irlande. Il devient le leader du parti Whig, concurrent des Tories (les conservateurs). Les whigs ne sont pas comparables à l'actuel parti travailliste, ni au parti libéral. Opposés à l'absolutisme royal, on pourrait tenter une comparaison avec le parti radical, en France, dans les années 1925. Toujours est-il que Burke, qui a été initié franc-maçon dans la loge Jérusalem 44 en 1769, se situe dans la faction conservatrice du parti.
Mais Burke est surtout célèbre pour son opposition farouche à la philosophie des Lumières et pour l'horreur que lui inspirent les idées à la mode en France, qui prépareront le terrain à la Révolution française, et qui représentent pour lui le mal politique. Il présente ainsi Jean-Jacques Rousseau comme un faux prophète. Ses écrits anti-révolutionnaires ne tardèrent pas à faire de Burke « le porte-parole de l'Europe monarchique ». Il cristallisa l'opinion anglaise et mobilisa son pays contre la Révolution. Son livre le plus célèbre est Réflexions sur la Révolution de France où il prédit la dérive dictatoriale de la Révolution française. Pour lui, il est impératif de préserver la hiérarchie sociale, de limiter la participation politique, de briser dans l'œuf toute velléité de démocratisation et de se conformer à la tradition. Burke critique l'esprit d'innovation qui est « le résultat d'un caractère intéressé et de vues bornées. » Il observe que ceux qui ne se conforment pas aux principes de leurs aïeux n'auront guère le souci de leur postérité. Refuser l'héritage des ancêtres revient à s'appauvrir.
S'adressant aux révolutionnaires français, il leur dit : « Vous avez mal commencé, parce que vous avez commencé par mépriser tout ce qui vous appartenait. »
Burke s'en prend à la composition de l'Assemblée constituante, formée d'hommes qui n'ont pas l'expérience des affaires publiques. Il estime qu'aucune élection ne peut donner à un homme des compétences qu'il ne possède pas. Pour lui, il est absurde de penser que la vérité et le bien commun pourraient sortir de la volonté du grand nombre. L'homme individuellement connaît rarement son intérêt bien compris. Quant aux foules, elles se laissent aller aux pires instincts et sont gouvernées par les passions qui sont un obstacle, comme le savaient déjà les sages de l'Antiquité, à l'exercice de la réflexion. Faire confiance au seul nombre reviendrait à ouvrir la porte à toutes les aventures. Quant aux parlements, il vaut mieux éviter une surreprésentation des juristes car « ils concevront la politique comme un vaste champ de chicane ». Pris dans leurs habitudes professionnelles, leur spécialisation étroite, ils ne posséderont pas l'aptitude à voir les choses de plus haut et de plus loin, et seront incapables de faire la synthèse des intérêts multiples qui constituent un État. L'Assemblée, pour Burke, ne doit pas être omnipotente. Il cite Montesquieu : « Le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu, absolument fou... »
Pour lui, l'art de gouverner est une expérience qui ne s'apprend qu'avec du temps et de la patience. Il faut voir à long terme. L'instabilité politique est un mal en soi. Lorsque tout peut être toujours remis en question, rien de solide ne peut être construit.
Burke considère que la religion est la base de la vie civile, « la source de tout bien et de toute consolation ». L'homme est par nature un animal religieux, et Burke ajoute ces paroles prophétiques : si par malheur, les hommes venaient à se détacher du christianisme, des superstitions grossières et dégradantes viendraient le remplacer...
Burke eut une grande influence auprès des penseurs et écrivains français : Joseph de Maistre, Alexis de Tocqueville, Taine, Renan et aussi Barrès. Ce dernier sut voir, comme Burke, le poids du passé et la présence des morts à nos côtés.
Burke meurt le 9 juillet 1797.
► Robert Spieler, Rivarol du 27/1/2012.

◘ “Réflexions sur la révolution de France” d'Edmund Burke (1790)
« Cette conviction si forte et si surabondante… cette houle limoneuse, ce torrent, cette mer », Taine
Étrange Angleterre ! Elle avait donné au continent l'exemple du déisme, de l'athéisme, de la libre-pensée, de la révolte contre l'autorité politique légitime. Les « idées françaises », l'esprit du siècle, qui allaient déferler sur l'Europe monarchique avaient commencé par être des « idées anglaises ». Or voici que d'Angleterre jaillit, dès novembre 1790, contre la Révolution qui n'en est encore qu'à ses débuts, le premier cri d'alarme, retentissant, poussé au nom de l'ordre établi et de la conservation sociale ! Et qui pousse ce cri ? Un membre illustre du parti whig, défenseur éclatant de la liberté politique, Edmund Burke.
Edmund Burke, né à Dublin en 1729, de père protestant et de mère catholique, avait débuté comme homme de lettres. Des essais philosophiques l'avaient fait connaître avant qu'il ne se consacrât à la politique. Membre de la Chambre des Communes à partir de 1766, sa vie publique, dans les rangs du parti whig, avait eu comme axe la lutte contre la tentative de restauration du pouvoir personnel par le roi George III. La crise américaine qui se solda par la guerre désastreuse entre l'Angleterre et les 13 colonies, futurs États-Unis, porta au roi un coup qui réduisit à néant toutes ses ambitions, et sauva sans doute la liberté anglaise. De mémorables interventions de Burke (discours sur la taxation des Américains, 1774 ; discours sur la conciliation avec l'Amérique, 1775), au cours du combat par lui livré pour empêcher la sécession des 13 colonies, avait mis le sceau à sa réputation. Réputation d’indomptable libéral, de magnifique, puissant et somptueux orateur politique.
Mais ensuite, Burke, aux prises avec la crise très grave où se débattait le parti whig, scindé en coteries rivales, avait commis, semble-t-il, des fautes de tactique et de jugement. Il s'était laissé aller à des écarts, à une certaine intempérance, revers de sa riche et généreuse nature irlandaise. La dissolution de 1784, triomphe du second Pitt, avait marqué, avec la durable défaite whig, la fin des espoirs politiques de Burke. Lorsqu’éclate la Révolution française, la réputation du grand whig est en déclin ; les jeunes gens jugent surannée son éloquence ; plusieurs fois il a paru manquer du sens des proportions ; dans son propre parti, on le tient à l'écart : trop impérieux, intraitable et violent ; ses ennemis s'acharnent à le décrier, le persécutent ; la moitié de la nation anglaise, nous dit-on, le considère alors comme « un fou » plein de dons.
14 juillet 1789, prise de la Bastille. Le célèbre whig Fox, ami de Burke, s'exalte : voilà le plus grand événement de l'histoire du monde, et le plus heureux. Dans bien des cœurs anglais, qui avant peu maudiront la France satanique, sonne pour le moment l'heure des vœux généreux. Quels accents enflammés ne peut-on attendre de l'ardente bouche irlandaise qui, contre l'opinion populaire, celle du Parlement, celle de la Cour, avait défendu la liberté américaine - maintenant qu'à son tour se lève, éclairant l'Europe, la liberté française !
Or Burke se tait ; silence réticent ; son premier mouvement a été défavorable. En 1773, Burke avait fait un voyage en France. Marie-Antoinette avait 16 ans alors, et n'était que dauphine ; il l'avait vue à Versailles et admirée. Ce souvenir devait lui inspirer, dans les Réflexions, une page d'anthologie (« elle était ainsi que l'étoile du matin, brillante de santé, de bonheur et de gloire »). Mais Burke à Paris avait aussi pris contact avec « les philosophes » du temps ; ces « encyclopédistes » et « économistes » comme on les appelait, ces sophistes destructeurs et athées, comme il les nomme. Il en était resté horrifié. Rationalisme en matière de religion, rationalisme en matière de politique, rien ne lui inspirait plus de dégoût, ni de crainte. Aussi son âme vibrante et excessive avait-elle été frappée d'une appréhension qui ne devait plus se dissiper, à la suite de ce contact avec les philosophes français tout occupés d'écraser l'infâme, ainsi qu'ils disaient (« l'infâme » étant le christianisme).
Comment, si cela était, Burke avait-il pris si ardemment le parti des colons américains ? Contradiction ? En aucune façon. Sans doute, certains des chefs de l'insurrection américaine, tels Jefferson, Franklin, étaient nourris des idées de Locke et de celles du XVIIIe siècle français, nourri lui-même de Locke. Mais ce n'étaient pas ces idées-là que Burke défendait ; ce n'était pas la notion des droits naturels abstraits, de l'homme né « libre et égal » à tout autre. Burke, bien au contraire, refusait absolument d'entrer dans la discussion abstraite des droits abstraits des colons américains. Le Parlement anglais avait-il le droit de taxer les colons ? Sans doute ; mais l'exercice d'un tel droit n'était pas praticable ; il risquait d'entraîner des calamités ; donc il était inopportun : « La question pour moi, s'écriait Burke, n'est pas de savoir si vous avez le droit de rendre votre peuple malheureux, mais si ce n'est pas votre intérêt de le rendre heureux ». Burke pensait aussi que les libertés revendiquées par les colons, ces Anglais d'au-delà des mers, étant des libertés anglaises, l'emploi de la force victorieuse contre les colons sonnerait en définitive le glas de ces libertés anglaises. Rien, dans son plaidoyer fougueux, ne se réclamait d'une conception abstraite de la société, fondée sur la nature et la raison, sur la liberté et l'égalité métaphysiques et en soi. Rien n'y pouvait passer pour la moindre concession aux « idées françaises ».
On s'étonne moins, cela étant connu, de voir Burke suivre les premiers travaux de l'Assemblée nationale constituante d'un esprit méfiant et fermé, plein de doutes sur l'avenir. Quand il croit reconnaître les principes abstraits, le goût de la table rase, la logique nue des sophistes français de 1773, ces doutes deviennent une certitude : cela finirait mal, et avant peu, cela serait très dangereux pour l'Angleterre elle-même.
Sur son dégoût intellectuel se greffe, lorsque Burke apprend les Journées des 5 et 6 octobre 1789 (le château royal, à Versailles, envahi, la reine menacée), une sorte de colère sacrée. Quoi, son étoile du matin, sa radieuse dauphine de 1773 élevée depuis au rang de reine, Marie-Antoinette, en butte à ces outrages de populace ! Ah ! certes, « le siècle de la chevalerie est passé ; celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé, et la gloire de l'Europe est à jamais éteinte ».
Colère sentimentale, dégoût intellectuel vont être poussés au paroxysme par un incident purement anglais. Chaque année, le 4 novembre, jour anniversaire du débarquement de Guillaume d'Orange en 1688, une Société de la Révolution, composée principalement, mais non uniquement, de dissidents, avait l'habitude de se réunir pour écouter un sermon commémoratif de la révolution whig ; après le sermon avait lieu un banquet, suivi des discours d'usage. La cérémonie du 4 novembre 1789 risquait d'être colorée par quelques reflets idéologiques de la toute récente Révolution française. C'est ce qui arriva. Un pasteur dissident, le docteur Price, écrivain politique connu, d'opinion avancée, qui prononçait le sermon, exprima sa joie devant les progrès nouveaux que la cause de la liberté venait de réaliser grâce à la France. Même note optimiste dans les discours de l'après-midi : les événements de France ouvraient d'immenses espoirs à la liberté humaine, comme à une durable paix franco-anglaise. Adresse enthousiaste à l'Assemblée nationale française.
Burke, mis au courant, et donnant tout de suite à l'incident une portée tout â fait disproportionnée à sa réalité, flambe de fureur : des Anglais dévoyés avaient osé mettre sur le même pied, associer fraternellement la Révolution de 1688, si parfaitement anglaise et respectable, concrète, limitée, protestante, et cette révolution de France, tout abstraite, iconoclaste, perverse et athée. Burke, dans une sorte d'explosion de ses 60 ans exaspérés, bondit sur sa plume pour écrire les Réflexions.
*
Exactement il commence par écrire une lettre — dénonçant le sermon du docteur Price, et la déplorable contagion de l'exemple français — à M. de Menonville, jeune député de la noblesse à l'Assemblée nationale, auquel, en octobre, il venait déjà d'écrire longuement sur les événements de son pays. Au début, il n'avait, assurera-t-il, d'autre objet que cette seconde lettre, lettre privée, tout comme la première. Mai le sujet devint si abondant, que tout naturellement un volume (de 356 pages in-octavo, dans la première édition) en sortit. Splendide et luxuriante nature intellectuelle de Burke !
Ce n'est pas dire que les Réflexions soient une longue improvisation passionnée. Si Burke a pris immédiatement la plume, sous le coup de l'indignation déchaînée en lui par l'incident du 4 novembre, au fur et à mesure que s'avançait la composition de sa lettre-livre, il a mûri et amplifié sa matière. « Chaque courrier — écrit son biographe, lord Morley — qui traversait la Manche, apportait de nouveaux matériaux à son mépris et à ses craintes ». Les révolutionnaires français s'avéraient de plus en plus abstracteurs, destructeurs, de plus en plus « architectes de la ruine ». Et Burke condamnait, condamnait, condamnait. Ainsi l'imposant monument oratoire s'élevait-il progressivement. « Burke révisait, effaçait, atténuait, forçait, accentuait, écrivait, et récrivait infatigablement. » Enfin, en novembre 1790, l'ouvrage était prêt à paraître. Il avait été juste un an sur le métier.
Il porte la marque de son origine et de sa confection à la fois fiévreuse et travaillée. Le manque de composition préméditée saute aux yeux. Burke avoue que son sujet aurait pu être mieux divisé et distribué. Il n'y a pas un seul titre tout au long de l'ouvrage, pas de chapitres, aucune indication extérieure qui permette de s'orienter au fur et à mesure de la lecture. Comme si l'auteur avait désiré maintenir à son livre l'aspect d'une protestation spontanée, écrite d'une seule haleine, d'une seule et gigantesque coulée !
On peut, assez artificiellement et pour la clarté, distinguer 2 grandes parties dans ces Réflexions, où réapparaissent sans cesse, diversement et obstinément orchestrés, les mêmes thèmes essentiels. Une première partie est consacrée à montrer, en prenant pour texte le révoltant sermon du docteur Price, le contraste complet entre la Révolution anglaise de 1688 et la Révolution française, contraste entièrement à l'avantage de la première: L'interprétation donnée par Burke, conservatrice à l'excès, des événements de 1688, n'est d'ailleurs pas acceptée en général par les auteurs anglais. La seconde partie est plus spécialement consacrée à la critique des « Nouveaux établissements » de l'Assemblée nationale. Bases de la représentation politique ; situation de l'exécutif ; organisation judiciaire, militaire, financière : tout est critiqué avec une sévérité plus d'une fois justifiée, mais toujours unilatérale, et où grince une hargne que rien ne saurait désarmer. Il est bien instructif de comparer ces pages avec les fameuses « Notes secrètes » qu'à la même époque Mirabeau adressait à la Cour : une sévérité analogue s'y allie à la hauteur, à l'étendue des vues d'un grand esprit politique, ouvert sur l'avenir et que n'emporte pas la passion.
Les Réflexions sont un torrent impétueux, bizarre, aveugle, plein de chatoiements magnifiques. On ne peut s'abandonner ici à son abondance incontrôlée, il faut maîtriser, endiguer ce flot inépuisable, autrement dit choisir. Or il y a dans ce livre célèbre, pétris, brassés ensemble, à la fois un pamphlet d'actualité contre les Constituants français, pamphlet hurlant de partialité, et un procès de doctrine - qui touche à l'un des plus hauts débats de la philosophie politique. Le pamphlet, où éclate une évidente ignorance des conditions réelles de la France de 1789 (si bien décrites au contraire, par un autre Anglais, Arthur Young, dans ses Voyages en France), ne présente plus d'intérêt que pour les historiens de la Révolution. Le procès de doctrine, au contraire, qui ne sera jamais tranché définitivement, garde un intérêt permanent, et lui seul va nous retenir.
*
Ce procès est celui de la conception abstraite et purement rationnelle — en même temps que purement individualiste — de la société civile. Conception issue de la philosophie anglaise, au premier chef de Locke, et qui s'épanouissait, cent ans plus tard, dans le cerveau rigoureux d'un Sieyès. Secouer le joug des préjugés, contraires à la raison, à la nature (bonne en soi), au bonheur terrestre (aspiration légitime de tout être humain sur la terre) ; faire table rase de tout cet héritage d'un passé absurde, pour construire de toutes pièces une société raisonnable, régie par une morale laïque, permettant de se passer de Dieu, ce prétexte à tous les fanatismes — société qui de façon presque automatique devait se diriger vers le progrès indéfini : tels étaient les dogmes principaux de cette conception, tout aussi dogmatique que celle qu’elle combattait. Telle était l'essence de ce qu'on appelle l'esprit du siècle, du XVIIIe siècle, si parfaitement étranger à celui du siècle précédent. Cet esprit avait une racine scientiste : les sciences exactes, surtout physiques et naturelles, avaient réalisé au XVIIIe s. d'énormes progrès, grâce à certaines méthodes de rigueur dans l'observation, de logique et d'abstraction. Pourquoi les mêmes méthodes ne transformeraient-elles pas de la même façon la science du gouvernement ? Ce que le XVIIe siècle, timoré, avait appelé le « mystère » du gouvernement, était, tout comme les mystères religieux, un prétendu mystère : une science politique, à créer, devait le disséquer, comme la science médicale dissèque le corps humain.
Voilà l'esprit, voilà la conception que Burke — qui a, au plus haut point, le sens du mystère du gouvernement et de la nécessité de ce mystère — entend écraser, dans l'étreinte de sa dialectique endiablée. Écrasons l'infâme ! — Burke, à son tour, lance ce cri, retourné, à ses interlocuteurs philosophes de 1773. Défendons les préjugés et tout ce qu'ils impliquent : esprit historique, héritage, privilèges, inégalité, hiérarchie, ordres et corps, religion établie avec ses propriétés et ses franchises. Défendons-les, et avec eux l'autorité traditionnelle, tous les anciens respects, toutes les anciennes chevaleries — contre esprit de révolte et de table rase, contre nature et raison des nouveaux iconoclastes. Contre eux, contre la Révolution, retournons ces notions mêmes, qu'ils ont perverties, de nature et de raison.
L'horreur de l'abstrait ; une notion inédite de nature ; une notion originale de la raison générale ou politique : on peut classer sous ces 3 rubriques, sans excès d'artifice, l'argumentation virulente et torrentielle de Burke, dans ses Réflexions, contre l'esprit du siècle.
Horreur de l'abstrait
Burke, on le sait, exprimait déjà cette horreur dans ses Discours sur la révolution américaine ; il avertissait qu'il ne défendait nullement la liberté abstraite, mais des libertés concrètes, les libertés anglaises transplantées en Amérique ; il disait : « Je n'entre pas dans ces distinctions métaphysiques, je hais jusqu'au son de ces mots ». Dans les Réflexions, il revient sans cesse sur ce point. Il refuse de discuter dans l'abstrait, c'est-à-dire en dehors des circonstances de temps, de lieu, de personne Il refuse de blâmer, de louer rien de tout ce qui a rapport aux actions humaines, ou à l'intérêt public, « sur le simple aperçu d'un objet dépouillé de tous ses caractères concrets, dans la nudité et dans tout l'isolement d'une abstraction métaphysique ». Il proclame que « les circonstances, qui ne sont rien pour quelques personnes, pourtant dans la réalité ce qui donne à un principe de politique sa couleur distinctive et son véritable caractère [et que] ce sont elles qui rendent un plan civil et politique utile ou nuisible au genre humain ». Défendre un principe abstrait sans connaître les circonstances exactes, c'est du don quichottisme ; c'est peut-être espagnol ou français, ce n'est pas anglais.
Exemple : on voudrait que Burke félicitât les Français sur leur liberté ; mais, demande-t-il, aurait-il pu raisonnablement, il y a dix ans, féliciter la France sur son gouvernement, « car alors elle en avait un », sans s'être informé auparavant de la nature de ce gouvernement et de la manière dont on l'administrait.
Puis-je aujourd'hui féliciter cette même nation sur sa liberté ? Parce que la liberté, dans son sens abstrait, doit être placée parmi les bienfaits du genre humain, irais-je sérieusement complimenter un fou qui se serait échappé de la contrainte protectrice et de l'obscurité salutaire de son cachot, sur le recouvrement de la lumière et de sa liberté ? Irais-je complimenter un voleur de grands chemins ou un meurtrier qui aurait brisé ses fers sur la récupération de ses droits naturels ? Ce serait renouveler la scène des galériens et de leur héroïque libérateur, le métaphysicien Chevalier de la Triste Figure.
♦ Erreur, en conséquence, la notion des droits de l'homme dans son abstraction et son absolu.
Oh ! s'il s'agissait des véritables droits de l'homme ! Certes, tous les hommes ont droit à la justice, au produit de leur industrie et à tous les moyens de les faire fructifier. «Ils ont droit d'appartenir à leurs père et mère..., d'élever et perfectionner leurs enfants... Quelque chose qu'un homme puisse entreprendre séparément pour son propre avantage sans empiéter sur l'avantage d'un autre, il a le droit de le faire. » Mais, dans le langage des révolutionnaires français et du docteur Price, il s'agit bien d'autre chose ! Ces droits de l'homme sont une « mine... préparée sous terre », dont l'explosion doit faire sauter « tout à la fois les exemples de l'antiquité, les usages, les chartes, les actes du Parlement, tout ». Ce qui est avant tout revendiqué, c'est le droit de partager le pouvoir, l'autorité, la conduite des affaires de l'État. Or, ce droit,
Je nierai toujours très formellement qu'il soit au nombre des droits directs et primitifs de l'homme en société civile... Le gouvernement n'est pas fait en vertu des droits naturels qui peuvent exister et qui existent en effet indépendamment de lui, ils sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus parfaits dans leur abstraction, mais cette perfection abstraite est leur défaut pratique ; en ayant droit à tout, on manque de tout. Le gouvernement est une invention de la sagesse humaine, pour pourvoir aux besoins des hommes... Au nombre de tous ces besoins, on convient que celui qui se fait le plus sentir est de restreindre suffisamment les passions... Dans ce sens, la contrainte est aussi bien que la liberté au nombre des droits des hommes.
Vanité d'ailleurs — s'agissant même des droits véritables et que Burke accepte — de ces définitions métaphysiques :
En vérité, dans cette masse énorme et compliquée des passions et des intérêts humains, les droits de l'homme sont réfractés et réfléchis dans un si grand nombre de directions croisées et différentes, qu'il est absurde d'en parler encore, comme s'il leur restait quelque ressemblance avec leur simplicité primitive... Tous les droits prétendus de ces théoriciens sont extrêmes, et autant ils sont vrais métaphysiquement autant ils sont faux moralement et politiquement. Les droits des hommes sont dans une sorte de milieu qu'il est impossible de définir [mais — ajoute Burke — « qu'il n'est pas impossible d'apercevoir »].
♦ Erreur, l'impersonnalité des institutions.
Sous la monarchie, les institutions, toutes liées à la personne du roi, avaient un caractère personnel que les abstracteurs français s'acharnent à détruire. Cette dépersonnalisation consterne et irrite Burke ; il y voit à juste titre la fin d'un système mélangé d'opinions et de sentiments qui avait son origine dans l'ancienne chevalerie et qui avait donné son caractère à l'Europe moderne : « S'il devait jamais totalement s'éteindre, la perte, je le crains, serait énorme ». Et Burke soupire, et Burke prophétise. Burke fait l'oraison funèbre de ces valeurs chevaleresques, de cet honneur selon Montesquieu : « Mais maintenant tout va changer, toutes les illusions séduisantes qui rendaient le pouvoir aimable et l'obéissance libérale, qui donnaient de l'harmonie aux différentes ombres de la vie et qui par une fiction pleine de douceur faisaient tourner au profit de la politique tous les sentiments qui embellissent et adoucissent la vie privée... On arrache avec cruauté toutes les draperies qui faisaient l'ornement de la vie ». La chose publique sera désormais dépouillée de « toutes nos ressources pour engager l'affection » ; un roi deviendra un homme comme un autre, et la reine simplement « une femme » ; or, écrit Burke, « une femme n'est qu'un animal et encore n'est-il pas du premier ordre ».
Dépersonnaliser ainsi les institutions, c'est empêcher de faire naître chez les citoyens l'amour, la vénération, l'admiration ou l'attachement ; tous ces nobles sentiments de l'homme pour l'homme. Philosophie mécanique, philosophie barbare, qui bannit toutes les affections, mais qui est incapable de les remplacer ! Or les affections sont les suppléments, les soutiens de la loi, laquelle, impersonnelle par essence, a besoin d'être suppléée, encouragée, soutenue, par des sentiments personnels. Une telle philosophie — rugit Burke, qui ne cesse d'animer, au cours de ces pages contre la perte de l'esprit de chevalerie, l'évocation de Marie-Antoinette insultée et poursuivie — une telle philosophie, mécanique et barbare, « n'a pu naître que dans des cœurs glacés et des esprits avilis ».
♦ Erreur enfin, la simplicité pseudo-géométrique des institutions.
Montesquieu avait eu au plus haut degré, dans un siècle à cet égard simpliste, le sens de la complexité infinie des choses politiques et sociales ; il n'y avait pas moins jeté, avec sa foi dans la raison (ce sens « exquis », comme il dit), le plus de clarté qu' avait pu. Mais les vrais « philosophes », les idéologues à la Helvétius, lui avaient reproché, comme une tare, liée à ses préjugés, son goût de concilier, de balancer les éléments divers de la réalité complexe — qu'eux, ces idéologues, voyaient simple et nue. Et Sieyès venait d'opposer à la « mécanique appliquée » de Montesquieu, à la grande hygiène politique et sociale de Montesquieu, sa « mécanique rationnelle » (A. Sorel).
C'est, bien entendu, Montesquieu que Burke, nourri de L'Esprit des lois, rejoint ici. D'après lui, la Constitution d'un État et la distribution équitable des pouvoirs relèvent de la science la plus délicate et la plus complexe ; il y faut une connaissance profonde de la nature humaine, de ses besoins, de tous les procédés susceptibles de faciliter ou d'empêcher les buts d'intérêt public que l'on recherche. Une discussion abstraite, par ex., sur les droits de l'homme (décidément bête noire de Burke), n'apporte rien, n'apporte aucune nourriture, aucun aliment, aucun remède aux maux sociaux dont on peut avoir à se plaindre. Pour alimenter, pour nourrir, un fermier vaut mieux qu'un professeur de métaphysique. Le raisonnement a priori laisse forcément de côté les causes obscures et cachées ; il est bien impuissant à maîtriser « la masse énorme et compliquée des passions et des intérêts humains », que la vie publique met en jeu.
Lorsque j'entends vanter la simplicité d'invention à laquelle on prétend arriver dans de nouvelles Constitutions politiques, je ne puis m'empêcher de conclure que ceux qui y travaillent ne savent pas leur métier ou qu'ils sont très négligents pour leur devoir. Les gouvernements simples sont fondamentalement défectueux, pour ne rien dire de plus.
Ainsi Burke exprime-t-il son horreur de l'abstrait, destructeur, inefficace, dépersonnalisant, et absurdement simplificateur.
Notion, retournée, de la nature
Que de jeux de mots dans l'histoire des idées ! combien de sens variés, parfois radicalement opposés, les 2 mots nature et raison n'ont-ils pas revêtus, selon les époques, selon le caprice des philosophies ou des passions affrontées ?
Burke est, semble-t-il, le premier à opérer le retournement systématique du mot nature, qui fera école chez tous les écrivains contre-révolutionnaires. Est naturel à ses yeux non pas ce qui vaut pour tous les hommes, non pas ce qui appartient par essence à la nature humaine, ce qui est inhérent à la nature humaine en tous temps et en tous lieux (ou, en termes de l'école de l'état de nature — Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau — ce qui se rapporte à l'homme considéré antérieurement à tous les liens sociaux). Est naturel, pour Burke, ce qui apparaît comme le résultat d'un long développement historique, d'une longue habitude ; autrement dit nature égale histoire, expérience historique, habitude créée par l'histoire. Burke professe que les choses ont une façon naturelle de s'opérer, que l'histoire nous révèle ; il faut que, nous autres hommes, nous laissions faire les choses, sans nous en mêler ; tout ira beaucoup mieux si nous nous ne nous en mêlons pas : « Laissées à elles-mêmes, les choses trouvent généralement l'ordre qui leur convient. » Cette conception, par excellence conservatrice, ne saurait être évidemment de nature à plaire à ceux pour qui les choses ne vont pas bien, ou vont même très mal. Cette conception risque d'aboutir à sanctifier l'habitude.
Elle sanctifie, en tout cas, l'héritage et les préjugés ; la table rase lui fait horreur.
L'HÉRITAGE. — Incontestablement, il est voulu par la nature. L'Angleterre, dans sa Constitution, n'a fait qu'appliquer à la politique cette institution si naturelle. Burke est intarissable là-dessus, lyrique et enthousiaste ; d'autant plus qu'il s'agit pour lui de pourfendre une interprétation de la Révolution de 1688 avancée par le docteur Price (« Le droit de fabriquer un gouvernement pour nous-mêmes ») :
La simple idée de la formation d'un nouveau gouvernement suffit pour nous inspirer le dégoût et l'horreur ; nous souhaitions à l'époque de la révolution, et nous souhaitons encore aujourd'hui, ne devoir tout ce que nous possédons qu'à l'héritage de nos ancêtres. Nous avons eu grand soin de ne greffer, sur ce corps et sur cette souche d'héritage, aucun rejet qui ne fût point de la nature de la plante originaire... La politique permanente de ce royaume... est de regarder nos franchises et nos droits les plus sacrés comme un héritage... Nous avons une couronne héréditaire, une pairie héréditaire et une Chambre des Communes et un peuple qui tiennent par l'héritage d'une longue suite d'ancêtres leurs privilèges, leurs franchises, et leur liberté... Cette politique me paraît être l'effet d'une profonde réflexion, ou plutôt l'heureux effet de cette imitation de la nature qui, bien au-dessus de la réflexion, est la sagesse par essence... Par cette politique constitutionnelle qui agit d'après le modèle de la nature, nous recevons, nous possédons, nous transmettons notre gouvernement et nos privilèges de la même manière dont nous recevons, dont nous possédons et dont nous transmettons nos propriétés et la vie... Notre système politique est dans une symétrie et dans un accord parfait avec l'ordre du monde.
L'ordre du monde, c'est l'ordre de la nature ; le système politique anglais est un système naturel, dans la mesure où il est le fruit du développement historique, non dérangé par la logique abstraite. Notons en passant que cette argumentation de Burke, toute soulevée par un magnifique orgueil insulaire, n'est pas sans rappeler celle dont Bossuet justifiait la monarchie héréditaire de mâle en mâle ; en ce sens le grand évêque français peut apparaître comme l'illustre précurseur de la « politique naturelle ».
LES PRÉJUGÉS. — Haïs de la logique abstraite, bête noire de l'Esprit du siècle, les préjugés sont, pour Burke, naturels dans la mesure où l'histoire les explique, où ils en sont le résultat. En particulier, rien de plus naturel que ce préjugé de la naissance sur lequel la noblesse est fondée, et contre lequel déblatèrent les révolutionnaires français. C'est l'indignation de ceux-ci qui est artificielle. Rien de plus naturel que l'effort vigoureux de chaque individu, pour défendre la possession des propriétés et des distinctions qui lui ont été transmises. Tenir avec force à de tels préjugés est comme un instinct (et quoi de plus naturel qu'un instinct ?), qui devient la garantie naturelle des propriétés et du maintien des sociétés. C'est la nature même qui a mis en nous cet instinct, pour repousser l'injustice et le despotisme, en un mot pour défendre la liberté. Ainsi le préjugé de la naissance contribue à protéger la liberté.
Ce qui n'est pas naturel, c'est l'égalité chère aux révolutionnaires français. Prétendue égalité ! prétendu nivellement ! Pourquoi prétendus ? Parce que, « dans toutes les sociétés qui nécessairement sont composées de différentes classes de citoyens, il faut qu'il y en ait une qui domine. C'est pourquoi les niveleurs ne font que changer et qu'intervertir l'ordre naturel des choses. Ils surchargent l'édifice de la société en plaçant en l'air ce que la solidité de la construction devait faire placer à la base ». Voilà comment les révolutionnaires français commettent la pire des usurpations, celle des prérogatives de la nature qui, seule, sait ce qui doit être en bas, et ce qui doit être en haut.
Le chancelier de France, à l'ouverture des États généraux, a dit sur le ton d'une fleur de rhétorique, que toutes les occupations étaient honorables. S'il avait envie de dire seulement qu'aucun emploi honnête n'était flétrissant, il n'aurait pas été au-delà de la vérité ; mais, en disant que toute chose est honorable, nous sommes forcés d'admettre quelque distinction. L'occupation d'un perruquier ou d'un chandelier, pour ne pas parler de beaucoup d'autres emplois, ne peut être pour personne une source d'honneur. L'État ne doit exercer aucune oppression sur des hommes de cette classe ; mais l'État en aurait une très grande à souffrir, si tels qu'ils sont, collectivement, ou individuellement, on leur permettait de le gouverner. Vous croyez qu'en faisant cela vous avez vaincu un préjugé, vous vous trompez, vous avez déclaré la guerre à la nature.
Phrases révélatrices de l'état d'esprit aristocratique et conservateur d'un grand whig, d'un illustre libéral anglais, admirateur de Montesquieu (dont la lecture n'a pu que confirmer sa conception de la liberté-privilège, sa répugnance à toute égalité démocratique dans une monarchie libre). Sutor ne ultra crepidam, affirme le dicton latin, remettant le cordonnier à sa place, le renvoyant à ses chaussures. De même Burke remet à sa place le marchand de chandelles, en lui demandant de ne pas s'occuper d'autre chose que de ses chandelles.
Et dans le même esprit, à propos de la représentation politique, Burke s'insurge, anti-Sieyès, contre la seule loi du nombre, contre l'exclusion de toutes prééminences, de toute préférence à la naissance et à la propriété héréditaire. « On dit que vingt-quatre millions d'hommes doivent l'emporter sur deux cent mille, cela est vrai si la Constitution d'un royaume est un problème d'arithmétique ; cette manière de parler n'est pas impropre quand elle a le secours de la Lanterne pour l'appuyer, mais elle est ridicule pour des hommes qui peuvent raisonner de sang-froid. La volonté du grand nombre et les intérêts du grand nombre sont rarement la même chose ; et la différence sera énorme si, en vertu de sa volonté, le grand nombre fait un mauvais choix. » Décidément, vous, révolutionnaires français, « aujourd'hui vous semblez être pour chaque chose égarés de la grande route de la nature ».
LA TABLE RASE. — Quel défi encore à la nature, quelle horreur ! Tout détruire pour tout reconstruire en partant de zéro ! comment un homme peut-il « parvenir à un degré si élevé de présomption que son pays ne lui semble plus qu'une carte blanche sur laquelle il peut griffonner à plaisir... Un bon patriote et un vrai politique considérera toujours quel est le meilleur parti que l'on puisse tirer des matériaux existant dans sa patrie. Penchant à conserver, talent d'améliorer : voilà les deux qualités qui me feraient juger de la bonté d'un homme d'État ». Sans doute, c'est lent, cela peut demander des années, et « un tel procédé ne convient pas à une assemblée qui met sa gloire à faire dans peu de mois l'ouvrage des siècles » (ni, faudrait-il ajouter, à ceux qui sont pressés, parce qu'ils souffrent). C'est lent, mais c'est la méthode de la nature « dans laquelle le temps est un moyen nécessaire ». La conservation de ce qui est, combinée avec une adaptation lente à ce qui devient, voilà ce qui est naturel.
Il faut donc :
que les opérations soient lentes, et, dans quelques circonstances, presque imperceptibles. Si, lorsque nous travaillons sur des matières inanimées, la circonspection et la prudence sont de sagesse, ne deviennent-elles pas, à plus forte raison, de devoir, lorsque les objets de notre constitution et de notre démolition ne sont ni de la brique ni des charpentes, mais des êtres animés dont on ne peut altérer subitement l'état, la manière d'être et les habitudes sans rendre misérables une multitude d'autres êtres semblables. Mais on dirait que l'opinion dominante à Paris est que, pour faire un parfait législateur, les seules qualités requises sont un cœur insensible et une confiance qui ne doute de rien.
Ce que les politiques français regardent comme la marque d'un génie « hardi et entreprenant » ne prouve qu'un manque déplorable d'habileté. S'ils sont la proie aveugle de tous les faiseurs de systèmes, aventuriers, alchimistes et empiriques opposés aux vrais médecins, c'est précisément à cause de leur « violent empressement », de leur hâte absurde et de « la défiance qu'ils ont de la marche de la nature ». Défiance qui correspond très exactement à la confiance qu'ils ont dans les démarches de la raison pure. Constructeurs français sans discernement, enragés à balayer, « comme de purs décombres », tout ce qu'ils ont trouvé, les Provinces comme les Ordres ! Ils sont bien du même pays que les jardiniers à la française, « jardiniers de leurs parterres, nivelant tout avec soin ».
Qu'elle est intéressante, cette critique des jardins à la Le Nôtre ! Nous saisissons ici à quel point la psychologie d'un peuple irrigue tout ce qu'il fait, se manifeste dans ses activités les plus variées. Entre un jardin à la française et un jardin à l'anglaise, même différence qu'entre les Constitutions de la Révolution française et la Constitution anglaise. Cette dernière est un fouillis apparent où s'ouvrent des perspectives subites et magnifiques (comme Montesquieu le premier l'a fait voir lumineusement). Tandis que le système français n'apparaît à Burke que le résultat d'une déplorable superstition du nivellement et du neuf, à laquelle il oppose la manière empirique anglaise de ne changer qu'en conservant et de ne conserver qu'en changeant, le culte anglais pour les « vieux établissements ».
La force de Burke consiste, le lecteur a pu déjà s'en rendre compte, à reprendre maintes fois, infatigablement, le même thème en le colorant différemment. Sur ce thème de la résistance à l'innovation conforme à la nature, du respect des préjugés conforme à la nature, Burke a encore une page éclatante de fougue pamphlétaire et de morgue insulaire :
Grâce à notre résistance obstinée à l'innovation, grâce à la paresse froide de notre caractère national, nous portons encore l'empreinte de nos ancêtres. Nous n'avons pas encore perdu, à ce que je vois, la façon de penser généreuse et élevée du XIVe siècle, et nous ne sommes pas encore, à force de subtilités, devenus sauvages. Nous ne sommes pas les adeptes de Rousseau, ni les disciples de Voltaire ; Helvétius n'a pas fait fortune parmi nous ; des athées ne sont pas nos prédicateurs ni des fous nos législateurs. Nous savons que nous n'avons pas fait de découverte, et nous croyons qu'il n'y a pas de découvertes à faire en moralité, ni beaucoup dans les grands principes de gouvernement, ni dans les idées sur la liberté qui, longtemps avant que nous fussions au monde, étaient aussi bien connus qu'ils le seront lorsque la terre aura élevé son moule sur notre présomption et que la tombe silencieuse aura appesanti sa loi sur notre babil inconsidéré. En Angleterre, nous n'avons pas encore été dépouillés de nos entrailles naturelles ; nous sentons encore au-dedans de nous, nous chérissons et nous cultivons ces sentiments innés qui sont les gardiens fidèles, les surveillants actifs de nos devoirs, et les vrais soutiens de toute morale noble et virile. Nous n'avons pas encore été vidés et recousus pour être remplis comme les oiseaux d'un musée avec de la paille, avec des chiffons, et avec de méchantes et sales hachures de papiers sur les droits de l'homme.
Quel mépris, dans ces lignes virulentes, pour tous les changements soudains à la française, déclaration des droits de l'homme, suppression de la noblesse, des droits féodaux, des provinces, des parlements, nationalisation des biens du clergé, etc. !
Avec quel orgueil Burke leur oppose le conservatisme anglais fondé sur le respect de la nature, c'est-à-dire, répétons-le, du développement de l'histoire dans son déroulement naturel !
Raison générale ou raison politique
C'est ici un nouvel emploi du procédé de retournement de l'argument adverse : à leur raison, Burke oppose la sienne. C'est aussi une nouvelle forme de réhabilitation du préjugé. Nous, Anglais, écrit Burke, « avons peur d'exposer les hommes à ne vivre et à ne commercer qu'avec le fond particulier de raison qui appartient à chacun, parce que nous soupçonnons que ce capital est faible dans chaque individu ». Cette raison individuelle, devant laquelle l'esprit du siècle est à genoux, Burke ne la nie pas, mais lui accorde peu d'efficacité. À elle seule, c'est un faible capital, et les hommes font beaucoup mieux « de tirer avantage tous ensemble de la banque générale et du capital des nations et des siècles », autrement dit des préjugés généraux, hérités des ancêtres. Il existe, à un moment donné du temps, pour une nation donnée, un ensemble de préjugés sur lesquels elle vit. Bon pour les penseurs abstraits, à la française, de haïr le préjugé, de le bannir, de lui donner la chasse, parce que la raison individuelle, qui ne l'a pas élu, est par lui choquée. Les Anglais raisonnent autrement :
Beaucoup de nos penseurs, au lieu de bannir les préjugés généraux, emploient toute leur sagacité à découvrir la sagesse cachée, qui domine dans chacun. S'ils parviennent à leur but, et rarement ils le manquent, ils pensent qu'il est bien plus sage de conserver le préjugé avec le fond de raison qu'il renferme, que de se dépouiller de ce qu'ils n'en regardent que comme le vêtement, pour laisser ensuite la raison toute à nu ; parce qu'ils pensent qu'un préjugé, y compris sa raison, a un motif qui donne de l'action à cette raison et un attrait qui lui donne de la permanence.
Le préjugé, vêtement d'une raison cachée ! Cette réhabilitation saisissante frappera vivement Taine qui, dans Les Origines, répétera : le préjugé, « sorte de raison qui s'ignore », « comme l'instinct, forme aveugle de la raison ». Et Barrès, disciple de Taine, en tirera une image bien connue : « Revêtons nos préjugés, ils nous tiennent chaud ».
Autant la raison individuelle est inefficace, hésitante, en face des décisions graves, autant la raison collective, cristallisée en préjugés, est efficace et sûre. Elle crée des réflexes, elle ploie l'âme à agir dans un certain sens qui est celui de la vertu, de même que de longues et bonnes habitudes physiques ploient le corps dans le sens d'un mouvement désiré : « Le préjugé est d'une application soudaine dans l'occasion ; il détermine, avant tout, l'esprit à suivre avec constance la route de la sagesse et de la vertu, et il ne laisse pas les hommes hésitant au moment de la décision ; il ne les abandonne pas au danger du scepticisme, du doute et de l'irrésolution ».
Ici encore, Taine fera directement écho à Burke, quand il professera avec force qu'une doctrine ne devient active, ne se transforme en ressort d'action qu'en devenant « aveugle », en se déposant dans les esprits à l'état « de croyance faite, d'habitude prise, d'inclination établie », en quittant le plan élevé, mais inefficace de l'intelligence pour celui de la volonté. Ainsi cette raison générale, fruit de la longue accumulation des expériences des morts qui nous ont précédés (la terre et les morts, dira Barrès), loin d'être une usurpatrice, a naturellement le pas sur la raison tout abstraite, comme doit l'avoir « une sœur aînée ». À partir de Burke se trouverait, par conséquent, édifié l'un des piliers les plus vigoureux, les plus valables à l'appui de la conception traditionaliste ou conservatrice de la société politique.
*
Le succès du livre devait être prodigieux : 11 éditions en moins de 12 mois, 30.000 exemplaires vendus jusqu'à la mort de Burke en juillet 1797.
En Angleterre, avant les Réflexions, la Révolution française inspirait quelque sympathie, mêlée d'étonnement et d'une vague inquiétude, d'une vague appréhension à peine consciente d'elle-même. Le Premier ministre Pitt, avant tout homme d'État, calculait les conséquences qu'une telle secousse pourrait avoir sur une grande puissance rivale, et n'exprimait en public ou en privé que des sentiments plutôt favorables. Après tout, ce gouvernement de Louis XVI qui croulait sous les coups des Constituants avait aidé les colons américains à secouer la tutelle anglaise ; pourquoi trop le plaindre ? « État d'esprit facile » (dit Lord Morley), auquel mit fin le livre de Burke : « D'un coup il divisa la nation en deux parties ; des deux côtés il précipita et accéléra l'opinion ». Toutes les fractions étroitement conservatrices, les tories, dont en tant d'occasions le grand whig Burke avait été la bête noire, se rassemblèrent avec enthousiasme derrière le nouveau drapeau qu'il déployait avec un tel éclat. George III, l'autoritaire, fit des bonds de joie : excellent livre que devait lire tout gentleman, clamait-il à tout venant. Les Anglais d'opinion trop francophile, libéraux avancés, appelés avec mépris «radicaux » ou « démocrates », devinrent suspects à une partie du peuple ; la foule brûla la maison de l'un d'eux, Priestley. Cependant les amis de Burke grondaient : ne rougit-il pas d'un tel succès ? N'a-t-il pas honte de sa nouvelle clientèle ? Fox ne cachait pas sa désapprobation ; Burke rompit publiquement avec lui, en mai 1791, au cours d'une scène dramatique à la Chambre des Communes : « Notre amitié est finie ».
Sur le continent, les Réflexions allaient devenir le catéchisme de la réaction contre-révolutionnaire. Catherine de Russie, l'ancienne amie des « philosophes » Voltaire et Diderot, adressa ses félicitations à l'auteur qui les dénonçait comme des malfaiteurs publics. Un jour, elle avait fait observer à Diderot qu'il écrivait sur le papier « qui souffre tout », tandis qu'elle, impératrice, travaillait « sur la peau humaine qui est bien autrement chatouilleuse et difficile ». À partir de la prise de la Bastille, il ne s'agissait plus d'inoffensif « papier », mais d'un travail explosif et corrosif des Français sur la peau humaine ; et Catherine, la despote éclairée, n'était plus de ce jeu-là ; et Burke devenait à ses yeux un bienfaiteur public. Une délégation de la noblesse française émigrée à Bruxelles fit témoigner à l'auteur des Réflexions, par son fils Richard « l'admiration et la reconnaissance que son ouvrage a inspirées à tous les Français sincèrement attachés à leur religion, à leur roi et aux lois du royaume ».
À la tribune de l'Assemblée nationale, le 28 janvier 1791, Mirabeau, qui avait connu Burke en Angleterre et avait même été son hôte dans sa propriété de Beaconsfield, exprima ses regrets de « cette publication d'un membre des Communes que tout admirateur des grands talents a été affligé de compter parmi les détracteurs superstitieux de la raison humaine ».
Burke, cependant, incapable de plier devant l'assaut de ses anciens amis, ne faisait que se raidir davantage dans une haine de plus en plus farouche et aveugle de la Révolution (1). Cassandre amer et frénétique, il dénonçait les calamités futures dont elle était grosse, et réclamait contre elle une politique de cordon sanitaire. Les événements tournaient dans le sens qu'il annonçait, et lui donnaient raison, toujours plus raison aux yeux du peuple anglais. Après le 10 août 1792 et la chute du trône, vint l'exécution de Louis XVI, qui dans le cœur de l'Angleterre entière souleva la même houle de colère, la même soif de châtiment, dont le cœur de Burke était plein depuis 2 années. Fox fut abandonné par le gros parti whig, Pitt dut céder au courant général, et l'Angleterre s'engagea dans la guerre européenne. Le plus ardent vœu de Burke était exaucé : quelques mois avant sa mort, à Noël 1796, il reçut à Beaconsfield la visite d'un avocat, Mackintosh, qui avait écrit en réplique aux Réflexions les Vindiciæ Gallicæ (1791) — défense de la France — et qui maintenant battait sa coulpe. Devant lui, il renouvela sa malédiction à « cette charogne [that putrid car case], cette mère de tout le mal, la Révolution française ».
Burke, Irlandais exalté, que A. Sorel a pu définir l'homme « le plus insulaire des trois royaumes », avait en somme, dans son ouvrage fameux, merveilleusement deviné et traduit, en les devançant, les sentiments profonds des Anglais en face de la Révolution, phénomène continental décidément incompréhensible. Il avait été la voix de l'Angleterre d'alors, laquelle avait beaucoup changé depuis un demi-siècle, et qui, notamment, sous l'impulsion de l'extraordinaire prédication de Wesley, était redevenue, dans sa masse, religieuse (et les classes dirigeantes avaient suivi). Dans cette Angleterre-là n'avaient plus cours les « idées anglaises », devenues « idées françaises » ; on ne les reconnaissait plus et elles inspiraient une méfiance croissante.
Moins étrange donc, à tout prendre, qu'il n'y paraissait au premier abord, le fait que l'Angleterre, patrie de Locke, ait produit le premier manuel de philosophie politique directement dressé contre celle — toute lockienne — dont était issue la Révolution française. L'outrance et l'excès du coloris mis à part, elles étaient bien, en 1790, un produit du terroir britannique, ces Réflexions de Burke, qui constituaient un tournant capital dans l'histoire de la littérature politique. Grâce à elles existait désormais un merveilleux arsenal, où devaient puiser leurs armes tous les ennemis de l'Esprit du siècle — de l'antihistorique, abstrait, rationaliste et individualiste Esprit du siècle.
► Jean-Jacques Chevallier, Les Grandes Œuvres politiques, de Machiavel à nos jours, A. Colin, 1949.
1. Cf. Tocqueville sur Burke, dans L'Ancien Régime et la Révolution, Gallimard, 1953, tome II, vol. 2, p. 338 : ce que Burke voit bien et ce qui lui échappe (« il demeure comme enterré dans le monde ancien et la couche anglaise de ce monde ») ; voir aussi vol. 1, pp. 94-96.

◘ Usage de Burke par Arendt
• Présentation : Hannah Arendt dénonce les formulations originelles des droits de l'homme qui les ont fait tenir pour des droits isolés et non intégrés à une communauté politique. Certes, à la différence de Burke, elle n'est pas hostile à ces Droits, mais elle tient à montrer que la focalisation formelle sur ceux-ci au détriment de l'attention accordée aux lois et pratiques politiques positives peut entraîner des effets pervers : ceux de l'impuissance “bien intentionnée”, pratiquement catastrophique.
 On a accusé H. Arendt de conservatisme. À en croire certains, il faudrait la ranger avec Burke dans la catégorie des antimodernes. Il est vrai qu'elle accorde un grand poids à la diatribe de Burke contre les droits de l'homme. En leur préférant les droits des Anglais (l'héritage inaliénable des droits que chacun transmet à les enfants au même titre que la vie elle-même), Burke a adopté un point de vue pragmatique qui n'est peut-être pas inapproprié quand des droits importants sont en jeu.
On a accusé H. Arendt de conservatisme. À en croire certains, il faudrait la ranger avec Burke dans la catégorie des antimodernes. Il est vrai qu'elle accorde un grand poids à la diatribe de Burke contre les droits de l'homme. En leur préférant les droits des Anglais (l'héritage inaliénable des droits que chacun transmet à les enfants au même titre que la vie elle-même), Burke a adopté un point de vue pragmatique qui n'est peut-être pas inapproprié quand des droits importants sont en jeu.
Certes elle n'approuve pas Burke d'avoir rejeté du revers de la main les notions de loi naturelle, de commandement divin ou d'espèce humaine. Il a quand même eut raison de miser sur la tradition et le poids de l'histoire. Les droits qui « naissent du cœur de la nation » (L'impérialisme) emportent tout de suite l'adhésion et présentent un contenu non équivoque. À l'opposé, les droits de l'homme finissent pas se réduire aux droits du « sauvage nu » dont parle Paine dans son introduction au traité de Burke : Reflections on the Révolution in France. H. Arendt se soucie avant tout de la protection des droits dits humains et elle constate — là dessus Burke a eu raison — que « seulement la restauration ou l'établissement des droits nationaux, comme le prouve le récent exemple de l'État d'Israël, peut assurer la restauration des droits humains » (ibid.). Elle concède à Burke que jusqu'ici les divers concepts de l'homme sur lesquels s'appuient les droits de l'homme n'ont pas eu d'impact dans la pratique :
La conception des Droits de l'Homme, fondée sur l'existence reconnue d'un être humain en tant que tel, s'est effondrée dès le moment où ceux qui s'en réclamaient ont été confrontés pour la première fois à des gens qui avaient bel et bien perdu tout le reste de leurs qualités ou liens spécifiques — si ce n'est qu'ils demeuraient des hommes. Le monde n'a rien vu de sacré dans la nudité abstraite d'un être humain. Et au regard des conditions politiques objectives, il est difficile de dire comment les différents concepts de l'homme sur lesquels sont fondés les droits humains — qu'il soit une créature à l'image de Dieu (dans la formule américaine), ou représentatif du genre humain, ou encore qu'il abrite en lui les commandements sacrés de la loi de la nature (dans la formule française) — auraient pu aider à trouver une solution au problème. (ibid.)
Aussi même les détenus des camps de concentration ont-ils cherché à se prévaloir de leurs anciens droits nationaux plutôt que de s'en remettre aux simples droits naturels. Il faut comprendre que le recours de H. Arendt à Burke est purement stratégique. Elle demeure fidèle à la doctrine de l'État de droit et à sa conception des « citoyens rendus égaux par l'espace public institué et réservé pour la parole et pour l'action politique » (« Le Grand Jeu du Monde », Esprit 7-8/1982). En conséquence, elle blâme Disraeli de s'être engagé dans la voie que Burke avait ouverte :
« Quand Disraeli fustigea “cette pernicieuse doctrine des temps modernes, l'égalité naturelle entre les hommes”, il suivait consciemment Burke qui avait “préféré les droits de l'Anglais aux droits de l'Homme” mais il négligeait la situation réelle, dans laquelle des privilèges pour quelques-uns avaient remplacé les droits de tous » (Sur l'Antisémitisme, p. 158)
En appliquant la notion d'héritage à la liberté, Burke transformait celle-ci en « privilèges acquis » et il la présentait comme « un bien propre au peuple de ce royaume, sans aucune référence à un autre droit plus général ni plus ancien ». Affirmation étrange qui n'allait pas manquer de donner au nationalisme britannique après la Révolution française une coloration raciste durable. H. Arendt regrette que les « droits des Anglais » n'aient pas été remplacés par « une orientation politique qui eût permis de proclamer les droits de l'homme ». Elle croit en l'unité de l'espèce humaine.
Mais pour être efficaces les droits de l'homme doivent s'enraciner dans la citoyenneté qui peut seule les garantir et en assurer le développement. Par son caractère intangible et par l'égalité qu'elle implique au moins idéalement, la citoyenneté, qui est beaucoup plus que la personnalité juridique, est apte à empêcher l'État d'agir en maître des droits de l'homme et d'en disposer à sa guise. Si l'on croit en l'unité de l'espèce humaine, il faut se comporter en conséquence et revendiquer pour tout homme le droit fondamental d'appartenir à une communauté politique. Ce droit est en pratique le moyen d'obtention de tous les autres droits. Voilà en quoi a consisté la contribution positive de Burke à ce débat.
► Lionel Ponton, extrait de : Philosophie et droits de l'homme, Vrin, 1990, pp. 155-157.