"Pour une sociologie de l'ethnicité"
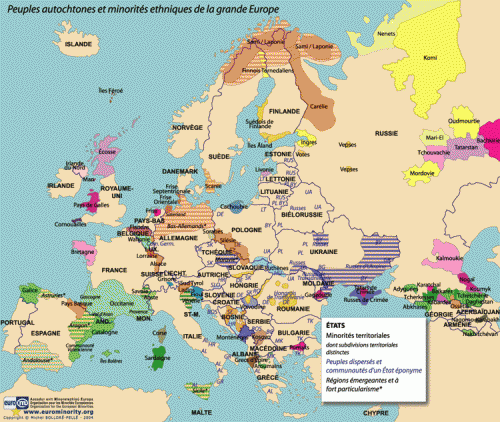
"Pour une sociologie de l'ethnicité"
« Pour une sociologie de l’ethnicité » : un sociologue rompt le tabou de l’ethnie
par Albert Bastenier
Albert Bastenier est professeur au département des sciences politiques et sociales de l’Université catholique de Louvain (Belgique). Dans le (long) article reproduit ci-dessous, il prend acte des effets de l’immigration massive en Europe de populations issues du tiers-Monde, à la différence de certains démographes et politiques qui s’efforcent de nier cette substitution de population. L’auteur voit dans ce bouleversement démographique un phénomène irréversible et ne cherche pas à dissimuler les implications considérables qu’il génère. Loin du discours publicitaire sur les beautés du métissage, il ne porte aucun jugement de valeur sur ce phénomène qu’il se contente d’enregistrer froidement (avec un indubitable fatalisme) en s’efforçant d’en tirer un certain nombre de conclusions. Affirmant que l’intégration républicaine traditionnelle est morte il propose de réévaluer la notion d’ethnicité, mise à mal par les universalistes républicains qui y voient le syndrome de la « peste communautaire » ou du « racisme ». Un discours en rupture (partielle) avec l’idéologie dominante.
Au cours des derniers mois, La vie des idées a publié diverses contributions consacrées au thème de l’identité, dont récemment un texte de Mirna Safi intitulé « L’usage des catégories ethniques en débat ». Il rendait compte du dossier que la Revue Française de Sociologie (2008, 49/1) a consacré aux discussions à propos de l’usage des catégories ethniques dans les sciences sociales. Il y était surtout question de la controverse au sujet du recueil de statistiques ethniques. Dans une perspective complémentaire, nous voudrions revenir sur la question en l’élargissant pour montrer que, comme catégorie d’analyse du social, l’ethnicité est loin de ne concerner que les statistiques.
S’il est vrai que la légitimité de l’instrument de recherche que constituent les statistiques ethniques devrait normalement finir par emporter l’adhésion, à lui seul il ne saurait toutefois prétendre englober l’ensemble des raisons qui justifient une réévaluation de la notion d’ethnicité dans le cadre des discussions que mènent les sciences sociales au sujet des identités. Réduite à cela, la question de l’ethnicité risque même de ne pas voir exploité tout le potentiel intellectuel qu’elle contient. On perdrait en tout cas une grande partie de son bénéfice si on ne voyait pas que, loin de ne permettre qu’un meilleur ciblage des politiques sociales antidiscriminatoires, elle jette aussi les bases d’une réflexion qui permet de mieux comprendre certains des rapports sociaux parmi les plus caractéristiques que génère actuellement l’Europe des migrations.
Ce ne sont, en effet, rien moins que les sources du peuplement continental lui-même qui sont occupées à se transformer par le biais des flux de population que la mondialisation intensifie et diversifie. Et parce qu’elle entraîne une recomposition et une requalification des interactions sociales au sein des populations du vieux continent, c’est de cette nouvelle donne démographique qu’il s’agit de saisir tous les enjeux.
Que les sources et les modalités du peuplement européen connaissent actuellement une profonde mutation, même les chercheurs peu enclins à accorder leurs faveurs aux thèses du multiculturalisme, l’admettent : liée au phénomène de leur vieillissement et de leur fécondité faible, la dépendance démographique des sociétés européennes est de plus en plus évidente. Selon Michèle Tribalat [1], ne fût-ce que le maintien de la population à son niveau actuel ne pourra venir que de la permanence d’un apport démographique externe. En outre, les données fournies par Eurostat permettent de dire que même dans le scénario d’une croissance démographique faible de l’Union à l’horizon 2030 (de 463 à 469 millions pour UE-25), celle-ci sera à mettre au seul crédit de l’immigration. On a là un véritable processus de substitution démographique et, en l’absence d’une hypothétique revivification de la fécondité des Européens, l’immigration est donc, selon l’expression suggestive de M. Tribalat, un « médicament à vie ». Elle souligne enfin que l’immigration suppose évidemment des répercussions importantes au sein des sociétés européennes, notamment sur la reconstruction des codes sociaux dans l’espace public.
Les conclusions auxquelles parvient François Héran [2] expriment des choses fort proches quoique avec un accent un peu différent : la démographie, dit-il, fait partie de ces instruments libérateurs qui permettent de s’extraire des vues étroites et voir que la part croissante des migrations dans la population européenne est un phénomène inéluctable. Le brassage des populations est en marche et rien ne l’arrêtera. Il n’y a pas à se demander s’il faut être pour ou contre. La seule question qui vaille est de savoir comment l’aider à se réaliser dans les meilleures conditions. Mieux vaut se préparer à ce brassage des natifs et des immigrés que de s’enfermer dans sa dénégation volontariste. C’est ensemble qu’il leur faudra croître et vieillir et, au lieu d’agiter l’image d’un spectre qu’il faudrait écarter, la sagesse est d’amener les esprits à y faire face.
Mais précisément, pour faire face, de quels discours disposons-nous ? A l’aide de quels concepts et cadre intellectuel cherchons-nous à penser l’avenir et les phénomènes collectifs complexes, souvent mal vécus, qui se développent dans le sillage des flux migratoires ? A ce monde neuf, de plus en plus hétérogène et caractérisé par la coprésence de plusieurs cultures sur le même espace, il faut fournir les moyens de se connaître, de jeter un regard lucide sur la réalité plutôt que de le laisser vivre dans la nostalgie d’un modèle d’intégration sociale qui ne fonctionne que de plus en plus mal.
C’est à cet égard qu’il y aurait avantage à en venir à une prise en considération dépassionnée de la potentialité intellectuelle contenue dans les catégories de l’ethnicité [3]. Dès lors que l’on admet que l’immigration fait partie des sources du peuplement européen, il s’impose de réfléchir, comme le dit M. Tribalat, sur les principes qu’adoptera l’Union dans la gestion de la diversité ethnoculturelle. Toutefois, même si on peut formuler des réserves à l’égard du multiculturalisme radical [4], n’est-ce pas une désinvolture peu propice à une telle réflexion que de se contenter, comme elle le fait, de qualifier les immigrés de simples « pièces rapportées » dans les sociétés européennes ? La théorie politique du multiculturalisme mérite plus qu’une mise en congé expéditive et, en l’occurrence, les catégories de l’ethnicité peuvent contribuer à l’approfondir et problématiser avec lucidité le nouveau monde social auquel nous avons affaire.
Même si elle commence par déplaire à beaucoup qui n’y voient qu’une atteinte à leur modernité et une concession à ce qu’ils appellent la « peste communautaire », l’anthropologie contemporaine – à commencer par la contribution décisive de Fredrik Barth [5] – nous a fourni des motifs suffisants pour revisiter la notion d’ethnicité. En ceci notamment que, si l’on veut bien abandonner la perspective intellectuelle statique et substantialiste qui en fait un quasi-équivalent de la race, on est loin de devoir comprendre cette notion comme une concession au communautarisme qui s’oppose aux idéaux républicains. En envisageant l’ethnicité non pas comme un patrimoine culturel statufié qui enchaîne les individus, mais de manière dynamique comme un processus social – c’est-à-dire comme une forme de l’action- au travers duquel les différents groupes humains devenus coprésents sur un même espace se perçoivent, se maintiennent ou transforment leurs frontières et leurs sentiments d’appartenance, on peut y discerner tout autre chose que l’expression d’un archaïsme cherchant à préserver des traditions culturelles rétives au compromis.
La tradition sociologique nous a tellement persuadés que l’évolution vers la modernité équivalait à un passage des communautés ethniques vers les sociétés nationales, que nous éprouvons quelque difficulté à accepter que l’on puisse aller aujourd’hui de la nation vers l’ethnicité. Et pourtant, il a une logique à ce qu’elle revienne au centre de la réflexion sociale dès lors que la mondialisation nous place dans une séquence historique où la coprésence de multiples cultures sur un même territoire devient un phénomène socialement aussi important que l’ancienne situation où les cultures différentes restaient pour l’essentiel confinées dans des espaces distincts. Ce sont donc les sociétés les plus modernes qui ne sont plus ethniquement homogènes et qui, en cela, diffèrent des sociétés traditionnelles et des tribus qui, elles, pouvaient l’être.
Face à cette situation, il ne s’agit pas de développer une rhétorique enthousiaste sur les beautés de l’hétérogénéité culturelle, mais d’y reconnaître la réalité en se demandant si, en utilisant la notion d’ethnicité, on ne parvient pas à mieux comprendre les enjeux liés à l’hétérogénéisation du vieux continent. Et à intervenir aussi avec plus de lucidité dans des situations et des luttes que l’on rejoint non pas en fonction de ses goûts et préférences, mais en raison de leur existence et de leur urgence.
Mais tentons d’abord de définir ces situations et ces luttes. Le dernier quart du XXe siècle, avec la tiers-mondisation des flux migratoires, fut le moment où commencèrent à être perceptibles certaines implications culturelles de la mondialisation. Ces flux ont en effet entraîné une recomposition culturelle de la population plus intense que le vieux continent n’en avait connue depuis longtemps. Ils ont également introduit les ingrédients d’une situation qui peut être qualifiée de postcoloniale parce que, parmi les immigrés, le ressentiment culturel des anciens colonisés parvient à se manifester sur la scène publique. Comme le montrent les « études postcoloniales » [6], c’est sur la trame d’un tel contentieux que se reconstruisent localement les identifications collectives et les rapports entre anciens mentors et pupilles coloniaux. Dans cette nouvelle séquence de l’histoire des sociétés européennes qui se reconfigurent en même temps qu’elles se repeuplent, il ne viendrait évidemment à l’esprit de personne de nier l’importance des composantes économiques et politiques qui hiérarchisent les différents groupes mis durablement en présence. On ne peut néanmoins minimiser l’importance de la dimension culturelle qui s’y adjoint et, surtout, ne pas observer qu’il y a des cultures qui confèrent de la dignité et de la puissance sociale tandis que d’autres confinent dans la faiblesse et la subalternité.
Toutefois, pour une sociologie réaliste qui quitte le terrain de la société conceptuelle pour rejoindre celui de la société réelle, il n’y a à vrai dire pas là une grande découverte : les sociétés humaines sont et restent des ensembles complexes de pratiques économiques, politiques et culturelles enchevêtrées, inégalement et imparfaitement unifiées, impliquant en même temps des solidarités et des antagonismes. Cependant, si un tel ensemble est générateur de conflits, il rend aussi particulièrement délicat tout discours sur l’intégration. Toujours cette dernière est poursuivie comme un bien souhaitable, mais elle n’est jamais qu’une intégration conflictuelle et partielle, à la manière du travail historique de la liberté qui lui-même prend souvent la forme d’une opposition à la domination. Ce qui compte le plus à partir de là, c’est de voir que, dans l’Europe actuelle, les appartenances culturelles en sont venues à jouer un rôle stratégique. Chacun des groupes en présence a tendance à réutiliser dans son patrimoine culturel et son passé – réel ou imaginaire – ce qu’il juge le plus approprié en vue d’affronter les défis du présent. Ceci revient à dire que les rapports de hiérarchisation culturelle dans l’Europe contemporaine résultent d’une coprésence spatiale où aucun des groupes en présence n’est plus à même d’être lui-même indépendamment de l’autre.
Ce constat nous place au cœur du processus de catégorisation mutuelle qu’est la logique ethnique. De part et d’autre, les acteurs cherchent à se positionner à l’aide, notamment, des représentations qu’ils se forgent au sujet de leur propre culture et de celle des autres. Les anciens Européens et les nouveaux arrivants suscitent ou transforment des identités, des affiliations et des appartenances en fonction d’objectifs qui ont du sens pour eux. Du côté des uns pour défendre les droits acquis de l’autochtonie. Et du côté des autres pour revendiquer une place respectable dans la société de leur transplantation. A l’aide d’un ensemble de traits culturels, spirituels et matériels parmi lesquels on peut retenir des choses comme la langue, le style de vie, une histoire partagée, la religion ou aussi des critères vus comme ceux de la dignité morale, tous ces acteurs réutilisent les dimensions symboliques de leur mémoire en vue de mieux affronter les enjeux de leur monde actuel. Pourquoi d’ailleurs faudrait-il s’en étonner jusqu’au point de ne pas l’admettre ? Aux côtés des déterminants économiques et politiques, en le combinant avec eux, ne convient-il pas de prendre en compte l’impact du facteur culturel comme source de différenciation et de hiérarchisation sociales ? Et pourquoi dans le domaine des pratiques culturelles davantage que dans celui des pratiques économiques ou politiques faudrait-il postuler que, pour fonctionner, les sociétés devraient disposer d’une assise épargnée par les tensions et les rapports de force ? Ce qui empêche de le penser, ne serait-ce pas le fait que, dans la sociologie française, sur fond d’universalisme abstrait et de jacobinisme, l’idée d’intégration républicaine a intellectuellement joué un rôle comparable à celui qu’avait joué l’idée de dictature du prolétariat dans la sociologie marxiste orthodoxe ?
S’il est exact qu’en adoptant la notion d’ethnicité l’analyse ne se préoccupe plus d’abord de savoir selon quelles procédures les immigrés abandonnent leur identité d’origine en vue de s’intégrer, ce n’est pas pour autant que l’on abandonne l’idée qu’il faut explorer les mécanismes qui président à la réintégration globale des sociétés élargies par l’immigration. La problématique est toutefois renversée : on se demande plutôt pour quelles raisons il ne faut plus s’attendre à ce que les immigrés, par une démarche d’assimilation, se transforment comme autrefois en autochtones. Et ceci non pas parce que, comme catégorie analytique de l’action, la notion d’ethnicité viserait à comprendre la rémanence d’identités intangibles qui auraient été réprimées et demanderaient à être réhabilitées. Ni non plus parce qu’elle affirmerait une volonté de sauvegarde des cultures comme on cherche à assurer la survie d’espèces naturelles menacées. Parce que nous sommes placés tout autrement qu’hier face à la question de la rencontre des cultures, ce que l’on cherche à comprendre, ce sont plutôt les interactions qui se construisent entre des acteurs culturellement différents mais placés dans une situation d’interdépendance irréversible. À l’opposé d’un passéisme, l’ethnogenèse dont il est question est donc synchrone avec la mondialisation qui signe la fin du monoculturalisme et fait passer l’Europe contemporaine dans une situation de pluriculturalité.
Il faudra bien finir par admettre qu’appeler unilatéralement les immigrés à s’intégrer aux sociétés européennes telles qu’elles fonctionnent actuellement, revient à leur demander de rallier la culture dominante comme on se convertirait à une religion. Et pour les sciences sociales, c’est continuer à faire comme si elles ne savaient pas que nombre de sociétés qui ont cherché ou cherchent encore à se bâtir sur la seule affirmation des exigences intégratrices d’une citoyenneté qui n’existe pas vraiment, choisissent en réalité de fonctionner sur l’inégalité, l’injustice et même l’ostracisme contre lesquels elles disent pourtant vouloir lutter. Si ces sciences veulent tenir un discours qui ait du sens, ce devra donc en être un autre, qui parvienne à montrer comment des populations diverses par leurs origines mais rassemblées sur le même territoire, se brassent et s’agrègent tout en développant entre elles les contradictions de la différenciation et de la hiérarchisation sociales où interagissent des différences culturelles, des inégalités économiques et les statuts politiques des uns et des autres. Tant du côté de la majorité que des minorités, les nouvelles solidarités et affiliations surgissent toujours en réponse aux lacunes ou aux échecs de la représentation démocratique, créant pour cela des stratégies de reconnaissance.
Ce n’est bien entendu que dans la mesure où elles rendent plus intelligibles les pratiques sociales caractéristiques des sociétés où les appartenances culturelles connaissent un nouveau développement que les catégories de l’ethnicité s’avèrent utiles. C’est-à-dire en référence avec un principe d’organisation de la totalité sociale qui fait ressortir la logique structurelle de la saillance ethnique. C’est pour ce faire qu’il faut réinterroger la théorie de l’action et s’enquérir du rôle qu’elle reconnaît à la culture dans la construction des rapports sociaux, c’est-à-dire aux acteurs comme sujets réflexifs et imaginatifs, producteurs de signes et de représentations à l’aide de quoi ils cherchent à orienter leur monde plutôt que de simplement le subir. Dans une visée heuristique, on peut alors appeler société ethnique celle où la dimension culturelle de l’agir humain s’affirme comme un ressort spécifique des processus collectifs et où de nombreux acteurs sont placés dans des rapports qui les incitent à remanier leurs identités, concevoir de nouvelles appartenances symboliques et produire divers dispositifs organisationnels qui en sont l’expression.
Pour expliciter cela d’une manière analogique, on pourrait dire que de la même manière que l’on a pu appeler société de classe celle qui, à partir du XIXe siècle et sur arrière-fond d’industrialisation capitaliste, a organisé socialement la conflictualité des statuts économiques, on peut appeler société ethnique celle qui, à la fin du XXe et sur arrière-fond de mondialisation, organise socialement la conflictualité entre les différents statuts culturels. Et que la conscience que l’on a de cette situation dans les différents segments de la population y supplante celle de la classe comme médium principal à partir de quoi les acteurs systématisent leur condition. Il ne faut pas prétendre que le facteur culturel en vient à se substituer au facteur économique dans la hiérarchisation sociale. Mais admettre qu’il y joue toutefois un rôle de plus en plus important qui complexifie davantage les rapports sociaux. On peut y voir une nouvelle configuration de la question sociale.
Dans le domaine scolaire, par exemple, l’analyse ethnique met en lumière que l’on s’y trouve aux prises avec l’une des institutions emblématiques par excellence des enjeux de la culture. Elle est chargée de la double mission de qualifier culturellement les individus qu’elle instruit en même temps que de disqualifier ceux qui ne répondent pas à ses exigences. Et parce que les établissements scolaires fonctionnent selon une logique de quasi-marché, on sait depuis longtemps qu’ils ne distribuent pas équitablement leurs bienfaits. En reconnaissant la chose, on n’a toutefois encore rien dit à propos des opinions qui expriment leur consternation au sujet d’une baisse du niveau scolaire liée à la présence des enfants d’immigrés. Pourtant, là est perceptible la compétition ethnique pour la captation des ressources éducatives. Les dires majoritaires témoignent d’une transformation de leurs attentes sociales. Ils veulent que les établissements scolaires concrétisent une différenciation entre eux et les « autres ». Leur souci est de garder le contrôle sur l’accès aux établissements les plus convoités, au cœur de la machine ethnonationale distributrice des prestiges de la culture. La préoccupation d’un statut avantageux durable se traduit dans une stratégie scolaire du groupe majoritaire qui vise à entretenir la frontière qui le sépare du groupe minoritaire. Se donne ainsi à voir le jeu des compatibilités et des incompatibilités symboliques au centre du processus ethnique. Par contre, pour nombre d’écoliers issus de l’immigration, les interactions sociales propres à l’enfance qui devaient être leur parcours initial dans la citoyenneté deviennent un détour par l’échec, l’épreuve publique que, jeunes encore, ils font de leur dévalorisation culturelle. L’école, dit Françoise Lorcerie [7], enferme les jeunes minoritaires dans les frontières de leurs origines. Il ne suffit donc pas de dire que l’école voit le processus ethnique pénétrer par capillarité dans ses murs. Elle est elle-même l’un des espaces où, au travers d’expériences scolaires hiérarchisées, ce processus pose les bases de sa construction. Et on ne s’étonnera pas que, pour ces jeunes, l’école soit fréquemment perçue comme une imposition sociale humiliante qu’ils vivent comme la domination culturelle toujours active des sociétés ex-colonisatrices. La considération dérisoire qu’affichent régulièrement les jeunes minoritaires à l’égard de l’école ou, plus gravement, la violence qu’y font exister certains, peut alors être vue comme l’expression réactive à l’humiliation qu’ils y éprouvent.
Que l’affaire du foulard se soit déclarée, elle aussi, dans l’enceinte scolaire n’est pas chose anodine. Ce n’est pas par hasard que ce soit sur cette scène éminemment symbolique que des jeunes filles ont tenté d’introduire cette pièce d’habillement. Elle est, en effet, expressive d’un défi ethnique adressé à la laïcité, elle-même non moins expressive de l’identité ethnique républicaine. Certes, il y a une diversité de motivations dans le port du voile islamique. Il s’agit d’une pratique complexe qu’il serait téméraire de réduire à une univocité de signification. Mais si, ici, on accorde prioritairement l’attention à l’antagonisme identitaire qui s’y manifeste plutôt qu’aux divers contenus que ses partisans ou ses adversaires y discernent, c’est parce que, à partir du paradigme ethnique, la dimension polémique entre les valeurs invoquées de part et d’autre n’a valeur que d’instrument : le motif que l’on se donne pour édifier des frontières et organiser socialement la différence. La pièce vestimentaire que d’un côté on exhibe et à laquelle de l’autre on s’oppose, est surchargée de messages contradictoires et vise, paradoxalement, soit par l’affirmation soit par l’interdiction, d’abolir les sources d’une ségrégation. Les portes de l’école deviennent ainsi la frontière de l’universalisme égalitaire, tandis que le voile devient le symbole frontalier d’une exigence de respect des identités différentes. Aux yeux de la majorité, la perception des minoritaires en est transformée : par leurs filles, ils font publiquement état de ce qu’ils vont jusqu’à prétendre à une renégociation de ce qui définit les sphères du privé et du public. Nacira Guénif-Souilamas [8] a bien mis en lumière l’ambivalence de cette situation, montrant que, lorsque l’interdit est placé sur certaines manifestations symboliques de la dignité culturelle des origines, la domination ethnique des majoritaires est contestée par la confrontation dont ces jeunes filles se font les protagonistes. Dans cette opposition, il n’y a pas ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Il y a deux légitimités culturelles qui s’affrontent et qui prennent les filles à témoin du malentendu en les sommant de prendre parti. On peut penser que, d’abord déchirées par ce choix impossible, elles mettent ensuite en scène à l’école l’ébauche des réponses personnelles actuellement possibles et, sur la ligne de crête entre une ethnicité subie et une ethnicité voulue, elles tentent finalement d’ouvrir un espace de liberté.
Outre le rôle d’acteur ethnique joué respectivement par l’État-nation auquel la religion musulmane répond à la manière d’une « patrie portative », d’autres exemples d’interactions pourraient encore être évoqués. Il en va ainsi des politiques urbaines dans les « villes globales », où la conflictualité entre les classes sociales semble en définitive ne plus être ressentie comme aussi menaçante pour la démocratie que celle entre les cultures. On pourrait parler aussi de l’ethnostratification du marché du travail dont témoignent le différentiel des salaires et la discrimination à l’embauche. Si la rivalité entre salariés autochtones et immigrés n’a pas été sans entraîner des contradictions au sein des organisations syndicales elles-mêmes, c’est parce que la question sociale y est restée durablement posée dans des termes exclusivement socioéconomiques, ce qui postulait que, pour y trouver leur place, les immigrés devaient accepter d’oublier leur identité ethnoculturelle au profit de celle de travailleur.
Ainsi, au cours des dernières décennies, diverses expressions de l’ethnicité ont transparu dans les rapports entre majorité et minorité culturelles [9]. Elles tendent certes à définir des frontières entre « eux » et « nous », mais elles montrent en même temps que cette forme de relations clôturées relève moins d’une pure logique de séparation que d’une tension dans l’interdépendance. Les frontières ne font donc pas que séparer et ségréguer. Elles organisent aussi l’interaction dans la contiguïté dès lors que les différents groupes ne disparaissent pas par la simple absorption de l’un par l’autre. On peut donc dire que, même si c’est dans la rivalité et le conflit, l’ethnicité est un mode d’organisation sociale de la différence. Les acteurs se différencient certes sur base d’un contentieux où s’intriquent des facteurs tout à la fois économiques, politiques et culturels. Mais ce que ce mélange de facteurs révèle, c’est, d’une part, que les frontières ethniques ne sont jamais séparables d’un état global de l’organisation sociale et peuvent donc évoluer en fonction de sa transformation, et, d’autre part, que l’ethnicité est moins liée à la matérialité des ressources culturelles mobilisées par les acteurs qu’à la signification qui leur est donnée dans les interactions actuelles de leur monde. L’ethnicité n’organise donc pas des niches culturelles inexpugnables, mais la dramaturgie d’une société qui doit globalement se réintégrer, reconstituer des rapports sociaux qui apparaissent comme défaits, où chacun est renvoyé à son identité personnelle, mais qui demandent à être réarticulés dans une nouvelle identité collective.
S’il est vrai que l’usage des catégories de l’ethnicité va croissant dans les travaux des sciences sociales, on ne manque pas de constater néanmoins que, lorsqu’il n’est pas exclusivement dénonciateur des périls du communautarisme, il en reste le plus souvent à une vision partielle du phénomène où le vocable ethnique désigne exclusivement les autres. L’ethnicisation des relations sociales que l’on y envisage concerne les seules minorités qui ne sont considérées que comme les victimes d’une stigmatisation qu’elles ne font que subir. Un tel usage équivaut en fait à une simple dénonciation de l’imposition identitaire unilatérale dont l’ancien racisme colonial était capable. Or, n’est-on pas dans une nouvelle séquence historique qui, pour les sciences sociales tout au moins, devrait mettre un terme à cet usage unilatéral ? Comme le suggère l’anthropologue indien Arjun Appadurai [10], ne faut-il pas admettre qu’après le colonialisme, la grande question pour les sciences sociales n’est plus principalement de traquer les suites de la colonisation telles qu’elles peuvent se perpétuer dans les discriminations des sociétés européennes, mais d’arriver à une pensée transformée, au-delà de la logique à l’œuvre dans les prétentions intellectuelles de la période coloniale qui substantifiait l’ethnicité et ne l’appliquait qu’aux autres ? Il s’agit, dit-il, non pas de se contenter de penser l’après-colonialisme mais surtout de parvenir à penser après le colonialisme en purgeant la pensée de ce qui reste en elle de son unilatéralisme intellectuel ancien. Ce qui invite à analyser les interactions sociales propres à l’Europe multiculturelle en tenant compte de ce que, comme y insiste F. Barth, on n’assiste jamais à l’apparition d’une affirmation ethnique isolée, mais à un système d’affirmations ethniques indissociables qui, par le truchement d’imputations identitaires croisées, se répondent en vue d’organiser les appartenances, les frontières et les rapports entre les anciens établis majoritaires et les nouveaux entrants minoritaires.
Hélène Bertheleu [11] a fort bien identifié les résistances qu’il y a en France à franchir le pas d’une telle démarche. Elle souligne que tout au long des années 1990, beaucoup d’intellectuels furent convaincus qu’il fallait résister à la montée des particularismes qui équivalaient à leurs yeux à une fragmentation ou une balkanisation de la société française. De leur point de vue, rejeter l’usage de la notion d’ethnicité participait directement au soutien de la pensée républicaine universaliste. Et si au cours des années plus récentes l’expression « ethnicisation des relations sociales » est entrée malgré tout dans le vocabulaire des sciences sociales, ce n’est toutefois qu’au prix d’une sérieuse réduction de sa portée. C’est-à-dire en en restant au seul point de vue de la majorité et des soucis que peut inspirer aux mandataires publics la gestion d’une société de plus en plus composite au sein de laquelle la stigmatisation ethnique des minorités vient anormalement redoubler l’exclusion économique et politique dont elles pâtissent déjà. En creux s’affiche ainsi l’idée que l’on aurait dû normalement en rester à la perspective assimilationniste du traitement de la question migratoire. Mais ce qui est surtout obtenu grâce à cette manière d’utiliser la notion d’ethnicité, c’est que la catégorie nationale française elle-même ne soit pas ramenée au rang de groupe ethnique. Une telle manière de raisonner équivaut cependant à occulter les dimensions constructiviste et interactionniste qui constituaient le principal du potentiel théorique de l’ethnicité comme catégorie analytique de l’action. Elle demeure donc largement impensée dans ce pays, conclut H. Bertheleu.
Dans l’Europe qui voit s’élargir les sources de son peuplement en même temps que la question des identités y prend une forme inédite, il s’agit de parvenir à gérer une nouvelle configuration de la conflictualité sociale. Et il faut parler d’une réintégration de la société globale parce que l’idée d’intégration n’est pas une idée dynamique, capable de nous éclairer au sujet des processus socioculturels en cours dans une société dont l’histoire n’est pas finie. On ne peut s’en remettre à une conception monumentaliste de la société, qui la voit comme un ensemble achevé et quasi immuable, imposant et admirable dans lequel les immigrés ne pourraient aspirer qu’à faire disparaître leurs identités d’origine. Si pour penser la nouvelle conflictualité sociale il n’y a eu longtemps, particulièrement en France, aucune place pour le paradigme ethnique, c’est notamment parce que la question de la citoyenneté y a été phagocytée par celle de la nationalité qui faisait de l’intégration un impératif capable de dissimuler les modalités complexes de la construction des appartenances collectives. Mais la nationalité, qui est elle-même une notion politico-culturelle historiquement située, n’est plus à même de remplir cette fonction aujourd’hui. Et comme le fait valoir Herman van Gunsteren [12], l’alternative culturelle entre le communautarisme et l’universalisme est précisément ce dont la théorie politique de la citoyenneté doit chercher à sortir aujourd’hui. Car la communauté de destin des individus rassemblés par l’histoire sur un même territoire n’a donné naissance qu’à une « citoyenneté imparfaite ». C’est-à-dire à un type d’accomplissement politique qui, au travers d’une multiplicité d’identifications sociales reliant entre eux les individus en même temps qu’elles les opposent, n’assure que provisoirement une maîtrise du lien collectif jugée acceptable. En d’autres termes, les contenus de la citoyenneté confondus avec la conformité culturelle de la nationalité n’ont jamais constitué une réalité achevée, située en dehors des tensions sociales et des rapports de pouvoir. Ils ne correspondent pas à une norme définitivement établie et font continuellement l’objet de luttes non seulement pour les défendre, mais aussi pour les réinterpréter et les étendre.
Le travail du chercheur n’est pas de juger et de prescrire, mais d’abord de comprendre. Dans la présente note, on a simplement voulu montrer que les catégories de l’ethnicité n’ont pas qu’une utilité statistique et qu’elles peuvent constituer un paradigme fécond qui apporte un nouvel éclairage au moment où, sans qu’il soit nécessaire de prétendre que tous les rapports sociaux relèvent d’elles, dans les sociétés européennes contemporaines elles mettent néanmoins en lumière des clivages basés sur une différenciation sociale autre que celles plus traditionnelles de la classe, du sexe ou de l’âge. La reconnaissance de ces clivages ouvre une perspective supplémentaire à l’étude de l’espace public vu tout à la fois comme espace de risque et espace d’accomplissement social. Les catégories de l’ethnicité permettent de comprendre comment naissent, se croisent et deviennent politiques des pratiques consécutives au rassemblement de différentes identités culturelles dans un même espace. Et que ce n’est pas de la bienveillance des uns pour les autres mais au contraire de l’émoi et des désaccords face à ce qui, de part et d’autre, est perçu comme une menace ou comme un risque, que, dépassant leurs contradictions, les sociétés ethniques s’attèlent à la construction d’un nouveau faisceau de normes communes. C’est par le biais de compromis successifs qu’est donc progressivement rediscutée l’autoréférentialité dont spontanément les différentes cultures se réclament et que se créent des possibilités d’action commune entre des parties qui, au départ, s’évitaient par l’érection de frontières entre elles. Ainsi se prépare la mise en forme d’institutions politiques autres que celles qui régissaient les sociétés monoculturelles.
Il est temps de sortir des faux procès en hérésie culturaliste et cesser d’agiter le spectre du communautarisme que la notion d’ethnicité n’est pas soupçonnable de couvrir. Car elle vise précisément à établir que, si la référence à la culture est distincte et ne peut être réduite à n’être qu’une fausse conscience dérivée de l’économique et du politique, cette référence n’a néanmoins pas d’existence en dehors de ses rapports avec ces autres éléments constitutifs de l’agir humain. Avec l’ethnicité, il ne s’agit pas de privilégier le domaine des pratiques culturelles, mais d’affirmer que la vie est action et qu’elle est, notamment, culturelle dans son action. Il faut conférer sa place à la culture dans l’analyse de la dynamique sociale au sein de laquelle, avec les domaines économique et politique, elle donne sa forme à ce que Marcel Mauss appelle le « fait social total ».
par Albert Bastenier [14-10-2008]
Notes
[1] Michèle Tribalat, « Hétérogénéité ethnoculturelle et cohésion sociale », dans [Futuribles, juillet-août 2007, n°332, pp. 71-84.
[2] François Héran, Le temps des immigrés. Essai sur le destin de la population française, Seuil, La république des idées, 2007.
[3] J’ai tenté de montrer la fécondité intellectuelle de ces notions dans mon ouvrage Qu’est-ce qu’une société ethnique ? Ethnicité et racisme dans les sociétés européennes d’immigration, P.U.F., Coll. Sociologie d’aujourd’hui, 2004.
[4] Citant David Miller (Citizenship and National Identity, Cambridge, Polity Press, 2000), M. Tribalat définit le multiculturalisme radical comme une politique uniquement soucieuse de la préservation des différences sans souci pour l’identification avec la communauté nationale et l’État.
[5] Fredrik Barth, « Les groupes ethniques et leurs frontières », traduction française dans P. Poutignat et J. Streiff-Fenart, Théories de l’ethnicité, PUF, 1995.
[6] Parmi tous les auteurs qu’il faudrait citer, on retiendra Stuart Hall, Paul Gilroy, Achille Mbembe, Homi Bhabha, Arjun Appadurai.
[7] Françoise Lorcerie, L’école et le défi ethnique. Éducation et intégration, INRP-ESF, 2003.
[8] Nacira Guénif-Souilamas, « Les beurettes aujourd’hui », dans F. Lorcerie , 2003, op. cit.
[9] Dans mon ouvrage sur la société ethnique, j’ai consacré de longs développements aux expressions concrètes de la conscience identitaire tant de la majorité que de la minorité ethniques.
[10] Arjun Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Payot, 2001.
[11] Hélène Bertheleu, « Sens et usage de l’ethnicisation. Le regard majoritaire sur les rapports sociaux ethniques », dans Revue Européenne des Migrations Internationales, 2007, vol.23, n°2, pp. 7-26.
[12] Herman van Gunsteren, A Theory of Citizenship. Organizing Plurality in Contemporary Democracies, Westview Press, 1998.
Source : http://www.laviedesidees.fr
Article printed from :: Novopress.info France: http://fr.novopress.info
URL to article: http://fr.novopress.info/?p=15135