Burckhardt
Historien suisse d'expression allemande, Jacob Burckhardt est né en 1818 à Bâle (Suisse). Fils d'un pasteur calviniste, il se destine à la théologie, avant d'entamer des études historiques à Berlin, en 1839. Il y subit l'influence de Leopold von Ranke (1795-1886), qui tente de mettre l'histoire au service du nationalisme prussien : sa première étude, consacrée en 1840 à Charles Martel, se ressent de cette philosophie de l'histoire. À partir de 1848, il cherche à concilier histoire politique et histoire de l'art. Des voyages en Italie (qui lui inspireront la rédaction d'un guide touristique, le Cicerone, en 1855) et son expérience de l'enseignement de l'histoire de l'art à Bâle à partir de 1858 — il est l'un des premiers à utiliser des documents photographiques — le décident à se consacrer à l'histoire italienne. La Civilisation de la Renaissance en Italie, publié en 1860, lui vaut une célébrité immédiate. La parution de ses notes de cours sur la civilisation grecque en 1898, l'année de sa mort, impressionna et influença grandement Nietzsche.

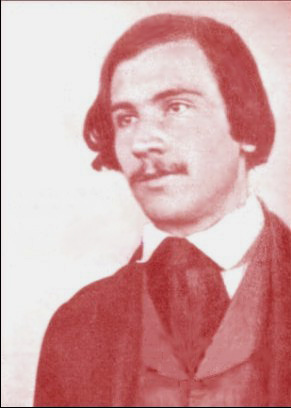 Jakob Burckhardt : un regard sur l'histoire mondiale
Jakob Burckhardt : un regard sur l'histoire mondiale
Réflexions sur son œuvre à l'occasion du 100ème anniversaire de sa mort
[« La grandeur est un besoin des époques terribles », J. Burckhardt, ci-contre vers 1845]
« Pourquoi ne pas fuir dans des circonstances plus simples et plus belles, si on en trouve encore quelque part ? Pour ma part, je suis bien décidé de jouir à ma façon de la vie, avant que ne viennent les mauvais jours » : ce sont là les paroles d'un jeune homme qui, pendant toute son existence, a émis le souhait de consacré sa vie à l'art et à la science.
Jakob Burckhardt, né le 25 mai 1818, était issu d'une vieille famille patricienne, bien en vue, de Bâle. En tant que fils de pasteur, il a pu très tôt jouir d'une éducation en sciences humaines, qui l'a conduit, comme le souhaitait expressément son père, à étudier successivement la théologie, puis l'histoire, la philologie et l'art. Après sa “promotion” et son “habilitation” en 1844, il enseigne brièvement à l'université de Zurich, puis revient à Bâle, sa ville natale, où il enseignera jusqu'à un âge très avancé l'histoire de l'art et l'histoire.
Burckhardt, un homme pour qui le regard est l'essentiel, qui aimait les voyages passionnément, a vite développé son amour de l'art antique et de l'art de la Renaissance italienne. Ses grands talents de dessinateur l'ont aidé à fixé ses impressions en images. Ce qu'il voyait était travaillé par son regard, qui produisait plus qu'il ne réfléchissait, car, outre le génie du dessin, Burckhardt possédait aussi celui de la poésie. Pendant longtemps, il a hésité, ne sachant pas s'il allait devenir historien ou écrivain. Finalement, il est devenu les deux. Cette combinaison a permis l'émergence de ses œuvres les plus célèbres, qui gardent encore aujourd'hui toute leur pertinence : par ex. Cicerone, sorte de guide de voyage, portant comme sous-titre « Invitation à jouir des œuvres d'art italiennes » ; ensuite Kultur der Renaissance in Italien, ou encore, Griechische Kulturgeschichte, paru après sa mort. Dans ce dernier ouvrage, Burckhardt présente une vision de la polis grecque, personnelle mais intéressante. Il y insiste aussi sur le pessimisme grec, dont il fait le noyau essentiel de la culture hellénique. Ses Weltgeschichtliche Betrachtungen (Considérations sur l'histoire universelle) procèdent de plusieurs cours donnés à l'université, et jettent les bases de sa théorie de l'histoire de la culture : celle-ci repose sur une vision de l'homme au comportement constant, « patient, porté sur l'effort et actif », car cet homme est l'élément porteur des « grandes forces de l'histoire », c'est-à-dire la culture, l'État et la religion. En tant que constantes de l'histoire, celles-ci forment l'essence de toute forme d'histoire.
Burckhardt souffrait du déclin de l'idéalisme allemand et se montrait fort sceptique face aux évolutions politiques de son temps. La démocratie de masse, les agitateurs socialistes et le libéralisme exclusivement axé sur le profit étaient tous pour lui les symptômes d'une décadence politique. « Depuis la Commune de Paris, tout est devenu possible en Europe, principalement parce que partout nous rencontrons de braves gens, des libéraux très convenables, qui ne savent pas exactement où se situe la limite entre le droit et l'absence de droit ni où commence le devoir de résister et de réagir ». Il prévoyait l'ère des dictatures et de l'extrémisme politique en Europe, l'ère des « terribles simplificateurs », qui n'avait plus rien à voir avec les « grandes individualités » radieuses, avec les « princes de la renaissance », avec ces figures nobles qui avaient tant inspiré la pensée de Nietzsche.
Burckhardt craignait que la “vieille Europe”, fatiguée et usée sur le plan culturel, finirait par sombrer définitivement à cause des luttes que se livraient partis et factions. À la fin de ces luttes, prévoyait-il avec raison et à propos, s'imposerait une démocratie corrompue : « Les masses veulent la tranquillité et le profit » : c'est par cette phrase qu'il résume sa position dans Weltgeschichtlicher Betrachtungen. Burckhardt était tout, sauf une personnalité politique, il était essentiellement un esthète, qui n'envisageait nullement de s'impliquer directement dans la politique. Son conservatisme est plutôt libéral et idéaliste. Il méprisait tant l'absolutisme royal d'avant la révolution de 1848 (Vormärz) que les révolutionnaires qui s'efforçaient de l'éliminer. Pour Burckhardt, les changements ne pouvaient s'accomplir que sur un mode évolutionnaire, s'ils ne voulaient pas n'être que purement subversifs. La césure ne cessait plus de s'élargir entre l'État et la société et prenait la forme d'une opposition croissante entre le pouvoir (politique) et la culture, surtout dans l'Allemagne impériale et wilhelminienne. Son pessimisme culturel n'était donc pas de principe mais était le résultat d'une observation fine des constellations historiques. Burckhardt a gardé l'espoir de voir les cultures renaître dans un futur lointain. Sa pensée est restée jusqu'au bout fidèle à la “vieille Europe” : ses idéaux de vie étaient une absence extrême de besoins, un pari foncier pour le spirituel au détriment du matériel, un service absolu à beau et au bien. Le 8 août 1897, quand meurt Jakob Burckhardt, disparait une figure tragique qui portait en elle les craintes et le pessimisme, mais aussi les espoirs et les aspirations du XIXe siècle, comme peu d'autres savants de cette époque.
► Frank Lisson, Nouvelles de Synergies Européennes n°29, 1997.
(texte paru dans Junge Freiheit n°33/97)

♦ pièce-jointe ♦
 Lire ses classiques : La Civilisation de la Renaissance en Italie
Lire ses classiques : La Civilisation de la Renaissance en Italie
Œuvre foisonnante, la Civilisation de la Renaissance en Italie de Jacob Burckhardt (1860) s'attache à décrire l'émergence de l'individu moderne.
La thèse
La Civilisation de la Renaissance en Italie est moins une histoire qu'un portrait : celui de la mentalité d'un peuple (Volkgeist) et de l'esprit d'un temps (Zeitgeist), l'une et l'autre indissociablement liés dans une civilisation que l'on ne peut appréhender que par l'histoire culturelle (Kulturgeschichte). Burckhardt est de ce fait l'héritier de la philosophie allemande qui, depuis Herder (1744-1803), donne à la notion de Kultur un sens national. Du XIVe au XVIe siècle, l'Italie est le lieu d'émergence de l'individu moderne, qui devient le sujet de son histoire. Il déchire le voile médiéval (« tissu de foi et de préjugés, d'ignorance et d'illusion ») qui l'empêchait de voir le monde tel qu'il est. L'ensemble du livre de Burckhardt s'enroule autour de cette idée centrale. L'exaltation de la subjectivité se comprend dans le contexte de la concurrence politique et idéologique des États, dont Burckhardt décrit la typologie dans sa première partie : « L'État considéré comme une œuvre d'art ». L'historien en approche l'histoire par l'art de la guerre, le jeu de la diplomatie ou les techniques de maniement des âmes par la propagande. Ainsi, en Italie, l'État « apparaissait comme une création calculée, voulue, comme une machine savante ». C'est la lutte politique qui, par une sorte de darwinisme social, crée les conditions d'une individualisation. Burckhardt s'attache à en relever les manifestations. Il décrit tour à tour le « désir de gloire » qui enfièvre la société et l'essor de la « raillerie et du mot d'esprit » qui vient le moquer. La quête passionnée des vertus de l'Antiquité est plus la conséquence que la cause de cet imaginaire nouveau. Les humanistes puisent dans le passé romain de quoi les armer dans leur « découverte du monde et de l'homme ». Voyages lointains, sens du paysage et de la nature, anatomie, lyrisme poétique : autant d'expressions d'un regard lucide sur le monde. Cette ambition nouvelle modifie les règles du jeu social : croyant repérer en Italie un « nivellement des classes », Burckhardt dépeint avec subtilité le raffinement des cours, l'éloquence politique, l'art de la conversation comme autant de stratégies de distinction. « Moins la supériorité de la naissance conférait de privilèges, plus l'individu était obligé de faire valoir ses avantages, mais plus aussi le cercle social devait se rétrécir ». Burckhardt clôt son livre sur le problème des mœurs et de la religion. Entre « dépravation morale » et aspiration vers Dieu, l'Italie des derniers siècles du Moyen Âge apparaît sous sa plume comme la préfiguration ambiguë d'un mouvement qui ne pourra pourtant se réaliser qu'ailleurs, en accomplissant l'idéal individualiste de la Renaissance : la Réforme protestante.
Qu'en reste-t-il ?
Œuvre foisonnante, dont la force suggestive est servie par une écriture flamboyante, la Civilisation de la Renaissance en Italie a exercé, pour le meilleur et pour le pire, une influence durable sur l'historiographie. Qui, avant Burckhardt, avait songé à faire de l'éloquence des notaires, du sens du paysage chez les peintres ou de la passion des princes pour les collections et lés ménageries des objets d'histoire ? Il est alors sans doute vain de souligner les manques : travaillant essentiellement sur des sources littéraires et narratives, Burckhardt se désintéresse totalement de l'économie, de l'histoire du travail ou de celle des techniques. Les classes populaires ne sont guère conviées au festin, sinon sous la figure vague d'un « peuple » subissant toujours l'histoire des grands. Fasciné par le détail des analyses, le lecteur d'aujourd'hui ne peut toutefois plus adhérer au sens général que Burckhardt voulait leur donner. Il postule en effet une double rupture, entre Moyen Âge et Renaissance d'une part, entre l'Italie et l'ensemble de l'Europe d'autre part, que toute l'historiographie récente contribue à réduire. De là le grand paradoxe de ce livre : Burckhardt défend l'idée d'un changement radical, mais le décrit en une grande synthèse immobile. Pour lui, la Renaissance italienne est un bloc : il fait de l'histoire totale, mais d'un objet imaginaire.
► Patrick Boucheron, L'Histoire n°253, 04/2001.

◘ Éditions françaises de La Civilisation de la Renaissance en Italie :
- Format numérique (tr. H. Schmitt, Plon, 1885), 1885) : tome I / tome II
- tr. H. Schmitt revue par R. Klein, Plon, 1958
- tr. H. Schmitt revue par R. Klein, Le Livre de poche, coll. Biblio-essai, 3 vol., 1986.
- tr. H. Schmitt revue par R. Klein, préf. de Robert Kopp, Bartillat, 2012, 642 p., 28 €.
◘ nota bene : « Si le livre de Burckhardt fut annoncé dans la Revue germanique dès sa parution, il fallut attendre un quart de siècle pour qu’il soit traduit en français — traduction sur la base de laquelle se sont faites depuis (non sans quelques corrections) toutes les autres éditions, y compris la dernière en date. Mais parler du “livre de Burckhardt” est déjà un abus de langage. Ce que cette première et (quasi unique) traduction française propose, ce n’est pas, en effet, le travail et la pensée de Burckhardt, mais une véritable refonte et reformulation de son livre. Elle se base sur la troisième édition du texte (1877), deux fois plus volumineuse que les précédentes — édition due à un certain Geiger qui prit avec l’ouvrage original des libertés dont son avant-propos laisse juger : “J’ai cru devoir respecter le caractère général de cet ouvrage et me contenter de faire des changements de peu d’importance. J’ai donc laissé subsister le texte presque en entier, me bornant à ajouter fréquemment des mots isolés ou même plusieurs lignes ; ce n’est qu’à titre d’exception que j’ai intercalé des passages d’une certaine étendue. Il est résulté de cette manière de procéder que, partout où nos idées sur le sujet traité par l’auteur se sont modifiées par suite de recherches plus récentes, les notes que j’ai remaniées, en prenant pour bases les recherches en question, ne cadraient plus exactement avec le texte”. Autant dire qu’il est impossible de retrouver la pensée propre de Burckhardt sous ces métamorphoses. L’essai brillant (de dimensions raisonnables) est transformé en somme érudite. Pour le lecteur français qui n’a pas accès à la langue allemande, la traduction, toujours reprise sur les bases de cette édition-écran, revient à confisquer la pensée. Or, c’est sur la base de ce travestissement, de cette confiscation que s’est faite une grande partie de la réception de Burckhardt en France (du moins en langue française). C’est notamment le cas du premier article important publié sur Burckhardt dans une revue française : une recension de la traduction publiée par le professeur de littérature Émile Gebhart dans la Revue des Deux Mondes [« La théorie de J. Burckhardt », 1885. Repris dans : La Renaissance italienne et la Philosophie de l'Histoire, Librairie Léopold Cerf, 1887] », extrait de : Marc Crépon, « L’art de la Renaissance selon Burckhardt et Taine (la question des appartenances) » in : Revue germanique internationale n°13, 2000.

◘ Jugements critiques :
• Traiter une époque dans son intégralité : « Publié à une époque où la discipline [l'histoire] était la chasse gardée soit des conteurs d’épopée à la Michelet, soit des positivistes plus arides, la Civilisation déroutera par sa vision non chronologique. Y est privilégiée une approche des faits humains en synchronie, plutôt qu’un récit des événements liés par des rapports de causalité. Au travers des plongées opérées par l’essayiste dans les conceptions de l’état, de l’individu, des rapports interpersonnels, des mœurs et des pratiques religieuses, c’est une société qui ressurgit, dans sa vivante complexité et sa richesse. » (F. Saenen, salon littéraire, 2013)
• « Quelle lumière les historiens ont-ils jetée sur l'histoire des civilisations ? Selon Guizot, la civilisation, au sens du XVIIIe siècle, constitue un progrès d'ordre social et intellectuel, dans une recherche d'équilibre des composantes de vie collective. Toutefois, l'étude de Guizot se réduit au cadre d'histoire politique, placée sous le signe de la lutte entre les deux principes de l'autorité et de la liberté. Jacob Burckhardt analyse un moment de l'histoire de l'Occident qu'il saisit aux sources italiennes. Sa vision de la civilisation se limite au triple aspect de l’État, de la religion et de la culture. Burckhardt passe sous silence l'organisation matérielle et sociale de l'Italie de cette époque de la Renaissance. Selon Oswald Spengler, chaque culture forme une expérience unique et manifeste une originalité. De même que Burckhardt, Spengler néglige les aspects de la civilisation matérielle. Il a voulu dégager le destin des valeurs spirituelles qui constituent, selon lui, une microcosme des civilisations. » (Roland Lamontagne, Problématique des civilisations, 1968)
• Nietzsche continuateur de Burckhardt ? : « La “question” de la Renaissance, et plus exactement de la Renaissance italienne, n’est pas premièrement pour Nietzsche la question d’une période de l’histoire de la philosophie caractérisée comme telle : elle est premièrement la question d’une civilisation “haute”, des conditions de son émergence, des causes de son déclin, de sa valeur en regard d’autres civilisations et, enfin et surtout, du projet qu’elle porte peut-être de médication pour notre civilisation “basse” et de fondation d’une nouvelle civilisation. C’est sur cette question de la civilisation que Nietzsche croise Burckhardt. Lorsque Nietzsche arrive à Bâle en 1869, Burckhardt a déjà publié deux textes majeurs sur la Renaissance : le Cicerone de 1855, dont la seconde partie est consacrée aux œuvres d’art italiennes post-antiques, et surtout la Civilisation de la Renaissance en Italie de 1860. C’est par ces ouvrages que Nietzsche fait sa première entrée dans la culture renaissante. Les textes plus tardifs de Burckhardt (de publication posthume) sur les Grecs et sur la conception générale de l’histoire témoignent pour une large part de son dialogue avec la pensée nietzschéenne : c’est là la partie la mieux connue des relations entre Burckhardt & Nietzsche. Pour la Renaissance, Nietzsche a recueilli la pensée burckhardtienne à son état achevé. Nous voulons dans cette étude montrer de quelle façon il se l’approprie sur un double plan : historico-sociologique d’une part, au sein d’une réflexion sur les caractères de la haute civilisation, anthropologico-psychologique d’autre part, au sein d’une réflexion sur la constitution de l’humanité supérieure », extrait de : Thierry Gontier, « Nietzsche, Burckhardt et la “question” de la Renaissance », in : Noesis n°10, 2006.
◘ Bibliographie :
- History : Politics or Culture ? Reflections on Ranke and Burckhardt, Félix Gilbert (Princeton Univ. Press, 1990)
- Jacob Burckhardt's social and political thought, Richard Sigurdson (Univ. of Toronto Press, 2004)
- Un saisissant tableau du Quattrocento, conférence de Robert Kopp (Canal Académie, 2012)
Commentaires
Je me permets de vous poster ces 2 extraits de l'"Histoire de la civilisation grecque" car ils sont vraiment profonds :
« D’autres polythéismes ont succombé à une systématisation, à une simplification théologique lors de graves crises spirituelles traversées par les peuples intéressés. Un sacerdoce puissant et cohérent, tel que les Grecs n’en ont eu à aucun moment de leur existence (pas plus qu’un État communautaire) est apparu et a plus ou moins assujetti la religion à la réflexion et à la spéculation. Là où une telle force s’impose, elle met fin à la culture mythique et place à la tête de la religion un couple de dieux avec un fils divin réincarné chaque année et mort de bonne heure, ou une trimurti, ou deux principes universels avec une suite démonique, etc. ; le reste, elle le réduit à des dieux locaux, des démons annexes et des personnages de contes. Le polythéisme grec s’est défendu de cette systématisation et a maintenu sa forme ancienne, qui précédait toute réflexion ; la théogonie était libre d’apporter une cohérence dans la vaste multiplicité de la vie des dieux ; toutefois elle non plus n’était pas l’œuvre de théologiens, mais de chanteurs populaires et ne changeait rien à la nature des dieux. La spéculation religieuse des orphiques et de Pythagore arriva bien trop tard, et ils ne pouvaient vouer à Homère et à Hésiode qu’une haine impuissante. Mais les philosophes de l’époque ultérieure, malgré tout ce qu’ils ont pu avancer sur les dieux et la nature divine – jusqu’au monothéisme et d’un autre côté jusqu’au reniement pur et simple des dieux – n’ont pas davantage pu éliminer un seul petit dieu ou héros dans le culte du peuple.
On reconnaîtra d’abord d’une manière générale que les conceptions grecques appartiennent au grand fond de la croyance des peuples aryens. Par-delà bien des pays, on n’a pas seulement reconnu dans les dieux des Védas de vieux parents des dieux grecs, mais on a même pu suivre le cheminement d’une masse d’homonymes, sans parler d’une foule de légendes et de conceptions mythiques que les Grecs partagent avec d’autres Aryens. Au fond, la recherche sur l’origine des dieux grecs se situerait de ce fait bien loin en arrière. »
Jacob Burckhardt, « Histoire de la civilisation grecque », Tome II, II – Les Grecs et leurs dieux, pp. 27-28, éditions de l’Aire, 2002.
_______________________
« Les aèdes ont sans doute été les premiers grands découvreurs et maîtres de la langue grecque et très certainement les créateurs du dialecte qui devint compréhensible aux Grecs parlant tous les dialectes. À vrai dire leur style et la forme extérieure, l’hexamètre, ne nous sont connus qu’à travers son exemple le plus achevé, à travers Homère. Leur lourde tâche d’aèdes avait vraiment de quoi remplir une vie, et à côté de cela, ils n’auraient pu se charger encore de la divination, de la guérison des maladies ou d’une fonction sacerdotale.
Et leur chant, malgré tous les dieux et toutes les croyances qu’il pouvait renfermer, n’avait pas besoin de prêtres pour se faire entendre. Ce sont les génies du chant, les Muses, de qui le jeune berger Hésiode reçoit directement sa place et sa consécration, et le récit qu’il en fait brille de la naïveté des premiers âges. Ton et poésie ont ici de bien plus grands patrons qu’aucun prêtre n’aurait pu l’être, à savoir les dieux eux-mêmes, Apollon, Hermès et les Muses déjà nommées ; sur l’Olympe, ce n’est que chant et musique. En dehors de ces dieux, ses prédécesseurs sur terre deviennent eux aussi pour l’aède des figures merveilleuses avec leurs propres mythes, le plus souvent tragiques.
Mais si nous voulons connaître avec exactitude son rapport avec les auditeurs, il nous faut faire abstraction de tout ce qui nous entoure aujourd’hui. Rien ne nous est plus étranger qu’un peuple qui ne s’intéresse pas aux évènements du jour, mais demande avec insistance et ardeur d’être informé en détail sur les dieux et héros qu’il a créés, mais qui sont restés inachevés et effrayants, et qu’on lui présente maintenant parés d’une telle beauté et d’une telle vitalité. C’est sa propre existence, mais exprimée de façon sublime, et de plus l’image de l’univers entier : l’Olympe, la Terre et les Enfers, dans un vaste ensemble. Jamais sur terre la poésie n’est redevenue une nécessité aussi pressante ; car seuls les aèdes possèdent des informations sur ce tout et complètent cette information de génération en génération.
Leur emprise complète sur l’imagination de la nation forme un tout avec sa façon naïve de croire en ses récits, qui après tout sont son œuvre personnelle et peuvent fortement diverger entre eux. Le peuple qui les écoutait croyait certainement tout ce qu’il entendait et en désirait toujours plus. Dans cette grande image idéale de son être personnel et durable, il ne jouissait pour ainsi dire que de réalités éternelles, alors qu’aujourd’hui nous ne sommes entourés que de journaux.
Les aèdes et leurs auditeurs n’ont pas été à ce point absorbés par leur sujet chez tous les peuples qui ont eu des épopées. Chez les Germains, ce que l’on rapportait sur les dieux était l’affaire d’une poésie profane, comme chez les Grecs, mais il y avait une sérieuse différence : « Dans le mythe germanique, l’esprit créateur qui l’a imaginé ne se laisse jamais prendre au mirage de sa réalité. Quelque extraordinaire qu’aient pu être ses rêves, il restait parfaitement conscient, au fond de lui-même, que tout était sa propre création, qu’il n’avait pas à considérer comme une réalité palpable, mais comme l’expression symbolique de rapports naturels et de préceptes moraux, et que malgré toute cette profondeur, tout ce sérieux, il ne s’en livrait pas moins à un jeu plein de fantaisie et de gaîté avec ses dieux et ses héros » (W. Jordan). Les Grecs, en revanche, semblent avoir été longtemps habités par la ferme volonté d’oublier le plus possible la signification originelle de leurs mythes et de tout concevoir de manière exclusivement épique, ce qui leur a permis d’atteindre une bien plus grande beauté épique ; ce qui manque – exception faite de la théogonie – c’est l’idée que le mythe pourrait être uniquement une enveloppe, une expression symbolique pour quelque chose qui se trouve située au-delà de lui ; forme et signification semblent parfaitement coïncider, du fait qu’un art savant en a réalisé la fusion. Toutes les tentatives visant à transformer spéculativement la religion, toutes les velléités tendant à concevoir le divin d’une manière abstraite ont dû rester impuissantes pendant de longs siècles, face à ce monde de belles figures.
À présent si l’on veut juger de la valeur d’une religion uniquement d’après sa faculté plus ou moins grande de jeter les bases de la moralité, même les plus beaux polythéismes se situent en retrait de ce point, et celui des Grecs tout autant. Ses dieux, même une fois libérés de leur lugubre forme démonique passée, n’en restent pas moins, d’après leur origine, des forces naturelles, et comme ils sont nombreux, on n’accorde qu’une confiance très limitée à la puissance de chaque divinité – car la force universelle en général, le destin, se situe en dehors d’eux – tout comme une confiance très relative en leur bonté. Le culte infiniment riche des dieux ne doit pas nous déconcerter sur ce point. Notre question initiale : quel bien les Grecs retiraient-ils de leurs dieux ? se rapproche déjà un peu de la réponse : plus de bien qu’on ne saurait le dire, étant donné que ces dieux étaient issus de la conception que s’en faisait l’ensemble du peuple et avaient été façonnés par les plus hautes forces spirituelles dont ils disposaient et modelés à l’image des hommes pour de venir le miroir transfiguré de la nation, mais un bien qui n’était que très relatif, dès l’instant qu’il s’agissait d’un symbole moral et d’un réconfort. »
Jacob Burckhardt, « Histoire de la civilisation grecque », Tome II, II – Les Grecs et leurs dieux, pp. 48-51, L’Aire 2002.