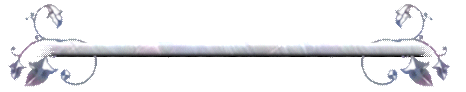Forêts
Entre les villes de Borken et de Dorsten, dans le vieux Land saxon de Hama, se trouve le village d'Erle, près de Raesfeld en Westphalie. Il y pousse un chêne très ancien, qui mesure 14 m. à la circonférence ; ses branches s'élèvent à 15 m. du sol.
Au printemps, malgré son très grand âge, ses feuilles réapparaissent, toutes vertes. Le vieil arbre doit être soutenu par des poutres qui le maintiennent debout et stable. Ce chêne a été planté sur le site d'un Assenkamp, un “camp des Ases”. Les Ases sont la plus vieille famille des dieux germaniques ; elle a combattu, avant de pacifier le monde, la famille des Vanes, divinités symbolisant la fertilité du sol.
Retenons que le Chêne de la Sainte-Vehme, avant sa christianisation toute superficielle, était consacré à Wotan, le père des dieux qui errait, monté sur son cheval Sleipnir, souvent gravé sur les pierres runiques pourvu de 8 jambes ; Wotan est également accompagné de 2 loups, Freki et Geri, et de 2 corbeaux, Hugin et Munin, qui lui transmettent la sagesse et lui rapportent tout ce qui se passe dans le monde des hommes. Les Indo-Européens ont toujours parfaitement perçu le caractère sacré des arbres ; le Freistuhl, littéralement “siège de l'homme libre”, en fait siège où s'assied le chef qui donne les directives pour administrer le peuple et dit la justice, est toujours situé au pied d'un grand et vieil arbre. Le Chêne de la Sainte-Vehme, lui aussi, est le site d'une ancienne Gerichtstätte (lieu de justice), où les libres communautés paysannes saxonnes venaient discuter et appliquer leurs lois.
Par un calcul approximatif, nous devinons que cet arbre, qui nous reste aujourd'hui, devait déjà avoir été énorme au temps de Charlemagne. De nos jours, on estime qu'il doit environ avoir 2.000 ans. C'est le seul arbre d'Allemagne qui reste debout et qui date d'avant le Christ. Le prédicateur chrétien Boniface n'a sans doute jamais réussi à trouvé le Chêne de la Vehme : sinon, il l'aurait abattu lors de la christianisation comme ont été abattus tous les arbres sacrés propres aux cultes païens. Après la soumission et la sanglante évangélisation des Saxons, Charlemagne n'a pas supprimé le Freistuhl d'Erle mais l'a transformé en Tribunal de la Feme ou Vehme, c'est-à-dire en un des tribunaux institué par le monarque carolingien pour maintenir en état de soumission les Saxons et combattre les païens et les hérétiques, au moyen de procédures secrètes, dont la légalité était des plus discutables. De nombreux nobles francs se sont installés, sur ordre de l'empereur, dans la région, dans le but d'empêcher toute restauration de la religion et du droit des ancêtres. C'est la raison pour laquelle le Chêne d'Erle a été nommé Feme-Eiche, Chêne de la Sainte-Vehme. Mais dans les proverbes de la région, on l'appelle le Ravenseiche, le Chêne des Corbeaux.
Durant le Moyen Âge, on a assisté à une revitalisation tacite du vieux droit germanique : les Westphaliens, Frisons et Saxons ont remis à l'honneur la libre juridiction, propre de leur souche. Leur tribunaux étaient composés de Fri-greven (des “comtes libres”), choisis parmi les paysans libres, puis nommés par l'empereur. Ce personnel des tribunaux a fini par fusionner avec la magistrature officielle. Ceux qui n'étaient pas Fri-greven devaient se rendre à cheval au palais de l'empereur pour recevoir confirmation de leur nomination en tant que juges. Le libre banc (= tribunal) d'Erle pouvait, lui, nommer d'office un Greve et 7 conseillers, de façon à ce que le tribunal puisse siéger au complet.
Pendant les XVe et XVIe siècles, le pouvoir des nobles (de souche franque ou gallo-romaine) et du clergé est devenu tellement puissant que les Freistühle furent interdites. Mais pour parvenir à les interdire, nobles allochtones et clergé ont dû livrer aux libres autochtones une longue lutte sanglante ; au XIXe siècle encore, les libres paysans de la région s'opposèrent, par des émeutes et du tumulte, aux lois imposées par l'archevêque de Münster.
Témoin de l'esprit d'indépendance de la race saxonne, l'énorme plaque de pierre qui constituait le Freistuhl proprement dit, a été déposée sur le pont de Dorsten et est devenu un monument vénéré par la population. En 1945, des soudards britanniques l'ont fait basculé dans la rivière, au fond de laquelle elle se trouve toujours, en dépit de son importance historique et culturelle. L'arbre, lui, a résisté à tout. En 1928, il a fallu l'étayer de poutres de bois. Son tronc s'est scindé en 4 et a été renforcé par un anneau de fer. Plus tard, le chirurgien du bois, Dr. Michael Mauer, a renforcé ses racines et sa couronne. Ainsi le Chêne de la Feme/Vehme peut espérer résister encore aux défis du temps et témoigner de sa noble histoire.
► Ulrich Steinmet, Combat païen n°18, 1992. (d'après Gedenkstätten deutscher Geschichte, Orion Heimreiter Verlag ; tr. fr. d'après un extrait de cet ouvrage paru dans la revue milanaise Orion)
LES ARBRES DE LA VIE
LES DIEUX VIVENT DANS LES FORÊTS
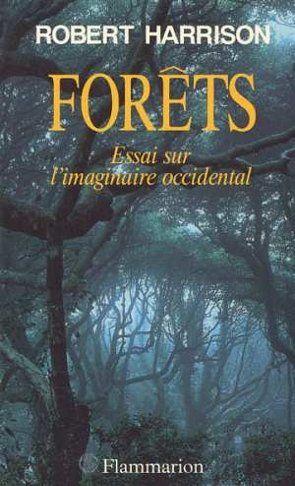 [Ci-contre : couverture de l'étude de R. Harrison, reparue en poche (Champs-Flammarion, 1994). « Le mot “forêt” est à l’origine un terme juridique. Tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes (foresta, forest, forst...), il vient du latin foresta. Le mot latin n’apparait pas avant la période mérovingienne. Dans les documents romains et les premiers actes du Moyen Âge le terme usuel pour désigner les bois et les régions boisées était nemus. Le mot foresta apparaît pour la première fois dans les lois des Lombards et les capitulaires de Charlemagne, pour désigner non tant les régions boisées en général que les réserves de chasse royale. L’origine du mot est incertaine. Selon toute vraisemblance, il viendrait du latin foris, en dehors. L’obscur verbe latin forestare signifiait retenir en dehors, mettre à l’écart, exclure. En effet, pendant la période mérovingienne où le mot foresta fit son entrée dans le lexique, les rois s’étaient octroyé le droit d’exclure du domaine public de vastes étendues boisées, afin d’y préserver la vie sauvage qui, en retour, devait assurer le maintien d’un rituel royal fondamental : la chasse »]
[Ci-contre : couverture de l'étude de R. Harrison, reparue en poche (Champs-Flammarion, 1994). « Le mot “forêt” est à l’origine un terme juridique. Tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes (foresta, forest, forst...), il vient du latin foresta. Le mot latin n’apparait pas avant la période mérovingienne. Dans les documents romains et les premiers actes du Moyen Âge le terme usuel pour désigner les bois et les régions boisées était nemus. Le mot foresta apparaît pour la première fois dans les lois des Lombards et les capitulaires de Charlemagne, pour désigner non tant les régions boisées en général que les réserves de chasse royale. L’origine du mot est incertaine. Selon toute vraisemblance, il viendrait du latin foris, en dehors. L’obscur verbe latin forestare signifiait retenir en dehors, mettre à l’écart, exclure. En effet, pendant la période mérovingienne où le mot foresta fit son entrée dans le lexique, les rois s’étaient octroyé le droit d’exclure du domaine public de vastes étendues boisées, afin d’y préserver la vie sauvage qui, en retour, devait assurer le maintien d’un rituel royal fondamental : la chasse »]
« Détruire des forêts ne signifie pas seulement réduire en cendres des siècles de croissance naturelle. C'est aussi un fonds de mémoire culturelle qui s'en va » : Robert Harrison résume bien, ainsi, l'enjeu plurimillénaire, le choix de civilisation que représente la forêt, avec ses mythes et ses réalités (Forêts : Essai sur l'imaginaire occidental, Flammarion, 1992). Une forêt omniprésente dans l'imaginaire européen.
L'inconscient collectif est aujourd'hui frappé par la destruction des forêts, due à l'incendie, aux pluies acides, à une exploitation excessive. Un être normal — c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore totalement conditionné par la société marchande — ressent, quelque part au fond de lui-même, quelle vitale vérité exprime Jean Giono lorsqu'il écrit de l'un de ses personnages : « Il pense : il tue quand il coupe un arbre ! »
Le rapport de l'homme à la forêt est primordial. Il traduit une vision du monde, le choix d'un système de valeurs. Car la forêt, symbole fort, porte en elle des références fondamentales. « Une époque historique — écrit Harrison — livre des révélations essentielles sur son idéologie, ses institutions et ses lois, ou son tempérament culturel, à travers les différentes manières dont elle traite ou considère ses forêts ». Dans la longue mémoire culturelle des peuples, la place donnée — ou non — aux forêts est un repère qui ne trompe pas.
Pour étudier la place des forêts dans les cultures et les civilisations, depuis qu'il existe à la surface de la terre des sociétés humaines, Harrison prend pour guide une grille d'analyse forgée par un Napolitain du XVIIIe siècle, Giambattisto Vico, qui résume ainsi l'évolution de l'humanité : « Les choses se sont succédé dans l'ordre suivant : d'abord les forêts, puis les cabanes, les villages, les cités et enfin les académies savantes » (La Science nouvelle, 1744).
Ainsi, les forêts seraient à l'origine la matrice naturelle d'où seraient sortis les premiers hommes. Lesquels, en s'affranchissant du milieu forestier pour ouvrir des clairières, en se regroupant pour construire des cabanes, auraient planté les premiers jalons de la civilisation, c'est-à-dire de la conquête de l'homme sur la nature. Puis, d'étape en étape, de la ruralité au phénomène urbain, de la rusticité à la culture savante, de la glèbe aux salons intellectuels, l'humanité aurait réalisé son ascension. On voit bien, ici, s'exprimer crûment cette conception tout à la fois linéaire et progressiste de l'histoire, qui triomphe au XVIIIe siècle avec la philosophie libérale des Lumières pour nourrir, successivement, l'idéologie libérale et l'idéologie marxiste. Mais cette vision de l'histoire plonge ses racines très loin, dans cette région du monde qui, entre Méditerranée et Mésopotamie, a donné successivement naissance au judaïsme, au christianisme et à l'islam, ces 3 monothéismes qui sont définis, à juste titre, comme les religions du Livre.
TU NE PLANTERAS PAS...
Religions du Livre, de la Loi, du désert. C'est-à-dire religions ennemies de la forêt, car celle-ci constitue un univers à tous égards incompatible avec le message des fils d' Abraham. La Bible, est, à ce sujet, sans ambiguïté. Dans le Deutéronome, Moïse ordonne à ses errants dont il veut faire le Peuple élu de brûler, sur leur passage, les bois sacrés que vénèrent les païens, de détruire ces piliers de bois qui se veulent image de l'arbre de vie : « Mais voici comment vous devez agir à leur égard : vous démolirez leurs autels, briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux sacrés, et vous brûlerez leurs idoles ». L'affirmation du Dieu unique implique l'anéantissement des symboles qui lui sont étrangers : « Tu ne planteras pas de pieu sacré, de quelque bois que ce soit, à côté de l'autel de Yahvé ton Dieu que tu auras bâti ».
Cet impératif sera perpétué par le christianisme, du moins en ses débuts lorsqu'il rencontre sur son chemin, comme principal obstacle, la forêt et ses mythes. Très vite, l'Église pose en principe un face à face entre les notions de paganisme, sauvagerie et forêt (sauvage vient de sylva), d'un côté, et christianisme, civilisation et ville, de l'autre. Quand Charlemagne entreprend. pour se faire bien voir d'une Église dont il attend la couronne impériale, une guerre sainte en Saxe, bastion du paganisme, il donne pour première consigne à ses armées de détruire l'lrminsul, ce monument qui représente l'arbre de vie et qui est le point de ralliement des Saxons. Le message est clair : pour détruire la capacité de résistance militaire des païens, il faut d'abord éliminer ce qui donne sens à leur combat. Calcul erroné, puisqu'il faudra, après la destruction de l'lrminsul, encore trente ans de massacres et de déportations systématiques pour imposer la croix. Les clercs entourant Charlemagne n'avaient pas compris que pour les Saxons comme pour tout païen, les dieux vivent au cœur des forêts, comme le constatait déjà Tacite chez les Germains de son temps. Autrement dit, tant qu'il reste un arbre debout, le divin est présent.
LA FORÊT-CATHÉDRALE
La soumission forcée des Saxons n'aura pas fait disparaître pour autant la spiritualité liée aux forêts. Car le christianisme a dû, contraint et forcé, s'adapter à la mentalité européenne, récupérer et intégrer les vieux mythes qui parlaient encore si fort, au cœur des hommes. Cette récupération s'exprime à travers l'architecture religieuse : « La cathédrale gothique — note Harrison — reproduit visiblement les anciens lieux de culte dans son intérieur majestueux qui s'élève verticalement vers le ciel et s'arrondit de tous côtés en une voûte semblable à celle des arbres rejoignant leurs cimes. Comme des ouvertures dans le feuillage, les fenêtres laissent pénétrer la lumière de l'extérieur. En d'autres termes, l'expression forêt-cathédrale recouvre davantage qu'une simple analogie, car cette analogie repose sur la correspondance ancienne entre les forêts et la résidence d'un dieu » (cf. aussi Les Racines des cathédrales, Roland Bechmann, Payot, 1981).
L'Église s'est trouvée, au Moyen Âge, confrontée à un dilemme : contre le panthéisme inhérent au paganisme, et qui voit le divin partout immergé dans la nature, il fallait décider d'une stratégie de lutte. Réprimer, pour extirper, éradiquer ? C'est la solution que préconisent de pieuses âmes, comme le moine bourguignon Raoul Glaber : « Qu'on prenne garde aux formes si variées des supercheries diaboliques et humaines qui abondent de par le monde et qui ont notamment une prédilection pour ces sources et ces arbres que les malades vénèrent sans discernement ». En favorisant les grands défrichements des Xlle et XIlle siècles, les moines ont un objectif qui dépasse de beaucoup le simple intérêt économique, le gain de nouvelles surfaces cultivables : il s'agit avant tout, de faire reculer ce monde dangereux, car magique, qui abrite fées et nymphes, sylves et sorcières, enchanteurs et ermites (dont beaucoup trop ont des allures rappelant fâcheusement les hommes des chênes, les anciens druides). Brocéliande est, comme Merlin, « un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres ».
Faut-il, donc, détruire les forêts ? Les plus intelligents des hommes d'Église comprennent, au Moyen Âge, qu'il y a mieux à faire. Le culte de saint Hubert est chargé de faire accepter la croix par les chasseurs. Les “chênes de saint Jean” doivent, sous leur nouveau vocable, fixer une étiquette chrétienne sur les vieux cultes du solstice qui se pratiquent à leur pied. On creuse une niche dans l'arbre sacré pour y loger une statuette de la Vierge (nouvelle image de l'éternelle Terre-Mère). Devant “l'arbre aux fées” où se retrouvent à Domrémy Jeanne d'Arc et les enfants de son âge, on célèbre des messes. La plantation du Mai, conservée, sera compensée par la fête des Rameaux ( qui vient remplacer la Fête de l'arbre que célébraient, dans le monde romain, les compagnons charpentiers pour marquer le cyclique et éternel retour du printemps).
Saint Bernard, qui a su si bien, comme le rappelle Henri Vincenot [in : Les Étoiles de Compostelle, Denoël, 1984, repris en Folio, 1987], perpétuer les traditions celtiques, assure tranquillement devant un auditoire d'étudiants : « Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira ». Cet accueil et cette intégration, par le syncrétisme, d'une nature longtemps perçue, par la tendance dualiste présente dans le christianisme, comme le monde du mal, du péché, sont poursuivis par un saint François d'Assise. « C'était en accueillant la nature — constate Georges Duby —, les bêtes sauvages, la fraîcheur de l'aube et les vignes mûrissantes que l'Église des cathédrales pouvait espérer attirer les chevaliers chasseurs, les troubadours, les vieilles croyances païennes dans la puissance des forces agrestes » (Le temps des cathédrales, Gal., 1976).
La perpétuation du symbole de l'arbre et de la forêt se fera, à l'époque moderne, par la plantation d'arbres de la Liberté (1), les sapins de NoëI, la branche verte placée par les compagnons charpentiers sur le faîtage terminé de la maison...
L'ARBRE COMME SOURCE DE VIE
 Mais, référence culturelle par excellence, la forêt reste, jusqu'à nos jours, un enjeu idéologique et l'illustration d'un choix de valeurs. Quand Descartes, dans son Discours de la méthode, compare l'autorité de la tradition à une forêt d'erreurs, il prend la forêt comme symbole d'un réel, foisonnant et touffu, dont il faut s'abstraire, en lui opposant la froide mécanique Raison. « Si Descartes se perd dans la forêt — le monde historique, matériel —, ne nous étonnons pas qu'il se sente chez lui dans le désert (...) C'est l'esprit désincarné qui se retire de l'histoire, qui s'abstrait de sa matière et de sa culture » (R. Harrison, op. cit.). Ajoutons : de son peuple.
Mais, référence culturelle par excellence, la forêt reste, jusqu'à nos jours, un enjeu idéologique et l'illustration d'un choix de valeurs. Quand Descartes, dans son Discours de la méthode, compare l'autorité de la tradition à une forêt d'erreurs, il prend la forêt comme symbole d'un réel, foisonnant et touffu, dont il faut s'abstraire, en lui opposant la froide mécanique Raison. « Si Descartes se perd dans la forêt — le monde historique, matériel —, ne nous étonnons pas qu'il se sente chez lui dans le désert (...) C'est l'esprit désincarné qui se retire de l'histoire, qui s'abstrait de sa matière et de sa culture » (R. Harrison, op. cit.). Ajoutons : de son peuple.
Inversement, en publiant leurs célèbres Contes et légendes du foyer, les frères Grimm, au XIXe siècle, entendent redonner, par le biais de la langue, un terreau culturel, un enracinement à la communauté nationale et populaire allemande. Or, significativement, la forêt est omniprésente dans leurs contes, en tant que lieu par excellence de ressourcement.
L'arbre comme source de vie. Présent encore parmi nous grâce à une reuvre qui a, par bien des aspects, valeur initiatique, Henri Vincenot me confiait un jour : « II y a dans la nature des courants de forces. Pour reprendre des forces, c'est vrai que mon grand-père s'adossait à un arbre, de préférence un chêne, et se pressait contre lui. En plaquant son dos, ses talons, ses mains contre un tronc d'arbre, il ne faisait rien d'autre que de capter les forces qui vivent et cornmontent en l'arbre. Il ne faisait qu'invoquer, pour y puiser une nouvelle énergie les puissances de la terre, du ciel, de l'eau, des rochers, de la mer... » (éléments n°53).
► Pierre Vial, Le Choc du Mois n°53, 1992.
(1) cf. Jérémie Benoit, « L'Arbre de la Liberté : résurgence d'une mentalité indo-européenne », in Études indo-européennes, 1991.

Voir aussi l’excellent site Le Recours aux forêts, et en particulier l’article de Rodolphe Christin « La forêt de l’homme ».
Un récit amoureux des bois : Le Journal des arbres, Jean Mailland, L'Amourier, 2009.

Les arbres sont des sanctuaires
 « Les arbres étaient pour moi depuis toujours les prédicateurs les plus convaincants. Je les vénère quand ils vivent parmi les peuples et les familles, dans les forêts et les bosquets. Et plus encore, je les vénère quand ils sont solitaires, tels des êtres esseulés. Pas comme des ermites qui par une quelconque défaillance se sont retirés furtivement, mais comme de grands personnages solitaires tels un Beethoven ou un Nietzsche. Dans leurs cimes, on entend bruire le monde, leurs racines reposent dans l’infini, sans s’y perdre, et ils n’aspirent de toute la force de leur vie qu’à une seule chose : obéir à la loi inhérente à leur nature, construire leur propre image, s’épanouir pleinement. Rien de plus sacré, rien de plus exemplaire qu’un arbre beau et vigoureux. Quand un arbre est scié et que sa plaie béante et mortelle s’ouvre au soleil, on peut lire toute son histoire sur la coupe claire de sa souche – sa tombe. Dans les cernes et les adhérences sont fidèlement archivés combats, peines, maladies, bonheur et plénitude, années maigres et années grasses, attaques refoulées et tempêtes subies. Chaque enfant, dans les campagnes, sait que le bois le plus dur et le plus noble présente les cercles annuels les plus serrés, que c’est dans les montagnes et dans le péril perpétuel que croissent les troncs les plus indestructibles, les plus robustes et les plus exemplaires. Les arbres sont des sanctuaires. Celui qui sait leur parler, les écouter, accédera à la vérité. Ils ne prêchent ni doctrines ni recettes mais, sans se soucier de ce qui est individuel, ils prêchent la loi profonde de la vie. »
« Les arbres étaient pour moi depuis toujours les prédicateurs les plus convaincants. Je les vénère quand ils vivent parmi les peuples et les familles, dans les forêts et les bosquets. Et plus encore, je les vénère quand ils sont solitaires, tels des êtres esseulés. Pas comme des ermites qui par une quelconque défaillance se sont retirés furtivement, mais comme de grands personnages solitaires tels un Beethoven ou un Nietzsche. Dans leurs cimes, on entend bruire le monde, leurs racines reposent dans l’infini, sans s’y perdre, et ils n’aspirent de toute la force de leur vie qu’à une seule chose : obéir à la loi inhérente à leur nature, construire leur propre image, s’épanouir pleinement. Rien de plus sacré, rien de plus exemplaire qu’un arbre beau et vigoureux. Quand un arbre est scié et que sa plaie béante et mortelle s’ouvre au soleil, on peut lire toute son histoire sur la coupe claire de sa souche – sa tombe. Dans les cernes et les adhérences sont fidèlement archivés combats, peines, maladies, bonheur et plénitude, années maigres et années grasses, attaques refoulées et tempêtes subies. Chaque enfant, dans les campagnes, sait que le bois le plus dur et le plus noble présente les cercles annuels les plus serrés, que c’est dans les montagnes et dans le péril perpétuel que croissent les troncs les plus indestructibles, les plus robustes et les plus exemplaires. Les arbres sont des sanctuaires. Celui qui sait leur parler, les écouter, accédera à la vérité. Ils ne prêchent ni doctrines ni recettes mais, sans se soucier de ce qui est individuel, ils prêchent la loi profonde de la vie. »
► Hermann Hesse, Bäume : Betrachtungen und Gedichte (source). [tr. anglaise : Wandering, Notes and Sketches, Farrar, Straus & Giroux, New York, 1972]
♦ traduction du poème Gestutzte Eiche (juil. 1919)

Forêt, territoire et changement des mentalités
La déforestation (diminution de la couverture forestière) est ... sociologue allemand Norbert Elias (1897-1990) [intro à venir...]
[Ci-dessous : couverture de l'édition poche de La dynamique de l'Occident (1939) qui étudie les conditions ayant rendu possible l'établissement du pouvoir étatique. Selon cet auteur, la construction des États européens prend place dans un processus de longue durée, propre à la civilisation occidentale qui se traduit par un auto-contrôle progressif des conduites individuelles et par un refoulement de la violence physique, de moins en moins présente dans la vie sociale, parce que monopolisée par l'État : il suffit d'imaginer à quel point, à la différence de la société d'aujourd'hui, la violence était un phénomène courant et banal dans la société féodale (tournois, croisades, guerres entre seigneuries, ...). Au terme du processus, la violence physique devient l'apanage de l'État et disparaît progressivement dans les relations sociales quotidiennes. Elias parle ainsi d'abaissement du seuil de sensibilité à la violence, ce qui signifie que l'univers social et politique se pacifient puisque la violence devient progressivement inacceptable à des individus, dont les structures mentales ont évolué en conformité avec les transformations sociales. Norbert Elias met en lumière un des facteurs déterminants dans la constitition des États : la configuration formée par la concurrence persistante entre seigneuries durant l'époque féodale pour le contrôle des territoires. L'état de guerre permanent entre unités de tailles voisines débouche, à terme, sur le triomphe d'une des unités qui finit par détenir le monopole coercitif après avoir assuré sa suprématie militaire. C'est ce qu'Elias appelle la loi du monopole : « Quand dans une unité sociale d'une certaine étendue, un grand nombre d'unités sociales plus petites, qui par leur interdépendance forment la grande unité, disposent d'une force spéciale à peu près égale – et peuvent de ce fait librement – sans être gênées par des monopoles déjà existants – rivaliser pour la conquête des chances de puissance sociale, en premier lieu des moyens de subsistance et de production, la probabilité est forte que les uns sortent vainqueurs, les autres vaincus de ce combat et que les chances finissent par tomber entre les mains d'un petit nombre, tandis que les autres sont éliminés ou tombent sous la coupe de quelques-uns »]
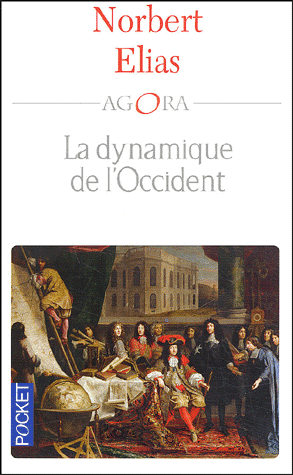 Nous avons montré dans ce même ouvrage, en nous référant à une série d'exemples, que le seuil de la pudeur et des sentiments de gêne ne cesse de progresser à partir du XVIe siècle. En effet, cette progression du seuil de la pudeur coïncide avec la curialisation [processus désignant l'extension des pratiques de la « société de cour », autrement dit le « raffinement » des mœurs] accélérée de la couche supérieure. Les chaînes d'interdépendances qui se croisent dans l'individu se resserrent et s'allongent, les liens entre les hommes se consolident, la nécessité de l'autocontrôle se précise. Plus la dépendance des hommes vis-à-vis de leurs semblables s'accroît, et plus ils prennent l'habitude de s'observer réciproquement : la sensibilité et les interdictions qu'elle entraîne se différencient de plus en plus ; les règles de la cohabitation humaine s'en trouvent altérées, l'homme a plus de raisons d'éprouver de la honte ou de la gêne en voyant les actions des autres.
Nous avons montré dans ce même ouvrage, en nous référant à une série d'exemples, que le seuil de la pudeur et des sentiments de gêne ne cesse de progresser à partir du XVIe siècle. En effet, cette progression du seuil de la pudeur coïncide avec la curialisation [processus désignant l'extension des pratiques de la « société de cour », autrement dit le « raffinement » des mœurs] accélérée de la couche supérieure. Les chaînes d'interdépendances qui se croisent dans l'individu se resserrent et s'allongent, les liens entre les hommes se consolident, la nécessité de l'autocontrôle se précise. Plus la dépendance des hommes vis-à-vis de leurs semblables s'accroît, et plus ils prennent l'habitude de s'observer réciproquement : la sensibilité et les interdictions qu'elle entraîne se différencient de plus en plus ; les règles de la cohabitation humaine s'en trouvent altérées, l'homme a plus de raisons d'éprouver de la honte ou de la gêne en voyant les actions des autres.
Nous avons souligné plus haut que la division progressive des fonctions et l'intégration plus complète des hommes aboutissent à l'effacement des grands contrastes entre les couches sociales et les pays, tandis que le conditionnement dans le cadre de la civilisation s'enrichit de nouvelles nuances, de nouvelles variantes. Dans la mesure où les contrastes du comportement individuel s'atténuent, où les grandes manifestations de déplaisir sont réprimées, modérées, ou transformées par des autocontraintes, s'affine aussi la sensibilité de l'individu pour les nuances du comportement, pour les gestes et attitudes des autres, se différencient la perception et l'expérience personnelle des strates du moi et du monde extérieur, strates dont l'existence avait naguère échappé à la conscience, en raison du voile que les pulsions déchaînées avaient jeté sur elles.
Les “primitifs” — pour évoquer un exemple qui se présente aussitôt à l'esprit — vivent l'espace humain et naturel du domaine vital relativement limité qui est le leur, à certains égards d'une manière plus “différenciée” que l'homme “civilisé”. La différenciation varie selon qu'il s'agit d'un paysan, d'un chasseur ou d'un éleveur de bétail. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que les primitifs, pour autant qu'il s'agit de domaines essentiels à la vie du groupe, sont plus habiles que les “civilisés” à établir des distinctions dans la nature, qu'il s'agisse d'arbres ; de bruits, d'odeurs ou de mouvements. Mais pour les primitifs, l'espace naturel est, bien plus que pour les civilisés, une “zone de danger”. Ils sont hantés de craintes que l'homme civilisé ignore ; et c'est en fonction de ces craintes que les distinctions se font ou ne se font pas. La manière de vivre la nature, d'abord pendant la montée du Moyen Âge et plus tard, au XVIe siècle, avec une accélération sensible, est déterminée par la pacification de plus en plus accentuée de vastes contrées. C'est grâce à elle que forêts, prairies, montagnes cessent peu à peu d'être des “zones de dangers” primordiaux, sources d'angoisses et de péril pour la vie de chacun. Plus tard, quand le réseau des voies de communication se fera plus dense, à l'image du réseau des interdépendances, quand les chevaliers pillards et les bêtes féroces se feront plus rares, quand les campagnes ne seront plus le théâtre du déchaînement des passions, quand elles porteront au contraire la marque d'activités paisibles, quand ceux qui les traverseront seront des commerçants et des voituriers, la nature aura au regard des hommes un aspect différent. Elle leur apparaîtra, dès lors que le refoulement des pulsions aura fait des yeux un instrument privilégié de la jouissance, comme un “régal pour la vue”. Les hommes — ou, plus exactement, les citadins, pour lesquels la nature n'est plus le décor de leur vie quotidienne — la considéreront comme un lieu de récréation. D'une sensibilité plus fine, ils découvriront dans la campagne une zone que les dangers et le jeu des passions sauvages avaient jusque-là cachée aux hommes. Ils commenceront à en apprécier l'harmonie des lignes et des couleurs ; ils s'ouvriront à ce qu'on appelle “les beautés de la nature”, leur sensibilité appréhendera les colorations et les formes des nuages, les reflets du soleil dans la cime des arbres.
La pacification entraîne aussi un changement de la sensibilité des hommes pour leur comportement dans les relations sociales. À mesure que s'atténue la peur de l'agression extérieure, on voit s'intensifier les craintes “intérieures”, c'est-à-dire les craintes que les différents secteurs de l'homme s'inspirent réciproquement. C'est à cause des tensions intérieures que les hommes prennent l'habitude d'observer plus attentivement ceux avec lesquels ils entretiennent des rapports sociaux ; une telle attitude fait naturellement défaut à des personnes qui s'attendent à tout moment à une agression imparable. Une partie des tensions susceptibles d'être “déchargées” dans des corps à corps impitoyables est maintenant l'enjeu du combat intérieur que l'individu se livre à lui-même. Les fréquentations sociales cessent d'être une “zone de danger”, parce que les banquets, les bals, les joyeuses réunions se terminent moins souvent en rixes et en bagarres. Mais elles deviennent des zones dangereuses, si l'individu ne se maîtrise pas, s'il franchit son propre seuil de la pudeur ou le seuil de la gêne des autres. La “zone de danger” traverse maintenant horizontalement les âmes de tous les individus. C'est pourquoi les hommes deviennent sensibles aussi dans cette sphère à des distinctions qui naguère accédaient à peine à leur conscience. Ce n'est plus seulement la nature qui est pour les yeux bien plus qu'autrefois une source d'agréments, mais le regard de l'homme est également à un plus haut degré que naguère une source de plaisir ou, au contraire, de déplaisir et de sentiment de gêne. La peur directe que l'homme inspire à l'homme a diminué au profit de la peur transmise par le canal des yeux et du surmoi, de la peur intérieure.
[...] C'est là un exemple [l'usage des armes] parmi d'autres de ces transformations structurelles de l'économie psychique auxquelles on applique volontiers le terme de “civilisation”. Or, il n'y a pas, dans la société humaine, de “point zéro” de la peur des puissances extérieures, il n'y a pas de point zéro des craintes internes, automatiques. L'une et l'autre ont pour l'homme une signification différente, mais elles sont, en dernière analyse, indissociables. Ce que nous observons au cours d'un processus de civilisation, ce n'est pas la disparition de l'une et l'apparition de l'autre. Ce qui change, c'est seulement le rapport entre les 2 peurs et leur structure : la peur des puissances extérieures diminue sans jamais s'évanouir complètement ; les craintes latentes ou actuelles — toujours présentes — qui résultent de la tension entre les pulsions et le moi augmentent par rapport aux premières, se diversifient et se perpétuent. Les exemples de la progression du seuil de la pudeur et du sentiment de gêne que nous avons cités dans la Civilisation des mœurs ne se veulent que des preuves simples et concrètes de l'orientation et de la structure de la transformation de l'économie psychique de l'homme, transformation que l'on pourrait mettre en évidence aussi dans une perspective différente. Ainsi, le passage de la formation catholique médiévale du “moi” à sa formation protestante s'opère selon un schéma analogue. On constate là aussi une évolution dans le sens de l'intériorisation des craintes. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui comme jadis les craintes internes de l'adulte sont liées aux craintes qu'inspirent à l'enfant les puissances extérieures.
► Norbert Elias, La dynamique de l'Occident, II, 5, Calmann-Lévy, 1977.