Morand
Paul Morand et Bucarest
Les réédition chez Plon de la promenade littéraire de Paul Morand sur Bucarest fut l'occasion pour notre collaborateur Hugues Rondeau de glisser l'ouvrage dans ses poches et de partir à travers les rues de la capitale roumaine sur les traces de l'ambassadeur écrivain.
[extrait sonore : Bohuslav Martinů - Symphonie n°1 - Largo]
[Ci-dessous : Couverture de l'édition originale, 1935. Les années 1920 et 1940 furent la grande époque "française" de la Roumanie. Ce pays était le premier client étranger de l'édition parisienne. Paul Morand évoquait dans Bucarest le "Petit Paris" qu'était la capitale roumaine]
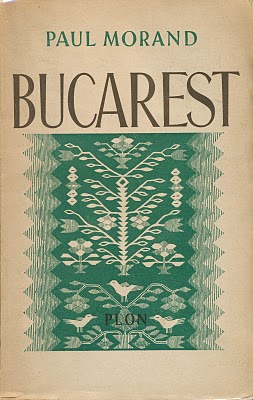 En arrivant dans la gare de Bucarest, le voyageur ne peut s'empêcher de se répéter cette entrée en matière des discours des ministres de la IIIe République que plaisante Morand : « la Roumanie, notre sœur latine ». Tout est latin en effet en cette ville où les cris résonnent de pavillons en immeubles, de boutiques en échoppes, au milieu des odeurs qu'exhale la chaleur exorcisée dans les soupirs d'hommes paresseusement attablés. Vingt ans de national-communisme à la Ceausescu, près d'un demi-siècle d'amitié tendue avec l'Union soviétique, n'ont pas entamé le caractère des Roumains. Là comme ailleurs les structures lourdes de l'histoire ont eu raison des vissicitudes du moment.
En arrivant dans la gare de Bucarest, le voyageur ne peut s'empêcher de se répéter cette entrée en matière des discours des ministres de la IIIe République que plaisante Morand : « la Roumanie, notre sœur latine ». Tout est latin en effet en cette ville où les cris résonnent de pavillons en immeubles, de boutiques en échoppes, au milieu des odeurs qu'exhale la chaleur exorcisée dans les soupirs d'hommes paresseusement attablés. Vingt ans de national-communisme à la Ceausescu, près d'un demi-siècle d'amitié tendue avec l'Union soviétique, n'ont pas entamé le caractère des Roumains. Là comme ailleurs les structures lourdes de l'histoire ont eu raison des vissicitudes du moment.
Paul Morand écrit que « Bucarest s'affermit au centre de l'amphithéâtre valaque protégé par le grand arc carpatique, courbé comme le dos d'un portefaix turc, et appuyé à sa base sur le fleuve nourricier par où était descendu un jour l'empereur Trajan, père des Roumains ». Pas une ligne n'est à changer dans cette description et s'il était quelque homme pressé qui mette en doute l'empreinte des Césars en Roumanie, il lui suffit pour se détromper d'observer les visages des habitants de Bucarest, autant de preuves que plus d'un légionnaire romain fut oublié au cœur de la Roumanie ou s'est oublié au cœur des Roumaines.
Bucarest, terre latine, en partage les défauts et d'abord celui d'un certain laisser-aller qui confine, en un parallèle de ses cousines Naples ou Tunis, à la saleté. Morand en fut dès l'abord frappé et reprend dans son texte les propos de voyageurs anglais, espions vénitiens ou négociants suédois qui voyaient au XVIIIe siècle s'entasser le fumier devant les portes. Les rues de Bucarest étaient alors de véritables radeaux sur la boue mouvante, « les véhicules y roulant lourdement, soulevant les madriers qui retombaient en s'enfonçant dans la glaise molle ». Le bitume et les trottoirs ont peu à peu, sous l'influence des Hohenzollern-Roumanie puis de la dictature communiste, pavé ce cloaque. Il n'en demeure pas moins qu'aujourdhui comme dans le Bucarest de 1935 que décrit Morand, routes et allées, impasses et cours, sont empreintes des remugles de la boue d'hier. Des époques d'une hygiène précaire, les habitants de la capitale roumaine ont conservé un redoutable fatalisme qui ruinait jusqu'aux rêves de pureté socialiste de Nicolae Ceausescu. Le voyageur ne doit pas hésiter à Bucarest pour se frayer le soir un chemin à enjamber les poubelles, vérifiant par la même que si en certaines cités, la nuit tous les chats sont gris, en Roumanie tous les rats sont noirs.
On connait l'intérêt que portait Morand aux cités radieuses, Venises de tous les sourires, on s'imagine donc que ce Bucarest des années 30 a les attraits outranciers des belles du sud. Las, la ville est empreinte d'une indicible tristesse, apanage de toute éternité de la Roumanie. Morand l'explique, en reprenant un texte du prince de Ligne, par la domination turque qu'eut à subir pendant des siècles le pays. « La crainte qu'ils ont des Turcs, l'habitude d'apprendre de mauvaises nouvelles... les ont accoutumés à une tristesse invincible. Cinquante personnes qui se rassemblent dans une maison ou une autre ont l'air d'attendre le fatal cordon ». Il va sans dire que la terreur pratiquée par la mythique Securitate, bras armé du Conducator, n'a pas enclin les habitants de Bucarest à l'optimisme.
À première vue la ville manque donc d'attrait et déçoit le voyageur. Ce que résume P. Morand en décrivant la lassitude de l'hospodar, gouverneur nommé par la Sublime Porte, qui arrivant d'Istambul, « trouve sa résidence misérable ».
[Ci-dessous : l'hôtel-restaurant Casa Capşa au centre de Bucarest dans les années 30]
 Pourtant derrière ces façades lépreuses, le Bucarest de 1935 comme celui de 1990, recèle des charmes insoupçonnés. L'un des moindres n'est pas l'extraordinaire vitalité de ses intellectuels. P. Morand s'avoue admiratif devant le talent multiforme des Roumains, véritable magie noire de l'esprit : « leur drôlerie, leur verve, leur mordant , leur rapidité , leur bon sens cynique les rendent redoutable. Il n'est pas facile de tenir sa place dans une discussion entre Roumains ». L'assertion reste aujourd'hui pertinente. Depuis la pseudo-révolution de décembre 1989, qui a brisé les cadres par trop rigides du stalinisme à la Ceausescu, Bucarest tout entière bruit des jeux de l'intellect. Les Roumains ont, pendant les décennies du communisme triomphant, maintenu la flamme vacillante de leurs brillantes élites (les écrivains Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Mihail Sadoveanu auxquels succédèrent les exilés de génie : Cioran, Ionesco, Eliade, Vintilia Horia). La terre était féconde et de nouvelles pousses ne demandaient qu'à poindre. L'arrivée au pouvoir d'Ilescu a ainsi permis à des écrivains comme Doïna Cornea ou Alexandre Paleologu de devenir de véritables autorités morales. Morand qui chantait les louanges des salons littéraires du Bucarest des années 30 n'aurait pas été outre mesure surpris de la curiosité intellectuelle de toute une population qui n'hésite pas aujourd'hui à afficher dans les magasins des portraits de Mircea Eliade.
Pourtant derrière ces façades lépreuses, le Bucarest de 1935 comme celui de 1990, recèle des charmes insoupçonnés. L'un des moindres n'est pas l'extraordinaire vitalité de ses intellectuels. P. Morand s'avoue admiratif devant le talent multiforme des Roumains, véritable magie noire de l'esprit : « leur drôlerie, leur verve, leur mordant , leur rapidité , leur bon sens cynique les rendent redoutable. Il n'est pas facile de tenir sa place dans une discussion entre Roumains ». L'assertion reste aujourd'hui pertinente. Depuis la pseudo-révolution de décembre 1989, qui a brisé les cadres par trop rigides du stalinisme à la Ceausescu, Bucarest tout entière bruit des jeux de l'intellect. Les Roumains ont, pendant les décennies du communisme triomphant, maintenu la flamme vacillante de leurs brillantes élites (les écrivains Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Mihail Sadoveanu auxquels succédèrent les exilés de génie : Cioran, Ionesco, Eliade, Vintilia Horia). La terre était féconde et de nouvelles pousses ne demandaient qu'à poindre. L'arrivée au pouvoir d'Ilescu a ainsi permis à des écrivains comme Doïna Cornea ou Alexandre Paleologu de devenir de véritables autorités morales. Morand qui chantait les louanges des salons littéraires du Bucarest des années 30 n'aurait pas été outre mesure surpris de la curiosité intellectuelle de toute une population qui n'hésite pas aujourd'hui à afficher dans les magasins des portraits de Mircea Eliade.
Bucarest est aussi la Mecque des hommes de presse. Dans les années 30, les journaux y faisaient florès, Morand se délectant en son hôtel de la lecture de Cuvântul, de Curentul, de Criterion ou de Viata Romana, toutes publications « à la tenue tout à fait remarquable ». La dite révolution de décembre 1989 a permis à l'histoire de faire un saut dans le temps et de restaurer au-delà des années de censure politique, le pluralisme de l'écriture. Le flâneur salarié qui met ses pas dans ceux de P. Morand peut à son tour gagner son gîte avec une moisson de titres divers, parmi lesquels il faut surtout retenir le très anti-conformiste România Mare, nationaliste et anti-sémite ou la gazette littéraire Arca qui affiche une indépendance que l'Occident se doit de jalouser.
Cette exubérance intellectuelle séduit d'autant plus le lecteur francophone qu'elle se fait à l'ombre de Corneille et de Montesquieu. On ne dira jamais assez combien les Roumains sont pétris de culture française classique et des feux des Lumières. Paul Morand voit les prémices de cette osmose entre les 2 pays dans la croisade que menèrent en 1396 Mircea le Grand, voevode de Valachie, et les chevaliers francs commandés par le fils du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, contre l'ennemi commun qu'était le Turc.
C'est alors noué dans le sang des combats et notamment dans les souffrances de la défaite de Nicopolis, une durable entente que viendra renforcer la lointaine protection qu'accorde au XVIe siècle Henri III, roi de France, à Pierre Boucle-d'Oreille, prince valaque avide de dominer l'ensemble des provinces roumaines. Quelques années plus tard, c'est un prince moldave, Jacques Basilic-Héraclide Despotas, qui entame des études de médecine à la faculté de médecine de Montpellier. Cette tradition se maintient jusqu'à nos jours et il n'est pas jusqu'au Premier ministre roumain en exercice, Petre Roman, qui n'ait été potache sur les bancs de l'université de Toulouse.
P. Morand ne se lasse pas de ce visage de la Roumanie, terre d'épanouissement pour les élites. Pourtant il préfère consacrer les plus belles pages de son livre à d'autres minois, ceux des femmes de Bucarest. Elles l'ont dès l'abord séduit, au point qu'il a songé à donner pour sous-titre à cette balade citadine, « le portait d'une jolie femme ». Il est vrai que de temps immémoriaux les douces de Bucarest font rêver les hommes d'Orient et d'Occident. Le chroniqueur Dionisie Eclesiarcul raconte ainsi qu'un amiral ottoman exigea au cours d'une visite en Roumanie que les boyards lui amène leurs boyaresses. Devinant ses intentions, ils firent venir des prostituées, les couvrirent de bijoux et les présentèrent comme leurs femmes. Vers la fin de la soirée, l'amiral demanda à l'hospodar de lui garder la plus belle et d'envoyer les autres à ses lieutenants. Les Ottomans ne dominent plus le monde et la concupiscence des hommes n'est plus ce qu'elle était mais le voyageur ne se contraint guère pour détourner le regard vers tant de poitrines de paysannes que servent des pieds menus. Pour ceux qui douteraient de l'admiration que l'on se doit de porter à ces odalisques des Carpates, Morand cite encore une fois le prince de Ligne : « Des femmes charmantes (...) une jupe extrêmement légère, courte et serrée masque leurs charmants contours, et une gaze en manière de poche dessine et porte à merveille les deux jolies pommes du jardin de l'Amour ».
Ces lignes prennent toute leur signification si l'on sait que Morand qui aimait à dire « Je n'aime pas qu'on me mette la main dessus, que ce soit un homme ou une femme » (cité par Ginette Guitard-Auviste dans la Nouvelle Revue de Paris n°13), ne succomba que pour la main de la princesse Soutzo, ex-épouse d'un hospodar roumain. À ce grand sceptique du couple (« Je pensais comme le disait souvent Marie Laurencin qu'un et un ne font pas deux, mais trois, et que trois ce n'est pas une bonne compagnie »), Hélène Soutzo s'offrira comme si indispensable qu'il ne saura lui survivre plus de 17 mois. Il est sans doute souhaitable pour tous les imitateurs de l'auteur de L'Europe galante en son périple roumain de tomber à leur tour dans les rets de fatales filles de Bucarest (« Hélène était la seule femme que je puisse épouser : auprès d'elle je ne m'ennuie jamais »). À défaut, le voyageur des années 90, à qui plus d'un visage sourit en autant de possibles aventures, garde à son tour, une fois l'éloignement consommé, le parfum d'une ville sensuelle, avec en tête cette ritournelle de Le Cler, promeneur de 1860, et qui résume le labeur essentiel de la cité : « À Bucarest on fait l'amour, ou bien on en parle ». Cette évocation légère de l'infinie séduction des belles descendantes des tribus Thraces révèle peut-être finalement la véritable nature de l'âme roumaine. La Roumanie est une nation femelle et cela explique sans doute qu'au printemps des peuples elle ait vécu son étrange révolution comme une commedia dell'arte. Faux procès de vrais dictateurs, complots étranges et génocides de pacotilles prennent un tour nouveau à l'aune de la féminité analysée par Morand : « Les femmes (...) rebâtissent le monde à mesure que les hommes le détruisent. Les catastrophes, elles les banalisent en révolutions, les révolutions en fêtes foraines et, notre goût du meurtre, elles en font de l'amour » (Le dernier dîner de Cazotte, in : Nouvelles des yeux, 1965 [repris dans : Nouvelles complètes, t. 2, Pléiade, 1992]). Morand a donc volontairement placé le nœud gordien et l'épilogue de son livre sous le riche signe de la féminité, clé de la Roumanie car source de vie, ce qu'il résume ainsi : « La leçon que nous offre Bucarest n'est pas une leçon d'art mais une leçon de vie (...). Capitale d'une terre tragique où souvent tout finit dans le comique, Bucarest s'est laissé aller aux évènements sans cette raideur, partant sans cette fragilité que donne la colère. Voilà pourquoi à travers la courbe sinueuse d'une destinée picaresque, Bucarest est resté gai ». Il est rarement en littérature d'observation que l'histoire aura rendue plus juste puisque aujourd'hui sur les ruines d'une bibliothèque détruite par les combats de l'hiver 1989 se pressent, dans les chaleurs de l'été, des jeunes filles en fleur, minaudant.
La Roumanie est ainsi une nation-phénix, toujours prête à renaître de ses cendres et il suffirait que le gouvernement d'Iliescu suive dans la tombe la dictature du génie des Carpates pour que revive le Bucarest des années 30 qu'a connu Morand. Ce serait là encore la démonstration du phénomène de glaciation qu'a fait subir le communisme aux peuples de l'Est, préservant par delà les miasmes de l'idéologie, leur véritable identité et peut-être également de façon plus malicieuse la preuve du génie littéraire de Paul Morand. En attendant cet hypothétique salut, Bucarest reste l'indispensable et unique (faute de guide officiel) Baedeker de la capitale roumaine. Morand a écrit dans Le Voyageur et l'amour : « l'amour est aussi un voyage », on serait tenté à la lecture de son livre de proclamer que l'inverse est aussi vrai, le voyage est un amour, Monsieur Morand, puisque vous nous faites tant aimer Bucarest.
♦ Bucarest, Paul Morand, Plon, 1990, 293 p.
► Hugues Rondeau, 1991.
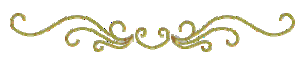
pièces-jointes :
Morand l'extravagant : Une lecture du siècle
[Ci-dessous : Paul Morand au volant d'une Bugatti type 51 aux pieds de la tour Eiffel en 1931, celle-là même qui portera le désir éperdu de fuite de Pierre, héros de L'homme pressé]
 C'est sur une épigraphe de Sterne (si l'on omet celle, précédente, qu'il attribue semble-t-il d'une manière fantaisiste à l'évêque Gilles de Caen) que s'ouvre le premier roman de Paul Morand, écrit dans les années 1910-1911 et publié trois quarts de siècle plus tard, Les Extravagants :
C'est sur une épigraphe de Sterne (si l'on omet celle, précédente, qu'il attribue semble-t-il d'une manière fantaisiste à l'évêque Gilles de Caen) que s'ouvre le premier roman de Paul Morand, écrit dans les années 1910-1911 et publié trois quarts de siècle plus tard, Les Extravagants :
« It is an age so full of light, that there is scarce a country or corner of Europe whose beams are not crossed and interchanged with others. » (« Nous vivons un siècle si éclairé, que c'est à peine s'il reste un pays ou un coin de l'Europe dont les rayons ne se croisent ou ne s'échangent avec d'autres. »)
On ne peut douter que Morand, à l'instar de Baudelaire avant lui, se soit découvert un frère en l'auteur du Voyage sentimental, qui entre tous certainement méritait le doux vocable d'extravagant, tout comme cet autre excentrique qui le précédait de deux siècles dans l'histoire, le Secrétaire de l'Amirauté Royale Samuel Pepys (prononcez : Pips) pour lequel l'auteur des Extravagants ne pouvait que s'enthousiasmer (cf. sa préface au Journal de Samuel Pepys). Mais le signe qui ne trompe pas, sous l'empire ou l'influence duquel se dessine toute son œuvre, il nous le donne en exergue de ce livre et, comme pour nous alerter s'il en était besoin, il ajoute, en citant Mme de Staël : « Désormais il faut avoir l'esprit européen ». L'Europe ! Que de fois ne revient-il pas en ce début de siècle, ce mot magique ! S'est-on jamais autant interrogé sur le vieux continent, à l'époque du réveil des consciences nationales ? A-t-elle jamais inspiré autant d'amour et d'inquiétude à ses enfants, la vieille Europe, qui faisait écrire à Larbaud : « Je me suis parfois demandé si tu n'étais pas une des marches, un canton adjacent de l'Enfer ». L'homme moderne, l'Européen, a choisi l'Europe comme patrie. Et quelle Europe ? Morand nous dit : Paris, Londres, Venise ; une identité nouvelle se forge et avec elle, un sens d'appartenance et de fidélité élargi à la mesure du siècle qui se lève. Il pressentit, en rejetant le cosmopolitisme dont on l'accoutra, que l'on édulcorait sous cette appellation son cruel message, dilué par les niais dans une douce loufoquerie d'artiste.
« Le cosmopolitisme, écrira-t-il, qui, loin d'être une foi, est un scepticisme ; qui, loin d'être une passion est une expérience. »
Mais qui ne savait lire, dans le poème Souvenir d'Istrie :
je suis étranger à mon pays ;
mon pays est étranger aux autres pays ;
je suis étranger aux deux étrangers
qui m'habitent en meublé.
Vois cette mer et ces chantiers ;
bleu et noir est une harmonie
que les Persans, dit-on, n'ont pas dédaignée.
N'y voit-on pas un écho prolongé à cette phrase des Extravagants : « J'ai la nostalgie de l'univers, j'ai le mal de tous les pays » ? Certes, ce n'est pas un hasard si, ayant traversé le siècle, six décennies plus tard, dans une Europe sauvagement morcelée et nouvellement isolée, il retrouve les mêmes mots pour décrire son spleen dans son dernier livre Venises, ce Venises prolongé à l'infini par un s anodin, recueillant dans ses eaux toutes les eaux des villes qu'il a aimées.
1900 : on découvre le siècle et le continent, l'espace embrasse le temps à travers la vitre des grands express — et pour ceux qui n'ont pu s'embarquer, la course de l'express n'en sera pas freinée ! « L'Europe est comme une grande ville », écrit encore Larbaud, et cette grande ville est fêtée à l'Exposition universelle. De son balcon de la rue Marbeuf, Paul Morand en « hume la musique, se brûle les yeux à l'embrasement des lampes à arc ». 1900, c'est le bonheur avec ses restaurants à trois francs. L'affaire Dreyfus est un incident clos. On réédite les Mille et une nuits dans la traduction du docteur Mardrus. À grands traits le siècle nous est révélé dans 1900, brasier de contradictions « où l'on ne doute de rien, sauf de son bonheur ». Écrit en 1930, autre pan abrupt de l'histoire, le livre se clôt sur une interrogation qui pourrait clore elle-même le siècle : « Pourquoi nous avoir fait croire aux microbes, à l'électricité et à la race blanche ? Pourquoi parler si haut et écrire si bas ? »
Le voyage est une composante même de l'époque, une sorte de matérialisation mentale, créée par le mouvement. Baudelaire a bu toutes les vapeurs de la capitale et le « progrès » a éloigné dans la préhistoire une époque « où », écrira Valery (je cite de mémoire) « l'eau était eau et l'air était air » — décomposés en molécules, à nous de retrouver et cette eau et cet air ! Mais le rat de La Fontaine (c'est-à-dire vous et moi) redécouvrira son échelle et, passant « les quelque soixante-dix à soixante-quinze lieues » qui séparent Paris de Bruxelles s'écriera encore : « Que le monde est spacieux ! » (Songeons que les Américains n'expriment jamais une distance, mais un temps : « C'est à deux heures d'avion, c'est une heure par l'autoroute », occultant ainsi l'espace que recouvre un point à un autre).
« Dans mes valises ? Shakespeare et l'indicateur des chemins de fer », déclare Morand. Les héros de E.M. Forster eux, comme Larbaub, s'arment du Baedeker. Il parcourt l'Afrique, les Caraïbes, les États-Unis, les Indes (il est sorti premier au concours des Affaires étrangères, n'oublions pas) et ses impressions qu'il consigne au jour le jour et rapporte dans différents volumes (Paris-Tombouctou, Hiver caraïbe, New York...) sont une véritable ethnographie du siècle (en comparaison, l'Afrique fantôme de l'ethnologue Michel Leiris est une œuvre littéraire). Drôle, grave, léger, profond, l'homme sans cesse interroge (l'interrogation comme procédé littéraire n'avait pas encore cours et tel homme l'eût dédaignée), et la somme de ses observations le conduit à écrire : « Le désert absolu, celui des cartes géographiques, n'existe pas ; sur terre, sauf aux pôles, il pousse toujours quelque chose » ; le désert des pôles, eût-il pu ajouter, enflamme jusqu'au délire l'imagination des poètes. Le voyage est une lecture qui demande à être interprétée ; dans Hiver caraïbe, il ironise sur le fait que, « peu après que Gobineau eut écrit : "Les Blancs ne purent s'imaginer voir des êtres égaux à eux dans ces hideuses créatures qui, par une bestialité méchante et le titre de fils de singes qu'elles revendiquaient", etc. Il se trouva un blanc pour revendiquer le titre de fils de singe : Darwin ». Voyageant dans le sud des États-Unis en bordure du Mexique, à la vue de l'architecture locale avec patios et haciendas, il constate : « Le vainqueur, comme il se doit, a subi la civilisation du vaincu ». À New York, il voit « sortir de ces bâtiments rouges les petits Chinois, si américains dans leurs manteaux de cuir et si mongols sous leurs casques à la Lindberg, prêts à boxer les petits Arméniens du quartier » et il comprend « que l'aventure actuelle de New York sera, dans un siècle ou deux, celle du monde entier » (il n'en aura pas fallu tant). Le fameux miroir de Stendhal, « que l'on promène sur un sentier » demande à être lu par un mage, ou un prophète ; Paul Morand, dans ses livres, nous a donné une lecture du siècle, spectateur et composant de la métamorphose. Il nous a aussi rappelé cette très ancienne leçon, que le « sens du détail » est essentiel à l'écrivain ; en littérature, pour qui veut invoquer même l'éternité, il importe de savoir faire la différence entre l'ale et le stout.
Venise, Londres, mouvement de balancier à double résonance, mais les deux notes ne font qu'un mouvement : entend-on l'une, l'autre répond. Venises se lit comme le testament spirituel d'un Occident qui va des rives du Bosphore à la Baltique et à Brooklyn et se souvient des Hellènes, de Rome, de l'Islam andalou et des chrétiens de Byzance. C'est aussi le livre d'un homme qui, jusqu'à la fin de sa vie, pratique l'art de vivre avec une curiosité naturelle pour tout, se rend à des expositions, invite à sa table des hippies anglais qu'il a rencontrés... C'est un homme qui s'est choisi Trieste pour dernier voyage, « Trieste cerné, comme l'est notre petit monde », et au couchant de sa vie porte une dernière interrogation.
► Samuel Brussel, La Nouvelle Revue de Paris n°13, 1988.
>>> suites articles à venir
