Dandy
 Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du “dandy”
Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du “dandy”
♦ Intervention de Robert Steuckers au séminaire de SYNERGON-Deutschland, Basse-Saxe, 6 mai 2001.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais formuler 3 remarques préliminaires :
◊ 1. J’ai hésité à accepter votre invitation à parler de la figure du dandy, car ce type de problématique n’est pas mon sujet de préoccupation privilégié.
◊ 2. J’ai finalement accepté parce que j’ai redécouvert un essai aussi magistral que clair d’Otto Mann, paru en Allemagne il y de nombreuses années (Dandysmus als konservative Lebensform, in : Gerd-Klaus Kaltenbrunner (Hrsg.), Konservatismus International, Seewald Verlag, Stuttgart, 1973, pp.156-170). Cet essai mériterait d’être à nouveau réédité, avec de bons commentaires.
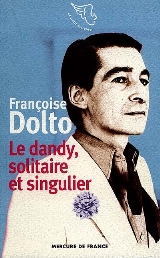 ◊ 3. Ma troisième remarque est d’ordre méthodologique et définitionnel. Avant de parler du “dandy”, et de rappeler à ce sujet l’excellent travail d’Otto Mann, il faut énumérer les différentes définitions du “dandy”, qui ont cours, et qui sont contradictoires. Ces définitions sont pour la plupart erronées, ou superficielles et insuffisantes. D’aucuns définissent le dandy comme un “pur phénomène de mode”, comme un personnage élégant, sans plus, soucieux de se vêtir selon les dernières modes vestimentaires. D’autres le définissent comme un personnage superficiel, qui aime la belle vie et pérégrine, oisif, de cabaret en cabaret. Françoise Dolto avait brossé un tableau psychologique du dandy [Le dandy, solitaire et singulier, 1962]. D’autres encore soulignent, quasi exclusivement, la dimension homosexuelle de certains dandies, tel Oscar Wilde. Plus rarement on assimile le dandy à une sorte d’avatar de Don Juan, qui meuble son ennui en collectionnant les conquêtes féminines. Ces définitions ne sont pas celles d’Otto Mann, que nous faisons nôtres.
◊ 3. Ma troisième remarque est d’ordre méthodologique et définitionnel. Avant de parler du “dandy”, et de rappeler à ce sujet l’excellent travail d’Otto Mann, il faut énumérer les différentes définitions du “dandy”, qui ont cours, et qui sont contradictoires. Ces définitions sont pour la plupart erronées, ou superficielles et insuffisantes. D’aucuns définissent le dandy comme un “pur phénomène de mode”, comme un personnage élégant, sans plus, soucieux de se vêtir selon les dernières modes vestimentaires. D’autres le définissent comme un personnage superficiel, qui aime la belle vie et pérégrine, oisif, de cabaret en cabaret. Françoise Dolto avait brossé un tableau psychologique du dandy [Le dandy, solitaire et singulier, 1962]. D’autres encore soulignent, quasi exclusivement, la dimension homosexuelle de certains dandies, tel Oscar Wilde. Plus rarement on assimile le dandy à une sorte d’avatar de Don Juan, qui meuble son ennui en collectionnant les conquêtes féminines. Ces définitions ne sont pas celles d’Otto Mann, que nous faisons nôtres.
L’archétype : George Bryan Brummell
Notre perspective, à la suite de l’essai d’Otto Mann, est d’attribuer au dandy une dimension culturelle plus profonde que toutes ses superficialités “modieuses”, épicuriennes, hédonistes, homosexuelles ou donjuanesques. Pour Otto Mann, le modèle, l’archétype du dandy, reste George Bryan Brummell, figure du début du XIXe siècle qui demeurait équilibrée. Brummell, contrairement à certains pseudo-dandies ultérieurs, est un homme discret, qui ne cherche pas à se faire remarquer par des excentricités vestimentaires ou comportementales. Brummell évite les couleurs criardes, ne porte pas de bijoux, ne se livre pas à des jeux sociaux de pur artifice. Brummell est distant, sérieux, digne ; il n’essaie pas de faire de l’effet, comme le feront, plus tard, des figures aussi différentes qu’Oscar Wilde, que Stefan George ou Henry de Montherlant. Chez lui, les tendances spirituelles dominent. Brummell entretient la société, raconte, narre, manie l’ironie et même la moquerie. Pour parler comme Nietzsche ou Heidegger, nous dirions qu’il se hisse au-dessus de “l’humain, trop humain” ou de la banalité quotidienne (Alltäglichkeit).
Brummell, dandy de la première génération, incarne une forme culturelle, une façon d’être, que notre société contemporaine devrait accepter comme valable, voire comme seule valable, mais qu’elle ne génère plus, ou plus suffisamment. Raison pour laquelle le dandy s’oppose à cette société. Les principaux motifs qui sous-tendent son opposition sont les suivants :
♦ 1) la société apparaît comme superficielle et marquée de lacunes et d’insuffisances ;
♦ 2) le dandy, en tant que forme culturelle, qu’incarnation d’une façon d’être, se pose comme supérieur à cette société lacunaire et médiocre ;
♦ 3) le dandy à la Brummell ne commet aucun acte exagéré, ne commet aucun scandale (par ex. de nature sexuelle), ne commet pas de crime, n’a pas d’engagement politique (contrairement aux dandies de la deuxième génération comme un Lord Byron). Brummell lui-même ne gardera pas cette attitude jusqu’à la fin de ses jours, car il sera criblé de dettes, mourra misérablement à Caen dans un hospice. Il avait, à un certain moment, tourné le dos au fragile équilibre que réclame la posture initiale du dandy, qu’il avait été le premier à incarner.
Un idéal de culture, d’équilibre et d’excellence
S’il n’y a dans son comportement et sa façon d’être aucune exagération, aucune originalité flamboyante, pourquoi la figure du dandy nous apparaît-elle quand même importante, du moins intéressante ? Parce qu’elle incarne un idéal, qui est en quelque sorte, mutatis mutandis, celui de la paiedeia grecque ou de l’humanitas romaine. Chez Evola et chez Jünger, nous avons la nostalgie de la magnanimitas latine, de l’hochmüote des chevaliers germaniques des XIIe et XIIIe siècles, avatars romains ou médiévaux d’un modèle proto-historique perse, mis en exergue par Gobineau d’abord, par Henry Corbin ensuite. Le dandy est l’incarnation de cet idéal de culture, d’équilibre et d’excellence dans une période plus triviale de l’histoire, où le bourgeois calculateur et inculte, et l’énergumène militant, de type hébertiste ou jacobin, a pris le pas sur l’aristocrate, le chevalier, le moine et le paysan.
À la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française, ces vertus, issues du plus vieux fond proto-historique de l’humanité européenne, sont complètement remises en question. D’abord par l’idéologie des Lumières et son corolaire, l’égalitarisme militant, qui veut effacer toutes les traces visibles et invisibles de cet idéal d’excellence. Ensuite, par le Sturm und Drang et le romantisme, qui, par réaction, basculent parfois dans un sentimentalisme incapacitant, parce qu’expression, lui aussi, d’un déséquilibre. Les modèles immémoriaux, parfois estompés et diffus, les attitudes archétypales survivantes disparaissent.
C’est en Angleterre qu’on en prend conscience très vite, dès la fin du XVIIe, avant même les grands bouleversements de la fin du XVIIIe : Addison et Steele dans les colonnes du Spectator et du Tatler, constatent qu’il est nécessaire et urgent de conserver et de maintenir un système d’éducation, une culture générale, capables de garantir l’autonomie de l’homme. Une valeur que les médias actuels ne promeuvent pas, preuve discrète que nous avons bel et bien sombré dans un monde orwellien, qui se donne un visage de “bon apôtre démocratique”, inoffensif et “tolérant”, mais traque impitoyablement toutes les espaces et résidus d’autonomie de nos contemporains. Addison et Steele, dans leurs articles successifs, nous ont légué une vision implicite de l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Europe.
L’idéal de Gœthe
Le plus haut idéal culturel que l’Europe ait connu est bien entendu celui de la paideia grecque antique. Elle a été réduite à néant par le christianisme primitif, mais, dès le XIVe siècle, on sent, dans toute l’Europe, une volonté de faire renaître les idéaux antiques. Le dandy, et, bien avant son émergence dans le paysage culturel européen, les deux journalistes anglais Steele et Addison, entendent incarner cette nostalgie de la paideia, où l’autonomie de chacun est respectée.
Ils tentent en fait de réaliser concrètement dans la société l’objectif de Gœthe : inciter leurs contemporains à se forger et se façonner une personnalité, qui sera modérée dans ses besoins, satisfaite de peu, mais surtout capable, par cette ascèse tranquille, d’accéder à l’universel, d’être un modèle pour tous, sans trahir son humus originel (Ausbildung seiner selbst zur universalen und selbstgenugsamen Persönlichkeit). Cet idéal gœthéen, partagée anticipativement par les 2 publicistes anglais puis incarné par Brummell, n’est pas passé après les vicissitudes de la Révolution française, de la révolution industrielle et des révolutions scientifiques de tous acabits. Sous les coups de cette modernité, irrespectueuse des Anciens, l’Europe se retrouve privée de toute culture substantielle, de toute épine dorsale éthique. On en mesure pleinement les conséquences aujourd’hui, avec la déliquescence de l’enseignement.
À partir de 1789, et tout au long du XIXe siècle, le niveau culturel ne cesse de s’effondrer. Le déclin culturel commence au sommet de la pyramide sociale, désormais occupé par la bourgeoisie triomphante qui, contrairement aux classes dominantes des époques antérieures, n’a pas d’assise morale (sittlich) valable pour maintenir un degré élevé de civilisation ; elle n’a pas de fondement religieux, ni de réelle éthique professionnelle, contrairement aux artisans et aux gens de métier, jadis encadrés dans leurs guildes ou corporations (Zünfte). La seule réalisation de cette bourgeoisie est l’accumulation méprisable de numéraire, ce qui nous permet de parler, comme René Guénon, d’un “règne de la quantité”, d’où est bannie toute qualité. Dans les classes défavorisées, au bas de l’échelle sociale, tout élément de culture est éradiqué, tout simplement parce que chez les pseudo-élites, il n’y a déjà plus de modèle culturel ; le peuple, aliéné, précarisé, prolétarisé, n’est plus une matrice de valeurs précises, ethniquement déterminées, du moins une matrice capable de générer une contre-culture offensive, qui réduirait rapidement à néant ce que Thomas Carlyle appelait la cash flow mentality.
En conclusion, nous assistons au déploiement d’une barbarie nantie, à haut niveau économique (eine ökonomisch gehobene Barbarei), mais à niveau culturel nul. On ne peut pas être riche à la mode du bourgeois et, simultanément, raffiné et intelligent. Cette une vérité patente : personne de cultivé n’a envie de se retrouver à table, ou dans un salon, avec des milliardaires de la trempe d’un Bill Gates ou d’un Albert Frère, ni avec un banquier ou un fabricant de moteurs d’automobile ou de frigidaires. Le véritable homme d’esprit, qui se serait égaré dans le voisinage de tels sinistres personnages, devrait sans cesse réprimer des bâillements en subissant le vomissement continu de leurs bavardages ineptes, ou, pour ceux qui ont le tempérament plus volcanique, réprimer l’envie d’écraser une assiette bien grasse, ou une tarte à la façon du Gloupier, sur le faciès blet de ces nullités. Le monde serait plus pur — et sûrement plus beau — sans la présence de telles créatures.
La mission de l’artiste selon Baudelaire
Pour le dandy, il faut réinjecter de l’esthétique dans cette barbarie. En Angleterre, John Ruskin (1819-1899), les Pré-Réphaélites avec Dante Gabriel Rossetti et William Morris, vont s’y employer. Ruskin élaborera des projets architecturaux, destinés à embellir les villes enlaidies par l’industrialisation anarchique de l’époque manchesterienne, qui déboucheront notamment sur la construction de “cités-jardins” (Garden Cities). Les architectes belges et allemands de l’Art Nouveau ou Jugendstil, dont Henry Vandervelde et Victor Horta, prendront le relais. À côté de ces réalisations concrètes — parce que l’architecture permet plus aisément de passer au concret — le fossé ne cesse de se creuser entre l’artiste et la société. Le dandy se rapproche de l’artiste. En France, Baudelaire pose, dans ses écrits théoriques, l’artiste comme le nouvel “aristocrate”, dont l’attitude doit être empreinte de froideur distante, dont les sentiments ne doivent jamais s’exciter ni s’irriter outre mesure, dont l’ironie doit être la qualité principale, de même que la capacité à raconter des anecdotes plaisantes.
Le dandy artiste prend ses distances par rapport à tous les dadas conventionnels et habituels de la société. Ces positions de Baudelaire se résument dans les paroles d’un personnage d’Ernst Jünger, dans le roman Héliopolis : « Je suis devenu le dandy, qui prend pour important ce qui ne l’est pas, qui se moque de ce qui est important » (« Ich wurde zum Dandy, der das Unwichtige wichtig nahm, das Wichtige belächelte »). Le dandy de Baudelaire, à l’instar de Brummell, n’est donc pas un personnage scandaleux et sulfureux à la Oscar Wilde, mais un observateur froid (ou, pour paraphraser Raymond Aron, un “spectateur désengagé”), qui voit le monde comme un simple théâtre, souvent insipide où des personnages sans réelle substance s’agitent et gesticulent. Le dandy baudelairien a quelque peu le goût de la provocation, mais celle-ci reste cantonnée, dans la plupart des cas, à l’ironie.
Les exagérations ultérieures, souvent considérées à tort comme expressions du dandysme, ne correspondent pas aux attitudes de Brummell, Baudelaire ou Jünger. Ainsi, un Stefan George, malgré le grand intérêt de son œuvre poétique, pousse l’esthétisme trop loin, à notre avis, pour verser dans ce qu’Otto Mann appelle l’« esthéticisme », caricature de toute véritable esthétique. Pour Stefan George, c’est un peu la rançon à payer à une époque où la “perte de tout juste milieu” devient la règle (Hans Sedlmayr a explicité clairement dans un livre célèbre sur l’art contemporain, Verlust der Mitte, cette perte du “juste milieu”). Sedlmayr mettait clairement en exergue cette volonté de rechercher le “piquant”. Stefan George le trouvera dans ses mises en scène néo-antiques.
Oscar Wilde ne mettra rien d’autre en scène que lui-même, en se proclamant “réformateur esthétique” (1). L’art, dans sa perspective, n’est plus un espace de contestation destiné à investir totalement, à terme, le réel social, mais devient le seule réalité vraie. La sphère économique, sociale et politique se retrouve dévalorisée ; Wilde lui dénie toute substantialité, réalité, concrétude. Si Brummell conservait un goût tout de sobriété, s’il gardait la tête sur les épaules, Oscar Wilde se posait d’emblée comme un demi-dieu, portait des vêtements extravagants, aux couleurs criardes, un peu comme les Incroyables et les Merveilleuses au temps de la Révolution française. Provocateur, il a aussi amorcé un processus de mauvaise “féminisation/dévirilisation”, en se promenant dans les rues avec des fleurs à la main. À l’heure des actuelles gay prides, on peut le considérer comme un précurseur. Ses poses constituent tout un théâtre, assez éloigné, finalement, de ce sentiment tranquille de supériorité, de dignité virile, de “nil admirari”, du premier Brummell.
Auto-satisfaction et sur-dimensionnement du “moi”
Pour Otto Mann, cette citation de Wilde est emblématique :
« Les dieux m’ont presque tout donné. J’avais du génie, un nom illustre, une position sociale élevée, la gloire, l’éclat, l’audace intellectuelle ; j’ai fait de l’art une philosophie et de la philosophie un art ; j’ai appris aux hommes à penser autrement et j’ai donné aux choses d’autres couleurs... Tout ce que j’ai touché s’est drapé dans de nouveaux effets de beauté ; à la vérité, je me suis attribué, à juste titre, le faux comme domaine et j’ai démontré que le faux, tout comme le vrai, n’est qu’une simple forme d’existence postulée par l’intellect. J’ai traité l’art comme la vérité suprême, et la vie comme une branche de la poésie et de la littérature. J’ai éveillé la fantaisie en mon siècle, si bien qu’il a créé, autour de moi, des mythes et des légendes. J’ai résumé tous les systèmes philosophiques en un seul épigramme. Et à côté de tout cela, j’avais encore d’autres atouts ».
L’auto-satisfaction, le sur-dimensionnement du “moi” sont patents, vont jusqu’à la mystification. Ces exagérations iront croissant, même dans l’orbite de cette virilité stoïque, chère à Montherlant. Celui-ci, à son tour, exagère dans les poses qu’il prend, en pratiquant une tauromachie fort ostentatoire ou en se faisant photographier, paré du masque d’un empereur romain. Le risque est de voir des adeptes minables verser dans un “lookisme” tapageur et de mauvais goût, de formaliser à l’extrême ces attitudes ou ces postures du poète ou de l’écrivain. En aucun cas, elles n’apportent une solution au phénomène de la décadence.
En matière de dandysme, la seule issue est de revenir calmement à Brummell lui-même, avant qu’il ne sombre dans les déboires financiers. Car ce retour au premier Brummell équivaut, si l’on se souvient des exhortations antérieures d’Addison et Steele, à une forme plus moderne, plus civile et peut-être plus triviale de paideia ou d’humanitas. Mais, trivialité ou non, ces valeurs seraient ainsi maintenues, continueraient à exister et à façonner les esprits. Ce mixte de bon sens et d’esthétique dandy permettrait de dégager un objectif politique pratique : défendre l’école au sens classique du terme, augmenter sa capacité à transmettre les legs de l’antiquité hellénique et romaine, prévoir une pédagogie nouvelle et efficace, qui serait un mixte d’idéalisme à la Schiller, de méthodes traditionnelles et de méthodes inspirées par Pestalozzi.
Retour à la religion ou “conscience malheureuse” ?
La figure du dandy doit donc être replacée dans le contexte du XVIIIe siècle, où les idéaux et les modèles classiques de l’Europe traditionnelle s’érodent et disparaissent sous les coups d’une modernité équarissante et arasante. Les substances religieuses, chrétiennes ou pré-chrétiennes sous vernis chrétien, se vident et s’épuisent. Les Modernes prennent le pas sur les Anciens. Ce processus conduit forcément à une crise existentielle au sein de l’écoumène civilisationnel européen. Deux pistes s’offrent à ceux qui tentent d’échapper à ce triste destin :
- 1) Le retour à la religion, ou à la tradition, piste importante mais qui n’est pas notre propos aujourd’hui, tant elle représente un continent de la pensée, fort vaste, méritant un séminaire complet à elle seule.
- 2) Cultiver ce que les romantiques appelaient la Weltschmerz, la douleur que suscitait ce monde désenchanté, ce qui revient à camper sur une position critique permanente à l’endroit des manifestations de la modernité, à développer une conscience malheureuse, génératrice d’une culture volontairement en marge, mais où l’esprit politique peut puiser des thématiques offensives et contestatrices.
Pour le dandy et le romantique, qui oscille entre le retour à la religion et le sentiment de Weltschmerz, cette dernière est surtout ressentie de l’intérieur. C’est dans l’intériorité du poète ou de l’artiste que ce sentiment va mûrir, s’accroître, se développer. Jusqu’au point de devenir dur, de dompter le regard et d’éviter ainsi les langueurs ou les colères suscitées par la conscience malheureuse. En bout de course, le dandy doit devenir un observateur froid et impartial, qui a dominé ses sentiments et ses émotions. Si le sang a bouillonné face aux “horreurs économiques”, il doit rapidement se refroidir, conduire à l’impassibilité, pour pouvoir les affronter efficacement. Le dandy, qui a subi ce processus, atteint ainsi une double impassibilité : rien d’extérieur ne peut plus l’ébranler ; mais aucune émotion intérieure non plus.
Pierre Drieu La Rochelle ne parviendra jamais à un tel équilibre, ce qui donne une touche très particulière et très séduisante à son œuvre, tout simplement parce qu’elle nous dévoile ce processus, en train de se réaliser, vaille que vaille, avec des ressacs, des enlisements et des avancées. Drieu souffre du monde, s’essaie aux avant-gardes, est séduit par la discipline et les aspects “métalliques” du fascisme “immense et rouge”, en marche à son époque, accepte mentalement la même discipline chez les communistes et les staliniens, mais n’arrive pas vraiment à devenir un “observateur froid et impartial” (Benjamin Constant). L’œuvre de Drieu La Rochelle est justement immortelle parce qu’elle révèle cette tension permanente, cette crainte de retomber dans les ornières d’une émotion inféconde, cette joie de voir des sorties vigoureuses hors des torpeurs modernes, comme le fascisme, ou la gouaille d’un Doriot.
Blinder le mental et le caractère
En résumé, le processus de deconstruction des idéaux de la paideia antique, et de déliquescence des substantialités religieuses immémoriales, qui s’amorce à la fin du XVIIIe siècle, équivaut à une crise existentielle généralisée à tous les pays occidentaux. La réponse de l’intelligence à cette crise est double : ou bien elle appelle un retour à la religion ou bien elle suscite, au fond des âmes, une douleur profondément ancrée, la fameuse Weltschmerz des romantiques. La Weltschmerz se ressent dans l’intériorité profonde de l’homme qui fait face à cette crise, mais c’est aussi dans son intériorité qu’il travaille silencieusement à dépasser cette douleur, à en faire le matériel premier pour forger la réponse et l’alternative à cette épouvantable déperdition de substantialité, surplombée par un économicisme délétère. Il faut donc se blinder le mental et le caractère, face aux affres qu’implique la déperdition de substantialité, sans pour autant inventer de toutes pièces des Ersätze plus ou moins boîteux à la substantialité de jadis.
Baudelaire et Wilde pensent, tous 2 à leur manière, que l’art va offrir une alternative, plus souple et plus mouvante que les anciennes substantialités, ce qui est quasiment exact sur toute la ligne, mais, dans ce cas, l’art ne doit pas être entendu comme simple esthétisme. Le blindage du mental et du caractère doit servir, in fine, à combattre l’économicisme ambiant, à lutter contre ceux qui l’incarnent, l’acceptent et mettent leurs énergies à son service. Ce blindage doit servir de socle moral et psychologique dur aux idéaux de combat politique et métapolique. Ce blindage doit être la carapace de ce qu’Evola appelait l’« homme différencié », celui qui “chevauche le tigre”, qui erre, imperturbé et imperturbable, “au milieu des ruines”, ou que Jünger désignait sous le vocable d’« anarque ». “L’homme différencié qui chevauche le tigre au milieu des ruines” ou “l’anarque” sont posés d’emblée comme des observateurs froids, impartiaux, impassibles. Ces hommes différenciés, blindés, se sont hissés au-dessus de 2 catégories d’obstacles : les obstacles extérieurs et les obstacles générés par leur propre intériorité. C’est-à-dire les barrages dressés par les “hommes de moindre valeur” et les alanguissements de l’âme en détresse.
Figures tchandaliennes de la décadence
La crise existentielle, qui débute vers le milieu du XVIIIe siècle, débouche donc sur un nihilisme, très judicieusement défini par Nietzsche comme un “épuisement de la vie”, comme “une dévalorisation des plus hautes valeurs”, qui s’exprime souvent par une agitation frénétique sans capacité de jouir royalement de l’otium [temps libre d'activité], agitation qui accélère le processus d’épuisement. La mise en schémas de l’existence est l’indice patent que nos “sociétés” ne forment plus des “corps”, mais constituent, dit Nietzsche, des “conglomérats de Tchandalas”, chez qui s’accumulent les maladies nerveuses et psychiques, signe que la puissance défensive des fortes natures n’est plus qu’un souvenir. C’est justement cette “puissance défensive” que l’homme “différencié” doit, au bout de sa démarche, de sa quête dans les arcanes des traditions, reconstituer en lui.
Nietzsche énumère très clairement les vices du Tchandala, figure emblématique de la décadence européenne, issue de la crise existentielle et du nihilisme : le Tchandala est affecté de pathologies diverses, sur fond d’une augmentation de la criminalité, de célibat généralisée et de stérilité voulue, d’hystérie, d’affaiblissement constant de la volonté, d’alcoolisme (et de toxicomanies diverses ajouterions-nous), de doute systématique, d’une destruction méthodique et acharnée des résidus de force. Parmi les figures tchandaliennes de cette décadence et de ce nihilisme, Nietzsche compte ceux qu’il appelle les “nomades étatiques” (Staatsnomaden) que sont les fonctionnaires, sans patrie réelle, serviteurs du “monstre froid”, au mental mis en schémas et, subséquemment, générateurs de toujours davantage de schémas, dont l’existence parasitaire engendre, par leur effroyable pesanteur en progression constante, le déclin des familles, dans un environnement fait de diversités contradictoires et émiettées, où l’on trouve :
- le “disciplinage” (Züchtung) des caractères pour servir les abstractions du monstre froid,
- la lubricité généralisée comme forme de nervosité et comme expression d’un besoin insatiable et compensatoire de stimuli et d’excitations,
- les névroses en tous genres,
- les fascinations morbides pour les mécanismes et pour les enchaînements, limités, de sèches causalités sans levain,
- le présentisme politique (Augenblickdienerei) où ne dominent plus, souverainement, ni longue mémoire ni perspectives profondes ni sens naturel et instinctif du bon droit,
- le sensibilisme pathologique,
- les doutes inféconds procédant d’un effroi morbide face aux forces impassables qui ont fait et feront encore l’histoire-puissance,
- une peur d’arraisonner le réel, de saisir les choses tangibles de ce monde.
Victor Segalen en Océanie, Ernst Jünger en Afrique
Dans ce complexe de froideur, d’immobilisme agité, de frénésies infécondes, de névroses, une première réponse au nihilisme est d’exalter et de concrétiser le principe de l’aventure, où le contestataire quittera le monde bourgeois tissé d’artifices, pour s’en aller vers des espaces vierges, intacts, authentiques, ouverts, mystérieux. Gauguin part pour les îles du Pacifique. Victor Segalen, à sa suite, chante l’Océanie primordiale et la Chine impériale qui se meurt sous les coups de l’occidentalisme. Segalen demeure breton, opère ce qu’il appelait le “retour à l’os ancestral”, dénonce l’envahissement de Tahiti par les “romances américaines”, ces “parasites immondes”, rédige un Essai sur l’exotisme et Une esthétique du divers. Le rejet des brics et brocs sans passé profond ont valu à Segalen un ostracisme injustifié dans sa patrie : il reste un auteur à redécouvrir, dans la perspective qui est nôtre.
Le jeune Jünger, encore adolescent, rêve de l’Afrique, du continent où vivent les éléphants et d’autres animaux fabuleux, où les espaces et les paysages ne sont pas meurtris par l’industrialisation, où la nature et les peuples indigènes ont conservé une formidable virginité, permettant encore tous les possibles. Le jeune Jünger s’engage dans la Légion Étrangère pour concrétiser ce rêve, pour pouvoir débarquer dans ce continent nouveau, perclus de mystères et de vitalité. 1914 lui donnera, à lui et à toute sa génération, l’occasion de sortir d’une existence alanguissante. Dans la même veine, Drieu La Rochelle parlera de l’élan de Charleroi. Et plus tard, Malraux, de Voie Royale. À “gauche” (pour autant que cette dichotomie politicienne ait un sens), on parlera plutôt d’“engagement”, où ce même enthousiasme se retrouvera surtout lors de la Guerre d’Espagne, où Hemingway, Orwell, Koestler, Simone Weil s’engageront dans le camp des Républicains, et Campbell dans le camp des Nationalistes, qui fut aussi, comme on le sait, chanté par Robert Brasillach. L’aventure et l’engagement, dans l’uniforme du soldat ou des milices phalangistes, dans les rangs des brigades internationales ou des partisans, sont perçus comme antidotes à l’hyperformalisme d’une vie civile sans couleurs. “I was tired of civilian life, therefore I joined the IRA”, est-il dit dans un chant nationaliste irlandais, qui, dans son contexte particulier, proclame, avec une musique primesautière, cette grande envolée existentialiste du début du XXe siècle avec toute la désinvolture, la verdeur, le rythme et la gouaille de la Verte Eirinn.
Ivresses ? Drogues ? Amoralisme ?
Mais si l’engagement politique ou militaire procure, à ceux que le formalisme d’une vie civile, sans plus aucun relief ni équilibre traditionnel, ennuie, le supplément d’âme recherché, le rejet de tout formalisme peut conduire à d’autres attitudes, moins positives. Le dandy, qui quitte la pose équilibrée de Brummell ou la critique bien ciselée de Baudelaire, va vouloir expérimenter toujours davantage d’excitations, pour le seul plaisir stérile d’en éprouver. La drogue, la toxicomanie, la consommation exagérée d’alcools vont constituer des échappatoires possibles : la figure romanesque créée par Huysmans, Des Esseintes, fuira dans les liqueurs. Thomas De Quincey évoquera les “mangeurs d’opium” (The Opiumeaters). Baudelaire lui-même goûtera l’opium et le haschisch. Ce basculement dans les toxicomanies s’explique par la fermeture du monde, après la colonisation de l’Afrique et d’autres espaces jugés vierges ; l’aventure réelle, dangereuse, n’y est plus possible. La guerre, expérimentée par Jünger, quasi en même temps que les “drogues et les ivresses”, cesse d’attirer car la figure du guerrier devient un anachronisme quand les guerres se professionnalisent, se mécanisent et se technicisent à outrance.
Autre échappatoire sans aucune positivité : l’amoralisme et l’anti-moralisme. Oscar Wilde fréquentera des bars louches, exhibera de manière très ostentatoire son homosexualité. Son personnage Dorian Gray devient criminel, afin de transgresser toujours davantage ce qui a déjà été transgressé, avec une sorte d’hybris pitoyable. On se souviendra de la fin pénible de Montherlant et on gardera en mémoire l’héritage douteux que véhicule encore aujourd’hui son exécuteur testamentaire, Gabriel Matzneff, dont le style littéraire est certes fort brillant mais dans le sillage duquel de bien tristes scénarios se déroulent, montés en catimini, dans des cercles fermés et d’autant plus pervers et ridicules que la révolution sexuelle des années 60 permet tout de même de goûter sans moralisme étriqué à beaucoup de voluptés gaillardes et goliardes.
Ces drogues, transgressions et sexomanies bouffonnes constituent autant d’apories, de culs-de-sac existentiels où aboutissent lamentablement quelques détraqués, en quête d’un “supplément d’âme”, qu’ils veulent “transgresseur”, mais qui, pour l’observateur ironique, n’est rien d’autre que le triste indice d’une vie ratée, d’une absence de grand élan véritable, de frustrations sexuelles dues à des défauts ou des infirmités physiques. Décidément, ne “chevauche pas le Tigre” qui veut et on ne voit pas très bien quel “Tigre” il y a à chevaucher dans les salons où le vieux beau Matzneff laisse quelques miettes de ses agapes sexuelles à ses admirateurs un peu torves...
Ascèse religieuse
L’alternative véritable, face au monde bourgeois, des “petits jobs” et des “petits calculs”, moqués par Hannah Arendt, dans un monde désormais fermé, où aventures et découvertes ne sont plus que répétitions, où la guerre est “high tech” et non plus chevaleresque, réside dans l’ascèse religieuse, dans un certain retour au monachisme de méditation, dans le recours aux traditions (Evola, Guénon, Schuon). Drieu la Rochelle évoque cette piste dans son Journal, après ses déceptions politiques, et rend compte de sa lecture de Guénon. Les frères Schuon sont exemplaires à ce titre : Frithjof part à la Légion Étrangère, arpente le Sahara, fait connaissance avec les soufis et les marabouts du désert ou de l’Atlas, adhère à une mystique soufie islamisée, part ensuite dans les réserves de Sioux aux États-Unis, laisse une œuvre picturale étonnante et époustouflante. Son frère, nommé le “Père Galle”, arpente les réserve améridiennes d’Amérique du Nord, traduit les évangiles en langue sioux, se retire dans une trappe wallonne, y dresse des jeunes chevaux à la mode indienne, y rencontre Hergé et se lie d’amitié avec lui. Des existences qui prouvent que l’aventure et l’évasion totale hors du monde frelaté de l’occidentisme (Zinoviev) demeure possible et féconde.
Car la rébellion est légitime, si elle ne bascule pas dans les apories ou ne débouche pas sur un satanisme de mauvais aloi, comme dans certaines sectes néo-païennes, plus ou moins inspirées par les faits et gestes d’un Aleister Crowley. Ce dérapage s’explique : la rébellion, faute de cause, devient hélas service à Satan, lorsque le mal en soi — ou ce qui passe pour le “mal en soi” — est devenu l’excitation existentielle considérée comme la plus osée. Dans un monde désenchanté, comme le nôtre, livré aux plaisirs stupides et passifs fournis par les médias, ce satanisme, avec son cortège sinistre de gesticulations absurdes et infécondes, séduit des esprits faibles, comme ceux qui traînent, par puritanisme mal digéré et mal surmonté, dans les salons où agit Matzneff et “passivent” ses voyeurs d’admirateurs. Ce n’est en tout cas pas l’attitude que souhaitait généraliser Brummell.
► Robert Steuckers, Forest / Flotzenberg, Vlotho im Weserbergland, mai 2001.
• Notes en sus :
1) Oscar Wilde est un auteur complexe bien éloigné de la réputation superficielle qui fut sienne. Bien plutôt qu'un apolitisme de pur esthète on trouve chez lui une veine utopiste (pacifisme, sympathie pour l'anarchisme activiste, anticonformisme libertaire) opposée au moralisme victorien (cf. « L'utopie selon Oscar Wilde », A. Lamarra, in Histoire transnationale de l'utopie littéraire et de l'utopisme, H. Champion, 2008) comme en témoigne cet essai méconnu, L'Âme de l'homme (trad. F. Weisman, éd. Moraïma, 47 rue La Fontaine, 75016 Paris ; corrigeant la traduction de 1906 : L'âme humaine disponible sur wikisource), dont voici la recension : Pour un socialisme individualiste — Il est toute une partie de l'œuvre d'Oscar Wilde qui échappe souvent au lecteur. On oublie qu'il fut un exceptionnel chroniqueur de mode, comme en témoignent ses 2 lettres au directeur de la Pall Mall Gazette (1884) ou au Daily Telegraph (1891) ou encore ses textes sur la décoration d'intérieur où il se fait le digne héritier du Poe de La Philosophie de l'ameublement. Il ne faut pas oublier non plus ses essais sur la réforme pénitentiaire ou les conditions de vie des enfants dans les prisons. Et les questions sociales ne le laissèrent pas indifférent. C'est en 1891, dans la Fortnightly Review, qu'il publia The Soul of Man under Socialism, dont les éditions Moraïma nous ont proposé l'an dernier une traduction sous le titre de L'Âme de l'homme. C'est un texte d'une générosité telle qu'elle frise l'utopie, mais « le Progrès est le résultat de la réalisation des utopies ». Ce que préconise Wilde, c'est un socialisme individualiste, même si certains passages, sur la plus-value que dégage le machinisme, par ex., rejoignent les idées de Marx. Pour Wilde, il ne s'agit ni d'avoir, ni d'exister, mais de vivre. L'abolition de la propriété, du mariage, des gouvernements (« Le pouvoir avilit », écrit-il ; pour Flaubert, c'étaient les honneurs), la mise en commun des moyens de production et la libération de l'homme du joug des machines, qui doivent être leurs esclaves, et non l'inverse, permettront à l'homme de s'épanouir. En supprimant les châtiments, on supprimera les criminels. N'est-ce pas Alphonse Allais qui prônait l'extinction du paupérisme passé 7 heures du soir ? Mais Wilde n'est pas un humoriste. Ses réflexions sur l'Art, la Presse ou la charité publique sont loin d'être obsolètes. Celles sur la portée révolutionnaire du véritable christianisme éclairent, de surcroît, sa pensée religieuse. Ces quelques dizaines de pages, d'une intelligence éblouissante, malgré quelque irréalisme, valent d'être méditées. Un véritable artiste, esthète de surcroît, nous parle d'un monde où nous vivons et y propose quelques modifications. (Bernard Delvaille, Magazine Littéraire n°343, mai 1996).

◘ Pistes de lecture :
♦ Articles
- Matzneff, le dandy lucide (C. Gérard)
- Qu’est-ce que le dandy ? (P. Le Vigan)
- Le dandy, une figure de l’hystérie (N. Rivière)
- « Le nouveau savoir-vivre » (A. Montandon)
- « Dandys et orgies » (S. Thorel-Cailleteau)
- « La figure du dandy » (P. Bollon) in Magazine littéraire n°273 (Baudelaire), 1990
- « Arrivisme, snobisme, dandysme» (J. d'Ormesson) in Revue de métaphysique et de morale 4/1963
- « Dandysme et Mysticisme : de la subversion et de la conformité », P. D. Laude, Symposium, Syracuse, Vol. XLV, no 1, printemps 1991
♦ Études littéraires :
- Le Mythe du dandy, É. Carnassus, A. Colin, 1971
- Le Dandysme en France (1817-1839), J. C. Prévost, Droz, 1957
- Le Dandysme, P. Favardin & L. Bouëxière, Manufacture, 1988
- Le Dandysme, obligation d'incertitude, F. Coblence, PUF, 1988
- L'Honnête homme et le dandy, A. Montandon (dir.), Gunter Narr Verlag, 1993
- Baudelaire et la religion du dandysme, E. Raynaud, Mercure de France, 1918
- La Grandeur sans convictions : essai sur le dandysme, MC Natta, Félin, 1991
- Brummell, ou le prince des dandys, J. de Langlade, Pr. de la Renaissance, 1985
- Le Mouvement décadent : Dandys, esthètes et quintessents, N. Richard, Nizet, 1968
- Le Dandysme de Baudelaire à Mallarmé, M. Lemaire, Pr. de l'Univ. de Montréal, 1978
- Masculin singulier : Le dandysme et son histoire, M. Delbourg-Delphis, Hachette, 1985
- Le Mouvement esthétique et décadent en Angleterre : 1873-1900, AJ Farmer, Champion, 1931
- Philosophie du dandysme : une esthétique de l'âme et du corps, D. Salvatore Schiffer, PUF, 2008
- Le Dandysme et la crise de l'identité masculine à la fin du XIXe siècle : Huysmans , Pater, Dossi, D. Tacium, Montréal, 1998 [pdf]
- Le dandysme et la mort à travers l'œuvre de Julien Gracq, [partie I / partie II]
♦ Sites

pièces-jointes :
◘ Si Barbey d'Aurevilly ressuscitait, que penserait-il des nouveaux Brummell ?
 Si vous croisez dans une rue de Paris un jeune homme en jean slim, chemise blanche et veste en velours, foulard noué autour du cou, vous penserez peut-être avoir rencontré un dandy. Rien n'est moins sûr. L'éphèbe n'est sans doute qu'un avatar du « minet du drugstore » des années 1960, un fils de famille soucieux de sa mise. Rien de plus.
Si vous croisez dans une rue de Paris un jeune homme en jean slim, chemise blanche et veste en velours, foulard noué autour du cou, vous penserez peut-être avoir rencontré un dandy. Rien n'est moins sûr. L'éphèbe n'est sans doute qu'un avatar du « minet du drugstore » des années 1960, un fils de famille soucieux de sa mise. Rien de plus.
Qu'est-ce qu'un vrai dandy ? En existe-t-il encore aujourd'hui ? L'urgence de la question vous avait peut-être échappé. Mais savez-vous qu'on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance de Jules Barbey d'Aurevilly, l'auteur Du dandysme et de George Brummell ? Le concept est flou, mais le mot reste séduisant. Le Bon Marché Rive Gauche ouvre demain une galerie store dénommée « Arty dandy ».
« Le dandysme n'est pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle », affirmait Charles Baudelaire, « ces choses ne sont pour le parfait dandy qu'un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit ». Le poète sait de quoi il parle, il est officiellement le premier dandy français. La mouvance est née à Londres vers 1800, incarnée par George Brummell puis lord Byron, ensuite par Oscar Wilde.
Elle ne se laisse pas définir facilement. Pour en cerner les contours, on peut lire l'essai de Barbey d'Aurevilly sur le Beau Brummell, ou encore Le Dandy, de Charles Baudelaire. Encore mieux, se plonger dans des romans, tels Le Portrait de Dorian Gray de Wilde ou À rebours de Joris-Karl Huysmans. Dans ce dernier, le héros, Jean Des Esseintes (inspiré par le bien réel comte Robert de Montesquiou-Fezensac), dégoûté de la société, hume avec ennui des parfums rares et recherche des stimulants artificiels dans un décor sophistiqué. Les traits majeurs du dandysme sont alors fixés pour longtemps : originalité, oisiveté, élégance du vêtement qui se veut reflet d'une distinction de l'esprit, narcissime, goût de l'instant, insolence voire provocation, plaisanterie avec la mort.
Style de vie
« J'ai mis mon génie dans ma vie, je n'ai mis que mon talent dans mes œuvres », lance Oscar Wilde, résumant l'attitude du dandy dans une boutade qui vaut mieux que beaucoup de commentaires éclairés. Car c'est bien de vie qu'il s'agit, de style de vie. Le dandy est un indépendant, il aime mieux étonner que plaire (« Il déplaisait trop généralement pour ne pas être recherché », disait l'écrivain anglais Edward Bulwer-Lytton à propos de Brummell). Il ne possède presque rien, ne s'intéresse pas au pouvoir, n'aspire même pas à l'argent comme à une chose essentielle. « Un crédit indéfini pourrait lui suffire », rappelle Baudelaire. Il vit dans son appartement, parfois à l'hôtel, achète surtout des vêtements et des parfums, invite des amis au restaurant, parle et boit dans les cafés. Ou alors reste dans sa chambre, drapé dans le confort de son orgueilleuse solitude.
Après la mort d'Oscar Wilde en 1900, peu d'hommes pourront se targuer d'être des dandys pur jus, capables de ressembler à ce héros du XIXe siècle finissant. Comme son personnage le baron de Charlus, Marcel Proust traversa à un moment de sa vie une période dandy. En témoigne le portrait peint par Jacques-Emile Blanche, où il figure en habit du soir, camélia à la boutonnière, cravate argentée autour du cou. De son côté, Jean Cocteau, trop soucieux de plaire, ne rentre pas vraiment dans la catégorie. Un dandy n'a pas le mauvais goût de se faire élire à l'Académie française.
Nouvelle définition
Le beau Pierre Drieu la Rochelle représente au contraire la quintessence du genre, jusque dans sa mort. Le suicide hante en effet la vie de nombreux dandys. Le film de Louis Malle tiré d'un de ses livres, Le Feu follet, est d'ailleurs la chronique d'un suicide annoncé. L'acteur Maurice Ronet y incarne si bien le personnage d'Alain Leroy que certains ont cru qu'il avait connu exactement la même fin. Rarement recensé officiellement comme dandy, l'acteur à l'élégance très Saint-Germain-des-Prés mérite de rentrer dans la famille. Tout comme l'auteur-compositeur Serge Gainsbourg, qui s'est suicidé à sa façon, en se consumant lentement. Le journaliste Alain Pacadis fait partie de la mouvance nocturne, incarnée désormais (en plus « soft ») par Frédéric Beigbeder et Ariel Wizman, lointains héritiers de Francis Scott Fitzgerald. Le chanteur anglais Pete Doherty reprend ce flambeau de l'autodestruction chic.
Point n'est besoin cependant de flirter avec la mort pour être un dandy. Une nouvelle définition, affranchie du corset noir des premiers temps, a vu le jour au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Le dandy est désormais avant tout un homme qui crée sa propre élégance de vie, sans se soucier du mieux-disant culturel du moment. Ce club comprend des membres aussi divers que l'écrivain Roger Nimier, le baron Alexis de Redé, le peintre Balthus, le duc de Windsor, le cinéaste Pier Paolo Pasolini, les musiciens britanniques Morrissey ou Bryan Ferry.
Qui mérite encore le titre de dandy en 2008 ? L'héritier Lapo Elkann, le musicien Jarvis Cocker, le designer Hedi Slimane, le chanteur Rufus Wainwright ? À quoi bon continuer à mettre la liste à jour ? Le mot semble usé. Le producteur et musicien Bertrand Burgalat, étiqueté dandy du siècle (malgré lui, « ce sont les autres qui vous collent une étiquette : punk, dandy... »), se méfie : « Le dandy est un terme revenu à la mode en France il y a dix ans par le biais du magazineTeknikart, qui l'opposait au branché, celui qui attend une autorisation ». D'ailleurs, il ne se baptiserait pas lui-même dandy.
Le dandysme est-il pour autant moribond ? Certainement pas. Tout simplement parce qu'il reste un idéal de vie unique en son genre. Il ne ressemble plus exactement à celui de Baudelaire ou de Wilde, mais n'en demeure pas si éloigné. Paradoxe...
« Ce qui fait le dandy, c'est l'indépendance », affirmait Barbey d'Aurevilly dans son opuscule précurseur. C'est toujours vrai. Ajoutez à cette forme de liberté une dose de raffinement dans la mise, quelle qu'elle soit (on peut être aujourd'hui dandy en jean et baskets). Saupoudrez le tout d'une certaine distinction d'esprit, vous avez la version moderne du dandy : un esthète de l'âme et du corps.
► Nicolas Iven, Les Échos 3/03/08 ©.

◘ Le dandysme dans les méandres de la représentation
 [Ci-contre : gants ayant appartenu à Barbey d'Aurevilly, chevreau blanc et broderie rouge, XIXe siècle. Musée de Saint-Sauveur-le-Vicomte]
[Ci-contre : gants ayant appartenu à Barbey d'Aurevilly, chevreau blanc et broderie rouge, XIXe siècle. Musée de Saint-Sauveur-le-Vicomte]
Si l'étiquette consiste dans l'ensemble codifié des règles de la politesse, l'usage qu'en fait le dandy est celui d'un détournement paradoxal qui usurpe individuellement un fonctionnement collectif. En cela, en posant sa propre loi, il introduit une dérégulation dans le fonctionnement social, une règle déréglante, posant la convenance de l'inconvenance et une domination sans intégration. Cette radicale volonté d'indépendance (« autrement, il y aurait une législation du Dandysme et il n'y en a pas ») va à l'encontre du tabou social de l'amoindrissement du Moi en faisant de la fatuité l'un des beaux arts. Cette affectation, qualité des plus négatives pour un La Bruyère (« un fat est celui que les sots croient un homme de mérite ») qui écrit notamment : « Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pourpoint à ailerons, des chausses à aiguillettes et des bottines ; il rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le jour qui suit », devient une notion fort positive pour le dandysme. L'originalité qui impose un narcissisme déclaré est signe de supériorité. Jules Barbey d'Aurevilly se définit comme le « fruit de cette vanité qu'on a trop flétrie » et Balzac fait de l'élégance « un habile développement de l'amour-propre ». La fatuité devient un idéal de puissance et d'éminence.
« Il n'y a plus à proprement parler, des fats, de ces fats transcendants. qui brillaient dans la société, dictaient des lois sur la parure et les modes, subjuguaient les femmes, imposaient aux hommes, dont la jeunesse s'empressait de copier les manières & d'imiter le ton » écrit Raisson dans son Code civil, Manuel complet de politesse (1828). La fatuité est un signe de supériorité sur les femmes comme on le voit avec Henri de Marsay dans La Fille aux yeux d'or de Balzac : « Les fats sont les seuls hommes qui aient soin d'eux-mêmes ». « Crois-tu que ce ne soit rien que d'avoir le droit d'arriver dans un salon, d'y regarder tout le monde du haut de sa cravate ou à travers un lorgnon et de pouvoir mépriser l'homme le plus supérieur s'il porte un gilet arriéré ? ». Dans la comédie vaudeville de Scribe & de Courcy Simple histoire de 1826, un personnage, lord Frédéric, s'exclame : « Fat !... c'est un mot français qui veut dire homme aimable, un homme aimé des dames ; mais aussi je trouve l'expression originale et je fais gloire d'être fat ».
La fatuité comme affirmation d'une suprématie crée un art de la distance et de l'écart. Le dandy s'éloigne physiquement et moralement de ses semblables en jouant l'altérité extrême. « La poignée de mains toujours trop fréquente avilit le caractère » dit Baudelaire. Il faut « fermer cette main trop souvent ouverte » (J. Barbey d'Aurevilly). Le gant dans l'étiquette vestimentaire représente cette barrière. « Beaucoup d'amis, beaucoup de gants » (Baudelaire).
Brummell, selon la légende, employait 4 artistes, 3 pour la main, 1 pour le pouce, afin de fabriquer ces gants qui lui moulaient les mains comme une mousseline mouillée en prenant le contour des ongles. Gants mouillés de Byron, gants fauves de lord Seymour, gants roses de Baudelaire, gants gris de Wilde, gants couleur paille de Beauvoir, gants blattes de Jules Barbey d'Aurevilly... que de sens divers dans cette signalétique minutieuse qui a la puissance d'un rituel !
Excentrique (et non marginal), le dandy rêve en autocrate d'une société dont il pose seul la règle — et le rêve oriental vient alimenter ce fantasme, chez Balzac, chez Gautier, etc. L'Orient, ou plutôt une certaine image de l'Orient, située parfois en plein Paris, permet de caresser l'idée d'un système de règles d'interactions sociales radicalement autres et où tout s'organise minutieusement autour de ce Moi tout-puissant dans un système de relations totalement asymétriques de maître à esclave. Le paradoxe apparaît là encore entre l'idée d'une liberté absolue et le besoin irrépressible d'un système de règles, indispensables en raison de l'admiration secrète de la règle parce qu'elle représente non seulement l'arbitraire mais dans son formalisme l'impératif catégorique des conditions a priori de la Beauté. Tout se passe comme si l'intériorisation de la Loi ne pouvait se faire chez le dandy que dans la suppression de l'autre, dans cette dialectique du dandy et du bâtard, du père perdu intériorisé dans l'image de son miroir. Nul étonnement alors à ce qu'il défie toute règle, puisqu'il impose dans un salto mortale toujours renouvelé la sienne propre.
L'étiquette est aussi un moyen d'accès à se donner des origines — non pas l'étiquette dans son contenu, mais l'étiquette dans son existence. Le dandy ne cesse, comme on le voit dans des exemples bien trop nombreux pour être cités ici (pensons à un de Marsay, aux dandys de Jules Barbey d'Aurevilly, ou à M. de Bougrelon de Jean Lorrain), de se chercher nostalgiquement des origines. Nous ne voulons pas nous lancer dans une entreprise d'interprétation psychanalytique du dandy qui serait ici aussi hasardeuse qu'intempestive, mais signaler certains modes de fonctionnement qui expliquent que, face à la dilapidation excessive et à la temporalité explosive et émiettée de ce météorite, l'étiquette offre le seul mode possible pour qu'intervienne une règle dans cette création instantanée et renouvelée à chaque instant...
L'idole qui se construit comme œuvre d'art dans l'isolement et le vertige de l'amour-propre recherche une inaccessibilité qui le rapproche du courtisan en ce que celui-ci, chez Castiglione comme chez Gracián, maintient une zone de réserve, de liberté intérieure nécessaire à sa stratégie sociale et, en même temps, indispensable au fonctionnement de l'étiquette. Le dandy va cependant plus loin dans sa tendance à la mystification, dernier recours possible dans ce XIXe siècle. L'insolence serait-elle devenue désormais la seule manière possible d'être poli en restant soi ?
Du dandy au snob
Le dandy est, nous semble-t-il, le dernier grand modèle et Baudelaire avait raison en voyant en lui l'ultime représentant du modèle ancien régime, et les nouveaux dandys du XXe siècle (1) que nous évoquerons rapidement trouvent sans doute dans le raffinement de l'habit ou le masque du déguisement une compensation. Mais ce dandysme de masse, « sorte d'équivalent du poulet aux hormones » (pour reprendre l'expression de Rose Fortassier) — qu'il relève du genre impeccable, comme les sapeurs sapés zaïrois ou congolais ou ces rockers qui arborent au métro Saint-James à Londres des jeans et des tee-shirts irréprochables, mais avec des visages de cire assez pervers et inquiétants (2), ou qu'il relève du genre débraillé de ces autres dandys de carnaval des banlieues chaudes, « épingles de nourrice dans Ies joues, lames de rasoir en guise de boucles d'oreilles, cheveux en cimier bariolé de casque » — s'il est chargé de signes, « langage pour ceux qui n'en ont pas ou qui s'en méfient », n'a plus rien à voir, en dépit des nomenclatures hâtives (3), avec le dandysme avec lequel il n'a plus en commun que quelques vagues ressemblances superficielles.
On a vu combien ce modèle était unique. Brummell seul peut en revendiquer à juste titre la seule appellation controlée (4). Si le vrai dandy est d'une grande rareté, en revanche (et des esprits un peu faibles ont pu les confondre bien à tort) les snobs pullulent ! Jean d'Ormesson, dans une conférence célèbre (5) prononcée au Collège philosophique, a distingué le snobisme de l'arriviste en dénonçant chez le snob un arrivisme imaginaire, un arrivisme décalé qui recherche non Ies prestiges mais le prestige au singulier, un prestige-vestige opposé au prestige-vertige. (…)
Au snob, on pourra opposer le modèle idéal apparemment très général n'est l'homme bien éduqué. L'homme bien éduqué est celui qui sait transformer la contrainte sociale en autocontrainte. L'exemple de la famille comme milieu d'éducation est important ; c'est là le premier espace social pacifié qui impose de tarir les impulsions et les émotions. Viennent ensuite l'éducation imposée par les diverses institutions (école, lycée, groupes sociaux de toute sorte, laïcs, militaires et religieux). Tous les manuels de la fin du XIXe et du début du XXe siècle mettent l'accent sur la précocité d'un tel apprentissage. (…) L'homme bien éduqué témoigne par la stylisation et la mise en forme de sa vie quotidienne qu'il est fiable pour ses contemporains, c'est-à-dire qu'il connaît et pratique les règles du savoir-vivre et qu'il est issu d'un milieu garant de l'authenticité de son comportement.
Là encore, c'est par la distinction qu'il s'affirme, par cet écart « propre à un individu, à une famille ou à un groupe social par rapport à la norme », un style qui « est cette élaboration particulière qui confère aux gestes, au discours, à l'allure des propriétés distinctives » (É. Cordonnier, Encycoplédie pratique de la politesse et du savoir-vivre, 1930). Les règles de la bonne éducation sont le signe visible d'une différence (« véritable capital symbolique que la bourgeoisie veut s’approprier », ref. infra), mais aussi d'une appartenance. Éric Mension-Rigau dans L'enfance au château (Rivages/poches, 1990), a analysé brillamment certains mécanismes propres à l'éducation et à la mimesis familale. Car l'éducation est d'abord un ensemble de gestes, d'habitudes, de pensées, de comportement général, ce qu'on appelle habitus social, qui ne peut s'acquérir que par imprégnation du milieu et non dans l'application de règles écrites qui ont été au XIXe siècle le guide de tous les arrivistes, nouveaux riches et parvenus. (…)
La bonne éducation est synonyme de bon milieu, de bonne société (évidemment d’appartenance). Il est frappant de noter combien depuis le courtisan du début de la Renaissance jusqu’aux aristocrats en passant par un gentleman démocratique, combien la structure de ce comportement a été stable et synonyme de politesse. (…) La consideration et la reputation semblent être devenues les motifs essentiels de l’homme “bien éduqué” au XIXe siècle.
► Alain Montandon (dir.), Pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe, Clermont II, coll. « Littératures », CNL, 1994, p. 446-450. [commandable sur le site de la MSH de Clermont-Ferrand]
◘ Notes :
- 1. Cf. R. Fortassier, « Dandysme pas mort », in L'honnête homme et le dandy (Gunter Narr V., 1992)
- 2. P. Mauriès, Choses anglaises, Seuil, 1989, p. 117 ; JJ Schul, Rose poussière, Gal., 1972.
- 3. Voir à ce sujet les différentes mises au point de H. Obalk, A. Soral et A. Pasche, Les mouvements de mode expliqués aux parents, R. Laffont, 1984 ; B. Couturier, Une scène-jeunesse, Autrement, 1987 ; P. Bollon, Morale du masque, Seuil, 1990.
- 4. Et même on peut se demander si Brummell était vraiment dandy (et sa vieillesse elle-même n'est-elle pas un démenti à tout son être ?), si le dandy n'est pas avant tout un mythe impossible et irréalisable !
- 5. « Arrivisme, Snobisme, Dandysme » in Revue de Métaphysique et de Morale, 68, 1963, p. 443-459.

◘ Barbey d'Aurevilly, le réfractaire
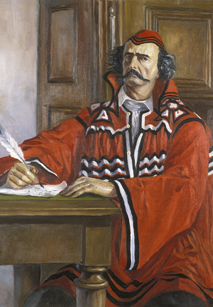 Réfractaire, du latin refractarius : indocile. Voilà qui définit à la perfection cet écrivain secret, né une nuit de Samaïn il y a 200 ans, et que le regretté Jean Mabire décrivait comme « l’incarnation d’un esprit de révolte et de défi » (Que lire ?, vol. 6).
Réfractaire, du latin refractarius : indocile. Voilà qui définit à la perfection cet écrivain secret, né une nuit de Samaïn il y a 200 ans, et que le regretté Jean Mabire décrivait comme « l’incarnation d’un esprit de révolte et de défi » (Que lire ?, vol. 6).
Jules Barbey, dit d’Aurevilly (1808-1889), d’abord républicain (pour narguer une famille aux prétentions nobiliaires et chouannes) puis défenseur du Trône et de l’Autel comme son maître Balzac. Opiomane et catholique tonitruant, dandy (ses redingotes moulantes, ses cravates précieuses, son essai sur Brummell) et pigiste désargenté ; bref, une somme de contradictions qui font l’homme authentique, celui qui ne fait jamais carrière. L’anticonformiste perdu au milieu des bourgeois goguenards, le solitaire entouré de coteries. Citons à nouveau Mabire, décidément doué : « la noblesse le déçoit, la bourgeoisie le hérisse, la populace l’écœure ». Comment ne pas être séduit par un tel énergumène qui, avec le temps, se révèle comme l’un des écrivains majeurs de son siècle, aux côtés de Baudelaire et de Gobineau, ces chantres de l’aristocratie spirituelle ?
Pour mieux connaître le « Connétable des Lettres », le lecteur se plongera sans tarder dans Les Diaboliques, son chef-d’œuvre, livre inquiétant et scabreux, d’un romantisme absolu. Et quelle langue somptueuse ! Le court essai que signe l’écrivain François Tallandier sera également bienvenu tant son auteur a compris Barbey, qu’il définit comme un réfractaire par vocation et par fatalité, celui qui, d’instinct, vomit la sirupeuse doxa [opinion] de son temps et qui, en fin de compte, refuse de « baiser le sabot de l’âne » — pour citer un autre rebelle, Charles de Coster.
Avec une sympathie non dénuée d’esprit critique, Tallandier a relu cet irrécupérable, antimoderne résolu autant que lucide : « les économistes effarés devant cet abîme du désir forcené de la richesse, qui se creuser de plus en plus dans le cœur de l’homme, et ce trou dans la terre qui s’appelle l’épuisement du sol ». Précurseur de la décroissance, Barbey apparaît aussi — à l’instar de Mistral — comme celui du réflexe identitaire, qui résiste à tout nivellement. En témoigne son attachement — paradoxal chez ce Parisien — à un Cotentin resté très païen. Explorateur des gouffres de l’Éros noir, Barbey a beau poser au sacristain : il scandalise les catholiques (« les vipères de vertu ») comme il horrifie les mécréants, mettant un point d’honneur à déplaire autant aux moisis qu’aux écervelés. Un libertin, qui se détache de son siècle avec superbe, les moustaches en broussaille et la cravache à la main. Le chantre des singularités proclamées comme des secrets inavouables. Un maître pour les indociles de demain.
♦ François Tallandier, Barbey d’Aurevilly, le réfractaire, Bartillat, 2008, 15 €.
► Christopher Gérard.

« Être un grand homme et un saint pour soi-même, voilà l'unique chose importante »
(Mon cœur mis à nu)
 Si le dandysme est « le fruit de la vanité », il partage avec elle une royauté fascinante et capricieuse. « Cette recherche inquiète de l'approbation des autres, cette inextinguible soif des applaudissements de la galerie est une reine aussi, comme l'orgueil est roi » (J. Barbey d'Aurevilly, Du Dandysme, p. 22) (1). La vanité, dont l'utilité sociale ne saurait être exagérée dans l'ordre des sentiments, est « entourée, occupée, clairvoyante, et son diadème est placé là où il embellit advantage » (ibid.). La gloire, dont rayonnent les grands hommes, est comme l'éclat sans cesse ravivé de la toute puissante vanité. Mais, faute d'admirer l'éclat de la beauté et le rayonnement de la distinction dans l'apparence souveraine, les petits esprits médisent de la vanité comme ils méconnaissent et travestissent le dandysme : ils ont imaginé que « le Dandysme était surtout l'art de la mise, une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d'élégance extérieure » (ibid., p. 29) ; or il est bien davantage : c'est toute une manière d'être, entièrement composée de nuances, comme il arrive toujours dans les sociétés très vieilles et très civilisées, où la comédie devient si rare et où la convenance triomphe à peine de l'ennui » (ibid.).
Si le dandysme est « le fruit de la vanité », il partage avec elle une royauté fascinante et capricieuse. « Cette recherche inquiète de l'approbation des autres, cette inextinguible soif des applaudissements de la galerie est une reine aussi, comme l'orgueil est roi » (J. Barbey d'Aurevilly, Du Dandysme, p. 22) (1). La vanité, dont l'utilité sociale ne saurait être exagérée dans l'ordre des sentiments, est « entourée, occupée, clairvoyante, et son diadème est placé là où il embellit advantage » (ibid.). La gloire, dont rayonnent les grands hommes, est comme l'éclat sans cesse ravivé de la toute puissante vanité. Mais, faute d'admirer l'éclat de la beauté et le rayonnement de la distinction dans l'apparence souveraine, les petits esprits médisent de la vanité comme ils méconnaissent et travestissent le dandysme : ils ont imaginé que « le Dandysme était surtout l'art de la mise, une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d'élégance extérieure » (ibid., p. 29) ; or il est bien davantage : c'est toute une manière d'être, entièrement composée de nuances, comme il arrive toujours dans les sociétés très vieilles et très civilisées, où la comédie devient si rare et où la convenance triomphe à peine de l'ennui » (ibid.).
C'est pourquoi le dandysme apparaît essentiellement comme la forme anglaise de la fatuité, car « nulle part l'antagonisme des convenances et de l'ennui qu'elles engendrent ne s'est fait plus violemment sentir au fond des mœurs qu'en Angleterre, dans la société de la Bible et du droit » (ibid.). Le dandysme est un jeu paradoxal, jeu de l'audace et de la retenue, de la convenance et de la provocation, de la règle et du caprice ; le dandy étonne et séduit tout à la fois : il transgresse les règles moins pour les annuler que pour les accomplir. Il supprime moins la règle qu'il ne la déplace sans cesse en la réinventant.
« Par la plaisanterie qui est un acide et par la grâce qui est un fondant, (les dandys) parviennent à faire admettre cette règle mobile, qui n'est, en fin de compte, que l'audace de leur propre personnalité » (ibid., p.40).
Le dandy parvient à réaliser un point d'équilibre mobile entre la tradition et la nouveauté, la rigueur et la fantaisie, faute duquel la recherche sombrerait dans l'arbitraire pur et l'audace finirait en inutile provocation. Ce point d'équilibre mobile est la distinction, qui désigne à la fois « la différence, par quoi le dandy se fait remarquer, et la simplicité, où s'abolissent toutes les dissonances (2). «Tout dandy est un oseur, mais un oseur qui a du tact, qui s'arrête à temps et qui trouve, entre l'originalité et l'excentricité, le fameux point d'intersection de Pascal » (ibid., p. 50).
Si le dandysme est la forme anglaise de la fatuité, il n'est pas cependant un pur phénomène de société, une curiosité étroitement localisée ; si la vanité est universelle, le dandysme a « sa racine dans la nature humaine de tous les pays et de tous les temps » (ibid., p. 81). À ce titre, il n'est pas un phénomène transitoire et secondaire, mais il joue dans toute société un rôle nécessaire. Les Dandys « entrent dans le bonheur des sociétés comme d'autres hommes font partie de leur moralité » et, chez eux, le caprice est un autre nom de la grâce. Le dandysme est une promesse gracieuse de bonheur et de perfection, qui charme les créatures intelligentes. Les dandys « attestent la magnifique variété de l'œuvre divine : ils sont éternels comme le caprice. L'humanité à autant besoin d'eux et de leur attrait que de ses plus imposants héros, de ses grandeurs les plus austères » (ibid., p. 78). Ces « dieux au petit pied », comme les appelle Barbey d'Aurevilly, ne veulent s'étonner de rien tout en suscitant étonnement et admiration ; ils « veulent toujours produire la surprise en gardant l'impassibilité » (ibid.), et cette distance permet à leur imagination d'explorer des formes nouvelles d'existence, dont l'humanité commune se défend en les qualifiant un peu trop rapidement de frivoles.
Dans l'essai consacré à Constantin Guys, Le Peintre de la vie moderne (1863), Baudelaire reconnaît ce paradoxe du dandy [chap. IX], dévoré du « besoin ardent de se faire une originalité » tout en demeurant « dans les limites extérieures des convenances », partagé entre « le plaisir d'étonner » et « la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné », de même qu'il évoque volontiers à son propos « les dons célestes que le travail et l'argent ne peuvent conférer » (pp. 907-908). Cependant il insiste davantage sur le caractère moral et la sublimité du dandy que sur le bonheur et la grâce qu'il promet. Le dandysme est moins, chez Baudelaire, perfection esthétique qu'aspiration éthique à l'intérieur même de la perfection visible. Les Journaux intimes le diront de manière saisissante : « Le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir » (Mon cœur mis à nu, p. 1208). Ce miroir est moins le symbole du reflet ou des mille reflets, où se mire le dandy dans sa complaisance à soi à travers l'autre, que l'exigence intérieure de lucidité et de conscience, qui fait du dandysme une manière d'être et de vivre toute idéale dans le dédoublement de soi. Le miroir, dans le dédoublement de la réflexion aiguisée, produit dans le moi un pur contrôle de soi et une présence, sans cesse plus douloureuse, à sa propre insuffisance (3). De ce point de vue, la sublimité du dandy est un autre nom de la sainteté. L'élégance de cet être quasi divin est comme l'expression esthétique de l'ascèse et la promesse du salut. L'aspiration du dandy peut donc maintenant s'exprimer dans cette règle d'or et de principe : « Avant tout, être un grand homme et un saint pour soi-même » (Mon cœur mis à nu, p. 1219). Cette formule énigmatique, qui apparaît 2 fois [la seconde p. 1222] dans Mon cœur mis à nu, soulignée chaque fois de manière différente, résume la spiritualité ou plus exactement la religion de Baudelaire ; notre tâche sera de l'élucider, en montrant que la théorie du dandysme est tout autre chose qu'une apologie de la vie mondaine et de l'élégance matérielle.
I - Du culte de la différence au culte de soi
1) - Le dandy « n'a pas d'autres profession que l'élégance » (Le Peintre de la vie moderne, p. 906), autant dire qu'il n'a pas de profession. Il dispose, « à son gré et dans une vaste mesure », du temps et de l'argent qui lui permettent d'organiser librement son existence ; le dandy, qui ne travaille pas, « n'aspire pas [non plus] à l'argent comme à une chose essentielle » (p. 907). L'amour de l'argent est un trait des natures grossières et l'exercice d'une profession est signe de servilité. « Un fonctionnaire quelconque, un ministre, un directeur de théâtre ou de journal, peuvent être quelquefois des êtres estimables, mais ils ne sont jamais divins. Ce sont des personnages sans personnalité, des êtres sans originalité, nés pour la fonction, c'est-à-dire pour la domesticité publique » (Mon cœur mis à nu, p. 1230). Comme « être divin », le dandy a une vocation. Cet « homme riche, oisif, (…) élevé dans le luxe et accoutumé dès sa jeunesse à l’obéissance des autres hommes » est le héros moderne par excellence qui « n’a pas d'autre occupation que de courir à la piste du bonheur » dans la distinction et dans la solitude (ibid.).
La solitude est essentielle au dandy (4). Elle constitue cette unité avec soi qui distingue le génie de tous les autres hommes : le dandy « veut être un, donc solitaire » (p. 1226) Il y a dans « le plaisir d’étonner » et « la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné » un goût pour la distance et la singularité, qui est signe d'élection. La mise à l'écart instaure un lieu imaginaire où le dandy peut jouir de sa propre supériorité, toute spirituelle. Ce serait en effet une erreur profonde que d'identifier purement et simplement le dandysme « avec un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle » (p. 970).
L'élégance de la mise, la distinction des manières et le luxe de la demeure aussi bien que la rigueur de l'étiquette à laquelle il se soumet ne sont, pour le véritable dandy, que « le symbole de la supériorité aristocratique de son esprit » (ibid.). Le dandy établit une barrière, qui l'isole et l'exalte, entre lui et la « canaille » ; en cultivant l'idée du beau dans sa personne, il élève une protestation désespérée contre la décadence et la corruption, contre la sottise humaine et contre la vulgarité :
« Un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. S'il commettait un crime, il ne serait pas déchu peut-être ; mais si ce crime naissait d'une source triviale, le déshonneur serait irreparable » (p. 907).
Le dandysme commence par le goût de la hiérarchie au niveau le plus humble, celui de la tenue, là où la différence fait norme dans la toilette même. Il manifeste ainsi « une gravité dans le frivole » dont il ne faut point se scandaliser, car il y a « une grandeur dans toutes les folies et une force dans tous les excès » (ibid.).
En se séparant de la foule, le dandy sait bien qu'il s'expose à sa haine et à sa méchanceté. L'élection est un signe de contradiction et de malédiction : « Quand j'aurai inspiré le dégoût et l'horreur universelle, j'aurai conquis la solitude » note Baudelaire dans Fusées (p. 1199) et cet aveu peut s'appliquer au dandy. La solitude est une conquête dont le poids est lourd à porter. Les terribles imprécations, que Bénédiction applique au Poète, valent pour tout être choisi et expriment admirablement l'expérience aristocratique de la solitude.
Il joue avec le vent, cause avec le nuage,
Et s'énivre en chantant du chemin de la croix ;
Et l'Esprit qui le suit dans son pèlerinage
Pleure de le voir gai comme un oiseau des bois.Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte,
Ou bien, s'enhardissant de sa tranquillité,
Cherchent à qui saura lui tirer une plainte,
Et font sur lui l'essai de leur férocité.Dans le pain et le vin destinés à sa bouche
Ils mêlent de la cendre avec d'impurs crachats ;
Avec hypocrisie ils jettent ce qu'il touche,
Et s'accusent d'avoir mis leurs pieds dans ses pas.
Dans un monde livré à l'animalité triomphante, la condition du poète préfigure celle de tout homme bien né.
2) - Le dandysme est certes de tous les temps, mais il se manifeste plus particulièrement dans ces époques indécises et troublées où, la fatalité paraissant suspendue, semble soudain possible une espèce nouvelle d'aristocratie, fondée « sur les facultés les plus précieuses et les plus indestructibles, et sur les dons célestes que le travail et l'argent ne peuvent conférer » (p. 908). C'est dans « les époques transitoires », quand « la démocratie n'est pas encore toute puissante » et « l'aristocratie n'est que partiellement chancelante et avilie », que le dandysme apparaît « en quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais tous riches de force native », élus et prédestinés par les puissances célestes, qui les marquent au front. Le dandysme, signe de déclin et symptôme de décadence, est en même temps protestation héroïque contre l'inévitable.
Mais le pessimisme de Baudelaire le laisse sans illusion : « la marée montante de la démocratie qui envahit tout et qui nivelle tout » ne peut pas être endiguée ; elle va tout emporter et tout submerger. Les temps sont proches où la mécanique et le progrès nous auront si bien « américanisés », auront si bien « atrophié en nous la partie spirituelle, que rien parmi les rêveries sanguinaires des utopistes ne pourra être comparé aux ré résultats positifs de la civilisation » qui se prépare (Fusées, p 1203). Dans un monde livré à « l'animalité générale », les gouvernements « seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme d'ordre de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie » (p. 1204). On sait que les insultes grossières adressées à la « pauvre Belgique », qui nous surprennent par leur violence et leur mauvais goût, expriment en fait un refus radical de la société moderne et des illusions qu'elle suscite pour se perpétuer, car, après tout, « la Belgique est ce que serait peut-être devenue la France, si elle était restée sous la main de la bourgeoisie » (Argument du livre sur la Belgique, p. 1314).
La ruine universelle, qui n'est rien d'autre que le progrès universel, se manifeste moins par la destruction des institutions que par « l'avilissement des cœurs » (Fusées, p. 1203). L'homme moderne est déjà corrompu, radicalement corrompu dans son esprit et dans son corps : « nous avons tous l'esprit républicain dans les veines, comme la vérole dans les os, nous sommes démocratisés et syphilisés » (Argument du livre sur la Belgique, p. 1315). Baudelaire revendique du moins pour l'homme authentique la conscience du mal et dans le mal. « Moi, quand je consens à être républicain, je fais le mal en le sachant » (ibidem, p. 1315) (5).
Le dandy cependant n'a rien du réformateur social, encore moins du meneur de foules et du conducteur de peuples ; il consent simplement parfois à jouer, sans grande illusion, le prophète de malheur que personne n'écoute. Il ne s'adresse à la canaille, dans le discours indirect et silencieux de l'ironie, que pour lui faire honte de sa vulgarité. « Le Dandy ne fait rien. Vous figurez-vous un Dandy parlant au peuple, excepté pour le bafouer » (Mon cœur mis à nu, p. 1213). Bafouer le peuple par l'ironie qu'il ne peut comprendre et qui est la marque du seul génie, ou, comme ferait le Saint dans un mouvement de juste colère, le fouetter pour le corriger et le transformer, ce sont les seules formes de communication qui ne rendent pas l'homme commun. Si « le vrai héros s'amuse seul, le monde hélas est fait de gens qui ne peuvent penser qu'en commun, en bandes. Ainsi, les Sociétés belges » (Mon cœur mis à nu, p. 1211). Cette distance cependant est moins une forme de mépris qu'une forme supérieure d'amour et de pitié.
3) - La formule par laquelle R. Kemp définit le dandysme — « un culte de la différence dans le siècle de l'uniforme. Et une denunciation » (p. 9) —, est donc rigoureusement exacte : elle nous invite à préciser plus vigoureusement la portée politique et spirituelle du dandysme baudelairien. Le dandysme ne refuse pas seulement « ce qu'il y a de vil dans une fonction quelconque » (Mon cœur mis à nu, p. 1213), l'utilitarisme (la société bourgeoise où l'homme s'identifie à sa profession et où toute profession tend vers le commerce, cette activité satanique parce que naturelle, il refuse plus énergiquement que tout l'idéal d'une société égalitaire. en lequel il voit la forme suprême de la dépravation politique, morale et esthétique. « L'homme, c'est-à-dire chacun, est si naturellement dépravé qu'il souffre moins de l'abaissement universel que de l'établissement d'une hiérarchie raisonnable » (Fusées, p. 1203) : pour qu'aucune hésitation ne soit possible sur sa pensée véritable, il ajoute plus loin : « Il n'y a de gouvernement raisonnable et assuré que l'aristocratique. Monarchie ou république basées sur la démocratie sont également absurdes et faibles » (Mon cœur mis à nu, p. 1213) (6). La société démocratique favorise « l'infamie de l'imprimerie, ce grand obstacle au développement du beau » ; la « canaille littéraire » flatte, grâce à la presse, le mépris du peuple pour l'art et son goût du mensonge (ibid., p. 1231). Le journal est comme le symbole et l'expression de cette veulerie de la société moderne que Baudelaire vomit :
« Tout journal, de la première ligne à la dernière, n'est qu'un tissu d'horreurs. Guerres, crimes, vols, impudicités, tortures, crimes des princes, crimes des nations, crimes des particuliers, une ivresse d'atrocité universelle. Et c'est de ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé accompagne son repas de chaque matin. Tout, en ce monde. sue le crime : le journal, la muraille et le visage de l'homme » (Mon cœur mis à nu, p. 1231).
Le dandysme est le dernier éclat d'une société aristocratique qui se décompose irrémédiablement, « un soleil couchant, l'astre qui décline, superbe, mus chaleur et plein de mélancolie » (Le Peintre de la vie moderne, p. 908). La politique baudelairienne est plus exactement une méta-politique où l'influence de J. de Maistre, l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg et du Pape (7), se fait sentir de manière significative. C’est ici, mais en d'autres lieux encore, que prend tout sens l'aveu de notre auteur : « De Maistre et Edgar Poe m'ont appris à raisonner » (Mon cœur mis à nu, p. 1234).
En effet, si les affirmations baudelairiennes comme les affirmations maistriennes ont bien évidemment une signification politique, puisqu'elles imitent à rejeter la société démocratique au nom d'une conception aristocratique de l'existence, ce refus de la société moderne, bourgeoise (8) et utilitaire, est méta-politique, en ce qu'il inscrit chez l'un comme chez l'autre, à l'intérieur d'une conception métaphysique et religieuse de la civilisation, elle-même inspirée par un christianisme mystique, tout à la fois réel et hétérodoxe (9). Le dogme du Progrès universel et mécanique de la civilisation, que les réussites matérielles de la technique semblent imposer, est « une doctrine de paresseux, une doctrine de Belges » (ibid., p. 1210).
L'individu s'en remet à l'autre, alors que la loi du progrès ne peut subsister sans l'effort de l'individu, de chaque individu : « quand tous les individus s'appliqueront à progresser, alors, et seulement alors, l'humanité sera en progrès » (ibid., p. 1232 ). Si l'individu s'en remet si facilement à l'autre et renonce à sa responsabilité, c'est que sa volonté est cassée, retournée contre elle-même, souillée par une faute plus primitive que toute faute personnelle, naturellement corrompue par « le péché originel ».
Ainsi, la vraie civilisation « n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel » (ibidem, p. 1224). C'est ce qui rend Baudelaire d'une lucidité si douloureuse et d'un scepticisme grandissant sur les chances du progrès de la civilisation : en conclusion de son analyse des Misérables, il s'écriera : « Hélas ! du Péché Originel, même après tant de progrès depuis si longtemps promis, il restera toujours bien assez de traces pour en constater l'immémoriale réalité ! » (p. 1149).
Car l'individu, dont dépend le progrès vrai, c'est-à-dire moral, reste éternellement divisé d'avec lui-même, Le cœur de l'homme est l'enjeu d'une lutte entre les deux principes qui l'ont choisi pour principal champ de bataille, la chair et l'esprit, l'enfer et le ciel, Satan et Dieu (Richard Wagner et Tannhäuser, p. 1060) ; la dualité irréductible de l'homme rend impossible toute réconciliation définitive et fait du Salut un vœu, une promesse et non une réalité effective. Dieu est « le véritable sens de la vie, le but de l'universel pèlerinage » (ibidem, p.1060), mais, en cette vie du moins, le « sens intime de Dieu est noyé par les concupiscences de la chair », la sainteté est « submergée par les soupirs de la volupté » (p. 1061). L'individu se débat dans l'ambiguïté et les contradictions, qu'il est impuissant, éternellement impuissant (?) à résoudre :
« Il y a dans tout homme à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu ou spiritualité, est un désir de monter en grade ; celle de Satan, ou animalité, une joie de descendre » (Mon cœur mis à nu, p. 1211).
La simultanéité de ces 2 postulations marque la grandeur et la misère de l'homme, grandeur de l'homme qui s'exprime dans une aspiration infinie vers le bien, misère de l'homme qui se marque dans son infinie faiblesse et sa perversité. Analysant l'essence du rire, « satanique et donc profondément humain » (De l'essence du rire, p. 716), Baudelaire observera : « L'humanité s'élève, et elle gagne pour le mal et l'intelligence du mal une force proportionnelle à celle qu'elle a gagnée pour le bien » (ibidem, pp. 717-718).
Le dandy n'échappe pas à cette condition (10), mais il abandonne les passions grossières aux mortels vulgaires : « les conditions matérielles compliquées auxquelles ils se soumettent, ... ne sont qu'une gymnastique propre à fortifier la volonté et à discipliner l'âme » (Le Peintre de la Vie moderne, p. 907) ; le culte de la différence et de l'originalité est un culte de soi et des passions nobles, qui peut survivre à toute désillusion. Le dandy recherche l'indépendance dans une sorte d'auto-idolâtrie désespérée. La formule anglaise, self-purification and anti-humanity, citée dans Fusées (p. 1198), donne la clef du personnage. Le culte de soi comme purification de tout ce qui, dans le moi, est péché, c'est-à-dire nature et corruption du mal, donne une portée métaphysique et religieuse au culte politique de la différence.
II - Le refus de la nature et le goût de l'artifice
1) « L'éternelle supériorité du dandy » réside dans sa spiritualité : très exactement le dandysme est « une espèce de religion ». Il représente ce qu'il y a de meilleur dans le mouvement de l'orgueil humain : un effort toujours repris pour « combattre et détruire la trivialité » (Le Peintre de la Vie Moderne, p. 908). Certes, il y a quelque chose de frivole et de vain chez le dandy, mais il y a une gravité dans cette frivolité. Le dandy règne dans le monde, sur le beau monde, en imposant tyranniquement de petites choses : il s'impose souverainement par des riens ; mais ces « petits riens », dans leur insignifiance même, signifient la primauté absolue du Rien, la supériorité éthique de l'imaginaire sur le réel et de l'idéal sur la vie. La fascination de la mort, obsédante dans les derniers poèmes des Fleurs du Mal, ne résulte pas d'un jeu gratuit ; elle exprime le sentiment intime du poète : « C'est la mort qui console, hélas ! et qui fait vivre » (p. 195). La mort qui console et qui fait vivre, la Mort des Pauvres, est la mort de l'homme tout simplement, celle qui, par delà le néant et le vide, est « le portique ouvert sur les Cieux inconnus » (p. 196). Il y a chez Baudelaire, une véritable Obsession du néant, comme en témoignent les vers suivants :
Comme tu me plairais, ô nuit ! sans ces étoiles
Dont la lumière parle un langage connu !
Car je cherche le vide, et le noir, et le nu ! (p. 147)
Le vide, le noir et le nu symbolisent la négation de la matière, de la chair, de la vie, de l'être trop plein, dans lequel l'homme, séduit ou englué, est éternellement prisonnier. Mais ce qui est librement « créé par l'esprit est plus vivant que la matière » (Fusées, p. 1189). La frivolité du fat, dont parle si bien Barbey d'Aurevilly, masque, sous l'artifice de la toilette et la vanité de la belle apparence, un refus radical de la nature et de la spontanéité instinctive.
Il y a une grandeur dans toutes les folies, et le dandysme en est une, comme il y a une force dans tous les excès. Mais, paradoxalement, l'excès n'est pas ici la négation de tout équilibre, car, nous l'avons déjà signalé, le « désir ardent de se faire une originalité » est « contenu dans les limites extérieures des convenances et le plaisir d'étonner » compensé par « la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné ». L'excès se résout en un point de perfection esthétique qui voile et, en même temps, réalise la perfection morale.
Le dandy fait de sa vie une œuvre d'art qui harmonise des exigences contradictoires : la distinction qui provoque et étonne, en multipliant les signes dans un raffinement de nuances imperceptibles, se montre, en un véritable retournement, simplicité absolue au delà de toute complication, tandis que l'élégance visible des toilettes et des manières, dans et par la tension qu'elle suppose, est l'envers d'une élégance toute spirituelle, d'une délicatesse morale et intérieure au delà de « l'extase et de l'angoisse de la vie ». La grâce légère, comme symbole de la moralité, est le fruit d'un imaginaire pur, qui exhausse la nature par la vertu de l'artifice. Tout est possible au dandy hormis la vulgarité, qui est toujours naturelle. C'est en ce sens que le dandysme est une forme de spiritualisme et de stoïcisme.
La discipline compliquée et exigeante à laquelle se soumet le dandy, sans laisser paraître la moindre gêne, est l'expression d'une ascèse véritable, dont le sens n'est pas mondain. Les règles mondaines de l'étiquette ne sont pas si éloignées des prescriptions monastiques qu'on pourrait croire ; « la tenue irréprochable de toute heure du jour et de la nuit et de la nuit » et « les tours les plus périlleux du sport » (p. 907) miment la scansion régulière des heures par la prière comme les macérations du moine.
« La règle monastique la plus rigoureuse, l’ordre irrésistible du Vieux de la Montagne, qui commandait le suicide à ses disciples énivrés, n'étaient pas plus despotiques ni plus obéis que cette doctrine de l'élégance et de l'originalité, qui impose, elle aussi, à ses ambitieux et humbles sectaires, hommes souvent pleins de fougue, de passion, de courage, d'énergie contenue, la terrible formule : Perinde ac cadaver ! » (p. 908).
Les dandys sont ainsi les « prêtres et les victimes » d'un étrange culte destiné « à fortifier la volonté et à discipliner l'âme » (p. 907). Prêtres et victimes, ils accomplissent consciemment le sacrifice qui, les purifiant de toute compromission avec la nature et la spontanéité, les réintègre dans l'unité perdue. Faut-il entendre qu'en sacrifiant aux règles de l'étiquette mondaine et du savoir vivre, le dandy joue, et fait plus que jouer, le sacrifice de son instinct et de ses passions, de sa vie même, en se conformant à la loi du monde ? Cette interprétation séduisante pourrait bien s’imposer, s'il est vrai, que le dandysme est une forme de stoïcisme, et si le stoïcisme est cette religion qui connaît qu'un seul sacrement : le suicide (Fusées, p. 1201).
2) La femme est incapable de sacrifice : elle est incapable de renoncer à ses passions et à l'instinct, parce qu’elle est incapable de la conscience du mal, qui rendrait possible un tel renoncement (11). C'est pourquoi « la femme est le contraire du dandy » (Mon cœur mis à nu, p. 1207). Elle est, selon un mot de J. de Maistre que Baudelaire s'approprie, « un bel animal », c'est-à-dire la nature dans sa spontanéité éternellement multiple et changeante. La femme est naturelle, parce qu'en elle l'existence se confond avec la parfaite simplicité de l’animalité ou plus largement de la vie en général.
« La femme ne sait pas séparer l'âme du corps. Elle est simpliste, comme les animaux. — Un satirique dirait que c'est parce qu'elle n'a que le corps » (ibidem, p. 1121). C'est à ce titre, selon le mot terrible souvent répété, que la femme doit faire horreur : « la femme est naturelle, c'est-à-dire abominable » (ibidem, p. 1207). À examiner la chose de plus près cependant, et le soulignement l'indique, ce n'est pas tant la femme qui doit faire horreur que la nature en elle. La formule dans sa violence doit être renversée : la femme est abominable parce qu'elle est naturelle. Le blasphème vise moins la femme, adorée ou profanée, que ce qu'elle symbolise : la nature corrompue.
Sur ce point, aucune hésitation n'est possible : l'essai sur Constantin Guys, le Peintre de la Vie moderne dans le chapitre consacré à l'éloge du maquillage, dénonce avec force le naturalisme philosophique et religieux comme la plus funeste erreur du XVIIIe siècle. L'apologie de la belle et bonne nature, prise comme unique « base, source et type de tout bien et de tout beau possibles » (p. 911), est une mystification intéressée des philosophes athées. Certes, la nature peut être représentée, en deçà du bien et du mal, comme une puissance neutre qui indique seulement l'ordre des nécessités et des besoins : elle contraint l’homme à vivre et lui enseigne les lois de la vie. Mais dès que l'on sort de cet ordre élémentaire, et même déjà à ce niveau, « la nature ne peut lui conseiller que le crime » (ibidem). « Passez en revue, analysez tout qui est naturel, toutes les actions et les désirs du pur homme naturel, vous ne trouverez rien que d'affreux » (ibidem).
La nature est le mal même, parce qu'elle est originellement corrompue : « c'est cette infaillible nature qui a créé le parricide et l'anthropophagie, et mille autres abominations que la pudeur et la délicatesse nous empêchent de nommer » (ibidem). La nature, source prétendue de tout bien et de toute beauté, est, dans sa spontanéité perverse et redoutable, un mythe que les philosophes du XVIIIe siècle ont forgé pour écarter le dogme du péché originel, que le christianisme, mais aussi toute vraie philosophie, place à l'origine de l'histoire de l'homme et du monde. La négation du péché est la source de toutes les erreurs et de toutes les illusions, mais aussi de toutes les fautes de ce siècle ; en conseillant à l'homme de se laisser guider par la pure nature, la négation du péché originel le livre sans défense à l'inspiratrice impitoyable de toute corruption.
Ce dogme du péché originel, Baudelaire ne l'emprunte pas directement à l’orthodoxie religieuse et au catholicisme, il le reçoit de J. de Maistre qui, dans les Soirées de Saint-Pétersbourg en particulier, en donne une interprétation personnelle, teintée de pessimisme et de platonisme. Maistre ne va pas jusqu'à soutenir, mais Baudelaire le dira, que le péché est moins la corruption que le déploiement même de la nature ; mais, en faisant du péché, une sorte de maladie de la nature que les païens eux-mêmes ont su reconnaître, il est sur la voie d'une interprétation qui modifie sensiblement le sens du dogme religieux de la chute (12).
L'identité du mal et de la nature, posée par l'affirmation du péché originel, repose en effet chez Baudelaire sur une conception assez singulière et fort peu chrétienne de la création. La création de l'homme et du monde, bien loin d'exprimer la générosité et la souveraine liberté de Dieu comme dans le christianisme authentique, réalise plutôt une chute de Dieu, ou encore une dualisation de l'Absolu, car le mal et la faute s'introduisent dans l'être avec la dualité. « Qu'est-ce que la chute ? Si c'est l'unité devenue dualité, Dieu a chuté. En d'autres termes, la création ne serait-elle pas la chute de Dieu ? » (Mon cœur mis à nu, p. 1217).
La forme est interrogative, mais la réponse décidément négative ne fait pas de doute ; dès lors certains thèmes baudelairiens, que l'on pouvait prendre superficiellement comme des fantaisies de poète platonicien, prennent une profondeur insoupçonnée. La Vie antérieure, qui évoque les vastes portiques où le poète a autrefois vécu dans les voluptés calmes, L’Invitation au Voyage vers ce lieu (antérieur ?) où « tout n'est qu'ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté », nous enseignent, comme Baudelaire l'a appris de J, de Maistre, que l'homme n'est pas fait pour le temps, l'agitation désordonnée de la multiplicité, en un mot les angoisses de la chair et du devenir, mais pour l'harmonie, le calme et la paix, en un mot pour l'éternité (13).
On comprend mieux le mépris de la chair, la condamnation de la vie et l'horreur du temps, qui sont des lieux communs de la poésie, si la chair, la vie et le temps sont produits par la chute et introduisent la contradiction dans l'unité (14). L'aspiration à une autre vie, dans le mythe d'une vie antérieure, est moins la fiction d'un poète que la nostalgie vécue de l'unité perdue dans les souffrances de la vie présente. La chute créatrice est sortie de l'unité, refus de la solitude, et le salut, douloureuse réintégration de l'unité (15). L'art, par la beauté, est sinon réintégration effective de l'unité, du moins l'expérience douloureuse de la séparation et promesse de salut. Il faudrait relire et méditer les textes fameux, dans lesquels Baudelaire précise la nature de la poésie et de la musique en rapport avec l'instinct du Beau.
C'est cet admirable, cet immortel instinct du beau qui nous fait considérer la Terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du Ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au delà et que révèle la vie, est la preuve la plus vivante de notre immortalité. C'est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau ; et quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d'un excès de jouissance, elles sont bien plutôt le témoignage d'une mélancolie irritée, d'une postulation des nerfs, d'une nature exilée dans l'imparfait et qui voudrait s'emparer immédiatement, sur cette terre même, d'un paradis révélé » (L'Art romantique, p. 1031).
3) L'Art révèle les splendeurs situées derrière le tombeau, mais ces splendeurs n'existent peut-être que par le miracle de l'art dans le mirage de la beauté. Le poète ne trouve dans l'expérience esthétique aucune garantie définitive ni aucune certitude absolue. Nous le savons la Beauté peut être mensonge. Non seulement la beauté de la femme, cependant surnaturelle et magique dans le maquillage, comme le montre le beau poème Semper Eadem et la supplication qui le termine : « Laissez, laissez mon cœur s'enivrer d'un mensonge, / Plonger dans vos beaux yeux comme dans un beau songe, / Et sommeiller longtemps à l'ombre de vos cils ! » (p. 115). Mais également la Beauté artistique en général dont Baudelaire ne parvient pas à décider, dans l’Hymne à la Beauté, si elle est Ange ou Sirène, divine ou diabolique. C'est que dans l'Art, il y a artifice, tromperie et calcul.
« Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul. Le crime, dont l'animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère, est originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu'il a fallu, dans tous les temps et chez toutes les nations, des dieux et des prophètes pour l'enseigner à l'humanité animalisée, et que l'homme, seul, eût été impuissant à la découvrir. Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité ; le bien est toujours le produit d'un art » (Le Peintre de la Vie moderne, p. 912).
Tous les termes de ce texte sont importants et semblent rapprocher Baudelaire de la révélation chrétienne ; mais les dieux et les prophètes, qui enseignent à l'humanité animalisée la vertu artificielle que l'homme eût été impuissant à découvrir tout seul, symbolisent moins la Révélation qu'une tradition immémoriale qui ne fait qu'un avec le caractère sur-naturel de la vertu et situe son origine en un lieu hors du monde, qui n'est peut-être pas différent du néant insolite de l'imagination. On comprend cependant mieux l'éloge du maquillage et de la mode, comme le soin que le dandy apporte à sa toilette : tout celà, comme artifice, témoigne déjà de la spiritualité :
« Le sauvage et le baby témoignent, par leur aspiration naïve, vers le brillant, vers le plumage bariolé, les étoffes chatoyantes, vers la majesté superlative des formes artificielles, de leur dégoût pour le réel, et prouvent ainsi à leur insu, l'immatérialité de leur âme » (ibidem, p. 912) (16).
Mais, si le dégoût du réel et l'immatérialité de l'âme sont des termes synonymes, l'idéal est-il autre chose que la forme négative de l'expérience de la vie ? N'est-ce pas, en définitive, le rien qui embellit ce qui est, pour reprendre en l'interprétant une formule de notre auteur (p. 911) ? Le platonisme de Baudelaire serait alors un platonisme paradoxal, puisque l'Idéal, sous la forme de l'espoir éternellement déçu, serait la négation de tout et non l'affirmation de l'être véritable, un rêve merveilleux et non la suprême réalité. Un bon interprète, D. Vouga, a pu fort justement écrire :
« Il faut bien constater que Baudelaire ne précise pas mieux que Maistre ce qu'est vraiment et essentiellement le bien : le bien, c'est tout au plus le contraire du mal, et plus exactement encore, la volonté, ou le désir, de ne pas succomber au mal, de s'efforcer vers un “mieux” ; mais le “bien” n'existe pas, et l'homme juste n'existe pas, ou n'existe que relativement à la condition humaine, c'est-à-dire au mal » (p. 140).
On comprend mieux, dans cette perspective, le début énigmatique de Fusées : « Quand même Dieu n'existerait pas, la religion serait encore Sainte et divine. Dieu est le seul être qui, pour régner, n'ait même pas besoin d'exister » (p. 1189). Si Dieu, tout en étant le sens véritable de la vie, n'a pas besoin d'exister pour manifester son empire, n'est-ce pas qu'il est essentiellement un besoin subjectif de l'homme, la face lumineuse de cet être ambivalent et torturé ? Le poète a donc raison de désespérer, en l'absence de tout secours extérieur et de toute aide possible, d'atteindre jamais la perfection et la paix. Si Dieu est l'expression métaphorique du besoin, éternellement impuissant et éternellement condamné, de sur-exister, nous avons eu raison de dire que l'extériorité du bien par rapport à l'homme était moins la preuve d'une révélation au sens religieux du terme que le signe du néant de son origine, le Rien éternellement et radicalement extérieur à l'être.
Si cette conclusion est la bonne, elle éclaire le dandysme d'une inquiétante lueur. L'auto-idolâtrie comme jeu de la dualité humaine, recherche d'une harmonie toujours menacée à l'intérieur de la division consciente de soi, indique la permanente possibilité de passer de l'angélisme rêvé à la bestialité réelle, si bien que l'aspiration vers Dieu peut à chaque instant s'inverser en dévotion à Satan (17). Le secret du dandysme serait alors le secret même de l'homme : non une sainteté espérée ou préfigurée, mais une sainteté inversée. Après tout, l’Essence du Rire dit bien que l'essence de l'homme est satanique, précisément à cause de cette éternelle duplicité.
Le rire est satanique, il est donc profondément humain. Il est dans l'homme la conséquence de l'idée de sa propre supériorité ; et, en effet, comme le rire est essentiellement humain, il est essentiellement contradictoire, c'est-à-dire qu'il est à la fois signe d'une grandeur infinie et d'une misère infinie, misère relativement à l Être absolu dont il possède la conception, grandeur infinie relativement aux animaux (pp. 716-171).
Le rire, toujours divers, expression d'un sentiment double, par opposition à la joie toujours une, est la manifestation de l'esprit de Satan ; mais, « le Sage ne rit qu'en tremblant » (p. 711).
III - Le dandysme comme vocation de l'homme
1) La nostalgie de l'unité dans l'expérience douloureuse de la division consciente fait l'essentiel de la spiritualité baudelairienne. La solitude des hauteurs est l'expression voilée de cette unité première dont l'homme, en cette vie, ne peut que rêver ou espérer le retour. Toute sortie de soi, et par conséquent, tout amour, si l'amour est besoin de sortir de soi vers un autre, est rupture de l'unité et de l'harmonie, et donc dégradation, refus concret et délibéré de la sainte solitude. « L'amour veut sortir de soi, se confondre avec sa victime, comme le vainqueur avec le vaincu » (Fusées, p. 1189) ; c'est pourquoi Baudelaire le compare à une opération chirurgicale ou à une torture délicieuse, mystérieusement inséparable de la volupté. Mais toute volupté n'est pas pure ; la volupté de la chair est infâme. « Moi, je dis : la volupté unique et suprême de l'amour gît dans la certitude de faire le mal. — Et l'homme et la femme savent de naissance que dans le mal se trouve toute volupté » (p. 1191).
L'amour charnel qui, nous rattachant à la vie, nous livre au devenir, est joie mauvaise, à laquelle l'homme se livre complaisamment pour sa propre punition et pour son propre abaissement. Cependant, l'amour si facilement corrompu peut aussi « dériver d'un sentiment généreux : le goût de la prostitution » (ibidem, p. 1189). La formule est paradoxale et provocante, blasphématoire même, quand Baudelaire n'hésite pas à l'appliquer à Dieu. Comment peut-on oser dire que « l'être le plus prostitué, c'est l'être par excellence » (p. 1220), puisqu'il est le réservoir commun, inépuisable de l'amour ? C'est que tout amour est prostitution c'est-à-dire don de soi, mais que toute prostitution n'est pas charnelle, moins encore vénale. Il y a une prostitution sainte et, donc, une prostitution qui ne relève pas, ou pas nécessairement, du satanisme dont nous parlions plus haut et de la bestialité.
« Goût invincible de la prostitution dans le cœur de l'homme, d'où naît son horreur de la solitude. — Il veut être deux. L'homme de génie veut être un, donc solitaire. La gloire, c'est rester un, et se prostituer d'une manière particulière. C'est cette horreur de la solitude, le besoin d'oublier son moi dans la chair extérieure que l'homme appelle noblement besoin d'aimer (Mon cœur mis à nu, p. 1226).
Dans ses hésitations mêmes, ce texte nous donne peut-être la solution de nos difficultés. Entre la solitude absolue et la dispersion radicale, entre l'égoïsme stérile et la perte de soi, il y a une troisième possibilité : sortir de soi tout en restant près de soi ; ou plus exactement, renoncer à toute possession immédiate pour se trouver spirituellement, concentrer son moi pur, et se trouver pour se répandre et disperser spirituellement son moi pur, oubli de soi dans la volupté calme du rythme et de l'harmonie. Dans l'amour pur, spirituel, l'homme se retient et se donne, se retient pour mieux se donner et plus universellement. La formule est claire : « La gloire, c'est rester un, et se prostituer d'une manière particulière ». (18)
2) Mais cette expérience de l'amour comme prostitution sainte est inséparable du sacrifice et du renoncement. Dans le Spleen de Paris, le poème Les Foules est la description la plus heureuse de cette expérience unique où solitude et multitude, unité avec soi et communion, loin de s'opposer et de s'exclure, se conjuguent et s'enrichissent mutuellement. Jouir de la foule est un art qui n'est pas à la portée de l'homme de la foule, affairé et occupé ; mais le poète, délaissé et méconnu, « jouit de cet incomparable privilège, qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui » (p. 296). Se multiplier indéfiniment sans disparaître ni se dissoudre : la vacuité est ici la condition d'une communion universelle dont l'ivresse est la récompense du promeneur solitaire et pensif.
« Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe » (ibidem).
Le bonheur animal de l'homme vulgaire, celui des heureux de ce monde, dont tout génie est privé, n'est rien en comparaison de ces bonheurs supérieurs, vastes et raffinés, bonheurs des fondateurs de colonies, des pasteurs de peuples, des prêtres missionnaires exilés au bout du monde, bonheur du prêtre et du soldat et bonheur du poète. Pleins des mystérieuses ivresses que ne connaît pas l'âme animale, fondateurs de colonies, conducteurs de peuples et missionnaires exilés au loin, au sein de la vaste famille que leur génie s'est faite, doivent rire quelquefois de ceux qui les plaignent pour leur fortune si agitée et pour leur vie si chaste (ibidem, p. 296). Vivre dangereusement ou chastement, c'est également renoncer à la satisfaction immédiate et à la tranquillité vitale, c'est sacrifier sa vie à l'idéal. Il ne faut pas s'étonner de trouver le poète dans la compagnie du prêtre et du soldat si, rassasié d'amertume et purifié par la souffrance, l'artiste vit lui aussi dangereusement. « L'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu » (Le Confiteor de l'artiste, p. 284). La prostitution sainte n'est donc pas une formule brillante, mais elle définit rigoureusement la vocation de l'homme et marque le prix de la vie. Quelques notations de Mon cœur mis à nu résument admirablement ce propos :
Il n'y a de grands parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat.
L'homme qui chante, l'homme qui sacrifie et se sacrifie.
Le reste est fait pour le fouet (p. 1220).
Baudelaire revient sur ce même thème dans un autre fragment, où il oppose très clairement l'idéal de la société bourgeoise et celui d'une société aristocratique, en marquant l'irrécusable supériorité de ce dernier. « Il n'existe que trois êtres respectables : le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer et créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions » (p. 1213). Ce qui nous reconduit à notre point de départ, la mise en cause par le dandy, inspiré par J. de Maistre, de la société démocratique.
3) En effet, nous n'avons pas abandonné notre réflexion sur le dandysme : le dandy est moins un personnage à part que celui qui, en chaque vocation, assume et accomplit ce qu'elle propose à l'homme. Le dandy c'est le prêtre, le poète et le soldat, en tant qu'ils goûtent aux mystérieuses ivresses du renoncement. Quelques équivalences au premier abord énigmatiques d'un fragment de Mon cœur mis à nu peuvent être comprises en ce sens :
« Dandies. L'envers de Claude Gueux. Théorie du sacrifice. Légitimation de la peine de mort. Le sacrifice n'est complet que par le sponte sua de la victime » (p. 1212).
Le dandy, prêtre et victime d'un culte apparemment frivole, accomplit en lui le sens mystérieux du sacrifice, comme et en tant que prêtre, poète et guerrier. Le dandy cependant reste un grand homme et un saint pour soi-même ; non parce qu'il s'enferme dans l'égoïsme, mais parce qu'il attend en vain un signe qui ne lui est pas donné. Le dandy ne trouve hors de lui aucun appui et ne connaît en lui aucun apaisement : le cœur éternellement déchiré, il est le seul témoin et la seule preuve de son propre salut. Le seul signe d'accomplissement qui lui sera donné, c'est le signe paradoxal de la souffrance consentie et de la douleur consciente, exaspérée par la lucidité :
« Pour que le sacrifice soit parfait, il faut qu'il y ait assentiment et joie de la part de la victime ».
Là encore la conception maistrienne du sacrifice, de la douleur rédemptrice, de la compensation éclaire d'une vive lumière les formules de Baudelaire. Nous retrouvons la magnifique prière qui donne sa conclusion au premier poème des Fleurs du Mal (Bénédiction) et qui peut également nous servir de méditation finale.
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance
Comme un divin remède à nos impuretés
Et comme la meilleure et la plus pure essence
Qui prépare les forts aux saintes voluptés !Je sais que la douleur est la noblesse unique
Où ne mordront jamais la terre et les enfers,
Et qu'il faut pour tresser ma couronne mystique
Imposer tous les temps et tous les univers.Mais les bijoux perdus de l'antique Palmyre,
Les métaux inconnus, les perles de la mer,
Par votre main montés, ne pourraient pas suffire
À ce beau diadème éblouissant et clair ;Car il ne sera fait que de pure lumière,
Puisée au foyer saint des rayons primitifs,
Et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière,
Ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs !
La religion de Baudelaire est une religion de la douleur universelle : la seule preuve, ici-bas, de notre dignité et de notre salut, la seule réalité que l'enfer et le mal ne peuvent corrompre, c'est la douleur, la souffrance que l'homme, dans le poète, mystiquement assume et qui l'ennoblit (19).
L'expérience poétique de Baudelaire est au fond religieuse. Il se recommande quelquefois de la pure doctrine catholique. Mais cette prétention est injustifiée pour 2 raisons étroitement liées l'une à l'autre : il remplace le surnaturel par l'artificiel et reconnaît une transcendance simplement imaginaire. Ces 2 points ont été particulièrement mis en lumière par D. Vouga dans l'essai déjà cité, Baudelaire et Joseph de Maistre, auquel nous devons beaucoup :
« Ce que Baudelaire appelle Dieu, c'est le besoin de croire qu'il existe une perfection où la matière est vaincue ; ce qu'il appelle religion, c'est l'effort qui va ou voudrait aller vers cette victoire. Et c'est pourquoi le bien qu'il envisage est plus artificiel que surnaturel, plus anti-naturel que sur-naturel » (p. 147).
Dieu est un autre nom de la Justice, dont rien n'atteste qu'Il existe en dehors de notre élan vers lui, de notre désir de sur-exister. Certes, il y a une transcendance, une extériorité à l'être et une idéalité du Bien, mais cette transcendance est imaginaire et non pas effective ; elle est celle du Rien de l'imagination ; elle ne peut donc s'abolir comme pure idéalité et pure extériorité ni du fait de l'homme ni du fait de Dieu. La religion est divine et sainte même si Dieu n'existe pas, et l'imagination, qui va plus loin que tout réel, pourrait enseigner l'homme impuissant, même si le prophète n'était à l'écoute d'aucune révélation.
Le dandysme est l'illustration de cette religion héroïque, dans laquelle la sainteté n'est jamais accomplie ni en l'homme ni hors de l'homme. Que manque-t-il à la religion de Baudelaire ? Pour le dire simplement, la grâce de l'incarnation. La sublimité du dandy dépasse la grâce comme élégance et distinction : en ce sens, Baudelaire va infiniment plus loin que Barbey d'Aurevilly. Mais, la grâce, qui n'est pas seulement légèreté du mouvement et élégance du geste, ne dépasse pas la justice et la moralité. Baudelaire ignore la grâce comme gratuité et surabondance du Don divin. Si l'homme reste éternellement inaccompli par l'homme, l'homme est déjà éternellement accompli par Dieu. Jésus, le Juste, pour parler comme Baudelaire dans l'Essence du rire, n'est pas un dandy, mais un saint. Par rapport à la sainteté authentique, le dandysme est caricature ou promesse, promesse qui attend son accomplissement.
► Paul Olivier, in : Analyses & réflexions sur... “Spleen et Idéal”, ellipses, 1984.
◘ Notes :
1 : Nous citerons Baudelaire dans l'édition des Œuvres complètes de la Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1954. En outre, nous citerons les ouvrages suivants, en indiquant le plus souvent uniquement le nom de l'auteur : Jules Barbey d'Aurevilly, Du dandysme, éd. d'Aujourd'hui, coll. Les Introuvables, Paris, 1977 ; Marcel A. Ruff, L'homme et l'œuvre, Hatier-Boivin, 1955 ; Roger Kemp, Dandies, Baudelaire & Cie, Seuil, 1977 ; Daniel Vouga, Baudelaire et Joseph de Maistre, J. Corti, 1957 ; E. Carassus, Le mythe du dandy, A. Colin, coll. U2, 1971 ; Joseph de Maistre, Les soirées de Saint-Pétersbourg (2 vol.), Trédaniel/La Maisnie, 1980, Considérations sur la France, Slatkine, 1980. Nous choisissons, conformément à l'usage de Barbey d'Aurevilly, l'orthographe dandys pour le pluriel de ce terme ; nous conserverons bien entendu la forme dandies dans les citations où elle apparaît. Nous ne mettrons pas la majuscule à dandy, et dandysme, sauf bien entendu dans les citations qui la comportent ; d'autres particularités orthographiques (poëme, ou poëte) s'expliquent par le souci de respecter les citations du poète.
2 : On retrouve ce thème dans un fragment de Fusées : « le charme infini et mystérieux » que procure la la contemplation d'un navire en mouvement résulte de la satisfaction que donne à l’esprit humain la régularité et la symétrie, la complication et et l'harmonie. « L'Idée poétique qui se dégage de cette opération du mouvement dans les lignes est l'hypothèse d'un être d'un vaste, immense, compliqué, mais euryyhmique, d'un animal plein de génie, souffrant et soupirant tous les soupirs et toutes les ambitions humaines » (p. 1201). Le dandysme serait la presentation visible d'une remontée à un mode de vie antérieur à la chute, celui-là même que formule la Vie antérieure ou l'Invitation au Voyage.
3 : L’Irrémédiable éclaire ce thème du miroir :
Tête-à-tête sombre et limpide
Qu'un cœur devenu son miroir !
Puits de Vérité, clair et noir,
Où tremble une étoile livide,Un phare ironique, infernal
Flambeau des grâces sataniques,
Soulagement et gloire unique,
— La conscience dans le Mal !
4 : Élévation exprime parfaitement cette joie de la solitude des hauteurs :
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde,
Tu sillones gaiement l'immensité profonde,
Avec une indicible et mâle volupté. (p. 86)
5 : La conscience dans le mal qui fait l'homme contradictoire est aussi, sous une autre forme, un thème maistrien. « Tous les êtres sont tranquilles à la place qu'ils occupant. Tous sont dégradés, mais ils l'ignorent ; l'homme seul en a le sentiment, et ce sentiment est tout à la fois la preuve de sa grandeur et de sa misère, de ses droits sublimes et de son incroyable dégradation. Dans l'état où il est réduit, il n'a pas même le triste bonheur de s'ignorer, il faut qu'il se contemple sans cesse, et il ne peut se contempler sans rougir ; sa grandeur même l'humilie, puisque ses lumières, qui l'élèvent jusqu'à l'ange, ne servent qu'a lui montrer dans lui des penchants abominables qui le dégradent jusqu'à la brute. Il cherche dans le fond de son être quelque partie saine sans pouvoir la trouver : le mal a tout souillé, et l'homme entier n'est qu'une maladie. Assemblage inconcevable de deux puissances différentes et incompatibles, centaure monstrueux, il sent qu'il est le résultat de quelque forfait inconnu, de quelque mélange détestable qui a vicié l'homme jusque dans son essence la plus intime » (Soirées de Saint-Petersbourg, IIe entretien, t. I, p. 68 ; la formule soulignée est d'Hippocrate) ; plus loin, Maistre insistera sur la faiblesse de la volonté : « [L’homme est puni par là où il a péché, c’est-à-dire dans sa volonté.] Il ne sait ce qu’il veut, il veut ce qu'il ne veut pas, il ne veut pas ce qu’il veut, il voudrait vouloir » (p. 69) : cette contradiction vivante n’est-elle pas précisément la condition de de l'héautontimorouménos [bourreau de soi-même] ? [Pour Spinoza (Éthique, III, prop. 129, scolie), vouloir ce que l'on ne veut pas et ne pas vouloir ce que l'on veut produit ce qui paralyse une décision éclairée ; c'est la définition même de la crainte. Cette peur éminemment contagieuse, car elle multiplie des images au lieu de multiplier les questions, repose sur le désir d'éviter un mal à venir qui pourrait être source d'un mal encore plus grand et cause d'un vouloir qui ne veut pas.]
6 : On pourrait citer ce texte de Considérations sur la France où J. de Maistre affirme son choix aristocratique : « Il y a dans chaque état un certain nombre de familles qu'on pourrait appeler co-souveraines, même dans les monarchies : car la noblesse, dans ces gouvernements, n'est qu'un prolongement de la souveraineté. Ces familles sont les dépositaires du feu sacré : il s'éteint lorsqu'elles cessent d'être vierges. C'est une question de savoir si ces familles une fois éteintes peuvent être parfaitement remplacées. Il ne faut pas croire au moins, si l'on veut s'exprimer exactement, que les souverains puissent anoblir » (p. 178) ; certes de nouvelles familles s'élancent, mais la puissance des souverains se borne à « sanctionner ces anoblissements naturels », quand les souverains « contrarient un trop grand nombre de ces anoblissements, ou s'ils se permettent d'en faire trop de leur pleine puissance, ils travaillent à la destruction de leurs états » (ibid.). C'est, sous une forme une plus precise, exactement la pensée de Baudelaire.
7 : J. de Maistre (1753-1821), écrivain français mais savoyard et sujet du Roi de Sardaigne, est un penseur méconnu, pour ne pas dire calomnié : on l'écarte trop souvent en le qualifiant de penseur réactionnaire, comme si toute pensée authentique n'était pas réactionnaire, c'est-à-dire intempestive ; ses ouvrages principaux sont : Considérations sur la France (1796) ; Du Pape (1819) ; Les Soirées de Saint-Pétersbourg (1821) ; son tort principal aux yeux de l'intelligentsia contemporaine est d'avoir dénoncé dans la révolution française cette horrible effusion de sang humain et d'avoir vu en elle non la naissance de la liberté, mais un moyen terrible de punition et de rachat. De Maistre est le génial penseur de la Contre-révolution : « le rétablissement de la Monarchie, qu'on appelle contre-révolution, ne sera point une révolution contraire, mais le mais contraire de la Révolution » (Considérations sur la France, p. 184) : on le croit tourné vers le passé, alors que sa méta-politique annonce l'avenir. Une excellente introduction à son œuvre est : Émile Dermenghem, Joseph de Maistre Mystique, éd. d'Aujourd'hui, coll. Les lntrouvables, 1980. L’A. montre en particulier que sa pensée religieuse, trop sommairement identifiée à l'ultra-montanisme et au catholicisme intégriste, est, chez cet ancien franc-maçon, admirateur de Louis Claude de Saint Martin, beaucoup plus complexe et originale qu'on ne le dit.
8 : Le refus de la bourgeoisie et de la démocratie s'exprime chez Baudelaire avec une rare violence, comme en témoigne ce fragment de Mon cœur mis à nu : « Tous les imbéciles de la Bourgeoisie qui prononcent sans cesse les mots : « immoral, immoralité, moralité dans l'art » et d'autres bêtises, me font penser à Louise Villedieu, putain à cinq francs, qui, m'accompagnant une fois au Louvre, où elle n'était jamais allée, se mit à rougir, à se couvrir le visage, et, me tirant à chaque instant par la manche, me demandait devant les statues et les tableaux immortels, comment on pouvait étaler publiquement de pareilles indécences » (p. 1232). Il écrira de même de Louis Veuillot, qui certes ne mérite guère un tel reproche : « Veuillot est si grossier et si ennemi des arts qu'on dirait que toute la démocratie du monde s'est réfugiée dans son sein » (p. 1222).
9 : Par hétérodoxe, nous entendons ce qui n'est pas réellement conforme à la règle de loi ; Baudelaire a beau utiliser des dogmes religieux, comme relui du péché originel ou celui de la souffrance rédemptrice, il est fort douteux que les grandes confessions chrétiennes acceptent de se reconnaître dans les interprétations qu'il en donne.
10 : Un voyage à Cythère s'achève par cette prière : « Ah ! Seigneur ! donnez-moi la force et le courage / De contempler mon cœur et mon corps sans dégoût ! » (p. 189) Cette prière pourrait être la prière du dandy, qui n'est pas meilleur que les autres hommes, même s'il sait sa déchéance.
11 : La femme n'est pas seulement le Bel animal, dépourvue de conscience ; elle est aussi l Ange ou la Madone ; mais Ange Madone, la femme ne l'est que comme création du poète, qui attend vainement la réalisation d'un rêve si doux.
J'ai vu parfois, au fond d'un théâtre banal
Qu'enflammait l'orchestre sonore,
Une fée allumer dans un ciel infernal
Une miraculeuse aurore ;
J'ai vu parfois au fond d'un théâtre banalUn être, qui n'était que lumière, or et gaze,
Terrasser l'énorme Satan ;
Mais mon cœur, que jamais ne visite l'extase,
Est un théâtre où l'on attend
Toujours, toujours en vain, l’Être aux ailes de gaze ! (p. 129).
Il faudra se souvenir de cette attente toujours déçue, quand nous nous interrogerons sur la Religion de Baudelaire.
12 : « Le péché originel, qui explique tout, et sans lequel on n'explique rien, se répète malheureusement à chaque instant de la durée, quoique d'une manière secondaire. Je ne crois pas qu'en qualité de chrétien, cette idée, lorsqu'elle sera développée exactement, ait rien de choquant pour votre intelligence. Le péché originel est un mystère sans doute ; cependant si l'homme vient à l'examiner de près, il se trouve que ce mystère a, comme les autres, des côtés plausibles, même pour notre intelligence bornée » (Les Soirées de Saint-Pétersbourg, IIe entretien, t. I, p. 63) ; c'est ce qui explique que tout en étant un mystère chrétien, le péché originel ait pu être conjecturé par les philosophes païens ; devant les contradictions de l'existence humaine, le philosophe reste en effet interdit : « Qui pourrait croire qu'un tel être ait pu sortir dans cet état des mains du créateur ? Cette idée est si révoltante, que la philosophie seule, j'entends la philosophie païenne a deviné le péché originel » (p. 69). Mais cependant n'identifie pas la création à la chute ni la nature au mal : le péché est un crime, c'est-à-dire une œuvre de la liberté humaine.
13 : L'homme n'est pas fait pour le temps : « L'esprit prophétique est naturel à l'homme, et ne cessera de s'agiter dans le monde. L'homme, en essayant, à toutes les époques et dans tous les lieux, de pénétrer dans l'avenir, déclare qu'il n'est pas fait pour le temps ; car le temps est quelque chose de forcé qui ne demande qu'à finir. De là vient que dans nos songes, jamais nous n'avons l'idée du temps, et que l'état de sommeil fut toujours favorable aux communications divines. En attendant que cette énigme nous soit expliquée, célébrons dans le temps celui qui a dit à la nature : Le temps sera pour vous, l'éternité pour moi » (Soirées de Saint-Pétersbourg, XIe entretien, t. II, p. 233), quand tout sera consommé en revanche il n'y aura plus de temps (p. 234). Ou encore ce texte où on reconnaîtra sans peine des thèmes baudelairiens : « L'homme est assujetti au temps ; néanmoins, il est par nature étranger au temps ; il l'est au point que l'idée même du bonheur éternel, jointe à celle du temps, le fatigue et l'effraie. Que chacun se consulte, il se sentira écrasé par l'idée d'une félicité successive et sans terme : je dirais qu'il a peur de s'ennuyer, si cette expression n'était pas déplacée dans un sujet aussi grave » (pp. 231-232) ; Baudelaire, plus conséquent encore, verra dans l'ennui une forme subtile de l'immortel péché.
14. On pourrait multiplier les références chez Baudelaire à cette horreur du temps et de la vie. L'Horloge ou L'Ennemi dans les Fleurs du Mal ; la Chambre double dans le Spleen de Paris sont de bons exemples.
Ô douleur ! ô douleur ! Le Temps mange la vie,
Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le cœur
Du sang que nous perdons croît et se fortifie ! (L'Ennemi, p. 92).
Oui ! Le Temps règne ; il a repris sa brutale dictature. Et il me pousse, comme si j'étais un bœuf, avec son double aiguillon. – “Et hue donc ! bourrique ! Sue donc, esclave ! Vis donc damné !” (La Chambre double, p. 287).
Le Temps règne avec « son démoniaque cortège de Souvenirs, de Regrets, de Spasmes, de Peurs, d'Angoisses, de Cauchemars, de Colères et de Névroses » (ibidem, p. 287) « et la suite des heures, jaillissant de la pendule, répète : “Je suis la Vie, l'insupportable, l'implacable Vie” ».
15. Chez Maistre aussi le mal est division : « Plus on examine l'univers, et plus on se sent porté à croire que le mal vient d'une certaine division qu'on ne sait expliquer, et que le retour au bien dépend d'une force contraire qui nous pousse sans cesse vers une certaine unité tout aussi inconcevable. Cette communauté de mérites, cette réversibilité que vous avez si bien prouvées, ne peuvent venir que de cette unité que nous ne comprenons pas » (Soirées de Saint-Pétersbourg, Xe entretien, t. II, p. 162).
16. La mode elle-même « doit être considérée comme un symptôme du goût de l'idéal surnageant dans le cerveau humain au-dessus de tout ce que la vie naturelle y accumule de grossier, de terrestre et d'immonde, comme une déformation sublime de la nature, ou plutôt comme un essai permanent et successif de réformation de la nature » (Le Peintre de la Vie moderne, p. 912).
17. Il suffit d'évoquer ici le Reniement de Saint Pierre :
Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait
D'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve ;
Puissé-je user du glaive et périr par le glaive !
Saint Pierre a renié Jésus... il a bien fait ! (p. 191).
L'atroce blasphème n'est cependant pas facile à interpréter ; il ne suffit pas à faire de Baudelaire un homme révolté contre Dieu, puisque la révolte du dandy comme celle du blasphémateur, inspirée par le désespoir du bien, est révolte contre la chute et non révolte contre le créateur.
18. Les poèmes (Vie antérieure, Invitation au Voyage), dans lesquels Baudelaire tente de penser l'unité et la volupté calme d'une existence enfin réconciliée avec elle-même et le divin, illustrent peut-être cette condition dont Maistre dit lui-même qu'elle est difficilement représentable. « Lorsque la double loi de l'homme sera effacée, et que ces deux centres seront confondus, il sera un ; car n'ayant plus de combat dans lui, où prendrait-il l'idée de la duité ? Mais si nous considérons les hommes, les uns à l'égard des autres, qu'en sera-t-il d'eux, lorsque le mal étant anéanti, il n'y aura plus de passion ni d'intérêt personnel ? Que deviendra le Moi, lorsque toutes les pensées, lorsque tous les esprits se verront comme ils sont vus ? Qui peut comprendre, qui peut se représenter cette Jérusalem céleste, où tous les habitants, pénétrés par le même esprit, se pénétreront mutuellement et réfléchiront le bonheur ? Une infinité de spectres lumineux de même dimension, s'ils viennent à coïncider exactement dans le même lieu, ne sont plus une infinité de spectres lumineux ; c'est un seul spectre infiniment lumineux. Je me garde bien cependant de vouloir toucher à la personnalité, sans laquelle l'immortalité n'est rien ; mais je ne puis m'empêcher d'être frappé en voyant comment tout, dans l'univers, nous ramène à cette mystérieuse unité » (Les Soirées de Saint-Pétersbourg, Xe entretien, t. II, pp. 171-172). Peut-être un tel texte éclaire-t-il la notation de Mon cœur mis à nu : « De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est là » (p. 1206) ?
19. La religion baudelairienne de la douleur universelle et rédemptrice, est-elle autre chose qu'un commentaire de ces formules de Maistre . « La terre entière, continuellement imbibée de sang, n'est qu'un autel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à l'extinction du mal, jusqu'à la mort de la mort » (Les Soirées de Saint Pétersbourg, VIIe entretien, pp. 25-26). La poésie n'est-elle pas un combat spirituel où s'accomplit l'essence de la guerre divine ?