Valentin Raspoutine
 Originaire de Sibérie orientale, Valentin Raspoutine consacre tous ses récits au destin de la campagne russe. L'Argent pour Maria (1967) dépeint le glissement des valeurs villageoises communautaires vers l'individualisme (personne ne donnera à Kouzma l'argent dont il a besoin pour sauver sa femme). Le monde paysan vit ses derniers jours, telle Anna, simple paysanne héroïne du Dernier Sursis (1970). Mes leçons de français (1973) rendent un dernier hommage à la bonté de ces gens simples, à travers la figure d'une institutrice, tandis que Vis et souviens-toi (1974) met en scène une femme incapable de survivre à la faute de son mari, déserteur : tous deux sont rejetés par la communauté. Le titre de l'Adieu à Matiora (1976) est emblématique : ce village englouti par les eaux, au nom du progrès, symbolise la fin de l'univers patriarcal – rupture trop brutale qui trouve en quelque sorte son châtiment dans l'Incendie (1985). À partir des années 1980, Raspoutine publie surtout des essais et des nouvelles. [Dictionnaire mondial des littératures, Larousse]
Originaire de Sibérie orientale, Valentin Raspoutine consacre tous ses récits au destin de la campagne russe. L'Argent pour Maria (1967) dépeint le glissement des valeurs villageoises communautaires vers l'individualisme (personne ne donnera à Kouzma l'argent dont il a besoin pour sauver sa femme). Le monde paysan vit ses derniers jours, telle Anna, simple paysanne héroïne du Dernier Sursis (1970). Mes leçons de français (1973) rendent un dernier hommage à la bonté de ces gens simples, à travers la figure d'une institutrice, tandis que Vis et souviens-toi (1974) met en scène une femme incapable de survivre à la faute de son mari, déserteur : tous deux sont rejetés par la communauté. Le titre de l'Adieu à Matiora (1976) est emblématique : ce village englouti par les eaux, au nom du progrès, symbolise la fin de l'univers patriarcal – rupture trop brutale qui trouve en quelque sorte son châtiment dans l'Incendie (1985). À partir des années 1980, Raspoutine publie surtout des essais et des nouvelles. [Dictionnaire mondial des littératures, Larousse]
Une thèse sur Valentin Raspoutine
♦ Recension : Gedächtnis und Leben in der Prose Valentin Rasputins, Günther Hasenkamp (Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1990, VII + 302 p.)
Valentin Grigorievitch Raspoutine, né le 15 mars 1937 en Sibérie, est le petit-fils d’un chasseur de la taïga et de Mariia Guerassimovna qui lui a raconté, pendant son enfance, les contes populaires de sa région. Ce qui lui a donné à jamais le sens de la continuité et de la durée, un goût indélébile pour tout ce qui est “archétype”. Son œuvre de grand prosateur russe est placée entièrement sous le signe de la “perte de conscience” qui affecte nos contemporains, du passage d’une conscience mythique-intégrative à une attitude totalement démythifiée. Tel est le déficit — la plaie béante — de nos temps modernes. Cette crise doit être dénoncée et combattue. Après la période de stagnation brejnévienne (la “kosnost”), Raspoutine retrouve pleinement son rôle d’“écrivain-prédicateur”, qui va s’engager pour son peuple, afin qu’il retrouve une morale basée sur les acquis de son histoire et de sa tradition. Avec les autres “ruralistes” de la littérature russe contemporaine, il mènera la “guerre civile” des écrivains contre les “libéraux”, c’est-à-dire ceux qui veulent introduire en Russie les idées occidentales et la culture de masse calquée sur le modèle américain. Contre cette vision purement “sociétaire” qui ne reconnaît aucune présence ni récurrence potentielle aux moments forts du passé, qui ignore délibérément toute “saveur diachronique”, Raspoutine et les ruralistes défendent le statut mythique de la nation, revalorisent la pensée archétypique, réhabilitent l’unité substantielle avec les générations passées.
Le slaviste allemand Hasenkamp démontre que cet engagement nationaliste repose sur une “conscience mythique” traditionnelle où il n’y a pas de séparation entre le microcosme et le macrocosme, entre la chose et le signe, la réalité et le symbole. Dans Adieu à Matiora, son plus célèbre roman, l’île qui va être engloutie par le fleuve représente la totalité du monde, sa continuité, qui va être submergée par la pensée calculante, techniciste, administrative. Matiora est la continuité, face au “temps nouveau”, qui déracine les habitants et prépare l’inondation finale. Cette ère nouvelle sera une ère de discontinuité qui claudiquera d’interruption en interruption, de retour furtif à une vague stabilité en nouveau déracinement. Cette fragmentation conduit au malheur et à la dépravation morale. Les axes majeurs de la pensée philosophique de Raspoutine, qui ne s’exprime pas par de sèches théories mais dans des romans poignants, où l’on retrouve des linéaments d’apocalypse ou de Ragnarök, sont : la mémoire et la réalité transcendantale. Derrière la réalité empirique, derrière les misères quotidiennes et la banalité de tous les jours, se profile, pour qui sait l’apercevoir et l’honorer, une réalité supérieure, immortelle. Le monde moderne a voulu faire du passé table rase, a jugé que la mémoire n’était plus une valeur et la faculté de se souvenir n’était plus une vertu. Contre l’idéologie dominante, qui veut nous arracher nos histoires pour nous rendre dociles, l’œuvre de Raspoutine, sa simplicité poignante et didactique, son universalité et sa russéité indissociables, sont des armes redoutables. À nous de nous en servir, à nous de diffuser son message. Qui est aussi le nôtre.
► Robert Steuckers, Vouloir n°105-108, 1993.

◘ En français :
- L'Adieu à l'île (Robert Laffont, 1979)
- De l'Argent pour Maria (Âge d'homme, 1979)
- Baïkal (Alidades, 1997) [extrait]
- L'Honneur de Tamara Ivanovna (Syrtes, 2006)
- L'Incendie (Julliard, 1988)
- Mes leçons de français (Éd. Librairie du Globe, 1998)
- Matoucka (Robert Laffont, 1977)
- Vis et n'oublie pas (Âge d'homme, 1979)
- « En conscience » (entretien, 1998)
◘ Documentaire : La Rivière de la vie - Valentin Raspoutine (Russie, 2011)

pièces-jointes
◘ Notice biographique :
Après un passage par le reportage journalistique, Valentin Grigorievitch Raspoutine (né à Oust-Ouda [Sibérie] en 1937) apparaît dans les années 1970 comme l’un des écrivains soviétiques les plus préoccupés par la ruine de l’âme et de la nature, et l’une des figures de proue de la “littérature paysanne”. Mais son réalisme éthique atteint à l’universel. Ses héros sont toujours placés devant l’imminence de la fin :
- la prison pour Maria, victime de l’égoïsme général (De l’argent pour Maria, 1967) ;
- la mort, qu’une vieille paysanne vit à l’avance comme un passage vers une autre lumière (Le Dernier Délai , 1970, traduit en français sous le titre de Matouchka) ;
- l’ensauvagement d’un déserteur malgré lui et la "traque" dont sera victime sa femme de la part des notables du village (Vis et souviens-toi, 1974) ;
- le dernier été d’une île de l’Angara qui va être submergée par un lac de barrage, ou la fin de la terre mère (L’Adieu à l’île, 1976, adapté au cinéma par Elem Klimov en 1981 [Les Adieux à Matiora]).
Les héroïnes féminines de Raspoutine, et surtout ses vieilles paysannes, sont déjà devenues des figures d’anthologie: leur rayonnement spirituel, leur bonté pleine d’abnégation, leur mémoire des générations, leur sens de la beauté cosmique et la profondeur de leurs monologues intérieurs s’opposent à l’égoïsme, à la cupidité, à l’oubli des jeunes générations happées par la ville et l’argent, tout comme à l’inhumanité de l’Administration. L’œuvre de Raspoutine prenait explicitement le contre-pied de tout un courant de la littérature soviétique qui glorifiait la conquête de la nature, le pouvoir illimité de la raison et du progrès, et choisissait de faire table rase du passé pour forger “l’homme nouveau”. Raspoutine montre la ruine spirituelle, sociale et écologique à laquelle le prométhéisme dont Gorki fut l’un des chantres a conduit le pays. L’un de ses récits les plus importants, L’Incendie (1985), est un cri d’alarme apocalyptique.
Dans son œuvre littéraire comme dans ses articles de presse, Raspoutine a sonné le tocsin (à propos de la sauvegarde du lac Baïkal, not.) bien avant l’arrivée au pouvoir en 1985 de Mikhaïl Gorbatchev. S'il est l’un des précurseurs des changements survenus en Union soviétique, il se veut vigilant. Pour lui (comme pour Soljénitsyne), la solution des problèmes économiques et sociaux passe avant tout par le recouvrement par l’homme de son âme et du sens de la vie. C’est le talent, l’éloignement de Moscou, la soif de vérité du public, la notoriété à l’étranger qui ont permis à Raspoutine de s’imposer. Ses maîtres avoués sont Dostoïevski pour l’analyse psychologique et Bounine pour la précision de la langue, ainsi que Andreï Platonov. Raspoutine, qui est aussi un grand paysagiste, retrouve le symbolisme des éléments naturels, des travaux et des jours ; sa langue, à la fois concrète et philosophique, révèle, par ses racines mêmes, la beauté et la sacralité de l’univers. Raspoutine n’est ni passéiste ni réactionnaire. C’est un écrivain engagé : affirmer le primat de l’éthique sur l’économique, la nécessité de conserver la mémoire des siècles, de retrouver les liens du ciel et de la terre pour asseoir l’avenir, placer la vie au-dessus de la loi équivaut, face à l’idéologie dominante, à une résistance morale. Cependant, ses prises de position publiques chauvines et antisémites le privent, dans les années 1990, d’un certain nombre de ses lecteurs.
► Michel Niqueux, in : Encyclopédie Universalis ©.

 Le bûcheron et le forestier [Portrait de Valentine Raspoutine]
Le bûcheron et le forestier [Portrait de Valentine Raspoutine]
[Ci-contre : le slavisant George Nivat, auteur de cet article]
Valentin Raspoutine, né dans un village sibérien perdu dans la taïga, au bord de l'immense fleuve Angara, vit aujourd'hui à Irkoutsk. Ce lieu même de résidence est un geste : c'est le refus de Moscou, du centralisme culturel, c'est aussi une plaidoirie pour le droit à la variété. Malgré une pénible mésaventure (il fut récemment attaqué dans les rues d'Irkoutsk par une bande de voyous), Raspoutine reste sibérien, comme Belov reste “vologdien” : repli sur le terroir, enlisement dans l'ethnographisme ou ressourcement profond ? En mars 1980 la Literaturnaïa Gazeta publia une des rares interviews de cet écrivain sobre et pudique. À la question « qui aimeriez-vous être si vous n'étiez pas écrivain ? » Raspoutine répondit :
« Forestier. C'est un métier magnifique, pur, bon, joyeux, un des très rares métiers d'aujourd'hui où tout est utile et justifié du début à la fin, où l'on sert l'homme et la beauté du monde qui l'entoure, où l'on assure la santé physique et morale non seulement des hommes d'aujourd'hui, mais également de ceux de demain. Avez-vous remarqué comme le bûcheron est différent du forestier ? Vous êtes-vous demandé pourquoi l'un est grossier et cruel, l'autre presque doux, bon et confiant ? »
La dialectique du bûcheron et du forestier anime secrètement toute l'œuvre de Valentin Raspoutine, c'est-à-dire la dialectique de la destruction et du respect, de l'artifice et du naturel. Dans la même interview Raspoutine se défend d'être un simple défenseur du village contre la ville (la critique l'a en effet mis au premier rang de la “prose rurale”, à côté de Vassili Belov et de Victor Astafiev) :
« Il ne s'agit pas d'opposer la ville au village, ce n'est pas une tentative pour préserver une campagne archaïque et qui a fait son temps comme parfois on nous caricature — il s'agit d'autre chose : lorsque la ville avait des “arrières” aussi solides que l'étaient nos campagnes, elle aussi, la ville, en tirait profit (…) Autrement dit la littérature “rurale” a su trouver les terminaisons nerveuses de cet énorme corps que nous baptisons peuple ».
Chaque œuvre nouvelle de Valentin Raspoutine touche en effet à ces “terminaisons nerveuses” que sont le respect de l'homme, la conscience, la cruauté, l'insensibilité. Il est loin d'être le seul écrivain soviétique publié à aborder les problèmes moraux (dans des contextes très différents plus sociologique, chez Iouri Trifonov, plus anecdotique chez Vassili Choukehine, mort en 1974, etc.) ; mais il est un de ceux chez qui la formulation philosophique va le plus loin. L'homme ne peut pas vivre sans “arrières”, c'est-à-dire une mémoire de soi et de la nation à laquelle il appartient. Tout Raspoutine nie l'idée que l'homme serait un produit des rapports de production ; il est un être libre, une “conscience” et chargé de gérer parcimonieusement et sagement le capital de bonté et de beauté de la vie. Je ne crois pas qu'il soit fortuit que Raspoutine cite, comme Soljenitsyne dans son discours de Nobel, la thèse dostoïevskienne que “la beauté sauvera le monde”. Il s'agit non seulement du primat éthique dans le projet artistique, mais également de l'action en profondeur de l'art, de “l'impression exprimée esthétiquement”.
L'étrange est que cette mission salvatrice ait été conçue par un petit paysan de l'Angara, élevé dans le dénuement et la grossièreté d'un kolkhoze sibérien des plus pauvres, pendant l'immédiat après-guerre. Un des rares textes autobiographiques de Raspoutine est le récit Les leçons de français. Le narrateur est un garçon de 12 ans ; on est en 1948 et il vient d'être envoyé à 50 kilomètres de son village pour étudier au lycée. Il est le premier “lycéen” du village. « La faim en cette année-là ne nous avait pas encore lâchés, et ma mère avait charge de trois enfants, j'étais l'aîné ». L'enfant est doué et obtient de bonnes notes, sauf en français : « J'aboyais en français à la façon de nos locutions villageoises avalant la moitié des sons et crachant l'autre par courtes rafales ». La nouvelle est bâtie sur le rapport d'amitié pudique qui s'établit entre ce sauvageon sibérien et la jeune femme professeur de français, émigrée du lointain et ensoleillé Kouban, qui le prend chez elle pour lui faire rattraper le niveau, s'aperçoit qu'il a faim, lui fait avouer qu'il joue pour de l'argent et se fait rosser par des voyous aux confins de la ville… N'arrivant par aucune ruse à lui faire accepter ni dîner chez elle, ni colis “anonyme”, elle le défie à un jeu d'adresse auquel elle jouait, petite fille, dans son Kouban natal, une sorte de jeu de piécettes où se combinent habileté à faire rebondir le kopeck contre le mur, et hasard… Il faut que le directeur de l'école entre chez Lydia Mikhaïlovka en pleine séance de jeu, lorsqu'elle, redevenue une fillette hardie, et lui, enfin quelque peu apprivoisé, sont au bord d'un miracle. Renvoyée chez elle la jeune femme expédiera au garçon, soigneusement empaquetées dans du coton, trois grosses pommes rubicondes, comme il n'en pousse pas dans la taïga…
Pudeur, poésie douce-amère de la vie, recherche de la pureté et délicate connaissance des sentiments humains se combinent chez Raspoutine avec le grand projet de retrouver les “arrières” de l'homme contemporain, ou plus exactement de l'homme soviétique. Il s'agit d'un homme soviétique très différent de celui d'Alexandre Zinoviev : Raspoutine voit certes la même rapacité, la même lubricité, le même triomphe du médiocre que ce que nous propose le « ratorium » du célèbre sociologue dissident. Mais au-delà du sinistre “ratorium”, où chacun étrangle son voisin du mieux qu'il peut, Raspoutine dessine en filigrane un homme ni nouveau ni ancien qui précisément cherche ses “arrières”, ne cède pas aux lois du “ratorium”, ne vit pas dans l'oubli narcotique de la jungle sociale, mais tente de vivre selon sa conscience.
Le premier récit, poignant dans sa nudité, fut le merveilleux De l'argent pour Marie. Au kolkhoze de Kouzma et Marie, personne ne veut tenir le magasin car tous les gérants précédents ont eu la “guigne” : les clients trompent immanquablement, implorent crédit et puis l'inspecteur vous tombe dessus, fait l'inventaire, constate le “trou” dans la caisse et c'est 15 ans de bagne pour “sabotage économique”. Pourtant comment survivre si le magasin reste fermé ? Marie cède aux injonctions du président du kolkhoze ; pendant six ans elle tient vaillamment le magasin, mais voici que survient l'inspecteur. Il y a un “trou” de mille roubles : Kouzma ni Marie n'en ont jamais possédé autant ! Alors commence la vaine quête de Kouzma auprès des voisins pour emprunter la somme : chacun compatit mais se dérobe. La lâcheté, la fourberie, l'avarice ou la malignité l'emportent. Le président du kolkhoze est un ancien “zek”, il a fait 15 ans de bagne pour un crime économique imaginaire. Il convoque les six fonctionnaires du kolkhoze, les seuls à recevoir une paye et leur propose de donner leur paye du lendemain à Kouzma. Sous le regard du président chacun des six fonctionnaires accepte (« nous autres aussi on en a un petit peu de conscience ») mais le lendemain commence une sinistre comédie, très gogolienne, où chacun vient, soi-même ou par épouse interposée, récupérer sa part. Marie n'aura pas l'argent, l'égoïsme triomphera ; elle ira au bagne et ses 4 enfants resteront orphelins… Ce qui est étonnant dans cette nouvelle, c'est de voir se rejouer la comédie humaine dans une réalité soviétique qui en somme n'a rien changé. L'homme naît libre ou esclave de cœur, bon ou mauvais…
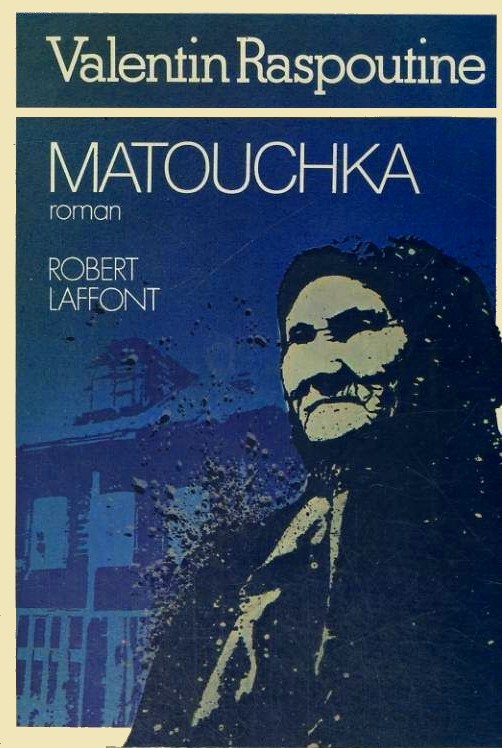 L'ultime délai (on a “traduit” en français : Matouchka) raconte les derniers jours d'une vieille Sibérienne, une vieille femme croyante : ses enfants se sont rassemblés autour d'elle pour son dernier soupir ; mais voilà qu'elle tarde malicieusement à mourir et que querelles, mesquineries, attendrissements, incompréhensions entre générations, entre ruraux et citadins éclatent autour de la mourante. Les hommes se saoulent, les femmes se querellent. La vieille Anna rampe au petit matin pour accéder une fois encore à la splendeur du jour levant. C'est toute la pureté baptismale du monde qui s'engouffre dans l'âme de la vieille Anna, pourtant « aussi inutile qu'une bougie en plein soleil ». Voici un dialogue entre Anna et sa voisine :
L'ultime délai (on a “traduit” en français : Matouchka) raconte les derniers jours d'une vieille Sibérienne, une vieille femme croyante : ses enfants se sont rassemblés autour d'elle pour son dernier soupir ; mais voilà qu'elle tarde malicieusement à mourir et que querelles, mesquineries, attendrissements, incompréhensions entre générations, entre ruraux et citadins éclatent autour de la mourante. Les hommes se saoulent, les femmes se querellent. La vieille Anna rampe au petit matin pour accéder une fois encore à la splendeur du jour levant. C'est toute la pureté baptismale du monde qui s'engouffre dans l'âme de la vieille Anna, pourtant « aussi inutile qu'une bougie en plein soleil ». Voici un dialogue entre Anna et sa voisine :
« — Écoute, ma vieille, on dépend tous de Dieu, et il en sera fait selon Sa volonté. On marchera jusqu'à tant qu'Il voudra.
— Je me tue à te répéter que moi, ce n'est pas marcher que je fais, c'est ramper à ses ordres. Attendre ici, que je me suis dit, serait trop bête. La mort m'a sûrement oubliée ; j'irai me montrer au jour, pour qu'elle me reconnaisse ».
Dans Matouchka la poétique spatiale de Raspoutine est déjà remarquable : elle imprègne littéralement tout le texte d'un sens religieux de la vastitude et de la pureté du monde :
« L'aurore montait, diligente, nette, rapide. Dans le ciel, surtout dans la partie que la mère voyait, le bleu devançant le soleil s'installait déjà, noyait la lumière laiteuse du premier jour naissant. En dépit de l'heure matinale la forêt brillait dans sa splendeur et faisait toilette, arbre par arbre ».
Raspoutine est un paysagiste dans la grande tradition russe, celle qui, de Tourgueniev à Iouri Kazakov, a fait du paysage russe un intarissable réservoir de bonté, de beauté et de pureté. Mais Raspoutine réaffirme avec un talent poétique particulier cette vocation spirituelle du paysage russe qui était celle célébrée par Dostoïevski (en particulier par l'errant Macaire dans l’Adolescent) : la pénétration du divin dans chaque molécule de vivant, la bénédiction de la nature, la permanente cohabitation de l'homme et de la création divine :
« Durant son existence, elle avait toujours vénéré ce mystère dont les contours obscurs hantaient fréquemment son esprit, l'incitant à méditer sur le soleil, la terre, l'herbe, les oiseaux, les arbres, la pluie, la neige — en somme sur tout ce qui cohabitait avec les humains pour les réjouir de sa présence et les préparer à leur fin ».
Les 2 autres romans (ou plutôt “grands récits” — en russe “Povesti”) de Raspoutine sont eux aussi situés en Sibérie. Le premier est Vis et n'oublie pas, l'histoire d'un déserteur de la dernière guerre. Le sujet était tabou, ou bien matière à du grand guignol patriotique. Raspoutine a bâti un drame lent et lancinant avec l'histoire de son déserteur. Il a déserté non par lâcheté mais par irritation : sa permission a été injustement rapportée. Et puis, après tant d'épreuves et de sang, quelque chose a lâché dans la trame de son âme. Il revient au pays et se cache sur la haute rive sauvage et boisée de l'Angara, face à son village. Nastiona, sa femme, s'aperçoit de son retour à la disparition d'une hache, dans la cabane de l'étuve. Le fugitif doit maintenant apprendre à vivre seul, en pleine forêt, comme une bête. Il retrouve certes Nastiona, le corps et l'amour de Nastiona, mais il l'entraîne dans son désespoir sans issue. Épiée, puis traquée par ceux du village, Nastiona enceinte est poursuivie dans la nuit, sur les eaux noires de l'immense Angara par les hommes du village afin qu'elle “donne” le déserteur. Alors, doucement, elle bascule dans le flot ténébreux de l'Angara : vivre, ne pas oublier… c'est impossible.
 L'autre récit L'Adieu à Matiora raconte l'immersion d'un village installé sur une île de l'Angara, à la suite de la construction d'un barrage. D'un côté une civilisation ancestrale, enracinée, respectueuse des valeurs, de l'autre une civilisation technicienne qui “prépare le terrain” en faisant table rase de l'ancien en passant les cimetières au bulldozer. La sombre beauté du paysage de ce royaume humide, la résistance morale des paysans, le recours à un parler dialectal très imagé, font de ce récit le plus dense de tous les textes de Raspoutine. Depuis Essenine, jamais le drame rural russe n'a été mis en relief avec cette puissance :
L'autre récit L'Adieu à Matiora raconte l'immersion d'un village installé sur une île de l'Angara, à la suite de la construction d'un barrage. D'un côté une civilisation ancestrale, enracinée, respectueuse des valeurs, de l'autre une civilisation technicienne qui “prépare le terrain” en faisant table rase de l'ancien en passant les cimetières au bulldozer. La sombre beauté du paysage de ce royaume humide, la résistance morale des paysans, le recours à un parler dialectal très imagé, font de ce récit le plus dense de tous les textes de Raspoutine. Depuis Essenine, jamais le drame rural russe n'a été mis en relief avec cette puissance :
« Avant, on la distinguait très fort, la conscience. Si quelqu'un la mettait de côté, ça se voyait tout de suite, en vivait tous en vue les uns des autres. Le peuple, bien sûr qu'il était de toute sorte. Y en avait qui aurait bien voulu vivre en conscience, mais où la prendre quand on n'est pas né avec elle ? Ça s'achète pas. Et puis y en avait qui en avaient de trop, même que ça n'était pas drôle. On lui enlève la dernière chemise et il dit même merci à ceux qui le déshabillent… »
Moins qu'un récit “écologique”, L'Adieu à Matiora, est un poème sur la résistance morale et sur la mémoire humaine. « Que doit sentir un être humain pour qui ont vécu les générations ? » demande Raspoutine. En somme c'est du prix à payer pour l'innovation qu'il s'agit. À des kyrielles de romans communistes “productivistes”, Raspoutine oppose cette simple et opiniâtre question.
[Ci-dessous : Conte moderne aux accents tragiques, Vis et n’oublie pas est aussi une image de la Russie d'aujourd'hui, avec sa vision pessimiste d'un monde chaotique sans règles, et dans lequel on ne se reconnaît guère. Avec son profond humanisme et sa voix singulière, la valeur du roman tient indéniablement à son style dosant habilement les tournures anciennes et le parler populaire. Ce qui fonde un peuple c'est sa langue, et Valentin Raspoutine démontre qu'il sait tirer parti avec talent de sa richesse.]
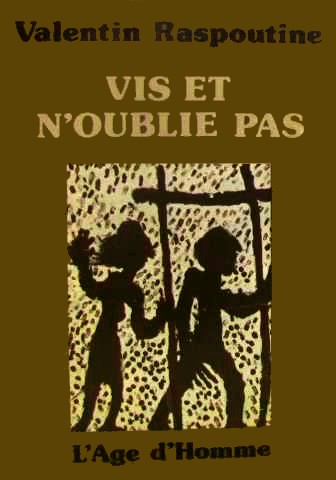 L'écrivain soviétique Valentin Raspoutine est-il chrétien ? Est-il nationaliste ? Est-il “national-communiste” ? (Ce mot est revenu à la mode dans l'émigration russe, on l'utilisait dans les années 20 pour les émigrés pro-soviétiques). Pour clarifier le problème, relevons que nulle part Raspoutine ne cède à la tentation impériale russe. S'il relit le grand historien Serge Soloviev et sa monumentale Histoire de Russie (1851-79), s'il relit Karamzine et son Histoire de l’État russe (1818-24), ce n'est pas pour nourrir artificiellement son œuvre d'une historiosophie discutable. Mais pour vivre, la nation russe doit se rappeler. Dans un intéressant article, le poète soviétique Eugène Evtouchenko, l'auteur des « Héritiers de Staline » note justement que cette devise de Raspoutine va contre la règle générale du : « vis et oublie ! » L'oubli fabriqué par le totalitarisme, l'oubli de la déculturation idéologique est l'adversaire de Raspoutine. Le simple fait que sa voix puisse s'élever dans la Russie soviétique prouve à quel point les choses sont plus compliquées qu'on ne nous les présente souvent sur les tréteaux parisiens. Il y a chez Raspoutine, comme chez Belov, Astafiev, Abramov, une certaine quête des origines russes, de cette civilisation de l'entraide paysanne qui a si fort fasciné le communiste et russophile Pierre Pascal (cf. sa Civilisation paysanne russe) : cette quête les relie, en dépit de tout à celle d'un Soljenitsyne dans son exil. Cela qui ne signifie nullement qu'il existe un “parti” rural ou national russe…
L'écrivain soviétique Valentin Raspoutine est-il chrétien ? Est-il nationaliste ? Est-il “national-communiste” ? (Ce mot est revenu à la mode dans l'émigration russe, on l'utilisait dans les années 20 pour les émigrés pro-soviétiques). Pour clarifier le problème, relevons que nulle part Raspoutine ne cède à la tentation impériale russe. S'il relit le grand historien Serge Soloviev et sa monumentale Histoire de Russie (1851-79), s'il relit Karamzine et son Histoire de l’État russe (1818-24), ce n'est pas pour nourrir artificiellement son œuvre d'une historiosophie discutable. Mais pour vivre, la nation russe doit se rappeler. Dans un intéressant article, le poète soviétique Eugène Evtouchenko, l'auteur des « Héritiers de Staline » note justement que cette devise de Raspoutine va contre la règle générale du : « vis et oublie ! » L'oubli fabriqué par le totalitarisme, l'oubli de la déculturation idéologique est l'adversaire de Raspoutine. Le simple fait que sa voix puisse s'élever dans la Russie soviétique prouve à quel point les choses sont plus compliquées qu'on ne nous les présente souvent sur les tréteaux parisiens. Il y a chez Raspoutine, comme chez Belov, Astafiev, Abramov, une certaine quête des origines russes, de cette civilisation de l'entraide paysanne qui a si fort fasciné le communiste et russophile Pierre Pascal (cf. sa Civilisation paysanne russe) : cette quête les relie, en dépit de tout à celle d'un Soljenitsyne dans son exil. Cela qui ne signifie nullement qu'il existe un “parti” rural ou national russe…
Le commun dénominateur est ici le thème de la résistance morale par delà la déculturation trop bien décrite par Zinoviev. Autrement dit c'est la survie russe que montre un Valentin Raspoutine. Cet homme jeune, si fidèle à l'immense espace de sa Sibérie natale, à la sauvage beauté de son fleuve natal, l'Angara, si subtilement apte à décrire les replis les plus pudiques de l'âme est avant tout un poète. Poète de l'espace, poète de l'homme, poète de l'adolescence. Un de ses plus beaux courts récits, Rudolfio raconte l'histoire d'un amour de fillette pas encore femme pour un homme de 26 ans. Rudolf ne sait pas comment répondre à l'amour de l'ombrageuse petite Io, qui a 15 ans et qui imagine leur union en fusionnant leurs noms en “Rudolfio”. Il ne lui donne pas le rêve qu'elle exige ; elle reçoit une leçon de banalité : c'est l'entrée dans l'univers des “grands”. Un univers que Raspoutine décrit si bien parce qu'il en sent encore, comme Io, toutes les écorchures… Parce qu'il est avec l'arbre et non le bûcheron…
► Georges Nivat, Magazine littéraire n°171, 1981. [Repris dans : Vers la fin du mythe russe, Âge d'homme, 1982]

Valentin Raspoutine, le “janséniste de l'Angara”
 Le poète Nikolaï Nekrassov écrivit en 1872 un long poème en 2 parties sur « les femmes russes ». Il y chantait l'exploit moral de 2 femmes russes, 2 princesses, qui avaient quitté tout le luxe de leur vie d'aristocrates pour suivre au bagne, à Nerchinsk dans le fin fond de la Sibérie, à 3 jours de traîneau d'Irkoutsk, leurs époux condamnés pour participation au complot du 14 décembre 1825. L’exploit de ces femmes est resté à tout jamais dans la légende russe. La princesse Volkonsky, qui, dans le poème, raconte sa vie à ses petits-enfants, célèbre avec émotion le peuple russe, le rude peuple des bagnards dont la fluette princesse n'avait jamais eu à se plaindre :
Le poète Nikolaï Nekrassov écrivit en 1872 un long poème en 2 parties sur « les femmes russes ». Il y chantait l'exploit moral de 2 femmes russes, 2 princesses, qui avaient quitté tout le luxe de leur vie d'aristocrates pour suivre au bagne, à Nerchinsk dans le fin fond de la Sibérie, à 3 jours de traîneau d'Irkoutsk, leurs époux condamnés pour participation au complot du 14 décembre 1825. L’exploit de ces femmes est resté à tout jamais dans la légende russe. La princesse Volkonsky, qui, dans le poème, raconte sa vie à ses petits-enfants, célèbre avec émotion le peuple russe, le rude peuple des bagnards dont la fluette princesse n'avait jamais eu à se plaindre :
Vous tous, je vous salue bien bas !
Merci ! ô merci, hommes simples
Qui nous aidiez tout simplement !
Pas un de vous ne se moqua,
Pour vous malheur est sainteté…
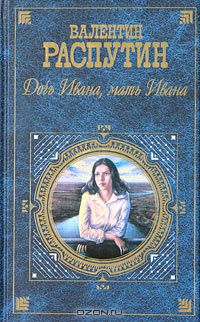 La longue nouvelle de Valentin Raspoutine Fille d’Ivan – Mère d’Ivan [tr. fr. : L'honneur de Tamara Ivanovna] (qui est un hybride de roman et de nouvelle, comme tous les textes de Raspoutine) est comme un lointain écho au poème de Nekrassov. Son titre aurait pu être « La femme russe », car l'héroïne, fille d'Ivan, et mère d'Ivan, femme d’Anatole, a pris le relais des 2 princesses « femmes de décembristes ». C'est sur elle que tient à présent l'honneur et la survie du peuple ; elle ne vient pas d'une lointaine capitale plus européenne que russe, elle n’a pas connu les gouvernantes françaises et les bals à la cour, elle n’a pas suivi son mari au bagne tout simplement parce que l'héroïsme est passé du côté de la femme russe du peuple, c'est elle la décembriste d'aujourd'hui, celle qui résiste moralement à l'arbitraire. Sa révolte n’a rien de politique, ne doit rien aux mentors occidentaux, c'est la révolte d'une mère courageuse et d'un tempérament ombrageux devant l'offense subie par sa fille qui a été violée par un freluquet caucasien, mais l'offense subie est plus générale encore puisque c’est tout le pays qui est violenté, tout le peuple qui est déboussolé, convulsivement rivé aux violences de l'écran de télévision, bousculé dans ses aîtres traditionnels, inondé de pacotille chinoise et de revendeurs escrocs. Un peuple qui a perdu l'axe même de sa vie. À croire que, comme lance Anatole, l'époux de l'héroïne, tous ont été débarqués d'un camion-remorque énorme, comme des déportés, sans passé ni racines.
La longue nouvelle de Valentin Raspoutine Fille d’Ivan – Mère d’Ivan [tr. fr. : L'honneur de Tamara Ivanovna] (qui est un hybride de roman et de nouvelle, comme tous les textes de Raspoutine) est comme un lointain écho au poème de Nekrassov. Son titre aurait pu être « La femme russe », car l'héroïne, fille d'Ivan, et mère d'Ivan, femme d’Anatole, a pris le relais des 2 princesses « femmes de décembristes ». C'est sur elle que tient à présent l'honneur et la survie du peuple ; elle ne vient pas d'une lointaine capitale plus européenne que russe, elle n’a pas connu les gouvernantes françaises et les bals à la cour, elle n’a pas suivi son mari au bagne tout simplement parce que l'héroïsme est passé du côté de la femme russe du peuple, c'est elle la décembriste d'aujourd'hui, celle qui résiste moralement à l'arbitraire. Sa révolte n’a rien de politique, ne doit rien aux mentors occidentaux, c'est la révolte d'une mère courageuse et d'un tempérament ombrageux devant l'offense subie par sa fille qui a été violée par un freluquet caucasien, mais l'offense subie est plus générale encore puisque c’est tout le pays qui est violenté, tout le peuple qui est déboussolé, convulsivement rivé aux violences de l'écran de télévision, bousculé dans ses aîtres traditionnels, inondé de pacotille chinoise et de revendeurs escrocs. Un peuple qui a perdu l'axe même de sa vie. À croire que, comme lance Anatole, l'époux de l'héroïne, tous ont été débarqués d'un camion-remorque énorme, comme des déportés, sans passé ni racines.
Les racines, c'est depuis toujours le thème central de Raspoutine, ce Sibérien timide aux yeux doux, mais qui ne supporte pas les mauvais traitements de la vie. Sa révolte avait commencé sous le régime soviétique. Il appartenait à ce qu’on peut baptiser la résistance morale, ou la dissidence douce : révolte contre le saccage du sol natal par l'énorme machine à brutaliser et à industrialiser du marxisme au pouvoir, révolte contre le vide spirituel, contre la liquidation de la vie paysanne. Avec Astafiev, son “voisin” de Krasnoïarsk, avec Vassili Belov, enraciné dans le Nord de la Russie, avec Zalyguine il représentait une sorte d'opposition tolérée, publiée dans certaines limites, et reconnue par le lointain Alexandre Soljénitsyne depuis son exil américain.
En 2000, le prix Soljénitsyne fut remis à Raspoutine en la Maison de l'émigration russe de Moscou, et son éloge prononcé par l'auteur de L’Archipel du Goulag.
À la frontière des années 70 et 80 se produisit dans la littérature soviétique un tournant qui ne fit pas de bruit et ne fut pas immédiatement remarqué, car il n’était accompagné d'aucune provocation dissidente. Sans rien bousculer et sans déclarations explosives, un groupe d'écrivains se mit à écrire comme s'il n’y avait aucune directive officielle concernant le “socialisme réaliste” ; en le neutralisant discrètement, ces écrivains se mirent à écrire dans la simplicité, sans concessions, sans encenser le régime soviétique, comme s'ils avaient oublié son existence. Leur matériau était pour l'essentiel la vie à la campagne, eux-mêmes étaient issus de la campagne, et c'est ce qui explique (mais la condescendance satisfaite du cercle des intellectuels, non dénuée d'envie, l'explique aussi) qu'on se mit à les appeler les “écrivains ruraux”. Il eût été plus juste de les baptiser “écrivains moraux”.
C'est en effet un mystère que la relative tolérance qu’eut le régime de Brejnev pour ces écrivains, dont Raspoutine. On peut peut-être l'expliquer par le fait que plusieurs des dirigeants provenaient eux-mêmes de la campagne et se retrouvaient en partie dans les œuvres de Raspoutine ou de Belov, de Choukchine ou d'Astafiev.
L’entrée dans la littérature de Raspoutine se fit avec un petit récit très délicat, La Leçon de français, et surtout avec Vis et n’oublie pas, un de ces récits-nouvelles, qui ont en russe pour nom générique “povest”, qui veut dire chronique, et qui excède la nouvelle par son ampleur, mais n’égale pas le roman par la minceur du thème central (toujours axé sur un épisode dramatique révélateur, comme dans la nouvelle au sens italien du terme de novella). Chez Raspoutine, ce genre allie une grande subtilité poétique à une forte tendance à l'allégorie. La vie soviétique enseignait à vivre en oubliant : la ligne générale du Parti faisait de tels zigzags, l'histoire sanglante des purges pratiquait de telles coupes dans le matériau humain que se rappeler tout équivalait à un crime politique et menait à sa propre perte. L’onde d'Innocent, le héros du Premier Cercle de Soljénitsyne garde en cachette dans son isba miséreuse une collection de journaux soviétiques des années 20 dont la seule conservation était un crime, puisque petit à petit tous les dirigeants politiques bolcheviks, épurés et châtiés, étaient devenus des non persons, comme les nomme Orwell. Or Vis et n oublie pas aborde précisément un des tabous les plus épais du non-dit soviétique, le phénomène massif de la désertion au moment de l'entrée en guerre de 1941. Mais en centrant la dynamique poétique de son récit non sur le déserteur, mais sur l'épouse du déserteur, la seule à connaître le secret, et qui va le ravitailler clandestinement en traversant à grand risque le redoutable fleuve Angara, Raspoutine sut mettre à jour ce drame, lui donner un relief saisissant, un épilogue tragique, et surtout une signification allégorique plus générale quoique inexprimée : il y a dans l'humain une fibre que l'on ne saurait anéantir.
Lentement, avec l'économie de moyens et de mots qui est la sienne — Raspoutine est lui-même un grand “taiseux”, peu fait pour les déclarations à la presse, et souvent tombé dans les traquenards tendus par les médias étrangers, qui ne l'aiment pas — Raspoutine construisit une œuvre d'une grande homogénéité : Le dernier délai, Adieu à la Matiora, L’Incendie. Adieu à la Matiora est un long récit-poème en prose sur l'anéantissement d'un village qui va être noyé pour les besoins d'un barrage hydroélectrique. Une sorte de long “pleur”, comme les aimait le peuple russe, et comme les folkloristes en ont recueilli des centaines en parcourant les campagnes de la seconde moitié du XIXe siècle aux débuts de l'ère soviétique. Une Russie anéantit l'autre, les adieux de la vieille Nastia à ses ancêtres, l'isba qu’elle nettoie et embellit pour la remettre aux destructeurs, comme on fait la toilette d'un mort, les déprédations, vols et viols des tombes, toute la grossière violence qui accompagne l'engloutissement de cette soviétique Kitège conduisent au tragique le plus classique : le malheur devait arriver. L’Incendie, paru au tout début de l'ère Gorbatchev, résonne comme l'annonce de la perestroïka, c'est-à-dire du désastre. La rapine, l'indifférence, la grossièreté ont pris le relais de la Russie pétrie de bonté et de courage qui était celle des ancêtres, celle que chantait à l'autre bout de la Russie le philologue et idéologue en chef du “caractère national russe”, l'académicien Dimitri Likhatchov. L’incendie rougeoie, une moitié du village retrouve les vieux gestes de l'entraide, l'autre moitié regarde avec une joie maligne. L’incendie va se répandre sur toute la terre russe…
On sait que, comme Astafiev et d'autres écrivains sibériens, Raspoutine éleva une protestation contre le projet titanique de détournement des fleuves sibériens qui ont la particularité de couler vers le Nord, c'est-à-dire les régions stériles de la terre sibérienne. Un projet prométhéen voulait les faire couler vers le sud et les chauds déserts en attente de colons. La protestation des écrivains eut raison des apprentis sorciers, du moins jusqu'à présent, car on voit reparaître le projet ces derniers temps. Respecter la pauvreté apparente de la terre sibérienne, c'est, pour Raspoutine, respecter son trésor caché de spiritualité.
Au nom de quoi Raspoutine élève-t-il sa voix grêle, mais que rien ne saurait jamais étouffer ? La réponse est difficile à donner, car il n’est pas un chrétien orthodoxe déclaré, il n’est pas et ne peut pas être, non plus que Soljénitsyne, un nostalgique de l'ère communiste, comme cela est devenu si fréquent dans la Russie amnésique d'aujourd'hui. Mais depuis la perestroïka, et l'énorme “remuement” de la Russie, Valentin Raspoutine dénonce une perte collective des fondements du pays. Les ancêtres sont trahis. Mais par qui ? Est-ce la télévision qui est coupable, elle que Raspoutine a toujours détestée, comme il déteste la chanson syncopée pop, l'engourdissement de l'âme dans le bruit moderne ? Est-ce le sournois envahisseur allogène, en l'occurrence le Caucasien qui tient la moitié des marchés et qui maltraite nos filles ? Est-ce nous-mêmes, les Russes d'aujourd'hui ? Mais alors depuis quand ?
Tolstoï n'hésitait pas à dénoncer la Russie elle-même pour les maux dont il la voyait accablée, et l'expliquait par l'abandon des fondements moraux de la Russie rurale, du peuple paysan. Il y a certes du tolstoïsme chez Raspoutine, mais le lecteur de Fille d’Ivan – mère d’Ivan percevra aussi dans l'œuvre une petite clochette obstinée qui désigne pour principal coupable « le Caucasien », et qui met mal à l'aise. Certes Raspoutine a retrouvé pour sa nouvelle une sorte de simplicité antique : tout se déroule de façon inéluctable, le monde vénal et bruyant qui a succédé au monde harmonieux, mais dur de Tamara Ivanovna conduit les plus faibles à la perte de leur identité, les plus vénaux à la concussion, les plus faibles au désespoir. Tamara Ivanovna agit comme une Antigone d'Irkoutsk. Elle a deviné que le procureur qui enquête sur la plainte de sa fille pour viol par un Caucasien va se laisser acheter, elle entrevoit même la scène juste au moment où de son sac à main, à travers le cuir, et sans la moindre hésitation, elle tire sur le coupable, exerçant ainsi son antique droit de vengeance. Après quoi elle se sent libérée, elle subira ses 5 ans de bagne avec dignité, elle sera applaudie par le public des assises, elle a fait justice, là où son père est trop vieux pour agir, son mari trop faible, son fils trop étourdi. Le mari Anatole se sait faible, et il philosophe avec un vieux SDF local sur la façon de “rester homme”. Elle, elle est restée femme, mère et fille, tigresse dans la vengeance, avec la même énergie masculine qu’elle mettait à conduire des camions quand elle a rencontré Anatole son mari au dépôt des camions. Jadis, disent les matrones qui commentent son acte, il fallait enfanter et enfanter sans cesse pour être une mère héroïne (titre que l'on décernait du temps de l'Union soviétique), et maintenant, il faut les défendre, ceux qu'on a enfantés, le revolver au poing…
La scène centrale qui clôt la première partie, où l'on voit Tamara se cacher dans l'enceinte de la procurature, se cacher dans un tas d'immondices, remonter furtivement et entrouvrir la porte du juge est un grand moment. Un moment de “thriller” et un instant de tragédie antique. L’acte est ici à son état pur, Tamara est Antigone.
Mais Raspoutine a voulu faire plus, et si le portrait du pleutre mari Anatole, qui n’arrive pas à s'adapter au délabrement des institutions soviétiques et tarde à quitter son ancien dépôt de camions, est relativement convaincant, si celui de son copain Diomine, parti dès la chute de la maison communisme et qui tient un kiosque privé sur le marché et a pu s'acheter une Mercedes, est lui aussi relativement convaincant — Diomine, quoique débrouillard, n’a pas perdu tout sens de la solidarité et du vieil honneur paysan — en revanche, le portrait d'Ivan, le fils lycéen qui peine à terminer ses études, hésite entre les skinheads et les “cosaques”, chacun de ces groupes autoproclamés voulant instaurer l'ordre par la brutalité (la “descente” des skinheads locaux dans la boite de nuit) ne nous convainc pas vraiment. L’auteur a confié au jeune homme un peu de son propre amour pour le mot russe, pour la densité poétique et étymologique du mot russe, et ces hymnes philologiques sont ici peu justifiés par l'économie du récit. Raspoutine veut-il nous dire qu'Ivan est appelé à être un écrivain ? Sa découverte du thesaurus de la langue russe est-elle une future catharsis qui aura lieu plus tard, au-delà de l'épilogue ? Le récit n’en dit rien, et ne peut rien en dire puisqu’il est centré sur autre chose. Autant la langue imagée de l'auteur, ses dialectismes, sa densité populaire intraduisible font la force de Raspoutine, autant ces digressions sur les découvertes philologiques de l'adolescent Ivan, qui n’a guère hérité le courage de son Antigone de mère, laissent perplexes.
Il y a, nous semble-t-il, dans la gaucherie de ces lignes secondaires emmêlées à l'intrigue principale, quelque chose de raté, bien sûr, mais aussi de touchant et d'inquiétant : Valentin Raspoutine, le reclus d'Irkoutsk, le chantre et le “découvreur” soviétique de la Sibérie, l'amoureux collectionneur du parler paysan, le moraliste misanthrope, bref, ce janséniste de l’Angara, peine à mettre en place sa propre vision du monde. Ce n’est pas hasard, c'est au contraire tragique nécessité : aucune catharsis toute faite ne lui semble en vue, et il exprime en cela le désarroi de toute une, ou même deux générations. La blessure intérieure ici est l'essentiel, les explications sociologiques ou démographiques semblent rajoutées. Une fois de plus, par la voix inflexible dans sa faiblesse de Raspoutine, s'élève la plainte. Une fois de plus, le tragisme l'emporte sur l'avenir et sur l'espoir, et l'on songe aux mots du philosophe Vladimir Weidlé, dans La Russie absente et présente : « L’histoire de la Russie est un échec ». Dite par un non-Russe, la formule serait une insulte, et une grossièreté. Dite par un Russe torturé, elle est un cri. Un cri de douleur…
► Georges Nivat, Vivre en Russe, L'Âge d'homme, 2007.

 Valentin Raspoutine et sa blessure
Valentin Raspoutine et sa blessure
Valentin Raspoutine, écrivain sibérien venu de l'Angara, est un homme timide, en perpétuelle quête de pureté morale, un écrivain et un homme avant tout autonome, quoique vulnérable, et impénétrable, une des figures les plus controversées de l'époque de la perestroïka, et cela bien malgré lui. Il a apporté dans les lettres soviétiques pendant les années 70 un souffle de fraîcheur extraordinaire. On a l'habitude de le classer dans ce qu'on appelle les “écrivains du village” (derevenščiki), groupe d'écrivains formé au début de ces années 70, qui comprenait Viktor Astafiev, Vassili Biélov, Vladimir Solooukhine, et aussi Vassili Choukchine, mort en 1974. Mais cette appellation est fallacieuse, car elle réduit ces écrivains à un concept de littérature régionale, au mieux elle en fait des régionalistes poétiques comme l'étaient la George Sand de François le Champi, le Ramuz de Derborence, Sergueï Aksakov d'Années d'enfance du petit-fils Bagrov ; au pire des chroniqueurs d'une vie rurale aujourd'hui inexistante, des passéistes impénitents, le plus souvent taxés aujourd'hui de chauvinisme et d'antisémitisme.
Parmi tous ces écrivains Valentin Raspoutine a une voix inimitable, faite de régionalisme sibérien, d'universalisme prophétique et de secrète blessure du moi. Avant tout c'est un rêveur d'unité et d'autonomie de la personne, et, par un certain côté, il se rattache de façon surprenante à Jean-Jacques Rousseau, au Jean-Jacques de la rêverie du lac de Bienne. « Je ne sais si pareille chose se produit chez d'autres, mais moi je n'ai pas de sentiment d'unité inséparable avec moi-même », écrit Raspoutine dans un petit chef-d'œuvre appelé Que dois-je dire de ta part à la corneille ?
« Je n'ai pas, comme il convient d'avoir, la perception interne que tout coïncide en moi du début à la fin, que tout se soude bien en un tout dans les plus petits détails, et que rien ne fronce ni n'a de jeu. Constamment, en moi quelque chose fronce, et a du jeu ; c'est par exemple la tête qui a mal, et pas d'un simple mal de tête que l'on peut corriger avec un cachet, mais on dirait qu'elle souffre de ne pas être sur la tête qui convient… »
Tout Raspoutine, dans son éternel sentiment douloureux du monde, dans sa gaucherie perpétuelle, dans l'indéfinissable attraction qu'exercent ses courts récits bâtis sur des broutilles, ses essais-lamentations sur l'unité en allée du monde russe, et même ses prises de position politiques, si peu politiques et si malhabiles, s'explique par cette “malchance” d'une difficulté à reconstituer l'unité essentielle, psychique et morale, de son propre moi.
« Il en résulte une seconde anomalie : je n'arrive absolument pas à m'habituer à moi-même. (…) Il suffit que je m'enfonce dans ma méditation, ou encore que je m'oublie dans une agréable carence de pensée, et voilà qu'on dirait que je m'envole dans une sorte d'au-delà étranger qui se présente à moi, et d'où je n'ai nul désir de revenir. Cette absence de domiciliation en soi, cette sorte de sentiment orphelin surgissent assez souvent, involontairement je me mets à me surveiller, à me guetter moi-même afin d'être au poste, bien en soi, mais tout le malheur vient de ce que je ne sais pas quel parti prendre, ni décider où est mon véritable ‘moi’ : dans l'objet de mon patient espoir ? ou bien dans ma fuite toujours ratée et toujours recommencée ? »
C'est cette fragilité intrinsèque, cette difficulté de l'âme à se domicilier sur terre et dans les choses en quoi consiste le cœur secret de l'œuvre de Valentin Raspoutine. Si nous avons évoqué le Jean-Jacques de la rêverie du lac de Bienne, c'est parce que certaines pages de Raspoutine sont consacrées à des rêveries de réunification de l'être, et que cette unité ne se retrouve jamais que transitoirement, et dans des états qui ne sont pas les états rationnels. Faire silence en soi et autour de soi est une des constantes de la poétique de V. Raspoutine, qui est une poétique de la solitude, et s'il aime tant les grands fleuves de la Sibérie, les espaces généreux de la taïga, les vastes prés couverts de baies au sud du lac Baïkal, c'est parce que là, l'âme parvient à faire silence et s'arrache à cette douloureuse distraction. Le récit dont nous avons extrait ce passage appartient aux petits récits autobiographiques de l'auteur. C'est une minuscule tranche de vie de l'écrivain qui nous est rapportée : le voici d'abord en vacances au-delà du Baïkal, avec sa fille. Il a inventé un jeu qui consiste à enquêter sur les petits événements de la vie de la fillette, puis à lui dire que la corneille est venue les lui raconter. Mais ce dimanche soir, il s'obstine à vouloir partir pour rentrer travailler à Irkoutsk dès le lendemain matin. La fillette se renferme, le père part, et les incidents du parcours une panne de carburant du car, un retard du bac, etc., sont autant d'épisodes retardateurs qui nous font comprendre que la corneille pourrait maintenant s'en prendre au père, et non plus à la fillette. Le narrateur retrouve la paix dans le silence extraordinaire du Baïkal, mais il se dit alors qu'il y a des questions au-delà desquelles on ne doit pas aller. Et cette magnifique soirée d'automne, si bien appariée à son âme, lui fait découvrir que c'est par un tel soir d'automne qu'il aimerait mourir « à l'heure lumineuse où s'ouvrent les espaces ».
Un autre récit autobiographique, les Leçons de français, nous fait découvrir l'enfance dure, et le caractère ombrageux du petit garçon Valentin. Envoyé à l'école à Irkoutsk, loin du village natal, parce qu'il a été repéré pour ses dons intellectuels, le petit Olivier Twist sibérien est malheureux, et ne mange pas à sa faim. Il se mêle à une bande de mauvais garçons qui jouent à une sorte de jeu de marelle, pour de l'argent, dans une carrière cachée. Mais lui joue parce que le rouble qu'il gagne à chaque fois par son adresse lui permet de s'acheter du lait au marché. Un jour qu'il s'est fait rudement tabasser, l'institutrice de français apprend qu'il joue pour de l'argent, ce qui, normalement, provoque le renvoi de tout élève surpris. Mais elle ne le dénonce pas, et découvre avec étonnement la misère du garçonnet, et du milieu rural dont il est originaire. Elle tente par diverses ruses de le nourrir, mais ne parvient pas à vaincre la réserve ombrageuse du garçon. Elle invente alors de lui donner des leçons de français chez elle, mais il refuse de dîner avec elle, il évente même facilement son stratagème, lorsqu'elle lui envoie un paquet de vivres par la poste. Elle finit par lui demander de jouer avec elle à un jeu auquel elle jouait petite fille, et pour de l'argent. Le garçon apprend vite, et glane des piécettes, mais, surprise avec lui par le directeur, elle est mutée. Cette délicate intrigue entre un garçonnet timide et sauvage et une jeune femme de 25 ans est menée avec un tact remarquable, et fait de Raspoutine un maître de la psychologie adolescente.
Ce thème de la solitude de l'être humain, de son inaptitude à s'enraciner dans le quotidien, nous le retrouvons tout au long de l'œuvre de Raspoutine. Son premier grand succès artistique a été le récit De l'argent pour Marie (1967). Marie tient le magasin du kolkhoze, et il est impossible de le faire sans donner à crédit, sans se laisser attendrir par la misère et les comédies des gens, et sans créer ainsi un “trou” dans la caisse.
« Après Rosa, le magasin était resté fermé pendant quatre mois. Personne n'acceptait d'être vendeur. Même pour des allumettes, les gens devaient se rendre à plus de vingt kilomètres, à Alexandrovskoïé, et lorsqu'ils arrivaient là-bas, le magasin n'était pas toujours ouvert. Inutile de le dire, le village en avait plus qu'assez… Le conseil rural téléphonait sans cesse au centre d'approvisionnement, d'où on leur répondait : Cherchez vous-mêmes quelqu'un sur place. Mais les gens disaient : On en a assez de fournir le quota pour les prisons. Chacun avait peur ».
Marie s'est laissée fléchir, contre les conseils de son mari, Kouzma. L'inspecteur vient et trouve ce “trou” ; Marie sera jugée et condamnée, si en 5 jours elle ne trouve pas mille roubles. La menace se referme sur Marie comme un nœud coulissant : dans une fable dont le thème est soviétique, mais dont la morale tragique est de tous les temps, Raspoutine nous montre, aussi bien que Tolstoï dans le Faux Coupon, la malédiction de l'argent, et l'égoïsme des hommes. Au Conseil du kolkhoze tout d'abord, où Kouzma est assis devant eux, « comme au tribunal ». Ensuite c'est la tournée des voisins, puis des notables du village, le vétérinaire et les autres. Presque tous refusent, certains prodiguent des bons conseils. « Le troisième jour prit fin aussi. À l'heure venue, il disparut sous terre, comme dans une tombe et de ce jour, il ne resta plus une miette. Il restait maintenant deux jours, trois jusqu'au retour de l'inspecteur ». Alors Kouzma part en ville pour implorer son frère. Il neige au sortir du train, et Kouzma prend l'adresse chiffonnée qu'il a dans sa poche. Il arrive devant la porte du frère : « Voilà, il est arrivé. Prie, Marie ! Maintenant on va lui ouvrir. » Le symbolisme de Raspoutine est discret, mais puissant : cette porte, c'est celle du cœur, celle du paradis, celle dont parle le Christ dans les Évangiles.
Le deuxième grand récit de Raspoutine fut le Dernier délai, un récit sibérien à forte consonance tolstoïenne… C'est qu'il s'agit, comme si souvent chez Tolstoï, de décrire une mort, le long processus d'une mort et de tout ce qu'elle révèle, la mort en tant que « détecteur de mensonge », comme le dit l'exégète soviétique de Raspoutine, Svétlana Sémionova. Au centre, une vieille femme, qui a convoqué ses enfants, venus de la ville, et devenus des bourgeois soviétiques, pour sa mort. Anne est une vieille femme dépositaire des antiques secrets de sagesse. Elle ressemble à ces vieilles femmes de Soljenitsyne, comme Stepanida dans le Pavillon des cancéreux, ou encore Matriona, que l'auteur interroge non par goût du passé, mais parce qu'elles seules ont su préserver, dans leur dénuement, un peu de la sagesse chrétienne d'autrefois, même si elles-mêmes n'en sont pas pleinement conscientes… Voici par ex. les retrouvailles entre Anne et son fils :
« Anne le dévisagea jusqu'à l'épuisement. Elle cherchait en lui son fils, celui qu'elle avait enfanté et élevé, le fruit de ses labeurs. Mais sitôt retrouvé, sitôt reperdu. Il ressemblait à son Ilia, et puis ce n'était plus du tout lui. Son garçon avait pris du poids, et puis il avait côtoyé tant de gens qu'elle, la mère, n'avait jamais connus ! Il lui était étranger. »
Anne fait attendre sa mort, et les enfants perdent patience. Elle écoute la vie, et semble s'en pénétrer avant de partir. « Figée dans une attitude étrange, dénuée de chaleur humaine, elle donnait l'impression d'être pénétrée d'une faculté d'entendre et de retenir des choses inaccessibles aux autres ». Des trois morts que représenta jadis Tolstoï, celle d'une dame du monde, celle d'un moujik et celle d'un arbre (dans l'ordre croissant de sérénité et d'adéquation à la nature), c'est à la mort du moujik que fait penser celle d'Anne.
« Malgré tout, la Mère ne se plaignait pas. Bonne ou mauvaise, cette vie lui avait appartenu, — c'était même la seule chose qui lui eût appartenu en propre. (…) Anne avait eu une vie simple, ne représentant en somme qu'une succession de répétitions : enfanter, travailler, dormir quelques heures avant de se replonger dans les mêmes tâches, — et sans jamais changer de décor, là-même où elle était venue au monde ».
Ce récit de Raspoutine est un de ceux où perce une consolation de type encore préchrétien, sans doute panthéiste, sans que l'auteur s'en doute. La vieille Anne médite sur toutes les particules de la vie, tout ce qui cohabite avec les humains, et il lui semble que le type de présence au monde que représente sa vie n'est pas du tout forcément le seul type d'existence. D'ailleurs elle a des moments où il lui semble nettement qu'elle a déjà vécu sa vie dans une vie antérieure. « Cette existence antérieure, l'avait-elle vécue sous les traits d'une apparence humaine, avait-elle marché, rampé ou volé ? Si l'on observe la naissance des volatiles, elle a lieu, en somme, deux fois : l'oiseau vient d'abord au monde enfermé dans sa coquille, puis il naît de nouveau en la brisant. » Étrangement la vieille Sibérienne de Raspoutine semble donc retrouver la philosophie bouddhiste, suivant, en quelque sorte, le chemin qu'avait, avant elle, parcouru Léon Tolstoï.
Vis et n'oublie pas qui date de 1974, et fut couronné en 1977 par le prix d'État (ancien prix Staline), est une nouvelle tragique sur un déserteur qui revient se cacher près de son village sur l'Angara, dont la femme devine la présence clandestine, et qu'elle retourne voir dans la forêt. Nastiona, comme Marie, est cernée par la méchanceté des hommes, qui, à la dernière page du récit, la pourchassent dans la nuit sur l'Angara, dans les flots duquel elle va se précipiter volontairement.« L'Angara eut un remous, la barque vacilla, dans la faible lumière de la nuit des ronds se formèrent et s'étendirent. Mais l'Angara eut un sursaut plus fort, il défroissa la surface et referma les ronds, et il ne resta plus rien sur place, pas même un creux sur lequel aurait pu trébucher le courant ». Le sort de Gousskov, le déserteur, qui rôde autour du village où sont ses parents et sa femme, est symbolique de cet exil de l'homme raspoutinien, ou plutôt de sa difficulté à se domicilier sur cette terre, même quand toutes les choses les plus familières, et la quotidienneté, sont là, à portée de main. L'étuve, qui dans les villages russes et surtout sibériens est toujours un bâtiment de rondins bien séparé de l'isba, au fond du jardin, devient le lieu de rendez-vous de Nastiona et son mari, c'est là qu'elle lui laisse la nourriture pour ses visites nocturnes et secrètes. Raspoutine est le premier à évoquer le problème des déserteurs de la Seconde Guerre mondiale, qui se sont parfois cachés pendant des décennies, et cette situation lui permet de procéder à une sorte de déréalisation, et de liturgisation des composantes les plus simples de la vie. Les 2 parias de la société que sont le déserteur condamné à se cacher jusqu'à la fin de ses jours, ou l'épouse condamnée à la pire des simulations et des solitudes, tous deux vivent la vie quotidienne comme un mauvais rêve. Toutes les mœurs paysannes de ce village de pêcheurs, décrites avec fidélité et précision, ont un sens métaphysique précis : ce sont les espèces d'une communion avec le monde, qui est refusée aux héros, et peut-être même à l'humanité entière depuis qu'elle est séparée d'avec elle-même. La dispute sourd entre ces 2 exilés de la vie.
« Tu en parles beaucoup du destin depuis quelque temps. Avant j'avais pas remarqué que tu t'en souciais tant que ça. — Tu ne devrais pas me le reprocher. Comment ne pas en parler, quand il est là, juste à côté, accroupi à mes pieds, qu'il ne me laisse pas faire un pas, qu'il me tient dans ses griffes, me fait faire ce qu'il veut. » (Chapitre 10).
Cette présence du destin pelotonné au fond des êtres donne au récit une rigueur purement classique. La nemesis est à l'œuvre, et aucune fioriture du destin n'aura lieu, aucun rebondissement de la fable, tout s'enchaînera avec la force de la tragédie antique. Seule se dissipe « la brume du cœur ». Et s'instaure cette sorte d'attention forcenée au réel qui donne des pages surprenantes, presque chagalliennes, par exemple lorsque, en rôdant autour de la maison de ses parents, Gousskov aperçoit dans l'enclos, derrière un merisier une grosse vache tachetée, noir et blanc avec son veau. Ces sortes de maternités animales — il y en a plusieurs dans le récit — sont poignantes, parce qu'elles soulignent précisément la perte du rapport au monde chez les humains. Gousskov n'aura plus jamais à s'occuper des bêtes : « Cette perte n'était pas essentielle, comparée à d'autres, mais il ne savait pourquoi, elle lui était particulièrement douloureuse et inexplicable, quelque chose en lui refusait de l'admettre ».
Le thème du souvenir, de la trace dans la mémoire est essentiel à tout le récit. Au despotisme idéologique qui régit les mémoires des hommes, qui fait s'évanouir à volonté les souvenirs, Raspoutine oppose le profond sillon du destin, ineffaçable ; le déserteur dont le souvenir se perd dans les sables, que les gens évitent de mentionner dans les conversations, qui n'a même plus de refuge dans les mémoires humaines, est l'image même d'un monde totalitaire où il ne fait pas bon se souvenir, où oublier est la condition de la survie. Dans sa remémoration de sa vie, Gousskov sait bien qu'il est devenu une cendre, moins encore, un souvenir de cendre.
Le livre le plus connu de Valentin Raspoutine — il en a été tiré un film par Elem Klimov — est l’Adieu à Matiora (1976). La disparition du village qui depuis 300 ans est bâti sur une île au milieu du fleuve Angara, et qui est maintenant condamné à l'engloutissement du fait de la construction d'un barrage hydro-électrique, est à l'évidence un symbole. Il s'agit de « l'île des morts », comme dans le célèbre tableau de Boecklin qu'ont tant aimé les symbolistes russes, et dont le jeune Raspoutine a sans doute vu une reproduction. L'insertion mythique du récit est fondée sur la simplicité de l'allégorie, le langage incantatoire des vieilles gardiennes de l'île, la puissance du débat entre le vivant et le mort dans la civilisation moderne industrielle. Raspoutine semble ici proche de toutes les antiques civilisations fondées sur le culte des morts, c'est-à-dire, comme l'écrit Svetlana Sémionova, sur la verticalité de la mémoire humaine. Le refus de voir détruire les tombes par l'équipe de désinfection correspond à la défense d'une conception archaïque des ancêtres, plus présents que les vivants sur l'île. Les éléments réalistes ne manquent pas dans le récit, conduit de main de maître, et nous savons que Raspoutine n'a eu qu'à prendre l'histoire de son propre village natal sur l'Angara, englouti par un barrage. Mais l'allégorie commande tout : en noyant l'île de l'humanité, la civilisation de l'oubli prépare un monde différent, d'où les vieilles forces spirituelles du monde auront été chassées.
L'antique rite funéraire semble ici s'appliquer non à une personne humaine mais à tout le village, et à toute une civilisation. De tous les “écrivains de la campagne”, Raspoutine se distingue par le tragisme aigu de sa perception. Certes le monde rural que décrit Vassili Biélov dans Harmonie, qui se veut une encyclopédie du cosmos du village russe, est aussi décrit sur le mode du regret, mais sans ce poignant rituel d'engloutissement collectif des vivants et des morts, qui sont condamnés à une seconde mort. Viktor Astafiev, lui, nous a laissé dans le Tsar-Poisson une puissante allégorie où la lutte de l'homme et de la nature (qui reprend le symbole chrétien du “Christ-poisson” — ichtus) alterne avec des “cènes” communautaires dans l'humble artèle des pécheurs ; cette allégorie reconstruit le monde ancien fondé sur la solidarité de tous avec tous et de l'homme avec la nature. Ces trois auteurs, Biélov, Astafiev et Raspoutine ont en commun une puissante nostalgie de paradis perdu, mais seul Raspoutine a inclus cette nostalgie dans une philosophie personnelle, que nous avons dégagée en début de cet article, une nostalgie vécue, existentielle de l'unité perdue du moi humain.
L'île a toujours été le topos préféré des utopistes. En choisissant ce topos, Raspoutine a voulu montrer que l'ancienne civilisation de l'harmonie était à son tour devenue une utopie, bouleversée et engloutie comme la ville mythique de Kitèje.
La tendance à l'allégorisme s'accentue dans le dernier grand récit publié de Raspoutine, l'Incendie (1985). Les flammes s'emparent des entrepôts d'un village neuf construit pour remplacer un autre village englouti, bourg déjà tout déglingué, sur la rive de l'Angara, qui n'est ni ville ni campagne, mais évoque plutôt un bivouac, « comme si ses habitants étaient des nomades qui s'étaient arrêtés un instant pour laisser passer le mauvais temps, et étaient restés coincés là ». La magistrale description du feu, un spectacle fascinant, que décrivit aussi Dostoïevski dans un chapitre des Démons, occupe presque tout le récit : c'est un véritable monstre vivant qui mugit, qui fait irruption, qui happe, qui dévore. « Des choses grésillaient comme sur une poêle, d'autres éclataient comme des obus. » (Chapitre 7). Mais le feu c'est aussi la révélation des caractères, des dévouements, et des bassesses, des pillages, des égoïsmes. Le héros, ou le narrateur, a compris que, depuis leur relogement dans ce bourg artificiel, les hommes avaient perdu ce qui les faisait vivre :
« Au début, pourtant, même dans le nouveau village, ils ne vivaient pas de cette façon, les gens séparés, chacun pour soi, s'écartant de plus en plus d'une vie en commun qu'ordonnaient des lois et des coutumes qui ne dataient pas d'hier. » (Chapitre 9).
Le feu révèle la fragilité de l'homme : il est si facile de se perdre. Tout le récit s'ordonne autour d'une dialectique de l'ordre et du désordre. Le désordre extérieur et cet ordre intérieur qu'il est si facile de perdre.
« Il ne se souvenait pas par quoi avait commencé ce désaccord avec-lui-même. Il avait bien dû commencer par quelque chose, il avait bien dû y avoir un jour où son âme ne s'était pas contentée de protester, mais s'était révoltée, et avait refusé de comprendre. » (Chapitre 11).
Ivan Pétrovitch a décidé de fuir, de quitter ce faux village natal. Mais l'incendie l'y trouve encore, et il se dévoue instinctivement, tout en revoyant défiler toute sa vie, et tout son désaccord secret avec lui-même.
« Que va-t-on faire, Afonia ? Tu sais ce qu'il faut faire maintenant ?
— On va vivre, répondit Afonia, le visage déformé par la souffrance que lui causaient ses blessures à vif, ou bien son âme tourmentée. Ce n'est pas chose facile que de vivre sur cette terre, mais il le faut. »
Ainsi s'achève cette fable sur le mal de vivre qu'éprouvent l'auteur et ses personnages, et avec eux tout le monde contemporain.
Les polémiques, les prises de position publiques ont pris de plus en plus de place dans la vie de Valentin Raspoutine après la parution de l'Incendie. Tout se passe comme si le phénomène de perestroïka, c'est-à-dire la profonde mutation de la Russie et la tentative d'insuffler à la société soviétique des éléments de capitalisme et d'américaniser les mœurs, avaient désarçonné l'écrivain. Peut-être est-ce parce qu'il ne sait plus très bien contre quoi lutter pour que revienne l'harmonie, dont son âme a soif. Le mal de vivre contemporain, surajouté à son très profond mal de vivre personnel, a déterminé toutes les positions politiques et écologiques de Raspoutine. Sa lutte contre les magnats soviétiques de l'industrialisation à outrance, son combat contre le projet de retournement des fleuves sibériens, sa défense du lac Baïkal contre les agressions industrielles, ou des vieilles villes historiques de la Russie sibérienne contre le bulldozer des urbanistes fous l'ont absorbé presque entièrement. Raspoutine a été sur tous les fronts pour tâcher d'endiguer le laisser-faire industriel, bien pire sous le régime planifié soviétique que sous les régimes capitalistes non planifiés. Mais la perestroïka a rendu l'ennemi insaisissable. Sur certains points Raspoutine a eu gain de cause, sur beaucoup d'autres le ravage continue.
Parfois, en lisant les noms de signataires comme les 74 écrivains qui en mars 1990 ont demandé l'attribution d'une plus grande part des moyens de publication aux éléments “nationaux” contre les éléments « russophones » mais étrangers, c'est-à-dire juifs, on a l'impression que Raspoutine est embarqué sur un mauvais bateau, où il se retrouve dans une paradoxale alliance avec ses ennemis d'hier, les bureaucrates du Parti. Mais l'écrivain s'en est expliqué, et comme excusé. Pour qui le connaît bien, il est clair que ses dernières positions, qui comportent des alliances avec certains des chauvins et d'anciens bolcheviks ne peuvent pas correspondre à des convictions de haine, si étrangères à l'homme et au poète Raspoutine, mais à une souffrance, à sa souffrance permanente, qui éprouve difficulté à se “domicilier” en ce monde. Le créateur et le pouvoir sont exclusifs l'un de l'autre, déclare-t-il tout en entrant, en juin 1990, au Conseil Présidentiel nouvellement formé par Mikhaïl Gorbatchev. Autrement dit, voici une souffrance de plus. « Je crois, je crois en la Patrie », répétait Raspoutine en 1988, comme une incantation contre lui-même et son mal de vivre… Partout l'on sent dans ses récents articles cette même souffrance : l'homme moderne ne lui plaît pas ; il réclame sans cesse, il ne veut rien donner.
Il y a en Valentin Raspoutine du Jean-Jacques Rousseau, avons-nous dit ; rappelons-nous dans la Lettre à d'Alembert l'épisode de l'Irlandais qui ne voulait pas sortir de son lit, bien que la maison brûlât : « Que m'importe, répondait-il, je n'en suis que locataire ». Quand le feu enfin arrive à lui : « Aussitôt il s'élance, il court, il crie, il s'agite, il commence à comprendre qu'il faut quelquefois prendre intérêt à la maison qu'on habite, quoiqu'elle ne vous appartienne pas ». C'est au fond de ce nous crie cet Alceste russe, ce Tchatski d'Irkoutsk, Valentin Raspoutine. La puissance de son œuvre tient à sa faiblesse cachée : sans la blessure secrète, ni les appels à la mémoire ni les admonestations adressées à l'homme moderne mauvais locataire du monde n'auraient la force qu'ils ont chez lui. Écrivain russe, qui s'enchante de retrouver dans le grand nord le langage du Dit de l'ost d'Igor, Raspoutine est aussi un écrivain local, parce que seul le local permet l'enracinement dans l'universel. Son action politique, peu comprise par les intellectuels de gauche de Moscou, et carrément déformée dans les médias occidentaux, s'explique sans doute par un sens aigu du délabrement de l'homme d'aujourd'hui, et aussi par un retrait sur des aîtres locaux, ceux de Sibérie, qui, selon Raspoutine, est devenue une « puissance littéraire ». Au fond, la Russie de Raspoutine est plus sibérienne qu'européenne. Là est le désaccord ; quant à l'énigme, ne vient-elle pas de la blessure secrète qu'on ne confie qu'à la corneille ?
► Georges Nivat, Russie-Europe : La fin du schisme (Études littéraires et politiques), L'Âge d'homme, 1993.