Frobenius
 ♦ 9 août 1938 : Mort à Biganzolo sur les rives du Lac Majeur en Lombardie du grand africaniste et préhistorien allemand Léo Frobenius, né à Berlin en 1873.
♦ 9 août 1938 : Mort à Biganzolo sur les rives du Lac Majeur en Lombardie du grand africaniste et préhistorien allemand Léo Frobenius, né à Berlin en 1873.
Pour lui, la seule méthode valable en ethnologie est l’approche culturaliste et historique. L’évolution culturelle, pensait-il, se développe en 3 stades. Frobenius a mené 12 expéditions en Afrique entre 1904 et 1935. Parallèlement à sa connaissance profonde de l’Afrique noire, il était aussi un spécialiste de l’art préhistorique européen, ce qui le conduisit à effectuer des recherches sur les contreforts des Alpes, en Norvège et en Espagne. L’objectif de sa vie de recherches était de comprendre les lois qui ont présidé à la naissance des cultures humaines. Il a procédé à une classification des cultures humaines en “complexes culturels” (en all. : Kulturkreise), chacun de ces complexes étant une entité vivante, biologique, qui connaît 3 âges : la jeunesse, la maturité et la sénescence. Chaque culture possède son “noyau”, son centre spirituel, son âme, qu’il appelait, en grec, la païdeuma [faculté et manière originales pour chaque peuple d'être ému, d'être saisi].
Les Africains, qui admirent son œuvre, se réfèrent essentiellement aux 3 volumes parus en 1912-13, Und Afrika sprach (Ainsi parla l’Afrique). Pour Frobenius, l’humanité a toujours connu des phases soudaines d’Ergriffenheit, de saisie émotionnelle et subite du réel, suivies de longues phases d’application. Les phases d’Ergriffenheit consistent à voir de manière soudaine les choses “telles qu’elles sont dans le fond d’elles-mêmes”, indépendamment de leur dimension biologique.
Pour Frobenius, il est probable que l’idée d’ordre et d’harmonie soit venue d’une observation du ciel et des lois cosmiques, observation qui conduit à vouloir copier cet ordre et cette harmonie, en inventant des systèmes religieux ou politiques. L’arrivée de facteurs nouveaux impulse de nouvelles directions à ces systèmes. Les systèmes ne sont donc pas seulement les produits de ce qui les a précédé objectivement, factuellement, mais le résultat d’un bilan subjectif, chaque fois original, dont la trajectoire ultérieure n’est nullement prévisible. Frobenius met ainsi un terme à cette idée de nécessité historique inéluctable.
Dans le cadre de la Révolution conservatrice et de la tentative d’Armin Mohler de la réactiver, la vision de Frobenius a inspiré la fameuse conception sphérique de l’histoire, où la personnalité charismatique inattendue (que cette personnalité soit un homme, un peuple, une élite militaire ou civile) impulse justement une direction nouvelle, chaque fois imprévisible et, donc, diamétralement différente de la vision linéaire et vectorielle du temps historique, propre des progressismes, et de la vision cyclique, où il y a éternel retour du même, propre des visions traditionnelles figées.
► Robert Steuckers.
• Ressources bibliographiques :
Leo Frobenius, anthropologue, explorateur, aventurier, Hans-Jürgen Heinrichs, L'Harmattan, 1999

pièce-jointe :
Les civilisations comme "absolu esthétique" :
L'approche morphologique de la Mittel-Europa
« L'important est de comprendre que tout factuel est déjà une théorie. Le bleu du ciel nous révèle déjà la loi fondamentale de la chromatique. Rien ne soit recherché derrière les phénomènes ; ils sont eux-mêmes la théorie. »
Gœthe, Maximen und Reflexionen, n. 575
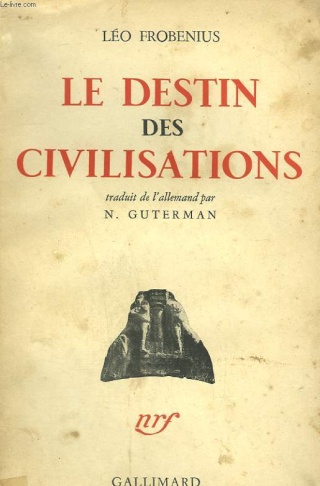 La réflexion placée ici en exergue évoque, grâce à la densité de l'aphorisme, davantage que ce que les mots paraissent dire explicitement. Elle renvoie à une saisie du réel sur un mode poétique et conceptuel, à une vision du monde et de l'homme opposée à celle, mécaniste, issue des Lumières. De fait, Gœthe est un jalon dans l'histoire des thèmes hérités de traditions anciennes et de la Renaissance, lesquels ont pour commun air de famille le projet d'intégrer « la science de l'homme, la science de la nature et une réflexion sur le destin de l'homme dans l'aventure de l'être » (1).
La réflexion placée ici en exergue évoque, grâce à la densité de l'aphorisme, davantage que ce que les mots paraissent dire explicitement. Elle renvoie à une saisie du réel sur un mode poétique et conceptuel, à une vision du monde et de l'homme opposée à celle, mécaniste, issue des Lumières. De fait, Gœthe est un jalon dans l'histoire des thèmes hérités de traditions anciennes et de la Renaissance, lesquels ont pour commun air de famille le projet d'intégrer « la science de l'homme, la science de la nature et une réflexion sur le destin de l'homme dans l'aventure de l'être » (1).
Ce projet marque au XXe siècle les auteurs, les idées, les modèles théoriques abordés ici. Ils constituent le courant appelé “Morphologie historique” (ou encore “Morphologie culturelle”). Il s'agit d'un des aspects de l'ethnologie religieuse, et de l'histoire des religions qui concerne plus particulièrement les pays germaniques (Allemagne, Autriche, Hongrie, Pays Baltes). Par son caractère fortement intégrateur, ce courant étend son champ à divers domaines, comme l'histoire des idées, de l'art, de la littérature.
Caractérisée par une forte réaction contre le scientisme et le positivisme, la Morphologie culturelle présente comme alternative à ces traditions une approche “morphologique”, ou “physiognomonique”, des civilisations. Le mode de connaissance qu'elle prône s'oppose sur 3 points fondamentaux aux procédure cognitives de la science moderne : a) elle se qualifie d'art plutôt que de méthode ; b) elle fonde sa connaissance sur l'intuition sensible que suscite l'objet d'étude dans l'esprit du chercheur, intuition qui par sa nature même relève de l'esthétique ; c) elle se sert de l'analogie comme procédure de validation de ses découvertes, en postulant un rapport d'isomorphie entre le monde organique de la nature et le monde historique de la culture humaine.
Le cadre conceptuel de la Morphologie culturelle
Pour mieux situer la Morphologie culturelle il faut revenir à la distinction, mise en place au XIXe siècle mais encore opérationnelle au XXe dans de nombreux secteurs des sciences humaines, entre Erklären et Verstehen, entre une science qui “explique” les comportements humains et un art qui cherche à “comprendre” le sens intérieur de ceux-ci, en procédant à leur interprétation (2).
L'École de la Morphologie culturelle se situe naturellement sur le versant du Verstehen. Elle partage une “poétique” commune à d'autres secteurs de la réflexion menée en Europe centrale. Cette poétique se révèle non seulement dans des conventions stylistiques et rhétoriques, mais aussi dans une mise en parallèle de 3 termes : les civilisations humaines, l'œuvre d'art, la morphologie des organismes naturels. Ce parallélisme postulé, plusieurs conséquences en découlent. Tout d'abord, chaque civilisation reflétant une configuration bien spécifique, est susceptible d'être assimilée à une variété naturelle parmi les nombreuses espèces vivantes. Comme celles-ci, elle connaît un cycle vital qui, d'une phase germinale, l'amène à l'épanouissement puis au déclin. Mais comme chaque espèce organique représente un sommet, un modèle paradigmatique d'accomplissement de rapports harmonieux d'équilibre, tant du point de vue interne qu'au regard de l'observateur extérieur, une autre métaphore s'offre à l'esprit dans l'étude d'une civilisation : elle est assimilée à une œuvre d'art, à un “absolu esthétique”. La spécificité de celui-ci consiste, en effet, à la fois en certains caractères objectifs — harmonie interne exhibée par l'œuvre entre ses parties constitutives et le tout —, et certains caractères subjectifs — la capacité qu'a l'objet esthétique de susciter chez le spectateur une jouissance esthétique en vertu de la congruence de ses proportions. De cette double assimilation métaphorique de la civilisation à l'organisme naturel et à l'œuvre d'art découle la méthode morphologique, qui se veut essentiellement intuitive. La contemplation des traits culturels d'un peuple est censée permettre à l'observateur de saisir intuitivement, derrière cette unité de sens et de forme, la « force formatrice », le principe actif informateur qui confère à la civilisation en question sa physionomie unique.
C'est dans ce contexte, dans cette “poétique” largement influencée par la pensée biologique et l'esthétique du Romantisme, que prend place la Morphologie culturelle. Trois auteurs nous paraissent en être en les plus représentatifs. Il s'agit des ethnologues allemands Leo Frobenius (1873-1938) et Adolf Jensen (1889-1965), et de l'historien des religions hongrois Karoly Kerényi (1907-1974).
Leo Frobenius commença sa carrière d'ethnologue en Mélanésie, pour se consacrer ensuite aux cultures africaines. L'intense activité de recherche exercée dans son sillage a pour épicentre Francfort. Il fonda le Frobenius Institut, né en concurrence avec l'École de Vienne du père Wilhelm Schmidt ; il dota cet Institut d'un périodique prestigieux, la revue Paideuma, dont le premier numéro contient le manifeste théorique de l'École (3).
Adolf Jensen, élève de Frobenius, lui succède à la direction de l'Institut. Auteur de plusieurs monographies (4), il a effectué des recherches en Mélanésie, à Céram, en Indonésie et en Afrique. Les sciences religieuses lui sont redevables de la notion, adoptée dans la terminologie technique, de “Dema”, une figure mythique caractérisée par un destin de mort et de renaissance, et dont le corps morcelé aurait été à l'origine des plantes cultivées.
Philologue hongrois, spécialiste du monde classique, Karoly Kerényi entend prolonger l'œuvre du mythologue Walter F. Otto. Il est l'auteur, notamment, d'un ouvrage fondamental sur les religions grecque et romaine, Die antike Religion (Amsterdam, 1940 et 1942), de Introduction à l'essence de la mythologie, écrit en collaboration avec CG Jung (5), et de Umgang mit göttlichen, Wesen und Gegenwärtigkeit des Mythos (6). Chez Kerényi comme chez Frobenius, le domaine esthétique et le domaine religieux semblent se fondre dans le concept unitaire de “culture”, dont chaque variante historique serait caractérisée par son propre style. Les affinités électives qui lient ces 2 savants partageant plusieurs thèmes de réflexion s'expriment dans la collaboration assidue de Kerényi à la revue de Frobenius, Paideuma, notamment dans les années 1950. De ces affinités témoignent aussi les nombreuses citations tirées d'écrits de Frobenius, lesquelles ponctuent les travaux de Kerényi. De plus, Kerényi a, comme Jensen, travaillé sur les matériaux mythologiques de l'île de Céram.
Les porte-parole de la Morphologie culturelle ne furent pas tous uniquement des spécialistes des mondes exotiques. Un certain nombre d'historiens comme Oswald Spengler (1880-1936), ou d'écrivains comme Hermann Keyserling (1880-1946) se livrèrent au même projet : la constitution d'une typologie systématique des visions du monde, dont chacune serait organisée autourd'un style original conférant à chacune d'elles une sorte de “réalité informée”, guidée par un principe régulateur interne dont la nature serait moins mécanique qu'organique.
Les 2 domaines d'observation privilégiés par la Morphologie culturelle sont la religion et l’art. Le choix de ces 2 objets n'est pas innocent. Mieux que n'importe quelles autres, ces expressions de la vie spirituelle seraient susceptibles, à elles seules, de fournir une clé pour la connaissance d'une culture (7). Avancée pour la première fois par Herder dans les années 1770, puis placée au cœur de l'anthropologie romantique, l'affirmation que la religion et l'art occupent un rôle privilégié dans la connaissance des civilisations humaines se double maintenant d'un choix méthodologique particulier. Par l'étude de la religion et de l'art, devenus par une procédure métonymique le lieu “exemplaire” de la culture tout entière, l'ethnologue et l'historien auront accès à la configuration spirituelle typique de chaque civilisation étudiée.
 Ce film spéculatif qui traverse la culture de l'Europe centrale sous-tend la pensée de la Morphologie culturelle. Il constitue à lui seul un chapitre qui mériterait d'être mieux exploré, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, en vue d'une meilleure connaissance de l'histoire des sciences anthropologiques du XXe siècle, et plus particulièrement pour mieux apprécier l'influence indirecte que, par la médiation de Franz Boas, la Morphologie a exercé sur l'anthropologie culturelle américaine des années 1920. Ensuite, parce que l'incontestable malaise que la lecture de ces auteurs peut susciter aujourd'hui s'accompagne de la découverte, chez ces mêmes auteurs, de réflexions surprenantes par leur actualité. Ce sentiment à la fois de malaise et d'actualité demande à être analysé, en évitant au préalable toute fermeture dogmatique vis-à-vis de l'orientation idéologique de l'École, mais aussi sans complaisance à l'égard de ce qui le suscite. Pour ce qui est des ouvertures stimulantes de la Morphologie culturelle, il est difficile de ne pas reconnaître que Frobenius, Jensen et Kerényi sont, chacun à sa manière, en avance pour l'époque. Ils font preuve de sensibilité à l'égard de l'implication subjective de l'historien dans la connaissance des civilisations éloignées dans le temps et dans l'espace (8).
Ce film spéculatif qui traverse la culture de l'Europe centrale sous-tend la pensée de la Morphologie culturelle. Il constitue à lui seul un chapitre qui mériterait d'être mieux exploré, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, en vue d'une meilleure connaissance de l'histoire des sciences anthropologiques du XXe siècle, et plus particulièrement pour mieux apprécier l'influence indirecte que, par la médiation de Franz Boas, la Morphologie a exercé sur l'anthropologie culturelle américaine des années 1920. Ensuite, parce que l'incontestable malaise que la lecture de ces auteurs peut susciter aujourd'hui s'accompagne de la découverte, chez ces mêmes auteurs, de réflexions surprenantes par leur actualité. Ce sentiment à la fois de malaise et d'actualité demande à être analysé, en évitant au préalable toute fermeture dogmatique vis-à-vis de l'orientation idéologique de l'École, mais aussi sans complaisance à l'égard de ce qui le suscite. Pour ce qui est des ouvertures stimulantes de la Morphologie culturelle, il est difficile de ne pas reconnaître que Frobenius, Jensen et Kerényi sont, chacun à sa manière, en avance pour l'époque. Ils font preuve de sensibilité à l'égard de l'implication subjective de l'historien dans la connaissance des civilisations éloignées dans le temps et dans l'espace (8).
Ces aspects porteurs et stimulants de la Morphologie culturelle ne doivent pas nous faire oublier certaines zones troubles et inquiétantes dans l'horizon qui constitue la toile de fond de ce courant. Un courant que ses détracteurs n'ont pas hésité à qualifier de “réactionnaire”, ce qui fera l'objet de nos remarques finales.
Jusqu'ici nous n'avons qu'évoqué le cadre conceptuel de la Morphologie culturelle. Il s'agit maintenant, d'une part, de préciser le contexte historique dans lequel elle s'insère, et de présenter ses thèmes constitutifs ; d'autre part, de traiter des fondements logiques, implicites et explicites, sur lesquels ce courant repose.
Le contexte de la Morphologie culturelle
Le contexte intellectuel qui sert de toile de fond à l'émergence de la Morphologie culturelle s'éclaircit si l'on tient compte de la situation de la culture allemande au XIXe siècle. Un bref détour s'impose pour évoquer tant le débat qui a suivi la crise du modèle hégélien de la philosophie de l'histoire, que l'avènement de l'historicisme contemporain, dans le cadre duquel l'École morphologique s'insère.
L'historicisme allemand contemporain est né, en effet, de la dissolution de la vision romantique de l'histoire. Cette vision comprenait le développement historique à partir du présupposé de l'identité entre le fini et l'infini et reconnaissait, dans les phases successives de l'histoire, la réalisation progressive d'un principe absolu immanent à ce développement. Ainsi, dans l'historicisme romantique, la reconnaissance de l'individualité irréductible de chaque phénomène historique était atténuée par l'idée que cette individualité n'est que l'expression d'une force universelle, ou principe absolu, qui dans son développement s'actualise en une multiplicité infinie de formes particulières (en réalisant ainsi la coïncidence de l'universalité et de l'individualité). À partir de cette idée d'un principe absolu dont le développement historique serait la réalisation, 2 orientations majeures se sont dégagées. L'une est proprement historiographique : de Herder elle conduit aux travaux de l'École historique, jusqu'à Ranke. L'autre, plus résolument spéculative, part de l'idéalisme postkantien pour déboucher sur la philosophie de l'histoire de Hegel.
La première orientation met l'accent sur une pénétration concrète des faits historiques grâce à la mise au point et à l'emploi d'instruments (philologie, archéologie, critique historique, etc.) susceptibles de mettre en lumière l'individualité des formes historiques concrètes. La coïncidence entre l'universel et l'individuel doit être recherchée dans la multiplicité infinie des phénomènes historiques et dans leur connexion organique. Ainsi, au contact de l'historiographie concrète, le présupposé d'un principe absolu à la base du processus historique a subi une inflexion, quand on a cherché à repérer ses connexions avec la réalité vivante. À l'affirmation de la nature foncièrement irrationnelle du principe absolu, ce courant de l'historicisme allemand a fait correspondre le recours à l'intuition pour saisir, dans l'individualité des phénomènes historiques, la force qui leur est immanente. Ce n'est donc pas ici une construction philosophique, mais l'enquête historique concrète, menée sur une base intuitive, qui permettrait de saisir la coïncidence de l'universel et de l'individuel.
La seconde orientation témoigne de l'effort de reformulation de la conception historique romantique sur la base des schèmes spéculatifs élaborés par l'idéalisme postkantien. Son terrain spécifique n'est pas l'activité historiographique concrète, mais la philosophie de l'histoire. Ainsi, l'histoire devient pour Hegel le développement de l'Esprit absolu, conçu comme l'Esprit du monde, à travers une succession de “stades” ou “moments” reliés par une relation dialectique, qui l'amèneront à prendre conscience de lui-même. La structure de l'histoire est dès lors comprise comme structure rationnelle, et le développement historique est conçu comme processus dialectique dans lequel l'Esprit absolu s'affirme. La tâche de la philosophie consistera alors à justifier la coïncidence qui, entre l'universel et l'individuel, se réalise dans chaque moment du processus historique, et à reconnaître la rationalité de celui-ci. C'est dans ce contexte, dominé par ces 2 orientations, que naît l'historicisme contemporain inauguré par Dilthey.
La crise de la culture romantique, manifestée dès 1848, se décline à travers plusieurs figures :
- A) La polémique contre la philosophie hégélienne de l'histoire, qui passe par le refus de 2 de ses idées maîtresses, à savoir : a) l'idée d'un développement unique et universel de l'histoire humaine ; b) le principe-guide de la rationalité historique.
- B) La réactualisation de l'héritage de l'École historique allemande, qui remonte à Herder, dominée par une forte tendance anti-spéculative ainsi que par une forte vocation pour la recherche historiographique concrète.
- C) La récupération de l'idée romantique de l'irrationalité foncière de l'histoire.
- D) La reprise des problématiques néo-kantiennes, notamment par Dilthey qui veut les élargir au domaine des sciences de la culture ou sciences de l'esprit (ce qu'il appelle « le monde historique »).
- E) La polémique contre le Positivisme.
Le milieu et la seconde moitié du XIXe siècle voient l'émergence de ce qu'on appelle l'« historicisme contemporain ». La rupture n'est pas toutefois radicale avec la culture romantique. Certes, pour contrecarrer les effets agnostiques inévitables du relativisme liés à une position antiuniversaliste et antiabsolue, déjà présente dans la pensée romantique de Herder, on cherche à renouer les liens avec la tradition rationaliste et critique. L'École badoise (représentée par les néokantiens W. Windelband et H. Rickert) et Dilthey lui-même n'ont pas renoncé à l'idée d'une fondation méthodologique du savoir historique selon des procédures critiques. Donc, si la polémique avec la culture romantique est ouverte au début du mouvement historiciste contemporain, plus tard, en revanche, lorsque celui-ci prendra une allure décidément néoromantique, la critique du rationalisme et du positivisme se radicalisera. Au début du XXe siècle, en effet, plusieurs thèmes du Romantisme se trouvent récupérés par cette École, elle aussi d'inspiration historiciste, mais “néo-romantique”, qu'est la “Morphologie culturelle” ou “Morphologie historique”.
Les thèmes constitutifs de la Morphologie culturelle
Au tournant du XXe siècle le tableau esquissé plus haut se redessine en fonction de l'émergence de nouvelles positions, dont celles de la Morphologie culturelle, centrées sur une approche résolument “irrationaliste” (9). Une série de thèmes porteurs de l'école morphologique se mettent alors en place. Il s'agit notamment de ceux qui tournent autour de 2 concepts typiquement romantiques, celui d'“organisme” — compris comme une totalité vivante régie par une finalité interne, et celui de “beau artistique” — conçu comme une unité complexe unissant l'expérience tant sensible qu'intelligible, et régie elle aussi par une finalité autonome reposant sur un rapport de congruence interne entre les parties et le tout.
Il nous paraît possible d'identifier cinq thèmes constitutifs de la Morphologie culturelle. Le premier est le fondement essentiellement irrationnel de l'histoire — thèse déjà formulée par Herder et Humbolt, mais refusée par la tradition philosophique spéculative romantique incarnée par Fichte, Schelling et Hegel. Une préoccupation esthétique semblait déjà servir de base, chez Herder, à la recherche historique. Repris par Dilthey, mais mitigé par le projet herméneutique d'une connaissance historique méthodiquement établie, le motif du fondement irrationnel de l'histoire est repris au XIXe siècle par Schopenhauer et Nietzsche, qui l'amplifient. La Morphologie historique, quant à elle, fera de ce fondement irrationnel de l'histoire l'un des ses motifs constitutifs. En reprenant les thèses de Herder, cette École pose l'histoire comme irrationnelle dans son essence ultime : elle jaillit de mobiles spirituels et d'actions dont la nature est “autre” que celle de la logique et de la rationalité pratique appliquée (par ex. l'économie). Frobenius, Jensen et Kerényi s'intéressent tout particulièrement à ce qui a dû se produire dans l'imagination créatrice des hommes, en un temps primordial où le monde s'est révélé à eux, les plongeant dans un état de « saisissement » (10). Le deuxième thème est l'idée d'originalité, ou d'individualité, historique. Cette idée est sous-tendue par une conception de la culture comprise comme monde autosuffisant, une sorte d'organisme vivant (voir Humbolt et Herder), dominé par une empreinte ou un style unique et irréductible. Déjà Herder posait le fondement esthétique du concept romantique d'“âmes des peuples”, ou d'“esprit des nations”, lorsqu'il affirmait en 1774 que ces âmes sont entre elles incomparables, car justement elles s'expriment poétiquement et se distinguent entre elles artistiquement (11). Ainsi, en s'opposant au scepticisme des Lumières, qui insistait plutôt sur la variété infinie des peuples et des coutumes, Herder avait introduit le canon poétique, et esthétiquement fondé, de l'incomparabilité des créations artistiques entre elles (12). Pour la Morphologie culturelle également, toutes les manifestations d'une culture déterminée gardent en elles une «tonalité » esthétique de fond, un « style » irréductible à toute interprétation fonctionnelle ou finaliste extérieure au style lui-même, et d'essence foncièrement antiutilitaire (le style est, en effet, ce qui excède le fonctionnel : il relève de l'« expressivité » pure) (13).
Le troisième thème est la dimension “vivante” des cultures, thème en partie hérité de la philosophie hégélienne de l'histoire, dont par ailleurs la Morphologie culturelle refuse l'idée d'un développement unique et universel. La Morphologie culturelle garde plutôt de l'hégélianisme le principe du mouvement permanent, mais cette dimension vivante et dynamique se trouve maintenant transférée de l'extérieur à l'intérieur de chaque culture. Chacune connaît un cycle, analogue à celui des êtres naturels, plantes et animaux, et dont le mouvement procède d'une première expérience fondatrice d'interaction avec l'environnement, ce qui confère à une civilisation son expressivité particulière. Une telle expressivité finit par atteindre sa forme stylistiquement accomplie, véritablement “organique”, et la conserve tant qu'elle garde encore en elle la trace de cette expérience primordiale ; ensuite, inéluctablement, elle dégénère, se rigidifie, devient mécanique et « inorganique » (14).
Le quatrième thème est l'analogie morphologique entre nature et culture. La singularité stylistique des civilisations repose sur un principe informateur de nature spirituelle. Toutefois, celui-ci se développe non par rupture et négation des formes organiques plus simples, mais par une évolution, analogue à celle du monde organique. Selon cette conception, il n'y a donc pas de véritable opposition entre histoire et nature, pas plus qu'entre les sphères biologique et psychique. Monde historique et monde organique se compénètrent. Il existe, en revanche, une articulation hiérarchique entre les ordres de cet ensemble unitaire (spirituel-psychique en haut, matériel-organique en bas ; en bas, les fonctions biologiques et utilitaires, en haut les fonctions spirituelles antiutilitaires). Ces ordres sont englobés dans le même processus vital, guidé par un principe unique (15). C'est probablement de Herder que la Morphologie culturelle tire cette démarche analogique. L'univers spirituel humain (le monde historique), dont l'essence n'est pas étrangère à celle, vivante, de l'univers naturel, apparaît organisé selon des figures analogues à celles qui composent ce dernier. Entre nature et culture existe ainsi une relation d'analogie telle qu'il devient possible d'envisager l'univers spirituel de la culture comme une sorte de « troisième règne », après le minéral et le végétal-animal, au-dessus de l'inorganique et de l'organique, règne qui se développe indépendamment, selon ses lois propres, homologues toutefois à celles de la nature (16).
Le cinquième thème de la Morphologie culturelle est l'analogie établie entre la culture et l'œuvre d'art. Dans la mesure où la Morphologie culturelle comprend les civilisations humaines comme les concrétions d'une « faculté active », mue par une « pulsion formatrice », les expressions culturelles concrètes (la religion et l'art, notamment) ne font que rendre visible en l'actualisant leur loi interne d'accomplissement selon une forme, dont cette loi interne est la cause finale en puissance. L'approche morphologique parvient ainsi à surmonter l'opposition entre contenu et forme, moyen et fin, la forme rendant visible un contenu compris comme principe stylistique non réductible à autre chose qu'à lui-même (17). La nature de ce principe qui organise l'unité culturelle d'une civilisation donnée présente une analogie évidente avec la nature du principe qui règle l'unité esthétique du Beau artistique telle qu'elle a été définie par le Romantisme (en particulier par Karl Philipp Moritz et, après lui, par Kant dans la Critique du jugement).
En conclusion, une symétrie profonde semble relier ces 2 principes régulateurs qui agissent dans le domaine de l'art, de la vie organique et de l'histoire des civilisations. Ces principes régulateurs autonomes, animés par une force formatrice dynamique, ne ressortissent dans aucun des 3 cas aux critères logiques de la causalité mécanique, et semblent reposer sur une sorte de finalité interne. La pensée romantique établissait déjà une analogie entre l'œuvre de la nature et l'œuvre d'art (18). La Morphologie culturelle, quant à elle, en suivant Herder va ajouter à ce parallélisme à 2 termes un troisième terme, celui des civilisations humaines qui partagent avec l'œuvre d'art plus d'un caractère, et distinguent celle-ci des œuvres de la nature. Au lieu de créer spontanément des formes, comme le fait la nature, l'artiste et les civilisations humaines procèdent à une activité imitatrice de la nature, avec laquelle ils établissent une relation pour ainsi dire au « deuxième degré ».
Mais loin d'être une imitation passive de la nature, l'œuvre d'art doit être « imitation formatrice » ; elle est absolument séparée de cette nature à laquelle elle renvoie pourtant. De même que toute véritable civilisation humaine, elle est ce qui est devenu Forme autonome par rapport au référent naturel qui l'a inspirée.
Les 5 points évoqués plus haut permettent de mieux comprendre pourquoi, selon les tenants de la Morphologie culturelle, chaque civilisation peut être envisagée comme un ensemble dans lequel forme et contenu, fin et moyen coïncident ; pourquoi la culture est essentiellement « expressive » ; et pourquoi, à partir de la prémisse d'une homologie entre monde biologique, univers esthétique et monde culturel, la seule méthodologie pertinente dans l'étude des civilisations est l'acte intuitif.
Le modèle morphologique de Leo Frobenius
Les thèmes constitutifs de la Morphologie culturelle reposent donc sur un postulat plus ou moins implicite. À savoir, l'isomorphie de l'œuvre d'art, de l'organisme biologique et de la culture. Ou, pour prendre un exemple un peu différent : le Beau, le vivant, la civilisation. Un exemple paradigmatique de cette isomorphie est fourni par l'œuvre de Leo Frobenius.
Connu des africanistes par ses ouvrages consacrés à l'art et à la symbolique africains, Frobenius est l'incarnation même de cet esprit germanique qui combat explicitement, au tournant du siècle, les idéaux de la science positiviste (identifiés par lui au matérialisme et à l'évolutionnisme), et qui se situe — comme Frobenius le disait lui-même — au sein du « mysticisme allemand », conçu comme antithèse du rationalisme et du scientisme, prépondérants dans la culture européenne, notamment anglaise et française (19). Il convient de situer l'œuvre de Frobenius et de son École dans le contexte de la crise de l'ethnologie naturaliste à caractère évolutionniste et dans celui de l'École historico-culturelle allemande d'où Frobenius lui-même est issu (20). Frobenius adresse 2 critiques à cette École. La première porte sur les techniques de travail qui prétendent fournir à l'ethnologie un outil censé réduire la masse des données ethnographiques à une série de cultures définies et ordonnées selon les critères de l'espace, du temps, et de la causalité. Frobenius dénonce le caractère foncièrement mécanique de cette méthode qui, selon lui, ne posséderait aucune valeur démonstrative pour identifier les parentés culturelles (21). La seconde critique, de caractère plus général, porte sur la primauté accordée aux aspects matériels et techniques des cultures humaines au détriment des formes exprimant « la véritable orientation de la vie spirituelle d'un peuple » – plus précisément, les formes religieuses et artistiques (22). Outre la tradition morphologique gœthéenne, et la tradition organiciste qui remonte à la pensée biologique de la fin du XVIIIe siècle, la pensée romantique elle aussi exerce son influence sur Frobenius, notamment pour ce qui concerne sa conception génétique des cultures (23).
Frobenius part de l'idée de l'idée de l'unité et de l'homogénéité substantielles de la culture, qu'il n'hésite pas à qualifier de « troisième Reich» (24), après le règne inorganique et le règne organique de la nature. Sur cette idée, qui remonte à la conception romantique de Herder et de Humbolt, Frobenius greffe un second motif romantique : celui de la supériorité et du bonheur de la société humaine à l'aube du monde. De la convergence de ces 2 thèmes il tirera une théorie qui s'inscrit dans la mouvance de l'« irrationalisme néo-romantique » de son époque. Dans le domaine de l'Histoire des religions et de l'Ethnologie, plus particulièrement, cet irrationalisme prend la forme d'un thème «classique», celui de la primauté de l'aspect sacral de la vie culturelle par rapport à la dimension profane. Toute activité technique ou économique humaine est appréhendée par le tenants de ce courant comme le simple sous-produit d'une action rituelle ou, plus généralement, « sacrale » (25). Chez Frobenius, toutefois, ce thème historico-poétique a pris la dimension d'une véritable théorie de l'origine de la culture. Cette théorie tourne autour du concept clé de “païdeuma” (littéralement : “celui qui reçoit l'enseignement”, mais aussi “l'enseignement lui-même”). Pour lui, ce concept constitue l'objet véritable de la recherche morphologico-culturelle. Vivre dans la sphère d'un païdeuma donné, c'est se trouver livré à lui, “saisi” (Ergriffen) au point d'agir, de créer, essentiellement sous son impulsion (26). En d'autres termes, toute civilisation naît sous l'impulsion de « forces obscures et profondes » qui l'auraient « soulevée » en la faisant passer de la condition animale à celle, spirituelle, de conscience ouverte sur le monde, conscience susceptible de « s'émerveiller » et de « s'émouvoir » face à lui. Toute civilisation serait donc pour Frobenius caractérisée par un principe informateur de base, qui lui confère une « orientation » spécifique, laquelle s'actualise dans chacune des expressions concrètes de cette civilisation. Mais cette « orientation intime » n'est pas le fruit d'une objectivation conceptuelle. Elle est le reflet d'une « commotion » originaire, suscitée jadis par un phénomène du monde extérieur à la conscience (la plante, l'animal, le cosmos, le cycle saisonnier, etc.), mais qui s'impose à cette conscience et dont la civilisation reste comme « capturée ». Cette source d'émerveillement et de « commotion » se cristallise en manifestations de la culture, lesquelles conservent en elles-mêmes une sorte d' « empreinte ».
Pour exprimer une telle dynamique créatrice, donatrice de toute civilisation, Frobenius recourt à 2 concepts : celui d'“expression” (Ausdruck) et celui de “représentation” (Vorstellung). Toute création culturelle (de l'économie aux mythes) trouve son origine, en tant qu'“expression”, dans l'expérience psychique décrite plus haut. Celle-ci reflète le processus d'identification de la conscience humaine avec un aspect polarisant de la réalité naturelle. En amont de l'histoire spirituelle de l'humanité se situe donc une expérience qui n'a rien à voir, ni avec l'aptitude intellectuelle-cognitive (connaître le monde), ni avec une aptitude praticoéconomique orientée vers un but utilitaire (exploiter le monde pour en tirer des bénéfices). Au contraire, nous retrouvons, en amont de cette histoire, un mode d'expérience dont le fondement est essentiellement affectif et émotionnel, et qui s'articule dans la séquence expérience -identification-expression. Ces 2 moments simultanés, la commotion et l'expression, sont caractérisés par une effervescence créatrice intense où le païdeuma se forme comme le fruit du processus mimétique entre l'homme et la nature, pour conférer à la civilisation son inflexion originale. À ces 2 moments suit une seconde phase, celle de la représentation de cette expérience. Au cours de cette seconde phase, la relation avec l'expérience inaugurale s'estompe. La phase de la représentation constitue en effet une sorte de déclin ou de dégénérescence par rapport aux moments primordiaux de l'expérience vécue et de l'expression, moments où la culture atteint son épanouissement spirituel et, avec celui-ci, son état d'organicité le plus accompli. En raison de sa nature “vitale”, “anti-utilitaire”, purement “expressive”, la phase de formation du païdeuma ne saurait être soumise à une connaissance procédant par la chaîne des effets et des causes, analogue à celle qui gouverne le domaine des sciences naturelles. Elle peut seulement être « contemplée ».
Cet exemple fourni par la pensée de Frobenius, laquelle pose le fondement foncièrement irrationnel, anti-utilitaire et expressif de la culture, nous conduit à examiner 2 types d'analogie. D'abord, l'analogie morphologique implicite, établie par Frobenius et d'autres auteurs, entre culture et art (donc, entre méthodes pour atteindre la compréhension de la culture, et méthodes de compréhension de l'œuvre d'art). Ensuite, Ensuite, l'analogie entre culture et orga-nisme biologique .
Le rapport entre la culture et le Beau artistique
Le rapport entre la connaissance historique (ou la connaissance de la culture) et la connaissance esthétique avait été déjà posé par Dilthey. C'est à lui, en effet, que Frobenius, Jensen et Kerényi empruntent les concepts de Erlebrnis (expérience vécue) et de Gemüt (affect, ou sensation de l'âme), qui font pendant au concept de « commotion » situé, lui, à l'origine de toute invention culturelle. Une telle « commotion », ou émerveillement primordial, ineffable par nature — nous l'avons vu — ne peut pas être expliquée. Elle ne peut qu'être « revécue » grâce à un processus d'intuition immédiate qui permettrait à l'observateur de revivre, à l'intérieur de luimême, dans l'intériorité da sa propre conscience, ce moment inaugural.
Frobenius affirme cela clairement, tout en se plaignant d'être né à une époque où « dominent les hommes chez lesquels l'intellect prévaut, et où sont devenus inutiles ceux qui sont sujets à la commotion ». À ceux-ci, ajoute-t-il, « un seul champ reste ouvert : celui de l'art ». De la manière d'envisager l'origine de l'art comme jaillissant de la “commotion”, un art compris non pas en tant que vérité mais en tant que seule réalité ontologique, découle la manière dont Frobenius envisage l'origine de la culture humaine. Le moment de création artistique et culturelle revêt toujours le même caractère : celui d'un ravissement enfantin. C'est la régression de toute superstructure rationnelle, de toute visée utilitaire — autant de thèmes qui nourrissent, par un retour aux idéaux romantiques, les arts figuratifs de son époque, du dadaïsme à l'art automatique (27).
Les références principales de la morphologie culturelle puisent, pour l'essentiel, dans l'esthétique romantique et dans la morphologie idéaliste de Gœthe. Il s'agit là d'un véritable topos des débats philosophiques à la fin du XIXe siècle. Semblables références (28), communes à tous nos auteurs, sont révélatrices et entraînent 2 conséquences : premièrement, à cette époque, dominée par l'influence profonde de la pensée de Gœthe, le modèle morphologique gœthéen des sciences de la nature se trouve transféré aux sciences de la culture. La culture tout entière est ainsi réinterprétée dans un registre morphologique ; deuxièmement, ce registre morphologique renvoie de façon systématique à la notion de “type”, compris comme « grande individualité ». Celle-ci reste au cœur des préoccupations singularisantes de l'approche historique, tellement liée, en Allemagne, au domaine de l'art.
Pour apprécier l'influence des canons de l'esthétique romantique sur la Morphologie culturelle, il n'est sans doute pas inutile de passer en revue les critères formulés par Karl Philipp Moritz dans une série d'écrits parus entre 1785 et 1793. Ces critères ou principes de l'esthétique selon Moritz peuvent se ramener à une série de propositions, dont certaines intéressent plus particulièrement notre propos (29) :
- 1. L'art n'est pas une imitation de la nature (contrairement à la définition de l'art en vigueur jusque-là). Sa finalité n'est donc pas extérieure à lui-même (il ne s'agit pas d'imiter la nature), elle est la création de la « Beauté ».
- 2. Le Beau n'a pas de raison d'être hors de lui-même. Il est à lui-même sa propre fin. La séparation est donc nette entre le Beau et l'utile, entre l'esthétique et l'éthique. La Beauté est intransitive, elle réside dans son propre accomplissement — et, en ce sens, est pure « expression ». C'est pourquoi, même le plaisir individuel est quelque chose de subordonné par rapport à la suprématie du beau (30).
- 3. Du Beau réel la nature aurait créé un reflet chez l'homme, à travers la création d'une faculté particulière afin « que nulle force, en lui, ne restât non développée ». Il s'agit de la « faculté active» (31).
- 4. Dans la mesure où, dans l'art, imitation il y a, une telle imitation ne saurait donc se situer qu'entre l'activité créatrice de la nature et l'activité créatrice de l'artiste. L'artiste étant saisi par une « pulsion d'imitation rivalisante », qui le pousse à imiter la nature en créant, il fait de cette « pulsion de formation » non pas une simple « imitation », mais une « formation créatrice » qui reproduit synecdochiquement les belles choses de la Nature (32).
- 5. Puisqu'elle doit nécessairement « s'attacher à quelque chose, la faculté formatrice choisit quelque objet visible, audible ou saisissable par l'imagination, objet sur lequel elle transpose, à une échelle réduite, l'éclat du beau suprême ». L'acte créateur reste donc polarisé dans un contenu particulier mais qui prend la valeur d'un Tout (33).
- 6. L'œuvre d'art, étant par nature dépourvue de toute finalité externe, possède en échange et corollairement, un principe interne d'organisation. Ainsi, chez Kant, Schelling, Moritz, Novalis et Kant, le Beau est un produit gouverné intérieurement par une « finalité sans fin ». Moritz écrit : « Là où, dans un objet, une utilité ou une fin externes manquent, cette fin doit être recherchée dans l'objet lui-même, dès lors qu'il doit éveiller en moi du plaisir ... » (34).
- 7. L'autonomie de cette totalité qu'est l'œuvre d'art, et qui est condition de sa beauté, a pour conséquence un paradoxe : elle ne laisse pas de place à l'explication (ce qui reviendrait à renvoyer à un ailleurs, à une instance extérieure à elle, alors que le Beau se définit par son autonomie absolue). C'est ainsi que Moritz affirme : « Car l'essence du beau consiste en ceci, qu'une partie devient toujours parlante et significative à travers l'autre, et que le Tout devient tel par lui-même — il s'explique lui-même —, se décrit par lui-même et n'a donc plus besoin d'aucun éclaircissement ni d'aucune description ultérieurs, hormis la simple indication distincte de son contenu » (35). En d'autres termes, le message artistique est exprimable (par la poésie ou la figuration), mais est indicible dans le langage commun.
- 8. L'œuvre et la nature partagent 2 caractères : elles sont 2 totalités refermées sur elles-mêmes, autosuffisantes ; cette similarité repose non pas sur des formes similaires mais sur le fait qu'elles possèdent une structure ou organisation interne identique. Le rapport entre les parties constitutives et le tout est le même. Entre nature et œuvre d'art existe le même rapport qu'entre macrocosme et microcosme. Ce qui varie, c'est seulement leur échelle respective.
Ces 8 principes furent récupérés tout au long du XIXe siècle pour servir de modèle de compréhension de tout produit spirituel d'ordre historique. La passerelle entre histoire et esthétique fait à plusieurs reprises l'objet de réflexions de la part de Dilthey. Il est persuadé que les Sciences de l'Esprit « doivent déterminer tant les aspects généralisants qu'individualisants de ce monde historique ». L'exemple typique est fourni par l'historiographie, qui justement cherche à « comprendre les phénomènes spirituels dans l'individualité qui leur est propre : l'universel est appréhendé dans le particulier » (36). La connaissance du monde historique humain s'enracine dans l'art compris comme organe de compréhension de la relation entre uniformité et singularité, relation qui se réalise dans le « type ». En effet, en histoire, l'individuation se réalise à partir d'une uniformité interrompue par un ensemble de formes fondamentales « qui toujours reviennent dans le jeu des variations », et qui constituent « les types du monde humain ». Ainsi, les “types” constituent les moyens termes entre l'uniformité et l'individuation historique. Ils indiquent, d'un côté, l'élément commun que l'on peut retrouver dans une sphère déterminée du monde humain, de l'autre côté sa norme intérieure (37). Or, le “type” constitue l'objet non pas du processus conceptuel pur, mais de la vision artistique, de la création poétique qui perçoit, par l'intuition, la consonance entre les aspects de la réalité, les parentés cachées, les structures communes. De là découle la fonction de l'art qui, en tant que terme médiateur entre l'Erlebnis (expérience vécue) et la pensée conceptuelle, permet d'assurer la connaissance du monde humain, en ce qu'il donne naissance à des « processus de développement en interaction constante avec l'environnement » (38).
Mais comment la connaissance typologique susceptible d'appréhender à la fois l'universel et l'individuel s'obtient-t-elle ? Le modèle de la création gœthéenne, dans la philosophie de Dilthey, est rapporté à l'importance de l'imagination. En reprenant une idée du Romantisme allemand, qui avait relié métaphysiquement poésie et philologie ou historiographie, Dilthey défend le principe que l'imagination, comprise comme faculté de mise en forme ou de mise en image, ancrée dans l'expérience vécue, se trouverait à la base tant de la création poétique que de la connaissance historique. Il met en parallèle ces 2 domaines — poésie et historiographie — en montrant leur analogie profonde sur 2 points.
D'abord l'art, et la poésie en particulier, remplissent un rôle de médiateurs entre l'universel et le particulier, car ils incarnent le processus même d'individuation. L'expérience singulière vécue, « matière de la création », comme la définit Gœthe, source de l'élaboration poétique ou artistique, est toujours universelle. Elle est en effet susceptible d'être revécue par l'interprète, qui s'élève lui aussi à un Erlebnis créateur. Également, l'expérience d'autrui, revécue par l'historien, est le fondement de la science historique. Cette analogie entre art et historiographie se confirme dans le fait que l'art ne reproduit pas la vie, mais la réinvente comme objet poétique. Or, cette réinvention agit, selon Dilthey, également en histoire dans la mesure où, comme le disait Gœthe : « Un fait de notre vie vaut non pas en tant qu'il est vrai mais en tant qu'il a quelque chose à signifier » (39).
Une autre raison justifie le rapprochement entre l'art et l'historiographie. Elle repose sur le fait que tant l'art que l'histoire ont pour objet une totalité, constituée par l'association entre vie et forme. Leur objet est la vie saisie à travers une forme. « La Beauté est une forme vivante : elle est produite lorsque la vision saisit la vie dans l'image, ou lorsque la vie est insufflée dans l'image », dit Dilthey lui-même, en citant Schiller (40).
Ces 2 analogies, établies par Dilthey, entre l'art et l'histoire seront récupérées par la Morphologie culturelle et adaptées à sa propre perspective. Celle-ci consiste à appréhender les civilisations humaines elles-mêmes comme des œuvres d'art à part entière, dans la mesure où elles se présentent comme des totalités constituées sur l'association vie + forme, dont la compréhension demande au chercheur un acte esthétique et intuitif. À Dilthey revient donc l'initiative d'avoir remis à jour, au sein de l'historicisme allemand, la thèse romantique de l'importance de la poétique pour l'étude systématique des formes historiques de la vie. Ce sont les poètes, Gœthe en tête, qui ont accordé la primauté à l'intuition et fondé la possibilité d'un entendement intuitif. L'intuition telle que Gœthe la présente permet à Dilthey, et à sa suite aux représentants de la Morphologie historique qui la réinterprètent de manière irrationaliste, de rouvrir le débat qui porte sur la question du rapport entre la partie et le tout, entre l'individuel historique et l'universel, et sur le type de faculté spirituelle censée réaliser, tant en art qu'en histoire, cette réappropriation créatrice.
Le rapport entre la culture et l'organisme biologique
L'analogie entre la nature du jugement esthétique et la nature de la connaissance de l'organisme biologique est établie nettement par Kant dans la Première introduction à la Critique de la faculté de juger (1789) (41). Lorsqu'il s'agit de définir cet être organisé qu'est l'“organisme” pour le distinguer de la “machine”, Kant s'exprime ainsi : « La machine possède uniquement la force motrice ; mais l'être organisé possède en soi une force formatrice [bildende Kraft] qu'il communique aux matériaux » (42).
Cette « force formatrice », nous l'avons déjà vue en action chez Moritz, qui s'en sert pour définir le principe de l'œuvre d'art. Quelques années plus tard elle figure dans la Critique de la faculté de juger, définissant l'organisme aussi bien que la faculté esthétique. C'est seulement à partir de ce moment que le parallélisme cher à Gœthe (43), entre œuvre d'art et organisme biologique traverse comme un fil rouge la vision organiciste qui domine la pensée allemande et qui postule, depuis Schelling et Hegel, l'alliance entre la nature et l'esprit, issus d'une origine commune. La pensée romantique est moniste, hostile à la différence instituée entre l'ordre subjectif et l'ordre objectif : l'identité primitive des réalités demeure un postulat jamais renié, d'où découle une véritable ontologie biologique, qui rompt avec la tradition scientifique précédente. En effet, la tradition philosophique rationaliste excluait de l'étude de la nature la notion de « formes plastiques » et exigeait que tout phénomène naturel fût expliqué selon les mêmes lois particulières, c'est-à-dire « mécaniquement et mathématiquement », comme dit Kant. En revanche, à la fin du XVIIIe siècle, Kant eut l'audace de chercher à redéfinir les frontières entre science mathématique de la nature et biologie. Dans la Critique de la faculté de juger, il distingue 2 types de connaissance : celle qui est fondée sur la causalité, et celle qui est fondée sur la finalité. La causalité vise la connaissance objective (succession chronologique des événements), relevant de l'ordre du devenir. La finalité, en revanche, vise la structure de ces catégories d'objets désignés comme “organismes”. Pour lui, la notion d'“organisme” est inconcevable sans la prise en compte de la notion de finalité. En effet, il définit l'organisme comme « un produit organisé de la nature dans lequel tout est à la fois fin et moyen » (44). La même distinction entre ces 2 domaines de la nature, qui seraient le mort et le vivant, est présente aussi chez Gœthe (45). La théorie de Gœthe a exercé une grande influence, non seulement sur le développement de la biologie et son concept d'évolution, mais également au sein des sciences historico-humaines (46).
Déjà à la fin du XVIIIe siècle, la pensée développée au sein de la biologie avait déplacé l'axe de la réflexion scientifique. Le pivot de la recherche biologique était désormais, depuis Linné et Cuvier, la morphologie. Un tel regard, tourné vers la totalité de ces formes, ouvre la voie d'accès à la compréhension tant du général que du singulier. C'est justement un tel rapport entre la totalité des formes et la forme singulière qui constitue l'essence de la nature organique. Mais c'est incontestablement à Gœthe, qui reprend le concept de “type” élaboré par Cuvier (concept qui servira à développer cette thèse du rapport entre la généralité et la particularité des formes organiques), que revient le rôle de grand interprète de la pensée morphologique (47). C'est son apport dans l'élaboration de la notion de “type morphologique”, qui constitue la référence constante de l'historicisme allemand, de Dilthey à Keyserling, en passant par Frobenius, Spengler et Kerényi.
À la différence de Cuvier, Gœthe posait la notion de type non pas d'une manière statique et géométrique (comme un « ensemble de rapports fondamentaux constants », repérables dans la structure des organismes), mais dynamique. Il ne reconnaissait d'autre réalité permanente que celle qui se manifeste à travers le devenir de la vie dont nous faisons nous-mêmes l'expérience (« appréhender l'éternel dans le transitoire »). Cette tension puissante entre être et devenir, persistance et changement, éternel et transitoire, se ramène chez Gœthe au concept de forme (48). En effet, dans la notion de “forme” une dimension inédite apparaît. Elle n'est pas saisissable dans son extension spatiale exclusivement (comme le type) ; elle appartient aussi au temps, et c'est dans celui-ci qu'elle s'accomplit et s'affirme. Ainsi les déviations, les difformités par rapport à la règle, qui se manifestent dans le processus, nous apprennent que la nature organique est bien vivante et soumise à des transformations – lesquelles nous permettent d'appréhender intuitivement l'“essence formelle” et de la contempler.
Ni cet esprit ni cette loi immanente et dynamique ne sont présents dans le concept de type selon Cuvier. C'est justement cet élément spirituel introduit par Gœthe qui permet d'abord à Dilthey, et ensuite à la Morphologie culturelle, de récupérer des concepts naturalistes comme ceux de type et de forme, dont une interprétation mécaniste est incompatible avec le monde humain de l'esprit, avec l'univers culturel-spirituel humain. Pour Gœthe, toutes les natures organiques supérieures sont façonnées selon un prototype ; la diversité des formes, en revanche, « naît de tout ce qui conditionne nécessairement les relations avec le monde extérieur, et on peut donc supposer à bon droit une diversité originaire simultanée, et une transformation continûment progressive, pour pouvoir concevoir les apparitions tant constantes que déviantes » (49). Un tel prototype apparaît non pas aux sens, mais à l'esprit confronté à la variété de ses manifestations. Gœthe exprime ainsi par avance l'idéal d'une “morphologie idéaliste” dont les prémisses étaient déjà contenues dans la polémique qui opposait Herder aux philosophes des Lumières, à propos de l'irréductibilité des cultures nationales à un modèle unique de validité universelle : « Les mettre tous ensembles ? Quintessence de tous les temps et de tous les peuples ? Quelle sottise ! Toute nation contient le centre de son bonheur en elle-même, tout comme toute sphère a en elle-même son barycentre » (50).
Gœthe ne fait que transférer cette idée, de l'histoire au monde de la vie en général. Lui aussi, comme Herder, affirme l'impossibilité d'isoler de la totalité de la vie un de ces “types” ou “espèces” singuliers, et de les exhiber comme un canon, comme une règle générale. Le rapport entre universel et particulier, au cœur de la tradition romantique, fait du factuel et du théorique non pas les termes d'une opposition, mais les 2 éléments d'une relation unitaire indissoluble. Entre l'universel et le particulier existe, selon Gœthe, non pas un rapport d'implication hiérarchique (subsumieren), mais plutôt la possibilité d'une représentation idéelle ou symbolique. Ce n'est qu'en tenant compte d'un tel rapport entre l'idée et la manifestation, que l'on peut espérer comprendre la théorie gœthéenne de la forme et, partant, celle du l'École morphologique. Le principe qui guide la nature se révélerait, ainsi au naturaliste non pas à travers une série illimitée d'observations éparses et fragmentaires, mais dans un seul « cas prégnant » et par intuition soudaine (51). Il apparaît donc à l'évidence que le concept gœthéen de genèse est “dynamique”, non pas historique. Il renvoie à une genèse idéale, non pas factuelle. À quel genre de savoir appartient alors la “morphologie idéaliste” ? Si elle ne constitue pas une théorie de la filiation historique, elle postule en revanche une règle interne autre que la causalité historique, à savoir la finalité formelle (ou « finalité sans fin »), déjà postulée par Kant qui en faisait le fondement du jugement esthétique et voyait en elle le principe d'organisation des organismes.
****
Considérons 3 des thèmes gœthéens : a) la vie comprise comme principe dynamique, régi par une finalité interne (le « principe de finalité formelle » selon Kant), dont la nature est organique et spirituelle à la fois ; b) la vie des organismes envisagée dans leur interaction constante avec leur environnement ; c) la question de la genèse idéelle et non pas réelle des formes.
Ces 3 thèmes constituent autant de lieux “topiques” de la Morphologie culturelle, laquelle les a récupérés et appliqués concrètement à l'étude des civilisations historiques. Ainsi, pour ce qui concerne le premier de ces 3 thèmes, à savoir la vision vitaliste, la Morphologie culturelle réinterprète cette vision comme la manifestation d'une parabole, analogue à celle, biologique, à laquelle les civilisations sont soumises. Cette parabole connaît une éclosion, un épanouissement et un déclin régis par un principe autorégulateur (le principe de «finalité formelle») que cette École réinterprète à travers la notion de « direction » et/ou de « destin ». Pour ce qui est du deuxième thème, l'interaction des ces organismes vivants avec leur milieu, la morphologie culturelle le revisite comme une interaction entre les civilisations historiques avec leur environnement naturel, interaction qui se concrétise dans l'abandon de ces civilisations à leur principe “païdeumatique”. Enfin, le troisième thème (la genèse idéelle des formes) se voit décliner comme la reconstruction de l'émergence idéelle des civilisations (la “commotion” et le “saisissement” face au monde), au détriment de la reconstruction factuelle de cette émergence.
L'approche morphologique s'inspire donc de Gœthe lorsque — à l'instar aussi de Herder — elle voit dans les cultures des totalités refermées sur elles-mêmes. Celles-ci sont étudiées par la Morphologie culturelle comme les variétés d'une espèce unique, ou l'actualisation d'autant d'essences originelles, conçues sous le mode de l'“Urphänomen” (52). Ces essences spirituelles archétypales, dont les civilisations ne sont que les concrétions hypostasiées, cristallisent en elles le principe constitutif de leur forme. Et ce, à ce moment précis de leur cycle organique où leur “vitalité” atteint son sommet, vitalité dont le signe est l'état d'“émerveillement” et de “saisissement” face au monde. Cette expérience d'émerveillement, que Gœthe qualifiait d'« aptitude la plus élevée de la pensée humaine », fixe le principe païdeumatique d'une culture, sa règle interne, son style spécifique et son “destin”.
La Morphologie historique est tributaire de Gœthe par un autre aspect encore. On a vu le rôle que l'intuition joue dans l'approche morphologique comprise non exclusivement comme méthode, mais aussi comme inséparable d'une Weltanschauung. Chez Gœthe déjà, ce sentiment de la vie qui traverse le tout est censé s'ancrer dans une forme de certitude fournie par l'intuition. C'est que l'intuition éclaircit ce sentiment en le posant sur des bases certaines. Car, pour Gœthe, la vie, comprise comme forme continue et vivante, n'est pas saisissable dans le concept, lequel peut seulement séparer, non pas véritablement réunir. Au travail analytique du concept doit donc s'associer celui, synthétique, de l'imagination (« l'imagination sensible exacte »), censée appréhender l'unité sous-jacente de la variété des formes vivantes. Les études de Gœthe consacrées à la morphologie des formes vivantes offraient ainsi un modèle susceptible d'être transféré du domaine de la vie organique à celui de la vie historique ainsi qu'à celui de l'esthétique. Encore faut-il, pour que ce transfert soit possible, partir du présupposé qu'entre le monde biologique naturel et le monde de l'esprit aucune opposition radicale ne subsiste, mais qu'une nécessité interne embrasse ces 2 mondes, les relie métaphysiquement. Voilà pourquoi la récupération de la pensée de Gœthe par la Morphologie culturelle réalise un retour à la philosophie romantique et, du même coup, au naturalisme qu'implique sa Weltanschauung.
La “vie” joue dans la Morphologie culturelle un rôle de premier plan en tant que principe actif. “Réalité” et “vie” sont pour ces auteurs synonymes. Si Spengler reprend l'opposition formulée par Dilthey entre sciences de la nature et sciences de l'esprit, il le fait (à l'instar de Frobenius, Jensen et Kerényi) en opposant les sciences du devenu aux sciences du devenir (53). Pour les représentants de la Morphologie culturelle, seul le monde historique — celui où l'homme peut saisir, par auto-observation, le processus créateur en acte — est véritablement vivant, en progression et transformation permanente. Il ne saurait être appréhendé par une démarche logico-intellectuelle, laquelle dénature les phénomènes en leur imposant le principe de causalité mécanique. C'est l'intuition, ou l'« imagination sensible exacte », qui nous fait accéder à ce processus créatif irréductible au principe de causalité, de tempe et d'espace mécaniques.
La conjonction de l'héritage esthétique de Moritz et de Kant, avec la pensée morphologique de Gœthe appelait un certain nombre de modifications de la part de la Morphologie culturelle : la « nature vivante » selon Gœthe devient, pour les représentants de ce courant (not. chez O. Spengler), « le monde comme histoire », ou « le troisième règne » (chez Frobenius), c'est-à-dire le monde de la vie spirituelle des civilisations considérée dans le développement pluriel des ses formes et de son devenir, accessible par intuition immédiate.
La différence entre nature et histoire se situe ainsi non pas au niveau de l'hétérogénéité des objets, mais dans la manière de considérer ces objets. Le monde peut en effet être appréhendé comme “histoire” ou comme “nature”, comme “devenir” ou comme “devenu”, comme “vivant, en transformation et métamorphose permanente” (monde organique) ou comme “mort, figé dans des formes statiques” régies par des lois mécaniques et immuables (celles-là mêmes qui règlent la connaissance mathématique et factuelle de la nature). Et puisqu'un tel organisme constitue une forme individuelle, il ne pourra être cerné par le recours à une explication causale, fondée sur des lois générales. Pour le saisir, il faudra recourir à « l'imagination sensible exacte ». C'est ici que la méthode “physiognomonique” apparaît comme la méthode par excellence de la morphologie culturelle.
L'ancienne physiognomonie consiste, à partir de traits morphologiques extérieurs, à connaître les tendances morales ou le caractère psychologique des hommes. De même, la physiognomonie de la Morphologie culturelle, appliquée à l'étude des civilisations, présuppose une analogie intrinsèque entre les expressions externes de celles-ci et leur orientation spirituelle interne, et pose qu'un lien organique et nécessaire conçu comme « direction » et « destin » relie ces 2 domaines du symbolisant et du symbolisé. Cette relation entre visible et invisible, entre forme extérieure et principe intérieur, renvoie inévitablement à l'idée d'une unité foncière de l'Être, à une syntonie de sphères en rapport de concordance réciproque (54).
Mais en quoi devait-elle consister au juste cette « grande époque » préconisée par Spengler et Frobenius, appelée à voir la mise en place de cette « nouveauté philosophique » dont la méthode morphologique devait constituer le support ? La suite des événements historiques, politiques et intellectuels de l'Allemagne, entre la fin de la Première Guerre mondiale et le déroulement de la Seconde, paraît en avoir été un des développements possibles, quoique certainement différent de ce que ces penseurs avaient pu imaginer.
L'orientation de la Morphologie culturelle a été qualifiée par ses détracteurs de “réactionnaire”. Bornons-nous ici à évoquer 2 des raisons de ce jugement. D'abord, elle l'est en ce sens qu'elle accorde la primauté logique, ontologique et esthétique au passé, au détriment du présent et du futur. Le seul avenir digne d'être vécu est celui, comme semblent le dire Frobenius et Kerényi, qui saurait retrouver la faculté spontanée, non intentionnelle, de réactualiser une phase d'éclosion et de vigueur créatrice, une phase d'« expressivité » pure reposant sur l'identification mimétique de l'âme humaine au monde et à ses phénomènes. Ce courant est “réactionnaire” pour une seconde raison aussi. Selon certains représentants de la Morphologie culturelle, cette condition première où la conscience et le monde se reflètent l'un dans l'autre n'est pas définitivement révolue. Peut-être pourra-t-elle encore être restaurée. Non pas par des hommes faisant preuve de “bonne volonté” — ce qui supposerait, de leur part, la production d'actes conscients et intentionnels, producteurs de “factualité” — mais par ceux qui sont « susceptibles d'éprouver l'étonnement primordial », capables de se soumettre à la “réalité” et au “destin” plutôt que de produire des “faits”.
Frobenius écrivait en 1933 que pour « réapprendre le sentiment de la vie », typique d'autres époques ou d'autres cultures, « aucun peuple n'est aussi qualifié que le peuple allemand ». Sa défaite essuyée 15 ans plus tôt est celle des valeurs rationnelles, réalistes, matérielles, « tout à fait étrangères à notre mentalité ». Mais maintenant que la civilisation allemande vient de vivre « une émotion qui correspond à son essence interne », le « sentiment allemand » est redevenu « pur », si bien que maintenant débarrassés d'un costume étranger « nous pouvons jouer le rôle qui fut écrit pour nous ». De telles paroles, rétrospectivement, prononcées au moment où naissait un autre “Reich”, dit lui aussi “troisième”, nous font l'effet de lourds nuages dans un ciel dont Frobenius ne paraît pas avoir pressenti les orages qui, pourtant, devaient se déclencher le soir même (55).
► Silvia Mancini, Diogène n°186, avril-juin 1999.
♦ Notes :
- 1. Judith Schlanger, Les métaphores de l'organisme, Vrin 1971 ; 2e édition, L'Harmattan 1995, p. 66-67.
- 2. C'est dans ce même climat que trouve sa place aussi l'École fondée par Aby Warburg, caractérisée par une méthode reposant sur l'utilisation des témoignages figuratifs comme sources historiques, afin de réaliser une histoire de l'art débouchant sur une Kulturwissenschaft, telle que l'envisageait Burckhardt.
- 3. Parmi ses ouvrages, ont été traduits en français La civilisation africaine (1933), tr. fr. Gallimard 1952, Rocher 1987 ; La mythologie de l'Atlantide, Payot 1940, Rocher 1993 ; Le destin des civilisations, Gallimard 1940 ; Peuples et sociétés traditionnelles du Nord Cameroun, Stuttgart, F. Steiner 1987.
- 4. Das religiöse Weltbild einer frühen Kultur, Stuttgart, Schröder 1952, ainsi que Mythes et cultes chez les peuples primitifs (tr. fr. Payot 1954).
- 5. Zurich. 1911, tr. fr. Payot 1953.
- 6 Munich/Vienne, Langen/Müller 1985.
- 7. D'où l'importance, pour Kerényi, de ce qu'il appelle le « style » commun à une civilisation, à la religion et à l'art. Pour lui, « le style constitue ce qui demeure constant dans le changement. C'est pourquoi, tout ce qui est périssable acquiert, par le style, une signification impérissable ». Umgang mit göttlichen Wesen und Gegenwärtigkeit des Mythos, Munich-Vienne, Lagen/Müller Verlag 1985. Tr. it. : Il rapporto con il divino, Turin, Einaudi 1991, p. 67-68. À rapprocher de l'idée de Jensen selon laquelle chaque civilisation est un « unicum » (A. Jensen, tr. fr. : Mythes et cultes chez les peuples primitifs, Payot 1954, p. 46).
- 8. C'est ainsi que Frobenius cite en exergue le mot de Woelfflin : « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde », La civilisation africaine (1933), tr. fr. Rocher 1987, p. 1987, p. 23), et que Jensen insiste sur la nécessité de recentrer culturelle sur mur le problème du sens (op. cit. 1951, p. 46-51).
- 9. Nous limiterons nos réflexions sur l'Irrationalisme à un aspect particulier, à savoir ce que G. Lukàcs appelle « la philosophie de la vie », en faisant référence notamment à ces auteurs, entre 1800 et 1900, qui théorisent l'immédiateté de la vie comme la voie d'accès à la « vraie réalité », en rupture avec les démarches de la pensée analytique et de la logique causale qui guide l'esprit scientifique.
- 10. Sur cette idée de « saisissement », cf. notamment A. Jensen, Mythes et cultes chez les peuples primitifs, op. cit., 1954, p. 73. Il convient d'entendre par là une expérience menant de la perception mystique ou esthétique (en tout cas a-logique) d'un ordre cosmique à la représentation de cette réalité dans les mythes, les cultes et les formes artistiques.
- 11. J. G. Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, 1773 ; tr. fr. : Une autre philosophie de l'histoire, Aubier 1964, p. 167-173.
- 12. À ce propos, la polémique qui l'oppose à Winckelmann, lequel voit dans la Grèce le modèle de l'Antiquité tout entière est très significative. Pour Herder, même l'art et la littérature de la Grèce sont « nationales ». La Grèce reste toutefois pour lui un modèle de cette jeunesse ou de cette primitivité, en tant que synthèse harmonieuse de primitivisme et d'accomplissement. Le fait que déjà chez Herder nous retrouvons le thème grec du mythe de Nemesis qui frappe toute force excessive atteignant son apogée nous semble très intéressant. Semblable thème jouera un rôle fondamental dans la conception non seulement de Spengler, mais aussi de Frobenius et de Kerényi.
- 13. K. Kerényi associe à cette idée d'immédiateté l'idée d'archetypos, d'archétype, de prototype, etc. Cf. surtout Wesen und Gegenwärtigkeit des Mythos (1964), tr. cit. 1991, p. 128.
- 14. Pour une grandiose évocation de l'origine des civilisations, du développement des cultures, de leurs cycles, etc., cf. particulièrement K. Kerényi, Einführung in das Wesen der Mythologie, Zurich, 1941. Tr. fr. : Introduction à l'essence de la mythologie, Payot 1953, p. 38-39. Cf. aussi L. Frobenius, Le destin des civilisations, Gallimard 1940, p. 81-82, repris in Leo Frobenius 1873-1973 : Une anthologie, préf. de Léopold Sédar Senghor, Wiesbaden, Steiner 1973, p. 19-63.
- 11. Rappelons ici la fameuse évocation, par Herder, de la chaîne des êtres, de la pierre au cristal, du cristal aux métaux, etc., jusqu'à l'homme, où la série s'arrête : cf. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1783). Tr. fr. : Idées pour la philosophie de l'histoire de l'humanité, Aubier 1962, p. 81. Nous retrouvons l'écho d'une telle conception chez Franz Boas, élevé dans le même climat intellectuel qui a donné naissance à l'école historico-culturelle allemande et, par là, à la morphologie historique, mais aussi plus généralement dans l'anthropologie culturelle américaine, pour qui la culture est comprise comme un ensemble bio-psychique. (;I'. Marvin Harris, The Rise of Anthropological Theory : A History of Theories of Culture, New York, Thomas Y. Crowell 1969 – notamment les chapitres IX (« Le particularisme historique : Franz Boas ») et X (« Le milieu boasien »). Cf. aussi : Georges Stocking, Race, Culture and Evolution, Chicago, Free Press 1968 – et plus particulièrement le chapitre VII : « De la physique à l'ethnologie ».
- 12. Tout se passe, écrit Kerényi, comme si déjà dans le plasma humain se trouvait « un élément spirituel, l'impériosité du spirituel », élément qui, dit-il, correspond au Païdeuma au sens où Frobenius l'entend. Cf. notamment Kerényi, op. cit. (1953), p. 37.
- 13. Sur ce principe antiréductionniste, compris aussi comme critique d'une certaine forme d'évolutionnisme, cf. Kerényi, op. cit. (1991), p. 22-25.
- 14. Rappelons ici le propos d'A. W. Schlegel qui oppose la pendule, mue par un mécanisme étranger, et le système solaire qu'à l'instar de l'œuvre d'art véritable est mu par une force résidant en lui-même. Cf. pour ce passage, L'absolu littéraire, Seuil 1978, p. 346-347.
- 15. Sur l'antagonisme entre le concept de « civilisation » et celui de « culture » dans la culture européenne du XIXe siècle, et sur l'utilisation de cette antithèse dans le processus de construction de l'identité culturelle allemande, cf. N. Elias, La civilisation des mœurs, Calmann-Lévy 1973 ; J. Starobinski, « Le mot civilisation », in Le temps de la réflexion, n. 4, 1983, p. 13-51 ; L. Dumont, L'idéologie allemande, Seuil 1991 ; E. Terray, Une passion allemande, Seuil 1994.
- 20. L'ethnologie historique allemande, née en réaction aux modèles généralisants de l'évolutionnisme, procédait à l'individuation d'une culture en la situant tout d'abord géographiquement, puis en élargissant éventuellement ses confins au fur et à mesure que la recherche mettait à nu la diffusion, dans l'espace, de certains éléments significatifs de la culture elle-même. Le type de phénomènes culturels pris en compte dans ce travail d'individuation touchait (not. chez F. Ratzel) les techniques de fabrication, les formes des ustensiles, les matériaux employés, etc. Ainsi, l'ethnologie allemande se situera de manière de plus en plus en explicite sur le versant culturaliste : des Völkerkreise (cycles ethniques) de Ratzel on passera aux Kulturkreise (cycles culturels) théorisés par Bernhard Ankermann (1859-1915) et Fritz Graebner (1887-1934). Toutefois, au sein même de ce courant, où Frobenius en 1898, alors âgé de 25 ans, fut l'artisan de la théorie des cycles culturels (théorie systématisée définitivement en 1904 par Ankermann et Graebner), une scission s'effectua. En effet, Frobenius s'éloigna progressivement de l'École historico-culturelle, en polémiquant contre ses méthodes jugées trop mécaniques, pour fonder sa propre école, à Francfort. Celle-ci se proposait de privilégier notamment les aspects spirituels de la culture en renouant ainsi avec la tradition, romantique et germanique, dont l'allemand F. Max-Muller avait été le porte-parole sur le terrain de l'histoire comparée des religions. Cf. Dario Sabbatucci, Sommario di Storia delle religioni, Rome, Il Bagatto 1991, p. 98-100.
- 21. Son argumentation rappelle beaucoup le discours morphologico-naturaliste de Cuvier et de Gœthe, notamment La métamorphose des animaux de ce dernier. Cf. « Der Ursprung der afrikanischen Kulturen » in Zeitschrift für Ethnologie, XXXVII, 1898, p. 88-89. Un exposé systématique de la polémique qui opposa L. Frobenius et ses disciples à l'École historico-culturelle de Graebner et Ankermann, ainsi qu'à celle de Vienne du père Wilhelm Schmidt, se trouve dans l'ouvrage d'Adolf Jensen, Das religiöse Weltbild einer frühen Kultur, Stuttgart, 1948. La rupture avec la théorie des cycles culturels sera explicite dans un article de Frobenius lui-même, in Zeitschrift für Ethnologie, XXXVII, p. 88, où il affirme : « J'avoue que ces travaux suscitent en partie aujourd'hui, en moi, une certaine peine ; ce travail contient de nombreuses erreurs, et la chose la meilleure sera d'avoir le courage de les avouer soi-même : Pater peccavi ».
- 22. Cette orientation aura 2 conséquences. D'une part, en Allemagne, le véritable objet de la recherche ethnologique s'identifie à la Kultur, en tant que manière historique d'être d'une ethnie déterminée. Sa problématique se développera ainsi en syntonie parfaite avec celle des sciences historiques. D'autre part, en inscrivant sa démarche parmi celles des sciences historiques – et en réclamant pour ces sciences un statut différent des sciences de la nature –, l'ethnologie allemande refuse dès ses débuts la typologie de l'anthropologie évolutionniste concernant les phases évolutives d'une culture unique, en défendant l'idée de l'irréductible variété des cultures historiques.
- 23. Tout était d'abord sacré, puis « on s'engagea avec une vitesse folle dans une voie de plus en plus profane » : Leo Frobenius, op. cit. 1933, tr. fr. 1987, p. 59-60. Cf. aussi Le destin des civilisations, op. cit. (note 15), p. 82. Des propos similaires sont présents aussi chez A. Jensen. Cf. notamment Mythos und Kult bei Naturvölkern, Wiesbaden, 1951, p. 70.
- 24. « Ma science de la civilisation veut que le devenir de la civilisation de l'humanité constitue un troisième règne (Reich). La civilisation est une chose organique, elle est essence, langue et histoire », in La civilisation africaine, Rocher 1987, p. 37.
- 25. Ainsi, un auteur comme E. Hahn pouvait affirmer (in Demeter und Bubo, Leipzig, 1897 – mais aussi in Die Entstehung der Pflugkultur, Heidelberg, 1909, p. 182-185, et in Von der Hacke zum Pflug, Leipzig 1919, p. 77-80) que l'origine des expressions techniques et économiques était de nature religieuse, et que l'emploi d'instruments et d'inventions à des buts utilitaires ou profanes n'attesterait qu'une phase historiquement secondaire, dérivée ultérieurement d'une phase initiale où le rite et le mythe gouvernaient l'existence des sociétés humaines.
- 26. On pourrait dire qu'un tel concept exprime la culture à l'état potentiel. La relation entre les produits de la culture et le païdeuma, telle que Frobenius la conçoit, peut être traduite dans les termes de l'opposition entre noumène et phénomène ou entre potentialité et actualité. Cf. par ex. Leo Frobenius, Païdeuma n° l, Francfort, p. 158, cité aussi in : K. Kerényi et et CG Jung, Introduction à l'essence de la mythologie, en collaboration avec CG Jung (1941), tr. fr. Payot 1993, p. 37, note.
- 27. La science des religions elle-même a pour objet un retour au « rapport » (Umgang) originel avec le divin, à partir d'une expérience vécue plutôt que d'une attitude intellectuelle. Cf. notamment K. Kerényi, Umgang mit göttlichen Wesen (1985), tr. it. 1991, cit., p. 28.
- 28. Cf. un exemple d'énumération in « Présentation » de Danièle Cohn à : Écrits d'esthétique, Cerf 1993, p. 7-8.
- 29. Sur la systématisation de l'esthétique romantique réalisée par Karl Philipp Moritz, voir, de cet auteur, Le concept d’achevé en soi et autres écrits (1785-1793), intro. de P. Beck, PUF 1995. Cf. aussi le travail de T. Todorov qui a fait connaître en France, avant sa traduction de l'allemand, cet auteur trop peu connu du public français ; voir surtout le chapitre VI (« La crise romantique ») de l'ouvrage de Todorov, Théories du symbole, Seuil 1977.
- 30. K. P. Moritz, Sur le concept d'achevé en soi (1785), in op. cit. (note 26), 1995, p. 83.
- 31. K. P. Moritz, Sur l'imitation formatrice du beau (1788), in op. cit. (note 26), p. 157.
- 32. Sur cette notion d'imitation et de « formation créatrice » chez Moritz, voir notamment ibid., p. 149.
- 33. D'où l'importance de ce qu'il appelle « premier instant du surgissement ». Cf. ibid., p. 159).
- 34. K. P. Moritz, Sur le concept d'achevé en soi (1785), in op. cit., p. 84 où il développe aussi ce qu'il entend par finalité interne et externe.
- 35. K. P. Moritz, La signature du beau (1788), in op. cit. (nota 26), p. 177.
- 36. Voir, à ce sujet, des déclarations caractéristiques, in « Présentation » de Danièle Cohn à Écrits d'esthétique, op. cit. (note 25), p. 23.
- 37. Dans ce « type », dit Dilthey, sont reliés entre eux plusieurs signes caractéristiques, plusieurs parties ou fonctions. Ces traits, dont l'union forme le « type », sont entre eux dans une relation réciproque telle que la présence de l'un permet d'inférer celle de l'autre, les variations de l'un celles de l'autre. De cet auteur, cf. Écrits d'esthétique (cité en note 25), p. 45. Voir, aussi, du même auteur, Théorie des conceptions du monde, PUF 1946, not. le chapitre : « L'art, la religion et la philosophie ».
- 38. W. Dilthey, Introduction à l'étude des sciences humaines, PUF 1942, p. 25-28.
- 39. Gœthe, dans une lettre à Eckermann du 30 mars 1831, cité dans W. Dilthey, Écrits d'esthétique, op. cit. note 25, p. 18.
- 40. W. Dilthey, Écrits d'esthétique, op. cit. note 25, p. 54.
- 41. I. Kant, Première Introduction à la critique de la Critique de la faculté de juger (1789), tr. fr. Vrin 1997, p. 61-63.
- 42. I. Kant, Critique de la faculté de juger (1790), tr. fr. : Vrin 1993, p. 297.
- 43. En soulignant l'affinité entre ses vues et celles de Kant, exposées dans la Critique de la faculté de juger, Gœthe va jusqu'à déclarer : « J'ai vu mes intérêts les plus opposés se réunir et s'associer, les productions de l'art traitées de la même façon que les productions de la nature », in Werke : Kommentare - Register, 13, Hambourg, 1981, p. 27. Cf. aussi Ernst Cassirer : Gœthe und die Kantische Philosophie (tr. fr. : « Gœthe et la philosophie kantienne », in Rousseau, Kant, Gœthe, Belin 1991, p. 98-100) ainsi que Jean Lacoste, Gœthe : Science et philosophie, PUF 1997, p. 218, et Danièle Cohn, La lyre d'Orphée, Flammarion 1999.
- 44. I. Kant, Critique de la faculté de juger, (1790), tr. fr. Vrin 1995, p. 301.
- 45. Oswald Spengler a relevé un passage, assez caractéristique, d'une déclaration de Gœthe à Eckermann, dans laquelle il est question de faction de la divinité dans le « vivant » et non pas dans le « mort » (cité dans Le déclin de l'Occident, tr. fr. Gallimard 1976, p. 61).
- 46. Le renouveau d'intérêt manifesté par l'histoire et l'épistémologie des sciences humaines de ces toutes dernières années pour la morphologie a mis en lumière une série d'ascendances intéressantes, notamment au sein de l'anthropologie et de la sociologie, reliant ces domaines à la tradition de la Morphologie idéaliste. À ce propos, cf. C. Severi « Structure et forme originaire » in Les idées de l'anthropologie, A. Colin 1988, p. 117-150 et J. Petitot, « La généalogie morphologique » in Critique n°620-621 consacré à Claude Lévi-Strauss, janv.-fév. 1999, p. 97-122.
- 47. La biologie, disait Gœthe, ne serait pas une véritable science si du particulier elle n'arrivait pas au général. Sur ce point précis, cf. Ernest Cassirer, op. cit., 1995, p. 153. Cf. aussi Jean Lacoste, Gœthe : Science et philosophie, PUF 1997, p. 15-87.
- 48. Cf. « Principes de Philosophie, discutés en mars 1830 au sein de l'Académie Royale des Sciences », in Naturwissenschaftliche Schriften, éd. de Weimar, t. VII, p. 189 sq.
- 49. JW Gœthe, « Die Skelette der Nagetiere », in Naturwissenschaftliche Schriften, VIII, Weimar, 1887-1919, p. 253.
- 50. J. G. Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte der Menschheit (1774). Trad. it. : Ancora una filosofia della storia per l'educazione dell'umanità, Turin, Einaudi 1981, p. 38.
- 51. Dans ce type de rapport à la connaissance, ni la déduction ni l'induction ne sont mises à contribution, l'idéal cognitif reposant en premier lieu sur l'intuition. Cf. not. « Zur Farbenlehre » (partie historique), in Naturwissenschaftliche Schriften, Weimar, 1887-1919, t. III, p. 236. Il est d'ailleurs intéressant de noter la ressemblance entre ces propos, par la suite récupérés par Dilthey lui-même au sujet de la démarche historique, et les arguments employés par C. Geertz pour définir, en anthropologie, le concept de « description dense ».
- 52. En reprenant ce concept, employé par Gœthe à propos des formes végétales, Judith Schlanger s'exprime ainsi sur l'approche morphologique d'O. Spengler (mais ce qu'elle dit pourrait s'appliquer aussi bien à tous les porte-parole de la Morphologie culturelle) : « Spengler voit dans les peuples et les styles nationaux non pas les acteurs mais les œuvres de la culture, substituant ainsi au pathos du peuple le pathos de la culture. La culture est le phénomène primaire [...] elle est un Urphänomen, au sens que la philosophie de la nature de Gœthe a voulu donner à cette notion », op. cit., 1995, p. 160.
- 53. O. Spengler, Le déclin de l'Occident (1917), tr. fr. Gallimard 1976, p. 35-38.
- 54. Aussi bien Spengler s'estimait-il en droit d'affirmer : « Toutes les méthodes pour entendre l'univers peuvent, en dernière analyse, être nommées "morphologie" », et il appelait de ses vœux l'avènement, en sciences humaines, d'une « physiognomonie réglée scientifiquement », cf. ibid., p. 16 et 108. Cf. aussi note 59, p. 19, sur ce qu'il attend d'une recherche historique à venir.
- 55. L. Frobenius, op. cit. (note 4), p. 32.