SE
Questions à Robert Steuckers :
Pour préciser les positions de « Synergies Européennes »

• Dans quelle mesure le "national-bolchevisme" s'insère-t-il dans la "troisième voie", entre libéralisme et marxisme ?
Le national-bolchevisme ne fait pas référence à une théorie économique ou à un projet de société : on l'oublie trop souvent. Ce vocable composé a été utilisé pour désigner l'alliance, toute temporaire d'ailleurs, entre les cadres traditionnels de la diplomatie allemande, soucieux de dégager le Reich vaincu en 1918 de l'emprise occidentale, et les éléments de pointe du communisme allemand, soucieux d'avoir un allié de poids à l'Ouest pour la nouvelle URSS. Avec Niekisch, ancien cadre de la République des Conseils de Munich, écrasée par les Corps Francs nationalistes mais mandatés par le pouvoir social-démocrate de Noske, le national-bolchevisme prend une coloration plus politique, mais s'auto-désigne, dans la plupart des cas par l'étiquette de "nationale-révolutionnaire". Le concept de national-bolchevisme est devenu un concept polémique, utilisé par les journalistes pour désigner l'alliance de 2 extrêmes dans l'échiquier politique. Niekisch, à l'époque où il était considéré comme l'une des figures de proue du national-bolchevisme, n'avait plus d'activités politiques proprement dites ; il éditait des journaux appelant à la fusion des extrêmes nationales et communistes (les extrêmes du "fer à cheval" politique disait Jean-Pierre Faye, auteur du livre Les langages totalitaires). La notion de "Troisième Voie" est apparue dans cette littérature. Elle a connu des avatars divers, mêlant effectivement le nationalisme au communisme, voire certains éléments libertaires du nationalisme des jeunes du Wandervogel à certaines options communautaires élaborées à gauche, comme, par ex., chez Gustav Landauer.
[Pour en savoir plus, de Thierry Mudry : cf. 1) "Le “socialisme allemand” : analyse du télescopage entre nationalisme et socialisme de 1900 à 1933 en Allemagne", in : Orientations n°7, 1986 ; 2) "L'itinéraire d'Ernst Niekisch", in : Orientations n°7, 1986]
Ces mixages idéologiques ont d'abord été élaborés dans le débat interne aux factions nationales-révolutionnaires de l'époque ; ensuite, après 1945, où on espérait qu'une troisième voie deviendrait celle de l'Allemagne déchirée entre l'Est et l'Ouest, où cette Allemagne n'aurait plus été le lieu de la césure européenne, mais au contraire le pont entre les 2 mondes, géré par un modèle politique alliant les meilleurs atouts des 2 systèmes, garantissant tout à la fois la liberté et la justice sociale. À un autre niveau, on a parfois appelé "troisième voie", les méthodes de gestion économique allemandes qui, au sein même du libéralisme de marché, se différenciaient des méthodes anglo-saxonnes. Celles-ci sont considérées comme trop spéculatives dans leurs démarches, trop peu soucieuses des continuités sociales structurées par les secteurs non marchands (médecine & sécurité sociale, enseignement & université). Le libéralisme de marché doit donc être consolidé, dans cette optique allemande des années 50 et 60, par un respect et un entretien des "ordres concrets" de la société, pour devenir un "ordo-libéralisme". Son fonctionnement sera optimal si les secteurs de la sécurité sociale et de l'enseignement ne battent pas de l'aile, ne génèrent pas dans la société des dysfonctionnements dus à une négligence de ces secteurs non marchands par un pouvoir politique qui serait trop inféodé aux circuits bancaires et financiers.
L'économiste français Michel Albert, dans un ouvrage célèbre, rapidement traduit dans toutes les langues, intitulé Capitalisme contre capitalisme, oppose en fait cet ordo-libéralisme au néo-libéralisme, en vogue depuis l'accession au pouvoir de Thatcher en Grande-Bretagne et de Reagan aux États-Unis. Albert appelle l'ordo-libéralisme le "modèle rhénan", qu'il définit comme un modèle rétif à la spéculation boursière en tant que mode de maximisation du profit sans investissements structurels, et comme un modèle soucieux de conserver des "structures" éducatives et un appareil de sécurité sociale, soutenu par un réseau hospitalier solide. Albert, ordo-libéral à la mode allemande, revalorise les secteurs non marchands, battus en brèche depuis l'avènement du néo-libéralisme.
La nouvelle droite française, qui travaille davantage dans l'onirique, camouflé derrière l'adjectif "culturel", n'a pas pris acte de cette distinction fondamentale opérée par Albert, dans un livre qui a pourtant connu une diffusion gigantesque dans tous les pays d'Europe. Si elle avait dû opter pour une stratégie économique, elle aurait embrayé sur la défense des structures existantes (qui sont aussi des acquis culturels), de concert avec les gaullistes, les socialistes et les écologistes qui souhaitaient une défense de celles-ci, et critiqué les politiques qui laissaient la bride sur le cou aux tendances à la spéculation, à la façon néo-libérale (et anglo-saxonne). Le néo-libéralisme déstructure les acquis non marchands, acquis culturels pratiques, et toute nouvelle droite, préconisant le primat de la culture, devrait se poser en défenderesse de ces secteurs non marchands. Vu la médiocrité du personnel dirigeant de la ND parisienne, ce travail n'a pas été entrepris.
[Pour en savoir plus : 1) R. STEUCKERS, "Repères pour une histoire alternative de l'économie", in : Orientations n°5, 1984 ; 2) Thierry MUDRY, "Friedrich List : une alternative au libéralisme", in : Orientations n°5, 1984 ; 3) RS, "Orientations générales pour une histoire alternative de la pensée économique", in : Vouloir n°83/86, 1991 ; 4) Guillaume d'EREBE, "L'École de la Régulation : une hétérodoxie féconde ?", in : Vouloir n°83/86, 1991 ; 5) RS, L'ennemi américain, Synergies, Forest, 1996/2ème éd. (avec des réflexions sur les idées de Michel Albert) ; 6) RS, "Tony Blair et sa “Troisième Voie” répressive et thérapeutique", in : Nouvelles de Synergies européennes n°44, 2000 ; 7) Aldo DI LELLO, "La “Troisième Voie” de Tony Blair : une impase idéologique. Ou de l'impossibilité de repenser le “Welfare State” tout en revenant au libéralisme", in : Nouvelles de Synergies eruopéennes n°44, 2000].
Perroux, Veblen, Schumpeter et les hétérodoxes
Par ailleurs, la science économique en France opère, avec Albertini, Silem et Perroux, une distinction entre "orthodoxie" et "hétérodoxie". Par orthodoxies, au pluriel, elle entend les méthodes économiques appliquées par les pouvoirs en Europe :
• 1) l'économie planifiée marxiste de facture soviétique,
• 2) l'économie libre de marché, sans freins, à la mode anglo-saxonne (libéralisme pur, ou libéralisme classique, dérivé d'Adam Smith et dont le néo-libéralisme actuel est un avatar),
• 3) l'économie visant un certain mixte entre les 2 premiers modes, économie qui a été théorisée par Keynes au début du XXe siècle et adoptée par la plupart des gouvernements sociaux-démocrates (travaillistes britanniques, SPD allemande, SPÖ autrichienne, socialistes scandinaves). Par hétérodoxie, la science politique française entend toutes les théories économiques ne dérivant pas de principes purs, c'est-à-dire d'une rationalité désincarnée, mais, au contraire, dérivent d'histoires politiques particulières, réelles et concrètes. Les hétérodoxies, dans cette optique, sont les héritières de la fameuse "école historique" allemande du XIXe siècle, de l'institutionnalisme de Thorstein Veblen et des doctrines de Schumpeter. Les hétérodoxies ne croient pas aux modèles universels, contrairement aux 3 formes d'orthodoxie dominantes. Elles pensent qu'il y a autant d'économies, de systèmes économiques, qu'il y a d'histoires nationales ou locales. Avec Perroux, les hétérodoxes, au-delà de leurs diversités et divergences particulières, pensent que l'historicité des structures doit être respectée en tant que telle et que les problèmes économiques doivent être résolus en respectant la dynamique propre de ces structures.
Plus récemment, la notion de "Troisième Voie" est revenue à l'ordre du jour avec l'accession de Tony Blair au pouvoir en Grande-Bretagne, après une vingtaine d'années de néo-libéralisme thatchérien. En apparence, dans les principes, Blair se rapproche des troisièmes voies à l'allemande, mais, en réalité, tente de faire accepter les acquis du néo-libéralisme à la classe ouvrière britannique. Sa "troisième voie" est un placebo, un ensemble de mesures et d'expédients pour gommer les effets sociaux désagréables du néo-libéralisme, mais ne va pas au fond des choses : elle est simplement un glissement timide vers quelques positions keynésiennes, c'est-à-dire vers une autre orthodoxie, auparavant pratiquée par les travaillistes mais proposée à l'électorat avec un langage jadis plus ouvriériste et musclé. Blair aurait effectivement lancé une troisième voie s'il avait axé sa politique vers une défense plus en profondeur des secteurs non marchands de la société britanniques et vers des formes de protectionnisme (qu'un keynésianisme plus musclé avait favorisées jadis, un keynésianisme à tendances ordo-libérales voire ordo-socialistes ou ordo-travaillistes).
[Pour en savoir plus : G. Faye, "À la découverte de Thorstein Veblen", in Orientations n°6, 1985]
• Quel est le poids du marxisme, ou du bolchevisme, dans cet ensemble ?
Le marxisme de facture soviétique a fait faillite partout, son poids est désormais nul, même dans les pays qui ont connu l'économie planifiée. La seule nostalgie qui reste, et qui apparaît au grand jour dans chaque discussion avec des ressortissants de ces pays, c'est celle de l'excellence du système d'enseignement, capable de communiquer un corpus classique, et les écoles de danse et de musique, expressions locales du Bolchoï, que l'on retrouvait jusque dans les plus modestes villages. L'idéal serait de coupler un tel réseau d'enseignement, imperméable à l'esprit de 68, à un système hétérodoxe d'économie, laissant libre cours à une variété culturelle, sans le contrôle d'une idéologie rigide, empêchant l'éclosion de la nouveauté, tant sur le plan culturel que sur le plan économique.
• Synergon abandonne-t-elle dès lors le solidarisme organique ou non ?
Non. Car justement les hétérodoxies, plurielles parce que répondant aux impératifs de contextes autonomes, représentent ipso facto des réflexes organiques. Les théories et les pratiques hétérodoxes jaillissent d'un humus organique au contraire des orthodoxies élaborées en vase clos, en chambre, hors de tout contexte. Par sa défense des structures dynamiques générées par les peuples et leurs institutions propres, et par sa défense des secteurs non marchands et de la sécurité sociale, les hétérodoxies impliquent d'office la solidarité entre les membres d'une communauté politique. La troisième voie portée par les doctrines hétérodoxes est forcément une troisième voie organique et solidariste. Le problème que vous semblez vouloir soulever ici, c'est que bon nombre de groupes ou de groupuscules de droite ont utilisé à tort et à travers les termes d'"organique" et de "solidariste", voire de "communauté" sans jamais faire référence aux corpus complexes de la science économique hétérodoxe. Pour la critique marxiste, par ex., il était aisé de traiter les militants de ces mouvements de farceurs ou d'escrocs, maniant des mots creux sans significations réelle et concrète.
Participation et intéressement au temps de De Gaulle
L'exemple concret et actuel auquel la nouvelle droite aurait pu se référer était l'ensemble des tentatives de réforme dans la France de De Gaulle au cours des années 60, avec la "participation" ouvrière dans les entreprises et l'"intéressement" de ceux-ci aux bénéfices engrangés. Participation et intéressement sont les 2 piliers de la réforme gaullienne de l'économie libérale de marché. Cette réforme ne va pas dans le sens d'une planification rigide de type soviétique, bien qu'elle ait prévu un Bureau du Plan, mais dans le sens d'un ancrage de l'économie au sein d'une population donnée, en l'occurrence la nation française. Parallèlement, cette orientation de l'économie française vers la participation et l'intéressement se double d'une réforme du système de représentation, où l'assemblée nationale – i. e. le parlement français – devait être flanquée à terme d'un Sénat où auraient siégé non seulement les représentants élus des partis politiques mais aussi les représentants élus des associations professionnelles et les représentants des régions, élus directement par la population sans le truchement de partis. De Gaulle parlait en ce sens de “Sénat des professions et des régions”.
Pour la petite histoire, cette réforme de De Gaulle n'a guère été prise en compte par les droites françaises et par la nouvelle droite qui en est partiellement issue, car ces droites s'étaient retrouvées dans le camp des partisans de l'Algérie française et ont rejeté ensuite, de manière irrationnelle, toutes les émanations du pouvoir gaullien. C'est sans nul doute ce qui explique l'absence totale de réflexion sur ces projets sociaux gaulliens dans la littérature néo-droitiste.
[Pour en savoir plus : Ange SAMPIERU, "La participation : une idée neuve ?", in : Orientations n°12, 1990-91]
• Les visions économiques des révolutionnaires conservateurs me semblent assez imprécises et n'ont apparemment qu'un seul dénominateur commun, le rejet du libéralisme...
Les idées économiques en général, et les manuels d'introduction à l'histoire des doctrines économiques, laissent peu de place aux filons hétérodoxes. Ces manuels, que l'on impose aux étudiants dans leurs premières années et qui sont destinés à leur donner une sorte de fil d'Ariane pour s'y retrouver dans la succession des idées économiques, n'abordent quasiment plus les théories de l'école historique allemande et leurs nombreux avatars en Allemagne et ailleurs (en Belgique : Émile de Laveleye, à la fin du XIXe siècle, exposant et vulgarisateur génial des thèses de l'école historique allemande). À la notable exception des manuels d'Albertini et Silem, déjà cités. Une prise en compte des chapitres consacrés aux hétérodoxies vous apporterait la précision que vous réclamez dans votre question. De Sismondi à List, et de Rodbertus à Schumpeter, une autre vision de l'économie se dégage, qui met l'accent sur le contexte et accepte la variété infinie des modes de pratiquer l'économie politique. Ces doctrines ne rejettent pas tant le libéralisme, puisque certains de ces exposants se qualifient eux-mêmes de "libéraux", que le refus de prendre acte des différences contextuelles et circonstancielles où l'économie politique est appelée à se concrétiser.
Le "libéralisme" pur, rejeté par les révolutionnaires conservateurs, est un universalisme. Il croit qu'il peut s'appliquer partout dans le monde sans tenir compte des facteurs variables du climat, de la population, de l'histoire de cette population, des types de culture qui y sont traditionnellement pratiqués, etc. Cette illusion universaliste est partagée par les 2 autres piliers (marxiste-soviétique et keynésien-social-démocrate) de l'orthodoxie économique. Les illusions universalistes de l'orthodoxie ont not. conduit à la négligence des cultures vivrières dans le tiers monde, à la multiplication des monocultures (qui épuisent les sols et ne couvrent pas l'ensemble des besoins alimentaires et vitaux d'une population) et, ipso facto, aux famines, dont celles du Sahel et de l'Éthiopie restent ancrées dans les mémoires.
Dans le corpus de la ND, l'intérêt pour le contexte en économie s'est traduit par une série d'études sur les travaux du MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales), dont les figures de proue, étiquetées de "gauche", ont exploré un éventail de problématiques intéressantes, approfondit la notion de "don" (c'est-à-dire des formes d'économie traditionnelle non basée sur l'axiomatique de l'intérêt et du profit). Les moteurs de cet institut sont not. Serge Latouche et Alain Caillé. Dans le cadre de la ND, ce sera surtout Charles Champetier qui s'occupera de ces thématiques. Avec un incontestable brio. Cependant, à rebours de ces félicitations qu'on doit lui accorder pour son travail d'exploration, il faut dire qu'une transposition pure et simple du corpus du MAUSS dans celui de la ND était impossible dans la mesure, justement, où la ND n'avait rien préparé de bien précis sur les approches contextualistes en économie, tant celles des doctrines classées à droite que celles classées à gauche. Notamment aucune étude documentaire, visant à réinjecter dans le débat les démarches historiques (donc contextualistes), n'a été faite sur les écoles historiques allemandes et leurs avatars, véritable volet économique d'une Révolution conservatrice, qui ne se limite pas, évidemment, à l'espace-temps qui va de 1918 à 1932 (auquel Armin Mohler, pour ne pas sombrer dans une exhaustivité non maîtrisable, avait dû se limiter).
Les racines de la Révolution conservatrice remontent au romantisme allemand, dans la mesure où il fut une réaction contre le "géométrisme" universaliste des Lumières et de la Révolution française : elle englobe par ailleurs tous les travaux des philologues du XIXe siècle qui ont approfondi nos connaissances sur l'antiquité et les mondes dits "barbares" (soit la périphérie persane, germanique, dace et maure de l'empire romain chez un Franz Altheim), l'école historique en économie et les sociologies qui y sont apparentées, la révolution esthétique amorcée par les pré-raphaëlites anglais, par John Ruskin, par le mouvement Arts & Crafts en Angleterre, par les travaux de Pernerstorfer en Autriche, par l'architecture de Horta et les mobiliers de Van de Velde en Belgique, etc. L'erreur des journalistes parisiens qui ont parlé à tort et à travers de la "Révolution conservatrice", sans avoir de culture germanique véritable, sans partager véritablement les ressorts de l'âme nord-européenne (ni d'ailleurs ceux de l'âme ibérique ou italienne), est d'avoir réduit cette révolution aux expressions qu'elle a prises uniquement en Allemagne dans les années tragiques, dures et éprouvantes d'après 1918. En ce sens la ND a manqué de profondeur culturelle et temporelle, n'a pas eu l'épaisseur suffisante pour s'imposer magistralement à l'inculture dominante.
[Pour en savoir plus : Charles CHAMPETIER, "Alain Caillé et le MAUSS : critique de la raison utilitaire", in : Vouloir, n°65/67, 1990]
Pour revenir plus directement aux questions économiques, disons qu'une révolution conservatrice, est révolutionnaire dans la mesure où elle vise à abattre les modèles universalistes calqués sur le géométrisme révolutionnaire (selon l'expression de Gusdorf), et conservatrice dans la mesure où elle vise un retour aux contextes, à l'histoire qui les a fait émerger et les a dynamisés. De même dans le domaine de l'urbanisme, toute révolution conservatrice vise à gommer les laideurs de l'industrialisme (projet des pré-raphaëlites anglais et de leurs élèves autrichiens autour de Pernerstorfer) ou du modernisme géométrique, pour renouer avec des traditions du passé (Arts & Crafts) ou pour faire éclore de nouvelles formes inédites (MacIntosh, Horta, Van de Velde).
Le contexte, où se déploie une économie, n'est pas un contexte exclusivement déterminé par l'économie, mais par une quantité d'autres facteurs. D'où la critique néo-droitiste de l'économisme, ou du "tout-économique". Cette critique n'a malheureusement pas souligné la parenté philosophique des démarches non économiques (artistiques, culturelles, littéraires) avec la démarche économique de l'école historique.
• Est-il exact de dire que Synergon, contrairement au GRECE, accorde moins d'attention au travail purement culturel et davantage aux événements politiques concrets ?
Nous n'accordons pas moins d'attention au travail culturel. Nous en accordons tout autant. Mais nous accordons effectivement, comme vous l'avez remarqué, une attention plus soutenue aux événements du monde. Deux semaines avant de mourir, le leader spirituel des indépendantistes bretons, Olier Mordrel, qui suivait nos travaux, m'a téléphoné, sachant que sa mort était proche, pour faire le point, pour entendre une dernière fois la voix de ceux dont il se sentait proche intellectuellement, mais sans souffler le moindre mot sur son état de santé, car, pour lui, il n'était pas de mise de se plaindre ou de se faire plaindre. Il m'a dit : « Ce qui rend vos revues indispensables, c'est le recours constant au vécu ». J'ai été très flatté de cet hommage d'un aîné, qui était pourtant bien avare de louanges et de flatteries. Votre question indique que vous avez sans doute perçu, à 16 ans de distance et par les lectures relatives au thème de votre mémoire, le même état de choses qu'Olier Mordrel, à la veille de son trépas. Le jugement d'Olier Mordrel me paraît d'autant plus intéressant, rétrospectivement, qu'il est un témoin privilégié : revenu de son long exil argentin et espagnol, il apprend à connaître assez tôt la nouvelle droite, juste avant qu'elle ne soit placée sous les feux de rampe des médias. Il vit ensuite son apogée et le début de son déclin. Et il attribuait ce déclin à une incapacité d'appréhender le réel, le vivant et les dynamiques à l'oeuvre dans nos sociétés et dans l'histoire.
Le recours à Heidegger
Cette volonté de l'appréhender, ou, pour parler comme Heidegger, de l'arraisonner pour opérer le dévoilement de l'Être et sortir ainsi du nihilisme (de l'oubli de l'Être), implique toute à la fois de recenser inlassablement les faits de monde présents et passés (mais qui, potentiellement, en dépit de leur sommeil momentané, peuvent toujours revenir à l'avant-plan), mais aussi de les solliciter de mille et une manières nouvelles pour faire éclore de nouvelles constellations idéologiques et politiques, et de les mobiliser et de les instrumentaliser pour détruire et effacer les pesanteurs issues des géométrismes institutionnalisés. Notre démarche procède clairement d'une volonté de concrétiser les visions philosophiques de Heidegger, dont la langue, trop complexe, n'a pas encore généré d'idéologie et de praxis révolutionnaires (et conservatrices !).
[Pour en savoir plus : R. STEUCKERS, "La philosophie de l'argent et la philosophie de la Vie chez Georg Simmel (1858-1918)", in Vouloir n°11, 1999]
• Est-il exact d'affirmer que Synergies Européennes constituent l'avatar actuel du corpus doctrinal national-révolutionnaire (dont le national-bolchevisme est une forme) ?
Je perçois dans votre question une vision un peu trop mécanique de la trajectoire idéologique qui va de la Révolution conservatrice et de ses filons nationaux-révolutionnaires (du temps de Weimar) à l'actuelle démarche de Synergies Européennes. Vous semblez percevoir dans notre mouvance une transposition pure et simple du corpus national-révolutionnaire de Weimar dans notre époque. Une telle transposition serait un anachronisme, donc une sottise. Toutefois, dans ce corpus, les idées de Niekisch sont intéressantes à analyser, de même que son itinéraire personnel et ses mémoires. Cependant, le texte le plus intéressant de cette mouvance reste celui co-signé par les frères Jünger, Ernst et surtout Friedrich-Georg, et intitulé Aufstieg des Nationalismus.
Pour les frères Jünger, dans cet ouvrage et dans d'autres articles ou courriers importants de l'époque, le "nationalisme" est synonyme de "particularité" ou d'"originalité", particularité et originalité qui doivent rester telles, ne pas se laisser oblitérer par un schéma universaliste ou par une phraséologie creuse que ses utilisateurs prétendent progressiste ou supérieure, valable en tout temps et en tout lieu, discours destiné à remplacer toutes les langues et toutes les poésies, toutes les épopées et toutes les histoires. Poète, Friedrich-Georg Jünger, dans ce texte-manifeste des nationaux-révolutionnaires des années de Weimar, oppose les traits rectilignes, les géométries rigides, propres de la phraséologie libérale-positiviste, aux sinuosités, aux méandres, aux labyrinthes et aux tracés serpentants du donné naturel, organique. En ce sens, il préfigure la pensée d'un Gilles Deleuze, avec son rhizome s'insinuant partout dans le plan territorial, dans l'espace, qu'est la Terre. De même, l'hostilité du "nationalisme", tel que le concevaient les frères Jünger, aux formes mortes et pétrifiées de la société libérale et industrielle ne peut se comprendre que parallèlement aux critiques analogues de Heidegger et de Simmel.
Dans la plupart des cas, les cercles actuels, dits nationaux-révolutionnaires, souvent dirigés par de faux savants (très prétentieux), de grandes gueules insipides ou des frustrés qui cherchent une manière inhabituelle de se faire valoir, se sont effectivement borné à reproduire, comme des chromos, les phraséologies de l'ère de Weimar. C'est à la fois une insuffisance et une pitrerie. Ce discours doit être instrumentalisé, utilisé comme matériau, mais de concert avec des matériaux philosophiques ou sociologiques plus scientifiques, plus communément admis dans les institutions scientifiques, et confrontés évidemment avec la réalité mouvante, avec l'actualité en marche. Les petites cliques de faux savants et de frustrés atteints de führerite aigüe ont évidemment été incapables de parfaire un tel travail.
Au-delà de “Aufstieg des Nationalismus”
Ensuite, il me semble impossible, aujourd'hui, de renouer de manière acritique avec les idées contenues dans Aufstieg des Nationalismus et dans les multiples revues du temps de la République de Weimar (Die Kommenden, Widerstand d'Ernst Niekisch, Der Aufbruch, Die Standarte, Arminius, Der Vormarsch, Der Anmarsch, Die deutsche Freiheit, Der deutsche Sozialist, Entscheidung de Niekisch, Der Firn, également de Niekisch, Junge Politik, Politische Post, Das Reich de Friedrich Hielscher, Die sozialistische Nation de Karl Otto Paetel, Der Vorkämpfer, Der Wehrwolf, etc.). Quand je dis "a-critique", je ne veux pas dire qu'il faut soumettre ce corpus doctrinal à une critique dissolvante, qu'il faut le rejeter irrationnellement comme immoral ou anachronique, comme le font ceux qui tentent de virer leur cuti ou de se dédouaner. Je veux dire qu'il faut le relire attentivement mais en tenant bien compte des diverses évolutions ultérieures de leurs auteurs et des dynamiques qu'ils ont suscitées dans d'autres champs que celui, réduit, du nationalisme révolutionnaire.
Exemple : Friedrich Georg Jünger édite en 1949 la version finale de son ouvrage Die Perfektion der Technik, qui jette les fondements de toute la pensée écologique allemande de notre après-guerre, du moins dans ses aspects non politiciens qui, en tant que tels, et par là-même, sont galvaudés et stupidement caricaturaux. Plus tard, il lance une revue de réflexion écologique, Scheidewege, qui continue à paraître après sa mort, survenue en 1977. Il faut donc relire Aufstieg des Nationalismus à la lumière de ces publications ultérieures et coupler le message national-révolutionnaire et soldatique des années 20, où pointaient déjà des intuitions écologiques, aux corpus biologisants, écologiques, organiques commentés en long et en large dans les colonnes de Scheidewege.
En 1958, Ernst Jünger fonde avec Mircea Eliade et avec le concours de Julius Evola et du traditionaliste allemand Leopold Ziegler la revue Antaios, dont l'objectif est d'immerger ses lecteurs dans les grandes traditions religieuses du monde. Ensuite, Martin Meyer a étudié l'œuvre d'E. Jünger dans tous ses aspects et montré clairement les liens qui unissent cette pensée, qui couvre un siècle tout entier, à quantité d'autres mondes intellectuels, tels le surréalisme, toujours oublié par les nationaux-révolutionnaires de Nantes ou d'ailleurs et par les néo-droitistes parisiens qui se prennent pour des oracles infaillibles, mais qui ne savent finalement pas grand chose, quand on prend la peine de gratter un peu... Par coquetterie parisienne, on tente de se donner un look allemand, un look "casque à boulons", qui sied à tous ces zigomars comme un chapeau melon londonien à un Orang-Outan... Meyer rappelle ainsi l'œuvre picturale de Kubin, le rapport étroit entre Jünger et Walter Benjamin, la distance esthétique et la désinvolture qui lient Jünger aux dandies, aux esthètes et à bon nombre de romantiques, l'influence de Léon Bloy sur cet écrivain allemand mort à 102 ans, l'apport de Carl Schmitt dans ses démarches, le dialogue capital avec Heidegger amorcé dans le deuxième après-guerre, l'impact de la philosophie de la nature de Gustav Theodor Fechner, etc.
En France, les nationaux-révolutionnaires et les néo-droitistes anachroniques et caricaturaux devraient tout de même se rappeler la proximité de Drieu La Rochelle avec les surréalistes de Breton, not. quand Drieu participait au fameux "Procès Barrès" mis en scène à Paris pendant la Première Guerre mondiale. La transposition acritique du discours national-révolutionnaire allemand des années 20 dans la réalité d'aujourd'hui est un expédiant maladroit, souvent ridicule, qui ignore délibérément l'ampleur incalculable de la trajectoire post-nationale-révolutionnaire des frères Jünger, des mondes qu'ils ont abordés, travaillés, intériorisés. La même remarque vaut not. pour la mauvaise réception de Julius Evola, sollicité de manière tout aussi maladroite et caricaturale par ces nervis pseudo-activistes, ces sectataires du satano-sodomisme saturnaliste basé à l'embouchure de la Loire ou ces métapolitologues pataphysiques et porno-vidéomanes, qui ne débouchent généralement que dans le solipsisme, la pantalonnade ou la parodie.
[Pour en savoir plus, de R. Steuckers : 1) "L'itinéraire philosophique et poétique de Friedrich-Georg Jünger", in : Vouloir, n°45/46, 1988 ; 2) "Friedrich-Georg Jünger", Synergies, Forest, 1996].
• Pourquoi Synergies accorde-t-elle tant d'attention à la Russie, outre le fait que ce pays fasse partie de l'ensemble eurasien ?
L'attention que nous portons à la Russie procède d'une analyse géopolitique de l'histoire européenne. La première intuition qui a mobilisé nos efforts depuis près d'un quart de siècle, c'est que l'Europe, dans laquelle nous étions nés, celle de la division sanctionnée par les conférences de Téhéran, Yalta et Postdam, était invivable, condamnait nos peuples à sortir de l'histoire, à vivre une stagnation historique, économique et politique, ce qui, à terme, signifie la mort. Bloquer l'Europe à hauteur de la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, couper l'Elbe à hauteur de Wittenberge et priver Hambourg de son hinterland brandebourgeois, saxon et bohémien, sont autant de stratégies d'étranglement.
Le Rideau de Fer coupait l'Europe industrielle de territoires complémentaires et de cette Russie, qui, à la fin du XIXe siècle, devenait le fournisseur de matières premières de l'Europe, la prolongation vers le Pacifique de son territoire, le glacis indispensable verrouillant le territoire de l'Europe contre les assauts des peuples de la steppe qu'elle avait subis jusqu'au XVIe siècle. La propagande anglaise décrivait le Tsar comme un monstre en 1905 lors de la guerre russo-japonaise, favorisait les menées séditieuses en Russie, afin de freiner cette synergie euro-russe d'avant le communisme. Le communisme, financé par des banquiers new-yorkais, tout comme la flotte japonaise en 1905, a servi à créer le chaos en Russie et à empêcher des relations économiques optimales entre l'Europe et l'espace russo-sibérien.
Exactement comme la Révolution française, appuyé par Londres (cf. Olivier Blanc, Les hommes de Londres, Albin Michel), a ruiné la France, a annihilé tous ses efforts pour se constituer une flotte atlantique et se tourner vers le large plutôt que vers nos propres territoires, a fait des masses de conscrits français (et nord-africains) une chaire à canon pour la City, pendant la guerre de Crimée, en 1914-1918 et en 1940-45. Une France tournée vers le large, comme le voulait d'ailleurs Louis XVI, aurait engrangé d'immenses bénéfices, aurait assuré une présence solide dans le Nouveau Monde et en Afrique dès le XVIIIe siècle, n'aurait probablement pas perdu ses comptoirs indiens. Une France tournée vers la ligne bleue des Vosges a provoqué sa propre implosion démographique, s'est suicidée biologiquement.
Le ver était dans le fruit : après la perte du Canada en 1763, une maîtresse hissée au rang de marquise a dit : "Bah ! Que nous importent ces quelques arpents de neige" et "après nous, le déluge". Grande clairvoyance politique ! Qu'on peut comparer à celle d'un métapolitologue du XIe arrondissement, qui prend de haut les quelques réflexions de Guillaume Faye sur l'“Eurosibérie” ! En même temps, cette monarchie française sur le déclin s'accrochait à notre Lorraine impériale, l'arrachait à sa famille impériale naturelle, scandale auquel le gouverneur des Pays-Bas autrichiens, Charles de Lorraine n'a pas eu le temps de remédier ; Grand Maître de l'Ordre Teutonique, il voulait financer sa reconquête en payant de sa propre cassette une armée bien entraînée et bien équipée de 70.000 hommes, triés sur le volet. Sa mort a mis un terme à ce projet. Cela a empêché les armées européennes de disposer du glacis lorrain pour venir mettre un terme, quelques années plus tard, à la comédie révolutionnaire qui ensanglantait Paris et allait commettre le génocide vendéen. Pour le grand bénéfice des services de Pitt !
Dans l'état actuel de nos recherches, nous constatons d'abord que le projet de reforger une alliance euro-russe indéfectible n'est pas une anomalie, une lubie ou une idée originale. C'est tout le contraire ! C'est le souci impérial récurrent depuis Charlemagne et Othon I ! Quarante ans de Guerre Froide, de division Est-Ouest et d'abrutissement médiatique téléguidé depuis les États-Unis ont fait oublier à 2 ou 3 générations d'Européens les ressorts de leur histoire.
Le limes romain sur le Danube
Ensuite, nos lectures nous ont amenés à constater que l'Europe, dès l'époque carolingienne, s'est voulue l'héritière de l'Empire romain et a aspiré à restituer celui-ci tout le long de l'ancien limes danubien. Rome avait contrôlé le Danube de sa source à son embouchure dans la Mer Noire, en déployant une flotte fluviale importante, rigoureusement organisée, en construisant des ouvrages d'art, dont des ponts de dimensions colossales pour l'époque (avec piliers de 45 m de hauteur dans le lit du fleuve), en améliorant la technique des ponts de bateaux pour les traversées offensives de ses légions, en concentrant dans la trouée de Pannonie plusieurs légions fort aguerries et disposant d'un matériel de pointe, de même que dans la province de Scythie, correspondant à la Dobroudja au sud du delta du Danube. L'objectif était de contenir les invasions venues des steppes surtout au niveau des 2 points de passage sans relief important que sont justement la plaine hongroise (la "puszta") et cette Dobroudja, à la charnière de la Roumanie et de la Bulgarie actuelles.
Un empire ne pouvait éclore en Europe, dans l'antiquité et au haut Moyen Âge, si ces points de passage n'étaient pas verrouillés pour les peuples non européens de la steppe. Ensuite, dans le cadre de la Sainte-Alliance du Prince Eugène (cf. infra), il fallait les dégager de l'emprise turque ottomane, irruption étrangère à l'européité, venue du Sud-Est. Après les études de l'Américain Edward Luttwak sur la stratégie militaire de l'Empire romain, on constate que celui-ci n'était pas seulement un empire circum-méditerranéen, centré autour de la Mare Nostrum, mais aussi un empire danubien, voire rhéno-danubien, avec un fleuve traversant toute l'Europe, où sillonnait non seulement une flotte militaire, mais aussi une flotte civile et marchande, permettant les échanges avec les tribus germaniques, daces ou slaves du Nord de l'Europe. L'arrivée des Huns dans la trouée de Pannonie bouleverse cet ordre du monde antique. L'étrangeté des Huns ne permet pas de les transformer en Foederati comme les peuples germaniques ou daces.
Les Carolingiens voudront restaurer la libre circulation sur le Danube en avançant leurs pions en direction de la Pannonie occupée par les Avars, puis par les Magyars. Charlemagne commence à faire creuser le canal Rhin-Danube que l'on nommera la Fossa Carolina. On pense qu'elle a été utilisée, pendant un très bref laps de temps, pour acheminer troupes et matériels vers le Noricum et la Pannonie. Charlemagne, en dépit de ses liens privilégiés avec la Papauté romaine, souhaitait ardemment la reconnaissance du Basileus byzantin et envisageait même de lui donner la main d'une de ses filles. Aix-la-Chapelle, capitale de l'Empire germanique, est construite comme un calque de Byzance, titulaire légitime de la dignité impériale. Le projet de mariage échoue, sans raison apparente autre que l'attachement personnel de Charlemagne à ses filles, qu'il désirait garder près de lui, en en faisant les maîtresses des grands abbés carolingiens, sans la moindre pudibonderie. Cet attachement paternel n'a donc pas permis de sceller une alliance dynastique entre l'Empire germanique d'Occident et l'Empire romain d'Orient. L'ère carolingienne s'est finalement soldée par un échec, à cause d'une constellation de puissances qui lui a été néfaste : les rois francs, puis les Carolingiens (et avant eux, les Pippinides), se feront les alliés, parfois inconditionnels, du Pape romain, ennemis du christianisme irlando-écossais, qui missionne l'Allemagne du Sud danubienne, et de Byzance, héritière légale de l'impérialité romaine.
La papauté va vouloir utiliser les énergies germaniques et franques contre Byzance, sans autre but que d'asseoir sa seule suprématie. Alors qu'il aurait fallu continuer l'oeuvre de pénétration pacifique des Irlando-Ecossais vers l'Est danubien, à partir de Bregenz et de Salzbourg, favoriser la transition pacifique du paganisme au christianisme irlandais au lieu d'accorder un blanc seing à des zélotes à la solde de Rome comme Boniface, parce que la variante irlando-écossaise du christianisme ne s'opposait pas à l'orthodoxie byzantine et qu'un modus vivendi aurait pu s'établir ainsi de l'Irlande au Caucase. Cette synthèse aurait permis une organisation optimale du continent européen, qui aurait rendu impossible le retour des peuples mongols et les invasions turques des Xe et XIe siècles. Ensuite, la reconquista de l'Espagne aurait été avancée de six siècles !
[Pour en savoir plus : R. STEUCKERS, "Mystères pontiques et panthéisme celtique à la source de la spiritualité européenne", in NdSE n°39, 1999].
Après Lechfeld en 955, l'organisation de la trouée pannonienne
Ces réflexions sur l'échec des Carolingiens, exemplifié par la bigoterie stérile et criminelle de son descendant Louis le Pieux, démontre qu'il n'y a pas de bloc civilisationnel européen cohérent sans une maîtrise et une organisation du territoire de l'embouchure du Rhin à la Mer Noire. D'ailleurs, fait absolument significatif, Othon I reçoit la dignité impériale après la bataille de Lechfeld en 955, qui permet de reprendre pied en Pannonie, après l'élimination des partisans du khan magyar Horka Bulcsu, et l'avènement des Arpads, qui promettent de verrouiller la trouée pannonienne comme l'avaient fait les légions romaines au temps de la gloire de l'Urbs. Grâce à l'armée germanique de l'Empereur Othon I et la fidélité des Hongrois à la promesse des Arpads, le Danube redevient soit germano-romain soit byzantin (à l'Est des "cataractes" de la Porte de Fer). Si la Pannonie n'est plus une voie de passage pour les nomades d'Asie qui peuvent disloquer toute organisation politique continentale en Europe, ipso facto, l'impérialité est géographiquement restaurée.
Othon I, époux d'Adelaïde, héritière du royaume lombard d'Italie, entend réorganiser l'Empire en assurant sa mainmise sur la péninsule italique et en négociant avec les Byzantins, en dépit des réticences papales. En 967, 12 ans après Lechfeld, 5 ans après son couronnement, Othon reçoit une ambassade du Basileus byzantin Nicéphore Phocas et propose une alliance conjointe contre les Sarrasins. Elle se réalisera tacitement avec le successeur de Nicéphore Phocas, plus souple et plus clairvoyant, Ioannes Tzimisces, qui autorise la Princesse byzantine Théophane à épouser le fils d'Othon I, le futur Othon II en 972. Othon II ne sera pas à la hauteur, essuyant une défaite terrible en Calabre en 983 face aux Sarrasins. Othon III, fils de Théophane, qui devient régente en attendant sa majorité, ne parviendra pas à consolider son double héritage, germanique et byzantin.
Le règne ultérieur d'un Konrad II sera exemplaire à ce titre. Cet empereur salien vit en bonne intelligence avec Byzance, dont les territoires à l'Est de l'Anatolie commencent à être dangereusement harcelés par les raids seldjoukides et les rezzou arabes. L'héritage othonien en Pannonie et en Italie ainsi que la paix avec Byzance permettent une véritable renaissance en Europe, confortée par un essor économique remarquable. Grâce à la victoire d'Othon I et à l'inclusion de la Pannonie des Arpad dans la dynamique impériale européenne, l'économie de notre continent entre dans une phase d'essor, la croissance démographique se poursuit (de l'an 1000 à 1150 la population augmente de 40%), le défrichage des forêts bat son plein, l'Europe s'affirme progressivement sur les rives septentrionales de la Méditerranée et les cités italiennes amorcent leur formidable processus d'épanouissement, les villes rhénanes deviennent des métropoles importantes (Cologne, Mayence, Worms avec sa superbe cathédrale romane).
Cet essor et le règne paisible mais fort de Konrad II démontrent que l'Europe ne peut connaître la prospérité économique et l'épanouissement culturel que si l'espace entre la Moravie et l'Adriatique est sécurisé. Dans tous les cas contraires, c'est le déclin et le marasme. Leçon historique cardinale qu'ont retenue les fossoyeurs de l'Europe : à Versailles en 1919, ils veulent morceler le cours du Danube en autant d'États antagonistes que possible ; en 1945, ils veulent établir une césure sur le Danube à hauteur de l'antique frontière entre le Noricum et la Pannonie ; entre 1989 et 2000, ils veulent installer une zone de troubles permanents dans le Sud-Est européen afin d'éviter la soudure Est-Ouest et inventent l'idée d'un fossé civilisationnel insurmontable entre un Occident protestant-catholique et un Orient orthodoxe-byzantin (cf. les thèses de Samuel Huntington).
Au Moyen Âge, c'est la Rome papale qui va torpiller cet essor en contestant le pouvoir temporel des Empereurs germaniques et en affaiblissant de la sorte l'édifice européen tout entier, privé d'un bras séculier puissant et bien articulé. Le souhait des empereurs était de coopérer dans l'harmonie et la réciprocité avec Byzance, pour restaurer l'unité stratégique de l'Empire romain avant la césure Occident/Orient. Mais Rome est l'ennemie de Byzance, avant même d'être l'ennemie des Musulmans. À l'alliance tacite, mais très mal articulée, entre l'Empereur germanique et le Basileus byzantin, la Papauté opposera l'alliance entre le Saint-Siège, le royaume normand de Sicile et les rois de France, alliance qui appuie aussi tous les mouvements séditieux et les intérêts sectoriels et bassement matériels en Europe, pourvu qu'ils sabotent les projets impériaux.
Le rêve italien des Empereurs germaniques
Le rêve italien des Empereurs, d'Othon III à Frédéric II de Hohenstaufen, vise à unir sous une même autorité suprême les 2 grandes voies de communication aquatiques en Europe : le Danube au centre des terres et la Méditerranée, à la charnière des 3 continents. À rebours des interprétations nationales-socialistes ou folcistes ("völkisch") de Kurt Breysig et d'Adolf Hitler lui-même, qui n'ont eu de cesse de critiquer l'orientation italienne des Empereurs germaniques du Haut Moyen Âge, force est de constater que l'espace entre Budapest (l'antique Aquincum des Romains) et Trieste sur l'Adriatique, avec, pour prolongement, la péninsule italienne et la Sicile, permettent, si ces territoires sont unis par une même volonté politique, de maîtriser le continent et de faire face à toutes les invasions extérieures : celles des nomades de la steppe et du désert arabique.
Les Papes contesteront aux Empereurs le droit de gérer pour le bien commun du continent les affaires italiennes et siciliennes, qu'ils considéraient comme des apanages personnels, soustraits à toute logique continentale, politique et stratégique : en agissant de la sorte, et avec le concours des Normands de Sicile, ils ont affaibli leur ennemie, Byzance, mais, en même temps, l'Europe toute entière, qui n'a pas pu reprendre pied en Afrique du Nord, ni libérer la péninsule ibérique plus tôt, ni défendre l'Anatolie contre les Seldjoukides, ni aider la Russie qui faisait face aux invasions mongoles. La situation exigeait la fédération de toutes les forces dans un projet commun.
Par les menées séditieuses des Papes, des rois de France, des émeutiers lombards, des féodaux sans scrupules, notre continent n'a pas pu être "membré" de la Baltique à l'Adriatique, du Danemark à la Sicile (comme l'avait également voulu un autre esprit clairvoyant du XIIIe siècle, le Roi de Bohème Ottokar II Premysl). L'Europe était dès lors incapable de parfaire de grands desseins en Méditerranée (d'où la lenteur de la reconquista, laissée aux seuls peuples hispaniques, et l'échec des croisades). Elle était fragilisée sur son flanc oriental et a failli, après les désastres de Liegnitz et de Mohi en 1241, être complètement conquise par les Mongols. Cette fragilité, qui aurait pu lui être fatale, est le résultat de l'affaiblissement de l'institution impériale à cause des manigances papales.
De la nécessaire alliance des deux impérialités européennes
En 1389, les Serbes s'effondrent devant les Turcs lors de la fameuse bataille du Champs des Merles, prélude dramatique à la chute définitive de Constantinople en 1453. L'Europe est alors acculée, le dos à l'Atlantique et à l'Arctique. La seule réaction sur le continent vient de Russie, pays qui hérite ainsi ipso facto de l'impérialité byzantine à partir du moment où celle-ci cesse d'exister. Moscou devient donc la "Troisième Rome" ; elle hérite de Byzance la titulature de l'impérialité orientale. Il y avait 2 empires en Europe, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient ; il y en a toujours 2 malgré la chute de Constantinople : le Saint-Empire romain germanique et l'Empire russe.
Ce dernier passe directement à l'offensive, grignote les terres conquises par les Mongols, détruit les royaumes tatars de la Volga, pousse vers la Caspienne. Par conséquent, tradition et géopolitique obligent : l'alliance voulue par les empereurs germaniques depuis Charlemagne entre Aix-la-Chapelle et Byzance, doit être poursuivie mais, dorénavant, par une alliance impériale germano-russe. L'Empereur d'Occident (germanique) et l'Empereur d'Orient (russe) doivent agir de concert pour repousser les ennemis de l'Europe (espace stratégique à 2 têtes comme l'est l'aigle bicéphale) et dégager nos terres de l'encerclement ottoman et musulman, avec l'appui des rois locaux : rois d'Espagne, de Hongrie, etc. Telle est la raison historique, métaphysique et géopolitique de toute alliance germano-russe.
Cette alliance fonctionnera, en dépit de la trahison française. La France était hostile à Byzance pour le compte des Papes anti-impériaux de Rome. Elle participera à la destruction des glacis de l'Empire à l'Ouest et s'alliera aux Turcs contre le reste de l'Europe. D'où les contradictions insolubles des "nationalistes" français : simultanément, ils se réclament de Charles Martel (un Austrasien de nos pays d'entre Meuse et Rhin, appelé au secours d'une Neustrie et d'une Aquitaine mal organisées, décadentes et en proie à toutes sortes de dissensions, qui n'avaient pas su faire face à l'invasion arabe) mais ces mêmes nationalistes français avalisent les crimes de trahison des rois, cardinaux et ministres félons : François I, Henri II, Richelieu, Louis XIV, Turenne, voire des séides de la Révolution, comme si, justement, Charles Martel l'Austrasien n'avait jamais existé !
L'Alliance austro-russe fonctionne avec la Sainte-Alliance mise sur pied par Eugène de Savoie à la fin du XVIIe siècle, qui repousse les Ottomans sur toutes les frontières, de la Bosnie au Caucase. L'intention géopolitique est de consolider la trouée pannonienne, de maître en service une flotte fluviale danubienne, d'organiser une défense en profondeur de la frontière par des unités de paysans-soldats croates, serbes, roumains, appuyés par des colons allemands et lorrains, de libérer les Balkans et, en Russie, de reprendre la Crimée et de contrôler les côtes septentrionales de la Mer Noire, afin d'élargir l'espace européen à son territoire pontique au complet.
Au XVIIIe siècle, Leibniz réitère cette nécessité d'inclure la Russie dans une grande alliance européenne contre la poussée ottomane. Plus tard, la Sainte-Alliance de 1815 et la Pentarchie du début du XIXe siècle prolongeront cette même logique. L'alliance des 3 empereurs de Bismarck et la politique de concertation avec Saint-Pétersbourg, qu'il n'a cessé de pratiquer, sont des applications modernes du voeu de Charlemagne (non réalisé) et d'Othon I, véritable fondateur de l'Europe. Dès que ces alliances n'ont plus fonctionné, l'Europe est entrée dans une nouvelle phase de déclin, au profit, notamment, des États-Unis.
Le Traité de Versailles de 1919 vise la neutralisation de l'Allemagne et son pendant, le Traité du Trianon, sanctionne le morcellement de la Hongrie, privée de son extension dans les Tatras (la Slovaquie) et de son union avec la Croatie créée par le roi Tomislav, union instaurée plus tard par la Pacta Conventa en 1102, sous la direction du roi hongrois Koloman Könyves ("Celui qui aimait les livres jusqu'à la folie"). Versailles détruit ce que les Romains avaient uni, restaure ce que les troubles des siècles sombres avaient imposé au continent, détruit l'oeuvre de la Couronne de Saint-Etienne qui avait harmonieusement restauré l'ordre romain tout en respectant la spécificité croate et dalmate.
Versailles a surtout été un crime contre l'Europe parce que cette nécessaire harmonie hungaro-croate en cette zone géographique clef a été détruite et a précipité à nouveau l'Europe dans une période de troubles inutiles, à laquelle un nouvel empereur devra nécessairement, un jour, mettre un terme. Wilson, Clemenceau et Poincaré, la France et les États-Unis, portent la responsabilité de ce crime devant l'histoire, de même que les tenants écervelés de cette éthique de la conviction (et, partant, de l'irresponsabilité) portée par le laïcisme de mouture franco-révolutionnaire. Derrière l'hostilité de façade à la religion catholique qu'elle professe, cette idéologie pernicieuse a agi exactement comme les papes simoniaques du Moyen Âge : elle a détruit les principes d'organisation optimaux de notre Europe, ses adeptes étant aveuglés par des principes fumeux et des intérêts sordides, sans profondeur historique et temporelle. Principes et intérêts totalement inaptes à fournir les assises d'une organisation politique, pour ne même pas parler d'un empire.
Face à ce désastre, Arthur Moeller van den Bruck, figure de proue de la Révolution conservatrice, lance l'idée d'une nouvelle alliance avec la Russie en dépit de l'installation au pouvoir du bolchevisme léniniste, car le principe de l'alliance des 2 Empires doit demeurer envers et contre la désacralisation, l'horizontalisation et la profanation de la politique. Le Comte von Brockdorff-Rantzau appliquera cette diplomatie, ce qui conduira à l'anti-Versailles germano-soviétique : les accords de Rapallo signés entre Rathenau et Tchitcherine en 1922. De là, nous revenons à la problématique du "national-bolchevisme" que j'ai évoquée par ailleurs dans cet entretien.
Dans les années 80, quand l'évolution des stratégies militaires, des armements et surtout des missiles balistiques inter-continentaux, amène au constat qu'aucune guerre nucléaire n'est possible en Europe sans la destruction totale des pays engagés, il apparaît nécessaire de sortir de l'impasse et de négocier pour réimpliquer la Russie dans le concert européen. Après la perestroïka, amorcée en 1985 par Gorbatchev, le dégel s'annonce, l'espoir reprend : il sera vite déçu. La succession des conflits inter-yougoslaves va à nouveau bloquer l'Europe entre la trouée pannonienne et l'Adriatique, tandis que les officines de propagande médiatique, CNN en tête, inventent mille et une raisons pour approfondir le fossé entre Européens et Russes.
Blocage des dynamiques européennes entre Bratislava et Trieste
Ces explications d'ordre historique doivent nous amener à comprendre que les soi-disant défenseurs d'un Occident sans la Russie (ou contre la Russie) sont en réalité les fossoyeurs papistes ou maçonniques de l'Europe et que leurs agissements condamnent notre continent à la stagnation, au déclin et à la mort, comme il avait stagné, décliné et dépéri entre les invasions hunniques et la restauratio imperii d'Othon I, à la suite de la bataille de Lechfeld en 955. Dès la réorganisation de la plaine hongroise et son inclusion dans l'orbe européenne, l'essor économique et démographique de l'Europe ne s'est pas fait attendre. C'est une renaissance analogue que l'on a voulu éviter après le dégel qui a suivi la perestroïka de Gorbatchev, car cette règle géopolitique garantissant la prospérité est toujours valable (par ex., l'économie autrichienne avait triplé son chiffre d'affaire en l'espace de quelques années après le démantèlement du Rideau de fer le long de la frontière austro-hongroise en 1989).
Nos adversaires connaissent bien les ressorts de l'histoire européenne. Mieux que notre propre personnel politique pusillanime et décadent. Ils savent que c'est toujours là, entre Bratislava et Trieste, qu'il faut nous frapper, nous bloquer, nous étrangler. Pour éviter une nouvelle union des 2 Empires et une nouvelle période de paix et de prospérité, qui ferait rayonner l'Europe de mille feux et condamnerait ses concurrents à des rôles de seconde zone, tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas la vaste éventail de nos potentialités, fruits de nos différences et de nos spécificités.
• Quelles sont les positions concrètes de Synergies Européennes sur des institutions comme le Parlement, la représentation populaire, etc. ?
La vision de Synergies Européennes est démocratique mais hostile à toutes les formes de partitocratie, car celle-ci, qui se prétend “démocratique”, est en fait un parfait déni de démocratie. Sur le plan théorique, Synergies Européennes se réclame d'un libéral russe du début du siècle, militant du Parti des Cadets : Moshe Ostrogovski. L'analyse que ce libéral russe d'avant la révolution bolchevique nous a laissée repose sur un constat évident : toute démocratie devrait être un système calqué sur la mouvance des choses dans la Cité. Les mécanismes électoraux visent logiquement à faire représenter les effervescences à l'œuvre dans la société, au jour le jour, sans pour autant bouleverser l'ordre immuable du politique. Par conséquent, les instruments de la représentation, c'est-à-dire les partis politiques, doivent, eux aussi, être transitoires, représenter les effervescences passagères et ne jamais viser à la pérennité. Les dysfonctionnements de la démocratie parlementaire découlent du fait que les partis deviennent des permanences rigides au sein des sociétés, cooptant en leur sein des individus de plus en plus médiocres.
Pour pallier à cet inconvénient, Ostrogovski suggère une démocratie reposant sur des partis ad hoc, réclamant ponctuellement des réformes urgentes ou des amendements précis, puis proclamant leur propre dissolution pour libérer leur personnel, qui peut alors forger de nouveaux mouvements pétitionnaires, ce qui permet de redistribuer les cartes et de répartir les militants dans de nouvelles formations, qui seront tout aussi provisoires. Les parlements accueilleraient ainsi des citoyens qui ne s'encroûteraient jamais dans le professionnalisme politicien. Les périodes de législature seraient plus courtes ou, comme au début de l'histoire de Belgique ou dans le Royaume-Uni des Pays-Bas de 1815 à 1830, le tiers de l'assemblée serait renouvelé à chaque tiers du temps de la législation, permettant une circulation plus accélérée du personnel politique et une élimination par la sanction des urnes de tous ceux qui s'avèrent incompétents ; cette circulation n'existe plus aujourd'hui, ce qui, au-delà du problème du vote censitaire, nous donne aujourd'hui une démocratie moins parfaite qu'à l'époque. Le problème est d'éviter des carrières politiciennes chez des individus qui finiraient par ne plus rien connaître de la vie civile réelle.
Weber & Minghetti : pour le maintien de la séparation des trois pouvoirs
Max Weber aussi avait fait des observations pertinentes : il constatait que les partis socialistes et démocrates-chrétiens (le Zentrum allemand) installaient des personnages sans compétence à des postes clef, qui prenaient des décisions en dépit du bon sens, étaient animés par des éthiques de la conviction et non plus de la responsabilité et exigeaient la répartition des postes politiques ou des postes de fonctionnaires au pro rata des voix sans qu'il ne leur soit réclamé des compétences réelles pour l'exercice de leur fonction. Le ministre libéral italien du XIXe siècle, Minghetti, a perçu très tôt que ce système mettrait vite un terme à la séparation des 3 pouvoirs, les partis et leurs militants, armés de leur éthique de la conviction, source de toutes les démagogies, voulant contrôler et manipuler la justice et faire sauter tous les cloisonnements entre législatif et exécutif. L'équilibre démocratique entre les 3 pouvoirs, posés au départ comme étanches pour garantir la liberté des citoyens, ainsi que l'envisageait Montesquieu, ne peut plus ni fonctionner ni exister, dans un tel contexte d'hystérie et de démagogie. Nous en sommes là aujourd'hui.
Synergies Européennes ne critique donc pas l'institution parlementaire en soi, mais marque nettement son hostilité à tout dysfonctionnement, à toute intervention privée (les partis sont des associations privées, dans les faits et comme le rappelle Ostrogovski) dans le recrutement de personnel politique, de fonctionnaire, etc., à tout népotisme (cooptation de membres de la famille d'un politicien ou d'un fonctionnaire à un poste politique ou administratif). Seuls les examens réussis devant un jury complètement neutre doivent permettre l'accession à une charge. Tout autre mode de recrutement devrait constituer un délit très grave.
Nous pensons également que les parlements ne devraient pas être uniquement des chambres de représentation où ne siègeraient que des élus issus de partis politiques (donc d'associations privées exigeant une discipline n'autorisant aucun droit de tendance ou aucune initiative personnelle du député). Tous les citoyens ne sont pas membres de partis et, de fait, la majorité d'entre eux ne possède pas de carte ou d'affiliation. Par conséquent, les partis ne représentent généralement que 8 à 10% de la population et 100% du parlement ! Le poids exagéré des partis doit être corrigé par une représentation issue des associations professionnelles et des syndicats, comme l'envisageait De Gaulle et son équipe quand ils parlaient de “sénat des professions et des régions”.
Pour le Professeur Bernard Willms (1931-1991), le modèle constitutionnel qu'il appelait de ses vœux repose sur une assemblée tricamérale (Parlement, Sénat, Chambre économique). Le Parlement se recruterait pour moitié parmi les candidats désignés par des partis et élus personnellement (pas de vote de liste) ; l'autre moitié étant constituée de représentants des conseils corporatifs et professionnels. Le Sénat serait essentiellement un organe de représentation régionale (comme le Bundesrat allemand ou autrichien). La Chambre économique, également organisée sur base des régions, représenterait les corps sociaux, parmi lesquels les syndicats.
Le problème est de consolider une démocratie appuyée sur les "corps concrets" de la société et non pas seulement sur des associations privées de nature idéologique et arbitraire comme les partis. Cette idée rejoint la définition donnée par Carl Schmitt des “corps concrets”. Par ailleurs, toute entité politique repose sur un patrimoine culturel, dont il doit être tenu compte, selon l'analyse faite par un disciple de C. Schmitt, Ernst Rudolf Huber. Pour Huber, l'État cohérent est toujours un Kulturstaat et l'appareil étatique a le devoir de maintenir cette culture, expression d'une Sittlichkeit, dépassant les simples limites de l'éthique pour englober un vaste de champs de productions artistiques, culturelles, structurelles, agricoles, industrielles, etc., dont il faut maintenir la fécondité. Une représentation plus diversifiée, et étendue au-delà des 8 à 10 % d'affiliés aux partis, permet justement de mieux garantir cette fécondité, répartie dans l'ensemble du corps social de la nation.
La défense des "corps concrets", postule la trilogie “communauté, solidarité, subsidiarité”, réponse conservatrice, dès le XVIIe siècle, au projet de Bodin, visant à détruire les “corps intermédiaires” de la société, donc les “corps concrets”, pour ne laisser que le citoyen-individu isolé face au Léviathan étatique. Les idées de Bodin ont été réalisées par la Révolution française et son fantasme de géométrisation de la société, qui a justement commencé par l'éradication des associations professionnelles par la Loi Le Chapelier de 1791. Aujourd'hui, le recours actualisé à la trilogie “communauté, solidarité, subsidiarité” postule de donner un maximum de représentativité aux associations professionnelles, aux masses non encartées, et de diminuer l'arbitraire des partis et des fonctionnaires. De même, le Professeur Erwin Scheuch (Cologne) propose aujourd'hui une série de mesures concrètes pour dégager la démocratie parlementaire de tous les dysfonctionnements et corruptions qui l'étouffent.
[Pour en savoir plus : 1) Ange SAMPIERU, "Démocratie et représentation", in Orientations n°10, 1988 ; • De R. Steuckers : 2) "Fondements de la démocratie organique", in Orientations n°10, 1988 ; 3) Bernard Willms (1931-1991) : Hobbes, la nation allemande, l'idéalisme, la critique politique des “Lumières”, Synergies, Forest, 1996 ; 4) "Du déclin des µours politiques", in NdSE n°25, 1997 (sur les thèses du Prof. Erwin Scheuch) ; 5) "Propositions pour un renouveau politique", in NdSE n°33, 1998 (en fin d'article, sur les thèses d'Ernst Rudolf Huber) ; 6) "Des effets pervers de la partitocratie", in NdSE n°41, 1999].
Propos recueillis par Pieter Van Damme, dans le cadre d'un mémoire de fin d'études
◘ Bibliographie :
- Jean-Pierre CUVILLIER, L'Allemagne médiévale, 2 t., Payot, t. 1, 1979, t. 2, 1984.
- Karin FEUERSTEIN-PRASSER, Europas Urahnen. Vom Untergang des Weströmischen Reiches bis zu Karl dem Grossen, F. Pustet, Regensburg, 1993.
- Karl Richard GANZER, Het Rijk als Europeesche Ordeningsmacht, Die Poorten, Antwerpen, 1942.
- Wilhelm von GIESEBRECHT, Deutsches Kaisertum im Mittelalter, Verlag Reimar Hobbing, Berlin, s.d.
- Eberhard HORST, Friedrich II. Der Staufer : Kaiser - Feldherr - Dichter, W. Heyne, München, 1975-77.
- Ricarda HUCH, Römischer Reich Deutscher Nation, Siebenstern, München/Hamburg, 1964.
- Edward LUTTWAK, La grande stratégie de l'Empire romain, Economica, 1987.
- Michael W. WEITHMANN, Die Donau : Ein europäischer Fluss und seine 3000-jährige Geschichte, F. Pustet/Styria, Regensburg, 2000.
- Philippe WOLFF, The Awakening of Europe, Penguin, Harmondsworth, 1968.

Présentation des options philosophiques et politiques de Synergies Européennes
Robert STEUCKERS, Lande de Lüneburg, 5 avril 1997
• Pourquoi le terme “synergie” ?
Pourquoi avons-nous choisi, pour désigner notre mouvement, d'adopter le terme de “synergie”, et non pas un autre terme, plus politique, plus ancré dans un champ idéologique clairement profilé ? Pourquoi employons-nous un vocable qui ne laisse deviner aucun ancrage politique précis ? En effet, la notion de “synergie” ne se laisse ancrer ni à droite ni à gauche. Au départ, “synergie” est un concept issu de la théologie, tout comme, d'ailleurs, tous les autres concepts politiques, même après la phase de neutralisation des effervescences religieuses qu'a connue la modernité à ses débuts, au XVIIe siècle. Pour Carl Schmitt, tous les concepts prégnants de la politique sont des concepts théologiques sécularisés. Dans le langage des théologiens, une “synergie” s'observe quand des forces différentes, des forces d'origines différentes, de nature différente, entrent en concurrence ou joignent leurs efforts pour atteindre en toute indépendance un objectif commun. Nos objectifs principaux, dûment inscrits dans notre charte, visent, d'une part, la liberté et la pluralité dans la vie quotidienne, d'autre part, la capacité de décider en cas de situation exceptionnelle. L'erreur des idéologies dominantes de ce siècle, c'est justement d'avoir pensé séparément la liberté de la décision.
• Ou bien l'on croyait, avec Kelsen notamment, que l'effervescence et les turbulences du monde cesseraient définitivement et qu'une ère de liberté éternelle s'ouvrirait sans que les hommes politiques n'aient plus jamais à prendre de décisions. Fukuyama a réactualisé ce vœu de “fin de l'histoire”, il y a 6 ou 7 ans.
• Ou bien on ne croyait qu'à la seule décision virile, comme les fascismes quiritaires, et on voulait maximiser à outrance la quantité de décisions suivies d'effets “constructifs”; de cette façon, on a contraint certains peuples à vivre dans une tension permanente, obligé les strates paisibles de la société à vivre comme les élites conquérantes ou les soldats sur la brèche, on a négligé l'organisation du quotidien, qui ne postulait nullement cette perpétuelle effervescence de la mobilisation permanente et totale. Les fascismes quiritaires, le national-socialisme n'ont généré ni un droit propre (si ce n'est une opposition systématique aux “paragraphes abstraits”) ni une constitution ni restauré un droit jurisprudentiel à la façon anglaise (au grand dam d'un juriste comme Koellreutter, qui a oscillé entre le droit anglais et le national-socialisme !). Aucun corpus doctrinal de ce siècle, d'après 1919, n'a su ou voulu penser conjointement et harmonieusement ces 2 impératifs, ces 2 nécessités :
1) se tenir prêt pour faire face aux imprévus qui s'abattent sans cesse sur le monde et sur l'histoire des hommes (ce que voulaient les décisionnistes) ;
2) organiser le quotidien dans la cohérence, sur le long terme (ce que voulaient les constitutionnalistes).
Une bonne part du débat politique de fond a tourné autour de l'opposition binaire entre “décisionnistes” (assimilés aux fascistes ou aux conservateurs) et “quotidiennistes” (qui survalorisaient l'Alltäglichkeit, le “règne du on”, les jugeant plus “moraux“ parce que leur marque principale était la quiétude). La nécessité d'organiser le quotidien dans la cohérence et sur le long terme n'exclut pas la nécessité impérieuse de la décision, de faire face à l'imprévu ou à la soudaineté.
Un projet politique d'avenir doit donc nécessairement reposer sur une capacité d'appréhension à la fois de la décision et du quotidien. Comment décision et quotidien ont-ils été appréhendés dans les idéologies dominantes de la gauche et de la droite ? Pourquoi les modes d'appréhension de ces droites et de ces gauches dominantes ont-ils été insuffisants ?
À droite : un fusionisme sans souci des valeurs
Dans le camp des droites, du conservatisme ou du national-conservatisme, il n'y a pas d'homogénéité dans l'appréhension de la liberté (entendue au sens d'absence de mobilisation politique permanente) ou de la décision. Quelques exemples : au temps de la guerre froide, terminée avec l'effondrement du Mur de Berlin en 1989, la liberté, disait-on, surtout aux États-Unis, s'opposait au communisme, quintessence de la non-liberté et idéologie fortement mobilisatrice. Hannah Arendt écrivait que le stalinisme, au début des années 50, était l'incarnation de l'“autoritarisme”, qui avait pris, jadis, tour à tour, un visage clérical, militariste, fasciste, etc. À la fin des années 50, pour faire pièce aux gauches étatistes, communistes, socialistes ou keynésiennes, le monde politique américain lance l'expérience du “fusionisme”, soit l'alliance des conservateurs anti-communistes et des libertaires anti-autoritaires, c'est-à-dire des partisans d'une société civile sans élites mobilisatrices et quiritaires, axée sur l'économie, le commerce et la technique, et les partisans d'une sorte de “leisure society”, propre des rentiers et des artistes situés en dehors de tout circuit économique fonctionnant.
Dans ce fusionisme, la question des valeurs reste sans solution. Parce que les valeurs habituellement attribuées au conservatisme, comme le sens du devoir, se marient mal avec les options des libertaires, on fait, par calcul politicien, l'impasse sur la valeur “devoir”, cardinale pour toute philosophie cohérente et stable de la Cité. On se rend forcément compte que la notion de devoir limite la liberté (du moins si on entend par liberté la licence ou la permissivité), ce que n'acceptent pas les alliés libertaires et anarchisants. Du fusionisme découle le conservatisme technocratique, qui se passe de toute référence à des valeurs mobilisantes et cimentantes et esquive de ce fait la question de la justice qui repose inévitablement sur une table de valeurs, située au-delà des intérêts matériels et économiques. Ainsi, les communautés ou les résidus de communauté perdent leur cohésion, en dépit des politiques conservatrices.
Fusionisme et conservatisme technocratique prennent le pas sur les conservateurs axiologiques (Wertkonservativen) ou les conservateurs décisionnistes, ruinant ainsi l'homogénéité de la droite et annonçant à plus ou moins long terme d'autres recompositions (même si elles se font encore attendre). Autres exemples : au niveau de la politique économique, axiologistes et décisionnistes chercheront généralement à inscrire des valeurs dans leur praxis économique. Ils s'opposeront dès lors forcément au néo-libéralisme ou à toute forme de globalisation inscrite sous le signe de cette idéologie strictement économique. Fusionistes et technocrates accorderont la priorité à l'efficacité et tolèreront les pratiques néo-libérales du profit à très court terme, considérant que la globalisation est inévitable et que la société qu'ils sont appelés à gérer n'aura pour seule originalité que d'être une niche particulière parmi d'autres niches particulières dans le processus général de globalisation, une niche qu'on nettoiera de ses particularités et où règneront, finalement, les mêmes principes que ceux de la globalisation.
Des idéologies qui donnent la priorité aux valeurs
En Europe, face à la problématique de l'unification européenne, si l'on donne la priorité aux valeurs, on sera :
- soit un nationaliste hostile à l'eurocratisme, dont le patriotisme nationalitaire sera fondé sur l'appartenance charnelle à une culture précise, héritée des générations précédentes et de l'histoire, cimentée par un jeu de valeurs de longue durée ;
- soit un européiste qui considère l'ensemble des peuples européens comme un écoumène civilisationnel de facture chrétienne ou non chrétienne,
- soit un ordo-socialiste ou un socialiste acceptant les règles de l'ordo-libéralisme allemand (le modèle du “capitalisme rhénan” selon Michel Albert).
Le souci des valeurs postule donc implicitement l'alliance prochaine :
- 1) des nationalistes qui auront la force de transcender les limites des États-Nations modernes conventionnels,
- 2) des européistes qui voient d'abord dans l'Europe à la fois un espace stratégique indissociable et un espace de civilisation et de valeurs spécifiques et, enfin,
- 3) des socialistes enracinés dans la culture industrielle de type “rhénan”, qui donne la priorité à l'investissement industriel par rapport au capital spéculatif, où les impératifs industriels locaux et les structures patrimoniales sont pris en compte concrètement, où les investissements dans l'appareil éducatif ne sont jamais rognés, et où l'on ne bascule pas dans les mirages délocalisés d'une culture économique axée principalement sur la spéculation boursière. La fusion de ces corpus politiques est l'impératif des premières décennies du XXIe siècle. À la fusion technocratisme conservateur/libertarianisme, née dans les années 50 aux États-Unis puis importée en Europe, il faut opposer la fusion de ces 3 forces politiques, au-delà de tous les faux clivages, désormais obsolètes.
Nationalistes patriotes, ordo-socialistes et européistes “axiologues” refusent pourtant l'eurocratisme actuel, car celui-ci ne tient nullement compte des valeurs et repose sur ce “relativisme des valeurs” et cet oubli des leçons de l'histoire qui provoquent la déliquescence des sociétés. Si l'européisme peut être un retour à des valeurs fondatrices, renforçant les ressorts de la Cité, l'eurocratisme ne peut que perpétuer le relativisme absolu et la déliquescence sociale.
Si l'on accorde la priorité à l'efficacité économique, on peut être en faveur de l'unification européenne, selon les critères critiquables d'aujourd'hui, mais on ne devra pas oublier que le chômage alarmant est un frein à l'efficacité économique et qu'il découle directement de l'application des principes néo-libéraux, issus du relativisme des valeurs et du refus des héritages historiques. En revanche, une volonté d'efficacité économique pourra s'avérer hostile à l'unification européenne dans les conditions actuelles, car le gigantisme eurocratique réduit l'efficacité là où elle est réellement présente et où elle constitue un barrage contre le chômage pandémique : dans certains tissus agricoles locaux (ce que n'a pas manqué de souligner la FPÖ autrichienne) ou dans certaines entreprises industrielles locales, bien ancrées dans le marché européen mais qui seraient incapables de faire face à une concurrence extra-européenne qui se nicherait dans notre continent, au nom d'un libre-échangisme planétaire ouvrant toutes les portes aux marchandises japonaises ou coréennes, dont le coût est plus bas car il n'inclut ni la sécurité sociale du personnel ni les taxes écologiques visant la protection du patrimoine “environnement” ni un certain réinvestissement dans les réseaux éducatifs.
Sur le plan géopolitique, opter pour le primat des valeurs implique de raisonner en termes de civilisation, de percevoir le monde comme un réseau d'espaces civilisationnels juxtaposés, différents mais pas nécessairement antagonistes. Ces espaces sont animés par une logique intérieure, c'est-à-dire par un système de valeur cohérent et accepté, impliquant pour les hommes harmonie et consensus. Le primat des valeurs implique aussi ipso facto que l'on respecte les valeurs qui animent les espaces voisins du nôtre. Cependant, opter comme les droites néo-libérales (voire les droites “hayekiennes”) pour un primat de l'efficacité, sans tenir compte des valeurs structurantes, ou ne considérer celles-ci que comme des reliquats en voie de disparition graduelle, c'est opter automatiquement pour le système des pseudo-valeurs occidentales modernes et relativistes. Une telle option implique le refus de toutes les valeurs structurantes des civilisations, quelles qu'elles soient, et impose le “relativisme des valeurs”, c'est-à-dire leur négation pure et simple (Benjamin Barber : McWorld contre Djihad !), et, partant, le refus de la valeur “justice” (Rawls).
La gauche tiraillée entre justice et relativisme
Dans le camp de la “gauche” (du moins pour les adeptes des systèmes de classification binaires qui se déclarent tels), il n'y a pas davantage d'homogénéité que dans le camp des droites (pour les binaires d'un autre genre...). Dans cette nébuleuse de gauche, aux contours flous, on est en faveur de l'unification européenne quand on imagine qu'elle est une étape vers l'“Internationale”, désormais mise en équation avec la parousie globaliste. Ou bien on est hostile à cette Europe de Bruxelles et de Strasbourg, parce qu'elle est une Europe capitaliste. Sur le plan géopolitique, face à l'émergence de “blocs civilisationnels”, une gauche sympathique mais en voie de disparition, approuve la consolidation des valeurs dans les aires civilisationnelles voisines des nôtres (islam, animisme africain, bouddhisme, indigénisme hispano-amérindien, etc.), tandis qu'une nouvelle gauche agressive et messianique fait sienne une vulgate militante basée sur les “droits de l'homme”, subtilement raciste car seule cette idéologie, née en Europe du Nord-Ouest, est jugée valable, le reste étant “tribalisme”, injure équivalant désormais de “para-nazisme”.
En conclusion, face à une droite tiraillée entre le sens des valeurs et le néo-libéralisme et face à une gauche tiraillée entre le sens de la justice et l'agressivité occidentaliste et relativiste, force est de constater que les vocables politisés de “gauche” et de “droite” ne recouvrent plus rien de précis, qu'ils ne parviennent plus à séparer réellement des options politiques antagonistes. La droite ou la gauche idéales, pour les uns comme pour les autres, n'existent pas : elles sont des “sites introuvables”, comme l'affirmait Marco Tarchi (in : « Destra e sinistra : due essenze introvabile », Democrazia e diritto, 1/1994, Ed. Scientifiche Italiane).
Sur le plan historique, effectivement, nous découvrons une flopée de figures et de théoriciens importants qui oscillent entre cette droite et cette gauche ou que l'on a fourré dans la boîte de gauche quand ils étaient vivants, pour les fourrer ensuite dans la boîte de droite, quand la mode a changé ou le vent a tourné. Ainsi, Georges Sorel, théoricien socialiste français du début du siècle, appartenait de son vivant à l'ultra-gauche syndicaliste et révolutionnaire. Mais ce syndicaliste-révolutionnaire inspire Mussolini, également classé dans la gauche socialiste et belliciste italienne. Mais, voilà, Mussolini, étatiste et volontariste, est contesté par la gauche parlementariste et déterministe : on le sort de sa boîte de gauche pour l'enfouir dans une boîte de droite, avec son Sorel, son fascisme et ses flonflons. Après 1919, les “révolutionnaires-conservateurs” allemands, Ernst Jünger et Carl Schmitt admirent chez Sorel son sens de la décision et sa théorie de la grève générale insurrectionnelle. Sorel reste donc, malgré son ouvriérisme foncier, dans la boîte de droite : il devient même une figure de la droite radicale en Italie, en France et en Allemagne, après 1945. En France, l'un de ses disciples, Hubert Lagardelle, devient même ministre de Vichy pendant la seconde guerre mondiale.
Il n'existe donc pas d'idées de droite qui n'aient pas été jadis à gauche. Le nationalisme est dans ce cas. Mais il n'existe pas davantage d'idées de gauche qui n'aient pas été ancrées un jour à droite. Cet état de choses doit nous conduire à formuler le jugement suivant : la gauche et la droite sont des concepts dépassés, dans la mesure où elles ne sont pertinentes que dans le cadre d'un régime précis mais uniquement tant que ce régime est accepté par les grandes masses et fonctionne efficacement, tant qu'il peut affronter les vicissitudes du monde en perpétuelle effervescence.
Représentations figées et guerre des looks
Mais tout régime s'use. L'usure de l'histoire est le lot de toutes les constructions politiques. Quand cette usure a fait son œuvre, les gauches et les droites institutionnelles voire leurs dérives plus radicales se figent, deviennent des phénomènes raidis dans un monde qui ne cesse de se mouvoir. À partir du moment où les gauches et les droites institutionnelles ne peuvent plus résoudre les problèmes de société comme le chômage et l'emploi, l'augmentation démesurée des dettes publiques, l'incompétence de la magistrature, la crise de l'enseignement, l'effondrement du consensus, elles ne sont plus que des “représentations” (pour reprendre le vocabulaire de Gilles Deleuze). Des sortes d'images platoniciennes figées que l'on agite comme s'il s'agissait de vérités révélées et immuables ou, plus prosaïquement, que l'on agite avec véhémence comme des pancartes revendicatrices lors de manifestations.
Toute l'histoire des “grands récits” (Lyotard) de l'idéologie occidentale du XVIIIe au XXe siècles consiste en une succession de “représentations” : aux représentations conservatrices-cléricales puis bourgeoises, on a opposé la représentation ouvrière-socialiste ou la représentation fasciste ou nationale-socialiste ou verte-écolo. Quand une représentation ne convenait plus à une catégorie de la population, on en fabriquait une nouvelle et on l'opposait aux plus anciennes. Toute la vie politique a consisté ainsi en une guerre des représentations, une guerre des looks. Jusqu'au paroxysme des représentations totalitaires... et surtout jusqu'à la satiété des citoyens.
Cette guerre des looks ne résout rien : on s'en est aperçu et ce fut la fin des “grands récits” (théorisée par Lyotard). Ce type de conflit est insuffisant. Avec Deleuze et ses continuateurs, on s'aperçoit désormais que l'on ne peut pas sans cesse produire et reproduire des représentations, en n'y apportant que de légères retouches. Le monde n'est pas fractionné en camps fermés sur eux-mêmes et détenteurs théoriques de vérités définitives. Le monde, l'histoire, les arènes politiques, les héritages juridiques, les jurisprudences, etc. sont bien plutôt autant de réseaux denses et inextricables, de croissances vitales, d'effervescences organiques ordonnées ou désordonnées mais néanmoins bien présentes et bien réelles, concrètes.
Dans ces réseaux, l'homme actif (politiquement, socialement ou existentiellement) doit se tailler, se frayer un chemin à la machette, sich eine Schneise durchhaken, disait Armin Mohler quand il tentait d'expliciter son existentialisme ou son réalisme héroïque (en l'appelant maladroitement “nominalisme”, vocable qu'a rapidement repris Alain de Benoist, son admirateur naïf, collectionneur–ânonneur de vocables non usuels, toujours vainement en quête d'une notoriété qu'il n'a jamais obtenue). La démarche vitale ne consiste donc plus à imposer au dense grouillement du réel des “représentations” figées et naïves, mais de repérer des forces et des opportunités, des passages et des trouées, pour cheminer le plus sûrement, le plus sereinement possible, en dépit des défis fusant de toutes parts.
Complexité, pluralité et démarche archéologique
Cette vision deleuzienne du réel, implique, sur le plan politique concret, de ne plus chercher à répandre des programmes rigides, à se balader dans la société avec sa pancarte ou son affiche sur le ventre, mais à retourner résolument à l'épais sous-bois de l'histoire, où les traits trop simples d'un look idéologico-politique ne valent que ce qu'ils valent : une mauvaise caricature, une gesticulation maladroite. Prendre position politiquement, aujourd'hui, c'est donc plonger plus profondément dans les tréfonds de notre histoire, aller fouiller sous l'humus qui ne recouvre le sol que sur une faible profondeur. Prendre position politiquement aujourd'hui, c'est procéder à une démarche archéologique, c'est faire l'archéologie de notre site de vie.
Je vis dans une Cité politique précise qui s'est construite progressivement au fil du temps, qui a généré un appareil juridique/constitutionnel complexe, tenant compte des strates multiples qui composent cette société et récapitulant subtilement dans les méandres mêmes de ses textes et dans les arcanes de ses pratiques les oppositions, fusions et contradictions dont cette société est finalement le résultat mouvant et vivant. Cet entrelac compliqué est précisément le sous-bois auquel il faut retourner et sur lequel il ne faut pas plaquer d'idéologie toute faite. Toute véritable prise en compte de l'histoire du droit dans une Cité interdit les jugements binaires des gauches et des droites ainsi que les simplismes des faux savants qui manient l'idéologie (schématisante) comme d'autres la trique.
La pensée politique doit donc retourner à des œuvres fondamentales, injustement méconnues, comme celles d'Althusius, de Justus Möser, de Wilhelm Heinrich von Riehl et d'Otto von Gierke. Leurs travaux prennent en compte l'ensemble des sociétés, avec toutes leurs différences intérieures, toutes les symbioses qui s'y juxtaposent. Leur pensée juridique, sociale et politique ne peut nullement se résumer à un schématisme binaire, mais exprime toujours de denses complexités, tout en nous apprenant à les explorer sans les mutiler. Le drame de la civilisation occidentale, c'est justement de ne pas s'être mis à l'écoute de ses œuvres depuis 200 ou 300 ans. Pour ces auteurs, ce qui compte, c'est le fonctionnement harmonieux/symbiotique ou le développement graduel de la Cité, selon des rythmes éprouvés par le temps, et non pas sa correction forcée et son alignement contraignant sur les critères d'un programme abstrait. Le programme-représentation ne saurait en aucun cas, avec cette pensée politique organique, oblitérer le fonctionnement rythmé et traditionnel d'une société.
Tout retour à ces corpus organiques postule de raviver des modèles liés à un site géographique, de faire revivre, vivre et survivre des héritages et non pas d'imposer des “choses faites”, des choses relevant de la manie moderne de la “faisabilité” (que Joseph de Maistre nommait plus élégamment l'“esprit de fabrication”). Le sous-bois épais et touffu de Deleuze, véritable texture de son “plan d'immanence”, est un héritage, non pas une fabrication. Le sous-bois est un tout mais un tout composé de variétés et de nuances à l'infini : l'attitude qui est pertinente ici n'est pas celle qui est pertinente là. L'homme qui chemine dans ce sous-bois (qui ne mène nulle part, si ce n'est sur la terre même, où il se trouve toujours déjà) doit être capable d'adopter rapidement et tour à tour plusieurs attitudes, de s'adapter plastiquement aux circonstances diverses qu'il rencontre au gré des imprévus : cette vision du monde comme un immense entrelac immanent d'abord, cette nécessité bien perçue de l'adaptation permanente ensuite, sont les 2 principales garanties de la pluralité. Quand on pense simultanément entrelac et adaptation, on pense pluriel et on est vacciné contre les interprétations et les représentations unilatérales.
Symbiotique et subsidiarité
Autre avantage pratique : la vision deleuzienne et le recours au filon qui part d'Althusius pour aboutir à Gierke permettent, une fois qu'ils sont combinés, de donner un contenu concret à ce que l'on nomme la subsidiarité. Dans l'article 3b du Traité de Maastricht, les législateurs européens ont prévu le passage à la subsidiarité sur l'ensemble du territoire de l'Union. Mais la définition qu'ils donnent de cette subsidiarité reste imprécise. Et elle est interprétée de diverses façons. En effet, que signifie la subsidiarité pour différents acteurs politiques européens ?
• Pour Madame Thatcher et ses successeurs, la subsidiarité n'était qu'un prétexte pour défendre exclusivement les intérêts britanniques dans le concert de l'UE. Certains gaullistes lui ont emboîté le pas, de même que le groupe De Villiers/Goldsmith.
• D'autres espèrent, par antipolitisme, que la subsidiarité va conduire à une balkanisation de l'Europe, à un retour à la Kleinstaaterei incapacitante, car, à leurs yeux, toute capacité politique est un mal en soi.
• Pour d'autres encore, elle n'est qu'un artifice de gouvernement dans un futur État européen hyper-centralisé. La subsidiarité conduira à l'intérieur d'une telle Europe à une régionalisation à la française, où les parlements régionaux sont purement formels et n'ont pas de pouvoir de décision réel.
• Pour nous, un projet continental de subsidiarité est un projet de rapprochement des gouvernants et des gouvernés dans tout l'espace européen, visant à instaurer des rapports de citoyenneté féconds, à redonner à la société civile un espace public, où ses dynamismes peuvent réellement s'exprimer et se répercuter dans la vie quotidienne de la Cité, sans rencontrer d'obstacles ou d'obsolescences incapacitantes. Ce projet continental de subsidiarité est indissociable de la question économique. Si l'ancrage politique au niveau des pays est une nécessité pour rétablir les consensus écornés par la déliquescence des valeurs, il doit être concomitant à une “recontextualisation” de l'économie. Si la volonté de “recontextualiser” l'économie, de réancrer les forces économiques sur le lieu même de leur déploiement, si cette recontextualisation redevient la caractéristique principale d'une économie saine, on ne pourra plus parler d'une césure gauche/droite mais d'un clivage opposant les orthodoxies économiques, voire les orthoglossies économiques (consistant à répéter inlassablement les mêmes discours idéologisés sur l'économie), aux hétérodoxies.
Pour les historiens français de l'histoire des théories économiques, les orthodoxies sont : 1) l'économie classique (le libéralisme dévié d'Adam Smith, le manchesterisme), 2) le marxisme et 3) la synthèse keynésienne, du moins telle qu'elle est instrumentalisée par les sociaux-démocrates. Toutes ces pensées orthodoxes sont mécanicistes. Face à elles, les hétérodoxies sont très variées : elles ne prétendent pas à l'universalité ; elles se pensent comme produits de contextes précis. Elles ont pour sources les réflexions posées par l'école historique (allemande) au XIXe siècle, pour laquelle l'économie se déployait toujours dans des espaces travaillés par l'histoire. Dans une telle perspective, aucune économie ne peut se développer dans un contexte dépourvu d'histoire. Outre l'école historique allemande, les hétérodoxies dérivent des socialistes de la chaire et des institutionalistes américains (dont Thorstein Veblen ; les institutions déterminent l'économie, or les institutions, elles aussi, comme le droit, sont produites par l'histoire). Pour François Perroux qui, en France, a fait la synthèse de ces corpus variés, l'économie se déploie au sein de dynamiques de structures, dans des turbulences où s'entrechoquent des forces variées : nous retrouvons là, dans un langage scientifique, avec un appareil mathématique adéquat, ce que le philosophe-poète Deleuze avait appelé le “rhizome”, ce sous-bois, cette jungle du plan d'immanence, dans laquelle l'homme lucide doit repérer et capter des forces.
Parmi ces lucides qui repèrent et captent, il y a bien entendu des hétérodoxes que l'on classe à gauche et d'autres que l'on classe à droite. Mais ce qui importe, dans leurs théories et discours, ce n'est pas le label, mais, plus justement, ce qui fait leur hétérodoxie, soit la volonté de se démarquer du mécanicisme des orthodoxies, de se dégager des impasses politiques dans lesquelles elles ont fourvoyé nos sociétés.
Révolution conservatrice et “événement-choc”
Mais si les questions brûlantes de la politique sont celles de la subsidiarité, de la réorientation de la pensée économique vers les théories hétérodoxes, que reste-t-il de notre engouement pour la Révolution conservatrice ? N'est-il pas le dernier indice d'un ancrage que l'on pourrait labéliser de “droite” ? N'est-il pas ce petit “plus” qui permettrait de nous ranger définitivement dans la “boîte de droite” ? Premier élément de réponse : ce qui consitue l'essence de la Révolution conservatrice, ce n'est pas tant la dimension proprement conservatrice, c'est-à-dire le maintien de formes anciennes ou la volonté de garder “fixes” et immuables certaines institutions, mais l'attention constante pour l'Ernstfall (le cas d'exception), l'éveil à tout ce qui est soudain (Das Plötzliche), inattendu (Das Unerwartete), l'événement-choc vécu en direct et qui appelle une réponse rapide, une décision (Eine Entscheidung).
Cette attention et cet éveil ont été considérés comme les marques les plus caractéristiques de la “Révolution conservatrice”, rangée à droite dans l'univers des panoplies politiques. Mais l'éveil à ce qui est soudain n'est pas seulement ancré à “droite”. Tant les surréalistes, contestataires et hostiles à toute forme de conservation institutionnelle, que Walter Benjamin y ont été attentifs et lui ont accordé la priorité, le statut d'essentialité, par rapport à la simple et répétitive quotidienneté. On retrouve la même valorisation de l'instant crucial, marqué d'une forte charge d'intensité, chez C. Schmitt, chez E. Jünger, chez M. Heidegger. Chez Benjamin, le fait de vivre un choc et de gérer ainsi l'irruption de l'imprévu, de vivre sous l'emprise d'une logique du pire, évite le traumatisme incapacitant, permet de vivre et de naviguer dans un monde qui transite de catastrophe en catastrophe.
Focaliser l'attention du personnel politique d'élite sur la soudaineté et l'irréductibilité du particulier face aux prétentions de l'universel, permet justement de ne pas “perdre les pédales”, de ne pas “craquer” devant le constat que l'on est bien forcé de poser aujourd'hui : la fin de l'histoire (Fukuyama), l'advenance d'un temps hypothétique où les décisions seraient devenues superflues, n'arriveront pas. Jamais. Cette non-advenance bien constatable prouve l'inanité des thèses de Kelsen ainsi que des institutions et des pratiques politiques qui en découlent. Elle contraint à penser métaphoriquement le plan du politique comme un sous-bois touffu, comme une masse unique et toujours particulière de sédimentations multiples, inextricablement enchevêtrées, dont témoignent l'histoire du droit, l'histoire constitutionnelle et la jurisprudence. Dans l'enchevêtrement de pratiques juridiques non répressives mais codifiant, décodifiant et recodifiant la convivialité publique (pratiques qui sont de ce fait non punissantes et non surveillantes, pour rappeler ici le travail de Foucault), dans cet enchevêtrement donc, s'expriment des valeurs, sous des oripeaux qui se modifient et s'adaptent au fil du temps, tout en conservant l'essentiel de leur message.
Conclusion
Par conséquent, le projet de Synergies Européennes étaye sa revendication de subsidiarité par un recours aux corpus symbiotiques d'Althusius, Möser, Riehl, Gierke, etc. pour organiser et renforcer une quotidienneté organique, dégagée des simplismes politiciens et mécanicistes qu'ont véhiculés la plupart des idéologies du pouvoir en Europe. Cette quotidienneté doit pouvoir s'exprimer dans des assemblées élues par la population de régions historiques, expressions de substrats historiques, juridiques et économiques de longue durée. Ces substrats représentent des “contextes” économiques particuliers, dont la particularité ne saurait être ni altérée ni oblitérée ni éradiquée. Toute volonté d'altérer, d'oblitérer ou d'éradiquer ces substrats participent d'une volonté mécanique de “surveiller” et de “punir”, qui se camoufle souvent derrière des discours iréniques et moralisants. Ces particularités substratiques doivent donc être prises en compte telles qu'elles sont, dans leur complexité que le philosophe-poète compare volontiers à un sous-bois touffu ou à une forêt vierge. Cette complexité est organique et forcément rétive à toute logique mécanique, binaire ou simpliste. Sur le plan économique, elle ne peut être appréhendée que par une pensée de type historique, c'est-à-dire, selon la classification qu'ont opérée les historiens français contemporains de la pensée économique, une pensée “hétérodoxe”.
Mais ce réel pensé comme sous-bois peut le cas échéant subir l'assaut d'aléas mettant ses équilibres particuliers en danger. L'événement-choc, soudain, fortuit, terrible, peut bousculer des équilibres organiques pluriséculaires : ceux-ci doivent toujours être capables de faire face, de cultiver une logique du pire, pour que les chocs qu'ils affrontent ne les détruisent ni ne les traumatisent. Telle est la disposition d'esprit qu'il faut retenir des décisionnistes historiques (Sorel et ses disciples de la “Révolution conservatrice”) et de l'œuvre de Walter Benjamin.
Deux pistes pour sortir des enfermements de gauche et de droite et pour accepter la diversité du monde et le divers en nos propres sociétés.
► Robert STEUCKERS.
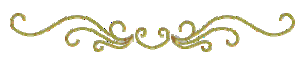
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
SYNERGIES en Allemagne : pourquoi ?
Une mise au point du Président Mark Lüdders
Quand on lui posait la question de savoir si la “droite” allemande avait un avenir, le non-conformiste Günter Maschke répondait brièvement et sèchement : “Pas pour le moment”. Et il poursuivait en expliquant pourquoi son pronostic était si négatif. Parce que le niveau intellectuel de ces droites était tout simplement misérable. Maschke a donné cette réponse à Junge Freiheit et à Vouloir en 1991. Son jugement n'a pas dû se modifier considérablement depuis lors. Tout porte à croire qu'il doit même être plus pessimiste encore à l'heure qu'il est.
En effet, on peut aisément constater que les droites allemandes se sont intellectuellement repliées sur des positions datant du siècle dernier, celui du bon vieil État-Nation. On s'encroûte dans ses manies, on quitte la ville pour s'installer dans une campagne soi-disant “vierge” de toutes compromissions avec la modernité, on sombre dans le solipsisme, on se plaint, on attend que cette situation si terrible infligée au pays par la défaite de 1945 prenne fin... Ces reclus et ces figés connaissent leurs ennemis : l'ordinateur, émanation de l'âge du Mal, le paprika que consomment les citadins et qui ne pousse pas en terre germanique (et ne peut donc être consommé sous peine de sombrer dans un état de péché mortel), la science qui n'est jamais qu'un résultat des Lumières, gauchistes avant la lettre, et “maçonniques” de surcroît... De Frédéric Nietzsche, ils ne connaissent que le nom, ont oublié celui d'Arnold Gehlen, ne s'intéressent plus aux travaux de Lorenz et de son école d'épistémologie biologique, ignorent bien entendu les leçons de Zinoviev et de De Felice, d'Oakshott et d'Ortega y Gasset, de Huizinga et de Maffesoli : tous des étrangers...
Ce petit monde replié sur lui-même est toutefois convaincu de 2 choses : les Juifs (toujours eux !) contrôlent tout dans le monde, et les Polonais occupent les provinces orientales de l'Allemagne qui doivent nous revenir. Quand les Juifs cesseront de tout contrôler et que Breslau, Stettin, Dantzig, etc. redeviendront pleinement allemandes, tout ira bien entendu mieux dans le meilleur des mondes... Force est de constater qu'une bonne partie des droites allemandes a complètement perdu le sens des réalités politiques et n'a plus qu'une culture politique fragmentaire et lacunaire, assortie de phobies inexplicables qui les empêchent de sortir de leur ghetto.
Face à ces droites repliées sur elles-mêmes, nous avons des droites qui se sont ancrées — ou cherchent à s'ancrer — dans l'ordre fondamental de la démocratie libérale : elles tentent d'entrer en dialogue avec l'établissement, afin de changer graduellement la société et en espérant qu'elles obtiendront finalement le pouvoir politique à haut niveau ou une parcelle importante de celui-ci. Mais en visant cet objectif fort lointain, ces droites-là oublient leurs positions idéologiques et axiologiques de base et snobent leur clientèle au parler plus cru et aux aspirations plus directes. Elles ne comprennent pas que la “méchante” oligarchie dominante ne s'intéresse pas à elles, mais ne vise que le maintien de ses postes, fonctions, statuts et positions et qu'elle dosera toujours savamment ses compromis pour rester au pouvoir et ne concéder que d'infimes parcelles de “pouvoir” purement décoratif, en marge des décisions politiques réelles.
Ces droites-là tentent à tout bout de champ de redéfinir les concepts, s'engluent dans des discussions interminables visant à ménager la chèvre et le chou, finissent par prétendre qu'elles seules respectent le principe de la liberté d'expression et sont en droit de détenir le label de “véritable libéralisme”. Ces droites-là pèchent également par naïveté : elles ne voient pas, ou refusent de voir, que l'idéologie libérale n'est plus ce qu'elle était au XIXe siècle, qu'elle n'est plus l'expression d'une bourgeoisie cultivée et entreprenante, mais qu'elle est un instrument de domination subtil ou une illusion progressiste agressive que l'on appelle la “permissivité”. En spéculant sur un libéralisme (conservateur et tocqueviellien) qui n'existe plus, ces droites se retranchent elles aussi dans des anachronismes du XIXe siècle. Elles demeurent certes “morales” ou “irréprochables” aux yeux de l'idéologie dominante, mais sur le plan politique ou sur le plan intellectuel, elles sont tout à fait inoffensives. Surtout parce qu'elles ne tentent même pas de construire une véritable alternative à l'idéologie dominante : elles demeurent obnubilées par leur souci d'être jugées “conformes à la constitution”.
Mais le paysage idéologico-politique allemand connaît tout de même quelques exceptions positives. Il faut mentionner ici les efforts des nationaux-révolutionnaires des années 70 qui ont eu l'intelligence et le courage de jeter les premiers ponts entre le savoir scientifique contemporain et une vision du monde alternative. Si, dans les droites, on a pu apercevoir deci-delà quelques modernisations dans le discours, c'est à cette petite phalange d'idéologues audacieux qu'on le doit. Mais ces hommes n'ont été qu'une poignée : une partie d'entre eux se sont malheureusement fondus dans les droites recluses ou “entristes”, une autre partie s'est retirée de tout, écœurée ; si bien que nous n'avons plus en Allemagne qu'un tout petit groupe d'intellectuels combattifs et toujours non-conformistes...
Devant ce triste bilan des agitations des droites allemandes, disons que la “Révolution conservatrice” de l'entre-deux-guerres avait appliqué à la perfection le mot-d'ordre de Schiller (“Vis avec ton siècle, mais n'en sois pas la créature”) mais qu'après cette formidable révolution intellectuelle, sur laquelle le monde entier se penche encore aujourd'hui, les droites allemandes sont entrées en une profonde léthargie, ont raté lamentablement leur connexion aux nouveaux impératifs scientifiques ou philosophiques.
Cet échec est un défi pour les jeunes qui refusent tant les schémas de la droite recluse que ceux de la droite alignée. Ces jeunes sont là, leur nombre croît, mais ils n'ont ni tribune ni organisation. Ils perçoivent l'étroitesse d'esprit des uns et l'opportunisme des autres. Ils veulent rester dans la société civile, dans la société réelle, bref dans le peuple, mais sans perdre leur ouverture d'esprit. Ils veulent influencer la société sans vénérer les vieilles lunes en place et sans sacrifier aux lubies du libéralisme permissif. Dans les circonstances actuelles du paysage politique allemand, ces jeunes révolutionnaires constructifs, disséminés dans toute la société civile, ne rassemblent pas leurs forces, ne mettent pas leurs énergies en commun pour atteindre un objectif bien défini : ils restent éparpillés dans de petites organisations sans envergure et demeurent isolés (ce que l'idéologie et le pouvoir dominants attendent d'eux). C'est à cette carence qu'entend répondre une organisation comme SYNERGON. En effet, SYNERGON veut construire une communauté de pensée, bâtir une plate-forme pour tous ceux qui luttent isolément, rassembler les jeunes qui réclament l'avènement d'une droite ouverte aux idées nouvelles et qui veulent collaborer activement avec leurs homologues de tous les pays d'Europe. Car il faut mettre fin à cette diabolisation xénophobique des autres Européens : il faut aller au devant d'eux pour apprendre leurs recettes, pour élargir nos propres horizons.
Un tel échange à l'échelle continentale animera et fécondera tous les “révolutionnaires-conservateurs” d'Europe : les Allemands pourront ainsi tirer profit de la flexibilité intellectuelle de leurs amis italiens, étudier plus profondément les legs de la pensée philosophique française de ces dernières décennies (Deleuze, Guattari, Foucault, Rosset, Maffesoli, etc.), découvrir les filons conservateurs-révolutionnaires des Russes, etc. Par ailleurs, Français, Italiens, Ibériques et Russes, épaulés par les Allemands, pourront plonger plus directement dans les méandres de la “Révolution conservatrice” qui alimente encore tous les discours innovateurs de notre temps. Une invention allemande comme le mouvement de jeunesse (des Wandervögel à la Freideutsche Jugend et aux expériences plus audacieuses et plus étonnantes des années 20) pourra apprendre aux autres Européens à vivre plus concrètement leurs idéaux et à les transmettre en dehors de la seule sphère intellectuelle. De plus, l'écologie politique organique, donc révolutionnaire-conservatrice, qui est une idée allemande, pourra être communiquée à tous les cercles intéressés d'Europe.
Le grand défi qui nous attend, nous les synergétistes de tous les pays qui appellent à l'unité, c'est de forger de concert une Weltanschauung qui soit réellement en prise avec notre temps, qui soit aussi éloignée de tout dogmatisme, de tout esprit partisan, qui puisse inclure et exploiter les résultats des recherches scientifiques les plus neuves, afin d'offrir à la société civile une alternative réelle et praticable à l'idéologie dominante, instrumentalisée par le pouvoir.
Pour obtenir un résultat tangible, nous devons donc échanger des idées au-delà des frontières en Europe, débattre, comparer des positions en apparence différentes voire irréconciliables. SYNERGON est le seul mode d'action commune qui puisse à l'heure actuelle répondre à ce défi. SYNERGON ne se pose pas d'emblée comme le concurrent d'autres organisations : nous ne cherchons pas à absorber ou à détruire ou à phagocyter des partis, des cercles ou des clubs déjà existants, mais nous voulons tout simplement animer un centre de coordination et de coopération.
Notre espoir est de réussir bien entendu, d'abord en établissant SYNERGON en Allemagne, afin que Günter Maschke puisse envisager l'avenir avec davantage d'optimisme.
► Mark LÜDDERS.

Avec « SYNERGON »
POUR QUITTER LE PROVINCIALISME INTELLECTUEL “BUNDESREPUBLIKANISCH”
 Pour un jeune Allemand comme moi, qui est appelé pour la toute première fois à disserter amplement sur les structures et les courants révolutionnaires-conservateurs ou “de droite” en Europe, le risque de subir un choc culturel est bien réel. Même si ce jeune Allemand est lui-même un partisan des idées et théories promues et défendues par ces courants de pensée, il finira par sombrer dans une sorte de mélancolie. Il s'apercevra bien vite que ses homologues dans beaucoup de pays d'Europe se meuvent avec une aisance insoupçonnée dans les espaces politiques ou pré-politiques et échangent idées, projets et points de vue avec d'autres courants intellectuels, souvent opposés.
Pour un jeune Allemand comme moi, qui est appelé pour la toute première fois à disserter amplement sur les structures et les courants révolutionnaires-conservateurs ou “de droite” en Europe, le risque de subir un choc culturel est bien réel. Même si ce jeune Allemand est lui-même un partisan des idées et théories promues et défendues par ces courants de pensée, il finira par sombrer dans une sorte de mélancolie. Il s'apercevra bien vite que ses homologues dans beaucoup de pays d'Europe se meuvent avec une aisance insoupçonnée dans les espaces politiques ou pré-politiques et échangent idées, projets et points de vue avec d'autres courants intellectuels, souvent opposés.
Tel est ma position : c'est donc un jeune homme étonné, un peu troublé, qui écrit pour la première ses sentiments en ce domaine et qui sort, par la plume, du cercle étroit de la culture politique de son pays. Je ne vais pas écrire un texte scientifique, car je ne suis pas un sociologue ou un diplômé en sciences politiques. Je veux plus simplement mettre de l'ordre dans quelques idées pour aider les lecteurs non germanophones à comprendre, dans la mesure du possible, la situation intellectuelle qui règne en Allemagne aujourd'hui.
rééducation
Lorsque les puissances occupantes ont commencé à intégrer la nouvelle “Bundesrepublik” dans leurs calculs et dans leurs projets militaires, quasi immédiatement après la seconde guerre mondiale, elles avaient déjà largement confié à des Allemands le soin de parfaire la politique de “rééducation” du peuple allemand. Elles n'auraient pu faire mieux. Car les Allemands ont la manie de la perfection : ils ont travaillé à cette rééducation avec un tel zèle que tous en Allemagne ont perdu l'idée même de maintenir une tradition nationale ou une logique de souveraineté, ont perdu la conscience de soi, si bien qu'aujourd'hui, au lendemain de la réunification des 2 plus grandes constructions étatiques allemandes d'après 1945, l'Allemand moyen croit, au fond de lui-même, que cette réunification est une honte et une catastrophe.
La vieille droite a été exclue du jeu politique dans une très large mesure. Au moment où l'“État social” prenait forme, au beau milieu du “miracle économique”, pendant et après la révolte étudiante de 68, les valeurs et les idées de la vieille droite sont devenues de plus en plus suspectes, ont été houspillées et considérées comme anachroniques. Dans les masses, l'omniprésence de la consommation tuait toute aspiration spirituelle, conduisait à l'affadissement généralisé. Dans les élites intellectuelles, on s'enthousiasmait totalement et volontairement pour les idées de la gauche, à un point tel qu'on peut dire aujourd'hui que les pays communistes n'auraient jamais pu obtenir un tel consensus par les moyens coercitifs qu'ils n'hésitaient pourtant pas à employer parfois. La parution de L'Archipel Goulag de Soljénitsyne n'a pas entamé en Allemagne de l'Ouest la foi des intellectuels en ces idées communistes qu'ils jugeaient “bonnes dans le fond”. Les centaines de morts le long du Rideau de Fer séparant les 2 Allemagnes, les milliers de prisonniers politiques en RDA, étaient dépourvus de tout intérêt et ne troublaient pas la vision messianique de la gauche, croyant qu'au bout du progrès vectoriel annoncé par la vulgate marxiste un avenir brillant et lumineux nous attendait. Cette Jérusalem terrestre valait bien quelques cadavres !
un fascisme extensible à l'infini !
Pour l'intellectuel de gauche ouest-allemand, le communiste persécuté au Chili, le membre de l'ANC sud-africaine emprisonné, étaient beaucoup plus proches que le malheureux candidat réfugié abattu comme un chien sous les barbelés du Rideau de Fer. Parler des millions de victimes du stalinisme dans l'ensemble des territoires sous contrôle soviétique était une indélicatesse. Ce l'est d'ailleurs toujours. Les droites allemandes ne pouvaient pas faire référence à ces faits sans encourir foudres ou moqueries. Mais aujourd'hui les gauches allemandes n'hésitent toujours pas à se servir de la “Massue-Fascisme”. Par “fascisme”, il faut entendre la définition très extensive qu'en donnait Dimitrov et sur laquelle je ne reviendrai pas.
En Allemagne, le concept de “fascisme” a perdu tous contours et limites : ce n'est plus qu'une injure politique, un moyen pour couvrir un adversaire d'opprobe. Le “fasciste”, c'est devenu le représentant du “mal absolu”, qui n'a donc plus aucun droit. Quand la majorité des médias qui se portent encore et toujours volontaires pour mettre les esprits au pas vous traitent de “fasciste”, vous n'avez déjà plus votre place dans la société. L'avant-garde de cette inquisition est portée par les journaux et les émetteurs qui croient dur comme fer que leur mission est de rééduquer le public, car telle a été la tâche que leur ont dévolue jadis les puissances occupantes.
Le terme “fasciste” connait des synonymes : “nazi” et, dans sa variante libérale, “extrémiste de droite”. Celui qui récolte l'une de ces étiquettes obtient le même résultat : l'exclusion, forme à peine atténuée de la “mort civile”. Il y a quelques années, le parti d'État de la RDA (qui existe toujours et s'appelle le PDS, ou “Parti du Socialisme Démocratique”) finançait généreusement le “mouvement antifasciste” (l'Antifa-Szene) qui entretenait des passerelles avec les groupes violents d'autonomes et de squatters, permettant une mobilisation rapide et des coups précis, perpétrables à tout moment. On a assisté en Allemagne à des attaques violentes contre des domiciles ou des appartements privés, contre des individus isolés, on a envoyé systématiquement des lettres de menaces ou de dénonciation, on a pratiqué la terreur téléphonée (appels nocturnes, injures, menaces physiques y compris sur les enfants) et on a assassiné des gens. Ces instruments de terreur peuvent être appliqués à tout moment contre n'importe quelle personne qui professe des idées de droite, même modérées.
émergence de la « nouvelle droite »
Mais malgré ces procédés terroristes et normalement illégaux, une “nouvelle droite” s'est constituée en Allemagne, avec la volonté de recourir à l'intelligence : cette “nouvelle droite” est principalement représentée par l'équipe de l'hebdomadaire Junge Freiheit. Beaucoup de jeunes intellectuels qui s'étaient déclarés “conservateurs” — et non pas “révolutionnaires-conservateurs” ou “de droite” au sens évolien du terme — apprennent au fil des semaines qui passent, dans les colonnes de cet hebdomadaire, qu'ils ne sont pas isolés et que sur tout le territoire allemand, ils ont des compagnons ou des amis. Les Italiens et les Français savent déjà depuis 2 générations qu'ils ne sont pas seuls dans leur pays, grâce à leurs journaux et leurs réseaux : il existe partout des jeunes non-conformistes qui refusent le discours dominant, le critiquent au départ de pensées classées à “droite”, sans risque de se faire traiter immédiatement de “nazi”, sans sombrer dans la xénophobie (car en Allemagne, la scène-antifa pose mécaniquement l'équation suivante : droite = xénophobie = antisémitisme = Auschwitz). Ces droites italiennes et françaises alignent des intellectuels à l'esprit vif, capables de s'insinuer dans tous les discours et dans toutes les thématiques actuelles. Les ouvrages des nouvelles droites française et italienne étaient totalement inconnus il y a quelques années : ils commencent à être lus en Allemagne, chez les étudiants et les diplômés universitaires appartenant au camp “conservateur”.
Chaque jour, ceux qui se déclaraient “conservateurs” apprennent ainsi que leurs positions sont finalement beaucoup plus radicales qu'ils ne l'avaient pensé. Plus frileux, comme tous les conservateurs, ils s'en effraient souvent. Mais le phénomène de la “nouvelle droite” allemande fait lentement son chemin, même si la presse établie, monotone, n'en prend connaissance que du bout des lèvres, pour s'en plaindre et s'en lamenter. Dans tous les partis, des individus et des petits groupes, professant plus ou moins ouvertement des idées “nouvelle droite” ou explorant l'une ou l'autre facette de ce corpus vaste et varié, se regroupent, deviennent suspects puis objets de haine. Les écoles de pensée, les laboratoires intellectuels de la droite allemande avaient sombré dans l'oubli depuis la mise hors jeu de la “Révolution conservatrice” par le pouvoir national-socialiste (entre 1933 et 1934). Aujourd'hui, un réseau de clubs refait surface, dans le sillage des “cercles de lecteurs de Junge Freiheit” dont les travaux sont de qualité inégale : on ne peut effectivement pas atteindre d'emblée la qualité des travaux de la revue romaine Pagine Libere, des cycles de conférence orchestrés par Marco Battarra et de Sinergie/Italia ou des “unités régionales” du GRECE français au temps de Guillaume Faye. Les cercles “conservateurs-révolutionnaires” allemands n'en sont qu'à leurs premiers balbutiements.
européaniser nos démarches
La cristallisation de la “nouvelle droite” allemande est lente. Nous avons besoin de tirer les leçons des expériences françaises et italiennes. Nous devons tenir compte de leurs recherches et de leurs résultats. Nous devons hisser les principes de la “Révolution conservatrice” au niveau européen. Car, pour nous Allemands, ce serait un moyen pratique et réalisable de contourner les interdits et les obstacles dressés par le cartel médiatique de la rééducation et de sortir de notre isolement et de notre quarantaine intellectuelle. Car si nous restons dans cet isolement et si nous nous y complaisons, nous nous épuiserons, nous sombrerons dans les fantasmes, le dogmatisme, l'actionnisme aveugle et la radicalisation insensée. Qu'on ne vienne pas me dire que cette “européanisation” de nos démarches constitue une “trahison à la patrie allemande”, car que vaudraient des patriotes purs dont les horizons seraient totalement bouchés ? De plus, j'ajouterais que notre “européanisation” n'est pas l'européanisation préconisée par les partis dominants.
Partons du principe que le seul courant de droite valable, sérieux, accepté par l'opinion publique comme tel est celui de la “nouvelle droite”. Cette “nouvelle droite” est considérée comme un produit d'origine française. Mais cette ND française a été fortement tributaire d'apports allemands. En acceptant un modèle français intéressant, nous pratiquons donc la réimportation de matériaux allemands transformés dans un pays où les laboratoires intellectuels n'étaient pas soumis à la férule des “rééducateurs”. [En dehors de la sphère politique, au niveau philosophique et académique, le même phénomène s'est produit avec le nietzschéisme : allemand à l'origine, le nietzschéisme a été ostracisé en Allemagne après 1945, sous prétexte, dixit Lukacs, qu'il était un “irrationalisme” conduisant au nazisme. Le nietzschéisme a été travaillé en France par des hommes comme Deleuze, Guattari, Foucault, etc., tous classés à gauche. Ils ont été traduits en allemand, si bien que le nietzschéisme est subrepticement revenu en Allemagne dans ces “wagons” français. Au grand dam d'un Habermas, qui a fulminé tout son saoûl contre cette gauche nietzschéiste française, cheval de Troie d'un “néo-nazisme” qui ne pouvait pas manquer d'éclore...].
deux problèmes concrets, deux obstacles à surmonter
En Allemagne, on raconte partout — et pas seulement dans les milieux “conservateurs” — qu'il faut se hisser désormais au niveau européen mais en conservant intacts les ressorts de son identité, que l'Europe de demain ne sera pas une espèce de nirvana où l'on entrera après avoir fait le vide de ce que l'on porte en soi, après avoir abandonné le principe du “connais-toi toi-même”. Si l'on peut devenir Européen sans se vider de sa substance, alors le projet européen cesse d'être abstrait pour redevenir concret, cesse d'être cette pure union économique et administrative que l'établissement a vendue aux Allemands pendant plusieurs décennies. Les partis établis n'ont pas voulu tenir compte d'un fait pourtant bien patent : une Europe purement économique et administrative ne peut durer, si l'on n'a pas au préalable réfléchi aux fondements spirituels et culturels de l'Union. Les politiques à courte vue des partis établis ne veulent même pas se rendre compte des dangers que recèle ce bureaucratisme de termitière qui permet à beaucoup de politiciens de seconde zone de se faire une niche ou de coopter leurs féaux.
Par ailleurs, les droites et les révolutionnaires-conservateurs d'Europe sous-estiment toute une série de choses bien pratiques. Je ne vais rien révéler d'extraordinaire, je vais tout simplement mentionner 2 problèmes très concrets : la diversité linguistique en Europe et l'esprit casanier de bon nombre d'entre nous. Deux problèmes, deux tares qu'il faut impérativement et rapidement surmonter. Ce serait un premier pas vers une véritable pratique de nos idées. Ceux d'entre nous qui possèdent des dons, même modestes, pour les langues, qu'ils se perfectionnent ! Qu'ils lisent les travaux de nos voisins, qu'ils s'abonnent à leurs journaux et fassent l'effort d'en traduire les meilleurs morceaux ! Être Européen, c'est aussi et surtout être capable de comprendre les données politiques et culturelles d'un pays voisin, d'entretenir des contacts personnels (par courrier ou via internet) avec des homologues non allemands (aux niveaux personnel, professionnel ou politique).
face à nous : un européisme sans substance
La plupart des intellectuels établis n'ont que le mot “Europe” à la bouche mais ignorent totalement ce qui se passe au-delà des frontières de leur pays. Cette lacune, tous les Européens peuvent la constater. Surtout les donneurs de leçons qui pontifient dans les médias : généralement ils sont unilingues, baraguinent quelques phrases mal torchées en basic English et ne savent rien, strictement rien, des littératures, des grands courants culturels, des institutions et des clivages politiques de leurs voisins. Bonjour l'“internationalisme” ! Nous savons ce qu'il nous reste à faire, nous, pour qui l'Europe est un mythe et non pas une abstraction ou une sinécure : nous serons des Européens ouverts aux identités de tous les autres, nous combattrons les lubies libéralistes qui conduisent à l'impasse.
Nous lirons les textes de nos amis italiens, russes, ibériques et français, que nos éditeurs politiquement corrects ne veulent ni traduire ni éditer. Nous traduirons, nous diffuserons, nous fructifierons. Prenons un exemple, typiquement allemand : l'ouvrage fondamental de Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche, n'est toujours pas traduit, alors que sa version française est disponible depuis plus de 13 ans ! Ce livre est pourtant fondamental pour développer une critique intelligente du fascisme : mais cette critique du fascisme n'est pas celle pour laquelle nos censeurs ont opté il y a quelques décennies... Donc Sternhell, homme de gauche israëlien irréprochable, est condamné au placard ! Enfin, bon nombre de textes d'Evola subissent toujours la quarantaine, etc... Nous avons donc du pain sur la planche !
Alain de Benoist n'aurait plus raison de dire aujourd'hui que les Allemands ne lisent que fort peu de textes venus d'ailleurs. Certes, ces textes ne sont pas disponibles en langue allemande. Les Allemands, en revanche, s'étonnent de voir leurs amis italiens et français exploiter tant de textes allemands. Ces exégèses permettent de renforcer nos propres interprétations, d'éclairer des aspects que nous ignorions, de découvrir des parallèles dont nous n'avions pas idée. Bon nombre d'idées ou de germes d'idées, oubliés ou refoulés, reviennent ainsi dans leur patrie allemande, par le biais d'exégètes italiens, français ou hispaniques.
Notre “nouvelle droite” veut elle aussi apporter sa pierre à l'édifice européen. En réactivant nos cercles d'études, en exprimant par le verbe et par la plume ce que nous ressentons ou ce que nous avons découvert, ce travail de construction est désormais possible. Dans les espaces de la haute voltige intellectuelle, tout peut être dit ou pensé, mais ce n'est que par les contacts et les échanges personnels qu'une révolution culturelle pourra démarrer, être mise à l'épreuve des faits. Ces échanges entre néo-droitistes de tous plumages, à l'échelle européenne, est l'impératif de notre génération, notre devoir face à l'histoire.
► Thomas Rohlff.

IXe Université d'été de "Synergies Européennes" (2001)

 L'Université d'été tient une place centrale dans les activités de l'association « SYNERGIES EUROPÉENNES ». Elle est simultanément la Diète du mouvement, qui permet à ses sympathisants, venus de toute l'Europe, de se rencontrer et de constater que bon nombre de leurs préoccupations sont les mêmes en dépit des barrières nationales ou linguistiques. Cette année, cette réunion annuelle a eu lieu en Basse-Saxe, à proximité du site archéologique préhistorique des "Externsteine", qui fut probablement un observatoire astronomique, comme Stonehenge en Angleterre. Les stagiaires ont visité ce site et suivi les explications d'un guide professionnel, qui s'est spécialisé dans la question, et qui maîtrise parfaitement l'histoire très controversée — à l'instar de Glozel en France — des recherches qui ont eu lieu là-bas depuis la fin du XIXe siècle.
L'Université d'été tient une place centrale dans les activités de l'association « SYNERGIES EUROPÉENNES ». Elle est simultanément la Diète du mouvement, qui permet à ses sympathisants, venus de toute l'Europe, de se rencontrer et de constater que bon nombre de leurs préoccupations sont les mêmes en dépit des barrières nationales ou linguistiques. Cette année, cette réunion annuelle a eu lieu en Basse-Saxe, à proximité du site archéologique préhistorique des "Externsteine", qui fut probablement un observatoire astronomique, comme Stonehenge en Angleterre. Les stagiaires ont visité ce site et suivi les explications d'un guide professionnel, qui s'est spécialisé dans la question, et qui maîtrise parfaitement l'histoire très controversée — à l'instar de Glozel en France — des recherches qui ont eu lieu là-bas depuis la fin du XIXe siècle.
Les interventions principales de la session de 2001
Lors de cette IXe Université d'été (qui est simultanément la XVIe rencontre internationale de ce type patronnée directement par « SYNERGIES EUROPÉENNES ») a vu se succéder des orateurs très différents. Les organisateurs ont toujours voulu présenter un panel d'orateurs chevronnés et d'orateurs néophytes. Cette méthode permet un enrichissement réciproque et évite le piège de la répétition, qui est mortel à terme. Souvent les orateurs néophytes se défendent d'ailleurs fort bien. Ce fut le cas cette année plus que jamais. Parmi les orateurs chevronnés, nous avons eu G. Faye, Frédéric Valentin, le Général Reinhard Uhle-Wettler et R. Steuckers.
Guillaume Faye et la « convergence des catastrophes »
Faye nous a parlé de la "convergence des catastrophes" qui risque fort bien de s'abattre sur l'Europe dans les 2 prochaines décennies. C'est un thème qu'il a déjà eu l'occasion d'évoquer dans ces 3 derniers ouvrages, mais qu'il va approfondir en étudiant les théories de la physique des catastrophes. Le résultat final de cette quête va paraître dans une dizaine de mois et nous offrir une solide batterie d'argumentaires pour notre "philosophie de l'urgence", héritée de sa lecture de Carl Schmitt (l'Ernstfall sur lequel il a déjà travaillé au début des années 80, not. avec le concours de R. Steuckers, de son ami et traducteur milanais Stefano Sutti Vaj et de Jaime Nogueira Pinto, éditeur de la revue portugaise Futuro Presente). L'influence d'auteurs comme Ernst Jünger et Martin Heidegger a également été capitale dans l'élaboration de cette pensée de l'urgence.
Faye est ainsi le disciple fidèle d'Armin Mohler, auteur du manuel de référence principal des ND allemandes et italiennes (paru en version française chez Pardès). Mohler développait, lui aussi, une pensée de l'urgence, tirée des auteurs de la Révolution conservatrice dont Jünger, de Carl Schmitt (die Entscheidung [décision], der Ausnahmezustand [état d'exception]), des disciples de celui-ci qui parlaient d'« Ernstfall », de la théorie de Walter Hof sur le “réalisme héroïque” et de la philosophie du Français Clément Rosset, auteur d'un ouvrage capital : La logique du pire. Pour Rosset, il fallait en permanence penser le pire, donc l'urgence, pour pouvoir affronter les dangers de l'existence et ne pas sombrer dans le désespoir devant la moindre contrariété ou face à un échec cuisant mais passager. Mohler et Rosset sont les véritables professeurs de Faye, tout comme son ami Giorgio Locchi, disparu trop tôt en 1992. G. Faye poursuit et approfondit ce filon très fécond de la pensée. En cela, il reste inébranlablement fidèle à l'option la plus essentielle de la "Nouvelle Droite", à laquelle il a voué son existence.
De nous tous, qui avons participé aux initiatives de la ND, incontestablement, Faye est celui qui a le plus donné, sans autre retours que l'ignoble trahison de ses premiers commanditaires, qui ont délibérément tenté de réduire sa voix à un silence définitif, d'abord en lui coupant les vivres, ensuite, dans une deuxième phase, en montant au printemps 2000 une machination, une cabale, destinée à le faire condamner à une amende astronomique par la XVIIe chambre de Paris. Qu'il accepte ici notre plus sincère gratitude. Et que les comploteurs soient assurés de notre plus parfait mépris [NDLR/RS : à propos de la critique de toute "pensée de l'urgence" chez A. de Benoist : Locchi, Mohler et Rosset sont également mes professeurs, des maîtres que je ne saurais renier : je n'accepte pas qu'on les trahisse aussi misérablement, que l'on opère une volte-face aussi pitoyable, surtout que rien, mais alors rien, n'est jamais venu infirmer la justesse de leurs démonstrations].
La critique d'Alain de Benoist contre la pensée de l'urgence, telle que Faye l'articule, est résumée en une seule page de son journal, celle du 1er août 1999 (cf. La dernière année, L'Âge d'Homme, 2000). Elle est à mon avis très bête, et tout à la fois suffisante et insuffisante. “Suffisante” par la prétention et la cuistrerie qui se dégagent de cette leçon sans substance, diamétralement opposée à celles de Mohler et Rosset, et “insuffisante” par sa nullité et sa non pertinence. De Benoist critique Faye, parce que sa vision "catastrophiste" dérive d'une analyse des effets pervers des politiques irréfléchies d'immigration, pratiquées en France et dans d'autres pays d'Europe occidentale. Faye a prévu également le terrorisme, qui a frappé en 2001, à New York et peut-être aussi à Toulouse. L'islamisme, en tant qu'extrémisme (qu'on ne confondra pas avec l'Islam), est évidemment un danger, pour les peuples de souche européenne comme pour les peuples musulmans, mais de Benoist, pour des raisons vénales et alimentaires, ou de vaine gloriole, ne peut développer une critique de ces dérives : il est un des correspondants ou des collaborateurs occasionnels à Paris du journal iranien Teheran Times. Cette modeste position, qui pourrait certes être intéressante, autorise-t-elle l'aveuglement intellectuel ou le reniement de ses propres positions ? Là est toute la question…].
Frédéric Valentin : régulationistes et modèles indien et chinois
Frédéric Valentin a abordé 2 thèmes importants : la théorie de la régulation, avancée par les gauches aujourd'hui, mais qui puise dans les corpus "hétérodoxes" (selon la définition de Perroux, Albertini et Silem). Pour les régulationistes français, la bonne marche de l'économie dépend de l'excellence des institutions politiques et économiques de l'entité où elle se déploie. Ces institutions découlent d'une histoire propre, d'un long terme historique, d'une continuité, qu'il serait tout à fait déraisonnable d'effacer ou de détruire, sous peine de disloquer la société et d'appeler une cascade de problèmes insolubles. Par conséquent, une économie qui se voudrait "mondiale" ou "globale" est une impossibilité pratique et une dangereuse illusion. Dans sa deuxième intervention, il a montré comment les civilisations indiennes et chinoises avaient mis au point des garde-fous pour empêcher les classes sociales s'adonnant au négoce (du latin "neg-otium", fébrilité ou frénésie sans élégance) de contrôler l'ensemble du corps social.
Reinhard Uhle-Wettler : Brzezinski, Kennedy, Chomsky
Le Général Uhle-Wettler, ancien commandant des unités parachutistes allemandes et ancien chef de la 1ère Division aéroportée de la Bundeswehr, nous a exhorté à lire attentivement :
• les ouvrages de Paul Kennedy sur la dynamique des empires et sur le concept d'hypertension impériale (imperial overstretch),
• de Zbigniew Brzezinski pour connaître les intentions réelles de Washington en Eurasie et
• de Noam Chomsky pour connaître les effets pervers du globalisme actuel.
Cet exposé a été d'une clarté limpide, tant par la voix d'un homme habitué à haranguer ses troupes que par la concision du chef qui donne des ordres clairs. En tous points, les énoncés et les conclusions du Général correspondaient aux projets de l'"Ecole des Cadres" de "SYNERGIES EUROPÉENNES", dirigée en Wallonie par Philippe Banoy, ce qui a évidemment enthousiasmé les stagiaires de cette école, présents à l'Université d'été ! Mieux : en entendant les paroles du Général, nous avons été frappé d'entendre son appel aux jeunes Allemands à rejoindre un cercle comme Synergies Européennes pour élaborer l'alternative au monde actuel.
Steuckers : cartographie géopolitique
Pour sa part, R. Steuckers a présenté 54 cartes historiques de l'Europe, montrant le conflit 5 fois millénaire de nos peuples avec les peuples de la steppe eurasiatique. Nos cartographies scolaires sont généralement insuffisantes en France, en Allemagne et en Belgique. Les Britanniques en revanche, avec les atlas scolaires de Colin McEvedy, que Steuckers n'a cessé de potasser depuis plus de 20 ans, disposent d'une cartographie historique beaucoup plus précise. En gros, quand les peuples européens dominent la steppe eurasienne jusqu'aux confins du Pamir (et peut-être au-delà, vers la Chine, à partir de la Dzoungarie et du désert du Taklamakan), ils sont maîtres de leur destin. Mais dès qu'un peuple non européen (Huns, Turcs) dépasse le Pamir pour s'élancer sur la ligne Lac Balkhach, Mer d'Aral, Mer Caspienne, il peut rapidement débouler en Ukraine puis dans la plaine hongroise et disloquer la cohésion territoriale des peuples européens en Europe. Cette vision, bien mise en exergue par la cartographie de Colin McEvedy, depuis la dispersion des peuples iraniens en Eurasie (vers 1600 av. JC), permet de bien mesurer les dangers actuels, où, avec Brzezinski, les Américains considèrent que l'Asie centrale fait partie de la zone d'influence des États-Unis, qui s'appuient sur les peuples turcophones.
Engelbert Pernerstorfer
 Dans une deuxième intervention, plus littéraire celle-là, Steuckers a montré comment les ferments de la fameuse "Révolution conservatrice" allemande étaient né dans un cercle lycéen de Vienne en 1867, pour se développer ensuite à l'Université puis dans la sphère politique, tant chez les socialistes que chez les nationalistes. L'objectif de ce cercle, animé par la personnalité d'Engelbert Pernerstorfer (1850-1918), était de raviver les racines, de promouvoir un système d'enseignement populaire, de combattre les effets de la société marchande et de la spéculation boursière, de diffuser des formes d'art nouvelles selon les impulsions lancées par Schopenhauer, Wagner et Nietzsche (la "métaphysique de l'artiste", créateur de formes immortelles par leur beauté).
Dans une deuxième intervention, plus littéraire celle-là, Steuckers a montré comment les ferments de la fameuse "Révolution conservatrice" allemande étaient né dans un cercle lycéen de Vienne en 1867, pour se développer ensuite à l'Université puis dans la sphère politique, tant chez les socialistes que chez les nationalistes. L'objectif de ce cercle, animé par la personnalité d'Engelbert Pernerstorfer (1850-1918), était de raviver les racines, de promouvoir un système d'enseignement populaire, de combattre les effets de la société marchande et de la spéculation boursière, de diffuser des formes d'art nouvelles selon les impulsions lancées par Schopenhauer, Wagner et Nietzsche (la "métaphysique de l'artiste", créateur de formes immortelles par leur beauté).
La "Révolution conservatrice" de Pernerstorfer est intéressante dans la mesure où elle se déploie avant la césure gauche/droite, socialistes/nationalistes, dévoilant une synthèse commune qui nous permet aujourd'hui de surmonter le clivage gauche/droite, qui bloque toute évolution idéologique, sociale et politique dans nos sociétés. Ensuite, le corpus idéologique qui a germé à Vienne de 1867 à 1914, permet de déployer une "Révolution conservatrice" civile, c'est-à-dire une Révolution Conservatrice qui est en phase avec toutes les problématiques d'une société civile et non pas de la réduire à un "univers soldatique" comme dans la période de guerre civile qui a régné en Allemagne de 1918 à 1923. L'"univers soldatique" est certes fascinant mais demeure insuffisant pour une pratique politique en temps normal (ceci dit pour répondre aux critiques d'A. de Benoist à l'encontre de toute pensée de l'urgence, critiques qu'il adresse surtout à Faye).
L'itinéraire de Georg Werner Haverbeck
Deux autres orateurs de 40 ans se sont succédé à notre tribune : Andreas Ferch qui nous a brossé une esquisse biographique de Georg Werner Haverbeck, ancien animateur de la jeunesse "bündisch", inféodé par décret aux jeunesses hitlériennes, en rupture de banc avec le parti dès 1936 (parce que Haverbeck voulait une jeunesse fonctionnant selon les principes de la "démocratie de base" et non pas une jeunesse sous la tutelle d'un État), pasteur à Marbourg dans les années 40 et 50, animateur de cercles pacifiques au temps de la guerre froide (ce qui lui a valu le reproche d'être un "agent rouge"), fondateur de l'écologie non politicienne dans les années 80, refusant l'inféodation au gauchisme des Grünen (ce qui lui a valu le reproche de "néo-nationaliste" sinon pire…). Un destin étonnant qui résume toutes les problématiques de notre siècle. Werner Haverbeck est décédé à la fin de l'année 1999, à l'âge de 90 ans.
Oliver Ritter : Heidegger et la technique
Oliver Ritter, pour sa part, nous a parlé avec une extraordinaire concision et une remarquable clarté de Martin Heidegger. Il a parfaitement démontré que la transposition de critères et de grilles d'analyse de type technique ou de nature purement quantitative/comptable dans l'appréhension du réel conduit à des catastrophes (à cause du "voilement" ou de l'"oubli" de l'Être). Face à l'option "archéofuturiste" de Faye, qui a des aspects techniciens, voire assurément "technophiles", en dépit de références heideggeriennes, les positions de Ritter sont bien sûr différentes, mais non "technophobes", dans la mesure où Heidegger s'émerveille aussi devant la beauté d'un pont qui enjambe une vallée, d'un barrage qui dompte une rivière ou un fleuve.
Heidegger, et Ritter à sa suite, dénonce le désenchantement, y compris celui des productions de la technique, par l'effet pervers de ce culte technicien et quantitativiste de la faisabilité (Machbarkeit, feasability). Cette faisabilité (que critique aussi Emanuele Severino en Italie) réduit à rien la force intérieure des choses, qu'elles soient organiques ou produites de la main de l'homme. Cette réduction/éradication conduit à des catastrophes, et assurément à celles, convergentes, qu'annonce Faye. Ce dernier est plus proche du premier Heidegger, qui voit l'homme arraisonner le réel, le commettre, le requérir ; Ritter, du second, qui contemple, émerveillé, les choses, souvent simples, comme la cruche qui contient le vin, au sein desquelles l'Être n'a pas encore été voilé ou oublié, de ce second Heidegger qui dialogue avec ses disciples zen japonais dans son chalet de la Forêt Noire.
Sven Henkler : le rapport homme/animal
Sven Henkler, secrétaire de Synergon-Deutschland, vient de sortir un ouvrage sur le rapport homme-animal, totalement vicié aujourd'hui. Henkler nous a présenté son ouvrage le plus récent, Mythos Tier, qui déplore la déperdition définitive du rapport sacré qui existait entre l'homme et l'animal, de l'effroi respectueux que ressentait parfois l'homme face à la force de l'animal (notamment l'ours). L'animal est devenu pure marchandise, que l'on détruit sans pitié quand les réquisits de l'économie l'exigent.
Ezra Pound et la « Beat Generation »
Thierry de Damprichard a présenté un panorama des auteurs américains de la Beat Generation et explicité quelles influences ils avaient reçues d'Ezra Pound. Cette présentation a suscité un long débat qu'il a magistralement co-animé avec G. Faye, très bon connaisseur de cette littérature, très en vogue dans les années 60. Ce débat a permis de rappeler que notre contestation du système (et de l'«américanosphère») est également tributaire de cette littérature protestataire. G. Faye a not. dit qu'elle avait marqué une figure non-conformiste française qui a démarré sa carrière dans ces années-là, qui est toujours à nos côtés : Jack Marchal.
J. R. Diaz : l'alliance indienne
Jorge Roberto Diaz nous a parlé de la géopolitique de l'Inde, dans le cadre de diverses interventions sur les questions stratégiques et géostratégiques. Le groupe "SYNERGIES EUROPÉENNES" aborde chaque année un ensemble de questions de ce domaine, afin de consolider ses positions géopolitiques. L'ouvrage auquel Diaz s'est référé pour prononcer son exposé est celui d'Olivier Guillard, La stratégie de l'Inde pour le XXIe siècle (Économica, Paris, 2000). Jouer la carte indienne est un impératif géostratégique pour l'Europe et la Russie d'aujourd'hui, qui permettrait de contourner la masse territoriale turcophone, afghane/talibanique et pakistanaise, mobilisée contre l'UE et la Fédération de Russie par les États-Unis.
Une alliance entre l'UE, la Russie et l'Inde aurait pour corollaire de contenir l'effervescence islamiste et surtout, comme l'a très bien exposé Diaz, de contrôler l'Océan Indien et le Golfe Persique, donc les côtes des puissances islamiques alliées des États-Unis. Le développement de la marine indienne est donc un espoir pour l'Europe et la Russie qui permettra, à terme, de desserrer l'étau islamique dans le Caucase et les Balkans et de parfaire, le cas échéant, un blocus de l'épicentre du séisme islamiste, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. La menace qui pèse sur l'Inde vient de l'occupation américaine de l'île de Diego Garcia, où sont concentrées des forces impressionnantes, permettant aux États-Unis de contrôler les flots et le ciel de l'Océan Indien ainsi que le transit maritime du pétrole en direction de l'Europe, de l'Afrique du Sud, du Japon et des nouveaux pays industriels d'Asie orientale.
Max Steens : le Tao du Prince de Han Fei
Max Steens nous a plongés dans la pensée politique chinoise, en évoquant la figure de Han Fei, sage du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Han Fei nous suggère une physique politique limpide, sans jargon, avec, en plus, 47 principes pour prévenir toute pente vers la décadence. Phrases ou aphorismes courts, à méditer en permanence ! Le renouveau de notre espace politico-idéologique passe à notre sens par une lecture des sagesses politiques extrême-orientales, dont
◊ le Tao-Te-King, traduit en italien par Julius Evola pendant l'entre-deux-guerres et texte cardinal pour comprendre son idéal de “personnalité différenciée” et son principe de “chevaucher le Tigre” (c'est-à-dire de vivre la décadence, de vivre au sein même de la décadence et de ses manifestations les plus viles, sans perdre sa force intérieure et la maîtrise de soi),
◊ le traité militaire de Sun Tsu comme le préconise Philippe Banoy, chef de l'école des cadres de "SYNERGIES EUROPÉENNES" en Wallonie,
◊ le "Tao du Prince" de Han Fei, comme le préconise Steens de l'école des cadres de Bruxelles et
◊ le code du Shinto japonais, comme le veut Markus Fernbach, animateur de cercles amis en Rhénanie-Westphalie. Fernbach est venu nous présenter le code du Shinto avec brio, avec une clarté aussi limpide que son homologue français ès-shintoïsme, que les lecteurs de la revue Terre & Peuple connaissent bien, Bernard Marillier, auteur d'une étude superbe sur ce sujet primordial, parue récemment chez Pardès.
Markus Fernbach : les leçons du shintoïsme
Ces voies asiatiques conduisent à tremper le caractère, à combattre en nos fors intérieurs tous les affects inutiles qui nous distraient de l'essentiel. Un collège de militants bien formés par ces textes, accessibles à tous, permettrait justement de sortir des impasses de notre mouvance. Ces textes nous enseignent tout à la fois la dureté et la sérénité, la force et la tempérance. Après la conférence de Fernbach, le débat s'est prolongé, en abordant notamment les similitudes et les dissemblances entre ce code de chevalerie nippon et ses homologues persans ou européens. On a également évoqué les "duméziliens" japonais, étudiés dans le journal "Études indo-européennes" du Prof. Jean-Paul Allard de Lyon III, bassement insulté par la presse du système, qui tombe ainsi le masque et exhibe sa veulerie.
Enfin, il y a eu un aspect du débat qui nous paraît fort intéressant et prometteur : notre assemblée comptait des agnostiques, des païens, des catholiques et des luthériens. Ethique non chrétienne, le Shinto peut être assimilé sans problème par des agnostiques ou des païens, mais aussi par des catholiques car le Vatican a admis en 1936 la compatibilité du shintoïsme et du catholicisme romain. On peut donc être tout à la fois catholique et shintoïste selon la hiérarchie vaticane elle-même. Dès lors pourquoi ne pas étendre cette tolérance vaticane aux autres codes, ceux de la Perse avestique ou des kshatriyas indiens, le culte romain des Pénates, etc., bref à tout l'héritage indo-européen ? Voilà qui apporterait une solution à un problème qui empoisonne depuis longtemps notre mouvance. Mais cette reconnaissance du shintoïsme, qui date de 1936, sous le Pontificat de Pie XII, est-elle encore compatible avec les manifestations actuelles du catholicisme : les mièvreries déliquescentes de Vatican II ou l'impraticable rigidité des intégrismes obtus ?
Manfred Thieme nous a ramenés à l'actualité en montrant avec précision les effets de la privatisation de l'économie dans les PECO (pays d'Europe centrale et orientale), en prenant pour exemple l'évolution de la République Tchèque.
La suite à Bruxelles…
Les autres conférences, prévues à Bruxelles pendant le week-end précédant l'Université d'été proprement dite, seront prononcées plus tard, majoritairement en langue néerlandaise. Successivement, Jürgen Branckaert, germaniste et angliciste, l'historien brugeois Kurt Ravyts, Philippe Bannoy, G. Faye et R. Steuckers y prendront la parole. Branckaert évoquera une figure cardinale de notre histoire : le Prince Eugène de Savoie, vainqueur des Turcs à la fin du XVIIe siècle. Un cercle "Prince Eugène" verra le jour à Bruxelles, rassemblant des Flamands et des Wallons fidèles à l'idée impériale, fédérant les cercles épars qui véhiculent la même inébranlable fidélité, tels “Empire et puissance” de Lothaire Demambourg ou la “Sodalité Guinegatte”. Des sections seront créées ensuite en Autriche, en Hongrie et en Croatie, de façon à nous remémorer notre seule légitimité politique possible, détruite par la Révolution française, mais dans une perspective plus claire et plus européenne que celle de l'iconographie que nous avait présentée, dans notre enfance, le Chanoine Schoonjans, avec les images de la collection “Historia”.
Ravyts analysera les influences de Gabriele d'Annunzio et de Léon Bloy, not. sur la figure du national-solidariste flamand Joris Van Severen. Il rendra de la sorte cette figure de notre histoire plus compréhensible pour nos amis français et italiens. Cet exposé permettra également de raviver le souvenir de Léon Bloy dans notre mouvance, qui l'a trop négligé jusqu'ici. Bannoy analysera l'œuvre de Vladimir Volkoff et en tirera tous les enseignements nécessaires : lutte contre la subversion et la désinformation. G. Faye présentera une nouvelle fois sa théorie de la “convergence des catastrophes", cette fois à l'occasion de la parution de son ouvrage Avant-guerre, promis pour février 2002.
► Jérémie Catteaux.
