Blüher
Hans Blüher : les héros masculins, porteurs d'État
 Son père l'avait averti de la toute-puissance de la société établie : « Ils t'injurieront et te brocarderont. Tu iras frapper en vain à la porte des maisons d'édition et des rédactions des journaux. Ils tairont ton nom et en feront un tabou que personne n'osera briser ou contourner ». Pourtant, à 23 ans, le jeune Blüher était fermement décidé à poursuivre sa voie : il voulait décrire le mouvement Wandervogel tel qu'il l'avait vécu, c'est-à-dire comme un « phénomène érotique ».
Son père l'avait averti de la toute-puissance de la société établie : « Ils t'injurieront et te brocarderont. Tu iras frapper en vain à la porte des maisons d'édition et des rédactions des journaux. Ils tairont ton nom et en feront un tabou que personne n'osera briser ou contourner ». Pourtant, à 23 ans, le jeune Blüher était fermement décidé à poursuivre sa voie : il voulait décrire le mouvement Wandervogel tel qu'il l'avait vécu, c'est-à-dire comme un « phénomène érotique ».
Son premier ouvrage, paru en 3 volumes en 1912, il l'appelait son « brigand ». Grâce à lui, il déboule d'un seul coup sous les feux de la rampe, où il récolte bien entendu les injures et les quolibets que son père lui avait prophétisés. Il était devenu l'advocatus diaboli en marge du mouvement de jeunesse. Le Wandervogel était décrit par son jeune historiographe comme un mouvement révolutionnaire dirigé contre l'esprit du temps et contre la poussiéreuse « culture des pères » car porté par la passion (érotique) de la jeunesse masculine.
Armin Mohler a placé Blüher (1888-1955) à côté d'Oswald Spengler, de Thomas Mann, de Carl Schmitt et des frères Jünger, dans la phalange de tête des penseurs de la Révolution conservatrice, et l'avait compté parmi les « principaux auteurs d'esprit bündisch ». Malgré ce grand honneur, son nom est aujourd'hui quasi oublié, plus rien ne s'écrit sur lui et ses ouvrages ne sont pas réédités. Le tabou fonctionne toujours.
Wandervogel et mythologie antique
Né en 1888 à Freiburg en Silésie, fils d'un pharmacien, Hans Blüher est profondément marqué par l'éducation qu'il reçoit au Gymnasium de Berlin-Steglitz, où il fait ses "humanités". Ce Gymnasium est aussi, ne l'oublions pas, le berceau du mouvement Wandervogel. Dans cette école, Blüher accède au monde spirituel de la mythologie antique, dont il restera compénétré jusqu'à la mort. Au même moment, les institutions prussiennes, prodigant leur formation militarisée — c'est un de leurs mérites, pense Blüher — suscitent aussi l'éclosion de forces différentes, contraires, de facture anarchisante, romantique et libre-penseuse.
 Assoiffé de savoir, Blüher est attiré par la pensée de Nietzsche, que les maîtres et les directeurs d'école condamnent encore. Cet engouement pour le philosophe de Sils-Maria le conduit à aller étudier brièvement la philologie à Bâle. À cette époque, Blüher part en randonnée, traverse les Alpes et se retrouve en Italie. Il dévore les œuvres de Max Stirner, surtout L'unique et sa propriété. Il en dira : « Ce fut l'extrémité la plus audacieuse, vers laquelle je pus me diriger ». Parce qu'il partageait avec lui la même vénération pour Carl Spitteler – pour Blüher, c'était un « Homère allemand » – il rencontre le pédagogue réformateur et charismatique Gustav Wyneken [ici vers 1930], figure de proue du mouvement de jeunesse.
Assoiffé de savoir, Blüher est attiré par la pensée de Nietzsche, que les maîtres et les directeurs d'école condamnent encore. Cet engouement pour le philosophe de Sils-Maria le conduit à aller étudier brièvement la philologie à Bâle. À cette époque, Blüher part en randonnée, traverse les Alpes et se retrouve en Italie. Il dévore les œuvres de Max Stirner, surtout L'unique et sa propriété. Il en dira : « Ce fut l'extrémité la plus audacieuse, vers laquelle je pus me diriger ». Parce qu'il partageait avec lui la même vénération pour Carl Spitteler – pour Blüher, c'était un « Homère allemand » – il rencontre le pédagogue réformateur et charismatique Gustav Wyneken [ici vers 1930], figure de proue du mouvement de jeunesse.
Wyneken avait créé la Communauté scolaire libre de Wickersdorf en Thuringe. Blüher considérait que cette initiative constituait le pôle apollinien du mouvement de jeunesse, tandis que le Wandervogel en constituait le pôle dionysiaque. Blüher ne rompit avec Wyneken, le réformateur des écoles, que lorsque celui-ci se mit à théoriser la notion d'un « peuple pur et bon » à la mode socialiste et à militer en faveur de « l'État failli » qu'était la République de Weimar. Blüher, lui, resta un monarchiste convaincu (il précisait : un « royaliste prussien ») ; il rendit même visite à l'Empereur Guillaume II en exil à Doorn aux Pays-Bas, où le monarque déchu était contraint de fendre son bois de chauffage à la hache.
Érotisme et sociétés masculines
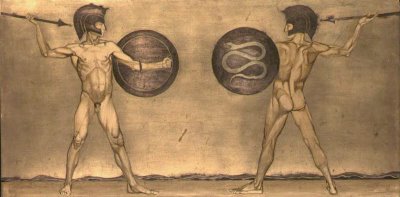 De tout son cœur, Blüher, l'outsider et l'universaliste, haïssait l'univers des doctes professeurs maniaques et méticuleux qui s'enfermaient dans leur spécialité. Il a finalement abandonné la rédaction de son mémoire sur Schopenhauer, dès qu'il s'est rendu compte qu'un tel travail n'était que superflu et inutilement pénible. Il considérait que l'université n'était plus qu'un « magasin à rayons multiples », dans lequel il allait pouvoir se servir selon son bon vouloir et ses humeurs. La monographie controversée sur le Wandervogel fut le premier coup d'éclat de Blüher. Mais il a continué à exploiter cette thématique en publiant chez Eugen Diederichs à Iéna son œuvre majeure : Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft : Eine Theorie der menschlichen Staatbildung nach Wesen und Wert (Le rôle de l'érotisme dans la société masculine : Pour une théorie sur l'essence et la valeur de la constitution de l'État humain).
De tout son cœur, Blüher, l'outsider et l'universaliste, haïssait l'univers des doctes professeurs maniaques et méticuleux qui s'enfermaient dans leur spécialité. Il a finalement abandonné la rédaction de son mémoire sur Schopenhauer, dès qu'il s'est rendu compte qu'un tel travail n'était que superflu et inutilement pénible. Il considérait que l'université n'était plus qu'un « magasin à rayons multiples », dans lequel il allait pouvoir se servir selon son bon vouloir et ses humeurs. La monographie controversée sur le Wandervogel fut le premier coup d'éclat de Blüher. Mais il a continué à exploiter cette thématique en publiant chez Eugen Diederichs à Iéna son œuvre majeure : Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft : Eine Theorie der menschlichen Staatbildung nach Wesen und Wert (Le rôle de l'érotisme dans la société masculine : Pour une théorie sur l'essence et la valeur de la constitution de l'État humain).
Ce sera son ouvrage le plus important, celui qui eut le plus de suites. La thèse de Blüher : l'Éros masculin cherche à atteindre 2 principes de socialisation opposés, d'une part celui qui repose sur la conquête sexuelle de la femme et sur la fondation d'une famille, et d'autre part celui qui vise la constitution d'une "ligue d'hommes" [Männerbund : « confrérie masculine », communauté de combat ou ligue spirituelle dont l’Éros masculin — ou homo-érotisme — est le lien, ce qui n'implique pas nécessairement sexualité]. Cette dernière forme de socialisation, dont l'érotisme est le moteur, n'a pas seulement été le pilier porteur de la culture grecque antique, mais a constitué l'assise de tout ordre de type étatique.
Dès lors, en suivant le même raisonnement, Blüher affirme que la protestation du mouvement de jeunesse bündisch et la forte valorisation des "héros masculins" dans ces milieux, où l'on s'insurgeait contre le monde bourgeois, étaient en fait des révoltes contre l'absoluisation dominante, dans ce même monde bourgeois, de la forme de socialisation visant la création de familles. Au cours de ce processus de survalorisation de la famille, l'homme se féminisait et la femme se virilisait. L'érotisme inter-masculin, décrit par Blüher, ne doit pas être confondu avec l'homosexualité, car il n'y conduit que dans des cas exceptionnels. Pourtant, comme l'affirmait Nicolaus Sombart dans les colonnes de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à l'occasion du centenaire de la naissance de Blüher, Die Rolle der Erotik... peut être considéré comme une réaction aux "procès Eulenburg" de 1907 à 1909, qui ont enclenché une persécution des homosexuels qui a éclaboussé le mouvement de jeunesse.
Blüher, Freud et la notion de refoulement
 Blüher a subi l'influence décisive de Freud, dont il avait très tôt lu les ouvrages et repris le concept de refoulement. À l'aide de cette notion-clef, il a examiné le cas du "persécuteur d'homosexuels" : celui-ci est dans le fond tout autant attiré érotiquement par la jeunesse masculine que l'homosexuel, mais ne l'admet pas et agit de toutes ses forces pour camoufler ses tendances vis-à-vis du monde extérieur en les transformant en leur contraire.
Blüher a subi l'influence décisive de Freud, dont il avait très tôt lu les ouvrages et repris le concept de refoulement. À l'aide de cette notion-clef, il a examiné le cas du "persécuteur d'homosexuels" : celui-ci est dans le fond tout autant attiré érotiquement par la jeunesse masculine que l'homosexuel, mais ne l'admet pas et agit de toutes ses forces pour camoufler ses tendances vis-à-vis du monde extérieur en les transformant en leur contraire.
Freud lui-même a publié un texte sur Blüher et sur sa théorie de la bisexualité dans la revue qu'il dirigeait, Imago. Il louait la perspicacité de son disciple Blüher : « Vous êtes une intelligence puissante, un observateur pertinent, un gaillard doué de beaucoup de courage et sans trop d'inhibitions ». Autodidacte et précepteur libre, Blüher devait finalement à Freud son existence matérielle quotidienne : comme la psychanalyse n'était pas encore ancrée dans les curricula universitaires, l'auteur de Die Rolle der Erotik... a pu ouvrir un cabinet de psychothérapeute, sans détenir ni titre ni diplôme. Il en a vécu chichement pendant toute sa vie.
Hans Blüher, chrétien et nietzschéen tout à la fois, monarchiste et révolutionnaire, était un homme bourré de contradictions. Il comptait parmi ses amis et ses interlocuteurs des intellectuels libéraux de gauche ou des pacifistes juifs comme Kurt Hiller, Gustav Landauer, Magnus Hirschfeld et Ernst Joel, ce qui ne l'a pas empêché d'écrire des ouvrages très critiques à l'encontre de la judaïté. Ainsi, par ex., son livre Secessio Judaica (1922) ou Streit um Israël : Briefwechsel mit Hans-Joachim Schoeps (Querelle à propos d'Israël : Correspondance avec H.J. Schoeps [1933]). Ces textes lui ont valu l'étiquette d'antisémite. Avec le recul, et malgré l'esprit de notre temps, cette accusation ne tient pas : il suffit, pour s'en convaincre, de lire les souvenirs autobiographiques que Blüher nous a laissés. Ils sont parus en 1953 chez l'éditeur Paul List à Munich, 2 ans avant la mort de leur auteur, sous le titre de Wege und Tage : Geschichte eines Denkers (Chemins et jours : Histoire d'un penseur).
Sous le Troisième Reich, ce penseur de la transgression a vécu retiré de tout, en préparant un ouvrage philosophique de grande ampleur qui a reçu le titre de Die Achse der Natur – System der Philosophie als Lehre von den reinen Ereignissen der Natur (L’Axe de la Nature : Une philosophie pour faire comprendre les manifestations pures de la nature, Stromverlag, Hamburg-Bergedorf, 1949, 608 p.) quand il est paru en 1949. Il avait traité Hitler d'estropié érotique.
► Michael Morgenstern, Vouloir n°134/136, 1996. (article tiré de Junge Freiheit n°6/1995)
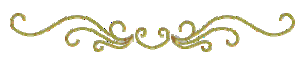
Sur l'Éros
 L’Éros n’est pas la sexualité, mais il est ce qui donne son sens à la sexualité. Sens, non pas "but".
L’Éros n’est pas la sexualité, mais il est ce qui donne son sens à la sexualité. Sens, non pas "but".
L’Éros est ce qui donne une forme et une direction aux contenus pulsionnels. L'Éros est quelque chose que les animaux ne connaissent pas, que seul l’être humain possède et qui constitue une partie de sa dignité et de son destin.
L’Éros est l’affirmation d’un être humain indépendamment de sa valeur. Cette phrase donne profondément à réfléchir. Affirmer quelqu’un "indépendamment de sa valeur" est une chose terrible, qui récuse toute mollesse et toute légèreté. Et le fait qu’une telle chose se produise non pas parce qu’on le "veut", mais parce qu’on est contraint de le vouloir, ne lui ôte rien de sa gravité. Soustraire un être humain à toute référence à la valeur, l’affirmer sans condition, jusqu’au sacrifice de sa vie s’il le faut, alors qu’il ne vaut peut-être rien en dehors de ce qu’il représente pour l’autre : voilà quelque chose d’un autre ordre que le plaisir ou le déplaisir, que le jeu ou les passe-temps. Un être qui aime, c’est-à-dire qui est touché par Éros, se trouve dans un rapport qui n’a rien à voir avec les choses contingentes, avec les pulsions entraînantes, avec les plaisirs amusants ou avec les avidités soupirantes. Il se trouve dans un rapport solennel qui ne s’origine nulle part ailleurs que dans les tréfonds de la nature humaine. Bien souvent, son destin s’accomplit dans la douleur. C’est pourquoi Éros a toujours été tenu pour sacré chez tous les peuples, indépendamment du sens ou du contenu qu’ils lui ont attribué. (...)
Dans la formulation de l’Éros comme "affirmation d’un être indépendamment de sa valeur", le terme valeur ne signifie pas un attribut particulier assigné aux choses ou aux êtres, mais l’échelle des valeurs qu’on utilise pour les mesurer. Chacun porte en lui un tel système de valeurs, qui peut être plus ou moins clair, plus ou moins profond, plus ou moins convenu ou personnel ; il n’est loisible à personne de se départir de son système de valeurs lorsqu’il aborde les êtres et les choses. Mais l'individu ne peut pas plus se soustraire à la nécessité d’affirmer certains êtres déterminés (on pourrait presque dire prédéterminés), indépendamment de leur valeur. Il peut après coup, au décours du temps, considérer que la personne correspond bel et bien à son échelle des valeurs : l’acte inaugural ne s’en est pas moins déroulé indépendamment de toute référence à la notion de valeur.
Cet acte inaugural implique une affirmation sans condition de deux personnes qui se saisissent mutuellement et sont saisies par leur être réciproque. Cette affirmation est perçue comme sainte et nécessaire, et peut se trouver en contradiction avec les exigences du système de valeur des intéressés. Pour reprendre l’image des deux moitiés séparées de l’être humain originel telles qu’Aristophane les a décrites dans le Banquet (de Platon), chacune des deux moitiés ne sait pas qui est l’autre au moment où elles se rencontrent, mais elles rejetteraient toute dérobade ou toute référence à une quelconque notion de valeur comme un péché à l’encontre de l'Amour.
(p. 226-227)
◘ Éros et Logos
À l'époque de l'érudition livresque et surtout de l'esprit de périphérique, on aime à désigner la personne fortement animée par Éros comme "malade d'amour" (érotomane). L'Éros est donc perçu comme une maladie, et n'est considéré comme "sain" que l'homme mesuré, savant, qui ne se laisse jamais déconcerter. La position centrale de l'esprit est la connaissance, c'est-à-dire ce procès par lequel on peut protéger les phénomènes passagers en les enfermant dans des conceptions scientifiques. La connaissance, c'est l'accent mis sur le général (avec le pathos requis : "l'éphémère"). Même quand il faut reconnaître quelque chose qui, de par sa nature, ne peut être qu'unique, par ex. un homme singulier et précis, l'acte de connaître ne se déroule que sous le primat de la généralité affichée par le concept. L'Éros procède tout à fait inversement. Sa position centrale est celle de l'amour d'une personne pour une autre : dans cet acte, avec le même fanatisme, avec la même constance et la même coercition, c'est la singularité qui est affirmée. Et c'est seulement parce que l'acte d'amour est unique et singulier, qu'il peut être pleinement accepté. L'Éros est la philosophie du particulier.
Mais où est le juge qui puisse décider ce qui est "juste"... ? On pourrait tout aussi bien dire, avec le même aplomb qu'on juge les aimants "malades", affirmer que tout homme qui ne se préoccupe que de connaissance est "malade". De ce fait, l'esprit aussi pourrait être malade. Qui pourrait s'opposer à cette affirmation, avec un langage plus clair ?
Éros et Logos sont face à face dans un duel à mort, si du moins on les pousse jusqu'à leur logique ultime en les maintenant séparés. Ces deux dieux forment en fait le destin de l'humanité, en eux se reflète toute la conflictualmité de l'existence. Il n'y a qu'un seul lieu où Éros et Logos se mêlent continuellement, s'unissent et font disparaître cette conflictualité : dans l'art. Une œuvre d'art détient la capacité de répéter ce processus de disparition du conflit en nous, car elle porte la réconciliation en elle. Tandis que nous, hommes en lutte permanente, sommes déchirés sans cesse entre ces deux puissances, le message de l'art fait de nous des récepteurs hissés à un niveau autre, qui fait s'évanouir tous nos intérêts, du moins nous fait oublier les choses qui nous excitaient immédiatement avant cette réception.
Les deux composantes de l'art sont parfaitement perceptibles dans chaque œuvre, mais jamais au point que l'on puisse dire : "ici est Éros" et "ici est Logos". Non : ils sont tous deux présents, inséparables, actifs dans leur unisson.
(p. 235-237)
► Extraits de Die Rolle des Erotik in der männlichen Gesellschaft, Diederichs Verlag, Jena, 1917. [cf. ce commentaire de texte]

◘ Textes de Blüher disponibles :
- Wandervogel, Histoire d'un Mouvement de jeunesse, éd. Les Dioscures, 1994 [seul le vol. I est paru]
- « La catastrophe de l'Ordre du Temple » [extrait du tome I de : Rôle de l’Érotique dans la Société masculine : Théorie de l’instauration des États selon leurs caractéristiques et leur valeur] et « Famille et Société masculine » in Palaestre n°1, dossier « Éros garçonnier. Famille et Société masculines », éd. Les Dioscures, Paris, 1994, 228 p.
- Pour une Renaissance de l’Académie platonicienne, suivi de : Empédocle ou le Sacrement de la Mort volontaire, Paris, L’Avrillée, 1998 (tr. : François Poncet en coll. avec Michel Meigniez de Cacqueray). Voir aussi addenda.
- L'homosexualité, l'inversion et la perversion, éd. Walter Beckers, coll. "Le Monde De La Sexologie", 1969 (trad. de Studien zur Inversion und Perversion : das uralte Phänomen der geschlechtlichen Inversion in natürlicher Sicht)
- Œuvres en allemand
◘ Études sur Blüher :
- « Hans Blüher et l'utopie du Männerstaat », André Gisselbrecht in Revue d'Allemagne n°3/XII, juil.-sept. 1990.
- La Sexologie politique de Hans Blüher, Luc Saint-Étienne, coll. Point de vue/GRECE, 1994, 30 p. *
- La Révolution conservatrice en Allemagne 1918-1932, A. Mohler, Pardès, 1993, pp. 574-618.
- Site-hommage : Biographie, bibliographie allemande (traduite en français), textes en ligne et sélection d'images.
- Irrationalisme et humanisme : critique d'une idéologie impérialiste, T. Schwarz, 1944, cf. ch. I
- Autorenportrait Hans Blüher (M. Lichtmesz). cf. aussi « Der Rebell, der weiß, um welche Tradition es geht » [de]
- Hans Blüher and the Wandervogel [en]
* : Cf. cette recension : DES NAZIS ET DES HOMMES
Au sein de la pléthorique historiographie sur le national-socialisme, rares sont les témoignages, du moins traduits en français, relatifs aux premières années du régime et à sa consolidation. Parmi eux, celui de Nicolaus Sombart, fils du grand économiste Werner Sombart, s'imposera assurément comme l'un des plus originaux et des plus importants.
Procédant par touches impressionnistes, mêlant l'anecdote à la réflexion, le portrait à la description sociologique, choses vues et vie rêvée, cette chronique d'une jeunesse berlinoise, qui couvre les années 1933-1943, restitue avec plus d'acuité que bien des ouvrages érudits l'atmosphère d'une époque. Mais ce livre apporte aussi un éclairage fort intéressant sur plusieurs figures et différents aspects de la Révolution conservatrice, en particulier sur l'une de ses 5 composantes essentielles selon la classification d'Armin Mohler : les Bündischen, qui incarnaient la tendance « ligueuse » du Mouvement de jeunesse.
Au sujet de son père (mort en 1941), le témoignage de Nicolaus Sombart, plein de piété filiale mais étranger à tout souci apologétique, fait revivre un mandarin allemand, qui tranchait cependant sur ses collègues par un cosmopolitisme culturel de grande classe. Austère et mondain à la fois, recevant chez lui ambassadeurs, écrivains et artistes, entretenant un vaste réseau de relations dans la grande bourgeoisie et la noblesse, le vieux savant ici évoqué n'a plus grand-chose du rote Professor, qui, à en croire certains de ses exégètes « radicaux », serait resté toute sa vie un farouche ennemi du capitalisme. Pour son fils, Werner Sombart était plutôt l'un des héritiers « de la bourgeoisie nationale-libérale dupée par Bismarck et qui, exclue de toute participation au pouvoir politique, cherchait dans la science un substitut qui leur permettrait d'assouvir ses aspirations à occuper des postes de décision ».
N. Sombart consacre aussi de belles pages à Carl Schmitt, très lié à son père et qu'il décrit comme un homme énigmatique et fascinant. Il y a là des observations fines sur le langage schmittien, à base d'images mythiques, sur l'admiration de Schmitt pour Disraeli, ou encore sur la façon dont Schmitt interprétait en privé l'histoire de l'Occident comme une grande querelle entre les tenants de l'utopie (juive) et ceux de l'eschatologie (chrétienne).
Pour le fils de l'illustre sociologue, qui s'appuie en l'occurrence sur sa propre appartenance, brève mais intense, à quelques formes tardives du courant bündisch, l'importance de la Révolution conservatrice doit être clairement reconnue. Il va même jusqu'à écrire à son sujet : « Avec le regard de l'ethnologue moderne, on peut voir ici le trait caractéristique d'une "identité culturelle" autochtone, de ce qui était spécifiquement et strictement "allemand". Ce n'est d'ailleurs pas seulement une possibilité, mais une obligation. »
MÄNNERBUND ET ESPRIT ALLEMAND
Considérée comme reflétant le cœur même de l'identité allemande, la Révolution conservatrice fait l'objet, de la part du fils de Sombart, d'une interprétation sans doute discutable et réductrice, mais qui a le mérite de conférer un principe d'unité et de cohérence à un phénomène particulièrement éclaté. Pour lui, les différents systèmes spéculatifs de la Révolution conservatrice « s'inspiraient tous du même modèle fondamental. [...]. Ils masquaient autre chose, un élément constitutif, exclusif, mystérieux et spécifique à cette pensée. Qu'est-ce, en effet, que l'antipode de cette société égalitaire, libertaire et démocratique qu'ils abhorraient ? L'association masculine, le Männerbund élitiste. L'esprit du Männerbund est le trait commun et spécifique de cette contre-culture allemande. Cela lui donne sa teinte si particulière, partout où elle émerge : son pathos, sa charge émotionnelle. Cela distingue la société allemande de toutes les autres sociétés patriarcales de l'Occident. C'est cela – conclut le fils de Sombart – et non pas l'homosexualité en tant que telle, qui constitue le vice allemand. »
L'esprit du Männerbund, de la « société masculine », serait donc une structure anthropologique propre à l'identité allemande, en même temps que la vraie clé permettant de saisir pourquoi l'Allemagne – ou, plutôt, ses classes dirigeantes – ont si difficilement accepté la modernité : « Je suis persuadé – poursuit N. Sombart – qu'il faut voir dans la persistance du syndrome du Bund masculin le facteur décisif, sans doute, de la résistance acharnée, de la passion avec laquelle les hommes allemands réagissent au "projet de la modernité". »
Tout au long de sa chronique, l'auteur, il est vrai, apparaît hanté par le thème de l'homosexualité – une homosexualité théorisée, esthétisée, objet d'ironie même, mais aussi, on le comprend bien, assumée sur tous les plans. Cela pourrait évidemment favoriser chez certains lecteurs un rejet systématique des affirmations de N. Sombart sur le « noyau » de la Révolution conservatrice. A priori, en effet, on n'est guère tenté de faire crédit à quelqu'un qui écrit avec le plus grand sérieux : « Puis-je rappeler ici que l'enthousiasme français pour le Troisième Reich – cela vaut aussi pour la Collaboration – fut pour l'essentiel l'affaire d'une coterie d'hommes aux penchants homosexuels ? »
MÄNNERBUND
Mais un tel rejet serait simpliste, trop commode aussi. Car N. Sombart sait de quoi il parle au sujet du courant bündisch. Ainsi quand il évoque le cas de Alfred Schmid (1899-1968), chimiste suisse, fondateur du Corps gris, « le plus exclusif et le plus élitiste » des Bünde de jeunesse, qu'A. Mohler cite à plusieurs reprises dans les pages de son travail magistral réservées à la caractérisation du courant bündisch (pp. 192-201 de la tr. fr.). Auteur d'une brochure, Aufstand der Jugend [1932, texte publié sous le nom de Fred Schmid, repris dans : Erfüllte Zeit : Schriften zur Jugendbewegung, herausgegeben von der Professor Dr. Alfred Schmid-Stiftung Altdorf/ Uri, Schweiz, Erstausgabe Südmarkverlag Fritsch Heidenheim, 1978, 160 p.], qui exerça une certaine influence au sein des ligues de jeunesse, Schmid incarnait, d'après N. Sombart qui le connut personnellement, l'archétype du dandy, et son homosexualité n'était pas que platonique. Il semble bien que l'on puisse en dire autant d'autres figures du courant bündisch.
L'un des principaux théoriciens de ce courant fut Hans Blüher (1888-1955), dont le jeune N. Sombart lut, évidemment, l'essai sur l'Éros intermasculin, Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft (« Le Rôle de l'érotisme dans la société masculine »), ouvrage en 2 volumes parus en 1917 et 1919. « Selon Blüher – écrit Armin Mohler –, l'Éros intermasculin est présent, en chaque homme, à des degrés d'intensité divers ; c'est seulement dans une faible minorité de cas qu'il aboutit à des rapports sexuels entre hommes, en l'occurrence lorsqu'il l'emporte trop fortement sur l'Éros qui vise la femme. »
Il est désormais possible, pour les non-germanistes, de se faire une idée des thèses que défendait Blüher, dont l'œuvre ne se réduit pas à une réflexion sur l'homosexualité. Plusieurs de ses textes — « Famille et société masculine » (un résumé de Die Rolle der Erotik), des extraits de sa correspondance avec Milla von Prosch, des « Apophtegmes » et « La catastrophe de l'Ordre du Temple » — viennent en effet de paraître dans la premier numéro de la revue Palaestre.
On n'est pas obligé de suivre « les routes du Saint Ordre mâle » cher à Montherlant et aux rédacteurs de la revue, ni de goûter l'iconographie pédérastique de Palaestre, pour reconnaître le réel intérêt de ce dossier sur Blüher, dont les textes sont bien traduits et intelligemment présentés. D'après les responsables du dossier, Blüher a résumé de la façon suivante sa thèse centrale : « Outre le principe de socialisation qu'est la famille, et qui trouve sa force dans l'éros hétérosexuel, un second principe est à l'œuvre dans l'espèce humaine, celui de la "société masculine", lequel trouve sa force dans l'éros intermasculin, et s'exprime dans les communautés masculines (Männerbünde). C'est de la nécessaire coexistence conflictuelle du second principe avec le premier que se dégage ce qui conduit l'homme à l'État. »
Ainsi exposée, cette thèse n'a rien d'aberrant et pourrait même éclairer utilement le fonctionnement d'un certain nombre de sociétés indo-européennes. Mais l'impression générale que l'on retire des informations sur la Révolution conservatrice contenues dans le livre de N. Sombart et dans Palaestre, c'est celle d'un phénomène strictement inexplicable en dehors du monde germanique, totalement impossible à exporter, du moins en ce qui concerne sa composante bündisch.
► Éric DELCOURT, éléments n°80, 1994.
♦ Nicolaus Sombart, Chronique d'une jeunesse berlinoise, Quai Voltaire, 1992, 370 p.
♦ La Sexologie politique de Hans Blüher, Luc Saint-Étienne, GRECE, 1994, 30 p.
♦ Revue Palaestre n°1, 1er trimestre 1994, 228 p.

Pièces-jointes :
Quand la jeunesse allemande se rebelle :
Hans Blüher contre l'ordre bourgeois
 « On les voyait s'enfoncer dans la sombre bruyère, à travers les mornes landes sablonneuses, barbarement accoutrés d'un costume fort maltraité, droits sous le lourd sac à dos. Méconnaissables, ils se regroupaient la nuit autour des feux de camp, échangeaient des propos mêlant rancœur, entrain et mélancolie, qu'ils n'avaient jamais pu tenir auparavant. »
« On les voyait s'enfoncer dans la sombre bruyère, à travers les mornes landes sablonneuses, barbarement accoutrés d'un costume fort maltraité, droits sous le lourd sac à dos. Méconnaissables, ils se regroupaient la nuit autour des feux de camp, échangeaient des propos mêlant rancœur, entrain et mélancolie, qu'ils n'avaient jamais pu tenir auparavant. »
Ainsi se présente dans les campagnes allemandes le mouvement des Wandervögel ("Oiseaux migrateurs"), créé en 1896 par des lycéens de Steglitz, dans la banlieue de Berlin. Voué à la randonnée et au ressourcement dans la nature sauvage, il prend son essor en pleine industrialisation galopante voulue par le Reich wilhelminien. Ce mouvement de jeunesse est tout à la fois une révolution contre la culture des parents, une échappée loin de l'autorité du corps enseignant, un besoin d'autonomie libératrice. « Les Wandervögel sont le plus noble, le plus pur, le plus sauvage assaut romantique que la jeunesse ait jamais donné en rupture avec la génération précédente. C'était un coup de bélier des forces de la nature, une régénération, un violent décapage de l'esprit ». Alors que le mouvement est tout jeune encore, s'y joint le jeune Hans Blüher, né en 1888, fils d'un pharmacien. Les Wandervögel ne sont qu'une quinzaine ; il seront plusieurs dizaines de milliers à l'approche de la Première Guerre mondiale. À 24 ans seulement, Blüher racontera leur histoire en publiant Wandervogel, Histoire d'un Mouvement de jeunesse, controversé mais admiré. C'est le point de départ d'une œuvre où se mêlent littérature, philosophie et politique, féconde et variée au point que dans l'ouvrage de référence fondamental sur les tendances nationalistes de l'époque : La Révolution conservatrice en Allemagne 1918-1932 par Armin Mohler, Blüher [p. 415-419] figure (en compagnie d'Oswald Spengler, Thomas Mann, Carl Schmitt, Ernst Jünger et son frère) dans la liste de la demi-douzaine d'« auteurs essentiels dont l'œuvre excède toute classification ».
Après le lycée, Blüher étudie la philosophie, la philologie, la physique et les sciences naturelles aux universités de Bâle et de Berlin, mais il sera renvoyé de l'université sans diplôme suite à la publication de plusieurs textes polémiques, notamment Ulrich von Wilamowitz et l'Esprit allemand (1916). Wilamowitz, alors recteur de l'Université, ayant présenté les Grecs avec une étroitesse de vue petite-bourgeoise, l'étudiant Blüher se permit d'écrire : « Si j'étais un Grec de l'Antiquité redescendu sur terre et que j'entendisse M. Wilamowitz tenir de tels propos sur mes sentiments fondamentaux, je préférerai causer par signes avec les charretiers allemands, plutôt que d'échanger un seul mot de grec avec ce monsieur ».
L'expérience vécue par Blüher dans le Wandervogel l'amène à se faire le théoricien des contributions respectives de la famille et de la société masculine à la construction de l'État (Le Rôle de l'Érotique dans la Société masculine, 1917 ; réflexion qui avait été commencée dans son histoire du Wandervogel). On peut les résumer comme suit : les institutions de l'État, purement masculines, sont le résultat d'un éros spécifique, d'une impulsion à vouloir vivre ensemble qui n'implique pas forcément la libido sexuelle. Les mâles d'une collectivité sont ainsi poussés à se retrouver à part de la famille, pour faire œuvre commune dans une entente tacite et informelle, en sorte d'apporter une âme et un sens au destin de cette collectivité. Au contraire, la famille, cellule tournée vers ses propres intérêts de survie, a un but utilitaire : assurer matériellement la continuité des générations. Par ces travaux, Blüher accède à la notoriété : Gottfried Benn et Theodor Daubler entrent en relation avec lui. Rainer Maria Rilke le découvre et l'admire.
À la fin de la guerre, l'effondrement de l'Allemagne est concomitante de la victoire de la révolution bolchevique en Russie. Certains préparent la même révolution en Allemagne. Le royaume de Prusse, origine de l'Empire allemand, n'existe plus en tant que nation politique. Les retentissantes attaques menées par Blüher contre la morale christiano-bourgeoise amènent l'intelligentsia rouge à le solliciter. Blüher prend conscience que les doctrines de la gauche drainent des foules qui représentent un matériel humain marqué au mauvais coin, et oppose une fin de non-recevoir par une simple carte postale. Il a choisi son camp, et décide de s'engager politiquement.
À Munich, il renoue avec la Jeunesse libre-allemande, créée en 1913 par une action commune de groupes principalement Wandervogel afin de faire vivre une culture propre à la jeunesse. Il entreprend une tournée de conférences qui a pour titre : Empire allemand, Judaïsme et Socialisme. « À cette époque, se rappellera-t-il plus tard, se rassemblait autour de moi une jeunesse qui avait de la prestance et portait souvent l'uniforme, des garçons bien nés, au cœur bien placé ». Il mobilise pour la contre-révolution, et participe aux Corps francs, troupes de volontaires levées pour défendre l'Allemagne à l'intérieur et aux frontières, alors précisément que la défaite avait dispersé l'armée et préparé le terrain au bolchevisme.
À la même époque, Blüher juge insuffisant l'enseignement des universités, « qui ne sont plus que de cossus grands magasins de l'esprit, où l'on se procure à prix d'argent un article de qualité correspondante ». Leur philosophie, constate-t-il, n'est plus une question de vie et de mort. Elles ne sont plus à la mesure de l'homme supérieur. Elles sont plus par elles-mêmes une cause. Blüher, au contraire, entend faire de l'aristie, c'est-à-dire de la préexcellence humaine qui n'est pas une supériorité de degré, mais d'essence, la valeur suprême d'un nouvel enseignement : il projette de fonder une académie élitaire inspirée de celle de Platon, et en expose les principes lors de réunions publiques.
En 1918, il rencontre une jeune fille des troupes féminines du Wandervogel, surnommée par lui Peregrina – la pélerine –, mystique et inspirée. C'est à son instigation que Blüher met en chantier ses ouvrages christiques (notons que le christianisme, chez Blüher, s'écarte fortement de l'interprétation éthique et spirituelle que lui veulent les Églises, en sorte de revenir, en un certain sens, à une vision antique qui déifie la nature humaine). Peregrina sera le grand amour féminin de sa vie. Néanmoins, elle le quittera au bout de 2 ans. Plus tard, Blüher épousera une femme médecin. Ils auront un fils.
En 1924, Blüher s'installe à Berlin-Hermsdorf, où il exerce comme psychothérapeute, et continue son œuvre littéraire. L'année suivante, il rédige un traité médical sur l'effet des névroses (Traité de l'Art de guérir), et sera le seul non-médecin admis au sein de la Société allemande de Psychothérapie.
Il fréquente régulièrement le Deutscher Herrenklub d'Heinrich von Gleichen, club politique qui relève directement du mouvement des Jeunes Conservateurs de Moeller van den Bruck et dont le but est « la fondation et l'affermissement d'une élite politique conservatrice et anti-réactionnaire ». Dans ce club on croise, par ex., Hindenbourg, le futur chancelier von Papen, des membres de la famille impériale, des hauts dignitaires religieux.
En 1934, le parti national-socialiste interdit à Blüher de publier. Ce silence forcé lui donne le loisir de commencer à rassembler la matière de son œuvre majeure : L'Axe de la Nature, qui paraîtra en 1949 (la Nature, pour Blüher, n'est pas la collection organisée des réalités objectives, mais le principe qui les organise. Dans cette vision, pour ne prendre qu'un exemple, la religion n'est plus un fait de l'histoire des hommes, mais devient un produit de la Nature). Blüher y développe une philosophie qui se réfère à Platon, Kant, Schopenhauer et Nietzsche (« il y a une morale de la substance, donc de l'être, et une morale des petites gens »). Sa métaphysique de la nature n'est accessible qu'à une minorité qu'il appelle « la race primordiale ». Dans la hiérarchie du savoir, les sciences exactes et les sciences naturelles ne sont, par leur objet, que des accessoires utiles à une compréhension immédiate limitée des êtres.
À sa mort en 1955, Blüher légua la totalité de son fonds documentaire, ainsi que les droits sur son œuvre, aux archives de l'État de Prusse, supprimé d'un trait de plume par les alliés en 1947.
• LES DEUX PILIERS DE LA SOCIÉTÉ : Blüher voit 2 principes agissants dans l'élaboration de la société : d'une part la disposition de l'individu à fonder une famille, qui ressortit à l'éros entre l'homme et la femme, et d'autre part la disposition des hommes à s'assembler en ligues, en corps constitués, qui ressortit à l'éros inter-masculin et fonde l'État.
• L'ÉROS FÉMININ : Pour Blüher, il ne fait pas de doute qu'il y a un antagonisme irréductible entre l'homme et la femme. La femme est irrévocablement subordonnée à l'homme, mais, pour rester fidèle à ce qu'elle est, elle doit tourner la loi de l'homme : « La femme est tout à la fois soumise et abandonnée à elle-même ». Être à la merci de l'homme est la forme a priori de l'éros de la femme. Les revendications en faveur de l'égalité des sexes s'élèvent quand l'homme abdique sa suprématie régalienne pour se travestir en bourgeois, car la femme refuse d'être sous la coupe d'un tel homme, dont l'empreinte irrite la femme, dont les lois qui consacrent l'allégeance de la femme la blessent. Blüher évoque par une image ce qui oppose l'éros de l'homme et celui de la femme : « L'éros masculin darde comme un rai de lumière jaillissant qui détermine les objets qu'il frappe à briller de leur propre éclat. L'éros masculin veut saisir, posséder, perpétuer. L'éros de la femme est un calice : elle a besoin de recevoir à pleins bords ». De même, chez l'homme et chez la femme, l'enfant ne répond pas aux mêmes attentes. Chez la femme, le désir d'enfant n'est pas la conséquence d'une pulsion de reproduction, d'une volonté de procréation, mais comble une satisfaction d'être. L'amour maternel n'entretient pas de rapport avec la valeur de l'enfant. L'homme, de son côté, est voué à la réalisation d'une œuvre dont l'accomplissement lui échappe sans cesse. Il est donc poussé à la continuation de soi, à se prolonger vers l'extérieur. Mu par une pulsion sexuelle et une volonté de procréation, l'homme tend, au moyen de l'héritier, vers l'achèvement de l'œuvre ; ce qui est hors de portée pour l'éternité.
• UNE THÉORIE SACRALE DE L'ÉTAT : L'État a pour lui la permanence des valeurs, il est ce qui dure, ce qui est porteur d'histoire, à l'opposé de la simple communauté humaine, jouet de toutes les fluctuations de la psychologie collective. La figure d'un monarque incarne le mieux le principe qui maintient l'État. Comme système de gouvernement, Blüher préconise un bicamérisme (inspiré par les chambres haute et basse de la Prusse). La chambre basse, « claire expression de la volonté du peuple », dispose sur les questions matérielles. Elle se recrute et vote ses résolutions comme l'ordinaire des assemblées démocratiques. La chambre haute, de son côté, rassemble une élite naturelle qui engage le destin de la communauté, elle porte les valeurs qui pérennisent l'État. La chambre haute ne cherche pas à démontrer, elle se présente en exemple. Contre les théories du socialisme et du libéralisme, qui placent les valeurs supérieures de l'humanité hors de l'État réduit au rôle d'un organisme de gestion économique, Blüher développe une théorie sacrale de l'État, lequel a pour mission de pousser les meilleurs à rencontrer leur destin.
• LE RÔLE DE L'ÉDUCATION : Par ailleurs, dans le même refus de soumettre l'homme à l'utilitaire, Blüher tient que tout système valable d'éducation doit, d'une part, prendre conscience que l'enfant et l'adulte ne vivent pas dans le même monde, et, d autre part, accepter qu'on n'instruise pas les enfants en vue d'une conjoncture socio-économique future, mais pour en tirer le meilleur. L'institution scolaire actuelle, constate Blüher, « est l'instrument d'une collectivité qui entend gouverner l'homme neuf dès la naissance. On contraint l'enfant à s'ajuster aux doctrines d'État qui prévalent. [...] Le contenu de l'enseignement est une incitation à des pensées contraires à celles qui s'éveillent naturellement dans l'adolescence ». En revanche, l'école que veut Blüher doit procurer « ce que faire découvrir est le premier souci d'un ami : les clefs de la liberté ». Pour que passent les valeurs vivantes entre le maître et l'élève, il est nécessaire qu'existe entre eux une relation personnelle forte. Il est donc logique que Blüher s'intéresse de près à la Libre Communauté scolaire de Gustav Wyneken, qui fleurit à ce moment-là en Thuringe. École tout à la fois libertaire, car on cherche à y soustraire l'enfance de la mainmise des adultes et des enseignants patentés, et antidémocratique, car le pouvoir s'y exprime à travers des regroupements d'élèves et de maîtres par affinité et maturité. Sur les questions économiques, Blüher se sent proche de Silvio Gesell (auteur d'une théorie monétaire d'après laquelle les billets de banque doivent être revalidés périodiquement par une estampille pour éviter la thésaurisation).
• SECESSIO JUDAICA : Les idées de Blüher sur le judaïsme sont exprimées en particulier dans Secessio Judaica (1922). Blüher sent dans les Juifs « sécularisés » confondus dans la société non sémite le fer de lance du matérialisme, du marxisme, du postulat qu'un homme en vaut un autre. Le peuple juif – « la race sacrale juive » dit Blüher –, élu à dessein de donner naissance à l'annonciateur de la Nouvelle Alliance (Jésus-Christ), a été atteint dans son essence et brisé dans son destin pour avoir refusé et tué le Messie. Cette malédiction explique la particularité du peuple juif : une volonté de disparaître à la vue, en sorte de se présenter par force comme des hommes des peuples chez qui ils se trouvent. Or la judéité, au contraire de la judaïté, est inadmissible. Cette concitoyenneté de forme, introduisant dans le génie des peuples une hétéronomie, a un effet décomposant qui excite par contre-coup l'antisémitisme, lequel, dans l'avenir, poussera les Juifs à faire sécession pour se retrouver en communauté. Et comme aboutissement : la création d'un État hébreux. Blüher rappelle que Chaïm Weizmann, futur premier président de la république israélienne, constatait tristement : « Partout où nous allons, nous apportons avec nous l'antisémitisme dans nos bagages ».
• UN HOMME SANS CONCESSION, MAIS D'INFLUENCE : Malgré les éloges qui le couvrent, Blüher est resté toute sa vie la cible de violentes prises à partie, et le restera toujours : son franc-parler, son refus de transiger dans l'exposé de ses idées, son style même, personnel et sans concession à la vulgarisation, ne permettent pas qu'il soit le mentor d'un parti d'ouverture. Il reste que d'après des chiffres officiels, Blüher comptait parmi les vingt auteurs les plus lus en Allemagne entre 1912 et 1933. Et Guillaume II, à qui Blüher rendait visite en Hollande et avec qui il entretenait une relation épistolaire, lui écrivit en 1929 : « Mon cher Blüher, votre réflexion produit au jour les mobiles souvent indiscernables mais déterminants des affaires humaines. En vous lisant, je me suis dit : Voilà donc ce qui me conduisait »
• JUS PRIMAE NOCTIS : Très peu comprennent la terrible responsabilité de l'homme qui déflore une jeune fille. Avec quelle facilité désèchent les femmes qui ont confié la fleur de leur jeunesse à un homme bas et vide ! Mais quel resplendissement exalte le corps féminin où en premier quelque âme noble a imprimé son amour ! Il devrait y avoir une caste d'hommes de haut rang – sacerdotes amoris et humanitatis –, d'âmes pures, qui, initiés par la connaissance de la vie et des fins dernières, déflorassent les jeunes femmes.
• COMMUNISME : Daimonion, au secours ! Le communisme, de quelque façon qu'on l'interprète, qu'on l'éclaire ou qu'on lui donne forme, signifie d'avoir en commun des biens matériels, principalement des terres et de l'argent. Maintenant, soyons sérieux, et chacun à part soi : avec qui partage-t-on spontanément des biens, sans raisonner ? Avec combien de personnes ? Je compte : trois ou quatre, à peine ! Et ce sont toujours ceux à qui nous lie un destin érotique. Une ou deux femmes, les enfants, peut-être quelques amis. Au-delà, on commence à y regarder de plus près. C'est précisément là l'erreur de calcul du communisme. Car hors de ce cercle priment l'individualité et la propriété privée. Escroquer autrui est pardonnable, surtout si c'est conscient. Mais il est méprisable de se voler soi-même. Laissez parler ces bienfaiteurs de l'humanité et leur sentimentalisme de bibliothèque rose ! L'humanité est dure, brutale, vindicative et perfide. Prétendre à quelque chose de commun avec elle rend vulgaire.
• DE LA MORT VOLONTAIRE : Honte à toi, bourgeois ! Il y a un souverain Commandement pour la mort volontaire ! Un sacrement par la mort qu'on se donne à soi-même ! Malheur à toi, ô homme ! Il n'est pas impossible que tu te supprimes. Ce peut être au moment de ton plus grand bonheur, afin de laisser de toi une image non flétrie. Sinon, ce sera pour assumer le fardeau d'une expiation impitoyable, subir – qui sait ? – des renaissances au monde pires encore.
► Vincent Malecki, Résistance ! n°5, 1998 (article remaniant quelque peu la notice biographique en exergue de l'édition de Pour une Renaissance de l'Académie platonicienne, p. 7-17).
[ci-haut : buste de Joachim Karsch]

|
DOSSIER HANS BLÜHER ET LES WANDERVÖGEL |
◘ 1) Veit A. Walkenhove, Gaie France n°8 (déc. 87 – janv. 88). Présentation : Au début du siècle, la jeunesse allemande s’affranchit du joug des curés et des instituteurs. Sac-à-dos sur l’épaule, ils parcourent le monde en quête de nouvelles valeurs. Les Wandervögel ont leur théoricien : Hans Blüher. À travers ce dossier, l’esquisse de ce qui pourrait être le sens et la fonction des amours inter-masculines.
HANS BLÜHER ET LE MOUVEMENT WANDERVOGEL
 Le 17 février 1988 marquera le centième anniversaire de la naissance d'un homme dont toutes les formations idéologiques ont tenté d'étouffer les idées. Lui-même se situait à l'extrême-droite. Son mérite : la découverte du rôle de l'érotisme dans la société masculine. Hans Blüher nous révèle le sens et la fonction de l'amour homosexuel. Si nous brisons aujourd'hui le tabou qui porte sur son œuvre, c'est moins dans un esprit de commémoration que dans la conviction que les travaux de Blüher sont essentiels à la conception d'une vision que nous définirions de nouvelle droite : H. Blüher voyait la condition et le fondement de toute culture dans l'érotisme inter-masculin.
Le 17 février 1988 marquera le centième anniversaire de la naissance d'un homme dont toutes les formations idéologiques ont tenté d'étouffer les idées. Lui-même se situait à l'extrême-droite. Son mérite : la découverte du rôle de l'érotisme dans la société masculine. Hans Blüher nous révèle le sens et la fonction de l'amour homosexuel. Si nous brisons aujourd'hui le tabou qui porte sur son œuvre, c'est moins dans un esprit de commémoration que dans la conviction que les travaux de Blüher sont essentiels à la conception d'une vision que nous définirions de nouvelle droite : H. Blüher voyait la condition et le fondement de toute culture dans l'érotisme inter-masculin.
LA CONFRÉRIE
À la dernière foire du livre de Francfort, l'éditeur des œuvres complètes de Gœthe et de ses écrits personnels, une collection de 143 volumes pour bibliophiles, reconnaissait lui-même : « Personne n'a besoin de Gœthe pour vivre ou pour survivre... Il n'est pas indispensable à la vie, il n'est pas indispensable à la survie ». L'objet de ce dossier est un auteur allemand bien moins connu, mais dont nous pouvons dire à coup sûr qu'il est indispensable à notre vie, à notre survie. Il l'est en tous cas pour tous ceux d'entre nous qui aspirent à retrouver la signification primordiale du culte de la virilité. Pour notre auteur, l'érotisme inter-masculin exprime l'ultime seuil jamais atteint par l'expérience humaine. En cela, son œuvre est capitale pour notre culture.
Son idée est la suivante : À la base de la culture, et donc de l'élément clef qui différencie l'homme de l'animal, il y a le lien érotique entre les meilleurs hommes et adolescents d'une société. Ce lien naturel, qui fonde la « confrérie » élitaire, pédagogique et guerrière, simultanément militante et spirituelle des garçons et des hommes est l'élément constitutif et régénérateur qui crée, anime et préserve l'État et la Nation au même titre que les religions, les philosophies et idéologies, les styles d'art et dans une certaine mesure les écoles scientifiques.
Plus de 2.000 ans après la rédaction du Banquet par Platon, un homme redécouvre le génie qui éclaira, en cette époque qui vit le passage du classicisme grec à l'hellénisme, tout l'horizon humain et son existence en tant que fait historique. Ce qui pouvait apparaître alors comme une vision éphémère et partielle, mêlée à des interprétations, des commentaires et des postulats bien subjectifs se transforma au début du siècle en Allemagne en une vue du monde globale et finie, en une philosophie de l'État, en un système individuel psycho-social et socio-politique : l'enseignement du Bund, la logique de la confrérie. À la base et au centre de cet enseignement, un auteur victime d'une veritable conspiration du silence.
UNE ADMIRATION SANS BORNE DE L'ÉLITE INTELLECTUELLE
Cet auteur se nomme Hans Blüher. Né le 17 février 1888 dans une petite ville de Silésie, il passe toute sa vie à Berlin où il s'éteint le 4 février 1955. Le 100ème anniversaire de sa mort passera probablement inaperçu, bien que ses adversaires ne soient pas parvenus à étouffer la trace de cet idéologue de génie de l'extrême-droite européenne.
Ce contre-révolutionnaire ultra-conservateur issu de la Garde Blanche, royaliste et partisan du principe de l'aristocratie féodale, dont on dit en résumant très grossièrement la pensée qu'il voyait dans les rapports homosexuels la base de la constitution de toute élite et donc la condition sine qua non de ta culture étonne dans une époque par ailleurs si totalement soumise aux opportunismes successifs des courants politiques dominants.
Pour les rares personnes réellement non-conformistes par contre, la référence à ce personnage était et reste une carte de visite, une marque laissant présager l'appartenance à la véritable élite intellectuelle européenne. Lorsque dans le n°4 de Gaie France, Alain de Benoist évoque pour la première, fois dans notre magazine le nom de Blüher, indiquant la nécessité d'une étude du complexe homosexuel à la lumière des œuvres de Blüher sur la confrérie, il est en illustre compagnie.
Gottfried Benn déclara une admiration sans borne pour cette œuvre, et Rainer Maria Rilke écrira peu avant sa mort à Blüher : « Une confiance illimitée m'envahit lorsque je vois tant d'éléments méconnus transmis avec une telle force, une telle maîtrise ». Rilke lui déclarera son admiration étonnée et chaleureuse. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'Alexis Carrel prendra connaissance de l'œuvre de Blüher, à une époque où la Gestapo a depuis bien longtemps réduit ce dernier au silence. Le célèbre médecin, philosophe et prix Nobel écrira en mai 1943 : « Au sujet de l'inversion sexuelle, on ne pourra sans nul doute découvrir jamais davantage ni dire plus ou mieux que le savant berlinois. Aussi je n'hésite pas à me rallier sans réserve aux thèses de Blüher. »
Un jugement que partagera parfois la presse. Le Basler Nationalzeitung qualifiera la parution de son œuvre maîtresse, L'Axe de la nature : Système philosophique fondé sur les réalités naturelles, le 13 mai 1950, d'« événement mondial ». En 1962, c'est la réédition du plus célèbre des livres de Blüher : Le rôle de l'érotisme dans la société masculine : Théorie de la fondation des États par type et par valeur, livre interdit sous Hitler. Le 22 juillet, le Basler Nachrichten écrit : « L'importance de l'œuvre est telle que sa lecture est impérative pour tous ceux qui veulent se consacrer à la psychologie, la sociologie, la psychiatrie ou la pédagogie. Pour la première fois depuis Platon, tout l'éventail de la sexualité est couvert. Par ce livre, Blüher a fondé la sexologie moderne, une sexologie encore inexistante ».
UNE SEXOLOGIE MODERNE
Un quart de siècle plus tard, force nous est de reconnaître que cette sexologie moderne est mal en point. C'est qu'entre-temps, une autre théorie a eu la faveur du système.
Blüher et ses élèves furent longtemps les seuls à s'engager pour la libération et la réhabilitation de l'érotisme et de la sexualité. Ils avaient contre eux tout le courant des gens incapables de concevoir la sexualité hors du cadre strict de la procréation. Ces partisans de la répression trouvèrent des adeptes dans la révolution culturelle inspirée du modèle chinois : c'est la terreur des Gardes Rouges en Chine et des Khmers rouges au Cambodge. Dans ces pays, la répression anti-sexuelle dépassera même l'intolérance des moralistes chrétiens.
Curieusement, dans sa version occidentale, symbolisée par la révolution étudiante, l'opposition extra-parlementaire, la Nouvelle Gauche des années 70 et l'anarchisme écologiste, pacifiste et féministe des Verts en Europe, la révolution culturelle parviendra à une conclusion inverse : en raison même de l’aspect négatif, bas, imputé à la sexualité, sa libération totale au nom des droits individuels est assimilée à une « prise de conscience révolutionnaire » précédant « la libération de l’homme des structures dominantes et des obligations sociales ».
Quels qu'en soient la nature, les phénomènes sexuels se voient gratifiés d'une revendication émancipatrice d'autant plus grande qu'ils s'éloignent des ordres de valeur traditionnels. Rien de commun ici avec la vision de Hans Blüher, fondateur de la sexologie moderne. Contrairement à la sexologie conventionnelle, médicale, principalement issue des États-Unis, Blüher n'assimile pas la sexualité à un phénomène issu de conditions d'existence extra-individuelles. Il y voit au contraire l'expression d'une force culturelle et historico-politique de premier plan et la range au nombre des questions existentielles décisives de l'individu et de la communauté. « Il vit dans la confusion », écrit-il dans son autobiographie, Werke und Tage, « l'homme qui ne sait pas s'il aime l'autre sexe ou le sien propre, s'il doit politiquement se compter au rang des gens de droite ou de gauche, s'il est croyant ou non ». Blüher n'a jamais fait mystère de ses positions. Pour lui, n'a de valeur que ce qui a un sens, une fonction, à la lumière de l'ordre naturel perceptible et compréhensible, que ce qui s'accorde aux dures règles de l'éthique et de l'esthétique.
Réprimées et passées sous silence par l'Allemagne d'Hitler et par le régime américano-catholique d'Adenauer, les idées de H. Blüher furent ressenties comme une provocation par la Nouvelle Gauche. L'accusation était toute prête : aux yeux des représentants de la révolution soixante-huitarde, toute référence à la constitution d'une élite néo-aristocratique, au sens de l'existence, à l'éthique et à l'esthétisme ne pouvait émaner que d'un « fasciste ». De fait, Blüher a influé en profondeur sur le fascisme authentique (fascista au sens de « faisceau », de Bund), mais le fait est passé inaperçu des intellectuels, qu'ils soient néo-marxistes ou américano-behaviouristes...
LE MAITRE À PENSER JUIF D'HITLER
Hans Blüher était initialement libéral, et de gauche, avant que ses recherches ne le poussent à d'autres conceptions politiques. En chemin, par un curieux hasard, il assista indirectement à l'une des retombées, d'ailleurs bien secondaire, de l'un des plus gros scandales politiques que connut l'Allemagne impériale dans les années qui précédèrent la Première Guerre mondiale, je veux parler de l'affaire Eulenburg/ Harden.
Le prince Eulenburg, grand seigneur et diplomate brillant aux intérêts spirituels et artistiques multiples, était l'un des 2 amis personnels que l'empereur Guillaume II eût jamais à l'époque de sa gloire, le second étant l'industriel Friedrich Alfred Krupp. Ce dernier fut conduit au suicide par l'alliance funeste de milieux criminels napolitains éconduits, du parti clérical italien et de la presse sociale-démocrate allemande et autrichienne, qui déclencha une campagne de presse monstrueuse. Grâce à son immense fortune, Krupp avait pu se bâtir dans l'île de Capri, très pauvre à l'époque, son empire pédérastique privé.
Bien que le Vorwärts, organe national du parti social-démocrate, officiellement partisan de la suppression de l'article 175 réprimant l'homosexualité, ait été jusqu'à publier des photos nues de Krupp et de ses garçons, l'empereur eut le courage et la force de caractère de faire envoyer, le jour de l'enterrement, une gerbe sur la tombe de Friedrich Alfred Krupp. L'inscription était éloquante : « À mon meilleur ami – Guillaume Imperator Rex ».
Quatre ans plus tard, l'affaire Krupp servit de modèle à une autre offensive dirigée comme la précédente en dernière instance contre l'empereur. Cens fois, le prétexte en était de protéger la Couronne, l'Empereur et l’État contre « un très grave danger ». À l'origine de l'affaire, un journaliste, Isidor Witkowski, juif polonais d'origine, qui avait acquis un certain poids politique après avoir servi d'agent de presse au chancelier Bismarck, aigri par sa disgrâce. À la mort du chancelier, le journaliste se posa en nationaliste fervent et en profita pour faire transformer son nom, peu éloquant, en « Maximilian Harden ».
Fin 1886, Witkowski-"Harden" publie une série d'articles alliant le flou « artistique » aux insinuations les plus sournoises. Il y « dévoile » que l'empereur est prisonnier d'une « coterie » qui voudrait le pousser à une conciliation, voire une entente avec l'« ennemi héréditaire français ». Et pour ajouter quelque consistance à la « perversité » d'une telle conception, Witkowski-"Harden" met l'accent sur le fait que la coterie, dirigée prétend-il par le comte Eulenburg et le diplomate français Lecomte, est une clique d'homosexuels : la « Table ronde de Liebenberg » (*), du nom du château du prince où se réunissent ses membres, souvent en présence de l'empereur.
[* : « expression qui comportait un sous-entendu singulièrement lubrique : Liebenberg, (littéralement "montagne de l'amour"), pouvait être lu à double-sens si on se référait au mons veneris ; les Allemands, tout wagnériens qu'ils étaient, avaient nettement à l'esprit ce Venusberg où le chevalier médiéval Tannhäuser avait sucombé aux tentations de la chair ». James D. Steakley, Iconographie d’un scandale, les caricatures politiques et l’affaire Eulenburg, postface de Derrière « Lui » : L'homosexualité en Allemagne écrit par J. Grand-Carteret en 1907, rééd. Cahiers Gay-kitsch-camp, Lille, 1992, p. 193. cf. recension]
Cette coterie se compose selon lui de hautes personnalités de la Cour et surtout de l'entourage militaire de Guillaume II. « La patrie est en danger », clame Witkowski-"Harden", mélange répugnant de père-la-morale offusqué et de coupeur de tête au visage de gentleman, « lorsqu'on voit un cercle d'hommes aux goûts contre-nature influer sur les décisions du souverain ». Notre homme, qui savait à merveille, – et avec quel pathétisme ! –, exprimer sa réprobation morale, clamait dans le même temps son patriotisme entier. À l'entendre, il se souciait peu de rendre publiques certaines affaires privées, et intimes. À moins bien sûr de s'y trouver contraint... Plus précisément... à moins qu'on ne lui tape sur ses doigts graisseux, auquel cas il saurait dévoiler des secrets « édifiants » sur les plus hautes personnalités de l'État. D'ailleurs, pour lui, l'acte sexuel n'est pas primordial. Il déclarera : « J'estime dangereuse toute amitié virile, même (sic) idéale, lorsqu'elle a des retombées politiques ».
Cette infâme campagne fut couronnée de succès. Compromis pour la seconde fois avec des personnalités accusées d'homosexualité, l'empereur dut abandonner le comte Eulenburg et la « Table ronde de Liebenberg ». Le « danger » d'une réconciliation franco-allemande était écarté. Rien décidément ne s'opposerait plus au déclenchement de la Première Guerre mondiale...
Beaucoup plus tard, dans l'Allemagne d'après 1945, H. Blüher est revenu sur l’affaire Witkowski-"Harden", dont il a dévoilé avec beaucoup de courage en ces temps d'aliénation les motivations réelles. En fait, ce qui inquiétait le repoussant personnage dans la « Table ronde de Liebenberg », c'était l'intérêt qu'elle portait aux théories raciales du comte de Gobineau et de Houston Stewart Chamberlain. Dans son autobiographie, publiée en 1953, Blüher explique les attaques de l'ancien journaliste par sa peur de voir l'empereur, qui sympathisait avec les juifs, subir l’influence de cercles antisémites. La source d'information de Blüher n'est autre que... Guillaume II, qu'il rencontra régulièrement par la suite dans son exil hollandais jusqu'à ce que le régime national-socialiste ne lui retire son visa. Hitler avait sacrifié Ernst Röhm et ses propres partisans des amours masculines au profit de la réaction christiano-bourgeoise. Sa bienveillance mêlée de distance se transforma en une persécution fanatique des homosexuels, ce qui fit dire à Blüher que Witkowski-"Harden" n'était en somme que le maître à penser juif de Hitler.
UNE RÉVOLUTION DE LA JEUNESSE CONTRE LA SOCIÉTÉ BOURGEOISE
 Nul n'aurait pu prévoir à cette époque (1906-1909) que ce fils de pharmacien d'une banlieue de Berlin compterait un jour parmi les proches de Guillaume II. Lorsqu'éclate l'affaire Eulenburg, Hans Blüher [ci-contre en 1906] achève des études qu'il a accomplies dans une école toute particulière : le collège de Steglitz a été le théâtre d'un événement unique : la naissance des Wandervögel, ces premières communautés de vie auxquelles Blüher donnera plus tard le nom de « mouvement de la jeunesse ». Blüher fut l'un des premiers à participer à ses actions. Il s'y consacre bientôt corps et âme.
Nul n'aurait pu prévoir à cette époque (1906-1909) que ce fils de pharmacien d'une banlieue de Berlin compterait un jour parmi les proches de Guillaume II. Lorsqu'éclate l'affaire Eulenburg, Hans Blüher [ci-contre en 1906] achève des études qu'il a accomplies dans une école toute particulière : le collège de Steglitz a été le théâtre d'un événement unique : la naissance des Wandervögel, ces premières communautés de vie auxquelles Blüher donnera plus tard le nom de « mouvement de la jeunesse ». Blüher fut l'un des premiers à participer à ses actions. Il s'y consacre bientôt corps et âme.
Pour pouvoir tant soit peu comprendre le caractère profondément révolutionnaire d'une formation aussi innocente pour nous que les Wandervögel, qui ne comptent dans les débuts que quelques dizaines de garçons entre 12 et 20 ans, il faut se remémorer les conditions qui régnaient alors.
Le XIXe siècle, qu'on a appelé fort justement le siècle de la bourgeoisie, a vu une stupéfiante dépossession politique de la jeunesse. Jamais auparavant elle n'avait été livrée si totalement à l’emprise de la famille, de l'école, des entreprises, de l'Église et de l'université. Face à cette tyrannie, la jeunesse est dépossédée de ses droits, elle n'a plus d'espace pour s'épanouir, pour se former elle-même à la vie et encore moins la possibilité d'accéder à une position autonome au sein de la société ou de la vie publique. Ces réflexions ne sont en rien exagérées. La « liberté académique » des étudiants était soumise à des restrictions telles qu'on ne peut guère parler de... liberté, au sens où nous l'entendons. Jusqu'au tard de l'époque baroque, on étudiait entre sa 14ème et sa 20ème année, et il fallait une ville petite-bourgeoise comme Leipzig pour refuser le titre de docteur à un étudiant de 20 ans en raison de son trop jeune âge. Johann Sebastian Bach eut à souffrir de cette atmosphère. De même Leibnitz, qui obtint les qualifications nécessaires dès l'âge de 17 ans sans être admis néanmoins.
À l'époque de Luther, en 1527, le Conseil Municipal d'Ulm édicta l'une des premières lois, remarquées, de « protection de la jeunesse ». L'accès aux maisons closes n'était plus autorisée dans la ville libre impériale qu'à partir de 14 ans. Les sociétés féodales ou d'esprit féodal se caractérisent par l'entrée des adolescents dans le monde des hommes une fois franchi le seuil de l'enfance défini selon des critères naturels de corps, d'intellect, de mentalité et de caractère. Cette caractéristique marquera le féodalisme sous ses formes les plus tardives : lorsqu'en 1745, après la célèbre attaque de Hohenfriedberg, la plus spectaculaire des victoires de la cavalerie dans l'histoire militaire, les officiers du régiment de dragons prussiens Markgraf von Ansbach-Bayreuth furent décorés de l'ordre Pour le mérite, beaucoup avaient entre 14 et 16 ans.
L'émancipation de la bourgeoisie s'accompagna de l'exclusion des adolescents de la communauté des hommes libres autonomes et responsables. Pour la bourgeoisie, la famille est la structure dominante : l'homme n'est estimé qu'en temps qu'époux et père de famille, la jeunesse est un groupe de population à part. Des conditions passées, il ne subsiste que les ligues étudiantes imitant jusque dans les plus infimes détails le corps d'officiers féodal. On retrouve ici ce sentiment, de communauté consciente entre de jeunes hommes et de « vieux messieurs », terme par lequel on désigne ceux qui ont achevé leurs études. Dernière survivance de la liberté des adolescents, encore faut-il ajouter que les garçons ont maintenant 20 ans et non plus 14 ou 15. Mais les étudiants eux-mêmes souffrent de l'emprise du monde adulte sur la jeunesse. Ce qui expliquera que Hans Blüher n'ait pu conclure normalement ses études. À 27 ans, c'est un auteur renommé par ses prises de position lors des continuels débats sur l'affaire Eulenburg.
Il sera néanmoins convoqué par les autorités universitaires pour avoir négligé de soumettre ses écrits à leur censure et à leur autorisation préalable, comme le stipule le règlement des universités. Blüher refusera de s'y soumettre, malgré les menaces. Le consilium abeundi lui déniera son titre universitaire. Il avait porté, il est vrai, dans une brochure, un jugement sévère sur le recteur de l'université de Berlin, le professeur von Wilamowitz-Möllendorf, autorité nationale pour l'histoire de la civilisation grecque antique qui s'était prononcé avec une singulière étroitesse d'esprit sur l'amour grec : « Si j'étais un Grec de l'antiquité redescendu sur terre et que j'entendais Wilamowitz parler ainsi des fondements de mon être, je préfèrerais m'adresser aux charretiers d'Allemagne par échange de signes plutôt que de parler un seul mot de grec avec cet homme ».
On s'imagine sans peine dans ces conditions la situation des plus jeunes. Toute constitution de groupe, tout projet commun de collégiens est soumis à la tutelle obligatoire des enseignants. Tout contact, et à plus forte raison tout rapport étroit entre des adolescents de différentes classes d'âge, disons entre des adolescents de 17 et de 14 ans, est interdit et totalement exclu. Et il est naturellement impensable que puissent s'établir des liens entre des adolescents et des adultes – même si la différence d'âge est faible – hors des cadres parental, familial, éducatif ou religieux créés par la société bourgeoise.
Pourtant, l'inconcevable se réalise... Un groupe de jeunes gens du collège de Berlin-Steglitz pose la première pierre qui fera s'écrouler la prison dans laquelle la société bourgeoise prétendait les enfermer. Au terme de rencontres régulières et de vacances communes baptisées « expéditions » effectuées dès 1896 en secret et dans la plus parfaite illégalité, Karl Fischer, alors étudiant, réussit à obtenir du directeur de son ancienne école un statut légal pour son organisation, le Wandervogel. Il créa donc un Comité pour les départs en vacance des élèves composé de pères ouverts d'esprit, d'enseignants appréciés et bientôt d'autres personnes intéressées par le projet. Cette institution prit en charge l'organisation légale des activités, mais s'en remit pour leur réalisation concrète aux plus jeunes, à ceux du moins qui étaient reconnus par les adolescents. Du jour au lendemain, l'ancienne doctrine qui niait la possibilité pour tout adolescent de s'organiser en dehors du contrôle des maîtres s'effaça.
Mais la liberté acquise signifia aussi l'abandon des séparations contre-nature entre les classes d'âge et les différents établissements. Dans les collèges allemands – le Wandervogel s'étendit rapidement dans tout le territoire du Reich – se créèrent spontanément un milieu, une ambiance à l'opposé de la conception bourgeoise du collège : une raison en étant qu'à l'instar des éphèbes grecs, les adolescents allemands créèrent une culture de la nudité qui exprimait à merveille leur perception de la vie. Cette atmosphère empreinte d'érotisme qui fonda le Wandervogel avant d'inspirer l'œuvre de Blüher donna tout naturellement naissance, imperceptiblement, à une conception de l’existence aux antipodes de l'« ère victorienne ».
Cette époque fut aussi celle d'un homme qui, payant courageusement de sa personne et de sa fortune, tentait depuis de nombreuses années de faire renaître l'héritage antique des cendres où le réduirent un millénaire et demi de christianisme. Un hasard extraordinaire voulut que cet homme, alors quincagénaire, rencontra H. Blüher, âgé lui-même de 17 ans. Le jeune chef Wandervogel préparait avec son groupe un grand tour d'Allemagne. Nous sommes alors en 1905. L'ami d'un ami surgi pendant les discussions préalables leur conseilla de faire halte chez un seigneur qu'il savait être hospitalier. C'est ainsi que Blüher fit la connaissance du personnage en qui il découvrira le prototype de l'homme qui fait l'histoire avant de se consacrer au thème qui fut la clef de son existence : l'enseignement du Bund – la découverte et la codification des lois fondamentales de toute communauté virile, lois fondées sur l'érotisme inter-masculin.
Ce que Blüher découvrit d'abord, ce fut un génial meneur d'hommes : Héritier d'une grande fortune industrielle, Wilhelm Jansen fut fervent catholique pendant sa jeunesse avant de devenir l'ennemi juré de l'Eglise et du christianisme. Pendant ses années d'études à l'université de Bonn, il fit partie de la plus distinguée des ligues d'étudiants, le Korps Borussia auquel appartenaient traditionnellement tous les princes de la maison des Hohenzollern. Il acquit comme il se devait la qualité d'officier de réserve dans le régiment féodal des hussards de Bonn ; pourtant Jansen gardait ses distances vis-à-vis d'un système qu'il jugeait pour une bonne part figé, bourgeois et fortement influencé par une impératrice bigote et prude. Plusieurs années après cette première rencontre, Blüher écrira : « Son domaine d'intérêt principal et naturel était l'assainissement de la jeunesse, sa libération des mains des instituteurs et des prêtres ».
Cette œuvre, c'est par le biais du nouveau mouvement sportif qu'il l'exercera : un mouvement qui commencera vers la fin du XIXe siècle à concurrencer la gymnastique allemande issue de l'époque napoléonienne « barbare et dénuée de goût » dira-t-il. À cette conception, Jansen oppose la gymnastique antique. La décoration des installations sportives qu'il fonda – notamment une palestre grecque à Berlin-Charlottenburg ornée de statues d'éphèbes et d'athlètes nus – reflétait une vision provocatrice, philosophique et en dernière analyse culturelle de la vie. À l'intérieur même de son domaine seigneurial, il avait fait bâtir un véritable « gymnasion » grec. Ici, une jeunesse vivante y jouissait des droits que l’Europe christiano-bourgeoise de l'ère victorienne ne concevait plus même pour ses statues... Pourtant, malgré son engagement, Jansen n'avait guère réussi à percer dans les mentalités. Il avait créé les conditions de vie d'un type très particulier de communauté, proche de la nature et organique. Mais si cette communauté pouvait naître spontanément, à partir de sa plus élémentaire substance, elle ne pouvait être créée de toutes pièces.
En 1902 pour la première fois, elle trouva un modèle conceptuel dans une étude de l'ethnologue Heinrich Schurtz : Classes d'âge et confréries (Alterklassen und Männerbünde). L'auteur y analysait les observations qu'il avait faites chez les peuples primitifs des îles du Pacifique. Or ce modèle conceptuel apparaissait brusquement au beau milieu de l’Europe sous la forme du Wandervogel ! Pour Blüher, cette étude sera plus tard une révélation. Il entreprendra l'analyse systématique du phénomène et établira que cette forme de société, loin d'être spécifique aux peuples « primitifs » ou « sauvages », obéit à une loi immuable de l'humanité et donc de la civilisation et de l'histoire. Mais l’adolescent de 17 ans était alors bien loin de ces réflexions lorsqu'il rencontra Wilhelm Jansen dans son domaine.
Ces quelques jours permirent par contre à Jansen de réaliser que ce Wandervogel était exactement ce à quoi il avait œuvré depuis si longtemps. Les adolescents furent conquis. Sa réputation et sa célébrité gagnèrent rapidement la ligue entière. W. Jansen répondait à un besoin que Blüher définira avec justesse quelques années plus tard : il n'y avait personne en qui la jeunesse pût se raccrocher pleinement, comme elle en éprouvait le désir. La jeunesse avait besoin d'un héros. Il ne faut pas s'étonner qu'elle se soit très vite attachée à un homme sans doute plus rare encore que le hasard qui avait permis leur rencontre. En un an, le domaine de Jansen devint le centre non pas du Wandervogel, mais de ses meilleurs éléments, de son noyau interne. Car il nous faut établir cette distinction.
L'extension du mouvement s'accompagna, ce qui était normal, d'un affaiblissement de la qualité de ses membres. Une fois créée la base légale de la ligue par son fondateur et premier dirigeant, Karl Fischer, il se présenta une nuée de candidats au professorat et de jeunes enseignants soucieux de faire carrière en affichant des idées pédagogiques « engagées et modernes ». Il y eut les hommes d'affaires, à l’affût d'un marché.
Et finalement la profiteuse sans vergogne, l'habituelle parasite et faussaire de toutes les idées à succès, j'ai nommé l'Église. Plusieurs groupes confessionnels Wandervogel apparurent. Pire encore, des dignitaires de l'Église s'infiltrèrent au sein même de la ligue et commencèrent par décréter que les chefs des groupes de jeunes devaient concevoir leurs sorties de sorte que la première activité dominicale soit consacrée à un service divin, « pour étancher la soif spirituelle des jeunes Wandervögel ». L'influence de ces éléments si parfaitement étrangers à l'esprit Wandervogel fut catastrophique. Mobilisant le type d'hommes qui leur correspondait le mieux, de jeunes bourgeois médiocres fondus dans la masse, ils détruisirent la substance même des Wandervögel, peu conscients encore de leur identité et l'entraînèrent vers le déclin et le néant. Plusieurs groupes accueillirent des filles, démarche fatale au passage du mouvement allemand de la jeunesse à une véritable confrérie, au Bund.
Si le Wandervogel a suscité de façon passive l'élaboration de l'enseignement du Bund, il ne l'a jamais réellement pris à son compte. L'erreur originelle fut son incapacité à se forger un programme concret d'action. Cette faiblesse est apparue avec Karl Fischer, mais Wilhelm Jansen n'y a pas remédié, et après lui le mouvement ne s'est plus adressé qu'à des milieux marginaux, fractionnés et sectaires. Encore faut-il convenir que le Wandervogel eut 2 grand mérites : cette révolte de la jeunesse fut victorieuse en cela qu'elle mit fin à la toute-puissance de la bourgeoisie et de son familiarisme patriarcal ; par sa présence et par ses conflits intérieurs enfin, elle aura permis à Hans Blüher, emprisonné jusqu'alors dans des questions plus ou moins secondaires d'analyser pleinement le sens de l'amour homosexuel.
◘ 2) Gaie France n°10 (mai-juin 88) : pp 27-34. Second volet de notre enquête sur Hans Blüher. Sa vie, son œuvre. À 24 ans, le jeune Blüher n'a plus d'attaches autres qu'intellectuelle et spirituelle avec la confrérie masculine. Au-delà de ses errements, une lueur éternelle lui survit. Grâce à lui, les grands projets esquissés dans l'antiquité européenne se trouveront peut-être, un jour, réalisés.
« CONTRAT SOCIAL » OU RÉVOLUTION ?
Si nous avons pu dire que Le rôle de l'érotisme de Blüher est l'ouvrage le plus important paru à ce jour, c'est que Blüher y démonte toutes les théories dominantes de l'époque : les idées freudiennes, le judéo-christianisme, le confucianisme, l'hindouisme et le bouddhisme... Il sape les bases mêmes de l'idéologie famillariste du « contrat social » de Rousseau, reprise par nos démocraties, libérales et socialistes. Le rôle de l'érotisme contient déjà l'ébauche de l'enseignement bündisch tel qu'il s'exprime à travers le livre célèbre d'un sociologue de Leipzig, Hans Freyer. Pour Blüher, la révolution de droite dépasse le cadre d'une contre-révolution d'opposition à la révolution communiste, en ce qu'elle s'oppose à l'« ancien régime ». Elle ne se donne pas pour objet de le sauver ou de le restaurer. Il s'agit bien au contraire de le réformer pour empêcher qu'il ne se fige et ne décline.
Pour lui, la révolution rouge est toujours une rébellion contre la réalité du monde et de la vie, contre « ce qui doit être ». Le concept d'« égalité » s' oppose au fondement élitaire, hiérarchique, aristocratique de la nature. Son objectif a été très clairement formulé par Karl Marx : « Jusqu'ici, la philosophie s'est contentée d'interpréter le monde. Nous voulons changer le monde ». La révolution rouge vise l'impossible, l'utopie. La révolution de droite vise le domaine du possible et du nécessaire, les « Idées » philosophiques. Ces idées ne sont pas des concepts subjectifs, mais des archétypes commandant les phénomènes temporels de la réalité pragmatique.
THÉOLOGIE DE LA NATURE
La vision du monde blühérienne est universaliste et théologique : elle conçoit le monde comme un système ordonné unique chargé de sens. Son argument central pour justifier l'érotisme et l'homosexualité est ébauché dans le quatrième chapitre du premier volume du Rôle de l'érotisme, joyau de la sexologie, puisqu'en 37 pages, il démolit toutes les théories fondées sur une origine pathologique de l'homosexualité en retournant contre eux les propres armes des sexologues. Le passage s'intitule : « Nature de l'inversion : Pathologie ou ordre naturel ? Deux conceptions en lutte ».
Il élargira son champ d'investigation dans un livre inachevé consacré à l'aspect sociologique du « rôle de l'érotisme » (1). Il y déclare notamment : « Nous disons qu'un instinct est naturel lorsqu'il remplit une fonction attestée dans l’ordre naturel, il accomplit alors la théologie objective de la nature ».
La grande idée de Blüher est que la culture se fonde sur un rapport érotique entre les hommes. Ce rapport élève l'humanité au-dessus de la forme sociale du troupeau (communauté de génération et d'éducation, mariage, famille). Toutes les cultures reposent sur ce principe. Il y a bien là une spécificité humaine, attestée à toutes les époques et dans toutes les parties du globe.
Une conception qui s'oppose aux théories nominalistes pour qui le monde, loin de reposer sur un ordre supérieur, hors de l'arbitraire humain, est un chaos sans but que l'homme se doit d'organiser à son gré. On est tout aussi loin ici des explications psychanalytiques, car si la culture s'obtient par la répression et la sublimation de penchants sexuels chaotiques en fonction de certaines normes sociales, le niveau d'acceptation ou de répression de la sexualité ne dépend plus que des conceptions des classes dominantes. C'est elles qui décideront quelles formes de sexualité sont utiles ou tolérables socialement et quelles formes doivent être réprimées et éliminées par « sublimation ».
On ne s'étonnera pas que Freud ait relativisé le concept de maladie. La thérapie psychanalytique se situe hors des normes naturelles puisqu'elle se donne pour unique objectif d'amener le patient à se conformer aux conventions de la société bourgeoise. On conçoit que la psychanalyse ait connu ses plus grands succès dans la nation la plus prude et la plus emprunte de moralisme petit-bourgeois qui soit : les États-Unis, et se soit intégrée à la religiosité puritaine d'une société qui a calqué ses valeurs sur l'Ancien Testament.
Pour Blüher, la sublimation de la sexualité ne peut être porteuse de valeurs culturelles que si la sexualité est perçue positivement. Blüher se fait l'écho d'une sexualité ouverte, orgiaque, tant hétéro-qu'homosexuelle. « Nous disons qu'un instinct est naturel lorsqu'il remplit une fonction attestée dans l'ordre naturel ». Blüher montre que seule l'union érotique et sexuelle d'individus de sexe masculin au fil des générations crée et maintient la forme de vie spécifique qui élève l'homme au-dessus de l'animal. Quelle que soit la définition que l'on puisse donner de l'homosexualité, elle a pour fonction de permettre la culture et son incarnation politique, l'État organique.
On retrouve ici trois pivots de la pensée blühérienne :
• 1. L'homosexualité est naturelle,
• 2. le monde est ordonné,
• 3. l'ordre naturel exige un droit naturel, qui a préséance sur les lois érigées par l'homme. À cet égard, puisque l'érotisme inter-masculin et l'homosexualité sont un facteur premier de l'ordre naturel, le droit exige qu'ils se développent librement. En cela, pas plus le mosaïsme Juif que les dictatures et les sectes religieuses avec leur ascétisme forcené n'ont naturellement le droit de réprimer l'érotisme garçonnier ou même à propager l'homophobie.
LA PROMESSE D'UN RENOUVEAU
La conception blühérienne est révolutionnaire à beaucoup d'égards. En établissant la nature et la fonction d'une confrérie élitaire, pédagogique, philosophique et militante, Blüher rejette au rang de superstition l'idéologie famillariste et le patriarcat qui font du mariage et de la famille la cellule de base de toute forme de vie communautaire. En reconnaissant dans l'Éros inter-masculin et l'homosexualité un facteur constitutif essentiel de l'humanité, des peuples et de la culture, il montre l'inanité de toutes les religions qui rejettent l'érotisme et assignent à tous les hommes le devoir de dépasser la chair et de renoncer à la vie terrestre : judaïsme, christianisme, islam, hindouisme et bouddhisme. On peut citer cette magnifique phrase de Rilke à propos du Rôle de l'érotisme : « Peu de gens ont ressenti la Grèce aussi Intensément que lui. L'apologie blühérlenne me semble être le chant sonore d'une nouvelle religiosité ».
DE LA FEMME AU CHRISTIANISME : L'ÉCHEC D'UNE TENTATIVE
Cette œuvre de portée mondiale, peut-on dire, n'attend plus qu'à être découverte, parfaite et transformée en une conception politique inspirée par sa dimension et sa hauteur de vue de l'hellénisme et de l'imperium romanum. Nietzsche pensait que dans sa conception (qui ne fut jamais pleinement réalisée), l'Empire romain était l'œuvre maîtresse d'un style grandiose. Un tel édifice était fait pour traverser les millénaires. Dans un passage célèbre de son Antéchrist, il écrira ceci : « Toutes les grandes architectures ont ceci de commun qu'elle ne font pas intervenir le hasard des personnes ». Cette réflexion s'applique bien évidemment aussi à Hans Blüher. Si nous avons peu critiqué dans l'ensemble les réflexions de ce génial penseur à travers ce dossier, cela n'implique pas que nous les acceptions sans réserve.
Comme tout autre, Blüher a connu des impasses et ceux qui auraient voulu le suivre jusqu'au bout n'auraient pas manqué d'être désorientés. Par ex. par son étonnant retour au christianisme. Ce pas a correspondu à son analyse de la question féminine, échec aussi surprenant que caractéristique, Blüher a traité du problème de la nature et de la valeur de la femme aussi souverainement qu'il avait abordé l'identité, la mission, la forme et la fonction des amours masculines. Mais traitant de la question féminine, il n'a pas voulu accepter ses propres conclusions, préférant se départir de la règle qu'il s'était fixée naguère : le philosophe doit renoncer à la volonté et à l'action pour se consacrer tout entier à la connaissance. En voulant dépasser une réalité qu'il avait clairement perçue, mais qu'il ne pouvait accepter, Il a provoqué sa propre chute.
BLÜHER DÉNONCE LE « PIÈGE DE LA FEMME »
Il avait détruit à la fois les bases du féminisme et les prétentions universalistes d'un type d'homme bourgeois, hétérocrate, fondées sur le patriarcat, la famille et le rejet des amours masculines. Blüher avait très clairement perçu la force destructive de la femme, vecteur d'anarchie. « Malheur à l'homme qui succombe à la femme ! », « Malheur à la civilisation qui se livre aux femmes ! », écrit-il dans le dernier chapitre du Rôle de l'érotisme. « Les femmes rêvent toujours de posséder l'homme en entier. Cette trappe vers le néant, qui se cache derrière chacune d'elle, réclame sa victime. La plupart des hommes se perdent ainsi par leurs femmes... L'homme de la confrérie au contraire ne peut sombrer car il engage le meilleur de lui-même dans l'homme ».
Blüher a réussi là où Socrate et Platon ont échoué : Il a identifié le rapport entre le logos et l'Éros. Il montre que la plus haute expression de la vie, la culture, implique que le logos et l'Éros se conjuguent et se fondent dans la confrérie érotique masculine fondatrice des États. Mais déjà il vit en marge de la confrérie. Sexuellement, il s'est tourné vers les femmes et en subira les conséquences dévastatrices. Lorsque viendra l'heure du conflit, il ne lui restera plus qu'à soumettre le logos et à passer par la trappe. Le philosophe de la Grèce païenne deviendra le dernier grand théologue chrétien.
Avant d'aborder ce chapitre, il nous faut brièvement aborder le sommet de sa philosophie, l'endroit où Blüher a éclairé les rapports entre logos et Éros.
L'ESPRIT EST HOMME
Là où Freud avait élargi le concept de sexualité, Blüher élargit celui de l'Éros. Le concept d'esprit implique la prise en considération de sa forme ultime, intérieure, de sa plus haute expression. La question est de savoir si une différence fondamentale sépare l'homme de la femme, et quelle est cette différence. Pour cela, il faut expliquer clairement ce qu'est l'« esprit », il ne suffit pas de définir par ce terme la conscience et les capacités intellectuelles, communes à l'homme et à la femme. Car on ne peut dès lors concevoir qu'une différence de gradation entre les 2 sexes, ce qui est inacceptable pour l'un comme pour l'autre.
Par contre, si l'« esprit » est ce qui libère la pierre originelle des lois de la nature pour les transformer en cathédrales, ce qui crée des symphonies à partir de tons, si l'esprit est ce qui transforme les sons en langue, ce qui, à partir d'éléments partiels, autonomes, crée l'unité du concept et du même coup la science, alors il faut dire que ce bien est propre à l'homme... Certes, ces qualités se retrouvent parfois chez la femme, mais chez elle, la création intellectuelle se paie par la perte visible, atroce de ses qualités fondamentales. Le rapport général que nous avons établi entre féminité et esprit ne s'en trouve donc pas modifié.
Le « Blüher » du Rôle de l'érotisme n'a pas encore fondé sa philosophie des idées sur une image universelle. Sa conclusion est encore partielle : « Rien ne nous dit évidemment que l'esprit soit le fondement du monde, que l'esprit, le plus désespéré et le plus solitaire des phénomènes, donne son sens à la nature. Peut-être l'esprit n'est-il que la plus scélérate des formes de vie qui sera jamais donné à l'œil divin de voir, la substance masculine du monde doit en accepter le destin ». « Le temps universel que nous connaissons, l'esprit l'a créé, et l'esprit est toujours homme » (Stefan George). Ce temps que nous connaissons, indépendamment de savoir s'il en existe un autre, est en tous cas le seul que nous puissions façonner et au sein duquel nous puissions agir. Or en son sein, l'élément essentiel est l'esprit créateur, l'esprit qui fonde la culture, et par là même donne son sens à toute chose. Dès lors, la boucle est fermée. Puisque l'homme seul peut participer de cet esprit, on conçoit que la pédérastie et l'homosexualité, si dénuées de sens, semble-t-il, lorsqu'elles sont perçues sous l'angle strictement biologique et matérialiste, sont en réalité les conditions, l'origine et le fondement indispensables d'un aspect essentiel de notre temps : la culture.
LOGOS ET ÉROS
Ayant reconnu cela, Blüher est en passe de devenir l'exécuteur de la philosophie européenne. Il en a corrigé l'erreur la plus grave : le dualisme platonicien, qui culmine par l'opposition entre un Éros « supérieur », intellectuel, asexuel et un Éros « inférieur » dominé par le désir de chair. Blüher a rétabli l'unité conceptuelle de l'Éros et de la sexualité masculine. Il a trouvé la formule qui dissipe la difficulté à laquelle Platon s'était heurté: l'Éros ne se manifeste pas nécessairement par une sexualité orgiaque, mais il est toujours en droit de le faire.
Le deuxième mérite de Blüher est d'avoir mis sur le même plan logos et Éros et d'avoir perçu que l'Éros était aussi instrument de connaissance. Là encore, Blüher va bien au-delà d'Aristote et de Platon. En tant que vecteur d'une connaissance conceptuelle des lois universelles, le logos seul réduirait l'ordre naturel à une image aride, sans vie, abstraite, schématique et mécaniste sans grand lien avec la réalité vivante. Le logos doit se compléter d'un autre organe de connaissance qui saisisse ce qui est particulier, individuel, personnel, ce qui va au-delà des lois générales, la diversité étonnante, manifeste du monde et de la vie : l'Éros. L'Éros est la connaissance passionnée, la connaissance de ce qui ne peut être conçu rationnellement.
BLÜHER : LA CHUTE
Mais Blüher commet alors une grave erreur, il introduit le dieu juif Jahwe et son excroissance chrétienne dans la philosophie occidentale. Tout se passe chez lui comme si la Bible et l'Évangile étalent la révélation de ce que Pythagore, Platon et Aristote avalent voulu dire sans parvenir à lui donner forme. L'exécuteur du paganisme se fit chrétien, il rentra même, sous le régime d'Hitler, dans le giron de l'Église protestante, et sa tombe aujourd'hui encore porte le monogramme chrétien. Un homme tel que Blüher a évidemment su garder ses distances face au clergé, à ses prétentions et à ses volontés de domination. Il est resté jusqu'à sa dernière heure un ennemi acharné et actif de la morale sexuelle judéo-chrétienne et de sa condamnation de l'homosexualité.
Cette conversion ne s'explique que si l'on tient compte de son échec sur la question féminine. S'il s' était satisfait de ses conclusions, ses réflexions auraient normalement suivi leur cours et un nouveau titre de gloire serait venu s'inscrire dans l'histoire de ce penseur génial. Mais son destin personnel s'y opposait. Seule la jeunesse de H. Blüher s'est identifiée au thème qui restera indubitablement lié à son nom dans l'histoire des idées : le rôle de l'érotisme dans la société masculine, le rôle de l'homosexualité dans l'histoire mondiale. Lorsqu'il entreprend son œuvre, à l'âge de 22 ans, il n'est plus ce jeune homme qui prit une part active à la vie de la confrérie. Son idée de la femme le mène toutefois quasiment aux mêmes conclusions qu'Otto Weininger, l'auteur de Sexe et caractère [tr. fr. : D. Renaud, Âge d'Homme, 1975], bible de l'anti-féminisme.
Par contre, il ne se satisfera pas du verdict final très dur de cet auteur, pour qui la femme est le « non-être ». Celui qui avait découvert et révélé l'Éros ne pouvait concevoir que son érotisme personnel ait pu le conduire vers l'« objet inférieur ». Les tentatives désespérées qu'il entreprit pour découvrir chez la femme ce qui eut pu correspondre à la grandeur, à la force et à l'éclat de la confrérie érotique masculine échouèrent naturellement. Il ébaucha alors une théorie à la mesure de ses espoirs, et fondée sur l'image d'une femme en devenir dont les hommes de sa condition auraient à découvrir les potentialités. Ce faisant, il passa par la trappe du néant, sombra dans ce qui était pire encore que le néant, le christianisme.
LA « PÉLERINE »
Rappelons brièvement les faits : À l'âge de 31 ans, au cours d'une fête campagnarde qu'une branche régionale du mouvement de jeunesse, déjà mortellement investi par les éléments féminins, organise en l'honneur de l'auteur célèbre du Wandervogel et du Rôle de l'érotisme, Blüher rencontre celle qui sera son grand amour féminin, l'équivalent de ce qu'avait pu représenter pour lui Rudi-"Antinoos". C'est une sténo-dactylo de 24 ans, honorée par un cercle de jeunes lesbiennes comme leur reine, mais dotée d'une propension particulière à la nymphomanie hétérosexuelle. Une femme qui s'est figée dans un rôle inspiré de Hildegard von Bingen et Thérèse d'Avila, de Diotime et de la baronne de Stein, l'amie de Gœthe. Elle se fait appeler « Peregrina », la pèlerine.
Lorsqu'il la rencontre, elle se montre cassante, méprisante. Il n'imagine pas que derrière ce voile, il n'y a que coquetterie. Le lendemain, elle l'a conquis et peut se permettre de clamer : « Quelque chose en toi ne tourne pas rond, tu es crispé... Tu joues les païens, mais au fond, tu ne l'es pas vraiment. Tu as dû subir un choc quand tu étais jeune, d'un homme d'Église, et par réaction, tu es retourné vers le paganisme. Ce monde païen que vous voudriez voir renaître, tu m'excuseras, il n'existe plus. Le christ l'a aboli et c'est lui maintenant le centre du monde... Nous en avons souvent discuté à l'intérieur de notre cercle, mais sans résultat... L'Église a mal fait les choses, et toi, tu te trompes. comme votre Nietzsche et votre George. Vous êtes des aventuriers, vous faites fausse route ! Le seul avantage que tu aies par rapport à eux, c'est que tu n'es pas encore fixé... Tu dois régler cette question du christ, c'est notre devoir... »
On le voit : l'affaire n'aurait pu être menée plus platement, d'une manière plus fallacieuse. Chaque mot justifie cette image classique bien qu'abusive qu'Euripide place dans la bouche de Médée : « Si la nature nous fit, nous autres femmes, entièrement incapables de bien, pour le mal, il n'est pas d'artisans plus experts ».
Les intentions de la « reine » « Pélerine », assise derrière sa machine à écrire dans sa banque régionale de Prusse occidentale, sont claires : elle veut triompher de Blüher, ou plutôt de sa gloire et ramener ce penseur génial à son propre niveau. Le monde païen de Nietzsche et de George, c'est l'image de la confrérie, d'un monde inaccessible à la femme, d'un monde où elle n'a pas de prise.
Et ce païen, attaqué au plus profond de lui-même, désabusé par sa conversion érotique à l'« objet inférieur », oublie sa culture classique, il oublie la phrase centrale d'Euripide : « La femme est le premier de tous les maux » (Phoenix). L'Incroyable se produit : non seulement Hans Blüher tombe dans le piège, mais il accepte de « régler cette question du christ ». Il ne se souvient pas, apparemment, de la définition que Nietzsche donne de l'Église chrétienne : une secte de femmes, poltronne, douceâtre, qui s'est forgée depuis toujours à son image un prince charmant irréel, le « christ », dont elle a fait son complice. Blüher réalise à quel point sa sténo-dactylo est influencée par les spécimens les plus hystériques des nonnes mystiques catholiques, pourtant il cède à ses injonctions. C'est la rédaction d'un ouvrage dont le magazine jésuite à grand public Der christliche Sonntag écrira, 35 ans après la mort de Blüher : « ...une approche remarquable de Dieu, pour autant qu'il soit accessible par la pensée naturelle. Évoquant les relations entre la religion et la philosophie, (le théologue catholique Joachim) Günther atteste à Blüher des profondeurs de vue et des observations comme on n'en trouve guère dans la philosophie contemporaine ». Dérision ou vengeance du destin ?
Lorsque Blüher achève son livre et déclare fièrement à la « pèlerine » qu'il a accompli « leur » œuvre, elle lui réplique, méprisante : « Je ne peux pas vivre tout le temps à ces hauteurs : Je suis une femme ». Hans Blüher aurait pourtant dû le savoir, il aura un moment de crise, et peut-être aurait-il sombré totalement s'il n'avait été sauvé par le rôle qui lui sera dévolu en politique, celui d'un contre-révolutionnaire. La pèlerine ne tardera pas à dévoiler sa vraie nature. Parvenue à ses fins, elle va s'attacher à satisfaire matériellement sa vanité et son ambition (Blüher est un auteur connu, certes, mais non pas riche). Son banquier, « mon chef », l'extrait de derrière sa machine à écrire pour en faire sa maîtresse et l'installer dans un logement confortable avec tout le luxe souhaité. Le banquier lui donnera aussi un enfant débile. Après quoi elle s'installera comme professeur de gymnastique dans l'un des quartiers les plus féodaux de Berlin.
Blüher doit admettre qu'il faut une certaine mesure de frivolité pour appeler gymnastique le « sport » qui est pratiqué dans cet appartement de luxe. Entre-temps, Il s'est marié à une doctoresse. Il n'en reste pas moins qu'elle continuera à exercer son emprise sur lui jusqu'à sa mort, qui surviendra six ans avant celle de Blüher. Elle succombera d'une sclérose multiple. De la même façon, elle restera la reine de son groupe de lesbiennes. Blüher lui doit sa conversion au christianisme, même si son livre sur Jésus reste, selon ses propres termes, fortement teinté de paganisme. Deux ans avant sa propre mort, dans sa biographie, il compose un hymne à l'âme éternelle de la « pèlerine ». Une sinistre illustration de ses paroles, quelque temps avant qu'elle ne le prenne dans ses filets : « Malheur à l'homme qui succombe à la femme ».
UN CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE
Si Blüher n'a pas sombré, le mérite en revient à son attache, non plus érotique, mais spirituelle et intellectuelle à la confrérie masculine. L'Allemagne a perdu la Grande Guerre, l'Empire issu du royaume de Prusse s'est effondré. La révolution, qui vient de triompher du tsar grâce aux conservateurs allemands, vit ses heures de gloire. Tout le monde pense que Blüher, qui vient d'asséner un coup fatal à la « morale sexuelle » christiano-bourgeoise, sera un homme de la gauche victorieuse. Salomon Kosmanowski, allas Kurt Eisner, qui vient de déposer la dynastie bavaroise millénaire des Wittelsbach pour s'auto-proclamer premier ministre, invite Blüher à Munich. Deux autres juifs célèbres, avec lesquels Blüher entretenait un débat amical, le philosophe Martin Buber et l'anarchiste Gustav Landauer sont déjà dans la capitale bavaroise et discutent âprement avec des militants également juifs, mais plus à gauche qu'eux, Levien et Leviné, partisans de la proclamation d'une république soviétique.
Entre-temps, Elsner a été assassiné par un lieutenant royaliste, le comte Arco-Valley. Landauer invite à son tour Blüher à Munich. Le refus du penseur lui sera signifié sur une simple carte postale, Blüher s'y proclame royaliste et conservateur. Il se rendra finalement à Munich, où afflue le gros des anciens combattants du Wandervogel et du mouvement de la jeunesse. Pour la plupart, ce sont de jeunes hommes des cercles qui se sont régénérés grâce à Blüher, à son Histoire d'un mouvement de jeunesse et sa « monographie érotique ». Blüher les mobilisera pour la contre-révolution et participera à la création de « corps francs » constitués par les confréries masculines de la Garde Blanche.
Il prononcera 2 discours publics devant une foule nombreuse, et proclamera son adhésion à l'extrême-droite. Une allocution qu'il a préalablement tenue dans les centres de propagande communiste de Berlin et Leipzig. Son discours porte un titre évocateur : « Empire allemand ,judaïsme et socialisme ». Il explique que l'Allemagne vaincue de 1918 doit s'atteler à la tâche qu'Édouard Drumont a défini pour la France de 1871 dans son livre La France juive : comme Drumont, il entend lutter « contre les forces qui utilisent la défaite d'un peuple pour détruire sa culture traditionnelle, sa substance spirituelle et intellectuelle et imposer le matérialisme, la profanation, la vulgarité et le socialisme ». Cette fois, Blüher semble invulnérable. Il survivra à la guerre civile comme il survivra à l'élimination de l'opposition royaliste et conservatrice sous Hitler.
BLÜHER CONTRE LA « LOGIQUE » DES POGROMS
Blüher s'opposera à l'idéologie d'Hitler. Il refusera même les propositions d'Ernst Röhm, malgré ce qui unit les 2 personnages : le royalisme du chef des SA, la position qu'il a occupée dans la Garde Blanche, ses projets pour le mouvement national de la jeunesse, qu'il entend rénover en y réintroduisant la pédérastie sacrée des Doriens. Il est curieux de constater que le principal grief de Blüher contre Hitler ait été sa crainte de voir Hitler donner une mauvaise image de marque des antisémites.
Dans ses discours comme dans les publications qu'il a consacrées au problème juif, Blüher a toujours mis les Allemands en garde contre les pogroms. Dès les années 20, Blüher écrit : « Les pogroms sont une chose tout à fait particulière, parce que le peuple juif est un peuple tout à fait particulier. Pour peu qu'un pogrom sanglant éclate en Allemagne, il se trouvera très certainement à Prague, Amsterdam ou Varsovie un sage parmi le peuple juif pour lever les bras au ciel et dire : "Écoute, Israël, ton heure est venue. Tes ennemis ont pris ton sang, Le seigneur a donné la victoire à son peuple !" Et il aura raison. Il n'y a pas pire erreur que de croire qu'un pogrom nous libèrera du judaïsme. (,..) Le judaïsme ne se trouve pas détruit lorsqu'on s'attaque à son sang, il est victorieux dans la nation qui le fait. »
Ce qui explique que Blüher ait été à ce point effrayé par les pogroms nationaux-socialistes qu'au sommet des succès de Hitler, en 1938, il ait cherché à se convertir au judaïsme, en signe de protestation. Après l'effondrement du national-socialisme par contre, il déclarera haut et fort qu'il est désormais possible et moralement acceptable de s'attaquer au problème posé par le judaïsme. Hans Blüher fait partie de ces gens qui traversent le temps, autant par leurs acquis que par leurs erreurs, plus évocatrices peut-être que les « connaissances » que peuvent livrer de petits esprits. Et ce qu'il s'agisse de sa mauvaise appréciation des potentialités de la femme, de sa conversion au christianisme ou de ses attaques contre le judaïsme.
LA RECONNAISSANCE DES AMOURS MASCULINES
Ce qui restera inoubliable dans son œuvre, c'est sa reconnaissance de la confrérie, du rôle de l'érotisme dans la société masculine, origine et condition de la culture. Cette lutte pour la reconnaissance de l'homosexualité, il l'a menée jusqu'au bout. Dès la création de la république fédérale, il adresse au Parlement ce message : « Tout Allemand cultivé soucieux de l'image de sa patrie et de la justice se doit de prendre parti contre les lois réprimant encore les relations homosexuelles masculines. Si trop peu de voix s'élèvent pour réclamer la suppression pure et simple de ces articles, c'est par crainte de la réprobation sociale. N'échappent à la peur que ceux qui ne craignent pas les hommes quand il est question de vérité et de justice. Par malheur, ils sont rares ». Blüher est de ceux-là.
Dès 1949, à une époque où personne ne pense encore à une émancipation, il notifie au parlement allemand que « c'est un crime contre la culture que d'avoir repris les paragraphes injustifiables et contre nature d'un État de non-droit ». Sachant quelle est l'autorité suprême, dans l'Allemagne d'Adenauer, Blüher fait un pas supplémentaire. Il envoie au Vatican celui qui sera son exécuteur testamentaire, Guillermo Herckmans-Hengsch, qui dirige alors une banque privée de Madrid et entretient de bonnes relations avec l'Opus Dei. Le pape Pie XII devra supporter d'entendre que Blüher estime souhaitable une « réparation » de l'Église catholique. Hitler n'a-t-il pas sacrifié Ernst Röhm, entre autres, à l'Église catholique ! Les intrigues et les attaques des catholiques ont directement préludé à l'arrestation puis à l'assassinat de Röhm et de ses amis. Blüher sait aussi qu'un homme de confiance de la conférence épiscopale a donné son accord à Hitler. Le renforcement de l'article 175 réprimant les rapports homosexuels fut essentiellement un cadeau fait à l'Église catholique. Blüher ne se fait guère d'illusions quant à ses chances de succès auprès de la hiérarchie catholique et de la République Fédérale. Du moins ses réflexions resteront-elles inscrites dans l'histoire.
Sa vie s'approchait de son terme. Une semaine avant son décès, survenu le 4 février 1955, il convoque sur son lit de mort tous les amis, élèves et partisans qu'il parvient à joindre. Il leur livre ses dernières volontés. Surtout, il leur fait promettre de se consacrer universellement à la libération et à la réhabilitation des amours masculines et pédérastiques, condition nécessaire de la continuation et du renouveau de la culture et des meilleures traditions humaines. Ainsi, les grands projets esquissés dans l'Antiquité européenne pourront-ils un jour se trouver réalisés. Un témoignage pour l'éternité.
(1) Manuscrit complété et publié en 1966 sous le titre : Discours d'Aristophane Prolégomènes à une sociologie de l'espère humaine. Malheureusement, les conceptions blühériennes y sont plus interprétées que décrites, ce qui nuit à l'authenticité de l'ensemble.
***
◘ 3) Joachim Münster, Gaie France n°8 (déc. 87 – janv. 88.) : p. 25-29.
SUR LE CHEMIN DES ENFANTS
L'Éros blühérien dans le mouvement allemand de la jeunesse
 Dans un article sur la pédérastie, « Mannen och Pojken » (1980), le poète suédois Nils Hallbech découvre chez les Wandervögel et dans le culte de Maximin si cher à Stefan George la renaissance de l'amour grec.
Dans un article sur la pédérastie, « Mannen och Pojken » (1980), le poète suédois Nils Hallbech découvre chez les Wandervögel et dans le culte de Maximin si cher à Stefan George la renaissance de l'amour grec.
Les éditions Pojkart ne sont-elles pas issues elles-mêmes des Wandervögel ! ou plutôt de l'une des 2 ligues majeures qui s'en réclament aujourd'hui : le Nerother Wandervogel ! C'est en 1974 qu'on voit apparaître très nettement dans cette ligue une homophobie doublée de l'obligation d'ascèse. Dès qu'il est question de jolis garçons, le grand maître des Nerother n'a qu'un mot : « fade ». Il est vrai que son accession à la couronne des chevaliers du cygne n'est intervenue qu'au prix d'une lutte sans merci menée à grand renfort d'histoires pédérastiques sur fond de sacs de couchage.
Plusieurs groupes scissionnèrent de cette organisation soudain bien puritaine, entre autres un groupe autonome, Hellas, un cercle adolescent répondant au nom de Phoenix et une section berlinoise du Nerother Wandervogel, proche du magazine pédophile Philius, publié depuis près d'un an. Quant à la seconde ligue Wandervogel subsistant actuellement, elle est mixte. Elle l'était d'ailleurs en 1913, lors de la parution de l'étude qui fonda la conception blühérienne de l'amitié virile, étude révolutionnaire qui suscita, nous le verrons, les plus vives controverses au sein des Wandervögel entre les partisans de la dissimulation et les tenants de l'exaltation de l'homosexualité au sein du mouvement allemand de la jeunesse. À l'époque, la Ligue allemande des Wandervögel énonçait sur un ton mi-ironique : « L'État Blüher n'est qu'une voie parmi beaucoup d'autres d'entrer dans le mouvement Wandervogel ».
L'étude avait été rédigée par Hans Blüher (1888-1955), membre actif des Wandervögel de 1902 à 1909. Son troisième tome, communément appelé Blüher III, (il s'intitule en fait Le mouvement allemand Wandervogel comme phénomène érotique : Contribution à une reconnaissance de l'inversion sexuelle, 1912) prend appui sur des faits concrets pour affirmer que l'orientation homosexuelle est naturellement un élément moteur du mouvement, qu'elle prenne des formes latentes ou refoulées ou se manifeste sur un plan sexuel.
Le mouvement Wandervogel, né en 1901, est alors subdivisé en une douzaine d'organisations comptant quelque 25.000 membres. Parmi les réactions les plus vives enregistrées à la parution de Blüher III, on peut noter celle de la Ligue allemande des Wandervögel. Les dirigeants de l'organisation, qui compte plus de la moitié des 25.000 membres, craignent le scandale ; ils se hâteront d'assurer tous les directeurs d'école de leur rejet des arguments de Blüher qui n'auraient d'autres sources selon eux qu'une imagination maladive. Toute personne suspecte est d'ailleurs réputée exclue de l'organisation. Blüher III trouvera un accueil favorable mais prudent au sein du Jungwandervogel, organisation de moyenne importance (2.300 membres en 1913).
Si la théorie développée par Blüher III est brillante, le texte ne fournit aucune indication précise quant aux différents degrés et manifestations d'amitié virile des organisations, et pour cause ! Dans ces conditions, il peut paraître hasardeux de vouloir faire revivre le passé. Tout au plus peut-on tenter de reconstituer les éléments d'un puzzle d'ailleurs bien incomplet : Blüher omet par ex. d'indiquer que le Jungwandervogel fut l'un des bastions de la pédérastie, or il est clair aujourd'hui que c'est bien sur lui et sur son prédécesseur, l'Altwandervogel, que Blüher se fonde lorsqu'il fait mention d'un érotisme viril que rien ne vient briser.
En 1905, sur le conseil de Hans Blüher, l'Altwandervogel accueille un hobereau, Wilhelm Manssen (1866-1943) (1). À cette époque, l'Altwandervogel n'a d'antenne qu'à Berlin et à l'est de l'Empire allemand. W. Mansen l'implantera à l'ouest. C'est un tombeur de garçons doué d'un charisme étonnant, constamment entouré d'une nuée d'adolescents. Dans ses mémoires, Werke und Tage (1953), Blüher rapportera plusieurs décennies plus tard qu'il n'avait qu'à choisir pour qu'un garçon (2) l'accompagne dans sa couche.
L'affaire Eulenburg-Molkte-Harden (3) plonge l'empire allemand dans un délire homophobe qui amène à l'intérieur même du mouvement allemand de la jeunesse, publiquement cité au regard de ses mœurs, la première guerre pédérastique. Au sein de l'Altwandervogel, c'est la chasse aux sorcières contre tous ceux qui, comme Jansen, défendent la pédérastie. Blüher discerne parmi les plus acharnés des ennemis des amoureux des garçons ceux-là même qui, attirés par ces derniers, refusent d'admettre leur inclination. Des hommes en somme qui déplacent le champ de la confrontation de l'intérieur vers l'extérieur. À l’époque, Blüher écrit qu'au terme de cette lutte entre christianisme et hellénisme au sein du mouvement Wandervogel, tous les amoureux des garçons sont écartés des postes de commandement; en fait, il n'en est rien, mais Blüher souhaite plus que tout éviter une nouvelle confrontation.
Dès 1910, le Jungwandervogel scissionne de l’Altwandervogel pour se regrouper autour de Wilhelm Jansen. La création de cette nouvelle organisation fut pour Hans Blüher l'occasion d'écrire son étude. Les plus illustres des chefs de groupe des Jungwandervogel concourent d'ailleurs à sa rédaction et en écartent certains propos, jugés trop directs.
Tentant de laver le mouvement de jeunesse allemand de sa « tâche » homosexuelle et d' « oublier » les bases posées par Blüher, l'histoire contemporaine a souvent retouché son image, notamment en regard du Jungwandervogel. C'est ainsi qu'un certain Otto Piper, qui fut le chef nominal du Jungwandervogel entre l'automne 1912 et l'été 1913 se souvient que dans son organisation, il n'y avait pas plus de vrais homosexuels que dans les autres groupes, et dans la société. Simplement, le thème de l'homosexualité y était plus fréquemment évoqué, et avec plus de tolérance. La formulation de Piper est habile. Hans Blüher établissait en effet une distinction très nette entre les vrais homosexuels et les amoureux des garçons à qui il appliquait le qualificatif d' « inversion sexuelle » (4). Par le terme de vrais homosexuels, Blüher désignait des hommes qui participaient d'une sub-culture citadine et faisaient l'objet des recherches de Magnus Hirschfeld. Si la première édition de Blüher III est préfacée par le célèbre sexologue, le fossé apparaît lors de la deuxième édition entre ces homosexuels citadins et les amoureux des garçons.
Entre-temps, Blüher a fait la connaissance de Magnus Hirschfeld et de son cercle. Une vision qui l'horrifie. Il y a entre Hirschfeld et lui toute la différence qui sépare San Francisco de Sparte. En ce sens, le Jungwandervogel compte peu de vrais homosexuels, Piper n'a pas menti, se contentant d'induire en erreur le grand public peu coutumier de ces distinctions.
Durant son adolescence, H. Blüher s'adonnera avec passion à l'amour tant pédérastique qu'homosexuel, au collège de Steglitz (près de Berlin) tout d'abord, lieu qui vit la naissance du mouvement Wandervogel, puis au sein de l'Altwandervogel. Par la suite, il se tournera vers les femmes, sans jamais perdre toutefois l'intérêt théorique qu'il portait à l'amitié virile à qui il attribuait la fondation des États.
On sait bien peu de choses de la deuxième décennie de ce siècle. La troisième décennie est l'époque des mouvements de jeunesse, et l’amitié virile y est plus présente encore qu'au début du siècle bien que le fait soit moins connu, sans doute parce que les traces de cette troisième décennie sont plus dispersées et qu'aucune œuvre significative ne vient la marquer.
Elle s'ouvre par la seconde grande guerre pédérastique du mouvement de jeunesse allemand. C'est précisément dans l'organisation qui avait réagi avec le plus de violence à Blüher que vers 1920 dans plusieurs sections du Wandervogel e.V., notamment à Brème et en Saxe, des chefs de groupe plaident la cause de la pédérastie ; la discussion s'engage jusque dans les colonnes de ses publications officielles. Deux dirigeants connus pour leurs goûts pédérastiques meurent mystérieusement en été 1920 lors d'un voyage de groupe en Suède.
Alarmé, le président du Wandervogel e.V. commande une étude destinée à réfuter Blüher III. Il n'eut qu'un pamphlet, assez mauvais de surcroît : Antiblüher – Groupement d'hommes ou de singes ? (5). Cette étude fut néanmoins envoyée gratuitement à tous les groupes de l’organisation, entraînant un torrent de protestation et une nuée de brochures et d'articles de journaux. La plupart des critiques condamnèrent l'aspect polémique de l’Antiblüher sans oser toutefois dans un tel contexte se faire les avocats de Blüher. Une demie douzaine de groupes quittèrent l'organisation et créèrent en 1921 le Wandervogel Jugendbund. Quant au Wandervogel e.V., il ne tarda pas à s'autodissoudre.
 La troisième décennie du mouvement allemand de la jeunesse vit aussi la naissance de l'organisation Wandervogel qui plus que nulle autre a été associée à l'amour pédérastique. Dans la nuit du 31 décembre 1919 au 10 janvier 1920, huit dirigeants issus de l’Altwandervogel fondèrent sur un sommet de l'Eifel près de Neroth dans le Pfälzer Drachenburg (mot à mot le Fort du Dragon) une cellule plus ou moins clandestine qui donnera naissance, à Pâques 1921, au Nerother Wandervogel, deutscher Ritterbund (Ligue de Chevalerie allemande des Wandervogel de Neroth). Le dynamisme et le romantisme de cette ligue, qui comptera de 500 à 1.000 adolescents, sont légendaires. Les chefs de groupes, confirmés dans leurs fonctions par l'initiateur monarchiste de la ligue, Robert Oelbermann (1896-1941) [ci-contre vers 1930] portaient le béret en velours à côtes rouge des chevaliers et les jeunes garçons le béret bleu des écuyers. On se disposait à construire une forteresse du Graal dans les profondeurs du Hunsrück. Une troupe partit entreprendre le tour du globe...
La troisième décennie du mouvement allemand de la jeunesse vit aussi la naissance de l'organisation Wandervogel qui plus que nulle autre a été associée à l'amour pédérastique. Dans la nuit du 31 décembre 1919 au 10 janvier 1920, huit dirigeants issus de l’Altwandervogel fondèrent sur un sommet de l'Eifel près de Neroth dans le Pfälzer Drachenburg (mot à mot le Fort du Dragon) une cellule plus ou moins clandestine qui donnera naissance, à Pâques 1921, au Nerother Wandervogel, deutscher Ritterbund (Ligue de Chevalerie allemande des Wandervogel de Neroth). Le dynamisme et le romantisme de cette ligue, qui comptera de 500 à 1.000 adolescents, sont légendaires. Les chefs de groupes, confirmés dans leurs fonctions par l'initiateur monarchiste de la ligue, Robert Oelbermann (1896-1941) [ci-contre vers 1930] portaient le béret en velours à côtes rouge des chevaliers et les jeunes garçons le béret bleu des écuyers. On se disposait à construire une forteresse du Graal dans les profondeurs du Hunsrück. Une troupe partit entreprendre le tour du globe...
Des 5 « sagesses » de la constitution fédérale inofficielle, la deuxième condition sine qua non était mot pour mot « un amour intense de l'ami ». Plus tard, on tentera parfois d'affaiblir le sens de ce précepte qui fut à la base de toutes les organisations Wandervogel en l’interprétant comme une « noble amitié ». Noble amitié, certes, mais pas au sens où s'entendent nos apprentis-ascètes.
Le plus célèbre des écrivains issus du Nerother Wandervogel fut Werner Helwig (1905-1985). Marié à une Française, il vécut la fin de sa vie à Genève et écrivit plusieurs ouvrages sur la Grèce et le Japon. Dans ses mémoires, Auf der Knabenfährte (1951), il rapporte qu'à l'époque de son passage dans le Nerother Wandervogel, il n'était pas inhabituel qu'une relation amoureuse s'établisse entre le chevalier et son écuyer. À la source de son « Eros energoumenos » (6), raconte, Helwig, il y eut un jeune garçon de 15 ans, Nechbe, qui fut son écuyer et sur lequel il veilla « amoureusement ». Helwig semble avoir eu un autre amour, un certain Alf à qui, pendant la courte idylle, il dédia semi anonymement le poème « Von der Nordsee zum Rhein » (1960) (7). Passées ses années de jeunesse, Helwig se tourna vers les femmes.
Le premier roi des Nerother, Robert Olbermann, lui mourut en camp de concentration, victime de l'art. 175 réprimant les rapports homosexuels. Son frère jumeau Karl, qui préféra s'exiler en Afrique du Sud, reprit la couronne de la ligue dans les années 50 et fit ériger à l’endroit prévu pour la forteresse imprenable du Graal un domaine inspiré de chevalerie. Seules demeurèrent sacrées ses fontaines de pierre, où venaient s'abreuver les oiseaux, les expéditions du groupe à Montségur dans le château cathare et un bois où fut notamment érigé un monument à la mémoire de Hans Blüher.
Mais à l'insu du second roi des Nerother vieillissant se constituèrent des groupes oublieux de la seconde sagesse. Pire encore, le vieux roi dut se faire seconder par un personnage trouble, jésuite, qui parvint contre son avis à remplacer le maître d'un second manoir des Nerother dans le Taunus, imprégné d'une saine joie de vivre, par un ascète de ses confidents. Il parviendra même finalement à succéder au roi.
Le nouveau maître se fera fort de passer sous silence l’histoire interne de la ligue ; pourtant, la parution en 1985 de l'étude de Stefan Krolle, Les intrigues des ligues : Histoire du Nerother Wandervogel avant et sous le national-socialisme – Une ligue de jeunesse entre conformisme et résistance, détruira ses espoirs. Krolle est issu d'une scission de gauche des Nerother Wandervogel. Il n'élude pas la question de l'art. 175 et surtout, il publie pour la première fois 2 lettres de Robert Oelbermann, alors en détention préventive, adressées à la Gestapo, dans lesquelles il défend la pédérastie, au détriment, il est exact, des « vrais homosexuels ».
Nous n'avons jusqu'ici évoqué que les Wandervögel. La troisème décennie du mouvement allemand de la jeunesse se caractérise pourtant aussi par le fait que les éclaireurs et les organisations scoutes se rapprochèrent, voire se confondirent avec les Wandervögel. Les théories de Blüher se concrétisèrent très clairement au sein de la Jungmannschaft Königsbuhl, devenue autonome fin 1923 [après avoir quitté le Bund der Köngener], qui se détacha de ses origines piétistes pour se fondre en 1924 en une Ligue des Nouveaux Éclaireurs [Neuapfinder], mystique et synchrétique dévouée à l'idole d'un Chevalier blanc. Pour les Nouveaux Éclaireurs, ce Chevalier Blanc symbolisait le rédempteur et l'« Éros adolescent ». Dans ses Pensées et souvenirs : Une jeunesse en Allemagne (1986), Golo Mann, fils de Thomas Mann, évoque des expériences d'Éros profane au sein de cette ligue.
La théorie blühérienne se retrouve dans Königsbühl (1925), roman quasi-autobiographique de Joachim Boeckh, chef du Jungmannschaft Königsbühl. À la base de l'idée de Blüher, reprise par l'auteur, un cercle ainsi structuré : au centre de la vie du groupe, un personnage, le Männerheld (sorte de héros tombeur de garçons) qui tire l'essentiel de son énergie créatrice de sa relation plus ou moins réciproque avec son « favori ». Autour de ces 2 jeunes gens, un cercle restreint d'anciens favoris et de personnes de second plan. À l'extérieur, un cercle plus large de garçons qui ignorent de ce qui se passe réellement au centre du groupe et créent donc une zone tampon naturelle avec le monde extérieur. Cette structure s'accommode de la présence d'autres entités organisées de manière semblable autour d'un chef moins charismatique.
Christoph Markwart est le chef suprême de Königbühl ; il a 25 ans et se prénomme comte d'empire ; son favori est l'aspirant Ottel. Ils sont passionnément épris l'un de l'autre et rêvent d'un nouvel empire à la Stefan George. L'activité qu'ils déploient, l'Éros néo-païen qu'ils entretiennent attirent à eux d'autres groupes.
Sans vouloir ici mentionner les plus évocateurs des quelque cent groupes qui se constituèrent dans les années 30 (puis disparurent pour la plupart), on peut néanmoins citer la confrérie la plus élitaire de l'époque : le Graue Corps, et la plus nombreuse, la Deutsche Freischar. Créé à la fin des années 20 à partir du Ring, groupe de jeunes piétistes suisses, le Graue Corps s'établit principalement en Allemagne. Il s’impose une transcendance gnostique chère à son chef mystique, (Al)fred Schmid (1899-1968), inventeur millionnaire et professeur de chimie à l'université de Bâle. Schmid assimilait les garçons qu'il choisissait pour son Corps à de nobles roses odorantes dont les étamines se font pétales. Il se vouait à un « Éros socratique » et associait à son rôle la notion spartiate d'eisplenas, qui incluait dans la Grèce antique l'initiation des garçons. Un observateur issu de la Deutsche Freischar habitué à des formes plus simples d'amours pédérastiques, rapporte dans ses souvenirs l’étrange impression que lui firent la centaine de jeunes que comptait le corps : « Descendirent, cravache à la main, des adolescents qu'on aurait pu croire sortis d'un concours de beauté masculine ».
Spectacle que la Freischar ne pouvait assurément pas offrir, malgré ou précisément à cause de ses quelque 10.000 membres. Le groupe de Stettin possédait bien les œuvres de Blüher, mais elles étaient reléguées dans le département sulfureux de la bibliothèque du groupe. Bon nombre d'écrivains ascètes et pédérastes sortirent de ses rangs. Parmi ces derniers, Heinz Birken, de son vrai nom Heinrich Eichen (1905-1986).
L'ère nationale-socialiste marque une césure profonde pour ces groupes, désormais interdits. Pour empêcher tout maintien d'activités, le nouveau régime fait un large usage de l'article 175. Après la Seconde Guerre mondiale, les organisations de masse scoutes domineront. Par comparaison, on a assez peu de documents sur cette époque. On complètera cette description par un renvoi au célèbre roman de Reinhard Gröper (Egbert-Hans Müller), né en 1929 : « Limfjord-Muscheln (1979-1984) Il y décrit une relation éphébophile à l'intérieur de la Ligue des Éclaireurs Allemands dans les années 50 et des rapports homosexuels entre des scouts allemands et des scouts suédois. L'un des garçons raconte symboliquement une tentative de séduction en Suède : « C'est alors que l'Aigle essaya vraiment de déployer ses ailes sur moi. Je ne songeai pas à assumer le rôle de Ganymède. Je levai alors mon bras : – Sire, dis-je fermement, je suis protestant. La référence au baptême fit son effet. »
Ces paroles, que Reinhard Gröper veut ironiques, illustrent toute la problématique de l'Éros blühérien à l'époque. Ni les premiers Wandervögel ni le mouvement allemand de la jeunesse ne pouvaient dans leur ensemble réaliser cette renaissance de l'amour grec : le cadre social était trop empreint de christianisme. Malgré l'insuffisance des informations disponibles, on peut considérer que l'amour grec n'a été pleinement vécu que dans des ligues ou à l'intérieur des ligues dans des cercles imprégnés d'une volonté d'évasion dans les forêts profondes et d'exploration du passé ou du culte d'une certaine excentricité. Il serait d'ailleurs fort instructif d'étudier la vie interne de ces groupes...
J.M.
Notes :
(1) Entre-temps, la renommée de Jansen a franchi l'Atlantique : Richard Mills lui a consacré un article intitulé « A Man of Youth : Wilhelm Jansen and the German Wandervogel Movement » (in Gay Sun shine, 10th Anniversary Issue 1980, Section 2, p. 48-50, San Francisco).
(2) Le terme de garçons se rapportera toujours ici à des adolescents.
(3) À partir de 1906. « Maximilian Harden » accusa à mots voilés le prince Philipp zu Eulenburg-Hertefeld et le comte Kuno von Molkte d'avoir enfreint l’article 175.
(4) L'« inversion » blühérienne n'est pas à prendre au sens d'une homosexualité réceptive. Par ce terme, Blüher entend une inversion de l'Éros de l'autre sexe vers le sien propre et non pas une transformation des rôles sexuels.
(5) Écrit par J. Plenge. En 32 pages, Blüher est qualifié de singe 91 fois !
(6) [note rajoutée] Éros énergumène : thème ornemental apparu à l'époque hellénistique, avec pour avatar romain Cupidon, et à la Renaissance un petit chérubin joufflu. Il désigne ici une figure allégorique désignant un tentateur espiègle, expérimentateur, éphémère et fulgurant, déjouant toute conception idéaliste de l'amour, pareil à celui évoqué par Paul Valéry, sous des angles différents, dans les rapports entre un Faust désabusé, son disciple ou la secrétaire Lust, décrits dans Mon Faust (1946) – ébauche théâtrale exprimant par ailleurs autant un drame personnel que la grande "crise de l'esprit" auquel est confrontée la civilisation européenne, avec ses prodigieuses avancées scientifiques et philosophiques mais aussi ses désastres éthiques et humains.
(7) In Die blaue Blume des Wandervogels, Werner Helwig, 1960. Le récit a été expurgé de la seconde édition (1980).
***
◘ 4) Gaie France n°8 déc. 87 – janv. 88 : p. 30.
• Texte de Hans Blüher
 Il est loin, me semble-t-il, le temps où la question des rapports intermasculins n'appartenait qu'aux homosexuels et ne concernait qu'eux. Nos connaissances en matière sexuelle ne nous permettent plus d'y voir un domaine clairement défini, les rapports existant entre les formes tangibles d'homosexualité et les nuances immanentes que l'on retrouve à travers toute notre culture sont tellement évidents que l'intérêt s'est déplacé d'un stéréotype de l'inverti apparu récemment à un phénomène beaucoup plus vaste : l'attirance générale de l'homme pour l'inversion sexuelle, qui nous offre des perspectives beaucoup plus larges sur l'être humain.
Il est loin, me semble-t-il, le temps où la question des rapports intermasculins n'appartenait qu'aux homosexuels et ne concernait qu'eux. Nos connaissances en matière sexuelle ne nous permettent plus d'y voir un domaine clairement défini, les rapports existant entre les formes tangibles d'homosexualité et les nuances immanentes que l'on retrouve à travers toute notre culture sont tellement évidents que l'intérêt s'est déplacé d'un stéréotype de l'inverti apparu récemment à un phénomène beaucoup plus vaste : l'attirance générale de l'homme pour l'inversion sexuelle, qui nous offre des perspectives beaucoup plus larges sur l'être humain.
En d'autres termes : l'humanitarisme cède la place à l'humanisme. Ce jeu de mots ne prend toute sa signification que si l'on fait quelque peu abstraction du sens premier de l'« humanisme ». Je veux dire par là que tant qu'il s'est agi de protéger la catégorie spécifique des invertis contre les mauvais traitements dont les affligeaient la société et le droit pénal, on a fait appel à la tolérance. On affirmait la nécessité d'une attitude humanitaire envers des « malheureux ». Ce raisonnement témoigne d'un degré d'avancement de la civilisation et je le suppose aller de soi. Mais je formulerai ici un autre type de réflexion.
Loin de constituer une extravagance de la nature, le plan sexuel qui s'incarne au niveau le plus haut dans le personnage de l'inverti intervient dans la vie de chacun et ne peut se concevoir séparément. Les homosexuels ne sont que des cas particuliers qui s'inscrivent dans la tendance générale de l'être humain à l'inversion sexuelle. Parfois même, la discrétion de leur comportement empêche que puisse s'appliquer à leur égard la notion de « tolérance ». Ici, il est question non plus de civilisation, mais de culture. Ce n'est plus une affaire de tolérance (on sait que Gœthe voyait dans ce terme une insulte), mais d'acceptation.
Cette révolution des mentalités, tous les corps de la société n'en sont pas capables. L'Église n'y parviendra jamais. Elle peut sous la contrainte tolérer les hérétiques, les libres penseurs etc., elle ne les acceptera jamais sur la base des faits qui ont fondé l'existence des hérétiques et des croyants. Mais nous en appelons ici à des formes d'organisation spirituelle beaucoup plus hautes que l'Église.
Si la science parvient à démontrer l'existence d'une chaîne ininterrompue de degrés d'inversion sexuelle et qu'une application puisse être définie, l'homo sapiens devra se resituer au regard de ces étapes. Il n'est plus question ici de bons sentiments ou de bel esprit : l'impératif catégorique de la pensée culturelle réclame la reconnaissance de ces lois et leur application. Si connaissant les faits explicatifs et leur interprétation théorique, on néglige de faire ce pas, on perd immédiatement la notion reliant la morale culturelle à cette question.
La conception développée ici se heurte à trois facteurs :
1. les tendances à la glorification de l'homosexualité à l'intérieur même du cercle des personnes concernées,
2. la tendance inverse de ceux qui, poursuivant une stratégie défensive, se bornent à tenter d'abattre les obstacles juridiques en reléguant la question dans le domaine privé,
3. toutes les personnes qui fondent leur conception morale sur une vision hétéronome.
Commençons par ce dernier point : Les réformateurs en termes de sexualité tentent parfois d'interpréter les forces historiques jusqu'ici dominantes dans les questions essentielles et requièrent d'elles une nouvelle prise de position. C'est ainsi qu'on en arrive toujours à un moment donné à demander la bénédiction de l'Église et son soutien. S'il est appréciable que de temps à autres une parole aimable émane de ces instances, ces positions sont dénuées de valeur culturelle. On pourra la tourner et la retourner comme on voudra, en dernière instance, l'éthique chrétienne est toujours hétéronome. Le concept extensible de dieu qui semble parfois stérile, panthéiste et donc inoffensif, apparaît l'instant suivant avec toute sa force : il est le « tout-puissant ».
Les « commandements de Dieu » peuvent bien être modulés, arrangés par le christianisme moderne, ils restent étrangers à l'essence humaine : l'homme ne peut envisager de conduite morale qu'en s'écartant de ses préceptes. Hétéronomie et morale sont incompatibles. On pourra l'appeler obéissance, dévouement, humilité, ils ne seront jamais volonté morale. Celle-ci n'obéit qu'à son propre impératif. Aucune volonté culturelle fondée sur la connaissance des faits naturels et aspirant à tirer de celle-ci des valeurs nouvelles ne peut se résoudre à s'imposer un alignement sur d'anciennes traditions. Il n'est pas de commandement hors le fait du commandement.
Si le christianisme s'attache maintenant à participer à la discussion, il est clair que sa position ne peut aller au-delà de la simple tolérance. On sait que de nombreux pasteurs se sont penchés sur la question homosexuelle : les valeurs défendues par le christianisme se heurtent à la modernité. Ses nouveaux apôtres louent à présent sa capacité d'adaptation en établissant que le christianisme s'est modelé à toutes les situations, à toutes les mentalités et à toutes les races. Un comportement qui appliqué à un individu serait interprété comme un défaut de caractère passe pour de la grandeur dès qu'il s'agit du christianisme.
Et de fait, cette religion s'est réellement adaptée à tous les milieux, elle transfert son hétéronomie à toutes les situations. Il n'est que de la voir se laisser accaparer à droit égal par les classes possédantes et les masses laborieuses, par l'impérialisme et le socialisme, par l'idée guerrière, l'idée de génocide et le pacifisme. Le christianisme a tendance à se mettre au service de tout ce qui présente quelques chances de succès. Depuis l'Antiquité, il a accompli et absorbé les opinions les plus contraires en s'imposant concession sur concession. Et j'ai le sentiment qu'il est en train de s'absorber lui-même, une issue qui lui sera fatale.
Il n'y a pas lieu de s'en lamenter : tout mode conceptuel est temporaire, après quoi il devient inopérant car il ne correspond plus à la situation nouvelle. En voulant le maintenir inutilement en vie, on ne fait que gangrener la jeune et saine culture en devenir. Le Christ a parlé du vin nouveau qu'il ne fallait pas verser dans de vieilles outres. Ce mot ne pouvait pas trouver meilleure application que la religion fondée par ses élèves.
[Illustration : Gravure sur bois (vers 1930) de Borris Goetz, qui fut membre du Graue Corps, la ligue de jeunesse la plus élitaire de l'époque.]
***
◘ 5) Veit A. Walkenhove, Gaie France n°9 mars-avril 88 : p 19-30.
HANS BLÜHER ET LE MOUVEMENT HOMOSEXUEL
Après l'histoire des ligues, celle de leur théoricien : Hans Blüher, né il y a tout juste un siècle. Menacé de renvoi à 15 ans parce qu'il couche avec ses petits camarades, il est sauvé in extremis par le chef et fondateur du Wandervogel, Karl Fischer, qui place en lui sa confiance. Très vite, Blüher entrera dans l'orbite de Wilhelm Jansen, jeune hobereau amoureux lui aussi des garçons. Confronté aux affairistes, aux bourgeois et au clergé infiltrés dans le mouvement, Blüher sera amené à entamer une réflexion théorique sur l'origine et la nature des ligues masculines. Ce sera pour lui la découverte de Freud et des cercles homosexuels de Magnus Hirschfeld. Mais leur matérialisme sexuel l'exaspère. Pour Blüher, les amours masculines sont porteuses de valeurs. C'est le deuxième volet de notre enquête.
Le propre du paganisme est de ne pas enfermer la réalité dans un carcan. La réalité est polymorphe, et le vécu homosexuel multiple. Il s'exprime, entre autres, magnifiquement, dans l'univers des confréries. (Michel Caignet)
UN MOUVEMENT DE LA JEUNESSE ALLEMAND DIVISÉ SUR LA QUESTION DES AMOURS MASCULINES
 Si l'étoile de Wilhelm Jansen était ascendante, celle de Karl Fischer baissait. Fischer était un personnage très abrupt, très dur, dont le caractère s'accordait parfaitement avec son éthique aristocratique, ses aspirations élitaires et son emprunte dominatrice. Sa méconnaissance pratique de l'homme offrait un contraste saisissant avec sa foi en l'inégalité humaine. Car si les meilleurs se sentaient irrésistiblement attirés vers lui, bien qu'il leur mena souvent la vie dure, ses propres faiblesses, communes à la plupart des natures autocratiques, le conduisirent à placer à des postes de commande des intrigants qui déservirent la cause et conspirèrent plus tard contre lui. Il paraît établi que Karl Fischer n'a jamais éprouvé de sentiments pour une femme, son amour était tout entier dirigé vers la jeunesse masculine.
Si l'étoile de Wilhelm Jansen était ascendante, celle de Karl Fischer baissait. Fischer était un personnage très abrupt, très dur, dont le caractère s'accordait parfaitement avec son éthique aristocratique, ses aspirations élitaires et son emprunte dominatrice. Sa méconnaissance pratique de l'homme offrait un contraste saisissant avec sa foi en l'inégalité humaine. Car si les meilleurs se sentaient irrésistiblement attirés vers lui, bien qu'il leur mena souvent la vie dure, ses propres faiblesses, communes à la plupart des natures autocratiques, le conduisirent à placer à des postes de commande des intrigants qui déservirent la cause et conspirèrent plus tard contre lui. Il paraît établi que Karl Fischer n'a jamais éprouvé de sentiments pour une femme, son amour était tout entier dirigé vers la jeunesse masculine.
En revanche, nul n'a jamais prétendu que cet amour éphébique se soit jamais traduit d'une manière érotique ou sexuelle chez ce rigide Prussien. Et si les attaques portées contre lui coïncidèrent avec le début de l'affaire "Eulenburg"-Harden, il ne fut jamais question d'« homosexualité » à son encontre. Le motif de cette fronde, que dirigeaient un candidat à l'enseignement, le Dr. "Qualle"-Anklam (« la méduse », surnom que lui avait donné Jansen) et un homme d'affaire enrichi, Friese, a été fort bien résumé par Blüher : « Ces démagogues avaient pour principe que tous les hommes sont égaux. Donc les Friese et les Anklam aspiraient à être fondamentalement les égaux de Karl Fischer, irremplaçable entre tous ».
Très durement éprouvé, Karl Fischer chargea l'adolescent de 17 ans qu'était alors Blüher de sonder Jansen pour savoir s'il était prêt à prendre la relève, question que Blüher lui posa à sa manière : « Veux-tu être notre roi ? » Ce à quoi Jansen répondit qu'il ne se sentait pas suffisamment monarchiste pour cela. Pourtant il sera pendant quelques années la figure centrale d'un mouvement de la jeunesse morcelé... il se heurtera dès l’origine aux mêmes ennemis. Cette fois, leurs menées anti-élitaires ne leur étaient d'aucun secours. C'est que la réponse de Jansen au jeune Blüher définissait exactement le personnage : c'était une sorte de Philippe Egalité d'Orléans, un riche grand seigneur brouillé avec sa classe, porté vers l'hédonisme et le "progrès" sans avoir d'ailleurs de conception politique ou idéologique bien définie. Après le monarchisme absolu d'un Karl Fischer, il introduisit une constitution républicaine au sein du mouvement de la jeunesse. Mais Jansen était une personnalité de trop de valeur et de noblesse pour le bourgeoigisme ascendant. Il était tout aussi inacceptable que Fischer. Cette fois, la médiocratie se fit moraliste.
Si Karl Fischer était a priori inattaquable de ce point de vue, pour Jansen au contraire, il était clair que ni la structure de sa personnalité ni ses actes ne répondaient aux normes bourgeoises. On connaissait son engagement public contre la tartufferie bourgeoise et chrétienne et sa lutte pour une renaissance de la culture antique du corps, incluant sa dimension érotique. Mais on savait surtout que son amour des éphèbes ne s'arrêtait pas à ce qui était jugé « convenable ».
Pourtant, sans l'affaire Eulenburg-"Harden", ils n'auraient pu lancer l'attaque frontale et massive qu'ils engagèrent contre lui.
Il faut se rappeler qu'à cette époque, le § 175 ne s'appliquait qu'à la sodomie. Les autres pratiques « homosexuelles » étaient légales à partir de 14 ans. Naturellement, c'est de cela qu'on l'accusa. De même, pour détruire l'ami trahi, Ernst Röhm, Adolf Hitler dut étendre considérablement la portée du § 175. Cette aggravation est d'ailleurs l'un des seuls vestiges législatifs que la RFA n'a pas complètement abolis.
Mais la persécution hystérique de toute forme d'érotisme inter-masculin avait déjà commencé dans les années qui précédèrent la Grande Guerre. La police et la justice de l'Empire connurent un regain soudain d'activité. Une information fut lancée contre Jansen, photographe de son état, certaines « âmes bien intentionnées » suggérant des activités illégales. Après multiples perquisitions et enquêtes, le Parquet rejeta la plainte comme « dénuée de fondement », mais déjà, comme par « miracle », le Dr. "Qualle"-Anklam avait lancé sa croisade, à la manière d'un Grand Inquisiteur, avec cette différence toutefois que la torture psychique tenait lieu de bûcher. Au reste, on pouvait toujours espérer que les victimes auraient le « bon goût » de se suicider ! Blüher raconte : « Cette république libre au nom de laquelle Friese et Anklam s'étaient dressés contre "l'absolutisme" de Fischer s'apprêtait à restreindre la liberté individuelle de chacun d'une manière qui ne s'était jamais vue dans le mouvement Wandervogel. On se prit à envoyer une lettre circulaire à tous les chefs Wandervogel en les sommant de déclarer sur l'honneur s'ils avaient ou non des penchants sexuels pour des personnes du même sexe, plus encore, ils devaient écrire leur opinion sur le sujet et dire quelle importance ils lui accordaient. Leur confirmation dans leur poste dépendrait de leur réponse.
Les choses en étaient là quand Jansen décida cette fois de contre-attaquer et de défendre les amours masculines contre les délires de Witkowski-"Harden". Une entreprise couronnée de succès : ses partisans étaient encore majoritaires dans les ligues. Il mit rapidement un terme à la campagne des lettres circulaires, mais déjà se dessinaient 2 camps partagés sur la question de l'érotisme masculin. Jansen fut peu à peu évincé de la direction du Wandervogel, et les partisans des amours masculines harcelés et progressivement affaiblis.
Pour comprendre la terreur qui régnait dans le « mouvement de la jeunesse », il faut savoir que la campagne moraliste s'appuyait sur un tout nouveau concept des médecins : l'homosexualité. Dès sa création, le terme fut recouvert d'un voile d'infamie. Les médecins ne percevaient l'« homosexualité » qu'en termes de cas cliniques. Une sorte de monstruosité résultant de toutes sortes de tares qu'il fallait « prévenir » pour empêcher la « contagion ». L'origine de la confusion était là. Nul ne pouvait à l'époque sérieusement s'identifier à la création sémantique des juges et des médecins, si bien que la position des amoureux des garçons s'en trouvait affaiblie. Hans Blüher s'opposera d'ailleurs sa vie durant à l'emploi de ce terme « idiot et infâme » des médecins pour décrire les amours masculines : « On ne peut décrire une statue de Praxitèle en utilisant l'image d'un orang-outan ».
DÉFAITE, RÉSISTANCE ET CONTRE-ATTAQUE : L'ÉCLAT DE LA PENSÉE ADOLESCENTE
Un jour, lors d'une audience de l'un des procès "Harden", le mouvement de la jeunesse fut nommément cité. À vrai dire, l'intervention était allusive, marginale, par la suite, nul ne sut même qui l'avait faite. Dans ce pays menacé par le démon de l'homosexualité, « un vieux monsieur avait fondé un club pour emmener de jeunes écoliers en excursion ». Il n'en avait pas été dit davantage, mais la presse titra aussitôt : « Le Wandervogel, un club de pédérastes ! ». Les dés étaient jetés. Le Dr. "Qualle" Anklam saisit le seul fait connu imputable à Jansen. Il en avait lui-même livré les détails dès le commencement des débats aux chefs de la ligue. Il entendait leur montrer par cet exemple la réalité de la vie d'une confrérie d'hommes et d'adolescents, par opposition aux images d'horreur véhiculées par la presse. Ils décidèrent de rompre unilatéralement la confidentialité de ces propos librement tenus et Anklam porta l'affaire devant le public. Les faits, qui remontaient à plusieurs années, s'étaient produits en dehors du Wandervogel et n'étaient pas répréhensibles aux termes du droit allemand de l'époque. Pourtant ils motivèrent la demande d'exclusion que le Dr. "Qualle" formula contre Jansen devant l’assemblée extraordinaire des chefs de la ligue berlinoise réunie à son appel.
Jansen se rendit personnellement à la réunion et tendit sans un mot, méprisant, une lettre de démission que le parti du Dr. Anklam, majoritaire, s'empressa de refuser avant de le contraindre par la force à subir un torrent de calomnies et de voter « démocratiquement » son exclusion de la direction de la ligue. Jansen démissionna alors du Wandervogel, suivant en cela l'exemple de son illustre fondateur, Karl Fischer. Et c'est de l'extérieur cette fois que Jansen influença et conforta ce que le mouvement de la jeunesse déchu comptait encore de confréries d'hommes et d'adolescents. Jansen avait son cercle d'inconditionnels, ceux dont Blüher put écrire, des années plus tard : « Des adolescents de vingt ans, ils surpassaient des gens de tout âge par leur sûreté de jugement et étalent la preuve vivante que l'éclat de la pensée adolescente peut dominer, sinon extérieurement, du moins à l'état latent, en tant que caractère, la folie de l'âge ». Le jeune Blüher était du nombre. Dès l'âge de 15 ans, bien avant l'« affaire » Jansen et les menées de Witkowski-"Harden", il n'avait échappé à l'exclusion du Wandervogel que grâce aux efforts déployés par Karl Fischer. On lui reprochait d'avoir ouvertement entretenu des relations sexuelles avec d'autres garçons de la ligue.
Entre-temps pourtant, son intérêt s'était porté vers le sexe féminin. Il poursuivit des études sans but, dispersées, rédigeant sans dons particuliers pour le genre quelques drames et nouvelles qui le destinaient à la bohème littéraire. L'heure de son destin sonna dans la nuit du 9 au 10 avril 1910. Ce jour-là, Jansen communica à ses fidèles, avec aplomb, mais non sans sarcasme qu'à l'occasion du dixième anniversaire de la création légale de la ligue, les chefs du Wandervogel avaient décidé de publier son histoire et avaient chargé le Dr. "Qualle" Anklam de sa rédaction. Reprenant son sérieux, Jansen se tourna vers Blüher, l'engageant à renoncer à ses drames vieillis que nul ne voulait lire pour se consacrer à sa vraie mission : prendre de vitesse le thuréfiaire du Wandervogel, le persécuteur de son fondateur et de tous les chefs de jeunes authentiques. C'est à lui qu'incombait la tâche d'écrire l'histoire vraie de cette décennie si tumultueuse et si riche en événements. Hans Blüher venait d'avoir 22 ans. Il passa le restant de la nuit à errer sans repos dans le Tiergarten Park. Au lever du jour, sa décision était prise. Quarante-trois ans plus tard, il se souvient : « Une joie indescriptible me saisit : le jour était venu de venger Karl Fischer ! »
Le Wandervogel, Histoire d'un mouvement de jeunesse : le même jour, Hans Blüher communiqua à Jansen le titre de l'étude, imprimant le concept sociologique attaché depuis lors à toutes les manifestations du Wandervogel : le « mouvement de la jeunesse ». Il ne posait qu'une condition : que Jansen accepte sa partition en 2 volets : « Tendance I : le Wandervogel est une révolution de la jeunesse contre la société bourgeoise. Tendance II : le Wandervogel est un phénomène érotique. Ce deuxième point fait difficulté, il m'est impossible de ne pas évoquer librement l'affaire qui t'a ruiné, celle du jeune garçon. C'est soit la vérité, soit le Dr. Anklam ».
Wilhelm Jansen eut le courage d'accepter cette condition. Tout autre était la liberté d'esprit des éditeurs tant bourgeois que "progressistes". Il révélait certaines faiblesses, lui dirent les 2 patrons de la célèbre maison d'édition de gauche de l'époque, Egon Fleischl & co. « Ce n'est pas ce que le public attend. Vous devez écrire ce qui est demandé ! » Par le terme de faiblesse, les 2 socialistes de salon entendaient le fondement érotique du mouvement de la jeunesse. L'un d'eux, Fritz Cohn, était l'époux de la « poétesse du prolétariat » de l'époque, Clara Viebig ; un épisode symbolique de l'hypocrisie des sociaux-démocrates allemands : en 1898, ils réclamaient l'abolition du délit de sodomie, seule pratique homosexuelle condamnée à l'époque, mais ils dénoncèrent l'homosexualité de l'industriel Krupp pour le détruire et tenter de faire échouer le programme naval de l'empereur Guillaume II. En 1927, lors du congrès de leur parti, les sociaux-démocrates réitérèrent leur volonté de faire disparaître le délit de sodomie, pourtant en 1932, ils tentèrent d'impliquer le chef des SA Ernst Röhm pour tenter de freiner l'avance du NSDAP. En 1980 enfin, Helmut Schmidt, alors chancelier, fit échec à l'abolition totale du § 175 inscrite au programme des libéraux, son partenaire de coalition, alors majoritaire.
L'ouvrage qui, malgré la concision et la précision de son jeune auteur comptera au total 3 volumes, ne trouva pas d'éditeur. Jansen prêta à Blüher la somme nécessaire à son édition. Il ne restait plus qu'à trouver un éditeur nominal qui permette la réalisation technique de l'entreprise. Il la trouva chez un petit libraire miteux, sans renom, négligé, un boutiquier juif trônant dans l'arrière-fond de son magasin qu'il fallut d'abord payer. l'affaire s'annonçait mal, d'autant que la parution de l'ouvrage se heurterait fatalement à une conspiration du silence. C'est alors que Blüher eut un trait de génie, un trait d'un raffinement discutable sans doute, mais qui lui assurait publicité et succès.
Le mouvement de la jeunesse était l'objet d'un vaste marché abritant toutes sortes d'hommes d'affaires. Ce créneau englobait outre les publications centrales et régionales des diverses ligues Wandervogel, des maisons d'édition et de diffusion qui se livraient entre elles une âpre concurrence. Blüher leur envoya des extraits de son ouvrage choisis de manière à le faire passer pour un recueil de souvenirs présentant sur un ton alerte et enjoué des expériences romantiques et parfaitement inoffensives. Nul n'avait songé jusqu'alors à écrire ce type d'ouvrage, et personne ne voudrait renoncer aux gains financiers attendus.
Toutes ces publications, y compris l'organe officiel du Wandervogel s'empressèrent de signer le subtil contrat que leur proposait cette maison d'édition curieusement inconnue. Par cet accord, elles s'engageaient à assurer une publicité rédactionnelle à l'ouvrage qu'elles acceptaient par ailleurs de diffuser. En outre, des pavés publicitaires étaient prévus. Ils ignoraient que les extraits proposés, très prenants, enthousiastes et d'un excellent rendement publicitaire étaient extraits non pas d'un, mais de 3 volumes.
Quarante ans plus tard, dans sa biographie, Hans Blüher se rappelle : « Et maintenant, imaginez l'effroi des patrons embourgeoisés du Wandervogel lorsqu'ils reçurent les caisses de livres et réalisèrent quel était l'esprit de l'ouvrage… Le Wandervogel, une révolution de la jeunesse... ! Les plus perspicaces pouvaient lire entre les lignes : le Wandervogel comme phénomène de libération érotique païenne... ! Dès la lecture du premier tome, ils comprirent qu'un sujet tabou entre tous serait ici traité sans ménagement. Mais ils en ressentirent aussi toute la fatalité. Ils avaient signé le contrat, il fallait payer et distribuer le produit malgré la crainte qu'il leur inspirait.
S'ils pensaient pouvoir empêcher la parution du second volume, ils durent se rendre à l'évidence : il était déjà trop tard, les contrats signés avec les petits magazines régionaux en garantissaient la publicité. Une situation horrible ! L'impression que doit ressentir celui qui, ayant avalé un poison, prend soudain conscience que dans quelques minutes, son organisme succombera au terrible combat. Cet ouvrage qui les remplissait de crainte était là, trop présent, et ils ne pouvaient rien. C'est alors que je fis circuler la rumeur de l'existence d'un troisième tome. Qu'allait-il renfermer ? »
Le second ouvrage dépassait déjà tout ce que la bourgeoisie Wandervogel, si avide de respectabilité, pouvait concevoir. Avec une désarmante franchise, qui n'avait d'égale que la liberté des amours adolescentes qui lui furent reprochées lorsqu'il avait 15 ans, Blüher fit toute la lumière sur les puissantes implications homosexuelles du phénomène Wandervogel, dimensions que l'affaire Eulenburg-"Harden" avait fait éclater au grand jour. C'est que jusqu'alors, malgré les luttes intestines dont nous avons parlé, les ligues s'étaient toujours efforcées de cacher les faits au public. Ce deuxième tome, qui révélait l'histoire secrète du Wandervogel, avait pour titre : Grandeur et déclin.
L'époque de grandeur s'identifiait aux temps où, par une sorte de providence naturelle, grâce à la force de leur personnalité, les chefs de la jeunesse avaient su créer, en même temps qu'une subculture antibourgeoise, une adolescence qui s'était émancipée du triple contrôle Famille-École-Église, et qui avait déserté les femmes pour replonger aux sources du paganisme. Une jeunesse effrontée, qui sacrifiait aux charmes de la nudité, et atteignait aux sommets d'une volupté fort éloignée des normes. Cette connaissance était toute entière contenue dans ce livre ! Le déclin s'identifiait au noyautage et à la victoire de ceux qui s'élevèrent contre le césarisme d'un Karl Fischer puis contre les mœurs d'un W. Jansen. Ce déclin est l'ultime résultat de ceux que Blüher assimile dans une tête de chapitre aux « forces destructrices », défenseurs de l'égalité et gardiens de la morale, parfaitement méritants aux yeux des gens « normaux », « bien-pensants » et « bien-intentionnés », ceux-là même qui entendaient transformer un mouvement de jeunesse élitaire, révolutionnaire, imprégné d'érotisme inter-masculin en une institution inoffensive et conformiste d'encadrement de la jeunesse.
Les positions de ce second volume étaient tranchées et ne laissaient guère de place au compromis. Les personnages découverts et disqualifiés par Blüher y virent leur chance : ils pouvaient dénoncer en Grandeur et déclin une interprétation partiale du Wandervogel, le reflet d'une prise de position partisane en faveur des « éléments nuisibles » que le Wandervogel avait rigoureusement écartés par une moralité irréprochable et un sens aigu de ses responsabilités face aux enfants qui lui étaient confiés. En somme, le seul élément déplaisant dans l'affaire était la découverte de certains faits qui pouvaient encore se passer quelques années plus tôt dans le Wandervogel, la découverte des efforts qui avaient dû être déployés pour faire du Wandervogel cette organisation respectable qu'on connaissait. Si Blüher s'était contenté de ces 2 premiers volumes, l'affaire n'aurait pas été si grave.
Mais l'œuvre ne s'arrêtait pas à Grandeur et déclin, cet homme inqualifiable avait réellement en vue l'édition d'un troisième volume, or la seule évocation de son titre montrait bien que l'érotisme païen des Wandervögel ne leur avait pas été insufflé de l'extérieur : il était intrinsèquement lié à eux : Le mouvement allemand des Wandervögel comme phénomène érotique : Contribution à la reconnaissance de l'inversion sexuelle. Le Wandervogel domestiqué put s'épargner la publicité et la diffusion de ce troisième volume, mais le boycott prononcé contre la « monographie érotique » fut sans effet, même à l'intérieur du mouvement.
Ce livre si fortement combattu suscita au contraire chez les Wandervögel un processus secret de régénération. Mais la valeur et l'intensité de ce mouvement ne se révélèrent que plusieurs années après, à l'époque révolutionnaire qui succéda à la Première Guerre mondiale. Cet esprit se manifesta avec la création de confréries guerrières telles que les corps francs de la Garde Blanche, lorsque le mouvement de la jeunesse se renouvela sous une forme plus militaire, prenant le nom de jeunesse bündisch, il était là quand l'idéologie de la Jeune Droite s'inspira de l'enseignement de la confrérie.
L'émoi suscité par l'œuvre de Blüher était aussi fort à l'intérieur des ligues Wandervogel que dans le grand public : le troisième volume était d'emblée assuré de l’intérêt de la presse non spécialisée. Et d'ailleurs, Blüher avait saisi l'occasion du boycott de la « bourgeoisie Wandervogel » pour envoyer un document de présentation de l'ouvrage à 3.000 personnes de la vie publique. Le troisième volume de son histoire du Wandervogel dépassait largement le cadre du mouvement. En fait, il allait à l'essentiel.
Blüher exposa le point de départ de la réflexion qui en était le centre : « Il y a deux discours possibles. Le premier consiste à dire : toutes les confréries viriles d'hommes ou d'adolescents volent apparaître de l'extérieur des hommes qui aiment les hommes, des éléments parasites qui viennent gangréner la confrérie et qu'il s'agit d'éliminer dès lors qu'ils sont pris en faute. Le deuxième discours est tout autre : les confréries viriles d'hommes et d'adolescents, pour autant qu'elles en méritent le nom, doivent leur existence précisément à ce type d'hommes et à ses variantes. Si on les élimine, tout s'écroule ». La thèse centrale du troisième tome consistera à montrer la validité de cette deuxième thèse. Pour le prouver, et affirmer du même coup la vanité du discours moralisateur, Blüher procède à une analyse approfondie de Grandeur et déclin et des faits exposés dans le second volume. Et c'est sur cette source d'informations prodigieuse qu'il s'appuiera pour fonder ses thèses théoriques.
Mais là, il rencontra une difficulté qui faillit ébranler ses convictions : analysant les affrontements autour de l'érotisme masculin, il dut se rendre à l'évidence : ses détracteurs ne se recrutaient pas seulement chez des personnes telles que le Dr. Anklam, bourgeois étrangers à l'idéal de la confrérie masculine, soucieux seulement de se mettre en avant, de faire carrière et de se remplir les poches par le biais du mouvement de la jeunesse. Il s'aperçut que les plus fanatiques adversaires de l'érotisme masculin appartenaient précisément à ce type d'hommes en qui Blüher voyait l'origine et le vecteur de la confrérie et qu'il pensait mus par l'érotisme masculin. On aurait pu penser qu'ils n'agissaient ainsi que pour dissimuler la corruption et la déformation de leur idéal esthétique. Mais cette agressivité n'était pas feinte. Leur aversion contre l’érotisme masculin et l'inversion sexuelle était tout aussi authentique que leur appartenance à ce type d'hommes dont la vocation, voire la condition d'existence était de s'épanouir au sein de la confrérie virile.
Son intimité avec Jansen et avec d'autres hommes attirés par les hommes le convainquit que cette orientation était le motif incontournable de la confrérie. Mais, à supposer que cette motivation fut fondée, elle aurait dû s'étendre à tous ceux qui composaient le type d'hommes de la confrérie. Blüher ne douta pas de son existence, mais il dut admettre que ce type d'hommes pouvait prendre 2 formes distinctes et opposées. Il n'était pas homogène. Tandis qu'il cherchait à résoudre ce dilemme, Blüher, alors étudiant en philologie classique et en philosophie fit la connaissance, par le biais d'un ami médecin, d'un personnage dont la notoriété ne couvrait encore qu'un cercle restreint de personnes averties : Sigmund Freud.
La notion freudienne d'inconscient, et l’importance de la sexualité dans cet inconscient lui livra tout à coup la clef de l’énigme. « Je pris conscience d'une notion fondamentale : le refoulement... Le concept freudien de refoulement indique qu'un penchant sexuel dont la validité n'est pas reconnue par la conscience se reporte sur son inconscient par un mécanisme psychique inconscient : le refoulement. Il ne disparaît pas, mais doté d'un signe négatif, il se mue en peur, en aversion, en honte et refait surface dès qu'un facteur le ramène à la conscience. En un éclair, Blüher perçoit toute la réalité de la situation qui oppose les 2 variantes de l'homme de la confrérie. Tous ces hommes étaient dévoués corps et âme aux adolescents. Ils leur consacraient leur temps et renonçaient pour eux aux femmes (vers lesquelles ils auraient pu se tourner).
Mais les uns acceptaient leur vraie nature, ils l’avaient reconnue et vivaient en conformité avec elle, tandis que les autres refoulaient leurs tendances et l'érotisme qui leur était sous-jacent... « "Je l'ai fait", dit le souvenir. "Je ne peux pas l'avoir fait", clame la fierté, qui reste inébranlable. Et le souvenir finit par céder », écrit Nietzsche dans Par delà le bien et le mal. Cette phrase s'applique parfaitement à ce phénomène. Il suffit de substituer fait par désiré, et on a le phénomène du refoulement. Le fanatique lutte en vain contre la reconnaissance de ses propres amours. Pour se rassurer, Il transfère le théâtre de bataille de lui-même vers l'extérieur, combattant avec acharnement les hommes de la confrérie qui acceptent leurs tendances.
Rares sont les livres à avoir eu un impact aussi soudain et aussi profond que ce troisième tome de l'histoire des Wandervogel de Blüher, la « monographie érotique », comme on l'a appelé. Les ennemis et adversaires de l’érotisme masculin se firent tout à coup moins bruyants, moins arrogants. Le rôle de ces croisés de la morale bourgeoise se trouvait subitement discrédité. Désormais, chacun pouvait craindre d'être tenu pour l'un de ces refoulés analysés par notre auteur. La parution de l'ouvrage permit aux éléments sains des ligues d'acquérir une plus grande liberté et au mouvement de jeunesse, pour une part, de se régénérer. Mais surtout, la « monographie érotique » de Blüher devint le fondement de l'enseignement de la confrérie, un enseignement qui prouvait que ces penchants prétendument illégitimes étaient en fait la condition sine qua non de toute culture, en ce qu'ils en créaient la base et en assuraient la persistance.
UNE DIFFÉRENCE DE MATÉRIAU HUMAIN
Avant qu'il ait pu donner sa forme définitive à ce qui n'était encore qu'une connaissance intuitive qu'il s'agissait d'étayer scientifiquement, il se heurta à une seconde thèse, inverse de celle des moralisateurs petit-bourgeois qui avaient infiltré le mouvement de la jeunesse : la psychanalyse, qui avait percé dans l’opinion publique et les conceptions développées par le premier mouvement homosexuel constitué en lutte pour son émancipation.
Les idées ultérieures de Blüher sur la civilisation seront fortement influencées par la personnalité de 2 figures du judaïsme qui se firent les avocats de cette thèse, Sigmund Freud et le Dr. Magnus Hirschfeld.
La « bourgeoisie Wandervogel » avait tenté d'empêcher la parution de la « monographie érotique » en portant l'affaire devant les tribunaux, considérant que l'ouvrage pouvait s'assimiler à un « écrit pornographique ». Blüher fut donc amené à consulter un avocat. Ce dernier lui conseilla de prévenir l'attaque en s'assurant du soutien de personnalités scientifiques reconnues. Dans l'atmosphère lourde de l'époque, dominée par les campagnes d'Isidor "Harden", la justice réagissait très brutalement à tout ce qui pouvait s'assimiler à la « menace homosexuelle » évoquée par nos « sauveurs de l'Empereur et de l'État ». Or un tel personnage existait. Il était bien connu des tribunaux qui l'avaient entendu comme expert lors des procès qui avaient suivi les articles de presse de Witkowski "Harden" : le Dr. Magnus Hirschfeld.
« J'écrivis une lettre très polie à ce monsieur. Il me répondit par retour du courrier, en me priant de lui envoyer le manuscrit. Et après quelques jours seulement, c'est une lettre enthousiaste que je reçus. Je devais absolument passer le voir. Il se réjouissait fort de me rencontrer. » Lorsque Blüher arriva à Berlin, ce fut le choc. Les gens du Comité Scientifique Humanitaire que dirigeait le Dr. M. Hirschfeld étaient bien éloignés du type d'hommes auquel Blüher faisait référence. Un fossé infranchissable séparait le monde de la confrérie virile de l'atmosphère moite du club où se réunissaient ceux que Hirschfeld assimilaient au « troisième sexe ». Le Comité Scientifique Humanitaire réunissait depuis 1897 les tenants d'une école de sciences sexuelles fondée sur les écrits publiés par le célèbre médecin. Au centre des idées développées par le Dr. M. Hirschfeld, la « théorie des étapes » qui plaçait l'orientation homosexuelle à l’intérieur d'une zone indifférenciée entre les sexes masculin et féminin : le « troisième sexe ». L'incompatibilité des 2 théories ne tarda pas à se manifester dans toute son acuité. Mais c'est le rapport ambigu que Blüher entretenait avec l’école psychanalytique qui déclencha la crise...
Sur le conseil de son avocat, qui l'avait engagé à rechercher pour sa « monographie érotique » le soutien de personnalités du monde scientifique, Blüher s'était également adressé à S. Freud à qui il devait sa compréhension de la mystérieuse variante anti-érotique et anti-sexuelle du type humain de la confrérie. Freud accueillit le manuscrit de Blüher par ces mots : « Nul doute que vous ayez une puissante intelligence, vous avez du courage et vous n'êtes pas homme à reculer. Ce que j'ai lu de vous est plus convaincant que la plupart des ouvrages homosexuels ou médicaux en ce domaine ».
L'essor prodigieux de la psychanalyse n'en était encore qu'à ses débuts : elle était loin de s'imposer et Freud était naturellement à l'affût de tout ce qui pouvait conforter son camp. Dès lors, il s'efforça d'attirer à lui ce remarquable élève et le gagner à son école à Berlin. Il lui proposa de collaborer à sa Revue médicale de psychologie et à Imago. La distance que l'étudiant de 23 ans garda vis-à-vis de cet homme de 32 ans son aîné, dont la renommée couvrait le monde entier, témoigne de la personnalité de Hans Blüher.
Certes, la conception freudienne de la sexualité, dont l'essence matérialiste ne lui apparut que bien plus tard, le mena tout d'abord sur une fausse route. Ces errements sont déjà perceptibles dans la « monographie érotique ». Pourtant, dès l'origine, il s'opposa à l'appréciation que Freud se faisait de l'érotisme inter-masculin. Freud assimilait la fixation érotique et sexuelle sur des partenaires de même sexe à une perturbation dans le développement de l'être humain vers un érotisme homme-femme ; il ne la considérait pas comme une perversion au sens commun du terme, mais il y voyait néanmoins une pathologie. Ce fut l'objet, entre le jeune Blüher et Freud, d'une longue correspondance.
Finalement, ils décidèrent d'un commun accord de porter la discussion devant le public. Pour ce faire, M. Hirschfeld, qui avait lui même des différents scientifiques avec Freud, mit à la disposition de Blüher l'une des publications périodiques du Comité scientifique humanitaire. Sous le titre Les trois formes principales d'inversion sexuelle, Blüher rédigea un essai dans lequel il rejetait à la fois la théorie des "étapes", le "Troisième sexe" de Hirschfeld, et l'opinion de Freud, qui niait à l'érotisme et à la sexualité inter-masculins le caractère d'un phénomène autonome ayant une fonction naturelle pour n'y voir qu'une déviance de la « norme hétérosexuelle ». Blüher raconte la suite. Pour bien comprendre toutes les ramifications de l'affaire, il faut se souvenir que M. Hirschfeld était un homme de parti, social-démocrate et pacifiste.
« Je m'attelai à cet article qui exprimait mon opposition à la théorie des "étapes". Candide comme je l'étais alors, je ne me doutais pas que la liberté intellectuelle était conditionnelle. On sait que la liberté passe pour être une notion très prisée à gauche. Je fus donc fort surpris en constatant que mon texte avait été dénaturé au point de faire de moi un adepte de la théorie que précisément je combattais. Sommé de s'expliquer, le Dr. Hirschfeld me répondit que j'étais dans le vrai, et, comble de l'hypocrisie, qu'il partageait mes conceptions. Toutefois, il n'était pas opportun de dire les choses de cette façon, l'opinion, qui était habituée au concept d'étapes intermédiaires ne devait pas être détrompée. Les cheveux se dressèrent sur ma tête. Jamais dans ma vie je n'avais rencontré pareil mépris de la vérité et de la science, semblable ignorance de nos valeurs les plus essentielles. Je pris rapidement congé. La première chose que je fis fut de retirer de la vente les exemplaires restants de la "monographie érotique" et de la faire rééditer. J'y rédigeai une préface expliquant ma rupture avec le Dr. Hirschfeld et j'y retirai son texte. Je mentionnai la falsification dont il s'était rendu coupable, accusant ce professeur "prestigieux" de malhonnêteté intellectuelle. »
Blüher souffrit beaucoup d'avoir été trompé. Sa rupture n'en fut que plus brutale. Après coup, il écrira : « J'ai conduit des gens sans préjugés à participer aux réunions du "Comité scientifique humanitaire" et il n'en est resté qu'un arrière-goût amer. Les personnes qui forment ce comité, à l'exception des médecins et de quelques cas rares, donnent une mauvaise impression d'eux-mêmes. Le matériau humain qui le compose est très éloigné de celui que j'ai décrit. Tous les chefs Wandervögel invertis qui ont approché le comité s'en sont d'ailleurs très vite retirés. Ils éprouvaient une sorte de répulsion vis-à-vis de cette société... Les qualités naturelles de l'homme, cette tension, ce côté racé, cette fougue, cette fraîcheur inébranlable ne retrouve pas dans ce cercle ». Ce que Blüher reproche en substance aux gens de la société, c'est leur féminité : « Nous sommes tous androgynes, c'est dire qu'il y a en chacun d'entre nous des traits masculins et féminins. Un surcroît de substance féminine chez l'homme est même indispensable à l’amélioration du type humain. Mais il y a une frontière au-delà de laquelle l'homme est avalé par la femme ».
Blüher s'éloigne du libéralisme et des Lumières pour se tourner vers l'extrême-droite. Si Blüher s'est écarté des positions qui étaient siennes dans sa « monographie érotique », ce n'est pas pour rejeter l’érotisme inter-masculin, mais bien plutôt pour relativiser la perception qu'il en avait. Cette perception, c'était celle de Freud. Blüher n'a jamais mésestimé Freud. Il lui gardera toute sa vie son estime et son admiration, surtout pour ses qualités humaines. Pourtant, son jugement était catégorique : « Je réalisai très tôt que la psychanalyse est matérialiste dans sa forme et participe en cela aux phénomènes qui détruisent la civilisation européenne », lorsqu'il en prit conscience, il rédigea son œuvre maîtresse : Le rôle de l'érotisme dans la société masculine.
LE VIRAGE À DROITE
« Éros n'est pas la sexualité. L'éros est ce qui donne son sens à la sexualité, il n'en est pas le but, l'éros est l'élément moteur de toute impulsion. Il est une qualité inhérente à l'homme, les animaux en sont dépourvus. La sexualité à l'état pur n'existe pas chez l’homme. » Ces quelques phrases révèlent la pensée qui sera à la base de sa seconde œuvre sur la sexualité. Son appréciation des phénomènes sexuels individuels reste la même. Ce qui change, c'est sa définition du concept de sexualité.
Dans sa « monographie érotique », il s'exprimait encore en ces termes : « Il faut donner au concept de sexualité son acception la plus large. Nous avons dépassé le stade où on pensait avoir compris l'instinct sexuel une fois qu'on l'avait défini : un instinct basé dans les parties génitales dont le but est la procréation de l'homme et de la femme par le biais du plaisir réciproque des 2 partenaires. Aujourd'hui, cette définition nous porterait à sourire ; elle s'applique tout au plus à un cas exceptionnel de la vie sexuelle. Un cas bien connu par sa fréquence et les conséquences qui en découlent, mais qui ne nous apprend rien de l'instinct lui-même... La nature de l’instinct, de tout instinct, est aussi insondable que celle du corps. La nature des choses n'est pas perceptible, le comportement sexuel l’est. Ne peuvent être comprises que les lois générales qui fondent la nature. La matière est certes beaucoup plus présente, mais elle n'est pas explicable ».
À l'instar de Freud, la « monographie érotique » fait de l'instinct sexuel le facteur élémentaire, absolu et originel : Tout est sexualité, la sexualité est la base de tout. Dans cette optique, le problème de la diversité de l’être humain ne se concevait qu'en termes matérialistes, darwinistes : Qu'est-ce qui différencie l’homme des « autres animaux » ? La réponse est : l’homme est doté d'une sexualité hypertrophique largement émancipée dans sa fonction reproductrice, il est capable de convertir cette énergie sexuelle. C'est cette conversion qui crée la spécificité de la vie humaine : la culture est « sexualité sublimée ». La culture se fonde sur la répression de l'instinct, répression qui commence déjà avec l'érotisme : l'amour n'est autre qu'une « forme sublimée de sexualité ».
H. Blüher n'a jamais dit à quelle époque il avait rejeté cette image du monde et les conséquences qu'elle impliquait. En soi, la théorie n'était pas gênante. D'ailleurs, un autre phénomène vient à l'esprit. Blüher a lui-même qualifié d'« années de confusion » l'époque qui a précédé la rédaction des Wandervögel, Histoire d'un mouvement de jeunesse. Cette confusion n'était pas dissoute lorsqu'il rédigea le troisième tome de son œuvre, la « monographie érotique » et résolut grâce à Freud un problème qui eut été insoluble autrement. Blüher ne réalisa pas immédiatement que le système psychanalytique ne s'appliquait qu'aux problèmes de psychologie sexuelle, à des cas très particuliers. « Je savais que les neuroses ne s'expliquaient pas hors du système de Freud, mais je m'aperçus bien vite que quant aux remèdes, la psychanalyse n'était d'aucun secours. » Un journaliste satirique de l'époque, Karl Kraus, a fort bien résumé la question par ces quelques mots : « La psychanalyse est la maladie qui prétend livrer son propre remède ». « Très tôt, écrivit Blüher, j'eus l'intuition que la "psychanalyse" était la négation des biens les plus élevés. »
Ces valeurs qui créent l’homme d'élite et fondent la hiérarchie du monde, lui échappaient encore quelque peu lorsqu'il écrivit sa « monographie érotique ». Par la suite, il écrira que « ses positions élitaires s'étaient trouvées temporairement recouvertes d'une croûte libérale ». De fait, le jeune Blüher avait été à l'école de Wilhelm Jansen. Ce dernier « ne voyait de valeurs que dans la modernité et le progrès. Il refusait catégoriquement toutes les notions, fussent-elles reconnues et apparemment indispensables, qui freinaient l'acheminement de l'homme vers la culture et son développement vers ce qu'il y avait de meilleur dans sa nature ».
Jansen était un libéral. Il ne comprenait pas que si les adolescents rêvaient de leur propre royaume, c'est que comme tous les régimes réactionnaires figés, imprégnés de vulgarité bourgeoise et de christianisme ranci de cette époque, l'Empire allemand ne répondait plus aux images mythiques qui lui avaient donné forme, noblesse et royauté. Blüher décrit fort bien dans son Wandervogel... la passion et le sérieux de ces adolescents qui regardaient en Jansen leur héros. Ils ne se contentaient pas d'aimer leur héros, ils voulaient être cette nouvelle aristocratie prête à lui obéir et à créer leur propre Empire. Il ne s'agissait pas d'une liberté sans engagement, mais de domination et de charges, de loi et d'ordre. C'est cet absolu qui anime la meilleure jeunesse, absolu dont aucun libéral ne peut percevoir le sens, qu'aucun libéral ne peut comprendre.
En cela, W. Jansen ne pouvait répondre à leur attente. Cet échec ne fut pas sans conséquences pour la vie du jeune Blüher qui passa par une période de désarroi et tomba dans les aberrations intellectuelles auxquelles succomba toute une jeunesse abandonnée à elle-même : matérialisme, nihilisme, anarchie. Chez lui, ces positions étaient purement intellectuelles, elles n'impliquaient pas d'engagement politique. Ce fut précisément l'erreur. Le libéralisme se présenta à lui sous la forme de W. Jansen et de son cercle. Quant aux idées d'extrême-gauche, elles se dessinèrent sous les traits de son jeune ami, Rudi-"Antinoos", qui sera certainement sa relation masculine la plus intense. Pourquoi se serait-il détourné des idées défendues par les êtres qui lui étaient les plus chers ? L'évolution de Rudi-"Antinoos" est typique. Plus vieux, il se mua en social-démocrate.
Le cercle de Magnus Hirschfeld agit sur H. Blüher comme un révélateur. Le libéralisme ne conduisait pas nécessairement l'être humain à offrir le meilleur de lui-même. Ces qualités qu'il avait décrites n'étaient pas tant le produit du libéralisme (le cercle de Hirschfeld lui en apportait la preuve) que le fruit d'une bonne disposition naturelle. Cette connaissance renforça sa controverse avec Freud. Tout ne pouvait être sexualité, la sexualité ne pouvait être le motif de toute chose. Elle était elle-même subordonnée à une substance primordiale. La connaissance ne pouvait se résumer à la compréhension de l'impulsion sexuelle.
L'humaniste Blüher, l’admirateur de la Grèce antique retourna à Platon et Aristote qu'il ne quitta plus. C'est sur la base de leur œuvre qu'il conçut son analyse de la philosophie européenne : en cela, L'axe de la nature (1950) découle en droite ligne du Rôle de l'érotisme dans la société masculine (1918/19). Le point central, le concept-clef de son œuvre sera dès lors la force primaire que Blüher découvrit au-dessus de toute chose, le facteur reliant tous les éléments au principe premier, l'esprit objectif qui se manifeste à travers les images primordiales, les « idées » de Platon et d'Aristote : l'Éros.
« Le concept moderne d'Éros a été créé par Blüher et par nul autre », écrivit plus tard le philosophe comte Keyserling. De fait, les théoriciens du matérialisme, Feuerbach, Stirner, Haeckel, M. Hirschfeld et les autres lui semblaient sombrer dans l'insignifiance. Même les plus grands, Darwin, S. Freud, perdaient à ses yeux une bonne part de leur prestige. Un épisode de sa rencontre avec Hirschfeld l'a profondément marqué, l'incitant à approfondir sa démarche intellectuelle. Lorsqu'ils firent connaissance, Hirschfeld travaillait à une documentation sur la pérennité de l'homosexualité à travers l'histoire. Le jeune Blüher lui fit parvenir une carte extraite d'une série de représentations publiées par une maison d'édition völkisch. L'ensemble faisait l'éloge de la race germanique et de la culture nordique. La carte elle-même représentait un Viking d'un certain âge, armé, qui entourait l'épaule d'un jeune guerrier en un geste incontestablement érotique. Le tout était illustré par un vers de l'Edda :
J'étais seul, solitaire était ma voie,
maintenant nous sommes deux,
car l'autre j'ai trouvé.
L'homme est la joie de l'homme.
Blüher pensait que ce document entrait dans le cadre de la publication de Hirschfeld. Ne prouvait-il pas la fréquence et la place des relations inter-masculines dans la civilisation nordique ? Or ses protagonistes modernes comptaient déjà parmi les adversaires les plus acharnés de l'érotisme inter-masculin qu'ils assimilaient, à la manière du judéo-christianisme qu'ils prétendaient pourtant combattre, à un phénomène de décadence entraînant le déclin des peuples, des races et des cultures. M. Hirschfeld n'utilisa pas cette carte, estimant qu'elle n'avait aucun caractère probant : ni la carte ni le texte n'avaient de contenu sexuel...
Dans son appréciation de la sexualité, Hirschfeld allait ici beaucoup plus loin que Freud. Freud aurait au moins vu dans cette carte une forme subtile de sexualité tendant vers l’érotisme et aurait décrété que la culture nordique, comme toutes les cultures, était le produit d'une « sexualité sublimée ». La réaction de Hirschfeld démontrait à l'évidence l'erreur fondamentale de toute idéologie fondant toute chose sur la sexualité. Car si toute culture était le produit d'une sublimation de l'instinct sexuel et si corollairement l'épanouissement sexuel s'accompagnait d'un appauvrissement culturel, l'esthétisme même ne s'expliquait plus. Dans l'optique de Hirschfeld, seule importait la sexualité manifeste, et pour ainsi dire bestiale.
Au reste, Freud n'avait jamais défini le terme de culture. Il semble qu'à ses yeux, ce terme se soit appliqué à l'atmosphère fin de siècle qui régnait tout particulièrement à Vienne, capitale de la monarchie déchue, symbole d'une civilisation bourgeoise, avec son idéal académique, éclectique et son esthétisme morbide, pour ainsi dire culinaire. Il en était sans doute de même pour Hirschfeld.
Dans le mouvement de la jeunesse, l'homosexualité était vécue librement, sans gêne, donnant lieu parfois à de véritables orgies. Indépendamment du fait que contrairement aux théories freudiennes, une manifestation quantitativement identique se traduisait qualitativement par un style très différent selon qu'il s'agissait du cercle de Hirschfeld ou des sphères Wandervögel : la culture Wandervogel s'épanouissait précisément là où la sexualité était la moins « sublimée ». Partout ailleurs, cette culture, lorsqu'elle subsistait, était dénuée d'énergie, médiocre. Loin de sublimer leur sexualité, ces gens n'était plus que l'ombre d'eux-mêmes, malades à force de vains combats, répondant tout à fait au concept blühérlen de typus Inversus neuroticus.
Blüher ne tarda pas à percevoir toute l'étendue des problèmes, les conséquences gigantesques soulevées par ses nouvelles certitudes : Un élan insurmontable le porta à les approfondir. « Je compris que l'éros Inter-masculin qui était le premier objet de mon étude ne se manifestait pas seulement dans des structures ponctuelles comme le Wandervogel, Il se manifestait tout autant dans la constitution des États, ce facteur n'était pas accidentel, de toute évidence, il s'agissait d'une constante dans l'histoire humaine. » D'où le titre de l'œuvre maîtresse de ses années de maturité : Le rôle de l'érotisme dans la société masculine et son sous-titre : Théorie de la constitution des États par nature et par valeur.

◘ Présentation de l'extrait d'article : Julius Evola, comme Hans Blüher, a défendu une conception "antifamilialiste" de l'origine de l'État, mais il a délaissé la dimension "érotique" des sociétés d'hommes qui avait été théorisée par Blüher. Les tentatives en langue française de dégager un intérêt de recherche concernant Blüher sont rares, raison pour laquelle nous citons celle-ci, mais cela demande de bien cerner les problématiques attenantes afin de de les confronter à des enjeux actuels. Nonobstant certains défauts relatifs au domaine idéaliste de l'histoire des idées (schématisme gauche/droite qui restreint le jusnaturalisme à une simple artificialité sociale et omet aussi bien le paternalisme d'un Filmer que l'étude d'Engels sur L'origine de la famille de la propriété privée et de l'État, jugement anachronique du corps d'État que constitue les Gardiens chez Platon comme "utopie" [cf. pour le contextualiser Éros philosophe de T. Ménissier chez Kimé et le chapitre de Foucault dans le deuxième tome de L'Histoire de la sexualité], négligence de la réponse critique de Freud dans sa Correspondance, etc.), les questions soulevées restent valables même si les racines de la solution sont pour l'essentiel aileurs.
Un modèle associatif peut-il jouer un rôle comparable à celui d'une institution tout en assurant un contre-pouvoir ? Il est bien évident que l'État moderne, instaurant la séparation public/privé, joue un rôle décisif dans l'individualisation du corps social (tout en visant, dans le même mouvement, à totaliser ces monades divisées et à s'incorporer, dans son ossature institutionnelle, l'unité), et ce rôle se traduit, comme l'a montré Foucault, dans la matérialité de ses techniques d'exercice du pouvoir, consubstantielle à sa structure propre, techniques qui façonnent les sujets sur lesquels ce pouvoir s'exerce jusque dans leur corporéité même. Le privé en ce sens n'est que la réplique du public, car si précisément dédoublement il y a, inscrit dans l'État et déjà présent sur un plan économique dans les rapports de production et la division sociale du travail, c'est que l'État en trace les contours. L'individuel-privé n'est pas un obstacle intrinsèque à l'action de l'État, mais un espace que l'État construit en le parcourant. Il fait partie intégrante du champ stratégique qu'est l'État moderne, c'est la cible que se donne l'État comme point d'impact de son pouvoir, bref n'a de condition d'existence que par l'État.
Ce qui est net pour ce point de mire, proprement insaissisable en soi, qu'est l'individu privé, sujet supposé de libertés inaliénables et de droits de l'homme, d'un habeas corpus dont le corps est précisément façonné par l'État, mais aussi par l'ensemble des foyers de privatisation. Pour ne prendre que ce lieu par excellence privé qu'est la famille moderne, elle ne s'instaure que dans une concomitance absolue avec l'émergence du public qu'est l'État moderne : non pas comme le dehors intrinsèque d'un espace public aux frontières rigides, mais comme ensemble de pratiques matérielles de l'État qui façonne le père de famille (travailleur, éducateur, soldat ou fonctionnaire), l'enfant-écolier au sens moderne et, bien entendu, on dirait surtout, la mère. La famille et l'État moderne ne sont pas, à proprement parler, 2 espaces (le privé et le public) équidistants et distincts, se limitant mutuellement, dont l'une serait, selon les analyses de l'École de Francfort (Adorno, Marcuse), le socle de l'autre (la famille de l'État). Si ces institutions ne sont pas isomorphes et n'entretiennent pas non plus de simples rapports d'homologie, elles ne font pas moins partie d'une et même configuration, en cesens que ce n'est pas l'espace "extérieur" de la famille moderne qui se clôt face à l'État, mais l'État qui, en même temps qu'il s'érige en public, trace le lieu auquel il l'assigne, par des parois mobiles qu'il déplace.
Par conséquent, si l'individuel-privé n'est pas une limite mais le canal même du pouvoir de l'État moderne, ceci ne veut pas dire que ce pouvoir n'a pas de limites réelles, mais que ces limites ne tiennent pas à quelque naturalité de l'individuel-privé : elles relèvent de résistances populaires car l'État est aussi la condensation matérielle et spécifique d'un rapport de force. L'individuel-privé apparaît donc également comme résultante de ce rapport de force, et de sa condensation dans l'État. S'il n'a pas d'essence intrinsèque posant, comme telle, des barrières extérieures absolues à l'État, et n'a probablement pas de signification absolue car naissant sur le terrain du capitalisme, il n'en est pas moins, en prenant forme politique, une ressource possible de luttes populaires nouvelles, non parce que il se taillerait, ce faisant, un terrain hors État (un empire dans l'empire dirait Spinoza), mais parce qu'il se situerait sur le terrain stratégique de l'État lui-même qui, dans sa forme moderne, existe comme espace public-privé, centre d'organisation des rapports de force.
Pratiquer une politique indépendante de la jeunesse sous le régime autoritariste bismarckien fut le grand mérite des ligues de jeunesse, peu ont réussi après-guerre à prendre maturité et à s'orienter efficacement contre Weimar, avant d'être récupérées dans le principe par l'appareil d'État totalitaire. En résumé, une nouvelle école n'est jamais qu'une étape-relais vers d'autres luttes se confrontant aux dures réalités, aucunement une fin en soi sous peine de se trahir dans sa vocation...
◘ Un père plus puissant ?
La famille est-elle la matrice de l'État ? Si cette question a laissé indifférents les courants d'opinion issus des doctrines du droit naturel et du contrat social, elle a longtemps divisé les théoriciens de droite : alors que les penseurs contre-révolutionnaires, comme Bonald ou Maurras, ont défendu une conception paternaliste du pouvoir, des auteurs plus atypiques, comme Hans Blüher ou Julius Evola, ont développé des vues fort originales. « État des fourmis », « père tout-puissant », « sociétés d'hommes »... un tour d'horizon de l'énigmatique archéologie familiale.
Depuis une dizaine d'années, l'essor conjoint de la sociologie de la famille et de l'anthropologie du droit a ramené au jour la question du rapport entre la famille et l'État, et plus précisément de l'influence des structures familiales sur la formation et la nature de l'institution étatique. Aujourd'hui posée par les seules sciences sociales en un temps d'indigence complète de la pensée et du débat politiques, cette question a hanté pendant des siècles les œuvres d'auteurs ne se limitant pas à un objectif d'observation scientifique, mais bien porteurs de prétentions normatives. Présente dès l'aurore grecque du politique, elle a ouvert un débat qui s'est poursuivi jusqu'aux temps modernes, où son amplitude a été progressivement restreinte sous l'effet du refoulement croissant des anciennes conceptions familiales (lignages, clans...).
Individu sans père et nostalgie de la mère
Peu à peu s'est ainsi tracée une ligne de partage entre les penseurs qui entendaient conserver ou restituer à ces conceptions anciennes leur validité et leur influence sur l'esprit de l'institution étatique, et ceux qui, au contraire, appelaient de leurs vœux un progrès conçu en termes d'émancipation vis-à-vis de la famille, tant pour l'individu que pour l'État – tous 2 libérés de l'influence de ce groupement intermédiaire et se retrouvant quasiment face à face. On aura aisément identifié là les mouvances respectives du conservatisme et du progressisme, ces fatales approximations que notre histoire politique nous a imposées sous les noms de droite et gauche.
(...)
La fourmilière équivoque
Absentes à gauche, la valorisation de la tradition patriarcale européenne et la mise en exergue simultanée de son caractère de matrice de l'État ne se retrouvent guère qu'à droite. L'exaltation des valeurs familiales est un lieu commun de la droite, tout comme son goût de l'ordre et de la cohésion nationale, qui lui vaut parfois d'être accusée de préparer les voies d'une fourmilière humaine. La critique n'est pas dénuée de fondement, puisque c'est précisément à une comparaison avec la fourmilière ou la ruche qu'ont recours les 2 penseurs de droite qui illustrent le mieux la division de leur camp idéologique sur la question du rapport famille-État. Le premier est Louis de Bonald (1754-1840), fondateur de la doctrine contre-révolutionnaire et principal inspirateur de la pensée française anti-démocratique du siècle dernier, qui écrit : « Il y a des lois pour la société des fourmis et pour celle des abeilles ; comment a-t-on pu penser qu'il n'y en avait pas pour la société des hommes, et qu'elle était livrée au hasard de leurs inventions ? Ces lois, quand elles sont oubliées de la société publique, se retrouvent dans la constitution de la société domestique ». Cette dernière n'est autre que la famille, régie par les mêmes normes fondamentales que l'État. Il ne saurait y avoir de solution de continuité de l'une à l'autre puisque, affirme Bonald, « le pouvoir est une paternité ».
À l'opposé se place Hans Blüher (1888-1955), figure atypique de la Révolution conservatrice allemande et historien du mouvement de jeunesse Wandervogel, qui lui aussi évoque ces « insectes constructeurs d'État », mais pour en tirer des conclusions inverses : « Dans l'État des abeilles, écrit-il, il n'y a qu'un acte hétérosexuel : le vol nuptial de la reine lors de la fondation de la ruche. La famille n'existe plus. Il n'y a qu'une seule génitrice, la reine, qui n'a de cesse de pondre (...) Chez les fourmis, la nature a détruit la famille en créant entre les 2 sexes un intermédiaire, de capacité neuronale supérieure (...) Ce sont les ouvrières, étrangères à toute activité génésique, qui sont maîtresses de la fourmilière » (1). Blüher en déduit que « partout où la nature a imposé une espèce constructrice d'État, il fallut en passer par une victoire sur la primauté de la famille ».
L'équivoque de la fourmilière, reposant de part et d'autre sur un naturalisme assez fruste, n'illustre pas seulement le rapport privilégié qu'entretient la pensée de droite avec l'idée de nature, comprise comme ordre biologique. Elle révèle également, à partir d'un point particulier, la sensible divergence des 2 grandes catégories, qui sont aussi les 2 principales générations, de cette pensée conservatrice.
(...)
Approches du « Männerstaat »
Il ne fait pas de doute qu'au regard de ce corps de doctrine, les positions non conformistes de la jeune génération néo-conservatrice de ce siècle apparaissent minoritaires. Leur originalité et leur radicalité compensatrices n'en sont que renforcées. Classé par Armin Mohler, dans son ouvrage pionnier sur la Révolution conservatrice allemande, parmi les « six auteurs essentiels excédant toute classification », Hans Blüher a poussé le plus loin l'antibourgeoisisme et le refus corrélatif de l'essence familiale de l'État. « On a dit, écrit-il, que l'État était une "grande famille" et on a inventé des mythes pour glorifier la naissance d'un peuple sous les traits d'une famille devenue adulte. On s'étonnera peut-être si je dis que la création de l'État est impossible là où la famille est la trame essentielle du tissu social, et où la sexualité a pour seul but d'y concourir » (2). Blüher reconnaît bien sûr que le développement de l'État n'a pas pour autant supprimé, comme chez certains insectes, la communauté familiale ; mais il affirme que celle-ci a vu son influence contrebalancée par une communauté distincte, dont l'existence est la conditio sine qua non de l'État : le Männerbund (littéralement « ligue virile » ou « confrérie masculine »).
Blüher s'appuie sur les travaux de l'ethnologue Heinrich Schurtz, dont l'ouvrage Alterklassen und Männerbünde, paru en 1902, fut le premier à attirer l'attention sur la signification politique des « sociétés d'hommes ». Affirmant retrouver « les formes fondamentales de la société », Schurtz postule en l'homme la présence de 2 instincts de communauté : l'un issu de la pulsion sexuelle, poussant l'homme vers la femme et la fondation d'un foyer ; l'autre issu de la « pulsion de socialisation » (Gessellungstrieb), conduisant à la formation du Männerbund dont la plus haute forme est l'État. Pour lui, la famille, devenue toute puissante dans l'ère bourgeoise, a ceci de dissolvant qu'elle est Reich der Frau et que l'homme y subit la domination de la femme, Herrin der Familie. Aussi valorise-t-il l'alternative représentée par les groupements masculins fondés, non sur le bios et son monde de pulsions conditionnées, mais sur l'esprit et l'idée, formes d'associations intellectuelles et en tant que telle supérieures – seules issues, hors de l'étroite sphère du privé, vers le domaine public, politique. Cette théorie, entérinée notamment par l'anthropologue Robert Lowie (3), est cependant altérée par Blüher pour servir sa conception paradoxale, à la fois anti-familiale et pan-érotique. Selon lui, la « pulsion de socialisation » est elle aussi de nature sexuelle ; seul son objet est différent, n'étant pas hétérosexuel, mais « homoérotique ». « Les Männerbunde, écrit-il, ne proviennent pas d'une pulsion de socialisation purement gratuite ; ils sont aussi le produit d'un érotisme intermasculin. C'est un éros de grande envergure qui hante la faculté qu'ont les hommes de construire l'État » (4).
L'idée blüherienne d'un eros heroïkos renonçant à la satisfaction sensuelle pour atteindre par « sublimation » à la création culturelle et politique, n'est que superficiellement le produit d'une lecture droitière de Freud (5). Elle se fait plus profondément l'écho des conceptions particulières de Platon, premier auteur à théoriser, dans sa République (375 av. notre ère) un État sans familles. André Gisselbrecht note que Blüher lui « emprunte l'idée qu'Eros doit s'investir dans des situations interhumaines qui ne soient pas productrices d'enfants, la concentration de leurs parents sur eux et leur survie s'effectuant au détriment de l'aspiration au beau, de là à la connaissance, et de là à l'éthique » (6). Et il rappelle le discours que Platon fait tenir à Phèdre dans le Banquet : « Sans amour, ni l'État ni l'individu ne peuvent rien faire de grand et de beau (...) Si donc il y avait le moyen de faire un État d'amants et d'aimés, on aurait la constitution idéale (...) Quand ils ont atteint leur plein développement, les garçons de cette nature sont les seuls à se consacrer au gouvernement des États ».
Au total, on peut dire que Blüher, s'il fait figure de (re)fondateur de la théorie anti-familiale de l'État, en a peut-être été simultanément le pire quoiqu'involontaire ennemi, en la rattachant aux plus utopistes des vues de Platon, et en y surimprimant des éléments de la psychanalyse freudienne déformés par le prisme de son propre daïmon érotique.
Plus cohérente est en la matière la conception de Julius Evola. Contemporain de Blüher, qui ne lui est pas inconnu (7), il s'inspire not. comme lui des travaux de Schurtz. « On connaît, écrit Evola, la doctrine d'après laquelle l'État descendrait de la famille : c'est le principe formateur de la gens, étendu et complété, qui aurait donné naissance à l'État (...) Mais si l'on comprend la famille dans le sens "naturaliste" qui est plus ou moins le sien aujourd'hui, le principe générateur de la communauté proprement politique doit être cherché dans un cadre très différent de celui de la famille ; il doit être cherché sur le plan de ce que l'on a appelé la société d'hommes » (8).
Evola rappelle que chez les peuples des origines – et aujourd'hui encore chez certains peuples dits « primitifs » –, l'individu était considéré comme mineur, et assimilé au groupe des femmes, des enfants, et même des animaux, aussi longtemps qu'il n'avait pas franchi victorieusement l'épreuve initiatique du « rite de passage ». Rite spécial, visant à détacher l'impétrant de la sphère matérielle, domestique et maternelle, et à le rendre digne d'intégrer la société des hommes – « homme » étant ici entendu au sens d'une dignité particulière, d'un véritable statut. Pour Evola, la « rupture de niveau » qui s'opère ainsi chez l'individu reflète celle qui sépare le « social » du « politique » : « L'État se trouve sous le signe masculin, la "société" et, par extension, le peuple, le demos, sous le signe féminin (...) Le fond mythologique que l'on retrouve toujours est celui de la dualité entre les divinités lumineuses et célestes du monde proprement politique et héroïque, et les divinités féminines et maternelles de l'existence "naturelle", chères surtout aux couches plébéiennes. C'est ainsi que dans la Rome antique, la notion d'État et d'imperium – de puissance sacrée – se rattachait étroitement au culte symbolique de divinités viriles du ciel, de la lumière et du monde supérieur, opposé à la région obscure des Mères et des divinités chtoniennes » (9).
Evola voit dans les sociétés européennes d'Ancien Régime un prolongement de cet idéal, l'imperium laissant la place au « droit divin » des rois et les « sociétés d'hommes » initiatiques à des ordres aristocratiques. Il analyse donc le processus révolutionnaire qui les mit à bas en termes de renversement des valeurs et de victoire du principe « nocturne », féminin, domestique et économiciste.
La nostalgie d'un « père plus puissant »
In fine, au-delà de l'opposition qui ressort des œuvres les plus représentatives de leur courant respectif, les 2 droites qui s'affrontent à fleurets mouchetés sur la question du rapport famille-État se retrouvent sur un terrain d'accord : celui de l'éloge nostalgique du Père. Pour détourner, à l'instar de Blüher, une idée de Freud, qui analysait Dieu comme « un père plus puissant », on peut dire que pour la droite intellectuelle, l'État est ce père plus puissant, d'ailleurs toujours mandaté par quelque puissance suprahumaine, quelle qu'en soit la nature exacte : nostalgie de l'ordre patriarcal et viril, de temps communautaires et guerriers, temps des origines et d'une autorité paterne d'avant la loi. La critique anti-constructiviste de la loi moderne – norme artificielle née de la volonté faillible des hommes – et not. du légicentrisme issu de la Révolution française, est précisément l'un des thèmes privilégiés du courant contre-révolutionnaire.
(...)
► Extrait de l'article « Un père plus puissant ? », Luc Saint-Étienne, in éléments n°83, 1995.
(1) H. Blüher, « Famille et société masculine » (1918), in Palaestre, 1er trim. 1994, pp. 33-34.
(2) Ibid., p. 33.
(3) Cf. Robert Lowie, Primitive Society, New York 1921, et The Origin of the State, New York 1927.
(4) art. cit., p. 43.
(5) Blüher était encore étudiant lorsque, par l'intermédiaire d'un ami médecin, il fit la connaissance du père de la psychanalyse, dont la notoriété était encore restreinte.
(6) André Gisselbrecht, « Hans Blüher et l'utopie du Männerstaat », Revue d'Allemagne, juil.-sept. 1990.
(7) Evola le mentionne, parmi d'autres représentants de la RC allemande, dans son autobiographie intellectuelle, Le Chemin du Cinabre, Arktos-Archè, Carmagnole-Milan, 1982, p. 134.
(8) Les hommes au milieu des ruines, Trédaniel-Pardès, 1984, p. 32-33.
(9) Ibid., p. 34-35.