Panunzio
SERGIO PANUNZIO : DU SYNDICALISME RÉVOLUTIONNAIRE AU FASCISME
Une loi du silence, implacable, s'abat sur des centaines d'auteurs non conformistes. Tout comme les disparus des dictatures sud-américaines, ces hommes paraissent s'évaporer sans laisser de traces. C'est ce qui est arrivé à Sergio Panunzio (1886-1944). Malgré la solidité et l'ampleur de son œuvre écrite (1), riche et complexe, qui concerne la philosophie, la sociologie, la politique et le droit. Une base académique solide reposant sur 2 doctorats, en droit et en philosophie (2), constituait la base d'une pensée libre, s'auto-dépassant continuellement, qui s'emparait sans cesse de nouveaux espaces intellectuels au lieu de se retrancher dans des positions défendant des idées caduques.
LE SYNDICALISME RÉVOLUTIONNAIRE
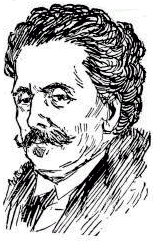 [Ci-contre : Antonio Labriola (1843-1904), professeur napolitain qui introduit les idées de Sorel en Italie. Il refuse les syndicats réformistes et développe un syndicalisme révolutionnaire et anarchisant, qui finira par épouser le “mythe national”. Le jeune Mussolini est fortement influencé par ses idées. Qui s'exprimeront notamment dans la revue La Lupa (Florence), en même temps que celles de Corradini, autre syndicaliste révolutionnaire et nationaliste. Dans le n°1 de La Lupa, on pouvait lire cette proclamation significative : « La Lupa est un hebdomadaire dirigé par ceux qui se trouvent à égale distance de tous les points de l'hémicycle politique »]
[Ci-contre : Antonio Labriola (1843-1904), professeur napolitain qui introduit les idées de Sorel en Italie. Il refuse les syndicats réformistes et développe un syndicalisme révolutionnaire et anarchisant, qui finira par épouser le “mythe national”. Le jeune Mussolini est fortement influencé par ses idées. Qui s'exprimeront notamment dans la revue La Lupa (Florence), en même temps que celles de Corradini, autre syndicaliste révolutionnaire et nationaliste. Dans le n°1 de La Lupa, on pouvait lire cette proclamation significative : « La Lupa est un hebdomadaire dirigé par ceux qui se trouvent à égale distance de tous les points de l'hémicycle politique »]
Il est encore très jeune lorsque ses préoccupations sociales le poussent dans les rangs marxistes. En 1903, il commence à collaborer à Avanguardia Socialista, journal édité à Milan, dans lequel le jeune Mussolini fait également publier ses premiers articles. Mais le marxisme commence déjà à être critiqué dans les rangs de la gauche. Georges Sorel met ses limites en évidence et, en Italie, Enrico Leone et Antonio Labriola soutiennent et diffusent ses thèses. C'est ainsi qu'un courant naît, rapidement baptisé syndicalisme révolutionnaire, qui s'écarte de l'orthodoxie marxiste.
La lecture du sociologue Gustave Le Bon contribue à cet éloignement. Les syndicalistes sont obsédés par le problème de la découverte des processus psychologiques qui gouvernent la mobilisation des masses ; en simplifiant : pour savoir comment lancer les ouvriers dans la révolution. Pour le marxisme classique, tout est un problème de développement des forces productives : quand le capitalisme sera arrivé à son zénith, il aura créé une telle masse de prolétaires déshérités que la révolution sera inévitable. Mais nombreux sont les révolutionnaires impatients, qui ne veulent pas attendre aussi longtemps. Panunzio arrive ainsi à la conclusion, tout comme le jeune leader socialiste Mussolini, que les phénomènes politiques de masses sont, en dernière analyse, des phénomènes psychologiques qui, par conséquent, sont indépendants du degré de développement des forces productives. L'œuvre théorique qu'à ce moment-là, Pareto, Mosca, Michels et Sorel publient, vont dans la même direction.
L'élite révolutionnaire avait pour mission de mobiliser les masses et le marxisme ne disposait pas des éléments d'analyse et de propagande permettant d'y arriver. Ajoutez à cela que, pour tous ces hommes, l'économicisme marxiste commence à se révéler étroit, eux qui rêvent d'un syndicalisme qui soit une idéologie plus moderne pour le mouvement ouvrier, à la fois plus pragmatique (moins spéculative et théorique) et plus idéaliste (parce qu'elle doit éluder le déterminisme et valoriser davantage la capacité de mobilisation des idéaux).
Le jeune Panunzio voit à quel point l'Italie est dominée par les groupes qui représentent les intérêts capitalistes, fondamentalement grâce à la légitimation des « mythes démocratiques » (vote, parlement, etc.) et des « symboles nationaux » (la nation), parvenant ainsi à les écarter de leur fidélité — qui suppose spontanéité et naturel — envers leurs véritables organisations : les syndicats. Pour lui, les « mythes démocratiques » sont tout particulièrement dangereux. Aussi dénonce-t-il — et on retrouve cette caractéristique dans sa toute pensée — la démocratie parlementaire et partitocratique comme système de domination politique de la bourgeoisie. Ses critiques sont analogues à celles, bien connues, de Michels, dans son œuvre classique sur les partis politiques. Les partis, même ceux qui s'auto-définissent comme partis ouvriers, créent une nouvelle oligarchie. Face à cette réalité, Panunzio veut instaurer un système basé sur l'autogouvernement effectif des travailleurs à travers leurs syndicats.
Aujourd'hui, nous ne devons pas nous étonner qu'il se soit éloigné de l'orthodoxie marxiste car, en Italie, n'existaient pas les pré-conditions que Marx supposait pour le triomphe de la révolution (il y avait un faible développement industriel et donc, une importance sociologique peu élevée du prolétariat et de la bourgeoisie). Et Panunzio, comme les autres syndicalistes révolutionnaires, avait besoin de nouveaux instruments d'analyse qui lui serviraient à faire la révolution en Italie, aussi vite que possible. Une évolution idéologique attirante commence ainsi, qui conduira de nombreux leaders syndicalistes révolutionnaires, comme Roberto Michels, A.O. Olivetti (3), Paolo Orano et Ottavio Dinale, des rangs prolétariens aux milices fascistes. Mais plus que de “conversions au fascisme”, il faudrait plutôt dire que ceux-ci furent leurs auteurs intellectuels authentiques. De fait, l'évolution de Panunzio reflète, comme peu d'autres, l'évolution du climat intellectuel italien avant, pendant et après la Première Guerre mondiale.
LA DÉCOUVERTE DE LA NATION
[L'événement qui a lait basculer les ultra-révolutionnaires italiens dans le nationalisme : la campagne de Tripolitaine en 1912. Couverture du discours La Grande Proletaria si è mossa (nov. 1911) de Giovanni Pascoli nourri des idéaux du Risorgemento]
 La guerre italo-turque, pour la Lybie, en 1911, réorienta le syndicalisme révolutionnaire vers la découverte de l'idée de Patrie, comprise comme « Nation Prolétaire » victime de la marginalisation et de l'oppression exercée par les puissances ploutocratiques. Les leaders du syndicalisme (Labriola, Olivetti, Orano) avaient été expulsés du Parti Socialiste italien pour déviationnisme idéologique. La guerre de Libye leur fait découvrir quelque chose d'insoupçonnable pour un militant formé dans la tradition marxiste : l'enthousiasme altruiste et la prédisposition au sacrifice que manifestent ces travailleurs italiens pour répondre aux objectifs nationaux. Il s'agit d'un phénomène que l'on ne peut nier ni méconnaître. Roberto Michels, toujours à l'avant-garde intellectuelle, tente de découvrir, dans son livre Impérialisme italien, les racines démographiques, économiques et sociales à la base de cette mobilisation populaire instinctive entraînée par la guerre de Libye.
La guerre italo-turque, pour la Lybie, en 1911, réorienta le syndicalisme révolutionnaire vers la découverte de l'idée de Patrie, comprise comme « Nation Prolétaire » victime de la marginalisation et de l'oppression exercée par les puissances ploutocratiques. Les leaders du syndicalisme (Labriola, Olivetti, Orano) avaient été expulsés du Parti Socialiste italien pour déviationnisme idéologique. La guerre de Libye leur fait découvrir quelque chose d'insoupçonnable pour un militant formé dans la tradition marxiste : l'enthousiasme altruiste et la prédisposition au sacrifice que manifestent ces travailleurs italiens pour répondre aux objectifs nationaux. Il s'agit d'un phénomène que l'on ne peut nier ni méconnaître. Roberto Michels, toujours à l'avant-garde intellectuelle, tente de découvrir, dans son livre Impérialisme italien, les racines démographiques, économiques et sociales à la base de cette mobilisation populaire instinctive entraînée par la guerre de Libye.
Panunzio mit un certain temps à suivre cette évolution et, — de fait — il ne parvint pas, jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale, à se reposer la question de la virtualité du syndicalisme révolutionnaire (même situation chez Olivetti, Orano, Dinale, Rocca et Mussolini). Mais, pendant ce temps, Panunzio continue à prendre ses distances par rapport aux dogmes marxistes. Marx avait écrit qu'il n'était pas venu prêcher une nouvelle morale, puisqu'il supposait que les idées des hommes, y compris les idées morales, ne constituaient qu'un reflet supra-structurel d'une infrastructure constituée par des conditions économiques données. L'influence de l'œuvre philosophique des néo-idéalistes italiens, Croce et Gentile, a été décisive pour les syndicalistes. Ils sont arrivé à la conclusion qu'il est absurde d'encore maintenir ce postulat. La composante éthique de l'homme n'est pas déterminée uniquement et exclusivement par les structures économiques d'une société.
En 1914, Panunzio écrit dans Utopia — la revue théorique que dirige l'un des propagandistes italiens les plus ardents du socialisme, Benito Mussolini — un article dans lequel il soutient que le socialisme doit être une revendication éthique en vue de construire une nouvelle société, qui incarnerait une réalité éthique supérieure. Les révolutionnaires doivent agir sous la dictée d’une inspiration éthique.
L'INTERVENTIONNISME
[Ci-dessous : La marcia su Roma (1922) par le futuriste Tato, peinture ayant appartenu à Mussolini]
 S'étant écarté des dogmes marxistes, Panunzio a pu constater, en observant les événements de la Première Guerre mondiale, à quel point l'idée de nationalisme continuait à être le moteur le plus efficace pour lancer les hommes dans l'action. Dans ses ouvrages Il concetto della guerra giusta et Principio e diritto di nazionalita, il donne un exposé, large et systématique, de cette idée fondamentale. Depuis le début, Panunzio a été partisan de l'entrée de l'Italie dans la guerre. En automne 1914, dans Utopia — qui se trouvait toujours sous la responsabilité de Mussolini —, il publie un article où il parle du caractère révolutionnaire de la guerre, puisque « la nationalité est fondamentale pour l'action de l'homme ». Il faut faire bouger les masses, les tirer de leur léthargie. Et il n'y a pas de catalyseur plus efficace que la guerre. Aujourd'hui nous savons, grâce aux études minutieuses et inégalables de Renzo De Felice, à quel point le comportement de Panunzio serait décisif pour arracher Mussolini à la neutralité qu'il défendait encore, suivant ainsi la ligne officielle du PSI, et pour le pousser jusqu'à l'interventionnisme.
S'étant écarté des dogmes marxistes, Panunzio a pu constater, en observant les événements de la Première Guerre mondiale, à quel point l'idée de nationalisme continuait à être le moteur le plus efficace pour lancer les hommes dans l'action. Dans ses ouvrages Il concetto della guerra giusta et Principio e diritto di nazionalita, il donne un exposé, large et systématique, de cette idée fondamentale. Depuis le début, Panunzio a été partisan de l'entrée de l'Italie dans la guerre. En automne 1914, dans Utopia — qui se trouvait toujours sous la responsabilité de Mussolini —, il publie un article où il parle du caractère révolutionnaire de la guerre, puisque « la nationalité est fondamentale pour l'action de l'homme ». Il faut faire bouger les masses, les tirer de leur léthargie. Et il n'y a pas de catalyseur plus efficace que la guerre. Aujourd'hui nous savons, grâce aux études minutieuses et inégalables de Renzo De Felice, à quel point le comportement de Panunzio serait décisif pour arracher Mussolini à la neutralité qu'il défendait encore, suivant ainsi la ligne officielle du PSI, et pour le pousser jusqu'à l'interventionnisme.
Principio e diritto di nazionalita développe exhaustivement ces idées. Panunzio signale dans ce texte l'importance sociale et politique du sentiment d'exigence chez l'homme, qui est fondamental. La Nation est une unité organique et naturelle composée d'hommes, qui ont en commun, non seulement le territoire, mais aussi les coutumes, la langue, l'histoire. La nationalité est, tout simplement, fondamentale pour la sociabilité humaine.
Pour les syndicalistes révolutionnaires, une conclusion va s'imposer : peut-être se sont-ils trompés et c'est l'idée de la nation, et non celle de Syndicat, que les hommes ressentent comme communauté humaine fondamentale Ce n'est pas uniquement un phénomène italien. Comme cela s'est déjà passé en Italie en 1911, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, tous les intellectuels de gauche ont regardé bouche bée, de quelle manière les masses de travailleurs allemands et français endossent joyeusement leurs uniformes et oublient toute idée d'internationalisme prolétarien. Oui, c'est la nation qui est la communauté « charismatique », qui est capable d'unir et de lancer le peuple à l'action. Mais Panunzio n'oublie pas ses idéaux syndicalistes. Et en unissant nationalisme et syndicalisme, Panunzio rassemble les éléments qui constitueront plus tard la synthèse fasciste.
LE DÉPASSEMENT DU SYNDICALISME
Lorsqu'il était jeune, Panunzio était convaincu que les associations économiques, les syndicats, constituaient la communauté primaire et exclusive de l'homme moderne, comme les hordes l'avaient été pour l'homme paléolithique, la polis pour l'homme de l'antiquité classique et le fief pour l'homme médiéval. La Révolution industrielle avait supposé un changement qualitatif sans comparaison depuis la Révolution néolithique, qui avait créé l'agriculture et sédentarisé l'homme. Cette nouvelle réalité sociale devait créer son nouveau modèle social et le syndicat était cette nouvelle communauté naturelle et moderne.
Mais maintenant, Panunzio découvrait que le syndicat ne pouvait satisfaire tous les besoins, subtils et complexes, de la nature humaine. Il y avait une forme d'association plus vaste et plus complexe, la nation. Et en plus, c'était la nation, et non le syndicat, l'objet primaire de la fidélité des hommes, tout comme la guerre l'avait prouvé. Sans la langue, sans l'art, sans la science ; sans la philosophie, sans l'histoire et sans le potentiel économique dont est porteuse une nation, l'homme n'avait ni substance, ni futur.
En 1918, à la fin de la guerre, Panunzio avait redéfini sa doctrine comme “Syndicalisme National”. Une évolution en tous points similaire à celles de Filippo Corridoni, Roberto Michels ou Benito Mussolini.
Donc, les nationalismes prenaient corps dans les États. L'État-Nation remplacera ainsi la « fédération de syndicats » comme communauté politique de niveau supérieur Mais Panunzio ne va pas renoncer à ses idéaux révolutionnaires dans le domaine social et se transformer en un nationaliste petit-bourgeois. Pour lui, l'élément fondamental de cet État-National ne peut être que le Syndicat. En réalité, Panunzio ne modifie pas le rôle qu'il avait toujours assigné aux syndicats (leurs objectifs moraux et éducatifs, leur rôle économique), mais change leur conception de l'État, qui devient plus qu'une structure artificielle, en devenant le corps physique de la Nation et, par conséquent, une structure « naturelle » et « éthique », à laquelle doit être réservée l'hégémonie juridique et organisatrice.
Panunzio avait tiré des leçons fondamentales de Gumplowicz, Le Bon, Pareto et Mosca : l'homme était, surtout et avant tout un être social. Face à l'individualisme des idéologies nées des Lumières (qui n'est que la sécularisation de l'individualisme religieux du christianisme). Panunzio affirme la socialité comme l’élément constitutif fondamental de l'homme. Cette idée était déjà nettement définie dans sa phase syndicaliste révolutionnaire ; c'est la raison pour laquelle il insiste et continue à insister sur le rôle du syndicat. Mais il modifie ses vues quant à l'association fondamentale qui détermine l'action de l'homme ; il établit qu'il en existe deux : la Nation — en premier lieu — et le Syndicat. En plus, Panunzio n'oublie pas que les exigences du développement économique plaident également en faveur d'une structure économique, supérieure en qualité en en dimensions au Syndicat, qui, dès lors, ne peut être que l'État-Nation.
Ainsi donc, en 1918, un an avant l'organisation de l'assemblée nationale fondatrice des Fasci di Combattimento, Panunzio a déjà établi toutes les lignes fondamentales du programme fasciste. Et, en 1919, en toute logique, il devient l'un des propagandistes les plus compétents du fascisme.
THÉORICIEN DU FASCISME
Entre 1918 et 1921, Panunzio reste en contact étroit avec Mussolini. A. James Gregor a souligné comment Panunzio a été l'un des intellectuels qui tenta le plus fermement de donner une base idéologique rationnelle au fascisme (4). D'après lui, son œuvre est comparable à celle de Giovanni Gentile et, à mon avis, dépasse celle-ci en pertinence politique. Ce spécialiste américain du fascisme italien a démontré par analyse scientifique que la lecture de l'œuvre de Panunzio suffit pour infirmer définitivement la thèse qui veut que le fascisme italien fut un activisme pur, qui adopta une idéologie a posteriori pour couvrir, pudiquement, son activisme irrationnel, dépouillé de toute rigueur conceptuelle.
Gregor a prouvé que la Théorie de la Révolution, la Théorie de la Dictature, la Théorie du Syndicalisme national, la Théorie de l'État Syndicaliste et Corporatif et la Théorie générale de l'État qui caractérisent le fascisme (c'est-à-dire, l'ensemble des discours idéologiques qu'adopte le fascisme lors des différentes phases de son activité politique), ont été largement développées et rationnellement fondées sur l'œuvre de Panunzio.
LA VIOLENCE ET LA LOI
 [Ci-contre : 1920 : L’Italie est en ébullition. Squadristes au cours d'une “expédition punitive”]
[Ci-contre : 1920 : L’Italie est en ébullition. Squadristes au cours d'une “expédition punitive”]
Dès le début de son œuvre, Panunzio rejette l'individualisme. L'homme n'est pas homme sinon en société. Ce sont là des idées similaires à celles exprimées par le jeune Mussolini dans son ouvrage La filosofia della forza. Mais si Panunzio affirme que les hommes ne sont pas des atomes mais des êtres sociaux, il affirme, en même temps, que cette situation n'est possible que parce qu'ils vivent en fonction de normes. Cependant, les normes juridiques ne sont pas sacro-saintes. Et la théorie de la révolution développée par Panunzio est un ensemble d'opinions raisonnées et normatives, qui constituent la base éthique des idées révolutionnaires du fascisme. De fait, Panunzio a été le seul parmi les intellectuels qui se rapprochent du fascisme, à donner une justification philosophique au recours fasciste à la violence, en phase révolutionnaire.
En réalité, Panunzio, qui possède une formation juridique solide, même en acceptant la nécessité et la souveraineté des lois, affirme que les lois existantes peuvent constituer un obstacle à la justice et au développement humain. Les lois ne peuvent être éternelles et doivent se transformer pour faire face aux nouveaux problèmes et aux nouvelles réalités. Et en temps de crise, le recours à la violence afin de changer les lois est légitime.
On peut dire la même chose au niveau international. L'Italie, nation prolétaire, a droit à la guerre, pour modifier un statu quo injuste. De manière identique, la révolution, en tant que guerre interne, est justifiée par Panunzio comme un recours contre l'injustice. Mais la violence ne peut être une fin en soi. La violence fasciste a pour objectif de créer un nouveau système étatique. Pour lui, le fascisme est une révolution qui conserve, renforce et défend l'idée d'État. Le fascisme est un exemple parfait de “Révolution conservatrice”. De fait, Panunzio a voulu, au long de toute son œuvre, définir simultanément le fascisme comme révolutionnaire (parce qu'il désirait créer un nouvel État) et comme conservateur (parce qu'il défendait l'idée de l'État).
La violence fasciste n'était donc pas une « maladie morale » comme disait Croce, mais, au contraire, une nécessité éthique, rationnelle et progressiste. L'organisation qui personnifie cette volonté de violence est le parti révolutionnaire, qui doit établir une « dictature héroïque », c'est-à-dire une dictature incarnée dans un homme unique (une idée analogue à celle du leader charismatique défendue par Michels).
Panunzio ne cessa de réfléchir, avec pertinence et profondeur, jusqu'à la fin de ses jours, au nouvel État fasciste (je signale au passage qu'il a consacré un texte important à l'Espagne nationale-syndicaliste). Il a toujours considéré le régime fasciste comme la forme transitoire entre l'État libéral-parlementaire créé par la bourgeoisie et le Nouvel État qui doit naître, pour l'organisation et la représentation non d'une seule classe sociale, mais de l'ensemble des travailleurs, tous types confondus, et de toutes les catégories qui forment une nation.
S'il critique férocement le parlementarisme libéral, il croit toujours à la nécessité de la représentation politique, qui doit se réaliser au départ de la revitalisation de parlements corporatifs représentant les intérêts sociaux réels et authentiques, contrairement aux partis qui cachaient la réalité directe et authentique de ces intérêts sociaux. Cette idée le force à affronter un autre théoricien de l'État fasciste, Carlo Costamagna, plus proche de ce que nous appelons la “statolâtrie”. Il combat également les tendances philo-collectivistes d'une partie de la gauche fasciste, modelées sur l'idée de la « corporation propriétaire » d'Ugo Spirito et soutenant, avec insistance, l'idée de l'« économie mixte », c'est-à-dire, de la coexistence des propriétés privée et étatique des entreprises. Au contraire, il a été très proche d'hommes comme Giorgio Del Vecchio, peut-être le juriste le plus remarquable de l'Italie fasciste, et de Giachino Volpe, l'auteur de la plus célèbre Histoire du Mouvement Fasciste. En tout cas, l'œuvre de Panunzio démontre — de manière répétée — qu'il est absolument faux que les fascistes n'aient jamais tenté d'élaborer des thèses idéologiques pour légaliser leur révolution et leur régime.
UNE ÉVOLUTION COHÉRENTE
Beaucoup seront surpris que l'on puisse évoluer du syndicalisme révolutionnaire au fascisme. Mais, en réalité, ce qui doit nous surprendre, c'est la cohérence lucide et la fécondité de la pensée de Panunzio. Notre auteur ne s'est pas laissé rattraper par des événements passagers et contingents, mais il a toujours tiré ses idées de prémisses qui, aujourd'hui encore, s'avèrent actuelles. Sa formation juridique et sa tendance naturelle à la spéculation déterminent le caractère de son œuvre, comme l'écrivit Francesco Perfetti (5).
Peut-être la meilleure contribution de Panunzio a-t-elle été de résoudre, comme personne ne l'avait fait, le problème juridique de la relation entre l'État et les autres forces sociales organisées. D'après lui, on doit se situer dans le domaine d'un État Corporatif, au sein duquel les corporations assument le rôle de Quatrième Pouvoir étatique, à côté de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Le long cheminement intellectuel qui conduit du syndicalisme révolutionnaire au fascisme se réalise chez lui de manière cohérente ; en effet, ce n'est pas un hasard si son premier ouvrage s'est appelé Il Socialisme Giuridico (6) et si Panunzio parle des syndicats ouvriers en les présentant comme les organisations destinées à modifier radicalement la société, il ne cesse pas non plus de parler d'un « droit syndical ouvrier »...
Un tel sens du juridique évite à Panunzio de se précipiter dans la voie de l'anarchisme. Vu le caractère italien et le climat intellectuel de l'époque, il n'était pas facile de se soustraire à cette tentation. Mais lorsqu'on a le sens du droit, on doit avoir le sens de l'autorité. Et si pour le jeune Panunzio, le syndicat devait faire face à l'État, cela ne signifiait pas qu'il devait s'opposer à l'idée d'autorité.
SYNDICALISME ET ANARCHIE
Dans La Persistenza del diritto, il écrit : « Ce qui différencie le vrai syndicalisme de l'anarchisme, c’est que le premier, même en niant l'État, ne nie pas simultanément toute forme d'organisation sociale basée sur l'autorité, alors que le second nie l'État parce que, intrinsèquement, il nie toute forme d'autorité sociale ». L'erreur de l'anarchisme — et également du marxisme — consiste à identifier domination de classe sociale avec État. Beaucoup pensent que c'est le cas dans l'État bourgeois, qui est au service de cette classe sociale et qui crée des codes juridiques imposés à la société pour maintenir sa domination.
Panunzio oppose une nuance importante à cette idée généralement acceptée : « le droit n'est pas une force qui s'impose toujours et nécessairement de l'extérieur et avec violence à un groupe déterminé de personnes, mais plutôt une force psychologique et sociale de toute première importance qui se produit ab intus, moyennant un processus de formation que l'on ne peut séparer d'un groupe humain ou d'un noyau associatif déterminé ». Autrement dit : le droit est l'émanation d'un groupe social, au sein duquel se produisent des idées, des sentiments, des opinions et des croyances collectives. Le Droit, comme la Religion ou l'Art, est un phénomène social et non le produit exclusif de l'État. Et par conséquent, il se perçoit également dans les lois psychosociologiques en vigueur dans les collectivités (et qu'essayèrent de découvrir non seulement Le Bon mais également Marde, Miceli et Sighele).
Le Droit, estime Panunzio, peut et doit naître, non de l'État, mais des groupes sociaux. Et pour lui, ces groupes sociaux doivent être les syndicats. Le syndicat ne fut jamais pour Panunzio un pur mécanisme revendicatif, un organisme économique, car pour lui, toute société, est à la fois économique, politique et juridique. Nous touchons ainsi à une idée fondamentale dans toute l'évolution idéologique de Panunzio : le syndicat comme groupe social politique et comme groupe de droit. Lors de sa phase syndicaliste révolutionnaire, Panunzio a cru que le syndicat devait s'opposer à l'État, le vider de son contenu et prendre sa place. Sa découverte « du fait national » le fait changer de vue.
Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est de souligner à quel point cette idée s'oppose aux thèses anarchistes. Panunzio se demande de quelle manière pouvait s'établir, dans l'histoire comme dans la réalité, le contrat social qui aurait mis fin à la société anarchique. Il ne se trompait pas quant à la nature humaine et il savait que, dans un groupe humain, le mal existerait toujours, tout comme d'ailleurs les comportements anti-sociaux. Raison pour laquelle l'autorité s'avérait essentielle dans toute société.
Les syndicats, en tant que groupes sociaux organiques réels doivent donner naissance à leur propre Droit. Mais vu l'existence de divers syndicats, par branches d'activité, le problème se posait du besoin d'un autre type d'autorité et de représentativité, qui ne peut être que la politique. Panunzio, comme tous les syndicalistes révolutionnaires, nie la virtualité de la représentation parlementaire et partitocratique Et, dans son cas, il propose une solution originale à ce dilemme : faire également des syndicats des organisations politiques. Et même il croit que ces syndicats pourraient adopter une politique socio-économique différente de celle suivie jusque là par les partis socialistes ouvriers.
CRÉER DE LA RICHESSE
Les partis de la gauche ouvrière se sont préoccupés surtout du problème de la distribution de la richesse. Par conséquent, ils ont adopté certains programmes politiques qui condamnaient la création de richesse ; conséquence les socialismes ont distribué fa misère au lieu de répartir la richesse. La bourgeoisie avait su créer de la richesse comme jamais auparavant dans l'histoire de l'homme, grâce à la révolution industrielle ; mais elle l'avait accaparé de manière scandaleuse Cependant, les forces ouvrières ne s'étaient préoccupées que de la répartition des richesses, comme si celles-ci croissaient spontanément. Donnons-en un exemple historique : si le seigneur féodal vivait beaucoup mieux que ses paysans, le fait qu'un prolétaire vive mieux qu'un seigneur féodal n'est pas dû à la distribution de la richesse de l'aristocratie entre les serfs, mais à la création de richesse. Si l'on ne répartissait que la richesse existante, on ne favoriserait que la consommation et chaque être humain ne se verrait attribuer qu'une part minime de la richesse globale. Au contraire, le syndicalisme devait tendre à créer le maximum de richesse car seule une société opulente apportera le bien-être à tout le monde.
L'attitude typique du mouvement ouvrier avait été d'arracher la richesse aux bourgeois (de manière révolutionnaire : avec les expropriations et les nationalisations ; de manière réformiste : moyennant des impôts progressifs sur la rente, orientés vers la redistribution de la richesse) Panunzio se montre beaucoup plus original : « le syndicalisme doit représenter la politique économique de production alors que le réformisme socialiste représente la politique anti-économique de consommation ».
Ce n'était pas là l'unique critique adressée par Panunzio aux partis ouvriers. De fait, il commence par leur reprocher d'être des partis. Ils participent ainsi au jeu de la bourgeoisie, ils trahissent leurs bases prolétariennes. Seuls, les syndicats modernes, avec leur caractère double, technico-économique et politico-social, peuvent en finir — pense-t-il — avec l'État bourgeois, théoriquement démocratique, mais basé, en réalité, sur la pré-puissance économique et sur l'éventuel recours à la violence.
LA CONCRÉTUDE “NATION”
La guerre de Libye et la Première Guerre mondiale vont mettre en relief les limites du syndicalisme : en effet, la Patrie apparaît comme une réalité plus suggestive pour les travailleurs que le syndicat. La nationalité l'emporte sur la conscience de classe. Panunzio réfléchit devant les faits qui se présentent à lui et arrive à une conclusion évidente : son modèle de société basé sur les syndicats souffre d'imprécision : seul, le national lui donne ses dimensions concrètes et solides.
De plus, seul le national jouit de plus de force parmi les masses que le mythe démocratique et peut, de fait, aider à mettre hors-jeu le Parlement bourgeois. Cette conviction se situait dans l'interventionnisme de nombreux hommes de gauche italiens : comme le Parlement s'opposait à la guerre, si l'on pouvait convaincre le peuple que l'intervention dans le conflit favoriserait ses aspirations nationales (en libérant les provinces italiennes soumises à l'empire austro-hongrois) et qu'en obtenant l'intervention italienne, on saperait le pouvoir du Parlement : de là, on insisterait sur le caractère révolutionnaire de la guerre : on ne livrerait pas seulement la guerre pour libérer des provinces italiennes, mais pour libérer l'Italie entière du joug du parlement dominé par des chambres réactionnaires.
QUEL PARLEMENT ?
Il serait pourtant faux de dire que Panunzio s'est opposé à tout type de représentativité politique. Mais il a aspiré à un parlement d'un nouveau genre, à un “parlementarisme des réalités”, opposé à celui, démodé, qui se révélait si fictif. Avant même de rejoindre les rangs du fascisme naissant, Panunzio s'était déjà largement préoccupé de la question de savoir comment faire représenter au Parlement les intérêts des professions et des travailleurs, au lieu des intérêts artificiels des partis.
L'élaboration définitive de ses idées se réalise déjà dans la période fasciste, alors que Panunzio a déjà adopté l'idée de l'importance suprême de la nationalité, et déduit qu'une nation ne peut prendre corps que dans un État. La pluralité sociale et la multiplicité syndicale s'accompagnent du monisme de l'État. Mais il s'agit de l'État des Syndicats.
Avec le triomphe du fascisme, Panunzio arrive à la conclusion que les syndicats ont donné vie au nouvel État, à l'État Syndical. Par conséquent, l'État doit reconnaître maintenant le rôle des Syndicats, leur reconnaître leur personnalité juridique. Dans Il sentimento dello Stato, Panunzio ajoute : l'homme ne peut « sentir l'État » s'il ne « sent pas le Syndicat », car on arrive à l'idée de l'État à travers des groupes sociaux intermédiaires qui socialisent l'homme. Ainsi, l'État ne doit pas se confronter aux syndicats, personnification des forces sociales, mais les intégrer dans la structure constitutionnelle. Aux Syndicats, on doit ajouter les Corporations, en tant que confédérations et — à travers les syndicats et les corporations — on doit atteindre l'intégration de l'Individu dans l'État.
Les fonctions des corporations doivent être consultatives, législatives ; elles doivent également servir d'intermédiaires entre les différents syndicats et entre ceux-ci et l'État. La nouvelle représentation, la nouvelle participation, ne doit pas se réaliser à travers les partis mais à travers les corporations Panunzio assigne ensuite aux Corporations un rôle fondamental dans la politique économique. Convaincu de l'utilité de l'initiative privée, il s'oppose aux thèses philo-collectivistes de Spirito (la « corporation propriétaire »). Grâce aux corporations, l'État doit diriger et planifier, et non gérer. Ce pluralisme économique rend nécessaire un organe délibératif et représentatif, qui ne discute plus d'abstraits programmes politiques de partis, mais des besoins concrets et réels issus du processus de création de la richesse nationale.
Tout comme dans le monde de la musique existent à la fois harmonie et pluralité des sons, l'État doit garder la souveraineté dans le domaine de l'économie mais doit également respecter un pluralisme et, par conséquent, doit posséder une Chambre où sont représentés les intérêts des corporations. Le fascisme crée ainsi un nouveau type d'État. Jusqu'à présent, a existé un État au service de la bourgeoisie, mais maintenant doit se créer un Nouvel État qui, en faisant des syndicats et des corporations ; la base de sa structure constitu tionnelle, intègre les intérêts de tous les Italiens et permet la création d'une nation très forte, riche et harmonieuse.
► Carlos Caballero-Jurado, Vouloir n°126/128, 1995.
• Notes :
- (1) Relation des ouvrages publiés par Sergio Panunzio. Le chiffre qui apparaît entre parenthèses indique la date de publication de l'œuvre ou des œuvres, Il socialisme giuridico, Il sindicalismo nel passato (1907) ; La persistenza del diritto (Discutendo di sindicalismo e anarchia), Lotta per l'assistenza e asso ciazione per la lotta (1910) ; Sindicalismo e Medioevo (Politica contemporanea) (1911) ; Il concetto della guerra giusta : Principio e diritto di nazionalita (1917) ; La Lega delle Nazione (1920) ; Diritto, forza e violenza (1921) ; Stato nazionale e sindicati, Il sentimento dello Stato, Che cos' e il Fascismo (1924) ; Lo Stato fascista (1925) ; Il diritto sindicale e corporativo (1930) ; Popolo, Nazione, Stato (1933) ; Le Corporazione Fasciste (1935) ; L'economia mista ; dal sindicalismi giuridico al sindicalismo economico (1936) ; Spagna nazional-sindicalista (1942) ; Motivi e metodo della codificazione fascista (1943).
- (2) Il reçut le grade de Docteur à Naples en 1908, pour sa thèse, Una nuova aristocrazia sociale : i sindicati. En 1911, à Naples également, il obtint le doctorat en philosophe.
- (3) Il n'est pas facile de trouver de la documentation sur les principaux syndicalistes révolutionnaires italiens. Dans la collection « I fatti della Storia » (dirigée par Renzo de Felice chez Bonacci à Rome), Francesco Perfetti a réalisé fa compilation et l'introduction à un excellent volume d'Olivetti. Cf. Angelo Oliverio Olivetti, Dal Sindicalismo Rivoluzionario al Corporativismo.
- (4) Dans son livre, Sergio Panunzio : Il sindicalismo ed il fondamento razionale del fascismo (Volpe editore, Roma, 1978), qui est une magnifique introduction à l'œuvre de Panunzio, accompagnée d'une sélection exhaustive de textes de cet auteur. Dans cet article, je suis l'argument des thèses exposées par A. James Gregor.
- (5) Francesco Perfetti, dans Ordine Nuovo n°2 (1ère année), juin 1970. J'utilise également ici, de manière systématique, les points de vue de Perfetti.
- (6) Il s'agit d'une compilation d'articles, dont quelques-uns parmi ceux-ci ont été édités en France par Sorel dans Mouvement Socialiste.

♦ Liens :
- Syndicalisme révolutionnaire et philosophie pragmatiste (I. Pereira)
- Syndicalisme et socialisme
- Fascisme (Wikiberal)

SERGIO PANUNZIO : DISCOURS DU 1er MAI 1933 (extraits)
(...) La vie politique actuelle connaît deux grands échecs : l'échec de l'État des partis ; l'échec de l'État des syndicats. Les conséquences extrêmes de ces échecs, dans le régime du suffrage universel élargi, du système démo-libéral des partis concurrents et égaux, ont été, comme on s'en est aperçu, le proportionalisme, le coalitionisme ou, mieux, l'hybridisme, transporté du pays dans les parlements et dans le mécanisme vital et constitutionnel de l'État ; conséquence : le nihilisme. (...) C'est Ostrogorski, ..., continuateur de Tocqueville, ..., qui a mis en exergue la nécessité, pour arrêter la crise, de substituer au système pesant et massifiant des partis permanents, constitués sur un mode rigide, un système agile et souple de lois provisoires et contingentes, adaptées à chaque coup par des groupes d'hommes afin de résoudre des problèmes déterminés et concrets. Le “légisme” signifie, en d'autres termes, “problémisme”. (...)
Sans aucun doute, seul est moderne le concept de parti révolutionnaire. Le présupposé intellectuel et philosophique de celui-ci est une conception idéaliste et processuelle de la réalité, de l'histoire, de la politique et du droit. Dominent aujourd'hui dans les ordres de la vie et dans la pensée, le dogmatisme et l'objectivisme, pour lesquels l'État n'est pas un processus, n'est pas toujours, par définition, en train de se faire, mais, au contraire, est un donné fixe, un fait immuable, et est toujours ainsi une sorte de masse de pierre au sein de laquelle il n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de place pour les contradictions fécondes, de faire la révolution, et où le concept de parti révolutionnaire, qui en découle, est purement et simplement ignoré. (...) Le parti révolutionnaire est le parti politique qui n'accepte pas l'État existant et ne s'y adapte pas ; le parti révolutionnaire nie l'État existant et veut l'abolir en expropriant le vieux pouvoir, en prenant possession de cet État par la violence, l'insurrection, afin de créer spirituellement et instaurer juridiquement l'État Nouveau. (...)
Le “Parti National Fasciste” est une institution essentiellement populaire qui embrasse en un seul symbole l'homme du peuple le plus humble et l'hiérarque ou le magistrat le plus élevé ; c'est une institution éminemment représentative qui sélectionne et recueille les énergies les plus vives et les plus passionnées du peuple, formant ainsi un véritable filtre à travers lequel passe le meilleur des forces du peuple. Le Parlement de vieille mouture recèle une puissance de représentativité bien moindre que celle du PNF, parce que le Parlement, plus il est parfait grâce au système proportionnel, ne fait rien d'autre que reproduire les forces, les classes et la mécanique des classes préexistantes dans le pays, et parce que le PNF, lui, au contraire, est un condensateur, un transformateur et un “dépasseur” de la statique des forces des classes sociales. (...)
Le vieux syndicalisme laisse les syndicats livrés à eux-mêmes et libres face à euxmêmes, concurrents et souverains. Au libéralisme des individus, succède alors un libéralisme des groupes. Nous avons alors affaire à une multiplicité irrésolue et statique. Et non l'e pluribus unum. Dans l'État fasciste corporatif, l'un politique, c'est l'État, qui s'auto-réalise dans la multiplicité sociale des syndicats ; mais le multiple, à son tour, s'auto-réalise et vit dans l'un politique.
► Sergio Panunzio, Il fondamento giuridico del fascismo, Bonacci ed., coll. “I fatti della storia”, 1987.