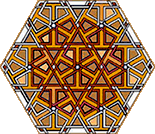Nasr
 L'œuvre de Seyyed Hossein Nasr :
L'œuvre de Seyyed Hossein Nasr :
Islam, connaissance, nature et sacré
Peu connu du public francophone, parce que peu de ses ouvrages ont été traduits en français (bien que les éditions L'Âge d'Homme de Lausanne préparent la traduction de l'un de ses livres, L'Islam traditionnel face au monde moderne [paru en 1993]), Seyyed Hossein Nasr est né à Téhéran, a fait ses études au Massachusetts Institute of Technology et à l'Université d'Harvard. En 1958, il est retourné à Téhéran, où il est devenu directeur de l'Académie impériale iranienne de philosophie en 1974 et professeur de philosophie à l'Université de sa ville natale. Aujourd'hui, il enseigne les sciences religieuses à la Temple University de Philadelphie. Notons aussi que S. H. Nasr a été le collaborateur du célèbre islamologue français Henry Corbin dans la rédaction de son Histoire de la philosophie islamique, parue chez Gallimard en 1964.
Nature et religion
Le premier livre de S. H. Nasr que j'ai lu en 1979 était Man and Nature : The Spiritual Crisis of Modern Man (Mandala Books/Unwin, London, 1968/76). Le propos de cet ouvrage était à la fois religieux et “écologique”, bien avant que ce vocable n'ait été à la mode. S. H. Nasr, avant tout le monde, nous demandait de ne pas penser séparément la crise spirituelle de l'homme, provoquée par les assauts de la modernité, et la crise écologique, subie par la nature, à cause de la logique accumulatrice et exploitante, inaugurée par cette même modernité. Le tour de force du Prof. Nasr a été d'aborder la double problématique de l'homme et de la nature en se référant au taoïsme, à l'hindouisme, au bouddhisme, au christianisme et à l'islam.
Vaste panorama des doctrines traditionnelles, présenté dans une optique qui pose comme axiome, en toute bonne logique traditionaliste et à la suite de Frithjof Schuon, « l'unité transcendante des religions », les travaux de S. H. Nasr visent, en fait, à recomposer cette harmonie entre l'homme et la nature qu'a brisée la modernité. La connaissance des doctrines traditionnelles, énoncées avec beaucoup de pédagogie par le Prof. Nasr, doit servir à reconstituer, pièce par pièce, l'unité perdue. La négligence des principes traditionnels a conduit à la crise (morale, politique, écologique). L'omniprésence des effets de cette crise dans la vie quotidienne moderne signale l'absence de “quelque chose”. Et ce sentiment d'absence est dû au bannissement de la nature hors de l'environnement quotidien moderne. Dépourvue de toute signification spirituelle, la nature déchoit : elle n'est plus qu'une “chose”, exploitable, pillable, instrumentalisable, qui est à la disposition de tous et d'un chacun.
Désacralisation et science sacrée
Parallèlement à cette désacralisation généralisée, à cette triste choséification de l'espace physique naturel, l'expérience religieuse, désormais débarrassée de tout ancrage fécond, n'est plus ouverte sur le cosmos ; elle n'est plus qu'une expérience strictement privée entre un homme et son Dieu. Dans un tel appauvrissement de l'expérience religieuse, le cosmos, le monde, ne sont plus perçus comme les œuvres de Dieu. Contrairement aux autres religions traditionnelles, le christianisme est, dans une certaine mesure, responsable de cette désacralisation, parce qu'il prèche le renoncement au monde et ne lui accorde, par conséquence, aucune importance métaphysique. Il ne s'agit évidemment pas du christianisme médiéval qui a su conserver relativement intactes les grandes doctrines ésotériques, notamment dans les gildes de bâtisseurs de cathédrales, chez les Fedeli d'amore (auxquels appartenait Dante ; cf. à ce propos : R. Guénon, Aperçus sur l'ésotérisme chrétien, Éd. traditionnelles, 1988), dans les cercles hermétiques de tradition pythagoricienne. Ce christianisme européen médiéval possédait sa science sacrée des objects matériels, capables de conduire l'âme, depuis les ténèbres de la materia prima, vers la luminosité du monde intelligible.
La tare de l'Occident : le refoulement incessant de la “science sacrée”
Mais cette science sacrée a sans cesse été refoulée par la tentation chrétienne de refuser le monde, d'une part, par la théologie trop rationaliste de l'Occident, d'autre part. Pour S. H. Nasr, c'est le contact entre la chrétienté et l'Islam, pendant les croisades, par l'intermédiaire de l'Ordre du Temple notamment, qui réveille les éléments dormants de l'ésotérisme religieux en Europe, après le rejet, au XIe siècle des thèses néo-platoniciennes. En effet, en Islam comme en Chine taoïste, l'observation de la nature et l'expérimentation ont toujours conservé leur attachement aux traditions gnostiques et mystiques, empêchant du même coup que ne s'opère là-bas le divorce complet entre science et sacré, survenu dans l'Europe du XVIIe siècle. En refusant de séparer totalement l'homme de la nature, l'Islam préserve une vision intégrale de l'Univers, non fragmentée, à l'instar de celle de Hugues de Saint-Victor et de Joachim de Flore au Moyen Âge, ou de Swedenborg, après la Renaissance. Dans cette perspective cosmique, intégrale, dépourvue de césure, l'homme cherche la transcendance et le surnaturel, non pas en s'opposant à la nature, mais en prenant appui sur cette même nature. Ce n'est qu'en étant ancré dans la nature que l'homme peut correctement la dépasser. L'homme doit apprendre à contempler la nature, non comme si elle était un domaine du réel tout-à-fait indépendant de lui, mais comme si elle était un miroir réfléchissant une réalité supérieure.
Amérindiens et Nord-Européens
S. H. Nasr réhabilite également les traditions animistes ou païennes qui ne véhiculent pas de césure entre l'homme et la nature. D'abord, les traditions des Amérindiens, surtout ceux des Plaines, qui n'ont évidemment pas développé une métaphysique bien articulée mais en possédaient néanmoins les fondements dans leur intériorité et les exprimaient par des symboles très parlants. L'Indien des Plaines était une sorte de monothéiste primordial, écrit S. H. Nasr, et voyait dans la nature vierge, les forêts, les arbres, les fleuves et le ciel, les oiseaux et les bisons, les symboles immédiats du monde spirituel. Raison pour laquelle l'Indien refuse que l'on meurtrisse la nature, qu'on la sollicite outrancièrement.
Ensuite, le paganisme nord-européen, différent du paganisme méditarranéen, urbanisé et dé-naturé, attribue également, selon S. H. Nasr, une signification symbolique et spirituelle à la nature.
L'unité entre l'homme et la nature, présente dans les doctrines traditionnelles, dans le christianisme ésotérique, dans la vision du cosmos des Indiens des Plaines et des Nord-Européens, disparaît avec Descartes, qui réduit le réel à l'esprit et à la matière, appauvrissant pendant plusieurs générations la perception occidentale de la nature. Celle-ci n'est plus perçue que sous l'angle d'une physique quantitative et mécanique, qui, d'abord, n'est pas la seule physique possible et qui, ensuite, ne rend compte, justement, que des aspects quantitatifs et mécaniques du monde, laissant de côté une myriade de facettes, d'harmonies, de formes, qui ne sont nullement accidentelles ou négligeables, mais, au contraire, étroitement liées à la racine ontologique des choses. Cette négligence et cette réduction conduisent à un déséquilibre dangereux, au désordre généralisé et à la laideur des productions artistiques et architecturales des hommes, surtout dans un monde comme le monde occidental où il n'y a plus d'autres sciences de la nature et où toute sapientia a été refoulée. L'Occident en vient ainsi à oublier que les phénomènes participent tous de plusieurs niveaux cosmiques différents et que leur réalité ne s'épuise pas dans un et un seul niveau d'existence. De la même façon qu'un tissu vivant peut être objet d'étude pour le biologiste, le chimiste ou le physicien, ou qu'une montagne peut être objet d'études pour le géologue, le géophysicien ou le géo-morphologue, tout phénomène, quel qu'il soit, doit être observé, analysé et contemplé sous différents angles ou points de vue.
Romantisme et évolutionnisme
L'Occident a du mal à se dégager de cette gangue physiciste / mécaniciste. L'attitude romantique envers la nature, première réaction contre le paradigme newtonien et cartésien, est demeurée plus sentimentale qu'intellectuelle, écrit S. H. Nasr. Il poursuit : « Cette attitude passive n'a pu inaugurer un nouveau savoir. Quels que soient les services que le mouvement romantique a rendu à l'esprit en rédécouvrant l'art médiéval ou la beauté de la nature vierge, il n'a pu influencer le cours de la science ni ajouter une nouvelle dimension à l'intérieur même de la science... ». Plus tard, la théorie de l'évolution, bien que biologisante et non plus unilatéralement mécanicisante, ne reflète que le Zeitgeist [esprit d'une époque] accumulateur, écrit S. H. Nasr, sans “ré-organiciser” de fond en comble les sciences physiques, tout en parodiant l'historicisme inhérent à la vulgate chrétienne.
Et quand la physique newtono-cartésienne s'effondre à la fin du XIXe siècle, l'Occident se retrouve sans aucune force spirituelle capable de ré-interpréter la nouvelle physique et de l'intégrer dans une perspective plus générale et universelle. Par ailleurs, l'effondrement du paradigme mécaniciste ouvre la voie à toutes sortes de mouvements pseudo-spirituels ou occultistes, tandis que les théologiens, maladroits et éloignés de toute véritable sapientia, ne parviennent pas à donner une réponse satisfaisante ou élaborent des corpus boîteux, comme celui de Teilhard de Chardin, qui, écrit S. H. Nasr, « est une absurdité sur le plan de la métaphysique et une hérésie sur le plan de la théologie ».
Dans un second ouvrage de S. H. Nasr, Knowledge and the Sacred, paru en traduction allemande en 1990 : Die Erkenntnis und das Heilige (E. Diederichs Verlag, München, 1990, 438 p.), notre auteur récapitule ses arguments, tout en opposant la connaissance sapentiale et les processus involutifs de désacralisation, l'homme pontifical (de pontifex, pontem-facere, faire de soi un pont entre le ciel et la terre) à l'homme prométhéen. Le propos de S. H. Nasr vise à réhabiliter le sacré dans la science, à réouvrir la science aux perspectives métaphysiques, c'est-à-dire aux plans qualitatifs ignorés par le paradigme newtono-cartésien, mais présents dans l'Islam traditionnel, par ex.
Pour S. H. Nasr, en Islam, religion qui, comme le judaïsme, repose sur la spiritualité abrahamique, le message de la révélation s'adresse essentiellement aux facultés de connaissance ; en effet, la révélation islamique s'adresse à l'homme en tant qu'intelligence, capable de faire la distinction entre le réel et l'irréel, de reconnaître et de vénérer l'Absolu. Ce message, écrit S. H. Nasr, a été déterminé dans l'histoire par son premier conteneur, c'est-à-dire la mentalité sémitique-arabe, qui lui a conféré une certaine émotionalité, une propension à l'inspiration exaltée, qui, sur le plan théologique, se traduit par une forme d'“anti-intellectualisme” volontaire / volontariste. Il n'en demeure pas moins que cette émotionalité anti-intellectualiste de facture sémitique-arabe n'est qu'un aspect circonstantiel de l'Islam. Son noyau essentiel demeure le primat de la connaissance, auquel émotions, inspirations et exaltations doivent rester subordonnées. Le premier article de la foi islamique Lã ilãha illa' Llãh (Il n'y a point d'autre divin que le Divin) s'adresse en premier lieu à la connaissance et non au sentiment ou à la volonté. Le principe de connaissance est le moteur de l'Islam et tous les noms traditionnels relatifs aux écrits sacrés ont un rapport avec la connaissance : al-qur’ãn (exposé, discours), al-furqãn (distinction), etc. En terre d'Islam, tout au long de l'histoire, nous repérons un véritable culte de la connaissance.
Sapienta / sophia néo-platonicienne et islamique
Culte de la connaissance qui est lié, écrit S. H. Nasr, à cette sapientia, cette sophia, qui dépasse la dichotomie conventionnelle entre l'intellectualisme grec et “l'inspirationalisme” hébraïque. La sophia, en effet, n'est ni pure intellectualité ni pure foi. Elle est les deux, à la perfection. Les néo-platoniciens l'ont mise en valeur, mais leur message n'a pas été entièrement compris, du moins dans le contexte chrétien et européen. La tradition chrétienne ne se veut pas a priori un chemin de la connaissance, mais un chemin de l'Amour, ce qui a conduit, dès l'aube de l'ère moderne, à négliger la sagesse/sophia, comme si elle était un corps étranger au sein d'une religion purement éthique, dont le socle serait l'amour pour Dieu et pour le prochain et l'élément central la foi. Certes, écrit Nasr, le christianisme est une religion qui privilégie la voie de l'Amour, mais son histoire révèle tout de même des pistes qui ont valorisé les voies de la connaissance et de la sagesse. Notamment, dans les traditions johannites, qui affirment le primat du logos, source de la révélation et de la connaissance (“Au commencement était le Verbe”). Cette attention moindre du christianisme au primat de la connaissance à conduit à la surévaluation contemporaine de l'éthique, au détriment de la naturalité, du politique et du travail (cf. Sigrid Hunke, Vom Untergang des Abendlandes zum Aufgang Europas : Bewußtseinswandel und Zukunftsperspektiven, Horizonte Verlag, Rosenheim, 1989).
L'œuvre de Jean Scot Érigène
Ce “chemin de la sagesse”, nous le retrouvons à Byzance, où se dresse la construction sacrée la plus belle du christianisme primitif, la Hagia Sophia, dédiée à la Sagesse, représentée par ailleurs sous les traits d'une belle jeune femme, qui sera, tour à tour, la Vierge Marie ou la Béatrice de Dante ou Fatima, la fille du Prophète. Mais ce culte de la sophia et de la gnosis sera graduellement refoulé, si bien qu'en Occident le concept de connaissance sera entièrement sécularisé. Pourtant la dimension sapientiale a été présente dans le christianisme, surtout chez Denys l'Aréopagyte, que le grand métaphysicien indien A. K. Coomaraswamy appelle le plus grand des Européens à côté de Dante. Son message est revenu au IXe siècle grâce aux traductions et aux travaux de l'Irlandais Jean Scot Erigène (810-877), dans le De divisione naturae, écrit entre 864 et 866. Pour Denys l'Aréopagyte et Jean Scot Erigène, la connaissance est centrale, elle est le moteur permanent de tout et non pas le simple moteur premier (à la phrase latine in principio erat verbum, soit “au commencement était le Verbe”, Scot Erigène substitue “in principio est Verbum”, soit “au commencement est le Verbe”, signalant par ce présent, qui est au fond intemporel, que le commencement de toute chose réside dans la connaissance). Cette vision du divin renoue avec l'émanatisme néo-platonicien : tout procède du moteur premier, c'est-à-dire du principe supérieur, thèse radicalement différente de celle de l'évolutionnisme, où tout part des êtres les plus bas de l'échelle.
Jugé hérétique et condamné par le Pape Honoré III en 1225, Jean Scot Erigène est compté parmi les philosophes panthéistes; les penseurs et philosophes islamiques, surtout ceux qui sont marqués par le soufisme, aiment son œuvre, comme celle de tous les néo-platoniciens, panthéistes et mystiques européens (Pélage, Maître Eckhart, Nicolas de Cues) car elle correspond à la théorie soufique de la Création que l'on désigne par “le renouvellement de la Création en chaque instant” ou “à chaque souffle” (Tajdîd al-khalq bilanfas), théorie proche de celle qui posent les archétypes se projettant dans l'existence par émanation à chaque instant, émanation qui traverse les hommes, anéantissant leur passé au même moment où elle les renouvelle. Les “expirs” (anfãs) du Clément sont dilatations du divin, c'est-à-dire déploiement de “possibilités relatives” à partir des archétypes ; la surabondance de l'Être “déborde” (afãda) sur les essences limitées. Ibn Arabî identifie “l'Expir” divin à la Nature universelle (at-Tabî'ah), attribuant à celle-ci une fonction cosmogonique analogue à celle que les Hindous désignent comme la Shakti, “l'énergie productive” de la Divinité (source de ce § : Titus Burckhardt, Introduction aux doctrines ésotériques de l'Islam, Dervy, 1969).
L'Occident n'a pas approfondi cette veine mystique et néo-platonicienne, contrairement à l'Inde et à l'Islam. Il a préféré les “synthèses théologiques” de Saint-Bonaventure, de Saint Thomas d'Aquin ou de Duns Scot, mettant l'accent sur la contemplation, le silence contemplatif ou la volonté. Pour S. H. Nasr, ces synthèses scolastiques surtout celle de Thomas d'Aquin, enferment leurs intuitions métaphysiques, qui sont justes, dans le corset étouffant de catégories syllogistiques, dans un rationalisme étroit. La sophia, dans ses avatars christianisés, est ainsi voilée; la connaissance, la sapience, perd son caractère sacré, et un divorce s'instaure entre la philosophie et la sagesse / sophia. Cette théologie et cette philosophie du voilement, amorçant la désacralisation généralisée du savoir et de la connaissance, donne le ton en Occident et refoule dans la marginalité les traditions mystiques (dont celle de Maître Eckhart). Le thomisme a donc été la forme la plus achevée et la plus mûre de la théologie chrétienne : mais il n'était pas pure sapientia et médiatisait dangereusement le rapport entre l'entendement humain et la raison divine.
Pour comprendre ce processus d'occultation de la sophia et de désacralisation, il faut signaler l'influence exercée par les doctrines d'Ibn Sînâ (Avicenne) et Ibn Rushd (Averroès) dans le monde où le latin était langue savante. La traduction en latin a gommé une bonne part des potentialités scientifiques et sapientiales de ces doctrines : en effet, en Islam, avec Suhrawardî, l'interprétation des travaux d'Avicenne et d'Averroès renforce la scientificité de la science islamique pré-moderne, sans scotomiser le fond sapiential, tandis qu'en Occident latin, les fragments épars les plus rationalistes de ces philosophies s'imposent. L'Occident opte dès lors pour une interprétation rationaliste de l'avicennisme et de l'averroïsme ; l'Islam, lui, proclame la primauté de l'intellectio sur la ratiocinatio. Suhrawardî parle d'illumination immédiate par la nature aux dimensions sacrées ; l'Occident privilégie les mécanismes médiats du discours.
Sur les traces de la religion
La présence de ces doctrines émanatistes, où la nature est respectée en tant que véhicule des grâces divines, dans toutes les traditions islamiques, christianisées, hindoues, chinoises, néo-platoniciennes, etc. permet de parler d'une philosophia perennis ou d'une sanatâna dharma (A.K. Coomaraswamy) ou de “religion pérenne” (F. Schuon ; cf. Sur les traces de la religion pérenne, Courrier du Livre, 1982) ou de “vraie religion de l'Europe” (Sigrid Hunke, La vraie religion de l'Europe, Labyrinthe, 1985 ; le livre de S. Hunke se limite géographiquement à l'Europe). S. H. Nasr nous rappelle que l'expression de philosophia perennis remonte au XVIe siècle et se retrouve dans l'œuvre d'un hébraïsant et arabisant italien, bibliothécaire du Vatican, Agostino Steuco (1497-1548), notamment dans son De perenni philosophia, un ouvrage clef, marqué par les pensées de Marsile Ficin (qui parlait de philosophia priscorium ou de prisca theologia), Pic de la Mirandole et Nicolas de Cues. Dans De pace fidei, Steuco plaide pour une réconciliation ou du moins pour une coexistence harmonieuse des grandes religions, qui s'opérerait par le haut, précisément sur base de la philosophia perennis. Ce recours à la philosophia perennis permet de renouer avec les traditions grecques païennes (Platon, Pythagore, Empédocle, etc.) et celles de l'Iran pré-islamique. La Sophia perennis précède donc les révélations du Livre, ce qui permet de parler de Tradition (primordiale) ou, en arabe, d'al-dîn.
Islam et christianisme
Pour compléter ces propos sur la définition que donne Seyyed Hossein Nasr de la Tradition et de la (philo)sophia perennis, il me semble bon de faire référence à quelques pages du livre de Frithjof Schuon (De l'unité transcendante des religions, Seuil, 1979), signalant les positions particulières de l'islam et du christianisme, ainsi que leurs convergences et différences majeures (pp. 131-138). Le christianisme repose sur le Christ. L'Islam ne repose pas immédiatement sur le Prophète mais sur le Qoran, affirmation de l'Unité divine. Le christianisme repose sur le fait christique, fait unique. L'Islam repose sur une idée d'Unité, laquelle est posée d'office comme pérenne. Par conséquence, le christianisme accorde une prépondérance à l'intermédiaire incarné. L'Islam n'accorde pas cette prépondérance à l'intermédiaire. Le christianisme, doctrine de l'incarnation, ne prévoit pas d'autre application humaine que les sacrements, notamment celui de l'Eucharistie. Il n'a jamais eu d'application sociale dans le sens complet du mot : comme le soulignait par ailleurs René Guénon dans Aperçus sur l'ésotérisme chrétien (op. cit. ; chap. l, « À propos des langues sacrées », pp. 15-19), le christianisme, contrairement au judaïsme et à l'Islam, n'a pas de code juridique, de Shariyah, et l'Europe chrétienne a dû se référer au droit romain, d'essence indo-européenne et “païenne”, alors que tous les autres legs de l'indo-européanité étaient dévalorisés au nom même de la Révélation ! De plus, aucun texte fondateur du christianisme ne repose sur une “langue sacrée”, originale et fixée ; les Évangiles ne sont pas écrits dans la langue que parlait le Christ et n'existent qu'en traductions grecques ou latines. Les interprétations peuvent dès lors varier à l'infini. Cette absence de “langue sacrée” et de Shariyah fait que les sociétés chrétiennes reposent sur un tissu d'ambiguïtés, qui corroborent leur faiblesse et leur propension à la décadence.
À notre époque, cette absence de droit sacré et de textes précis, permet à certains cénacles et philosophes d'affirmer un “primat de la Loi”, dans une optique très moderne et très militante. Pour les tenants de ce primat de la Loi, il faut respecter les systèmes modernes, juridiques ou économiques, lesquels forment un ersatz de loi, d'essence moderne, comme si ces systèmes et ces pratiques constituaient une Loi héritée d'une tradition religieuse multiséculaire ou multimillénaire. Si les Juifs de l'Ancien Testament, ou les Juifs actuels, respectent la Loi, leur Loi, il faut respecter, disent-ils, les lois actuelles comme si elle était une Loi traditionnelle. Et ne rien mettre en doute, sous peine d'être accusé de “fascisme”. Ce fétichisme de la Loi conduit à une limitation ou à un rejet du droit, dans le sens romain du terme. Ce “nomos” moderne transcenderait ainsi les modalités juridiques, nées et peaufinées au fil des siècles. Le droit doit céder le pas devant la pseudo-Loi, sous prétexte que ce droit est d'origine romaine, donc païenne. En politique internationale, ce type de discours conduit à un déni général des souverainetés populaires, parce que celles-ci ne sont pas en adéquation parfaite avec les principes simples de la pseudo-Loi, vu qu'elles sont toujours circonstantielles. Le discours sur la pseudo-Loi correspond parfaitement à la volonté américaine d'imposer un “nouvel ordre mondial”. Mais cette pseudo-Loi est parodie, parce qu'elle ne repose sur aucune source religieuse sûre, écrite dans une langue sacrée, parlée par un Prophète ou léguée par une caste souveraine comme les Brahmanes indiens.
Islamophobie ?
À la lecture de ces textes, nous constatons que l'islamophobie n'est pas une idéologie défendable, parce que :
♦ Le primat accordé à la connaissance, plutôt qu'aux sentiments ou à un fait, fût-il essentiel, est une idée qui sied davantage à la véritable psyché européenne qu'à la psyché arabosémitique, plus enthousiaste et émotive ;
♦ La présence d'une Shariyah montre qu'il n'y a pas négligence de la cité ou de la communauté populaire, alors que dans le christianisme, il y a rejet de tout ce qui est profane en dehors de l'Église ; en Islam, chaque homme dispose de sa propre autonomie ; il est un “cube” bien circonscrit, reflet de la ka'ba et transposable partout, indépendamment de l'environnement, sans perte de son identité. Le parallèle entre cette vision du croyant et celle du paysan germanique ou du colon romain, indépendant et libre, chef des siens et dégagé de toute tutelle, est frappant.
♦ Le parallèle entre les “hérétiques” européens de facture néo-platonicienne ou panthéiste et les soufistes persans ou inscrits dans la tradition d'un Ibn Arabî montre que les traditions philosophiques sont inséparables. Et que les adversaires des uns et des autres sont ceux qui veulent réduire la multiplicité des émanations de l'Un à quelques schémas inopérants, qui ne conduisent qu'à la décadence par fermeture d'esprit et par refus del'apport d'innovations (des innovations qui, dans la perspective non linéaire mais cyclique de la Tradition / al-dîn, sont des avatars existentiels donc circonstanciels des “essences immuables”, des archétypes, de l'Un) que constitue en permanence le flux venu de l'Un, de Dieu.
♦ Dernière remarque : l'Islam ne doit pas être jugé à l'enseigne des dysfonctionnements sociaux provoqués par l'immigration ; agressivité pathologique de certains migrants (musulmans ou non), délinquance et mal-de-vivre des jeunes générations arabo-musulmanes et négro-africaines ne sont pas des faits consubstantiels à l'Islam, mais des effets d'une désislamisation, comme sont effets de la désislamisation les attitudes crispées, soi-disant “fondamentalistes” et militantes, attitudes justifiées par des arguments pseudo-religieux qui ne vont jamais à l'essentiel (c'est-à-dire au noyau ésotérique fondamental de l'Islam). Généralement, les tenants de ce pseudo-islamisme, bigot et superficiel, veulent justifier et excuser des comportements délictueux par la différence de religion, défendant des Musulmans qui ont enfreint et la Shariyah et les lois des pays-hôtes. Attitude évidemment inadmissible que. l'on doit condamner au nom du droit romain comme au nom de la Shariyah.
► Robert Steuckers, Vouloir n°89/92, 1992.
Pièces-jointes :
◘ Nous ajoutons ici, extraits de l'ancienne revue d'études polythéiste Antaïos n°16 (2001), un texte de S. H. Nasr, suivi d'un article relatif à cet auteur de J.-L. Gabin, et enfin en point d'orgue du dossier Dharma (qui comprenait également 2 textes traduits, un de Ram Swarup, l'autre de Rishi Kumar Mishra, ainsi que 2 entretiens, l'un avec J. Haudry et l'autre avec J. Vertemont) une note de C. Gérard (reprise dans le recueil La source pérenne).

Qu'est-ce que la Tradition ?
Le terme de tradition ne signifie pas non plus exactement traditio au sens catholique bien qu'il embrasse l'idée implicite dans le terme de traditio : la transmission d'une doctrine et de pratiques inspirées et en définitive révélées. En fait, le mot tradition se rapporte étymologiquement à l'idée de transmission et inclut dans l'extension de son concept l'idée de transmission de connaissance, pratiques, techniques, lois, formes et de nombreux autres éléments de nature orale ou écrite. La tradition est une présence vivante qui laisse son empreinte sur la réalité humaine mais n'est pas réductible à cette empreinte. Ce que la tradition transmet peut apparaître sous la forme de mots sur un parchemin mais peut aussi prendre la forme de vérités gravées dans l'âme des hommes et être aussi subtil que le souffle ou même le regard par lequel certains enseignements sont transmis. La tradition telle que nous l'entendons techniquement dans cet ouvrage, comme dans tous nos autres écrits, signifie les vérités ou principes d'origine divine révélés ou dévoilés à l'humanité et, en fait, à tout un secteur cosmique, par l'intermédiaire de divers messagers, prophètes, avatâras, Logos ou autres médiations, de même que tous les prolongements et les applications de ces principes dans divers domaines dont la loi et la structure sociale, l'art, le symbolisme, les sciences, y compris de toute évidence la Connaissance suprême et l'ensemble des moyens y conduisant.
En son sens plus universel, on peut considérer que la tradition comprend les principes qui relient l'homme au Ciel, et donc la religion, tandis que d'un autre point de vue la religion peut être considérée en son sens essentiel comme l'ensemble des principes révélés par le Ciel et qui relient l'homme à son Origine. Dans ce cas, la tradition peut être considérée en un sens plus restreint comme l'application de ces principes. La tradition comprend les vérités d'un caractère supra-individuel enracinées dans la nature du réel comme tel car, comme on a pu le dire, « la tradition n'est pas une mythologie puérile et désuète, mais une science terriblement réelle » (1).
La tradition, comme la religion, est à la fois vérité et présence. Elle concerne le sujet connaissant et l'objet connu. Elle jaillit de la Source dont tout provient et à laquelle tout retourne. Elle embrasse ainsi toutes choses comme le “Souffle du Miséricordieux” qui, selon les soufis, est à la racine même de l'existence. La tradition est inextricablement liée à la Révélation et à la religion, au sacré, à la notion d'orthodoxie, à l'autorité, à la continuité et à la régularité de la transmission de la vérité, à l'exotérique et à l'ésotérique comme à la vie spirituelle, à la science et aux arts. Les couleurs et les nuances de sa signification apparaissent en fait dans une plus grande clarté à mesure que sa relation à tous ces éléments et à d'autres concepts corrélatifs est élucidée.
Pour le grand nombre de ceux qui ont, ces dernières décennies, entendu l'appel de la tradition, la signification de cette notion est avant tout associée à la sagesse pérenne qui réside au cœur de toute religion et qui n'est autre que la Sophia dont la possession n'a cessé d'être considérée comme le couronnement ultime de la vie humaine par la perspective sapientielle de l'Occident autant que de l'Orient. Cette sagesse éternelle dont l'idée de tradition ne saurait être séparée et qui constitue un des principaux éléments du concept de tradition n'est autre que la sophia perennis de la tradition occidentale, sagesse que les hindous désigne du nom de sanatâna dharma (2) et les musulmans de celui d'alhikmat al-khâlidah (ou en persan jâwidân khirad) (3).
En un sens, le sanatâna dharma ou la sophia perennis est en relation avec la Tradition primordiale et par là même avec l'Origine de l'existence humaine. Ce point de vue ne doit cependant point nous détourner de l'authenticité des messages célestes ultérieurs manifestés dans diverses révélations, ni saper leur validité ; chacune de ces révélations a en effet une origine qui est l'Origine et qui marque le commencement d'une tradition qui est à la fois la Tradition primordiale et son adaptation à une humanité particulière, l'adaptation étant une Possibilité divine manifestée sur le plan humain. L'attirance de l'homme de la Renaissance pour la quête des origines et de la “Tradition primordiale” qui conduisit Marsile Ficin à délaisser la traduction de Platon pour le Corpus Hermeticum, alors considéré comme plus ancien et primordial, tendance qui devint également partie intégrante de la vision du monde et du Zeitgeist du XIXe siècle (5), est à l'origine de nombreuses confusions relatives à la signification de la “Tradition primordiale” dans son rapport aux diverses religions. Chaque tradition et la Tradition comme telle sont reliées en profondeur à la sagesse pérenne ou Sophia, pourvu que ce lien ne soit pas seulement considéré d'un point de vue temporel et ne soit pas non plus cause d'un rejet des autres messages du Ciel que constituent les diverses religions et qui sont bien entendu intérieurement reliés à la Tradition primordiale, sans pour autant constituer simplement sa continuation temporelle et historique. Le génie spirituel et la particularité de chaque tradition ne peuvent être négligés au nom de la sagesse toujours présente qui réside au cœur de la totalité des descentes célestes.
A. K. Coomaraswamy, l'un des plus éminents représentants contemporains des doctrines traditionnelles, traduisait sanatâna dharma par philosophia perennis, désignation à laquelle il ajoutait l'adjectif universalis. Sous son influence, beaucoup ont identifié la tradition avec la philosophie pérenne à laquelle elle est profondément apparentée (6). Le terme de philosophia perennis, ou sa traduction française, est néanmoins problématique en soi et doit faire l'objet d'une définition avant que la tradition puisse être comprise sous le rapport de la relation qu'elle entretient avec elle. Contrairement à l'assertion d'Huxley, le terme de philosophia perennis ne fut pas pour la première fois employé par Leibniz dans une célèbre lettre à Rémond datant de 1714 (7). En fait, il fut probablement employé pour la première fois par Augustinus Steuchus dit Eugubinus (1497-1548), philosophe et théologien augustinien de la Renaissance. Bien que le terme ait été associé à de nombreuses écoles philosophiques dont la scolastique, particulièrement le thomisme (8), et le platonisme en général, ce sont là des associations plus récentes, tandis que pour Steuchus il s'identifiait à la sagesse pérenne — qui embrasse à la fois la philosophie et la théologie —, et non seulement à une école sapientielle donnée.
L'œuvre de Steuchus intitulée De perenni philosophia est marquée par les influences de Ficin, de Pic et même de Nicolas de Cues, particulièrement le De pace fidei où il est question de l'harmonie entre les diverses religions. Steuchus, qui connaissait l'arabe et d'autres langues sémitiques et occupait les fonctions de bibliothécaire du Vatican où il avait accès à la “sagesse des âges” dans la mesure où c'était alors possible en Occident, reprit les idées de penseurs antérieurs concernant la présence d'une ancienne sagesse ayant existé depuis l'aube de l'histoire. Ficin ne fit pas usage du terme de philosophia perennis, mais il fit souvent allusion à la philosophia priscorum ou prisca theologia, terme qui peut être traduit par philosophie ou théologie ancienne ou vénérable. À la suite de Gémisthe Pléthon, le philosophe byzantin qui traita de cette antique sagesse et souligna le rôle de Zoroastre en tant que maître de cette ancienne connaissance de caractère sacré, Ficin mit l'accent sur la signification du Corpus Hermeticum et des Oracles Chaldaïques, œuvres dont il considérait Zoroastre comme l’auteur et qu'il situait à l'origine de cette sagesse primordiale. Il avait la conviction que la philosophie véritable prenait sa source dans Platon, héritier de cette sagesse, et la théologie véritable dans le Christianisme (9). Cette vraie philosophie, vera philosophia, n'était autre pour lui que la religion, et la vraie religion n'était autre que cette philosophie. Pour Ficin, comme pour bien des platoniciens chrétiens, Platon avait eu connaissance du Pentateuque et n'était autre qu'un un « Moïse de langue grecque », ce même Platon que Steuchus appelait divus Plato de la même manière que maints sages musulmans lui avaient donné le titre d'Aflâtûn al-ilâhî, le « divin Platon » (10). Ficin, en un sens, a reformulé les positions de Gémisthe Pléthon concernant la pérennité de la vraie sagesse (11). Pic de la Mirandole, compatriote de Ficin, devait ajouter aux sources de la philosophia priscorum, le Qoran, la philosophie islamique et la Kabbale en plus des sources non-chrétiennes et tout particulièrement gréco-égyptiennes prises en compte par Ficin, cela tout en suivant la perspective de celui-ci et en mettant l'accent sur l'idée de la continuité de la sagesse essentiellement une à travers les diverses civilisations et périodes de l'histoire. (…)
Si la sagesse pérenne ou antique doit être comprise comme l’entendaient Pléthon, Ficin et Steuchus, elle est alors en rapport avec l’idée de tradition et peut même traduire sanatâna dharma, pourvu que le terme de philosophia ne soit pas seulement compris en termes théoriques, mais qu’il incluse également la réalisation (12). La tradition implique le sens d'une vérité qui est d'origine divine et se trouve perpétuée tout au long d'un cycle majeur de l'histoire de l'humanité par l'entremise d'une transmission et d'un renouvellement du message par la voie de la Révélation. Elle comprend également une vérité intérieure qui réside au cœur des différentes formes sacrées et qui est unique puisque la Vérité est une. Dans les deux sens, la tradition est étroitement en rapport avec la philosophia perennis dans la mesure où celle-ci est comprise comme la Sophia qui a toujours été et sera toujours, et qui se perpétue par la voie d'une transmission horizontale et, verticalement, par la voie d'un renouvellement par contact avec la réalité qui était “au commencement”, et est ici et maintenant (13). (...)
De nos jours, la critique du monde moderne et du modernisme est devenue un lieu commun, des œuvres des poètes aux analyses des sociologues (14). Cependant, l'opposition de la tradition au modernisme, totale et complète quant aux principes, ne découle point de l'observation de faits et de phénomènes ou du diagnostic porté sur les symptômes de la maladie. Elle est fondée sur l'étude des causes du mal. La tradition est opposée au modernisme parce qu'elle considère les prémisses sur lesquelles il repose comme erronées et fausses dans leur principe (15). Elle n'ignore pas le fait que tel élément d'un système philosophique moderne donné puisse être valide ou manifester un bien. En fait, l'erreur ou le mal absolu ne sauraient exister puisque tout mode d'existence inclut quelque élément de vérité et de bonté qui, en leur pureté, relèvent de la Source de toute existence.
Ce que la tradition critique dans le monde moderne, c'est la vision du monde, les prémisses, les fondements qui, de son point de vue, sont fondamentalement erronés, de telle sorte que le bien qui se manifeste dans ce monde ne peut être qu'accidentel et secondaire. On pourrait dire que les mondes traditionnels étaient essentiellement bons et accidentellement mauvais tandis que le monde moderne est essentiellement mauvais et accidentellement bon. La tradition est donc opposée au modernisme dans son principe. Elle combat le monde moderne afin de créer un monde normal (16). Son but n'est pas de détruire ce qui est positif, mais d'ôter le voile d'ignorance qui permet à l'illusoire de se donner comme réel, au négatif' comme positif, et au faux comme vrai. La tradition n'est pas opposée à la totalité du monde d'aujourd'hui et elle refuse en fait d'identifier au modernisme l'ensemble de l'existence contemporaine. Après tout, bien que notre époque ait été qualifiée d'ère de l'espace ou d'ère atomique, l'homme ayant visité la lune et ayant accompli la scission de l'atome, on pourrait tout aussi l'appeler, selon la même logique, l'ère monastique puisque vivent aujourd'hui des moines comment vivent aussi des astronautes. Le fait que la période actuelle ne soit pas désignée comme l'ère monastique, mais comme l'ère de l'espace, est en soi le fruit du point de vue moderniste qui identifie le modernisme au monde contemporain, alors que la tradition distingue nettement les deux, cherchant à détruire le modernisme, non à détruire l'homme contemporain, mais plutôt à le sauver en s'efforçant de l'écarter d'un chemin dont l'issue ne peut être que perdition et destruction. Dans cette perspective, l'histoire de l'humanité occidentale au cours des cinq derniers siècles constitue une anomalie dans la longue histoire de l'espèce, et ce tant en Orient qu'en Occident. En s'opposant au modernisme en principe et de façon catégorique, ceux qui adoptent la perspective traditionnelle n'ont qu'un seul souhait, celui de permettre à l'homme occidental de rejoindre le reste de l'humanité.
► Seyyed Hossein Nasr, extrait de : La Connaissance et le Sacré, L'Âge d'Homme, 1999, pp. 63-67 et 80-81.
♦ Notes :
- (1) F. Schuon, Comprendre l'Islam, Ed. du Seuil.
- (2) Le terme de sanatâna dharma ne peut être traduit exactement, bien que sophia perennis soit peut-être la traduction la plus proche puisque sanatâna signifie pérennité (c'est-à-dire perpétuité tout au long d'un cycle d'existence humaine et non éternité) et dharma, le principe de conservation des êtres, chaque être ayant son propre dharma auquel il doit se conformer et qui constitue sa loi. Mais le dharma s'applique également à la la totalité d'une humanité au sens de Mânava-dharma et se rapporte dans ce cas à la connaissance sacrée ou Sophia qui est au cœur de la loi présidant à un cycle humain. En ce sens, le sanatâna dharma correspond à la sophia perennis, particulièrement si on prend en considération sa dimension de réalisation et non seulement son aspect théorique. En son sens intégral, le sanatâna dharma est la Tradition primordiale elle-même telle qu'elle a subsisté et continuera de subsister jusqu'à la fin du cycle humain présent. Voir R. Guénon, « Sanatâna Dharma », dans ses Études sur l'Hindouisme, Paris I V, 08, pp. 105-6.
- I ? Il s'agit là en fait d'un ouvrage célèbre de Ibn Miskawayh (Muskûyah) qui contient des aphorismes et des maximes métaphysiques et éthiques de sages musulmans et préislamiques. Voir l'édition par A. Badawi de al-Hikmat al-khâlidah : Jâwîdân khirad, Le Caire, 1952. Cet ouvrage traite de la pensée et des écrits d'un grand nombre de sages et de philosophes, y compris ceux de la Perse antique, de l'Inde et du monde méditerranéen (Rûm). Sur cet ouvrage, se reporter à l'introduction de M. Arkoun à la traduction persane d'Ibn Miskawayh, Jâvîdân khirad, Téhéran, 1976, pp. 1-24.
- (4) La Tradition primordiale n'est autre que ce que l'Islam désigne sous le terme de al-dîn al-hanîf, réalité à laquelle se réfère le Qoran dans des contextes divers, mais d'ordinaire en relation au prophète Abraham habituellement désigné comme hanîf ; par ex., « Non, mais (nous suivons) la religion d'Abraham, le pur (hanîfan), qui n'était pas au nombre des idolâtres » (11, 135). Voir également les versets III, 67 et 95-VI et 161-XVI,120-et XVII, 31.
- (5) Se reporter à M. Eliade, « The Quest for the Origins of Religion », History of Religions 411 (Summer 1964) : 154-69.
- (6) Le célèbre ouvrage d'Aldous Huxley, Perennial Philosophy, New York, 1945, est l'un des livres s'efforçant de démontrer l'existence de cette sagesse vivante et pérenne et d'en présenter le contenu par le biais d'un choix de textes d'origines traditionnelles diverses, mais l'ouvrage demeure à bien des égards incomplet et sa perspective n'est pas traditionnelle. Le premier ouvrage à avoir pleinement réalisé la suggestion de Coomaraswamy en réunissant un vaste compendium de connaissances traditionnelles afin de démontrer la remarquable pérennité et universalité de la sagesse est l' l'œuvre malheureusement négligée de W.N. Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, Londres et New York, 1971, œuvre-clef pour la compréhension du sens donné par les auteurs traditionnels au concept de philosophie pérenne.
- (7) Après avoir déclaré dans cette lettre que la vérité a une extension plus grande qu'on ne le pensait auparavant et qu'on en trouve la trace jusque chez les Anciens, il affirme, « et ce serait en effet perennis quaedam Philosophia », C.J. Gerhardt (édit.), Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibnitz, Berlin, 1875-90, volume 3, p. 625. Également cité chez C. Schmitt, « Perennial Philosophy : Steuco to Leibnitz », Journal of the History of Ideas 27 (1966) : 506. Cet article (pp. 505-532 du volume cité) retrace l'histoire de l'usage du terme philosophia perennis en portant particulièrement son attention sur son arrière-plan à l'époque de la Renaissance, notamment chez Ficin et d'autres figures des débuts de la Renaissance. Voir également J. Collins, « The Problem of a Perennial Philosophy », dans ses Three Paths in Philosophy, Chicago, 1962, pp. 255-79.
- (8) L'identification de la « philosophie pérenne » au thomisme et à la scolastique en général est un phénomène du XXe siècle, tandis qu'à la Renaissance la scolastique s'opposait généralement aux thèses de Steuchus.
- (9) Héritier de Zoroastre, d'Hermès, d'Orphée, d'Aglaophème (le maître de Pythagore) et de Pythagore.
- (10) Ce terme se retrouve chez des philosophes musulmans tel al-Fârâbî de même que chez certains soufis.
- (11) À propos des conceptions de Ficin, se reporter aux divers ouvrages de R. Klibansky, E. Cassirer et P.O. Kristeller sur la Renaissance, particulièrement les Studies in Renaissance Thought and Letters de Kristeller, Rome, 1956 ; et du même, Il pensiero filosofico di Marsilio Ficino, Florence, 1953.
- (12) En se référant à religio perennis, Schuon peut écrire, « terme qui évoque la philosophia perennis de Steuchus Eugubin (XVIe siècle) et des néoscolastiques : mais le mot philosophia suggère à tort ou à raison une élaboration mentale plutôt que la sagesse et ne convient donc pas exactement à ce que nous entendons » Regards sur les mondes anciens, Paris, 1976, p. 174.
- (13) « Le terme de philosophia perennis (...) désigne la science des principes ontologiques fondamentaux et universels ; (...) science immuable comme ces principes mêmes, et primordiale du fait même de son universalité et de infaillibilité. Nous utiliserions volontiers le terme de sophia perennis pour indiquer qu'il il ne s'agit pas de “philosophie” au sens courant et approximatif du mot. (...) Il importe de savoir avant tout qu'il est des vérités qui sont inhérentes à l'esprit humain mais qui, en fait, sont comme ensevelies “au fond du cœur”, c'est-à-dire contenues à titre de potentialités ou de virtualités dans l'Intellect pur : ce sont les vérités principielles et archétypiques, celles qui préfigurent et déterminent toutes les autres ? Y ont accès, intuitivement et infailliblement, le “gnostique”, le “pneumatique”, le “théosophe” – au sens propre et originel de ces termes – et y avait accès par conséquent le “philosophe” selon la signification encore littérale et innocente du mot : un Pythagore ou un Platon, et en autre partie un Aristote... », Schuon, Sur les traces de la religion pérenne, Paris, 1982, pp. 9-10. Voir également Schuon, Wissende, Verschwiegene, Eingeweihte : Hinführung zur Esoterik, Herderbücherei Initiative 42, Munich, 1981, pp. 23-28.
- (14) Il y a un demi-siècle, on devait lire T.S. Eliot pour se rendre compte de la lamentable condition spirituelle de l'homme moderne, mais aujourd'hui, les analystes de la société humaine sont nombreux à prendre conscience du caractère profondément vicié des axiomes qui fondent le modernisme, et nombreux aussi à entreprendre d'étudier la société moderne de ce point de vue (...).
- (15) Sur les critiques traditionnelles du monde moderne, voir R. Guénon, La Crise du monde moderne, Paris, 1926 et A.K. Coomaraswamy, Suis-je le gardien de mon frère ?, Paris 1997.
- (16) Faisant référence à son premier contact avec des auteurs traditionnels, J. Needleman écrit : « These were out for the kill. For them, the study of spiritual traditions was a sword with wich to destroy the illusions of contemporary man », Needleman (ed.), The Sword of Gnosis, Baltimore, 1974, p. 9.

◘ Seyyed Hossein Nasr : universitaire iranien, après des études au MIT et à Harvard, a dirigé l'Académie Impériale de Philosophie (Téhéran). Il a collaboré avec H. Corbin à la rédaction de l'Histoire de la philosophie islamique (Gallimard 1964). Spécialiste du Soufisme, il enseigne actuellement les études islamiques à Washington. Les éditions L'Âge d'Homme ont publié en 1993 L'Islam traditionnel face au monde moderne, ouvrage fondamental pour mieux distinguer entre Islam traditionnel et fondamentalisme (avatar du modernisme). L'auteur se penche sur 3 hautes figures de l'islamologie européenne : L. Massignon, H. Corbin et T. Burckhardt. Il a paru intéressant de publier dans cette livraison quelques pages de son livre fondamental pour la vision du monde traditionnelle : le professeur Nasr s'inscrit dans la tradition soufie et travaille précisément contre l'oubli des traditions, de toutes les traditions, y compris hindoues, païennes, etc. Son essai réhabilite avec talent le principe d'une connaissance sapientiale (ou sacrée) et propose aux Européens le recours aux filons néoplatoniciens et mystiques pour sortir de l'ornière moderniste. Il dresse un parallèle entre les hérétiques européens (panthéistes par ex.) et les soufis persans. La démarche de S.H. Nasr illustre parfaitement la convergence entre hommes de tradition, par delà les appartenances extérieures.

À la recherche du Sanâtana Dharma
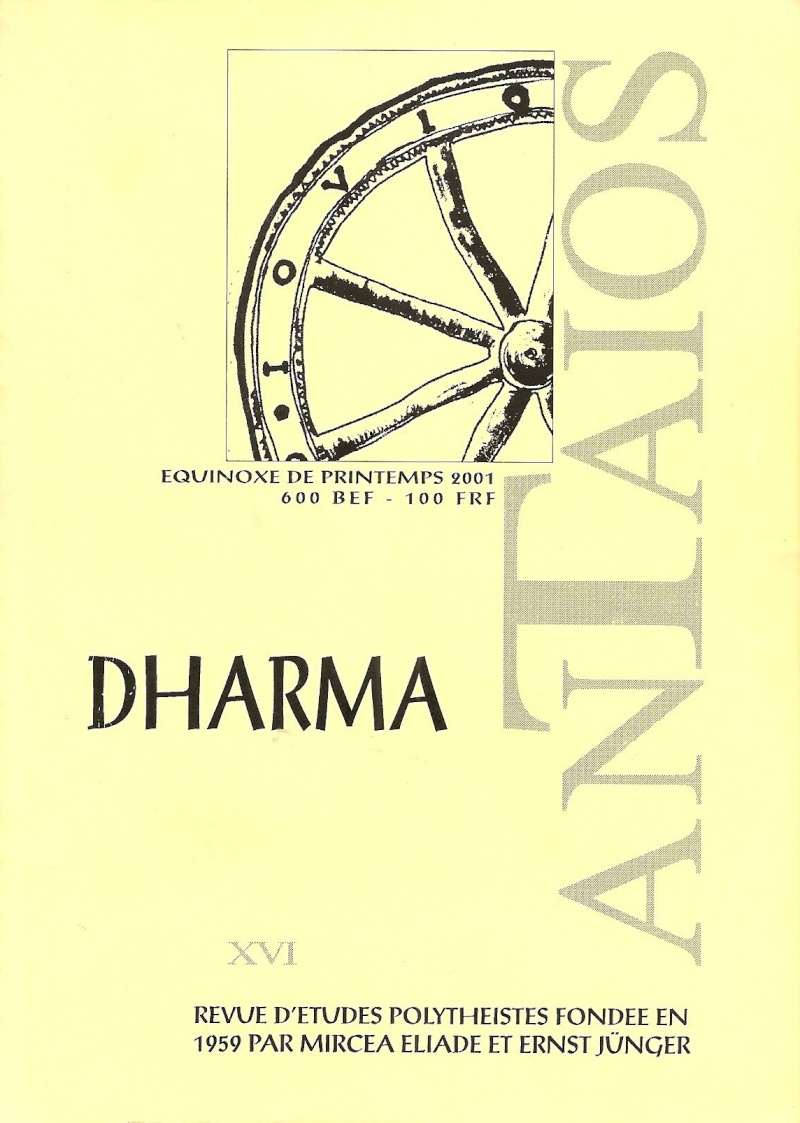 Sanâtana Dharma, Tradition primordiale, Loi éternelle, Sophia perennis. Comme toujours, les termes sanscrits se traduisent par une succession d'approximations qui, chacune, ont leur part de vérité et, chacune, leur part de limites. Ainsi se forme la nébuleuse sémantique éclairant comme un halo le mot sanscrit, lequel finit par perdre son italique et prendre place dans notre index. Sanâtana Dharma : ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que les porte-parole occidentaux contemporains de cette notion si précieuse, puisqu'elle signifie, en dépit des différences exotériques et des oppositions historiques, l'unité transcendante des religions, ou des révélations métaphysiques, ces porte-parole — Guénon, Daniélou, Coomaraswamy, Nasr, pour ne citer que ceux dont je connais les ouvrages — sont allés en chercher la flamme ailleurs que dans la tradition chrétienne, qui est, pourtant, selon toute vraisemblance, la seule tradition régulière vivante d'Occident.
Sanâtana Dharma, Tradition primordiale, Loi éternelle, Sophia perennis. Comme toujours, les termes sanscrits se traduisent par une succession d'approximations qui, chacune, ont leur part de vérité et, chacune, leur part de limites. Ainsi se forme la nébuleuse sémantique éclairant comme un halo le mot sanscrit, lequel finit par perdre son italique et prendre place dans notre index. Sanâtana Dharma : ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que les porte-parole occidentaux contemporains de cette notion si précieuse, puisqu'elle signifie, en dépit des différences exotériques et des oppositions historiques, l'unité transcendante des religions, ou des révélations métaphysiques, ces porte-parole — Guénon, Daniélou, Coomaraswamy, Nasr, pour ne citer que ceux dont je connais les ouvrages — sont allés en chercher la flamme ailleurs que dans la tradition chrétienne, qui est, pourtant, selon toute vraisemblance, la seule tradition régulière vivante d'Occident.
En effet, si l'on excepte, peut-être (1), quelques Loges maçonniques et quelques cayennes de Compagnons, le Christianisme, apparaît hélas comme le seul cadre traditionnel sur lequel les Occidentaux devraient pouvoir s'appuyer pour accéder à la science sacrée. Les événements attribués à l'enfance de Jésus sont si proches de ceux de Krishna ou de Pythagore, ses miracles et certains rites autour du vin si semblables à ceux de Dionysos que la régularité chrétienne ne fait aucun doute. Il s'agit bien d'une expression particulière, d'une descente du Sanâtana Dharma : les Hindous ne s'y trompent pas, qui considèrent volontiers le Christ comme un avatâra de Vishnou.
Hélas, cependant, pour notre point de vue ; car la difficulté principale que pose le Christianisme pour qui cherche à accéder au Sanâtana Dharma, c'est qu'en éliminant les autres formes de culte sur les territoires où il s'est répandu, il semble qu'il ait éliminé radicalement aussi son propre ésotérisme. Après des siècles de persécution des “hérétiques”, de torture pour les alchimistes, de bûcher pour les “sorciers”, il semble ne rester aujourd'hui de l'Église catholique qu'une enveloppe séculière, diffusant le sentimentalisme, le puritanisme et le plat socio-démocratisme (2) que nous lui connaissons.
Cela ne signifie pas que toute voie vers la sapience soit définitivement fermée du côté chrétien, en particulier, peut-être, grâce à l'Église orthodoxe. Mais la violence du christianisme contre le libre exercice de l'intelligence, son exigence absurde d'interpréter les textes “à la lettre”, la fatuité de ses porte-parole s'autoproclamant les représentants de la seule vraie religion ont pour conséquence de rejeter d'abord nos contemporains vers l'antichristianisme, l'athéisme, et l’action politique ou humanitaire, et c'est ce qui explique que les 4 auteurs que j'ai cités tout à l'heure soient allés chercher, ou aient trouvé ailleurs, le dépôt millénaire du Sanâtana Dharma.
Arrivé à un certain point de compréhension, écrit Guénon à plusieurs reprises, la coquille extérieure grâce à laquelle la recherche ésotérique peut continuer importe peu, à partir du moment où elle est régulière — c'est-à-dire à partir du moment où ses liens organiques avec le Sanâtana Dharma sont assurés. Cette question de la régularité de la coquille ou, pour dire autrement les choses, de l'intégration dans une chaîne ininterrompue du savoir traditionnel, fait l'unanimité des auteurs dont je vais parler.
On se demandera donc pourquoi 4 auteurs majeurs, venus d'horizons très divers mais dont l'indépendance et la probité intellectuelle ne font aucun doute, insistent sur cette régularité du cadre pour l'accès aux plus hautes connaissances de la science sacrée. Quelles perspectives dégagent les œuvres de ces auteurs qui ont décidé de s'adresser à nous, Occidentaux d'aujourd'hui ? Y a-t-il des voies possibles pour l'accès, sous nos “climats”, à l'intégralité du Sanâtana Dharma ? Des obstacles ou des dérives contre lesquels il faut se prémunir ?
Seyyed Hossein Nasr et Ananda Coomaraswamy
Avec La Connaissance et le sacré, de Sayyed Hossein Nasr (3), c'est un outil capital pour la recherche du Sanâtana Dharma que viennent de publier les éditions de L'Âge d'homme. Avec une aisance stupéfiante, l’auteur, un Soufi Iranien vivant actuellement aux États-Unis, relie des traits fondamentaux de l'Hindouisme, de l'Islam, du Bouddhisme, du Christianisme, du Taoïsme et du Mazdéisme. Il n'oublie ni l'Égypte, ni la Grèce, ni Rome, et c'est dans un clarté extrêmement réconfortante que l'on avance, à mille lieues d'un vague syncrétisme ou d'obscurités pseudo-mystiques. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'événement spirituel dans l'apparition de ce texte, car, à aucun moment, l’auteur, qui est un musulman, n'établit de hiérarchie entre les différentes voies traditionnelles sur lesquelles il s'appuie sans cesse. On n'imagine pas un Chrétien se défaire ainsi de son intolérance et de son mépris, ou de son apitoiement pour les autres religions (4). Nasr dit même que la tolérance est, certes, préférable au fanatisme, mais que le mot de “tolérance” implique un sentiment de supériorité vis-à-vis de celui dont on “tolère” les errements et les erreurs ; ce n'est pas ainsi qu'il envisage « l’unité transcendante des religions ». L'auteur dit aussi que, le crépuscule moderniste étant venu d'Occident, il fallait qu'à un point terminal du cycle le retour de la lumière traditionnelle éclatât en Occident même. C'est ainsi qu'il signale une floraison étonnante de textes traditionnels fondamentaux, publiés à l'Ouest depuis le début du XXe siècle, et qui trouvent peu à peu leur public. La Connaissance et le sacré, qui fut originellement écrit pour les Gifford Lectures de l'Université d'Edimbourg, est si condensé que des dizaines de pages ne parviendraient pas à le commenter convenablement. Dans une courte préface, l'auteur nous dit que son livre « n'a d'autre objectif que de favoriser une resacralisation de la connaissance et le renouveau de l'authentique tradition intellectuelle de l'Occident, avec l'aide des traditions encore vivantes de l'Orient où la connaissance n'a jamais été séparée du sacré » (5). Je me contenterai donc ici d'indiquer le contenu de chaque chapitre, en mentionnant les éléments qui peuvent éclairer directement notre recherche du Sanâtana Dharma.
Le premier chapitre, intitulé : « la connaissance désacralisée », présente les premiers gnostiques chrétiens : Clément d'Alexandrie, Origène, Denys l'Aréopagyte, puis Scot Erigène, qui considérait « le livre de la nature comme une voie d'accès privilégiée à la connaissance sacrée » (6). Suivent Maître Eckhart, Nicolas de Cues, les notions de la Docte Ignorance et de la coincidentia oppositorum, Jacob Boehme, Henry More, Silésius, et nous discernons des chemins secrets : « En dépit de la pression croissante du rationalisme et de l’empirisme, la doctrine sapientielle exposée par Boehme et Silésius se perpétua en marge de la vie intellectuelle européenne, tandis que le devant de la scène appartenait de plus en plus exclusivement à ceux qui se flattaient d'être éclairés par les Lumières tout en déniant à l'esprit humain toute possibilité d’illumination par l’Intellect intérieur » (7). La recherche de la science sacrée par les illuministes du XVIIIe siècle, cherchant à combattre l'influence étouffante du rationalisme des “Lumières”, s'incarne principalement, nous dit Nasr, chez Novalis, puis chez Swedenborg, dont on sait l'importance pour Baudelaire.
Clarté torrentielle dans l'analyse des causes de la désacralisation de la connaissance en Occident. Pour l’auteur, ce que la Renaissance devait appeler le “miracle grec” constitue à bien des égards un « miracle à rebours » : après Platon, nous dit-il, qui avait déjà mis en garde contre « la désacralisation du cosmos dans la religion des dieux de l’Olympe, (...) la tradition grecque, au lieu de donner naissance à une variété de perspectives intellectuelles sur le modèle des darshanas de l'hindouisme, favorisa l'apparition des sophistes, de l'épicurisme, du pyrrhonisme, de la nouvelle Académie et de nombre d'autres écoles d'inspiration rationaliste et sceptique qui éclipsèrent presque totalement la fonction sacramentelle de la connaissance » (8).
Dans le camp rationaliste, Nasr analyse principalement Averroès, Descartes et sa réduction de l'être à l'ego, puis le « grossier positivisme » d'Auguste Comte : « Le point de vue profane ne pouvait observer qu'un monde profane, dans lequel le sacré n'avait aucun rôle à jouer. La quête de l'homme typiquement moderne consiste en fait depuis lors à “tuer les dieux” partout où il peut les trouver et à bannir le sacré d'un monde qu'on s'empresse de confectionner sur un nouveau patron en tissant les fils de la mentalité sécularisée » (9).
Le chapitre II, « Qu'est-ce que la tradition ? », consacre une longue analyse au Sanâtana Dharma à laquelle on ne peut que renvoyer le lecteur : « Pour le grand nombre de ceux qui ont, ces dernières décennies, entendu l'appel de la tradition, la signification de cette notion est avant tout associée à la sagesse pérenne qui réside au cœur de toute religion et qui n'est autre que la Sophia dont la possession n'a cessé d'être considérée comme le couronnement ultime de la vie humaine par la perspective sapientielle de l'Occident autant que de l'Orient » (10).
Le chapitre III est consacré à « la redécouverte du sacré » et au « renouveau de la tradition ». Les noms de William Blake, Kathleen Raine, Emerson précèdent ceux de Guénon, Coomaraswamy, Frithjof Schuon : « Le point de vue traditionnel présenté avec tant de rigueur, de profondeur et de grandeur par Guénon, Coomaraswamy et Schuon s'est trouvé singulièrement négligé dans les milieux universitaires et sa diffusion sur le plan “horizontal” et quantitatif fut limitée. Son impact profond et qualitatif a cependant été incommensurable. Vérité totale, il a pénétré le cœur et l'esprit de quelques uns au point de transformer la totalité de leur existence » (11). La variété des domaines analysés est très stimulante : toujours dans ce chapitre III, l’auteur traite du regain d'intérêt pour les mythes, de la manifestation inattendue de la quête du sacré dans certains secteurs de la science moderne, de la mécanique quantique et de l'écologie, des travaux de Mircea Eliade, Gilbert Durand, Fernand Brunner, etc.
Le chapitre IV est intitulé « Scientia Sacra ». On y aborde des notions comme l'intuition intellectuelle, les différences entre l'être, l'étant, l'essence et l'existence ; la nature hiérarchique de la réalité ; nécessité et possibilité ; la divine Mâyâ, le Voile ; rayonnement et réverbération ; la notion de Mal comme privation d'un Bien ; le libre arbitre ; l'Intelligence comme don divin ; l'intellection et la raison ; révélation et initiation ; intelligence du cœur et intelligence du mental ; l'œil du cœur...
Le chapitre V est consacré à « L'homme pontife et Prométhée » (12). Il contient une brillante démolition de la théorie de l'évolution, non pas de l'évolution interne des espèces, qui est une évidence, mais du concept de transformisme d'une espèce dans l'autre, indissociable de la notion de progrès si chère aux politiciens, aux médias, à Teilhard de Chardin et aux gourous de sectes en tout genre. On peut noter, j'y reviendrai peut-être à une autre occasion, que beaucoup d'arguments avancés par Nasr se sont trouvés confortés récemment par le dérangeant professeur de biologie d'Harvard, Stephen J. Gould (13).
On s'abreuve aux pages de La Connaissance et le sacré, dont on ne finirait pas de disserter et dont chaque paragraphe fourmille d'indications pour la recherche du Sanâtana Dharma. Je mentionne simplement, pour finir, ses grandes divisions : le chapitre VI est intitulé : « Le cosmos comme théophanie » ; le chapitre VII : « L'éternité et l'ordre temporel » ; le chapitre VIII : « L'art traditionnel, fontaine de connaissance et de grâce » ; le chapitre IX : « Connaissance principielle et multiplicité des formes sacrées » ; et le chapitre X : « La connaissance du sacré comme délivrance ». L'auteur de La Connaissance et le sacré donne d'importantes indications bibliographiques qui devraient engager des éditeurs à commander des traductions ; il signale l'existence d'autres penseurs traditionnels en Occident. Il ne cite de Daniélou que l'Introduction to the Study of Musical Scales de 1943 et paraît ignorer ses autres publications. Mais son érudition est si vaste et si profonde qu'on s'étonne déjà de son étendue (14). Dans une courte notice, l'éditeur nous apprend que Sayyed Hossein Nasr a enseigné la philosophie à l'université de Téhéran de 1958 à 1979 et qu'il est actuellement professeur d'études islamiques à la George Washington University. Pierre-Marie Sigaud, le directeur de la collection, ajoute que Nasr a eu à maintes reprises l'occasion de donner des cours et des conférences en France. On ne peut que souhaiter que cette perspective se renouvelle et que de nouveaux ouvrages soient traduits.
C'est une véritable joie, aussi, que de lire un autre ouvrage de cette même collection Delphica, La Transformation de la nature en art, d'Ananda K. Coomaraswamy, un auteur que Daniélou, Guénon et Nasr évoquent et citent souvent :
« Coomaraswamy était profondément réceptif aux formes esthétiques et connut en fait l'appel de la tradition alors qu'il travaillait comme géologue dans les collines de Sri Lanka et de l'Inde où il fut le témoin de la rapide destruction de la civilisation et de l'art traditionnels de sa patrie. Coomaraswamy fut aussi un érudit méticuleux et soucieux des détails alors que Guénon fut essentiellement un métaphysicien et un mathématicien soucieux des principes. Les 2 hommes étaient complémentaires jusque dans leurs traits personnels et dans leurs styles littéraires, et pourtant en parfait accord quant à la validité de la perspective traditionnelle et des principes métaphysiques qui sont au cœur de tous les enseignements traditionnels » (15).
Avec Coomaraswamy, dont l'érudition, une érudition vibrante, est également impressionnante, l'approche du Sanâtana Dharma se fait plutôt par la proximité de l'art traditionnel. Dans un substantif chapitre consacré à Maître Eckhart, Coomaraswamy déclare que le métaphysicien allemand du XIIIe siècle présente « un parallélisme étonnant avec les modes de pensée indiens ; certains passages entiers et certaines phrases isolées se lisent comme une traduction directe du sanskrit (…). Bien entendu, nous ne suggérons pas que des éléments indiens quelconques soient effectivement présents dans les écrits de Maître Eckhart, bien que l'on trouve certains éléments orientaux dans la tradition européenne, dérivés de sources néoplatoniciennes et arabes. Ce qui est prouvé par les analogies que nous établissons n'est pas l'influence d'un système de pensée sur un autre, mais la cohérence de la tradition métaphysique dans le monde à toutes les époques » (16).
Les études de Coomaraswamy comportent des analyses capitales à propos de l'inspiration artistique, de la place comparée des ouvriers et des artistes dans la vie moderne et dans la tradition. Elles font comprendre en quoi les sociétés traditionnelles, que la propagande moderne présente invariablement comme sclérosées, offraient une véritable promotion intellectuelle et spirituelle par et dans le travail, qui n'était jamais séparé des principes métaphysiques, et constituait naturellement l'une des voies d'accès au Sanâtana Dharma :
« Notre système de pensée moderne a substitué une division du travail à un système de castes spirituelles qui divise les hommes en espèces. Ceux qui ont le plus perdu au change sont les artistes, professionnellement parlant, d'un côté, et les ouvriers en général de l'autre. L'artiste (dans le sens où on l'appellerait maintenant) y perd par son isolement et son orgueil, et par l'émasculation de son art, dont la signification et la motivation ne sont plus intellectuelles, mais seulement émotionnelles. L'ouvrier, à qui l'on dénie maintenant le nom d'artiste (artifex), y perd dans le fait qu'on ne lui passe plus commande et qu'au contraire, on le force à travailler de façon inintelligente, les biens étant évalués au-dessus des hommes. Tous ont doublement perdu du fait que l'art est maintenant un luxe, et qu'il n'est plus le type normal de toute activité, tous les hommes étant contraints de vivre dans la saleté et le désordre » (17).
Les comparaisons entre la société traditionnelle et la société moderne sont souvent très éclairantes, et permettent de comprendre ce que l'on ressent confusément encore aujourd'hui lorsqu'on arrive à se trouver en contact avec ce qui reste des civilisations traditionnelles :
« On a dit avec raison que la civilisation était le style. Dans ce sens, une culture immanente dote chaque individu d'une grâce extérieure, d'une perfection typologique telle que seuls de rares êtres peuvent atteindre par leurs propres efforts un type de perfection qui n'appartient pas au génie. Au contraire, une démocratie, qui oblige à sauver “la face” autant qu'à sauver son âme, condamne en fait chacun à exhiber ses propres irrégularités et imperfections ; et cette acceptation implicite de son imperfection formelle mène bien trop facilement à un exhibitionnisme qui fait de la vanité une vertu, ce que l'on décrit avec complaisance comme une affirmation de soi » (18).
Pour Coomaraswamy, c'est la vie traditionnelle dans son ensemble qui est une œuvre d'art :
« Cette conformité extérieure, où l'homme se perd dans la foule aussi facilement que l'architecture s'intègre à son paysage natal, constitue pour l'oriental lui-même une intimité à l'intérieur de laquelle le caractère individuel peut fleurir sans embarras. C'est d'autant plus vrai dans le cas des femmes qui, en Orient, ont été longtemps protégées des nécessités d'affirmer leur personnalité. On peut dire que pour les femmes des classes aristocratiques en Inde et au Japon, il n'a existé aucune liberté au sens moderne. Pourtant, modelées par des siècles de style de vie, elles ont réalisé une absolue perfection dans leur genre. Peut-être même l'art asiatique ne peut-il montrer aucune réalisation aussi élevée. En Inde, où la “tyrannie de caste” gouverne strictement le mariage, le régime alimentaire et chaque détail de la conduite extérieure, il existe, et il a toujours existé, une liberté sans restriction quant aux modes de croyance ou de pensée (...). Il est parfaitement normal pour les différents membres d'une même famille de choisir eux-mêmes la divinité particulière de leur dévotion personnelle » (19).
Ces considérations, qui soulignent ce que le mode de vie moderne a supprimé en Occident, contribuent à mieux faire comprendre les valeurs que l'Orient, en dépit des attaques qu'il a subies et qu'il continue à subir, réussit malgré tout à conserver. Les valeurs qu'il peut transmettre aux “chercheurs de vérité” ont été également brillamment exposées par 2 auteurs français dont les points de vue se complètent et se différencient subtilement, René Guénon et Alain Daniélou.
René Guénon et Alain Daniélou
A. Daniélou a témoigné plusieurs fois (20) de l'importance qu'avait représentée pour lui la lecture de l'Introduction générale aux doctrines hindoues de Guénon. Il en traduisit des passages en hindi dans les années 40, car les milieux traditionnels dans lesquels il avait été accueilli à Bénarès étaient intéressés par la façon dont Guénon présentait le Sanâtana Dharma et la « crise du monde moderne ». Dans le Dossier H consacré à Guénon, Daniélou aborde la question de l'accès à l'intégralité du Sanâtana Dharma, à propos du Védisme. Le Védisme, précise Daniélou, est « censé représenter la tradition primordiale d'un point de vue, disons, officiel. Mais, du point de vue ésotérique, il apparaît comme une religion qui en est devenue, à un certain moment, le véhicule » (21). Daniélou s'étonne que Guénon n'ait pas eu accès au Shivaïsme, car les plus hauts degrés de l'initiation ésotérique, transmis « presque exclusivement par les Sannyasis, sont shivaïtes. Ils sont en dehors du Brahmanisme, comme d'ailleurs de toute religion, et représentent en fait ce que Guénon appelle la Tradition primordiale » (22). Mais Daniélou considère que l'Introduction aux doctrines hindoues est le premier ouvrage à avoir tracé un tableau authentique du Sanâtana Dharma, « cette conception d'une révélation première transmise à travers les âges par des initiés, telle qu'elle apparaît dans l'hindouisme mais dont les traces doivent inévitablement se retrouver, sous une forme plus ou moins cachée, dans toutes les civilisations puisqu'elles sont la raison d'être de l'homme » (23). Comme souvent avec Daniélou, tout est dit en très peu de lignes ; notamment le fait que cette révélation première affleure dans toute société humaine, mais que sa signification intégrale n'est transmise que par des voies initiatiques, lesquelles ne sont pas faciles d'accès, ne sont pas destinées à tout le monde et, pour commencer, ne sont pas présentes partout. Afin d'éviter autant que se peut toute méprise, Daniélou reprend, dans le même texte, la question de l'origine transcendante, supra-humaine dirait Guénon, du Sanâtana Dharma :
« La première révélation de ce que l'homme doit connaître des lois qui régissent l'Univers et des destinées des êtres vivants a été donnée à des Rishis (Voyants), des sages des premiers âges. Leur enseignement a été ensuite transmis par des initiés, des hommes jugés dignes d'assurer la continuité de cette fonction essentielle, à travers toutes les mutations, les alternances de décadence et de progrès, les changements de religion, de langue, de société. Ceci n'exclut pas que des révélations ultérieures viennent parfois rafraîchir la mémoire des représentants de la Tradition » (24).
Sur ces questions, alors que, sur d'autres points, Daniélou émet des réserves sur telle ou telle attitude, ou sur tel écrit de Guénon (25), l'accord entre les 2 auteurs est total, comme en témoigne cet extrait d'une lettre de R. Guénon à A. Daniélou, en date du 27 août 1947 :
« Je ne puis laisser dire que je suis “converti à l'Islam” car cette façon de présenter les choses est complètement fausse ; quiconque a conscience de l'unité essentielle des traditions est par là même inconvertissable à quoi que ce soit, et il est même le seul qui le soit ; mais on peut “s'installer”, s'il est permis de s’exprimer ainsi, dans telle ou telle tradition suivant les circonstances, et surtout pour des raisons d'ordre initiatique. J'ajoute à ce propos que mes liens avec les organisations ésotériques islamiques ne sont pas quelque chose de plus ou moins récent comme certains semblent le croire ; en fait ils datent de bien près de 40 ans... » (26).
Accord total, aussi, sur ce que Guénon nomme, dans Le Règne de la Quantité, la pseudo-initiation et la contre-initiation. Daniélou écrit, toujours dans ce témoignage du Dossier H : « Guénon, qui avait pris contact avec les diverses organisations initiatiques, les Rose-Croix, les Francs-maçons, les Théosophes, etc., en avait aussitôt avec justesse décelé les artifices. Certains de ces ouvrages, tels que Le Théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, et L'Erreur spirite en sont une condamnation très bien documentée » (27). Daniélou ne cite pas Le Règne de la Quantité (28) qui me semble, personnellement, un ouvrage de tout premier plan pour la quête du Sanâtana Dharma, du moins pour nous aujourd'hui, en Europe, qui cherchons à travers les livres et n'avons pas bénéficié d'un enseignement régulier dans une instance traditionnelle, comme ce fut le cas pour les 2 auteurs dont nous parlons. Le Règne de la Quantité consacre plusieurs chapitres aux organisations syncrétiques et aux sectes, permettant de mieux identifier les culs-de-sac et les pièges de l'entreprise anti-traditionnelle multiforme qui marque la dernière période du Kali Yuga.
Un vrai trousseau de clefs (29) pour aujourd'hui que Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, d'autant plus stupéfiant qu'il fut publié pur la première fois en 1946. Je me contenterai d'une brève citation, en rapport avec ce que disait Coomaraswamy tout à l'heure des chemins où se sont perdus tant d'artistes et de “poètes maudits”, ces martyrs météoriques de la modernité :
« Certains recherchent avant tout de prétendus “pouvoirs”, c'est à dire, en somme, sous une forme ou une autre, la production de phénomènes plus ou moins extraordinaires (..). Bien entendu, il ne s'agit aucunement ici de nier la réalité des “phénomènes” (..) ils ne sont même que trop réels, pourrions-nous dire, et ils n'en sont que plus dangereux (..). En général, l’être qui s'attache à ces choses devient ensuite incapable de s'en affranchir et d'aller au-delà, et il est irrémédiablement dévié (...). Il peut y avoir là une sorte de développement “à rebours” qui (...) éloigne toujours davantage de la réalisation spirituelle jusqu'à ce que l'être soit définitivement égaré dans ces prolongements inférieurs (…) par lesquels il ne peut qu'entrer en contact avec “l'infra-humain” » (30).
Il y a ainsi dans Le Règne de la Quantité des mises en garde nombreuses et détaillées contre l'action des organisations pseudo-traditionnelles, qui d'ailleurs se haïssent entre elles avec une virulence que Guénon compare aux haines qu'on observe entre des chapelles politiques rivales. J'emploie d'ailleurs à dessein l'expression “chapelle politique”, parce qu'à mes yeux, j'y reviendrai dans un instant, la politique et “l'actualité”, si importantes dans la vie de nos contemporains, me semblent fonctionner comme de véritables substituts du religieux (31). Daniélou, lui aussi, met en garde expressément contre toutes les formes d'enrôlement, particulièrement contre les pièges dans lesquels tombent en Inde les Occidentaux trop crédules, « parfois attirés par des sectes prétendues initiatiques ou enrôlés par des aventuriers pseudo-mystiques, en particulier certains Indiens qui diffusent un Védanta très simplifié et exploitent leur crédulité » (32). Il faut remarquer qu'A. Daniélou a cru nécessaire de revenir sur ces questions à la fin de sa vie, lors de la réédition du Chemin du labyrinthe, comme si les illustrations terrifiantes contenues dans « Le Maître des Loups » et « Le bétail des dieux » (33) ne suffisaient pas à dessiller nos yeux occidentaux, imbus de positivisme et du sentiment de supériorité que décerne si prodigalement l'enseignement massifié de nos Universités. On pourra se reporter en particulier à ce que Daniélou écrit à propos de « Wolfgang », qui « confondit, comme beaucoup, la fumée du haschich (34) et la spiritualité indienne » et se laissa entraîner par un de ces « ascètes hirsutes qui, par des pratiques liées au yoga, acquièrent d'étranges pouvoirs qui vont de la lévitation à l'hypnotisme, en passant par la vision à distance, l'insensibilité à la chaleur et au froid, l'envoûtement, l'asservissement de leurs victimes, etc. J'ai toujours eu très peur de ces êtres étranges dont le regard fulgurant fait aussitôt vaciller votre raison et votre volonté, et dont il vaut mieux s'éloigner sans délai » (35). On peut aussi faire son profit, dans ces ultimes pages d'A. Daniélou, des précisions qu'il apporte au sujet de prétendues activités politiques qu'il aurait eues en Inde, ou de sympathies politiques qui auraient été les siennes en Occident. On ne voit pas très bien pour quelle raison A. Daniélou, qui n'a jamais été effrayé d'assumer son anticonformisme, aurait dissimulé au soir de sa vie des appartenances ou des sympathies, dans une biographie qui est à mille lieues du nombrilisme (36) mais dont la sincérité ne fait aucun doute. Contrairement à Julius Evola, mais proche encore sur ce terrain de Guénon, Daniélou s'est toujours tenu volontairement à l'écart de la politique. Le dernier texte du Chemin du labyrinthe s'intitule symboliquement « le choix du libre arbitre » :
« Dans la société orthodoxe où je vivais (pendant la seconde guerre mondiale, à Bénarès) s'affrontaient subtilement et se mêlaient une orthodoxie védique sympathisant avec les théories aryennes du nazisme et une tradition shivaï'te profondément opposée aux aryens. Swamy Karpâtrî, dont je suivais fidèlement les enseignements, avait créé un mouvement culturel, le Dharma Sangh (association pour la défense des valeurs morales et religieuses) afin d'opérer un retour aux valeurs de la culture et de la société traditionnelle. Il critiquait les idées socialistes représentées par le Congrès national de Gandhi et Nehru mais aussi les réformateurs pseudo-traditionnels comme Aurobindo ou Tagore, qui prétendaient revenir à une tradition idéalisée, mais étaient très imbus d'idées occidentales. Par ailleurs, Karpâtrî était très hostile aux idées du Rashtrya Svayam Sevak Sangh (association pour la défense des valeurs nationales) qui préconisait des méthodes inspirées du fascisme dans la lutte contre le Congrès et les idées modernistes (...). De par mon opposition à la domination anglaise et mon attachement à l'Inde, j'avais des rapports très proches avec les dirigeants du mouvement indépendantiste, avec Nehru et sa famille et aussi avec la célèbre poétesse Sarojini Naïdu, tous membres influents du Congrès (…). À aucun moment et en aucune façon je n'ai voulu me mêler des mouvements politiques, ni d'un côté ni de l'autre » (37).
On ne saurait être plus net, surtout en 1992, à l'ultime page de son autobiographie. Et je voudrais à présent citer presque intégralement la fin de ce « choix du libre arbitre », non par une sorte de culte, que Daniélou eût été le premier à tourner vertement en ridicule, mais parce qu'il serait vain de vouloir rivaliser avec lui dans la concision, la précision du détail, et l'adéquation avec ce thème de la recherche du Sanâtana Dharma que j'ai essayé d'aborder aujourd'hui :
« Je n'ai jamais voulu m'affilier à aucune secte religieuse ou croyance, jamais voulu perdre mon libre arbitre. Mais, frondeur de nature, j'ai toujours tendance à m'opposer à l'idéologie dominante, à contrecarrer ce que les gens prennent pour des vérités établies, à toujours remarquer que l'enfer est pavé de bonnes intentions, à penser que la remise en question de toute affirmation est le seul moyen de faire évoluer la connaissance. La discussion est un élément de recherche et non point d'assertion » (38).
C'est bien dans le domaine des prétendus “débats” politiques que la discussion est vraiment stérile, la règle du jeu consistant à ne pas écouter l'adversaire, à l'empêcher de parler, les moyens les plus malhonnêtes n’étant pas les moins indiqués. Dans notre société, où il semble que la parole soit avant tout un pouvoir qui se nourrit de lui-même, les marionnettes-héros de la télévision rivalisent avec celles de la politique dans une sorte de clôture narcissique sur le vide. Penser la discussion comme un élément de recherche légitime à l'époque où le dogme du politiquement correct la considère comme un indice d'éducation inconvenante, ne peut qu'attirer des représailles de la part des tenants de la langue de bois. Cela n'a pas manqué pour A. Daniélou, à propos de qui on affirme dur comme fer dans les officines indianistes et les parkings de méditation des ashrams qu'il fut au minimum, sinon le fondateur, du moins l'idéologue du RSS qu'il citait tout à l'heure. Mais continuons à lui laisser la parole :
« Le paradoxe, la remise en question des évidences qui semblent les mieux établies est un exercice salutaire, le seul capable défaire avancer les choses et de ne point rester figé sur des dogmes. Ce qui m'a fait souvent attribuer une appartenance à des théories auxquelles je ne souscris en aucune façon. La liberté d'esprit a difficilement sa place dans une société infectée par des conflits et des appartenances idéologiques également arbitraires » (39).
Il me semble que le propos ne peut pas être plus clair au sujet des prétendus engagements politiques d'A. Daniélou. À propos du rôle de gourou qu'il s'est toujours refusé à tenir, il n'est pas indifférent que plus de la moitié du dernier paragraphe du Chemin du labyrinthe, dans un passage qui suit immédiatement celui que nous venons de lire, lui soit consacré :
« Je ne suis pas prophète, d'ailleurs ma barbe se refuse à pousser. Mon âge fait que les gens attendent de moi des directives ou des oracles, ce à quoi je me refuse ; je ne suis pas un guru. Je continue toujours à chercher à comprendre le mystère du monde et, pour cela, je suis prêt, chaque jour, à tout recommencer, à réexaminer mes convictions, à rejeter toute croyance, à m'avancer seulement dans la direction du savoir qui est le contraire de la foi. Ma méfiance reste entière vis-à-vis de tout rite ou cérémonie qui m'apparaît comme du théâtre dès qu'il y a des témoins. Je me refuse à faire une puja pour des dévots toujours fanatiques (nous dirions aujourd'hui des “fans”) » (40).
On a trop peu souvent l'occasion de saluer la probité intellectuelle pour ne pas être heureux que, dans des temps comme les nôtres, il reste de ces esprits présentant ce curieux mélange de goût du paradoxe, de liberté, de souveraineté, en même temps que d'une forme d'humilité devant la connaissance, et de distance un peu moqueuse vis-à-vis de ce qui occupe tant d'occidentaux depuis Descartes : leur propre ego. Mais il ne faut pas croire que cette légèreté de bonne compagnie ait été synonyme de superficialité ou de scepticisme. Daniélou nous le rappelle dans la péroraison de son texte que je vais à présent citer jusqu'à la fin, lui laissant d'une certaine façon le dernier mot avant de conclure :
« La seule valeur que je ne remets jamais en question est celle des enseignements que j’ai reçus de l'hindouisme shivaïte qui refuse tout dogmatisme, car je n'ai trouvé aucune forme de pensée qui soit allée aussi loin, aussi clairement, avec une telle profondeur et une telle intelligence, dans la compréhension du divin et des structures du monde. Aucune forme de pensée n'approche de près ou de loin cette merveilleuse recherche qui nous vient du fond des âges. Aucune des idéologies, aucune des théories qui divisent le monde moderne ne me semble mériter que je m'y associe, que j'en prenne la défense. Elles me paraissent puériles, quand elles ne sont pas simplement aberrantes » (41).
Conclusion
Le chemin pour retrouver une sagesse oubliée n'est pas toujours facile à suivre, mais il est à présent bien tracé.
« Dans le monde moderne où les voies de la transmission normale de la connaissance ésotérique sont fermées pour la plupart, les livres jouent un rôle très différent de celui qu'ils jouaient dans des circonstances normales, de sorte que certains enseignements jusque là préservés sous forme orale se mirent à circuler sous forme écrite, constituant ainsi véhicules d'enseignement et de guidance pour ceux qui se trouvent privés de tous les autres moyens. Cette manifestation compense la disparition des voies traditionnelles de transmission de la connaissance, au moins dans son aspect théorique, sans que cela implique que cette situation elle-même puisse entraîner la manifestation de l'intégralité de la connaissance traditionnelle dans les livres sous une forme facilement accessible à tous » (42).
Pour l'approche intellectuelle de cette sagesse, les langues occidentales, requalifiées métaphysiquement, en quelque sorte, par tous ces auteurs extrêmement attentifs à la précision du vocabulaire, disposent à présent d'un grand nombre de textes fondamentaux, aisément accessibles. S'agissant du désir de “pratiques”, en revanche, on peut noter les mises en garde répétées de tous ces auteurs. On a oublié dans notre monde profane combien toutes les sociétés traditionnelles étaient attentives aux questions de purification, de qualification, aux instants favorables et défavorables, aux précautions pour neutraliser les forces dangereuses, grâce à des “techniques de pointe”, si l'on ose dire, dont l'origine et l'inspiration, analysées comme “primitives” par les ethnologues positivistes (43), sont toujours présentées comme “non-humaines”.
La recherche du savoir est toujours légitime, mais l'utilisation de ce savoir pour jouir d'un pouvoir est un obstacle, une disqualification dans cette sorte de jeu de l'oie qui consiste à retrouver patiemment le chemin du divin. Et quant à l'incorporation effective dans une tradition régulière, ce qui peut être également une aspiration légitime, les auteurs traditionnels sont encore unanimes : la première règle consiste à accepter de devenir ce que l'on est, accepter sa naissance hic et nunc (44), car si l'esprit souffle où il veut, on sait qu'invariablement, du point de vue initiatique, « c'est en réalité la voie qui choisit l'homme et non l'homme qui choisit la voie » (45).
Il semble qu'au fur et à mesure que le monde moderne descend plus bas dans l'inharmonie et l'empoisonnement de la planète, des lumières apparaissent, différentes comme sont différentes les voies. Les auteurs traditionnels du XXe siècle ont en commun des connaissances immenses et des clés pour l'interprétation des grands symboles qui soudain se répondent et correspondent dans une unité éclatante — et non plus ténébreuse comme chez Baudelaire (46). Ils ont en même temps des styles très différents et même des formulations qui pourraient sembler contradictoires : Nasr se réfère au Dieu de l'Islam et du Christianisme, alors que le mot “Dieu” est beaucoup moins prononcé dans l'œuvre de Guénon ; Coomaraswamy traduit “Deva” par “Anges”, alors que Daniélou, qui a consacré un ouvrage entier à la réhabilitation intellectuelle du polythéisme, parle évidemment de Vishnou et de Shiva comme d'autant de Dieux ou d'aspects du divin.
Nous avons donc de quoi lire, relire, débrouiller l'écheveau. La floraison d'ouvrages traditionnels (47), dont l'authenticité ne fait aucun doute et qui s'épanouissent depuis le début du XXe siècle en Occident, compense jusqu'à un certain point l'absence à peu près certaine de voie initiatique dans le Catholicisme, l'absence de cultes maintenus vivants autour des Déesses et des Dieux gréco-romains. Rien ne nous empêche de vénérer les Principes organisateurs de l'harmonie du monde, de bâtir des enclaves d'harmonie, modestes mais incommensurables, d'attendre la lumière au fond de notre cœur.
► Jean-Louis Gabin, Pondichéry, Shivaratri 2001.
♦ Notes :
- 1 René Guénon, Études sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage, Éd. traditionnelles.
- 2 Témoigne d'un degré supplémentaire de la profanation de ses propres symboles par l'Église catholique, la décision édifiante d'ouvrir, en juillet 2000, une seconde Porte de Saint Pierre, en raison de l'affluence des fidèles au Jubilé. Après l'inversion du rituel de la messe, les bénédictions papales à travers la vitre blindée d'un hélicoptère ou à la télévision, il semble que la parodie moderniste ait pris le pas sur tout dans l'instance régulière de la tradition occidentale, et que les aspirations à la transcendance n'aient jamais été aussi difficiles à étancher de toute l'histoire de l'Occident. À quand les ciboires jetables en matière plastique et le livre de messe sur ordinateur ? Sous la houlette d'un chef formé dans les kolkhozes, l'Église catholique aborde le troisième millénaire de son règne comme un vulgaire parti politique sentimentaliste et puritain.
- 3 Je m'aperçois que, par préjugé, je n'aurais certainement jamais ouvert ce livre (pas plus que je n'irais consulter spontanément l'ouvrage d'un Père ou d'un Abbé) si un ami, Polythéiste convaincu, ne me l'avait mis entre les mains : des cheminements inconnus de certaines œuvres.
- 4 Mais on peut espérer un miracle et attendre une publication chrétienne contemporaine qui soit aussi souveraine qu'un texte de Maître Eckhart.
- 5 Seyyed Hossein Nasr, La Connaissance et le sacré, traduit de l'anglais par Patrick Laude, L'Âge d'homme, coll. Delphica, 1999, p. 8. Peut-on regretter que l'éditeur omette de mentionner le titre original de cet ouvrage ? D'autre part, les notes finales sont difficilement maniables compte tenu de l'absence d'en-tête dans tout le livre. Ces carences sont d'autant plus visibles que l'autre livre de la même collection, dont je parle plus loin, La Transformation de la nature en art, d'Ananda K. Coomaraswamy, est totalement exempt de ces défauts
- 6 Id., p. 31. 7 Id., p. 40. 8 Id. p. 44. 9 Id., p. 54. 10 Id., p. 64. 11 Id., p. 98.
- 12 Un chapitre particulièrement riche, de mon point de vue : « Les enseignements traditionnels envisagent le bonheur de l'homme dans la conscience de sa nature de pontifex et dans sa conformité à cette nature de pont entre le Ciel et la terre. Ses lois et ses rites religieux ont une fonction cosmique et il prend par là conscience de l'incapacité qui est la sienne d'échapper à ses responsabilités en tant que créature vivant sur cette terre sans être seulement de cette terre, en tant qu'être suspendu entre le ciel et la terre, formé sur un moule à la fois spirituel et matériel, créé pour refléter la lumière de l'Empyrée divin et préserver l'harmonie dans le monde en prodiguant cette lumière et en mettant en pratique cette forme de vie qui est en accord avec sa réalité intérieure révélée par la tradition » (p. 142) ; « L'homme a accès en lui-même à de multiples niveaux d'existence et à une hiérarchie de facultés et même de “substances” qui ne peuvent en tout cas être réduites aux deux entités du corps et de l'âme ou de l'esprit et du corps, lesquelles reflètent le dualisme dominant dans la pensée occidentale post cartésienne. Ce dualisme méconnaît l'unité essentielle du microcosme humain précisément parce que la dualité implique l'opposition et, par contraste avec la trinité, n'est pas un reflet de l'unité » (p.146) ; « Le corps lui-même est le temple de Dieu » (p. 148) ; « Quant aux parties sexuelles, elles expriment la hiérogénèse, activité divine dont le résultat terrestre est la procréation d'un autre homme ou d'une autre femme qui, d'une façon miraculeuse, n'est pas seulement un être biologique, bien qu'il ait été extérieurement porté au monde par des voies biologiques » (p. 150) ; « L'homme possède de nombreuses facultés internes, une mémoire bien plus étendue que ceux qui sont le produit de l'éducation moderne peuvent l'imaginer et qui joue un rôle très positif dans l'activité intellectuelle et artistique de l'homme traditionnel. Il possède une imagination qui, loin de n'être que simple fantaisie, a le pouvoir de créer des formes correspondant aux réalités cosmiques » (p. 150)
- 13 Stephen J. Gould, L'Éventail du vivant, le mythe du progrès, traduit de l'américain par Christian Jeanmougin, Éditions du Seuil, 1997.
- 14 D'autre part la diffusion des œuvres majeures de Daniélou aux États-Unis est certainement postérieure à ce livre auquel l'auteur commença à travailler à la fin des années 70.
- 15 Seyyed Hossein Nasr, La Connaissance et le sacré, op. cit., p. 95.
- 16 Ananda K. Coomaraswamy, La Transformation de la nature en art, tr. de fr. Jean Poncet et Xavier Mignon, L'Age d'homme, Coll. Delphica, 1994, note p. 74.
- 17 Id., p. 78. 18 Id., p. 50. 19 Id., p. 44.
- 20 A. Daniélou, Le Chemin du labyrinthe, Souvenirs d'Orient et d'Occident, 2e édition, Le Rocher, 1993, p. 157-159.
- 21 A. Daniélou, « René Guénon et la tradition hindoue », in René Guénon, Dossier H René Guénon, L'Âge d'Homme, Lausanne, p. 137.
- 22 Id., ibid. 23 Id., ibid. 24 Id., p. 136.
- 25 A. Daniélou, Le Chemin du labyrinthe, op. cit., p. 157-159.
- 26 A. Daniélou : « René Guénon et la tradition hindoue », op. cit., p. 138. 27 Id., ibid.
- 28 R. Guénon, Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, Gallimard, coll. Traditions, 1997, en particulier les ch. XXXVI, XXXVIII et XXXIX.
- 29 Je ne peux résister à un autre passage : « Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil autour de soi pour constater qu'on s'efforce partout de plus en plus de tout ramener à l'uniformité, qu'il s'agisse des hommes eux-mêmes ou des choses au milieu desquelles ils vivent, et il est évident qu'un tel résultat ne peut être obtenu qu'en supprimant autant que possible toute distinction qualitative. Mais ce qui est encore bien digne de remarque, c'est que, par une étrange illusion, certains prennent volontiers cette “uniformisation” pour une “unification”, alors qu'elle en représente exactement l'inverse en réalité, ce qui peut du reste paraître évident dès lors qu'elle implique une accentuation de plus ne plus marquée de la séparativité. La quantité, insistons-y, ne peut que séparer et non unir », Le Règne de la Quantité, op. cit., p. 51-52.
- 30 Id., p. 233.
- 31 Ce qui, d'ailleurs, souligne le ridicule que l'on peut observer inévitablement lorsque une hiérarchie religieuse se met à singer la “démocratie” politique.
- 32 A. Daniélou, Le Chemin du labyrinthe, op. cit. , p.340.
- 33 A. Daniélou, Le Bétail des dieux et autres contes gangétiques, Le Rocher, 1994.
- 34 Je suis frappé, relisant Daniélou – qui ne peut être suspecté de puritanisme –, de ses mises en garde répétées contre l'usage des drogues, même de celles qui sont devenues extrêmement banales en Occident, comme le haschich. Les drogues, dit Daniélou, sont « des sortes d'anges déchus » qui, lorsqu'on fait appel à eux en dehors de cadres rituels permettant de les contrôler, vampirisent leurs victimes.
- 35 A. Daniélou, Le Chemin du labyrinthe, op. cit., p. 366.
- 36 Jacques Cloarec a dit combien ce n'est qu'à force d'insistance de sa part et de celle de Pierre Bérès qu'A. Daniélou se résolut à rédiger ses mémoires.
- 37 A. Daniélou, Le Chemin du labyrinthe, op. cit. , p. 380. 38 Id., p. 381.
- 39 Id., ibid. 40 Id., ibid. 41 Id., p. 381-382.
- 42 La Connaissance et le sacré, op. cit., note 22, p. 348.
- 43 Jean Servier, L'Homme et l'Invisible, Le Rocher, 1994, p. 253.
- 44 Ce n'est pas un hasard si Daniélou a souhaité réunir ses articles et ses conférences sous le titre de « Cahier du Mleccha » : le Mleccha, c'est le barbare né hors de l'Inde, ce qui ne l'empêche nullement, à condition d'accepter certaines règles, d'accéder aux plus hautes formes du savoir.
- 45 La Connaissance et le sacré, op. cit. , p. 264.
- 46 Dans son célèbre sonnet « Correspondances », Baudelaire exprime une intuition certaine mais blessée en quelque sorte, obscure de l'unité du macrocosme et du microcosme. Il parle de « ténébreuse et profonde unité » et son œuvre entière est baignée dans le soleil du XIXe siècle, couché « dans son sang qui se fige » (Les Fleurs du Mal, « Correspondances », « Harmonie du soir », Garnier Frères, 1959, p. 13 et 52).
- 47 René Guénon, Alain Daniélou, Ananda Coomaraswamy, Seyyed Hossein Nasr, et aussi Fritjhof Schuon, Jean Borella, Titus Burkhardt, Jean Servier, Arthur Avalon... Je serais plus réservé vis-à-vis de l'œuvre de Julius Evola, qui donne la suprématie aux Kshatriyas sur les Brâhmanes, ou de celle de Carlos Castaneda, mêlée de pratiques magiques, dans la lumière crépusculaire des civilisations assassinés du continent américain. À partir de ces auteurs qui se rattachent explicitement au Sanâtana Dharma, il y a des trésors chez Mircéa Eliade, Gilbert Durand, Dumézil, bien d'autres encore.

◘ Docteur ès Lettres, Jean-Louis Gabin a publié une biographie de Gilbert Lely (Gilbert Lely : Biographie, Librairie Séguier, Paris 1991) et s'est chargé de l'édition des Poésies complètes de Lely aux éditions du Mercure de France (3 volumes, 1990-2000). Il a collaboré au Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours (M. Jarrety, éd.) aux PUF (Paris 2001). Dans Antaios, il a déjà publié : « Tantra, poètes maudits et transmission initiatique » (VI/VII, 1995), « La civilisation des différences » (X, 1996), « Le message de l'Hindouisme : Réveiller les Dieux » (XI, 1996), « Chants du Labyrinthe » (XIII, 1998), « Daniélou le Passeur » (XIV, 1999), ...

Au service du Dharma
« Tous nous collaborons à l'achèvement d'une œuvre unique, les uns sciemment et avec conscience, les autres à leur insu » (Marc Aurèle, Pensées, VI, 42)
« Révérez le divin, faites des sacrifices pour tous les Dieux » (Inscription hermétique d'Égypte, époque romaine)
« Si quelqu'un te demande de lui expliquer le Dharma, réponds d'abord : je ne l'ai pas étudié à fond » écrit prudemment Kenneth White dans ses Lettres de Gourgounel, citant un aphorisme indien (1). L'idée de consacrer une livraison d'Antaïos au Dharma ne m'est pas venue lors d'une édifiante lecture de Guénon ou de Schuon, mais un soir à Delhi, où mon hôte, après un sublime chou-fleur au piment, à l'issue d'une passionnante discussion sur la modernité et le réveil païen de l'Europe, me lança, comme pour m'encourager : « les protecteurs du Dharma sont ses protégés ». Venant de ce lettré hindou, l'exhortation prenait tout son poids d'autant qu'il me l'écrivit en sanskrit dans le livre qu'il m'offrait. Surtout elle réveillait en moi le souvenir d'anciennes certitudes refoulées. Dans la touffeur nocturne, emporté par une Ambassador conduite à tombeau ouvert par un adepte de Shiva, je redevenais conscient d'une évidence : depuis toujours, je m'étais senti au service de quelque chose d'indéfinissable, de mystérieux et d'écrasant. Ni morale ni religion, encore moins idéologie, certainement pas révélation, qu'était-ce donc ? Depuis l'école, je le sentais sans l'admettre souverainement, gêné, presque effrayé de paraître plus décalé, plus martien encore : ce monde moderne n'était pas le mien, il me paraissait indigne d'admiration et moi, minuscule rebelle vaguement camouflé, je me savais ailleurs. Mais où ? Mon Brahmane, déchirant gentiment le voile, venait de m'indiquer mon poste : j'étais au service des Dieux, ou mieux, du Dharma. À ma place dans une cohorte très vénérable, celle des soldats de la Tradition. La majuscule me dérange et surtout l'idée d'être amalgamé à ces traditionalistes bornés, catholiques ou musulmans de synthèse aux écrasantes certitudes. Plutôt que de Tradition, parlerai-je d'Ordre ? L'idéologie pointe alors son museau. La Loi ? Trop à la mode. Le Droit ? Vieillot. Va pour Dharma, malgré son aspect faussement exotique. Mais qu'est-ce donc que le Dharma ?
René Guénon, dans un texte publié en 1949, précise que « la notion du sanâtana Dharma est une de celles qui n'ont pas d'équivalent en Occident » et que toute traduction ne peut être qu'insuffisante (2). Le problème réside moins dans le terme sanâtana, que l'on peut rendre par le latin perennis (éternel), que dans Dharma. Sa racine dhri signifie soutenir, ou mieux maintenir. Voilà qui me comble : plutôt que banalement conservateur, je me suis toujours senti mainteneur (le premier verbe ne permettant pas de se définir sérieusement). Une posture, une sensibilité vécue dans les actes les plus triviaux de la vie quotidienne, par ex. traverser la rue, prennent tout leur sens : maintenir. Quoi donc ? L'ordre inviolable du monde, auquel même les Dieux sont soumis. Là, je me retrouve en terre connue : nos Pères à nous Païens, ceux d'avant Socrate, que la tradition nomme Physiciens, avaient concentré leurs méditations sur la nature du Kosmos. « Ce monde, le même pour tous, ni Dieu ni homme ne l'a fait, mais il était toujours, il est et il sera, feu toujours vivant, s'allumant en mesure et s'éteignant en mesure » dit Héraclite d'Éphèse. Ho kallistos, ho kosmos : le plus bel ordre, l'ordre du monde, précise l'Obscur (3). Ordre et désordre liés en un système où le hasard même a sa place, maison commune des Dieux et des mortels où, par le jeu subtil de forces contraires, règne l'équilibre. Écoutons le lumineux M. Conche : « le monde, système ordonné sans origine, n'est pas l'œuvre d'une intelligence ordonnatrice, planificatrice ; il est indépendant des dieux et de leur providence, et les précède » (4). Ce monde-feu, un, toujours vivant, incréé, soumis aux cycles de la divine alternance, voilà notre bonne nouvelle : « le secret de la présence éternelle de l'Être à Lui-même, et donc, contrairement à ce que prétend la thèse créationniste, l'homogénéité essentielle du divin, de l'humain et du mondain », comme l'écrit justement J. P Lippi qui retrouve l'intuition des Présocratiques (5).
De son côté Frithjof Schuon en 1966, dans un numéro d'Antaios, première du nom (1959-1971), celle qui nous inspire, définit ce qu'il appelle Religio perennis (6). Grand connaisseur du soufisme et du chamanisme amérindien, F. Schuon parle de religio en tant que lien entre le ciel et la terre, « discernement entre le réel et l'illusoire, concentration permanente et unitive du réel ». J'avoue que ses digressions dogmatiques sur les hétérodoxies, nécessairement frelatées, ne me convainquent guère, que l'étrange absence des Présocratiques m'étonne. Mais Schuon rappelle à propos que toute civilisation « intégrale et saine » doit se fonder sur le Dharma. Tout ceci se trouve déjà chez les Grecs, s'est transmis de l'Ionie archaïque à Byzance et puis à Florence — salut aux mânes de Gémiste Pléthon et de Marsile Ficin ! —, de l'Égypte à la Perse en un ballet tournoyant de correspondances mystérieuses.
De citer Guénon et Schuon ne fait pas de moi un “traditionaliste”, malgré le respect dû à leur travail de dévoilement. Non, leur Tradition primordiale, je l'avoue, me paraît muséifiée, singulièrement dénuée de vie, oublieuse des métamorphoses subies de toute éternité par le Dharma, ignorante des relais néoplatoniciens ou pythagoriciens. Et trop complaisante face à la prétention des religions abrahamiques à posséder le monopole de la vérité, la voie unique d'accès au Sacré. Cet exclusivisme et cette intolérance ne sont guère cosmiques. Les religions du Livre tendent en effet à refouler, à nier tout l'héritage qu'elles ont capté et souvent dénaturé : Dieu est un mot païen, celui que les Indo-Européens utilisaient pour désigner le ciel lumineux (*deywos) ; Allah est le nom d'une grande divinité dispensatrice de pluie d'avant l'Islam et l'Ancien Testament, malgré les épurations textuelles, demeure plein de traces de Polythéisme. Le fondateur en France des recherches sur l'imaginaire, Gilbert Durand, rappelle que Henry Corbin, spécialiste du Monothéisme quasi parfait qu'est l'Islam, admettait « que le monde imaginal est le lieu de la renaissance des Dieux ». Il citait C.G. Jung, rencontré aux rencontres du cercle Éranos : « il est essentiel à la Théotès (deitas abscondita) de se révéler et se manifester par la pluralité de ses théophanies, en formes théophaniques illimitées » (7).
Cette évidence a été niée pendant des siècles par les tenants d'idéologies monolâtriques, intolérantes et répressives. Chrétiens et Musulmans ont voulu rompre avec les cultes antérieurs qualifiés de démoniaques : les premiers ont assassiné Hypathie, sage du Ve siècle qui dispensait un enseignement traditionnel, celui, précisément de la Traditio perennis. Les seconds ont incendié la bibliothèque d'Alexandrie, exterminé par milliers les Brahmanes, détenteurs d'un savoir authentiquement traditionnel. Les uns et les autres ont volontairement brisé le fil d'une tradition vivante pour commettre un crime inexpiable : la confiscation spirituelle, vol à main armée perpétré contre des populations converties par la ruse ou la force, à qui furent cachées les racines immémoriales de leur religion. Combien de Chrétiens sincères n'ignorent-ils pas que le cœur de leur foi provient d'un fond qui n'a rien d'évangélique, et qui doit tout aux religiosités cosmiques ? Le culte des sources et des saints, la Kaaba, la dévotion à la Mère de Dieu sont pur Paganisme, un Paganisme volé, maquillé et appauvri. Parler d'unité des religions, de sanctification du Paganisme par ses assassins relève de l'ignorance ou de l'autosuggestion. Plus grave : ces 2 idéologies, la chrétienne et l'islamique, prônent la conversion des infidèles et la pratiquent journellement. Les populations polythéistes du Pakistan sont harcelées par les Musulmans, qui, tout près, dynamitent les statues bouddhistes. En Inde, les églises chrétiennes dépensent des sommes astronomiques pour convertir les Hindous et saper le socle des traditions ancestrales. Les Chrétiens indiens sont aujourd'hui les alliés des Musulmans et des marxistes contre les tenants du sanâtana Dharma. Lire les témoignages de défenseurs contemporains de l'Hindouisme comme Ram Swarup ou Rishi Kumar Mishra nous donne un éclairage original, celui d'indigènes fidèles aux traditions de leurs pères — exactement comme nos ancêtres païens face aux missionnaires chrétiens — et permet de nuancer fortement les thèses d'un Guénon et d'un Schuon sur l'unité transcendantale des religions (du Livre ?), limitée aux aspects strictement ésotériques. Or, l'agression menée en Inde contre la Tradition éternelle — sanâtana Dharma — n'est le fait ni de soufis ni de mystiques, mais bien de stratèges et d'idéologues à la langue fourchue. Qu'en disent les traditionalistes chrétiens ? Soutiennent-ils les menées impies des missionnaires ? Acceptent-ils le principe de la conversion, c'est-à-dire l'abandon par un peuple des traditions religieuses de ses ancêtres au profit d'une voie jugée la seule bonne en tous lieux et en tous temps ? Telle est en tout cas pour un Païen conséquent la pierre d'achoppement dans son dialogue avec des traditionalistes. Minimiser ce problème, qui est tout sauf théorique, le nier serait une infamie commise à l'encontre de ceux qui, aux Indes, résistent de plus en plus victorieusement, Dieux merci.
Mais revenons à l'essentiel : le Dharma, la Norme universelle, don des Puissances que nous appelons parfois les Dieux, conscients toutefois que les noms donnés, Zeus, Sarasvati, Perkunas ne sont jamais que des voies d'accès au divin, to theion ou ta daimonia, formes du neutre, singulier ou pluriel. Au-delà des Dieux, nul paradis, nul enfer, nul sauveur, mais la toute-puissante Moïra, qui s'incarna, dit-on, en 3 sœurs, Atropos, Clotho et Lachésis, filles de Zeus et de Thémis, voire de la Nuit. Face aux Dieux, Puissances du Oui, symboles de plénitude et de vie, se dressent ces images nocturnes du terme, Puissances du Non et de la mort qui filent le destin du nouveau-né. Même Zeus leur est soumis puisqu'il fait corps avec le Kosmos, l'Ordre fatal, le Dharma. Violer la norme, qui n'est autre que le Sacré, susciterait un impensable cataclysme.
Tout ce que les Grecs avaient su, mais aussi les Scandinaves avec leur figure d'Yggdrasill, l'Arbre du Monde qui ne peut s'effondrer sans entraîner les mortels et les Puissances, tout m'était rappelé ce soir-là par un Brahmane souriant qui, en une phrase, m'adressait un signe : le réel est juste, ce qui est doit être. Amor fati. Voilà bien le cœur du Paganisme, religion de la vérité.
À la question “qu'est-ce qu'être Païen aujourd'hui ?”, offrons donc une réponse : se placer au service du Dharma. Réhabiliter la figure de l'homo religiosus, affirmer joyeusement, contre tous les dogmatiques bornés, le réveil de l'homo paganus.
« La terre avec l'eau, le feu avec l'air, le soleil avec le soleil, l'âme avec l'âme et le preux avec le preux... » (8).
► Christopher Gérard, Fête de la naissance d'Artémis et d'Apollon.
♦ Notes :
- (1) K. White, Lettres de Gourgounel, Presses d'aujourd'hui, Paris 1979, p. 74.
- (2) R. Guénon, Études sur l'Hindouisme, Éd. traditionnelles, Paris 1989, pp.105-116.
- (3) Héraclite, Fragments, 80 (30 éd. Diels-Krantz) et 79 (124), éd. et trad. M. Conche, PUF, 1998.
- (4) Ibidem, p. 281.
- (5) J.P. Lippi, « Réponses sur la Tradition », in A. Guyot-Jeannin, Enquête sur la Tradition, Trédaniel, Paris 1996. Lire aussi l'entretien dans Antaios XIV (Mithras invictus), printemps 1999.
- (6) F. Schuon, « Religio perennis », trad. française dans Regards sur les mondes anciens, Éd. traditionnelles, 1980, pp. 173-183. Texte gracieusement signalé par O. Dard de Genève qui prépare une synthèse sur le métaphysicien alémanique pour les éditions Pardès.
- (7) G. Durand, « homme religieux et ses symboles », in J. Ries (dir.), Traité d'anthropologie du Sacré, t. I, Les origines et le problème de l'homo religiosus, Édisud-Desclée, Paris-Tournai-Louvain 1992, pp. 73-120. Voir aussi le t. II, L'homme indo-européen et le sacré, Édisud, Aix-en-Provence 1995.
- (8) M. Eemans, Het bestendig Verbond, De Phalanx, Bruxelles 1941. Trad. D. Helemans.