Globalisation
L’Europe face à la globalisation
Texte de l’allocution de Robert Steuckers au colloque annuel 2004 (*) de la Gesellschaft für Freie Publizistik, dont l’invité d’honneur était Viatcheslav Dachitchev, le conseiller de Mikhaïl Gorbatchev pour les questions allemandes. C’est le Prof. Dachitchev qui a été l’artisan de la réunification. Il soutient désormais la lutte du Président Poutine contre les oligarques et contre les menées américaines en Caucasie, par terroristes tchétchènes interposés. (Synergies Européennes, octobre 2005)
Mon exposé d’aujourd’hui aura bien évidemment une dimension géopolitique, mais aussi une dimension géo-économique, car les grandes voies et les réseaux de communication, sur terre comme sur mer, et la portée des systèmes d’armement les plus modernes, jouent un rôle considérable dans la concurrence actuelle qui oppose l’Europe aux États-Unis. L’ampleur de ces voies, de ces réseaux, etc. déterminent les catégories dans lesquelles il convient de penser : soit en termes de peuples, soit en termes d’Empire.
Si l’on parle des peuples, on doit savoir de quoi il retourne. À l’époque des soulèvements populaires au XIXe siècle, les peuples se sont dressés contre les empires multiethniques, qu’ils considéraient comme des “camisoles de force”. À partir de 1848, les Polonais et les Finnois en Russie, les Tchèques et les Italiens sur le territoire où s’exerçait la souveraineté de la monarchie impériale et royale austro-hongroise, les Slaves du Sud et les Grecs au sein de l’Empire ottoman, les Irlandais dans le Royaume-Uni, se sont rebellés ou ont développé un mouvement identitaire qui leur était propre. En France, les mouvements culturels bretons ou provençaux (les “félibriges”) se sont développés dans une perspective anti-centraliste et anti-jacobine.
 D’où vient cette révolte générale de type culturel ? Elle provient, grosso modo, de la philosophie de l’histoire de Johann Gottfried Herder, pour qui la langue, la littérature et la mémoire historique constituent, chez chaque peuple, un faisceau de forces, que l’on peut considérer comme étant son identité en acte. L’identité est par conséquent spécifique au peuple, ce qui signifie que chaque peuple a le droit de posséder sa propre forme politique et de constituer un État selon sa spécificité, taillé à sa mesure et révisable à tout moment. L’avantage de cette perspective, c’est que chaque peuple peut déployer librement ses propres forces et ses propres caractéristiques. Mais cette perspective recèle également un danger : à l’intérieur d’une même communauté de peuples ou d’un espace civilisationnel, la balkanisation menace.
D’où vient cette révolte générale de type culturel ? Elle provient, grosso modo, de la philosophie de l’histoire de Johann Gottfried Herder, pour qui la langue, la littérature et la mémoire historique constituent, chez chaque peuple, un faisceau de forces, que l’on peut considérer comme étant son identité en acte. L’identité est par conséquent spécifique au peuple, ce qui signifie que chaque peuple a le droit de posséder sa propre forme politique et de constituer un État selon sa spécificité, taillé à sa mesure et révisable à tout moment. L’avantage de cette perspective, c’est que chaque peuple peut déployer librement ses propres forces et ses propres caractéristiques. Mais cette perspective recèle également un danger : à l’intérieur d’une même communauté de peuples ou d’un espace civilisationnel, la balkanisation menace.
Herder en était bien conscient : raison pour laquelle il avait tenté, sous le règne de la Tsarine Catherine II, d’esquisser une synthèse, not. une forme politique, idéologique et philosophique nouvelle qui devait s’appliquer à l’espace intermédiaire situé entre la Russie et l’Allemagne. Herder rêvait de faire émerger une nouvelle Grèce de facture homérienne entre les Pays Baltes et la Crimée. Les éléments germaniques, baltes et slaves auraient tous concourru à un retour à la Grèce la plus ancienne et la plus héroïque, qui aurait été en même temps un retour aux sources les plus anciennes et les plus sublimes de l’Europe. Cette idée de Herder peut nous apparaître aujourd’hui bien éthérée et utopique. Mais de cette esquisse et de l’ensemble de l’œuvre de Herder, on peut retenir un élément fondamental pour notre époque : une synthèse en Europe n’est possible que si l’on remonte aux sources les plus anciennes, c’est-à-dire aux premiers fondements de l’humanité européenne, au noyau de notre propre spécificité humaine, que l’on veillera à activer en permanence. Les archétypes sont en effet des moteurs, des forces mouvantes, qu’aucun progressisme ne peut éteindre car, alors, la culture se fige, devient un désert, tout de sécheresse et d’aridité.
La “nation” selon Herder
La nation, en tant que concept, était, pour Herder une unité plus ou moins homogène, une unité inaliénable en tant que telle, faite d’un composé d’ethnicité, de langue, de littérature, d’histoire et de mœurs. Pour les révolutionnaires français, la nation, au contraire, n’était nullement un tel faisceau de faits objectifs et tangibles, mais n’était que la population en armes, quelle que soit la langue que ces masses parlaient, ou, pour être plus précis, n’était jamais que le demos en armes, ou encore le “Tiers-État” mobilisé pour étendre à l’infini l’espace de la république universaliste. Tilo Meyer nous a donné une excellente définition de la nation. D’après lui, l’ethnos, soit le peuple selon la définition de Herder, ne peut pas être mis purement et simplement à la disposition du démos. Ne sont démocratiques et populaires, au bon sens du terme, que les systèmes politiques qui se basent sur la définition que donne Herder de la nation. Les autres systèmes, qui découlent des idées de la révolution française, sont en revanche égalitaires (dans le sens où ils réduisent tout à une aune unique) et, par là même, totalitaires. Le projet actuel de fabriquer une “multiculture” relève de ce mixte d’égalitarisme équarisseur et de totalitarisme.
La mobilisation des masses au temps de la Révolution française avait bien entendu une motivation militaire : les armées de la révolution acquéraient de la sorte une puissance de frappe considérable et décisive, pour battre les armées professionnelles de la Prusse et de l’Autriche, bien entraînées mais inférieures en nombre. Les batailles de Jemmappes et de Valmy en 1792 l’ont démontré. La révolution introduit un nouveau mode de faire la guerre, qui lui procure des victoires décisives. Clausewitz a étudié les raisons des défaites prussiennes et a constaté que la mobilisation totale de toutes les forces masculines au sein d’un État constituait la seule réponse possible à la révolution, afin de déborder les masses de citoyens armés de la France révolutionnaire et ne pas être débordé par elles. L’exemple qu’ont donné les populations rurales espagnoles dans leur guerre contre les troupes napoléoniennes [« guerre des partisans » appelée « Guerre de l’Indépendance », de 1808 à 1813] (1), où le peuple tout entier s’est dressé pour défendre la Tradition contre la Révolution, a prouvé que des masses orientées selon les principes de la Tradition pouvaient battre ou durement étriller des armées de masse inspirées par la révolution. La pensée de Jahn, le “Père Gymnastique”, comme on l’appelait en Allemagne, constitue une synthèse germanique entre la théorie de Clausewitz et la pratique des paysans insurgés d’Espagne. La mobilisation du peuple s’est d’abord réalisée en Espagne avant de se réaliser en Allemagne et a rendu ainsi possible la victoire européenne contre Napoléon, c’est-à-dire contre le principe mécaniste de la Révolution française.
Après le Congrès de Vienne de 1815, les forces réactionnaires ont voulu désarmer les peuples. L'Europe de Metternich a voulu rendre caduque, rétroactivement, la liberté politique pourtant promise. Or si le paysan ou l’artisan doit devenir soldat et payer, le cas échéant, l’impôt du sang, il doit recevoir en échange le droit de vote et de participation à la chose politique. Lorsque chaque citoyen reçoit le droit et la possibilité d’étudier, il reçoit simultanément un droit à participer, d’une manière ou d’une autre, aux débats politiques de son pays ; telle était la revendication des corporations étudiantes nationalistes et démocratiques de l’époque. Ces étudiants se révoltaient contre une restauration qui conservait le service militaire obligatoire sans vouloir accorder en contrepartie la liberté politique. Ils étayaient intellectuellement leur rébellion par un mixte étonnant dérivé du concept herdérien de la nation et d’idéaux mécanicistes pseudo-nationaux issus du corpus idéologique de la révolution française. À cette époque entre révolution et restauration, la pensée politique oscillait entre une pensée rebelle, qui raisonnait en termes de peuples, et une pensée traditionnelle, qui raisonnait en termes d’empires, ce qui estompait les frontières idéologiques, très floues. Une synthèse nécessairement organique s’avérait impérative. Une telle synthèse n’a jamais émergé, ce qui nous contraint, aujourd’hui, à réfléchir aux concepts nés à l’époque.
La dialectique “peuples/Empire”
Revenons à la dialectique Peuple/Empire ou Peuples/Aires civilisationnelles : à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, nous avions, d’une part, de vastes unités politiques, que la plupart des hommes étaient incapables de concevoir et de visionner, mais, par ailleurs, ces unités politiques de grandes dimensions, mal comprises et rejettées, s’avéraient nécessaires pour affronter la concurrence qu’allait immanquablement imposer la grande puissance transatlantique qui commençait à se déployer. Les colonies espagnoles se sont “libérées”, du moins en apparence, pour tomber rapidement sous la dépendance des États-Unis en pleine ascension. Le ministre autrichien de l’époque, Hülsemann, à la suite de la proclamation de la “Doctrine de Monroe”, ainsi que le philosophe français Alexis de Tocqueville, qui venait d’achever un long voyage en Amérique du Nord, lançaient tous 2 un avertissement aux Européens, pour leur dire qu’au-delà de l’Atlantique une puissance était en train d’émerger, qui était fondamentalement différente que tout ce que l’on avait connu en Europe auparavant. La politique internationale venait d’acquérir des dimensions véritablement continentales voire globales. L’avenir appartiendrait dorénavant aux seules puissances disposant de suffisamment d’étendue, de matières premières sur le territoire où elles exerçaient leur souveraineté, un territoire qui devait être compact, aux frontières bien délimités et “arrondies”, et non pas aux empires coloniaux dispersés aux 4 vents.
Hülsemann, et après lui Constantin Franz, plaidaient pour une alliance des puissances coloniales dépourvues de colonies, ce qui a conduit notamment à la signature de traités comme celui qui instituait “l’alliance des trois empereurs” (Russie, Allemagne, Autriche-Hongrie) ou à l’application de principes comme celui de “l’assurance mutuelle prusso-russe”. Au début du XXe siècle, l’alliance qui unissait l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie a voulu réanimer l’homme malade du Bosphore, c’est-à-dire l’Empire ottoman, dont elles voulaient faire un “territoire complémentaire”, source de matières premières et espace de débouchés. Cette volonté impliquait la construction d’un réseau de communications moderne, en l’occurrence, à l’époque, d’une ligne de chemin de fer entre Hambourg et Bagdad (et éventuellement de continuer la ligne de chemin de fer jusqu’à la côte du Golfe Persique). Ce projet recèle l’une des causes principales de la Première Guerre mondiale. En effet, l’Angleterre ne pouvait tolérer une présence non anglaise dans cette région du monde ; la Russie ne pouvait accepter que les Allemands et les Autrichiens déterminassent la politique à Constantinople, que les Russes appellaient parfois “Tsarigrad”.
La leçon de Spengler et d’Huntington
En Europe, les structures de type impérial sont donc une nécessité, afin de maintenir la cohérence de l’aire civilisationnelle européenne, dont la culture a jailli du sol européen, afin que tous les peuples au sein de cette aire civilisationnelle, organisée selon les principes impériaux, puissent avoir un avenir. Aujourd’hui, le Professeur américain Samuel Huntington postule que l’on se mette à penser la politique du point de vue des aires civilisationnelles. Il parle, en anglais, de “civilizations”. La langue allemande, elle, fera la différence, avec Oswald Spengler, entre la notion de Kultur, qui représente une force organique, et celle de Zivilisation, qui résume en elle tous les acquis purement mécaniques et techniques d’une aire civilisationnelle ou culturelle. Ces acquis atteignent leur apex lorsque les forces issues des racines culturelles sont presque épuisées.
S. Huntington, que l’on peut considérer comme une sorte de disciple contemporain de Spengler, pense que ces forces radicales peuvent être réactivées, si on le veut, comme le font les fondamentalistes islamistes ou les rénovateurs de l’hindouisme aujourd’hui. Il évoque une aire civilisationnelle “occidentale”, qui regroupe l’Europe et l’Amérique au sein d’une unité atlantique. Mais, pour nous, comme jadis pour Hülsemann et Tocqueville, l’Europe — en tant que source dormante de l’humanité européenne primordiale — et l’Amérique — en tant que nouveauté sans passé sur la scène internationale et dont l’essence est révolutionnaire et mécaniciste — constituent 2 pôles fondamentalement différents, même si, à la surface des discours politiques américains, conservateurs ou néo-conservateurs, nous observons la présence de fragments effectivement “classiques”, mais ce ne sont là que les fragments d’une culture fabriquée, vendue comme “classique”, mais dont la seule fonction est de servir de simple décorum.
Ce décor “classique” est l’objet d’intéressantes discussions idéologiques et philosophiques aux États-Unis aujourd’hui. On s’y pose des questions telles : Doit-on considérer ces éléments de “classicisme” comme les simples reliquats d’un passé européen commun, plus ou moins oublié, ou doit-on les évacuer définitivement de l’horizon philosophique, les jeter par-dessus bord, ou doit-on les utiliser comme éléments intellectuels pour parfaire des manœuvres d’illusionniste dans le monde des médias, pour faire croire que l’on est toujours attaché aux valeurs européennes classiques ? Ce débat, nous devons le suivre attentivement, sans jamais être dupes.
L’Europe actuelle, qui a pris la forme de l’eurocratie bruxelloise, n’est évidemment pas un Empire, mais, au contraire, un Super-État en devenir. La notion d’ “État” n’a rien à voir avec la notion d’ “Empire”, car un “État” est “statique” et ne se meut pas, tandis que, par définition, un Empire englobe en son sein toutes les formes organiques de l’aire civilisationnelle qu’il organise, les transforme et les adapte sur les plans spirituel et politique, ce qui implique qu’il est en permanence en effervescence et en mouvement. L’eurocratie bruxelloise conduira, si elle persiste dans ses errements, à une rigidification totale. L’actuelle eurocratie bruxelloise n’a pas de mémoire, refuse d’en avoir une, a perdu toute assise historique, se pose comme sans racines. L’idéologie de cette construction de type “machine” relève du pur bricolage idéologique, d’un bricolage qui refuse de tirer des leçons des expériences du passé.
Cela implique que la praxis économique de l’eurocratie bruxelloise se pose comme “ouverte sur le monde” et néo-libérale (2), ce qui constitue une négation de la dimension historique des systèmes économiques réellement existants, qui ont effectivement émergé et se sont développés sur le sol européen. Le néo-libéralisme, qui plus est, ne permet aucune évolution positive dans le sens d’une autarcie continentale. L’eurocratie de Bruxelles n’est donc plus une instance européenne au sens réel et historique du terme, mais une instance occidentale, car tout néo-libéralisme doctrinaire, en tant que modernisation du vieux libéralisme manchesterien anglo-saxon, est la marque idéologique par excellence de l’Occident, comme l’ont remarqué et démontré, de manière convaincante et suffisante, au fil des décennies, des auteurs aussi divers qu’Ernst Niekisch, Arthur Moeller van den Bruck, Guillaume Faye ou Claudio Finzi.
Les peuples périssent d’un excès de libéralisme
Mais tous les projets d’unir et de concentrer les forces de l’Europe, qui se sont succédé au fil des décennies, ne posaient nullement comme a priori d’avoir une Europe “ouverte sur le monde”, mais au contraire tous voulaient une Europe autarcique, même si cette autarcie acceptait les principes d’une économie de marché, mais dans le sens d’un ordo-libéralisme [entendu au sens ancien de potectionnisme], c’est-à-dire d’un libéralisme qui tenait compte des facteurs non économiques. En effet, une économie ne peut pas, sans danger, refuser par principe de tenir compte des autres domaines de l’activité humaine. L’héritage culturel, l’organisation de la médecine et de l’enseignement doivent toujours recevoir une priorité par rapport aux facteurs purement économiques, parce qu’ils procurent ordre et stabilité au sein d’une société donnée ou d’une aire civilisationnelle, garantissant du même coup l’avenir des peuples qui vivent dans cet espace de civilisation. Sans une telle stabilité, les peuples périssent littéralement d’un excès de libéralisme (ou d’économicisme ou de “commercialite”), comme l’avait très justement constaté A. Moeller van den Bruck au début des années 20 du XXe siècle.
Pour ce qui concerne directement le destin de l’Europe, des industriels et économistes autrichiens avaient suggéré une politique européenne cohérente dès la fin du XIXe siècle. Par ex., Alexander von Peez (1829-1912) avait remarqué très tôt que les États-Unis visaient l’élimination de l’Europe, non seulement dans l’ensemble du Nouveau Monde au nom du panaméricanisme, mais aussi partout ailleurs, y compris en Europe même. La question de survie, pour tous les peuples européens, était donc posée : ou bien on allait assister à une unification grande-européenne au sein d’un système économique autarcique, semblable au Zollverein [Union douanière] allemand ou bien on allait assister à une colonisation générale du continent européen par la nouvelle puissance panaméricaine, qui était en train de monter. Il avertissait les Européens du danger d’une “américanisation universelle”. Le théoricien de l’économie Gustav Schmoller, figure de proue de l’”école historique allemande”, plaidait, pour sa part, pour un “bloc économique européen”, capable d’apporter une réponse au dynamisme des États-Unis. Pour lui, un tel bloc serait “autarcique” et se protègerait par des barrières douanières, exactement le contraire de ce que préconise aujourd’hui l’eurocratie bruxelloise.
 Julius Wolf (1862-1937, ci-contre), un autre théoricien allemand de l’économie, prévoyait que le gigantesque marché panaméricain se fermerait un jour aux marchandises et aux produits européens et qu’une concurrence renforcée entre les produits européens et américains s’instaurerait à l’échelle de la planète. Arthur Dix et Walther Rathenau ont fait leur cette vision. Jäckh et Rohrbach, pour leur part, se faisaient les avocats d’un bloc économique qui s’étendrait de la Mer du Nord au Golfe Persique. C’est ainsi qu’est née la “question d’Orient”, le long de l’Axe Hambourg/Koweit. L’Empereur d’Allemagne, Guillaume II, voulait que les Balkans, l’Anatolie et la Mésopotamie devinssent un “espace de complément” (Ergänzungsraum) pour l’industrie allemande en pleine expansion, mais il a invité toutes les autres puissances européennes à participer à ce grand projet, y compris la France, dans un esprit chevaleresque de conciliation. Gabriel Hanoteaux (1853-1944) a été le seul homme d’État français qui a voulu donner une suite positive à ce projet rationnel. En Russie, Sergueï Witte (1849-1915), homme d’État de tout premier plan, perçoit également ce projet d’un œil positif. Malheureusement ces hommes d’État clairvoyants ont été mis sur une voie de garage par des obscurantistes à courtes vues, de toutes colorations idéologiques.
Julius Wolf (1862-1937, ci-contre), un autre théoricien allemand de l’économie, prévoyait que le gigantesque marché panaméricain se fermerait un jour aux marchandises et aux produits européens et qu’une concurrence renforcée entre les produits européens et américains s’instaurerait à l’échelle de la planète. Arthur Dix et Walther Rathenau ont fait leur cette vision. Jäckh et Rohrbach, pour leur part, se faisaient les avocats d’un bloc économique qui s’étendrait de la Mer du Nord au Golfe Persique. C’est ainsi qu’est née la “question d’Orient”, le long de l’Axe Hambourg/Koweit. L’Empereur d’Allemagne, Guillaume II, voulait que les Balkans, l’Anatolie et la Mésopotamie devinssent un “espace de complément” (Ergänzungsraum) pour l’industrie allemande en pleine expansion, mais il a invité toutes les autres puissances européennes à participer à ce grand projet, y compris la France, dans un esprit chevaleresque de conciliation. Gabriel Hanoteaux (1853-1944) a été le seul homme d’État français qui a voulu donner une suite positive à ce projet rationnel. En Russie, Sergueï Witte (1849-1915), homme d’État de tout premier plan, perçoit également ce projet d’un œil positif. Malheureusement ces hommes d’État clairvoyants ont été mis sur une voie de garage par des obscurantistes à courtes vues, de toutes colorations idéologiques.
Constantinople : pomme de discorde
 La pomme de discorde, qui a conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale, était, en fait, la ville de Constantinople. L’objet de cette guerre si meurtrière a été la domination des Détroits et du bassin oriental de la Méditerranée. Les Anglais avaient toujours souhaité laisser les Détroits aux mains des Turcs, dont la puissance avait considérablement décliné (“L’homme malade du Bosphore”, disait Bismarck). Mais, en revanche, ils ne pouvaient accepter une Turquie devenue l’espace complémentaire (Ergänzungsraum) d’une Europe centrale, dont l’économie serait organisée de manière cohérente et unitaire, sous direction allemande. Par conséquent, pour éviter ce cauchemar de leurs stratèges, ils ont conçu le plan de “balkaniser” et de morceler encore davantage le reste de l’Empire ottoman, de façon à ce qu’aucune continuité territoriale ne subsiste, surtout dans l’espace situé entre la Mer Méditerranée et le Golfe Persique. La Turquie, la Russie et l’Allemagne devaient toutes les 3 se voir exclues de cette région hautement stratégique de la planète, ce qui impliquait de mettre en œuvre une politique de “containment” avant la lettre. Les Russes rêvaient avant 1914 de reconquérir Constantinople et de faire de cette ville magnifique, leur “Tsarigrad”, la ville des Empereurs (byzantins), dont leurs tsars avaient pris le relais. Les Russes se percevaient comme les principaux porteurs de la “Troisième Rome” et entendaient faire de l’ancienne Byzance le point de convergence central de l’aire culturelle chrétienne-orthodoxe. Les Français avaient des intérêts au Proche-Orient, en Syrie et au Liban, où ils étaient censé protéger les communautés chrétiennes. Le télescopage de ces intérêts divergents et contradictoires a conduit à la catastrophe de 1914.
La pomme de discorde, qui a conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale, était, en fait, la ville de Constantinople. L’objet de cette guerre si meurtrière a été la domination des Détroits et du bassin oriental de la Méditerranée. Les Anglais avaient toujours souhaité laisser les Détroits aux mains des Turcs, dont la puissance avait considérablement décliné (“L’homme malade du Bosphore”, disait Bismarck). Mais, en revanche, ils ne pouvaient accepter une Turquie devenue l’espace complémentaire (Ergänzungsraum) d’une Europe centrale, dont l’économie serait organisée de manière cohérente et unitaire, sous direction allemande. Par conséquent, pour éviter ce cauchemar de leurs stratèges, ils ont conçu le plan de “balkaniser” et de morceler encore davantage le reste de l’Empire ottoman, de façon à ce qu’aucune continuité territoriale ne subsiste, surtout dans l’espace situé entre la Mer Méditerranée et le Golfe Persique. La Turquie, la Russie et l’Allemagne devaient toutes les 3 se voir exclues de cette région hautement stratégique de la planète, ce qui impliquait de mettre en œuvre une politique de “containment” avant la lettre. Les Russes rêvaient avant 1914 de reconquérir Constantinople et de faire de cette ville magnifique, leur “Tsarigrad”, la ville des Empereurs (byzantins), dont leurs tsars avaient pris le relais. Les Russes se percevaient comme les principaux porteurs de la “Troisième Rome” et entendaient faire de l’ancienne Byzance le point de convergence central de l’aire culturelle chrétienne-orthodoxe. Les Français avaient des intérêts au Proche-Orient, en Syrie et au Liban, où ils étaient censé protéger les communautés chrétiennes. Le télescopage de ces intérêts divergents et contradictoires a conduit à la catastrophe de 1914.
En 1918, la France et l’Angleterre étaient presque en état de banqueroute. Ces 2 puissances occidentales avaient contracté des dettes pharamineuses aux États-Unis, où elles avaient acheté des quantités énormes de matériels militaires, afin de pouvoir tenir le front. Les États-Unis qui, avant 1914, avaient des dettes partout dans le monde, se sont retrouvés dans la position de créanciers en un tourne-main. La France n’avait pas seulement perdu 1,5 million d’hommes, c’est-à-dire sa substance biologique, mais était contrainte de rembourser des dettes à l’infini : le Traité de Versailles a choisi de faire payer les Allemands, au titre de réparation.
Ce jeu malsain de dettes et de remboursements a ruiné l’Europe et l’a plongée dans une spirale épouvantable d’inflations et de catastrophes économiques. Pendant les années 20, les États-Unis voulaient gagner l’Allemagne comme principal client et débouché, afin de pouvoir “pénétrer”, comme on disait à l’époque, les marchés européens protégés par des barrières douanières. L’économie de la République de Weimar, régulée par les Plans Dawes et Young, était considérée, dans les plus hautes sphères économiques américaines, comme une économie “pénétrée”. Cette situation faite à l’Allemagne à l’époque, devait être étendue à toute l’Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale. C’est ainsi, qu’étape après étape, l’”américanisation universelle” s’est imposée, via l’idéologie du “One World” de Roosevelt ou via la notion de globalisation à la Soros aujourd’hui. Les termes pour la désigner varient, la stratégie reste la même.
Le projet d’unifier le continent par l’intérieur
La Seconde Guerre mondiale avait pour objectif principal, selon Roosevelt et Churchill, d’empêcher l’unification européenne sous la férule des puissances de l’Axe, afin d’éviter l’émergence d’une économie “impénétrée” et “impénétrable”, capable de s’affirmer sur la scène mondiale. La Seconde Guerre mondiale n’avait donc pas pour but de “libérer” l’Europe mais de précipiter définitivement l’économie de notre continent dans un état de dépendance et de l’y maintenir. Je n’énonce donc pas un jugement “moral” sur les responsabilités de la guerre, mais je juge son déclenchement au départ de critères matériels et économiques objectifs. Nos médias omettent de citer encore quelques buts de guerre, pourtant clairement affirmés à l’époque, ce qui ne doit surtout pas nous induire à penser qu’ils étaient insignifiants. Bien au contraire !
Dans la revue Géopolitique, qui paraît aujourd’hui à Paris, et est distribuée dans les cercles les plus officiels, un article nous rappelait la volonté britannique, en 1942, d’empêcher la navigation fluviale sur le Danube et le creusement de la liaison par canal entre le Rhin, le Main et le Danube. Pour illustrer ce fait, l'article présentait une carte parue dans la presse londonienne en 1942, au beau milieu d’articles qui expliquaient que l’Allemagne était “dangereuse”, non pas parce qu’elle possédait telle ou telle forme de gouvernement qui aurait été “anti-démocratique”, mais parce que ce régime, indépendamment de sa forme, se montrait capable de réaliser un vieux plan de Charlemagne ainsi que le Testament politique du roi de Prusse Frédéric II, c’est-à-dire de réaliser une navigation fluviale optimale sur tout l’intérieur du continent, soit un réseau de communications contrôlable au départ même des puissances qui constituent, physiquement, ce continent ; un contrôle qu’elles exerceraient en toute indépendance et sans l’instrument d’une flotte importante, ce qui aurait eu pour corollaire immédiat de relativiser totalementle contrôle maritime britannique en Méditerranée et de ruiner ipso facto la stratégie qui y avait été déployée par le Royaume-Uni depuis la Guerre de Succession d’Espagne et les opérations de Nelson à l’ère napoléonienne. Ainsi, pour atteindre, depuis les côtes de l’Atlantique, les zones à blé de la Crimée et des bassins du Dniestr, du Dniepr et du Don, ou pour atteindre l’Égypte, l’Europe n’aurait plus nécessairement eu besoin des cargos des armateurs financés par l’Angleterre. La Mer Noire aurait été liée directement à l’Europe centrale et au bassin du Rhin.
Une telle symphonie géopolitique, géostratégique et géo-économique, les puissances thalassocratiques l’ont toujours refusée, car elle aurait signifié pour elles un irrémédiable déclin. Les visions géopolitiques du géopolitologue français André Chéradame, très vraisemblablement téléguidé par les services britanniques, impliquaient le morcellement de la Mitteleuropa et du bassin danubien, qu’il avait théorisé pour le Diktat de Versailles. Ses visions visaient également à créer le maximum d’États artificiels, à peine viables et antagonistes les uns des autres dans le bassin du Danube, afin que de Vienne à la Mer Noire, il n’y ait plus ni cohérence ni dynamisme économiques, ni espace structuré par un principe impérial (reichisch).
L’objectif, qui était d’empêcher toute communication par voie fluviale, sera encore renforcé lors des événements de la Guerre Froide. L’Elbe, soit l’axe Prague/Hambourg, et le Danube, comme artère fluviale de l’Europe, ont été tous 2 verrouillés par le Rideau de Fer. La Guerre Froide avait pour objectif de pérenniser cette césure. Le bombardement des ponts sur le Danube près de Belgrade en 1999 ne poursuivait pas d’autres buts.
Étalon-or et étalon-travail
La Guerre Froide visait aussi à maintenir la Russie éloignée de la Méditerranée, afin de ne pas procurer à l’Union Soviétique un accès aux mers chaudes, à garder l’Allemagne en état de division, à laisser à la France une autonomie relative. Officiellement, la France appartenait au camp des vainqueurs et cette politique de morcellement et de balkanisation lui a été épargnée. Les Américains toléraient cette relative autonomie parce que les grands fleuves français, comme la Seine, la Loire et la Garonne sont des fleuves atlantiques et ne possédaient pas, à l’époque, de liaisons importantes avec l’espace danubien et aussi parce que l’industrie française des biens de consommation était assez faible au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est que dans les années 50 et 60 qu’une telle industrie a pris son envol en France, avec la production d’automobiles bon marché (comme la légendaire “2CV” de Citroën que les Allemands appelaient la “vilaine cane”, la “Dauphine” ou les modèles “R8” de Renault) ou d’appareils électro-ménagers de Moulinex, etc., ensemble de produits qui demeuraient très en-dessous des standards allemands. La force de la France avait été ses réserves d’or ; celle de l’Allemagne, la production d’excellents produits de précision et de mécanique fine, que l’on pouvait échanger contre de l’or ou des devises.
Anton Zischka écrivit un jour que le retour d’Amérique des réserves d’or françaises — pendant le règne de De Gaulle, au cours des années 60 et à l’instigation de l’économiste Rueff — a été une bonne mesure mais toutefois insuffisante parce que certaines branches de l’industrie de la consommation n’existaient pas encore en France : ce pays ne produisait pas d’appareils photographiques, de machines à écrire, de produits d’optique comme Zeiss-Ikon, d’automobiles solides destinées à l’exportation.
Comme Zischka l’avait théorisé dans son célèbre ouvrage Sieg der Arbeit (La victoire de l’étalon-travail), l’or est certes une source de richesse et de puissance nationales, mais cette source demeure statique, tandis que l’étalon-travail constitue un facteur perpétuellement producteur, correspondant à la dynamique de l’époque contemporaine. Les stratèges américains l’avaient bien vu. Ils ont laissé se produire le miracle économique allemand, car ce fut un développement quantitatif, certes spectaculaire, mais trompeur. À un certain moment, au bout de quelques décennies, ce miracle devait trouver sa fin car tout développement complémentaire de l’industrie allemande ne pouvait se produire qu’en direction de l’espace balkanique, du bassin de la Mer Noire et du Proche-Orient.
Dans ce contexte si riche en conflits réels ou potentiels, dont les racines si situent à la fin du XIXe siècle, les instruments qui ont servi, depuis plusieurs décennies, à coloniser et à mettre hors jeu l’Allemagne et, partant, l’Europe entière, sont les suivants :
◊ ◊ ◊
♦ La Mafia et les drogues
Pour en arriver à contrôler l’Europe, les services secrets américains ont toujours téléguidés diverses organisations mafieuses. Selon le spécialiste actuel des mafias, le Français Xavier Raufer, le “tropisme mafieux” de la politique américain a déjà une longue histoire derrière lui : tout a commencé en 1943, lorsque les autorités américaines vont chercher en prison le boss de la mafia Lucky Luciano, originaire de Sicile, afin qu’il aide à préparer le débarquement allié dans son île natale et la conquête du Sud de l’Italie. Depuis lors, on peut effectivement constater un lien étroit entre la mafia et les services spéciaux des États-Unis. En 1949, lorsque Mao fait de la Chine une “république populaire”, l’armée nationaliste chinoise du Kuo-Min-Tang se replie dans le “Triangle d’Or”, une région à cheval sur la frontière birmano-laotienne. Les Américains souhaitent que cette armée soit tenue en réserve pour mener ultérieurement d’éventuelles opérations en Chine communiste. Le Congrès se serait cependant opposé à financer une telle armée avec l’argent du contribuable américain et, de surcroît, n’aurait jamais avalisé une opération de ce genre. Par conséquent, la seule solution qui restait était d’assurer son auto-financement par la production et le trafic de drogue.
Pendant la guerre du Vietnam, certaines tribus montagnardes, comme les Hmongs, ont reçu du matériel militaire payé par l’argent de la drogue. Avant la prise du pouvoir par Mao en Chine et avant la guerre du Vietnam, le nombre de toxicomanes était très limité : seuls quelques artistes d’avant-garde, des acteurs de cinéma ou des membres de la “jet society” avant la lettre consommaient de l’héroïne ou de la cocaïne : cela faisait tout au plus 5.000 personnes pour toute l’Amérique du Nord. Les médias téléguidés par les services ont incité à la consommation de drogues et, à la fin de la guerre du Vietnam, l’Amérique comptait déjà 560.000 drogués. Les mafias chinoise et italienne ont pris la logistique en main et ont joué dès lors un rôle important dans le financement des guerres impopulaires.
L’alliance entre la Turquie et les États-Unis a permis à un troisième réseau mafieux de participer à cette stratégie générale, celui formé par les organisations turques, qui travaillent en étroite collaboration avec des sectes para-religieuses et avec l’armée. Elles ont des liens avec des organisations criminelles similaires en Ouzbékistan voire dans d’autres pays turcophones d’Asie centrale et surtout en Albanie. Les organisations mafieuses albanaises ont pu étendre leurs activités à toute l’Europe à la suite du conflit du Kosovo, ce qui leur a permis de financer les unités de l’UÇK. Celles-ci ont joué le même rôle dans les Balkans que les tribus Hmongs au Vietnam dans les années 60. Elles ont préparé le pays avant l’offensive des troupes de l’OTAN.
Par ailleurs, le soutien médiatique insidieux, apporté à la toxicomanie généralisée chez les jeunes, poursuit un autre objectif stratégique, celui de miner l’enseignement, de façon à ce que l’Europe perde un autre de ses atouts : celui que procuraient les meilleurs établissements d’enseignement et d’éducation du monde, qui, jadis, avaient toujours aidé notre continent à se sauver des pires situations.
Dans toute l’Europe, les forces politiques saines doivent lutter contre les organisations mafieuses, non seulement parce qu’elle sont des organisations criminelles, mais aussi parce qu’elles sont les instruments d’un État, étranger à l’espace européen, qui cultive une haine viscérale à l’égard de l’identité européenne. La lutte contre les organisations mafieuses implique notamment de contrôler et de réguler les flux migratoires en provenance de pays où la présence et l’influence de mafias se fait lourdement sentir (Turquie, Albanie, Ouzbékistan, etc.).
♦ Les multinationales
Depuis les années 60, les multinationales sont un instrument du capitalisme américain, destiné à contraindre les autres États à ouvrir leurs frontières. Sur le plan strictement économique, le principe qui consiste à favoriser l’essaimage de multinationales conduit à des stratégies de “délocalisations”, comme on le dit dans le jargon néo-libéral. Ces stratégies de délocalisation sont responsables des taux élevés de chômage. Même dans le cas de produits en apparance peu signifiants ou anodins, tels les jouets ou les bonbons, les multinationales ont détruit des centaines de milliers d’emplois. Exemple : les voitures miniatures étaient, jadis, dans mon enfance, fabriquées généralement en Angleterre, comme les Dinky Toys, les Matchbox et les Corgi Toys. Aujourd’hui, les miniatures de la nouvelle génération, portant parfois la même marque, comme Matchbox, nous viennent de Thaïlande, de Chine ou de Macao.
À l’époque de son engouement pour l’espace politique national-révolutionnaire, le sociologue allemand Henning Eichberg, aujourd’hui exilé au Danemark, écrivait, avec beaucoup de pertinence, dans la revue berlinoise Neue Zeit, que nous subissions “une subversion totale par les bonbons” (eine totale Subvertierung durch Bonbons). En effet, les douceurs et sucreries pour les enfants ne sont plus produites aux niveaux locaux, ou confectionnées par une grand-mère pleine d’amour, mais vendues en masse, dans des drugstores ou des pompes à essence, des supermarchés ou des distributeurs automatiques, sous le nom de “Mars”, “Milky Way” ou “Snickers”. Ce ne sont plus des grand-mères ou des mamans qui les confectionnent, mais des multinationales sans cœur et tout en chiffres et en bilans, gérés par d’infects technocrates qui les vendent dans tous les coins et les recoins de la planète. À combien de personnes ces stratégies infâmes ont-elles coûté l’emploi, ont-elles ôté le sens à l’existence ?
Dans l’Europe entière, les forces politiques saines, si elles veulent vraiment lutter contre le chômage de masse, doivent refuser toutes les logiques de délocalisations et protéger efficacement les productions locales.
♦ Le néo-libéralisme comme idéologie
Le néo-libéralisme est l’idéologie économique de la globalisation. L’écrivain et économiste français Michel Albert a constaté, au début des années 90, que le néo-libéralisme, héritage des gouvernements de Thatcher et de Reagan, correspond en pratique à une négation quasi complète de tout investissement local (régional, national, transnational dans un cadre continental semi-autarcique et auto-centré, etc.). Il réagissait contre cette nouvelle pathologie politique, qui consistait à vouloir imiter à tout prix la gestion thatcherienne et les “reaganomics” et préconisait de remettre à l’ordre du jour les politiques “ordo-libérales”. L’“ordo-libéralisme” ou “modèle rhénan” (dans le vocabulaire de M. Albert), n’est pas seulement allemand ou “rhénan” mais aussi japonais, suédois, partiellement belge (les structures patrimoniales des vieilles industries de Flandre ou de Wallonie) ou français (les grandes entreprises familiales autour des villes de Lyon ou de Lille ou en Lorraine).
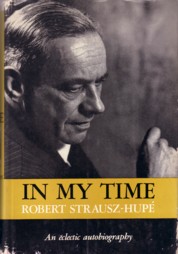 Ce “modèle rhénan” privilégie l’investissement plutôt que la spéculation en bourse. L’investissement ne se fait pas qu’en capital-machine dans l’industrie mais aussi, pour Albert, dans les modules de recherche des universités, dans les écoles supérieures professionnelles ou, plus généralement, dans l’enseignement. Conjointement aux idées délétères du mouvement soixante-huitard, l’idéologie néo-libérale a miné les systèmes d’enseignement dans toute l’Europe. En Allemagne, aujourd’hui, la situation est grave. En France, elle est pire, sinon catastrophique. En Angleterre, une initiative citoyenne, baptisée Campaign for Real Education, revendique actuellement, auprès des enseignants et des associations de parents, la revalorisation de la discipline à l’école, afin d’améliorer le niveau des études et les capacités linguistiques (en langue maternelle) des enfants. Le géopolitologue Robert Strausz-Hupé (1903-2002, ci-contre couverture de son autobiographie In my time parue en 1965), qui œuvrait dans les cénacles intellectuels gravitant jadis autour de Roosevelt, avait planifié la destruction des forces implicites du vieux continent européen, dans un programme destiné à l’Allemagne et à l’Europe, au même moment où Morgenthau concoctait ses plans pour une pastoralisation générale et définitive de l’espace germanique. Selon ce Strausz-Hupé, il fallait briser à jamais l’homogénéité ethnique des pays européens et ses systèmes d’éducation. Pour réaliser ce projet au bout de quelques décennies, les spéculations anti-autoritaires de pédagogues éthérés, la consommation de drogues et l’idéologie de 68 ont joué un rôle-clef. En évoquant ces faits, quelques voix chuchotent que le philosophe Herbert Marcuse, idole des soixante-huitards, aurait travaillé pour l’Office for Strategic Studies (OSS), l’agence américaine de renseignement qui a précédé la célèbre CIA.
Ce “modèle rhénan” privilégie l’investissement plutôt que la spéculation en bourse. L’investissement ne se fait pas qu’en capital-machine dans l’industrie mais aussi, pour Albert, dans les modules de recherche des universités, dans les écoles supérieures professionnelles ou, plus généralement, dans l’enseignement. Conjointement aux idées délétères du mouvement soixante-huitard, l’idéologie néo-libérale a miné les systèmes d’enseignement dans toute l’Europe. En Allemagne, aujourd’hui, la situation est grave. En France, elle est pire, sinon catastrophique. En Angleterre, une initiative citoyenne, baptisée Campaign for Real Education, revendique actuellement, auprès des enseignants et des associations de parents, la revalorisation de la discipline à l’école, afin d’améliorer le niveau des études et les capacités linguistiques (en langue maternelle) des enfants. Le géopolitologue Robert Strausz-Hupé (1903-2002, ci-contre couverture de son autobiographie In my time parue en 1965), qui œuvrait dans les cénacles intellectuels gravitant jadis autour de Roosevelt, avait planifié la destruction des forces implicites du vieux continent européen, dans un programme destiné à l’Allemagne et à l’Europe, au même moment où Morgenthau concoctait ses plans pour une pastoralisation générale et définitive de l’espace germanique. Selon ce Strausz-Hupé, il fallait briser à jamais l’homogénéité ethnique des pays européens et ses systèmes d’éducation. Pour réaliser ce projet au bout de quelques décennies, les spéculations anti-autoritaires de pédagogues éthérés, la consommation de drogues et l’idéologie de 68 ont joué un rôle-clef. En évoquant ces faits, quelques voix chuchotent que le philosophe Herbert Marcuse, idole des soixante-huitards, aurait travaillé pour l’Office for Strategic Studies (OSS), l’agence américaine de renseignement qui a précédé la célèbre CIA.
Dans toute l’Europe, les forces politiques saines devraient militer aujourd’hui pour réaffirmer l’existence d’un système ordo-libéral de facture “rhénane” (selon Albert), c’est-à-dire un système économique qui investit au lieu de spéculer et qui apporte son soutien à l’école et aux universités, sans négliger les autres secteurs non marchands, comme les secteurs hospitalier et culturel, car les piliers porteurs non marchands de toute société ne peuvent être mis à disposition ni être sacrifié à la seule économie. Ces secteurs non marchands soudent les communautés populaires, créent une fidélité à l’État dans toutes les catégories sociales. Le néo-libéralisme ne soude pas, il dé-soude, il ne génère aucune fidélité et fait régner la loi de la jungle.
♦ Les médias
L’Europe est également tenue sous la coupe d’un système médiatique qui, in fine, est téléguidé par certains services étrangers, qui veillent à susciter les “bonnes” émotions au bon moment. Ces médias façonnent la mentalité contemporaine et visent à exclure du débat tout esprit indépendant et critique, surtout si ces esprits critiques sont effectivement critiques parce qu’ils pensent en termes d’histoire et de tradition. En effet, les esprits détachés du temps et de l’espace, sans feu ni lieu (Jacques Ellul), représentent ce que l’on appelle en Allemagne die schwebende Intelligenz, l’intelligentsia virevoltante, qui est justement cette forme d’intelligentsia dont l’américanisation et la globalisation ont besoin. La domination de l’Europe par des instruments médiatiques a commencé immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, not. quand une revue, apparemment anodine dans sa forme et sa présentation, Sélection du Reader’s Digest, a été répandue dans toute l’Europe et dans toutes les langues, quand la France de 1948 fut contrainte de faire jouer dans toutes ses salles de cinéma des films “made in USA”, sinon elle ne recevait pas les fonds du Plan Marshall. Le gouvernement Blum a accepté ce diktat, qui signait l’arrêt de mort du cinéma français.
Quand l’ancien créateur cinématographique Claude Autant-Lara, classé à gauche au temps de sa gloire, fut élu au Parlement Européen sur les listes du nationaliste français Jean-Marie le Pen, il reçut le droit de prononcer le discours inaugural de l’assemblée, vu qu’il en était le doyen. Il saisit cette opportunité pour condamner, du haut de la tribune de Strasbourg, la politique américaine qui a toujours consisté à imposer systématiquement les films d’Hollywood, pour torpiller les productions nationales des pays européens. Les chansons, les modes, les drogues, la télévision (avec CNN), l’internet sont autant de canaux qu’utilise la propagande américaine pour effacer la mémoire historique des Européens et d’influencer ainsi les opinions publiques, de façon à ce qu’aucune autre vision du monde autre que celle de l’American way of Life ne puisse plus jamais émerger.
Dans toute l’Europe, les forces politiques saines doivent viser à faire financer des médias indépendants, locaux et liés au sol, qui soient à même de fournir au public des messages idéologiquement et politiquement différents. Afin d’empêcher que nos peuples soient abrutis et placés sous influence par des systèmes médiatiques hypercentralisés et téléguidés par une super-puissance étrangère à notre espace. Un tel contrôle médiatique s’avère nécessaire dans la perspective des guerres du futur, qui seront des “guerres cognitives”, dont l’objectif sera d’influencer les peuples et de rendre les “audiences étrangères” (“enemy/alien audiences” dans le jargon de la CIA ou de la NSA) perméables au discours voulus par les services spéciaux de Washington, afin qu’aucune autre solution à un problème de politique internationale ne puisse être considérée comme “morale” ou “acceptable”.
♦ Les moyens militaires
On affirme généralement que la puissance des États-Unis est essentiellement une puissance maritime. Les puissances mondiales, qui sont simultanément des puissances maritimes (des thalassocraties), sont généralement “bi-océaniques” : on veut dire par là qu’elles ont des “fenêtres” sur 2 océans. L’objectif de la guerre que les États-Unis ont imposé au Mexique en 1848 était de se tailler une vaste fenêtre donnant sur l’Océan Pacifique, pour pouvoir ensuite accéder, à court ou à moyen terme, aux marchés de Chine et d’Extrême-Orient et d’en faire des marchés exclusivement réservés aux productions américaines. Lorsque l’Amiral américain Alfred Thayer Mahan s’efforce à la fin du XIXe siècle de faire de la Navy League un instrument pour promouvoir dans les esprits et dans les actes l’impérialisme américain, il poursuivait simultanément l’objectif de faire de la flotte américaine, qui était alors en train de se développer, un monopole militaire exclusif : seule cette flotte aurait le droit de s’imposer sur la planète sans souffrir la présence de concurrents.
Son but politique et stratégique était de donner aux puissances anglo-saxonnes une “arme d’intervention” globale et ubiquitaire, susceptible de donner à la Grande-Bretagne et aux États-Unis un instrument capable de développer une vitesse de déplacement supérieure à tous les autres instruments possibles à l’époque, afin d’assurer le succès de leurs interventions partout dans le monde. Les autres puissances ne pouvant pas posséder d’instruments aussi rapides ou d’une vitesse encore supérieure. Par conséquent, l’objectif visait aussi à enlever à l’avenir aux autres puissances de la planète la possession d’un armement naval similaire ou comparable. La conquête de l’espace maritime du Pacifique a donc eu lieu après celle des côtes californiennes en 1848, pour être plus exact 50 ans plus tard, lors de la guerre contre l’Espagne qui a abouti à l’élimination de cette puissance européenne dans les Caraïbes et dans les Philippines. L’Allemagne, à l’époque, a repris à son compte la souveraineté sur la Micronésie et a défendu, dans ce cadre, l’île de Samoa, avec sa marine de guerre, contre les prétentions américaines. Entre 1900 et 1917, les États-Unis n’ont posé aucun acte décisif, mais la Première Guerre mondiale leur a donné l’occasion d’intervenir et de vendre du matériel de guerre en telles quantités aux alliés occidentaux qu’au lendemain de la guerre ils n’étaient plus débiteurs du monde mais ses premiers créanciers.
En 1922, les Américains et les Britanniques imposent à l’Allemagne et à leurs propres alliés le Traité de Washington. On ne parle pas assez de ce Traité important, décisif et significatif pour l’Europe toute entière. Il imposait à chaque puissance maritime du monde un tonnage spécifique pour sa flotte de guerre : 550.000 tonnes pour les États-Unis et autant pour l’Angleterre; 375.000 tonnes pour le Japon ; 175.000 tonnes pour l’Italie et autant pour la France. Versailles avait déjà sonné le glas de la marine de guerre allemande. La France, bien que considérée comme un État vainqueur, ne pouvait plus désormais, après le traité de Washington, se donner les moyens de devenir une forte puissance maritime. La réduction à quasi rien du tonnage autorisé de la flotte allemande était en fait, aux yeux de Washington, une vengence pour Samoa et une mesure préventive, pour éliminer la présence du Reich dans le Pacifique. Pourquoi est-il important aujourd’hui de rappeler à tous les clauses du Traité de Washington ? Parce qu’avec ce Traité nous avons affaire à un exemple d’école du modus operandi américain.
- 1. Ce procédé a été systématisé par la suite.
- 2. Les peuples lésés ont tenté en vain d’apporter des réponses à ces mesures qui restreignaient considérablement l’exercice de leur souveraineté. Il suffit de penser au développement de l’aviation civile française, aux temps héroïques où se sont distingués des pilotes exceptionnels comme Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, ou au développement des dirigeables Zeppelin en Allemagne, qui a connu un fin tragique en 1937 à New York quand le “Hindenburg” s’est écrasé au sol en proie aux flammes.
Du “Mistral” aux “Mirages”
Les 2 puissances que sont la France et l’Allemagne n’ont pas pu remplacer leurs marines perdues à la suite des clauses du Traité de Washington de 1922 par une “flotte aérienne” adéquate et suffisante. L’objectif général poursuivi par les Américains était de ne tolérer aucune industrie autonome d’armement de haute technologie chez leurs anciens alliés. Après la Seconde Guerre mondiale, la France et les petites puissances occidentales ont été contraintes d’acheter le vieux matériel de guerre américain pour leurs armées. L’armée française a ainsi été dotée exclusivement de matériels américains. Mais avec l’aide d’ingénieurs allemands prisonniers de guerre, la France a été rapidement en mesure de fabriquer des avions de combat ultra-modernes, comme par ex. les avions à réaction de type “Mistral”.
Après 1945, l’Allemagne n’a plus possédé d’industrie aéronautique digne de ce nom. Fokker, aux Pays-Bas, n’a plus pu qu’essayer de survivre et est finalement resté une entreprise trop modeste pour ses capacités réelles. Sous De Gaulle, les ingénieurs français développent, en coopération avec des collègues allemands, les fameux chasseurs Mirage, concurrents sérieux pour leurs équivalents américains sur le marché mondial. Les chasseurs Mirage III constituaient un développement du Volksjäger (“chasseur du peuple”) allemand de la Seconde Guerre mondiale, le Heinkel 162. En 1975, les Américains forcent les gouvernements des pays scandinaves et bénéluxiens de l’OTAN à acquérir des chasseurs F-16, après avoir convaincu une brochette de politiciens corrompus. Cette décision a eu pour effet que les Français de Bloch-Dassault et les Suédois de SAAB n’ont plus pu opérer de sauts technologiques majeurs, parce que la perte de ce marché intérieur européen ne leur permettait pas de financer des recherches de pointe. Le même scénario s’est déroulé plus récemment, avec la vente de F-16 aux forces aériennes polonaise et hongroise. Depuis ce “marché du siècle”, les avionneurs français et suédois claudiquent à la traîne et ne parviennent plus à se hisser, faute de moyens financiers, aux plus hauts niveaux de la technologie avionique. Si, sur le plan des technologies de l’armement, les Allemands ont eu l’autorisation de construire leurs chars Léopard, c’est parce que l’Amérique est avant tout une puissance maritime et ne s’intéresse pas a priori aux armements destinés aux armées de terre. Les Américains mettent davantage l’accent sur les navires de guerre, les sous-marins, les missiles, les satellites et les forces aériennes.
Dans un article paru dans l’hebdomadaire berlinois Junge Freiheit, on apprend que les consortiums américains achètent les firmes qui produisent des technologies de pointe, comme Fiat-Avio en Italie, une branche du gigantesque consortium que représente Fiat et produit des moteurs d’avion; ensuite une entreprise d’Allemagne du Nord qui fabrique des sous-marins et le consortium espagnol Santa Barbara Blindados, qui fabrique les chars Léopard allemands pour le compte de l’armée espagnole. De cette manière, les tenants de l’industrie de guerre américaine auront accès à tous les secrets de l’industrie allemande des blindés. Ces manœuvres financières ont pour objectif de contraindre l’Europe à la dépendance, avant qu’elle ne se donne les possibilités d’affirmer son indépendance militaire.
Les organisations militaires qui sont ou étaient sous la tutelle américaine, comme l’OTAN, le CENTO ou l’OTASE, ne servaient qu’à une chose : créer un marché pour les armes américaines déclassées, notamment les avions, afin d’empêcher, dans les pays “alliés”, toute éclosion ou résurrection d’industries d’armement indépendantes, capables de concurrencer leurs équivalentes américaines. Les progrès technologiques, qui auraient pu résulter de l’indépendance des industries d’armement en Europe ou ailleurs, auraient sans doute permis la production de systèmes d’armement plus performants pour les “alien armies”, les armées étrangères, ce qui aurait aussi eu pour conséquence de tenir en échec, le cas échéant, la super-puissance dominante, devenue entre-temps la seule superpuissance de la planète, voire de la réduire à la dimension d’une puissance de deuxième ou de troisième rang.
Le réseau “ÉCHELON”
 La crainte de voir des puissances potentiellement hostiles développer des technologies militaires performantes est profondément ancrée dans les têtes du personnel politique dirigeant des États-Unis. C’est ce qui explique la nécessité d’espionner les “alliés”. Comme nous l’a très bien expliqué Michael Wiesberg dans les colonnes de l’hebdomadaire berlinois Junge Freiheit, le système satellitaire “ÉCHELON” a été conçu pendant la Guerre Froide en tant que système d’observation militaire, destiné à compléter les moyens de communication existants de l’époque, tels les câbles sous-marins ou les autres satellites utilisés à des fins militaires. Mais sous Clinton, le système “ÉCHELON” a cessé d’être un instrument purement militaire ; très officiellement, il poursuit désormais des missions civiles. Et lorsque des objectifs civils deviennent objets de systèmes d’espionnage de haute technologie, cela signifie que les “alliés” de la super-puissance, hyper-armée, deviennent, eux aussi, à leur tour, les cibles de ces écoutes permanentes. Dans un tel contexte, ces “alliés” ne sont plus des “alliés” au sens conventionnel du terme. La perspective purement politique, telle qu’elle nous fut jadis définie par un Carl Schmitt, change complètement. Il n’existe alors plus d’ennemis au sens “schmittien” du terme, mais plus d’”alliés” non plus, dans le sens où ceux-ci serait théoriquement et juridiquement perçus et traités comme des égaux. Le langage utilisé désormais dans les hautes sphères dirigeantes américaines et dans les services secrets US trahit ce glissement sémantique et pratique : on n’y parle plus d’”ennemis” ou d’”alliés”, mais d’alien audiences, littéralement d’”auditeurs étrangers”, de “destinataires [de messages] étrangers”, qui doivent être la cible des services de propagande américains, qui ont pour mission de les rendre “réceptifs” et dociles.
La crainte de voir des puissances potentiellement hostiles développer des technologies militaires performantes est profondément ancrée dans les têtes du personnel politique dirigeant des États-Unis. C’est ce qui explique la nécessité d’espionner les “alliés”. Comme nous l’a très bien expliqué Michael Wiesberg dans les colonnes de l’hebdomadaire berlinois Junge Freiheit, le système satellitaire “ÉCHELON” a été conçu pendant la Guerre Froide en tant que système d’observation militaire, destiné à compléter les moyens de communication existants de l’époque, tels les câbles sous-marins ou les autres satellites utilisés à des fins militaires. Mais sous Clinton, le système “ÉCHELON” a cessé d’être un instrument purement militaire ; très officiellement, il poursuit désormais des missions civiles. Et lorsque des objectifs civils deviennent objets de systèmes d’espionnage de haute technologie, cela signifie que les “alliés” de la super-puissance, hyper-armée, deviennent, eux aussi, à leur tour, les cibles de ces écoutes permanentes. Dans un tel contexte, ces “alliés” ne sont plus des “alliés” au sens conventionnel du terme. La perspective purement politique, telle qu’elle nous fut jadis définie par un Carl Schmitt, change complètement. Il n’existe alors plus d’ennemis au sens “schmittien” du terme, mais plus d’”alliés” non plus, dans le sens où ceux-ci serait théoriquement et juridiquement perçus et traités comme des égaux. Le langage utilisé désormais dans les hautes sphères dirigeantes américaines et dans les services secrets US trahit ce glissement sémantique et pratique : on n’y parle plus d’”ennemis” ou d’”alliés”, mais d’alien audiences, littéralement d’”auditeurs étrangers”, de “destinataires [de messages] étrangers”, qui doivent être la cible des services de propagande américains, qui ont pour mission de les rendre “réceptifs” et dociles.
Que signifie ce glissement, cette modification, sémantique, en apparence anodine ? Elle signifie qu’après l’effondrement de l’Union Soviétique, les “alliés” européens sont devenus superflus et ne constituent plus qu’un ensemble de résidus, vestiges d’un passé bien révolu, tant et si bien que l’on peut sans vergogne aller pomper des informations chez eux, qu’on peut les placer sous écoute permanente, surtout dans les domaines qui touchent les technologies de pointe. Les Européens ont déjà pu constater, à leurs dépens, que des firmes françaises et allemandes ont été espionnées par voie électronique ou par le truchement des satellites du système ÉCHELON. Certaines de ces entreprises avaient mis au point un système de purification des eaux. Comme les informations qu’elles envoyaient par courrier électronique avaient préalablement été pompées, les entreprises concurrentes américaines avaient pu fabriquer les produits à meilleur marché, tout simplement parce qu’elles n’avaient pas investi le moindre cent dans la recherche.
L’appareil étatique américain favorise de la sorte ses propres firmes nationales et pille simultanément les entreprises de ses “alliés”. Cette forme d’espionnage industriel recèle un danger mortel pour nos sociétés civiles, car elle génère un chômage au sein d’un personnel hautement qualifié. Duncan Campbell, un courageux journaliste britannique qui a dénoncé le scandale d’ÉCHELON, donne, dans son rapport, des dizaines d’exemples de pillages similaires, dans tous les domaines des technologies de pointe. Les États-Unis, cependant, ne sont pas les seuls à participer au réseau satellitaire d’espionnage ÉCHELON ; la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande y participent aussi, si bien qu’une question importante se pose à nous : le Royaume-Uni constitue-t-il une puissance européenne loyale ? Le Général de Gaulle n’avait-il pas raison quand il disait que la “relation spéciale” (special relationship) entre les États-Unis et la Grande-Bretagne était derechef hostile au continent européen, et le resterait à jamais ?
◊ ◊ ◊
Lorsque nous évoquons une “Europe des peuples”, nous devons avoir en tête 2 faisceaux de faits, jouant chacun un rôle important :
◊ 1. Le premier faisceau de faits est de nature culturelle. La culture est ce que l’on doit maintenir intact, dans la mesure du possible, dans le tourbillon incessant des modèles divergents que nous propose la modernité. Nous en sommes bien évidemment conscients, nous plus que beaucoup d’autres. Mais cette conscience, qui est la nôtre, recèle un grand danger, propre de tout combat culturel : celui de transformer tout héritage culturel en un fatras “muséifié” ou de percevoir toute activité culturelle comme un simple passe-temps. La défense de nos héritages culturels ne peut en aucun cas être “statique”, dépourvue de dynamisme. Toute culture vivante possède une dimension politique, économique et géopolitique.
◊ 2. Second faisceau de faits : le peuple, en tant que substrat ethnique porteur et créateur/fondateur de culture, ne peut jamais, au grand jamais, être mis à disposition par la classe politique dominante. Ce substrat populaire fait émerger, au fil du temps, une culture et une littérature spécifiques et non aliénables, produits d’une histoire particulière. Il génère également un système économique spécifique, qui est tel et non autre. Toute forme économique nait et s’inserre dans un espace particulier, est une émanation d’une époque particulière. Par voie de conséquence, toute économie viable ne peut s’inscrire dans un schéma conceptuel qui se voudrait d’emblée “international” ou “universel”. Perroux, Albertini et Silem, les grands théoriciens français de l’économie et de l’histoire économique, insistent justement sur la dimension historique des systèmes économiques, sans oublier les grands théoriciens des systèmes autarciques. Pour clarifier leurs propos si pertinents, ils ont classés l’ensemble des systèmes en 2 catégories didactiques : les “orthodoxes”, d’une part, les “hétérodoxes”, d’autres part.
“Orthodoxes” et “hétérodoxes” en théorie économique
Les “orthodoxes” sont les libéraux de l’école d’Adam Smith (les “libéraux manchesteriens”) et les marxistes, qui pensent sur base de concepts “universels” et veulent implanter les mêmes modèles et catégories partout dans le monde. Ils sont en fait les ancêtres philosophiques des araseurs globalistes d’aujourd’hui. Les “hétérodoxes” en revanche mettent l’accent sur les particularités de chaque système économique. Ils sont les héritiers de l’”école historique” allemande, et d’économistes tels Rodbertus, Schmoller et de Laveleye. Sous la République de Weimar, le Tat-Kreis et la revue Die Tat, avec des héritiers de cette école comme Ferdinand Fried et Ernst Wagemann, ont poursuivi cette quête et approfondi cette veine intellectuelle.
Comme nous venons de le dire, pour les “hétérodoxes” et les tenants de l’école historique, chaque espace économique est lié à un lieu et est le fruit d’une histoire particulière, que l’on ne peut pas tout bonnement mettre entre parenthèse et ignorer. L’histoire et l’économie façonnent les institutions, qui sont liées à un substrat ethnique, à un lieu et à une époque, des institutions qui font fonctionner une économie de manière telle et non autre. Nous percevons très nettement, ici, pourquoi l’UE a connu jusqu’ici l’échec, et le connaîtra encore dans l’avenir : elle n’a jamais emprunté cette voie hétérodoxe. Nous, bien évidemment, nous optons pour cette approche hétérodoxe de l’économie, dans le sens où l’entendent Perroux, Silem et Albertini. L’économie est le “nomos” de l’oïkos, ce qui signifie qu’elle est la mise en forme d’un lieu de vie spécifique, où j’habite, moi, en tant que “façonneur” potentiel du politique, avec les miens. D’après l’étymologie même du mot économie, il n’y a pas d’économie sans lieu (**). Une économie universelle n’existe pas par définition.
Revenons à la géopolitique. Par définition, la discipline, que constitue la “géopolitique”, traite de l’influence des facteurs géographiques/spatiaux sur les ressorts éternels de la politique, à l’intérieur d’une aire donnée. Les facteurs spatiaux, immédiats et environnants, influencent bien entendu la manière de pratiquer l’économie dans les limites de l’“oïkos” lui-même. S’il nous paraît utile et équilibrant de conserver ces modes hérités de pratiquer l’économie, et de ne pas les remplacer par des règles qui seraient soi-disant applicables sans faille à tous les lieux du monde, alors nous pouvons parler d’un principe “autarcique”, quand l’économie se donne pour but d’être et de rester auto-suffisante. La notion d’autarcie économique n’implique pas nécessairement que l’on constitue à terme un “État commercial fermé” (l’interprétation étroite de l’idée conçue par Fichte). À l’heure actuelle, la notion d’autarcie devrait viser un équilibre entre une ouverture raisonnable des frontières commerciales et la pratique tout aussi raisonnable de fermetures ad hoc, afin de protéger, comme il se doit, les productions indigènes. Une notion actualisée d’autarcie vise un “auto-centrage” bien balancé de toute économie nationale ou “grand-spatiale” (großräumisch / reichisch), ainsi que l’avait théorisé avec brio André Grjébine, un disciple de François Perroux.
De Frédéric II à Friedrich List
Friedrich List s’était fait l’avocat, au XIXe siècle, des systèmes économiques indépendants. C’est lui qui a forgé, par ses idées et plans, les économies modernes de l’Allemagne, des États-Unis, de la France et de la Belgique, et partiellement aussi de la Russie à l’époque du ministre du Tsar Serguëi Witte, l’homme qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, a modernisé l’empire russe. L’idée principale de List était de lancer le processus d’industrialisation dans chaque pays et de développer de bons systèmes et réseaux de communications. À l’époque de List, ces systèmes et réseaux de communications étaient les canaux et les chemins de fer. De son point de vue, et du nôtre, chaque peuple, chaque aire culturelle ou civilisationnelle, chaque fédération de peuples, a le droit de construire son propre réseau de communication, afin de se consolider économiquement. Dans ce sens, List entendait réaliser les vœux concrets contenus dans le Testament politique de Frédéric II de Prusse.
Le roi de Prusse écrivit en 1756 que la mission majeure de l’État prussien dans l’espace de la grande plaine de l’Allemagne du Nord était de relier entre eux par canaux les grands bassins fluviaux, si bien qu’entre la Vistule et la Mer du Nord les communications s’en trouvent grandement facilitées. Ce projet visait à dépasser l’état de discontinuité et de fragmentation de l’espace nord-allemand, qui avait grevé pendant des siècles le destin historique du Saint-Empire. Le système de canaux envisagés réduisait ensuite la dépendance de cette plaine par rapport à la mer. En son temps, List développa également le projet de relier à l’Atlantique les grands lacs situés au centre du continent nord-américain. Il encouragea les Français à construire un canal entre l’Atlantique et la Méditerranée, afin de relativiser la position de Gibraltar.
Il donna aussi le conseil au roi des Belges, Léopold Ier de Saxe-Cobourg, de relier les bassins de l’Escaut et de la Meuse à celui du Rhin. Ainsi, successivement, l’État belge a fait creuser plusieurs canaux, dont le “Canal du Centre”, le Canal Anvers-Charleroi et, beaucoup plus tard seulement, le Canal Albert (en 1928), couronnement de ce projet germano-belge du XIXe siècle. List conseilla à tous de construire des lignes de chemin de fer, afin d’accélérer partout les communications. Ce sont surtout l’Allemagne et les États-Unis qui doivent à ce grand ingénieur et économiste d’être devenus de grandes puissances industrielles.
Du droit inaliénable à déployer ses propres moyens électroniques
Les puissances thalassocratiques ne peuvent en aucun cas tolérer de tels dévelopements dans les pays continentaux. Les Anglais craignaient, aux XIXe et XXe siècles, que l’élément constitutif de leur puissance, c’est-à-dire leur flotte, perdrait automatiquement de son importance en cas d’amélioration des voies navigables intra-continentales et des chemins de fer. La presse anglaise s’était insurgée contre la construction, par les Français, du grand canal entre l’Atlantique et la Méditerranée. En 1942, cette même presse londonienne publie une carte pour expliciter à son public les dangers que recèlerait la construction d’une liaison entre le Rhin, le Main et le Danube. Dans son ouvrage du plus haut intérêt, intitulé Präventivschlag, Max Klüver nous rappelle que les services spéciaux britanniques avaient planifié et commencé à exécuter des missions de sabotage contre les ponts sur le Danube en Hongrie et en Roumanie. La Guerre Froide — il suffit de lire une carte physique de l’Europe — avait également pour objectif de couper les communications fluviales sur l’Elbe et le Danube, afin d’empêcher toute dynamique entre la Bohème et l’Allemagne du Nord et entre le complexe bavaro-autrichien et l’espace balkanique.
La guerre contre la Serbie en 1999 a servi, entre autres choses, à bloquer tout trafic sur le Danube et à empêcher l’éclosion d’un système de communication à voies multiples entre la région de Belgrade et la Mer Egée. Les idées de List restent tout à fait actuelles et mériteraient bien d’être approfondies et étoffées, not. en incluant dans leurs réflexions sur l’autarcie et l’indépendance économique la technologie nouvelle que représentent aujourd’hui les systèmes satellitaires. Tout groupe de peuples, toute fédération comme l’UE par ex., devrait disposer du droit, inaliénable, de déployer ses propres moyens et systèmes électroniques, afin de renforcer sa puissance industrielle et économique.
Pour observer de réelles actualisations des théories de List, qui, en Europe, sont refoulées voire “interdites” comme presque toutes les doctrines “hétérodoxes”, nous devons tourner nos regards vers l’Amérique latine. Sur ce continent, travaillent et enseignent des disciples de List et de Perroux. Lorsque ces théoriciens et économistes latino-américains parlent de s’émanciper de la tutelle américaine, ils utilisent le concept de “continentalisme”. Ils désignent par là un mouvement politique présent sur l’ensemble du continent ibéro-américain et capable de rassembler et de fédérer toutes les forces souhaitant se dégager de la dépendance imposée par Washington.
L’Argentine, par ex., a développé des idées et des idéaux autarcistes bien étayés dès l’époque du Général Péron. Avant que les forces transnationales du monde bancaire aient ruiné le pays en utilisant tous les trucs possibles et imaginables, l’Argentine bénéficiait d’une réelle indépendance alimentaire, grâce à sa surproduction de céréales et de viandes, destinées à l’exportation. Cette puissance civile constituait une épine dans le pied de la politique américaine. L’Argentine avait aussi, not. grâce à l’aide d’ingénieurs allemands, pu développer une industrie militaire complète et bien diversifiée. En 1982, les pilotes argentins se servaient d’avions de combat fabriqués en Argentine même, les fameux “Pucaras”, qui détruisirent des navires de guerre britanniques lors de la Guerre des Malouines. Cette politique d’autonomie bien poursuivie fait de l’idéologie péroniste, qui l’articule, l’ennemi numéro un des États-Unis en Amérique ibérique, et plus particulièrement dans le “cône sud”, depuis plus de 60 ans. Les nombreuses crises, créées de toutes pièces, qui ont secoué la patrie du Général Péron, ont réduit à néant les pratiques autarciques, pourtant si bien conçues. Une expérience très positive a connu une fin misérable, ce qui est un désastre pour l’humanité entière.
Ceux qui veulent aujourd’hui poursuivre une politique européenne d’indépendance, en dehors de tous les conformismes suggérés par les médias aux ordres, doivent articuler les 6 points suivants pour répondre à la politique de globalisation voulue par les États-Unis :
♦ Point 1 : Abandonner le néo-libéralisme, retrouver l’ordo-libéralisme !
L’économie doit à nouveau reposer sur les principes du “modèle rhénan” (Michel Albert) et retrouver sa dimension “patrimoniale”. La démarche principale pour retourner à ce modèle “rhénan” et patrimonial, et réétablir ainsi une économie de marché ordo-libérale, consiste à investir plutôt qu’à spéculer. Lorsque l’on parle d’investissement, cela vaut également pour les établissements d’enseignement, les universités et la recherche. Une telle politique implique également le contrôle des domaines stratégiques les plus importants, comme au Japon ou aux États-Unis, ce que pratique désormais le Président Poutine en Russie post-communiste. Poutine, en effet, vient de prier récemment l’oligarque Khodorovski, d’investir “patriotiquement” sa fortune dans des projets à développer dans la Fédération de Russie, plutôt que de les “placer” à l’étranger et d’y spéculer sans risque. L’eurocratie bruxelloise, elle, a toujours refusé une telle politique. Récemment, le député du Front National français Bruno Gollnisch a proposé une politique européenne selon 3 axes : 1) soutenir Airbus, afin de développer une industrie aéronautique européenne indépendante de l’Amérique ; 2) développer “Aérospace” afin de doter l’Europe d’un système satellitaire propre ; 3) soutenir toutes les recherches en matières énergétiques afin de délivrer l’Europe de la tutelle des consortia pétrolier dirigés par les États-Unis. Un programme aussi clair constitue indubitablement un pas dans la bonne direction
♦ Point 2 : Lutter pour soustraire l’Europe à l’emprise et l’influence des grandes agences médiatiques américaines !
Pour nous rendre indépendants des grandes agences médiatiques américaines, qui interprètent la réalité ambiante de la scène internationale dans des perspectives qui vont à l’encontre de nos propres intérêts, l’Europe doit donc développer une politique spatiale, ce qui implique une étroite coopération avec la Russie. Sans la Russie, nous accusons un retard considérable en ce domaine. Pendant des décennies, la Russie a rassemblé un savoir-faire considérable en matières spatiales. La Chine et l’Inde sont prêtes, elles aussi, à participer à un projet commun dans ce sens. Mais, pour pouvoir combattre le plus efficacement qui soit le totalitarisme médiacratique que nous imposent les États-Unis, nous avons besoin d’une révolution intellectuelle et spirituelle, d’une nouvelle métapolitique, qui briserait la fascination dangereuse qu’exerce l’industrie américaine de la cinématographie et des loisirs. Si les productions européennes présentent une qualité et attirent le public, tout en conservant la diversité et la pluralité des cultures européennes au sens où l’entendait Herder, nous serions en mesure de gagner la “guerre cognitive”, comme l’appellent aujourd’hui les stratégistes français. Toute révolution spirituelle a besoin de fantaisie, de créativité, d’un futurisme rédempteur et, surtout, d’une certaine insolence dans la critique, comme le démontre l’histoire d’une feuille satirique allemande d’avant 1914, le Simplicissimus. Un esprit d’insolence, lorsqu’il fait mouche, aide à gagner la “guerre cognitive”.
♦ Point 3 : Les principes de politique étrangère ne devraient pas être ceux qu’induit et prêche l’Amérique sans arrêt
L’Europe doit imposer ses propres concepts en politique extérieure, en d’autres termes rejeter l’universalisme de Washington, que celui-ci s’exprime sur le mode du “multilatéralisme”, comme le veut Kerry, ou de l’”unilatéralisme”, tel que Bush le pratique en Irak. Pour une Europe, qui ne serait plus l’expression de l’eurocratie bruxelloise, aucun modèle ne devrait être considéré comme universellement valable ou annoncé comme tel. Que 2 faisceaux de principes soient rappelés et cités ici :
◊ Armin Mohler, décédé en juillet 2003, parlait de la nécessité de donner une interprétation et une pratique allemandes au gaullisme, dans la mesure, écrivait-il dans son ouvrage Von rechts gesehen (Vu de droite), où l’Europe devrait sans cesse s’intéresser aux — et protéger — (les) pays que les Américains décrètent rogue states (“États-voyous”). Lorsqu’A. Mohler écrivit ses lignes sur le gaullisme, l’État-voyou par excellence, dans la terminologie propagandiste américaine, était la Chine. Au même moment, dans le camp “national-européen”, Jean Thiriart et les militants de son mouvement Jeune Europe à Bruxelles, disaient exactement la même chose. En Allemagne, Werner Georg Haverbeck, à Vlotho, tentait, dans son Collegium Humanum de répandre dans les milieux intellectuels allemands une information plus objective sur la Chine. La reine-mère en Belgique, Elisabeth von Wittelsbach, pour s’opposer ostensiblement à la “Doctrine Hallstein” de l’OTAN, entreprit à l’époque de faire un voyage en Chine. Tous furent affublés de l’épithète disqualifiante de “crypto-communistes”. Or, orienter la politique internationale de l’Europe selon certains modèles chinois n’est nullement une idiotie ou une aberration.
◊ Cette “sinophilie” des années 50 et 60 nous amène tout naturellement à réflechir sur un modèle que l’Europe pourrait parfaitement imiter, au lieu de suivre aveuglément les principes et les pratiques de l’universalisme américain. Ce modèle est celui que la Chine propose aujourd’hui encore, après la parenthèse paléo-communiste :
- Aucune immixtion d’États tiers dans les affaires intérieures d’un autre État. Cela signifie que l’idéologie des droits de l’homme ne peut être utilisée pour susciter des conflits au sein d’un État tiers. Le Général Löser, qui, immédiatement avant la chute du Mur, militait en Allemagne pour une neutralisation de la zone centre-européenne (Mitteleuropa), défendait des points de vue similaires.
- Respect de la souveraineté des États existants.
- Ne jamais agir pour ébranler les fondements sur lesquels reposaient les stabilités des États.
- Continuer à travailler à la coexistence pacifique.
- Garantir à chaque peuple la liberté de façonner à sa guise son propre système économique.
Cette philosophie politique chinoise repose sur les travaux d’auteurs classiques comme Sun Tzu ou Han Fei et sur le Tao Te King. Cette pensée recèle des arguments clairs comme de l’eau de roche, sans rien avoir à faire avec ce moralisme délétère qui caractérise l’articulation dans les médias de l’universalisme américain.
♦ Point 4 : S’efforcer d’être indépendant sur le plan militaire
La tâche principale d’un mouvement de libération contientale dans toute l’Europe serait de viser la protection sans faille de l’industrie de l’armement et d’éviter que les firmes existantes ne tombent aux mains de consortia américains tels Carlyle Incorporation. Fiat Avio en Italie, la dernière firme qui construisait des sous-marins en Allemagne, le consortium espagnol Santa Barbara Blindados viennent tout juste de devenir américains par le truchement de spéculations boursières. Autre tâche : privilégier systématiquement l’Eurocorps au lieu de l’OTAN, tout en transformant cet “Eurocorps” en une armée populaire de type helvétique, soit en une milice, comme l’avaient voulu Löser en Allemagne, Spannocchi en Autriche et Brossolet en France. L’OTAN n’a en effet plus aucune raison d’exister depuis que l’Allemagne et l’Europe ont été réunifiées en 1989. Dans la foulée de la disparition du Rideau de Fer, les Européens ont raté une chance historique de façonner un ordre mondial selon leurs intérêts. C’est pourquoi la belle idée d’un “Axe Paris-Berlin-Moscou” vient sans doute trop tard. Troisième tâche : construire une flotte européenne dotée de porte-avions. Quatrième tâche : lancer un système satellitaire européen, afin que l’Europe puisse enfin disposer d’une arme pour mener tout à la fois les guerres militaires et les guerres culturelles/cognitives. Ce qui nous conduit à énoncer le point 5.
♦ Point 5 : Combattre le réseau ÉCHELON
En tant que système d’observation et d’espionnage au service de la Grande-Bretagne, de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, ÉCHELON est une arme dirigée contre l’Europe, la Russie, l’Inde, la Chine et le Japon. Il incarne l’idée dangereuse d’une surveillance totale, comme l’avaient prédite Orwell et Foucault. La pratique américaine et anglo-saxonne d’une surveillance aussi ubiquitaire doit être contrée et combattue par toutes les autres puissances du monde qui en font l’objet. Elle ne peut l’être que par la constitution d’un système équivalent, fruit d’une étroite coopération entre la Russie, l’Europe, l’Inde, la Chine et le Japon. Si ÉCHELON n’est plus le seul et unique système de ce type, les puissances de la grande masse continentale eurasiatique pourront apporter leur réponse culturelle, militaire et économique. En ÉCHELON, en effet, fusionnent les opérations culturelles, économiques et militaires qui sont menées partout dans le monde aujourd’hui. La réponse à y apporter réside bel et bien dans la constitution d’un “Euro-Space” en liaison avec le savoir-faire russe accumulé depuis le lancement du premier spoutnik à la fin des années 50.
♦ Point 6 : Pour une politique énergétique indépendante
Pour ce qui concerne la politique énergétique, la voie à suivre est celle de la diversification maximale des sources d’énergie, comme De Gaulle l’avait amorcée en France dans les années 60, lorsqu’il entendait prendre ses distances par rapport à l’Amérique et à l’OTAN. Le Bureau du Plan français voulait à l’époque exploiter toutes les sources d’énergie possibles : éoliennes, solaires, marémotrices, hydrauliques, sans pour autant exclure le pétrole et le nucléaire. La diversification permet de se dégager d’une dépendance trop étroite à l’endroit d’une source d’énergie unique et/ou exclusive. Aujourd’hui, cette politique de diversification reste valable. Ce qui n’exclut pas de participer à un vaste projet de développement des oléoducs et gazoducs eurasiens, de concert avec la Russie, la Chine, les Corées et le Japon. L’objectif majeur est de se dégager de la dépendance à l’égard du pétrole saoudien et, par ricochet, des sources pétrolières contrôlées par les États-Unis.
Ces 6 points ne pourront jamais être réalisés par le personnel politique actuel. Ceci n’est pas une conclusion qui m’est personnelle, fruit d’une aigreur à l’endroit de l’établissement politique dominant. L’analyse, qui conclut à cette incompétence générale du personnel politique établi, existe déjà, coulée dans des ouvrages de référence, solidement charpentés. Ils constituent une source inépuisable d’idées politiques nouvelles, de programmes réalisables. Erwin Scheuch, Hans-Herbert von Arnim, Konrad Adam, la tradition anti-partitocratique italienne, l’œuvre d’un Roberto Michels, critique des oligarchies, l’œuvre de l’ancien ministre de Franco, Gonzalo Fernandez de la Mora, nous livrent les concepts de combat nécessaires pour déployer une critique offensive et générale des partitocraties et des “cliques” (Scheuch) en place. Cette critique doit contraindre à terme les “élites sans projet” à laisser le terrain à de nouvelles élites, capable d’apporter les vraies réponses aux problèmes contemporains. Pour finir, il me paraît utile de méditer une opinion émise jadis par A. Moeller van den Bruck, qui disait que la politique partisane (la partitocratie) était un mal, parce que les partis s’emparent de l’appareil d’État, alors que celui-ci devrait en théorie appartenir à tous; ainsi s’instaure, dit Moeller van den Bruck, un “filtre” entre le peuple réel et le monde de la politique, qui détruit toute immédiateté entre gouvernés et gouvernants.
Seule cette immédiateté, postulée par Moeller van den Bruck, fonde la véritable démocratie, qui ne peut être que populiste et organique. S’il n’y a ni populisme ni organicité en permanence, l’État dégénère en une institution rigide et purement formelle, inorganique et dévitalisée.
Cette grande idée de l’immédiateté dans le politique pur permet de réaliser de véritables projets et de démasquer les messages idéologiques qui nous conduisent sur de fausses routes. C’est à la restauration de cette immédiateté que nous entendons œuvrer.
► Robert Steuckers, Forest-Flotzenberg / Friedrichsroda (Thüringen), avril 2004.
◘ Notes :
(*) Original allemand : R. Steuckers, « Europa der Völker statt US-Globalisierung », in Veröffentlichungen der Gesellschaft für Freie Publizistik, XX. Kongress-Protokoll 2004, Die Neue Achse : Europas Chancen gegen Amerika, Gesellschaft für Freie Publizistik e. V., Oberboihingen, 2004. Ont également participé à ce Congrès, Dr. Rolf Kosiek, Dr. Dr. Volkmar Weiss, Dr. Walter Post, Prof. Dr. Wjatscheslaw Daschitschew [Viatcheslav Dachitchev], Harald Neubauer, Dr. Pierre Krebs, Dr. Gert Sudholt.
(**) Le mot grec oïkos est de même racine indo-européenne que le latin vicus, signifiant “village”, soit un site bien circonscrit dans l’espace. Le terme latin vicus a donné le néerlandais wijk (quartier) et le suffixe onomastique anglais “-wich”, comme dans “Greenwich”, par ex., qui donnerait “Groenwijk” en néerlandais. Le son “w” ou “v” ayant disparu dans le grec classique et s’étant maintenu dans les langues latines et germaniques, la forme originale est “[w/v]oikos”, où l’on reconnaît les 2 consonnes, inamovibles, tandis que les voyelles varient. Le “k” est devenu “tch” en anglais, selon les mêmes règles phonétiques qui ont donné le passage de castellum (latin) à castel (vieux français), à “cateau” ou “casteau” (picard), à “château” (français moderne) ; ou encore le passage de “canis” (latin) à “ki” (picard du Borinage) puis à “chien” (français moderne) et à “tché” (wallon de Liège). De “tché”, on passe ensuite au domaine germanique où bon nombre de “k” latins ont donné un “h” aspiré, en passant par le son intermédiaire écrit “ch” en néerlandais et en allemand (exemple : “canis”/ “hond/Hund”; “cervus”/ “cerf” / “hert”/”Hirsch”, etc.). Les noms de peuples suivent aussi la même règle : les “Chattes” de l’Antiquité sont devenus les “Hessois” (“Hessen”) d’aujourd’hui, en tenant compte que le “t” se transforme en double “s”, selon les règles des mutations consonantiques, propres aux langues germaniques continentales.
* * *
◘ Scholies annexes :
1 : Napoléon, affairé par ses guerres en Europe, n'eut pas l'occasion de retenter son habile stratégie d'apaisement lorsque, promu Premier Consul peu de temps après son coup d'État du 18 brumaire An VIII (9 nov. 1799), il avait obligé de nombreux chefs chouans à traiter avec lui en contrepartie de la liberté religieuse réhabilitée et de la réouverture des églises, ayant bien compris que ce qui avait amené la protestation monarchique sur les lèvres des habitants des campagnes répondait avant tout à une protestation religieuse (c'était surtout pour la petite noblesse vendéenne que la défense de l'autel entraînait celle du trône). Si la résistance patriotique espagnole durant cette guerre d'Espagne peut être dite concilier tradition et révolution, c'est surtout sur un plan symbolique, en tant qu'elle marqua l'imaginaire collectif, car d'une part la première guerre carliste (1833-1840) fut de fait peu concernée par le “Printemps des peuples”, d'autre part, comme l'a bien montré Engels avec les soulèvements paysans à la fin du Moyen Âge, l'absence de vision politique définie mena les mobilisations populaires à rester sans portée historique (excepté en Suisse où la liberté communale fut sauvegardée). L'engagement populaire espagnol ne s'explique pas factuellement par le seul impact sur la population de la crise provoquée par la guerre, il fut organisé et encadré par la noblesse au sein des “Juntas” dans les diverses régions de la péninsule. Le rôle important de la presse d'opposition, si elle a colporté l'image d'une hispanité marquée et éloignée d’une francisation excessive, rend difficilement compte de la complexité et des aspects contradictoires de la Révolution libérale espagnole, qui prend ses racines autour de la Révolution française et qui culmine à la fin du premier tiers du XIXe siècle :
« Contre l'Espagne des Habsbourgeois, contre l'Espagne de la Contre-Réforme, le changement de dynastie en 1712 avec la fin de la “Guerre de succession”, introduit en Espagne la culture française et, avec elle, les Lumières. Quand, avec la Révolution, les Lumières renversent la monarchie française [sic], les Bourbons reculent aussi en Espagne, et s'allient, contre la Révolution, avec l'Espagne de la Contre-Réforme. Joseph Ier, le frère de Napoléon, règne de 1808, l'année de l'invasion napoléonienne, à 1813, l'année où l'Espagne “gagne” la “Guerre d'indépendance”. Si nous prenons en compte l'échec du mouvement autonome du libéralisme espagnol, c'est-à-dire, de ce que représentent les “Cortes de Cadiz”, quand on analyse les 5 ans du règne de Joseph Ier, cette période représente, même au milieu d'une guerre, la continuité entre la monarchie des Lumières du bourbon Charles III, devenu aujourd'hui en Espagne une référence même pour la gauche politique (notre histoire est tellement pauvre aussi en talents de gauche) et une monarchie restaurée à l'ombre de la Révolution française. Voilà ce que pour A. Soboul signifie Napoléon. Et cette continuité aurait signifié d'un point de vue espagnol une monarchie en voie de devenir une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une monarchie transformée conformément aux principes de la Révolution Française (dans le même sens où le développement politique de l'Angleterre peut être compris comme une monarchie transformée conformément aux principes de la modernité politique), c'est-à-dire que le roi Joseph Ier aurait représenté une Espagne sans guerre civile. Puisque dans le contexte de cette profonde équivoque historique en laquelle a consisté cette geste collective que fut la “Guerre de l'indépendance”, les Lumières devinrent “afrancesamiento” , et les “afrancesados”, des traîtres. “Afrancesado” – “traître” est une expression qui a encore des échos dans l'imaginaire collectif espagnol. À l'ombre des Bourbons qui reviennent avec une attitude contre-révolutionnaire, se met en marche cette dialectique de révolution et contre-révolution qui au milieu du XIXe s. s'étend déjà au socialisme, dialectique de laquelle est témoin, à la fois que promoteur, Donoso Cortès avec son imposant essai Catholicisme, libéralisme et socialisme [1851], autrement dit Contre-Réforme, Révolution française, révolution socialiste. La Guerre Civile de 1936 n'est seulement qu'un épisode de cette dialectique, bien qu'il soit le plus important.
L'invasion napoléonienne en 1808 représente militairement ce type de guerre totale que Clausewitz analyse dans son livre De la guerre [1832]. Mais cette guerre suscite aussi en Espagne cet autre type de guerre qu'ont analysé Clausewitz et Carl Schmitt et qui, seulement en partie, se recouvre avec la guerre développée par l'armée régulière. Il s'agit des “guerrillas”, de la “guerre des partisans” de C. Schmitt. Le maréchal Palafox, défenseur de Saragosse contre les Français, entre autres, en même temps qu'il la convoque, la définit aussi parfaitement avec une phrase qui est devenue célèbre en Prusse : contre les Français, “guerre jusqu'au couteau” (Krieg bis zum Messer) (l'arme blanche que tout Espagnol portait [faute de fusils suffisants]). En 1808, on a créé en Espagne contre Napoléon une Junta suprema en substitution de Charles IV et de son fils (le futur Charles VII), déportés par Napoléon de Madrid à Bayonne. Les communiqués de cette Junta Suprema, en appelant la population à la résistance contre Napoléon, ont non seulement suscité l'enthousiasme du publiciste allemand Ernst-Moritz Arndt, mais sont aussi devenus la base littéraire et argumentative de l'édit de Wilhelm III de Prusse du 22 avril 1813, par lequel on organise le Landsturm, c'est-à-dire une structure de résistance similaire à la guerrilla espagnole, complémentaire de la Landwehr ou milice nationale réorganisée par l'édit du 17 mars 1813. De ce Landsturm, Fichte dit dans la Staaatslehre de 1813 qu'il est un des rares cas, auxquels nous n'assistons pas souvent, “dans lesquels la science et le gouvernement se mettent d'accord” », M. Jiménez-Redondo, « Fichte contre Napoléon : pourquoi la nation française était incapable de liberté », in Fichte et la politique, Polimetrica Publisher, 2008, Milan, Italie, pp. 415-417.
 2 : L'originalité historique du néolibéralisme ouvre à maintes disputes rhétoriques. Néanmoins son effectivité est circonscrivable dans le champ de tensions du politique : « la mise en contexte de luttes politiques et d'individus (...) permet de saisir ce que le néolibéralisme recèle de nouveau » (F. Denord, Néo-libéralisme version française, p. 4, Démopolis, 2007). Cette machine de guerre idéologique a rompu depuis belle lurette avec les illusions du laisser-faire (supposé gardien des “libertés” individuelles) des “derniers libéraux”, elle ne repose aucunement sur une ontologie des lois “naturelles” du marché, elle assume le caractère juridiquement et politiquement construit de l'ordre du marché, ou, bien plutôt, elle vise à construire un ordre de marché par un interventionnisme d'un nouvel ordre. Pour imager notre propos, inous pourrions dire avoir affaire à une reconfiguration complète du système/de la matrice, redistribuant les rôles sociaux, modifiant même les critères du jugement (d'où pour certains un processus de dé-démocratisation).
2 : L'originalité historique du néolibéralisme ouvre à maintes disputes rhétoriques. Néanmoins son effectivité est circonscrivable dans le champ de tensions du politique : « la mise en contexte de luttes politiques et d'individus (...) permet de saisir ce que le néolibéralisme recèle de nouveau » (F. Denord, Néo-libéralisme version française, p. 4, Démopolis, 2007). Cette machine de guerre idéologique a rompu depuis belle lurette avec les illusions du laisser-faire (supposé gardien des “libertés” individuelles) des “derniers libéraux”, elle ne repose aucunement sur une ontologie des lois “naturelles” du marché, elle assume le caractère juridiquement et politiquement construit de l'ordre du marché, ou, bien plutôt, elle vise à construire un ordre de marché par un interventionnisme d'un nouvel ordre. Pour imager notre propos, inous pourrions dire avoir affaire à une reconfiguration complète du système/de la matrice, redistribuant les rôles sociaux, modifiant même les critères du jugement (d'où pour certains un processus de dé-démocratisation).
L'effondrement du capitalisme d'État à l'Est ne doit pas masquer le déclin inéluctable de la démocratie libérale. Cette dernière, on le sait, est vantée comme garantissant (au moins minimalement) les libertés individuelles voire collectives par la division des différents pouvoirs et la pluralité des principes qui la régissent. Or la logique néolibérale étend sa stratégie d'intégration qui, subordonnant tout à la seule raison économique, empêche de faire jouer les différences de principes et de légitimités comme facteurs de limitation du pouvoir. C'est ce qui explique que cette logique « [fasse] passer les rationalités et les juridictions morales, économiques et politiques de l'indépendance relative dont elles jouissaient dans les systèmes de démocratie libérale, à leur intégration discursive et pratique. La gouvernementalité néolibérale mime l'autonomie relative de certaines institutions (la loi, les élections, la police, la sphère publique) les unes par rapport aux autres, et l'autonomie de chacune d'entre elles par rapport au marché. Or c'est grâce à cette indépendance qu'ont été jusqu'à présents préservés un intervalle et une tension entre l'économie politique capitaliste et le système politique libéral » (Wendy Brown, Les habits neufs de la politique mondiale, Néo-libéralisme et néo-conservatisme, éd. Les Prairies ordinaires, 2007, p. 59-60).
Si on peut trouver une anticipation de cette nouvelle pratique de gouvernement des hommes (par les intérêts) dans l'utilitarisme de Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle (c'est lui aussi qui a établi la panopticon, modèle architectural de prison permettant au gardien d'avoir à l'œil à chaque instant le délinquant, et ce à fin d'obtenir un amendement complet et une “dépersonnalisation” du criminel. Cf. Surveiller & punir, Foucault), c'est néanmoins à la fin du XXe siècle que s'est mis en place cette intégration de toutes les sphères politiques et sociales dans et par la logique de l'intérêt. La phase de la démocratie libérale est révolue car le clivage intérêt individuel/général, vie terrestre/vie céleste, monde profane de la société civile/monde sacré de la bureaucratie d'État, aussi mystificateur et formel soit-il aux yeux de Marx (Sur la question juive), est complètement dissous par la logique néo-libérale. Pour elle toute décision et même toute loi sont devenues tactiques, opératoires, soumises à une règle d'efficacité immédiate dans un jeu de rapports de forces et de maximisation des résultats.
Les dérives du type montages maquillés en Raison d'État (mensonge irakien de Bush et Blair) ne sont donc pas conjoncturelles mais structurelles. Cette double logique du pompier pyromane est autant intérieure (manipulation cynique des clients-citoyens qui s'accorde bien avec la gestion de type managérial de l'opinion) qu'extérieure (la guerre, latente ou manifeste, redevenue un levier d'agrégation et de mobilisation des individus dispersés). Il n'est pas un fait du passé ou du présent, aussi sacré soit-il, et surtout s'il est sacré, qui ne puisse être instrumentalisé à des fins de domination. La discipline sociale de la “valeur-travail” et le gouvernement social sont des composantes essentielles du néolibéralisme comme mode de gouvernement des individus. Au nom de la “responsabilisation” des individus s'effectue une “privatisation” des problèmes sociaux (démantèlement des systèmes de retraite, d'éducation publique et de santé) qui renvoie au placard le modèle du Welfare (État social, social-démocratie) vanté pour son “actualité” (alors qu'il garde surtout un rôle symbolique, cf. Baudrillard, Pour une économie du signe).
Le contrôle des sociétés, ce que Foucault nommait la “gouvernementalité” (Naissance de la biopolitique, Seuil, 2004), souvent signifié de nos jours par l'anglicisme “gouvernance”, s'appuie non tant sur un sujet de droit que sur un sujet de référence constitué comme un être maximisateur de son utilité. Le projet politique néolibéral dépasse de très loin le seul cadre de la politique économique. Il n'est en rien une réactivation du vieux libéralisme économique, visant un retrait de l'État ou, plus pragmatiquement, une diminution de son interventionnisme. Il est conduit par une logique normative qui concerne tous les champs de l'action publique et tous les domaines de la vie sociale et individuelle. Basée sur le modèle “anthropologique” de l'homo œconomicus, elle met en scène certaines valeurs (concurrence, “responsabilité”, esprit gagnant au sens d'entrepreneur de sa vie) relatives à une “rationalité calculante” (et non plus délibérative) et vise à produire un sujet nouveau, l'homme néolibéral (apte à se laisser gouverner par son propre intérêt), intégré dans son dispositif (de pouvoir).
Ce projet constructiviste, on en perçoit mal d'ailleurs la visée fondamentale quand on s'arrête à quelques effets décriés (pression du monde économique sur la sphère privée, intrusion des intérêts marchands dans le secteur public, etc.) toujours (ré)ajustables. Il vise à mettre en œuvre une universalisation pratique de la rationalité économique (appliquée donc à tous les domaines de l'existence), avec pour référent normatif le sujet rationnel calculateur.
Aux petits rhéteurs pérorant sur la chose publique comme des Marseillais sur le cagnard, à tous ceux qui croient qu'il n'y a rien de nouveau à l'Ouest depuis Adam Smith alors que c'est l'ère de l'agent Smith, il est bon de rappeler – leur agitation masquant mal une peur de la pauvreté – que non seulement ils se trompent d'époque (illusions de la partitocratie) mais qu'en plus le nouvel ordre mondial n'est en rien la question de la place plus ou moins grande du marché régi par des artifices légaux mais la production active d'une réalité institutionnelle et de rapports sociaux entièrement ordonnés selon les principes du calcul économique marchand. Il s'agit là bel et bien d'une pratique nouvelle de gouvernement (bienvenue dans le monde réel ! ).
Est peu à peu remplacé la normativité politique et morale des “démocraties libérales”, le sujet économique nouveau dépasse le clivage entre “citoyen” et marchand, la forme entrepreneuriale est le nouveau paradigme. Le système n'a ni intérieur ni extérieur, schizophrénisant inexorablement par là les mentalités, et c'en est rester à la mystification entretenue par l'esprit du temps (Zeitgeist) que de croire qu'il s'agit de tension entre intérêt individuel et général alors que cela n'a plus du tout cours.
Le champ public se désintègre lentement dans un calcul coûts-bénéfices, et ceux qui font leurs pleureuses sur la perte de tout “projet collectif” (réclamations incantatoires de plus de démocratie) sont aveugles sur le brouillage des pistes du néolibéralisme, visant à masquer un projet hautement politique conduisant à dépolitiser les rapports sociaux rabattus systématiquement sur la seule logique du calcul privé. Ceux allant jusqu'à évoquer l'anticipation de Marx de la dissolution de tous les critères moraux et politiques dans les « eaux glacées du calcul égoïste » jouent à peu de frais les Cassandre alors qu'il s'agit de la nouvelle normativité politique et morale (et aussi apolitique et amorale) qui s'impose. Le rêve américain tournera vite au cauchemar, comme dans le film de Lynch, quand ceux gagnants se découvriront perdants.
Que vise la mise en œuvre de cette universalisation pratique de la rationalité économique ? Le contrôle d’un « sujet » rationnel et calculateur, l’homo œconomicus, est beaucoup plus aisé à mettre en œuvre que celui d’un “sujet” ne se référant pas á cette rationalité économique. L’acception de cette norme est déjà une marque d’asservissement. Le contrôle social peut ainsi être plus facilement hierarchisé et au final piloté par un nombre de plus en plus restreint d’individus, à moins de penser que cette machinerie fonctionnerait par elle même et ainsi d’ignorer les intérêts qu’elle pourrait servir. Toutefois même si le système capitaliste enferme le “sujet” dans l’illusion d’un libre-arbitre, l’asservissement est plus ou moins volontaire, en ce sens que le refus de cette norme entraînant un bannissement social, le “sujet” choisit alors la survie á court terme. S'ouvre une nouvelle ère, celle des esclaves sans maîtres...
La mutation du capitalisme ne laisse aisément deviner sa puissance, non que manqueraient de nouveaux outils critiques (économistes hétérodoxes, ...) ou d'initiatives louables de terrain (micro-crédit, ...), mais avant tout parce qu'elle met chacun de nous face à l'histoire : ses conséquences sont redoutables. Il s'agit non pas d'une domination formelle qui laisseraient aux peuples ou gouvernements une marge relative de manœuvre mais d'une domination réelle, sans échappatoire, totale. La fusion régime-système ne résulte pas purement et simplement que de ce que Marx (mésestimant, par un reste d'utopisme progressiste anti-simonien, l'État comme puissance souveraine) nomme une idéologie dominante (alliée de la coercition), encore moins de la cupidité (vision moralisatrice inapte à décrire l'émergence historique du capitalisme moderne comme le soulignait Max Weber), mais d'une pluralité de facteurs (juridiques, administratifs, techniques, boursiers, monétaires, ...) qu'on pourrait intituler la logique de l'Extrême-Occident, l'aboutissement d'un processus de rationalisation qui en s'étendant à tous les secteurs (sociaux, économiques, politiques, culturels, ...) a assuré le passage complet d'une rationalité de valeurs à une rationalité de fins (d'ordre fonctionnaliste).
Qui à la vérité ne peut se dire affecté (et infecté) ? Le simulacre recouvre la “câge de fer” bien réelle. La “propagation virale” est autant horizontale que verticale et intègre/instrimentalise tout. Le citoyen-client est moins récalcitrant par rapport à son propre assujetissement, tout en participant à sa subordination. reste seulement à mourir à cette époque (et non de cette époque), à l'instar du poète Rimbaud faisant l'épreuve d'une bascule irréversible avec l'Occident, quitte à décaper toute illusion comme le préconisait Netchaiev.
Face au “turbocapitalisme” quelle opposition concrète ? Fi de tout idéaliste ! Sa logique systémique n'est nullement un “en dehors”, elle ne cesse d'interpeler ce que nous sommes devenus. Chercher une oasis face au désert qui croît ? Se rasséréner d'un “marche ou crève” sans souci autre que de tenir ? Mais la lucidité, comme rappelle le poète, n'est-elle pas « la blessure la plus rapprochée du soleil » ? La “terra nova” ne sera point dès lors celle promise des Liberals ou néoconservateurs mais celle incognita du partisan, celle du Grand Jeu (qui n'a rien à voir avec le militantisme-évasion attaché à son minoritarisme).
Que faire ? L'attentisme (type “grand soir”) ressemble fort à un aveu d'abandon, reste donc en un premier temps à réinventer des pratiques répondant à la fois à une autre idée de l'humain et à un contre-projet. « Une histoire des racines de l'utilitarisme repose la question politique de la “manière de faire la société” à laquelle est appelée à répondre toute collectivité humaine quand elle reprend, dans certains moments exceptionnels, la parole sur son destin, au-delà des intérêts immédiats perçus. Elle repose également, à l'instant où il est donné à chacun de reprendre le sens de sa vie, la question éthique décisive de la 'manière d'être homme', au-delà de la fonction économique à laquelle il est voué » (C. Laval, L'homme économique, essais sur les racines du néolibéralisme, Gal., 2007, p. 345-346).
Toutefois il n'y aura ni durabilité historique ni fécondité élargie des contre-projets sans une synergie “mutualisant” les efforts et qui, telle la vague scélérate, catalysera les lignes de force pour balayer la colonie pénitentiaire auto-suffisante et auto-duplicante. Survivre à la Périphérie appelle nécessairement à affronter le Centre, cet œil du cyclone aux anneaux ne cessant d'enfler, autant en nous que dans ce qui nous environne. Devenir – à l'instar des tricksters – un et plusieurs, tout comme les agents du système, et en sur-vivre... Résister et inverser le processus de globalisation, voilà un travail augustéen, voilà une raison de tisser des synergies, des synergies européennes...

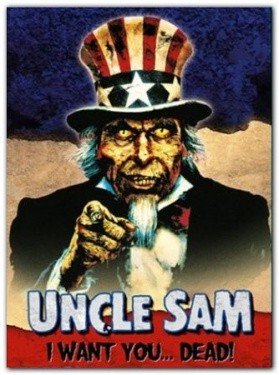 « L'empire [entendu ici comme projet mondialiste] contemporain n'est pas un faible écho des impérialismes modernes, mais une forme fondamentalement nouvelle de domination. L'empire a coupé le cordon ombilical qui le reliait à l'État-nation et n'est plus délimité par un territoire, même si la Fédération américaine et son complexe militaro-industriel s'avèrent être le laboratoire et l'instrument majeure de cette nouvelle domination : dépourvu de centre politique, le nouvel imperium global devient l'expression d'un ensemble géométrique de rapports de pouvoir et de domination créés par les marchés mondialisés à tous les niveaux de la vie sociale. En contraste avec les systèmes de domination verticaux et concentrés des anciens empires européens, le pouvoir, dans la nouvelle configuration mondialisée, est diffus, déconcentré et horizontal. Ce phénomène, à son tour, conduit à de nouvelles formes transnationales de résistance de la part des réseaux décentralisés : les multitudes. L'empire ainsi défini devient un royaume mondial sans limites et sans nom. » M. Hardt & A. Negri, Empire, éd. Exils, 2000. L'impérialisme défini en termes de réseaux rend certes compte des effets de l'autonomisation de la finance depuis les années 80 mais minimise leur intrication avec les territoires, not. en informant l'arsenal juridique. En omettant la dimension historique et politique du droit, l'anticapitalisme ne laisse que le rêve d'une monade insaissisable, celle qui s'imagine un empire dans l'empire...
« L'empire [entendu ici comme projet mondialiste] contemporain n'est pas un faible écho des impérialismes modernes, mais une forme fondamentalement nouvelle de domination. L'empire a coupé le cordon ombilical qui le reliait à l'État-nation et n'est plus délimité par un territoire, même si la Fédération américaine et son complexe militaro-industriel s'avèrent être le laboratoire et l'instrument majeure de cette nouvelle domination : dépourvu de centre politique, le nouvel imperium global devient l'expression d'un ensemble géométrique de rapports de pouvoir et de domination créés par les marchés mondialisés à tous les niveaux de la vie sociale. En contraste avec les systèmes de domination verticaux et concentrés des anciens empires européens, le pouvoir, dans la nouvelle configuration mondialisée, est diffus, déconcentré et horizontal. Ce phénomène, à son tour, conduit à de nouvelles formes transnationales de résistance de la part des réseaux décentralisés : les multitudes. L'empire ainsi défini devient un royaume mondial sans limites et sans nom. » M. Hardt & A. Negri, Empire, éd. Exils, 2000. L'impérialisme défini en termes de réseaux rend certes compte des effets de l'autonomisation de la finance depuis les années 80 mais minimise leur intrication avec les territoires, not. en informant l'arsenal juridique. En omettant la dimension historique et politique du droit, l'anticapitalisme ne laisse que le rêve d'une monade insaissisable, celle qui s'imagine un empire dans l'empire...

Globalisation, “superclasse” et mercenaires “éditocrates”
 Il y a bien longtemps — quasiment depuis que le monde est monde — qu’une catégorie de rêveurs songe à établir, en pensée d’abord, en actes ensuite, une “utopie planétaire”, un monde tout à fait idéal, parfait, générant le bonheur sans discontinuité aucune. Armand Mattelart nous a brillamment esquissé la progression de cette idée dans un ouvrage concis et didactique : de Thomas More à la Civitas christiana, du système de la paix perpétuelle à l’idéal du « genre humain » d’Anarcharis Cloots, de la religion de l’humanité d’Auguste Comte aux projets socialistes et communistes de la fin du XIXe siècle, du système wilsonien/rooseveltien des Nations Unies à la modernité managériale et aux inforoutes qui ouvrent tout à tous, l’histoire de la pensée et des hommes a été balisée de projets similaires.
Il y a bien longtemps — quasiment depuis que le monde est monde — qu’une catégorie de rêveurs songe à établir, en pensée d’abord, en actes ensuite, une “utopie planétaire”, un monde tout à fait idéal, parfait, générant le bonheur sans discontinuité aucune. Armand Mattelart nous a brillamment esquissé la progression de cette idée dans un ouvrage concis et didactique : de Thomas More à la Civitas christiana, du système de la paix perpétuelle à l’idéal du « genre humain » d’Anarcharis Cloots, de la religion de l’humanité d’Auguste Comte aux projets socialistes et communistes de la fin du XIXe siècle, du système wilsonien/rooseveltien des Nations Unies à la modernité managériale et aux inforoutes qui ouvrent tout à tous, l’histoire de la pensée et des hommes a été balisée de projets similaires.
Nous vivons aujourd’hui l’aboutissement de ces rêves et force est de constater que les utopistes ne nous ont nullement mitonné un monde meilleur, plus gai à vivre, plus soucieux de réaliser les aspirations simples et profondes des hommes, plus juste ou plus “démocratique” ; leurs adversaires intellectuels, les “dystopistes” (de Zamiatine à Orwell et à Burgess) ont été des prophètes bien plus pertinents, des penseurs autrement plus profonds, des séismographes nettement plus subtils.
Le talon d’acier de l’idéologie globaliste se fait sentir surtout depuis l’effondrement du système soviétique, depuis la chute du Mur de Berlin. Nous avons tous été de gros naïfs, avouons-le, pendant les années d’euphorie, à partir de 1984, où Gorbatchev annonçait sa perestroïka et sa glasnost, jusqu’à 1989, lorsque les Hongrois ont démantelé le Rideau de Fer le long de la frontière autrichienne puis lorsque le Mur de Berlin a été ouvert par les Vopos, chargés auparavant de mitrailler tous ceux qui voulaient passer à l’Ouest. Quinze petits mois d’espoir ont encore suivi cette euphorie, avec, pour péripétie marquante, le simulacre de putsch qui a amené Eltsine au pouvoir, qui livrera la Russie à ceux qui entendaient depuis toujours la détruire.
Enfin, juste après ce putsch de sotie, il y eut la Guerre contre Saddam, le vainqueur arabe des Perses avec l’appui occidental, devenu croquemitaine en un simple tour de bras médiatique ; cette guerre remettait les pendules à l’heure voulue par Washington : pas de puissance régionale capable d’autonomie en zone d’hydocarbures. La rente pétrolière irakienne était utilisée pour le développement intérieur du pays, pour la constitution d’une armée régionale solide, ensuite elle était répartie entre un éventail diversifié de fournisseurs extérieurs, russes, européens et japonais. Comme en Libye, mutatis mutandis…
Ce genre de diversification, qui évite la dépendance à l’endroit d’un fournisseur unique ou trop important, avait été théorisée jadis par le Président des Seychelles. Cette pratique intelligente et commode est un scandale pour la superclasse au pouvoir : toutes les mannes pétrolières doivent confluer vers les seuls bassins de réception qu’elle contrôle. À la même époque, l’affirmation de l’Europe, enfin réunifiée après la chute du Rideau de Fer, n’a donc pas duré fort longtemps : les promesses de l’Acte unique n’ont pas été réalisées ou ne l’ont été que dans leurs aspects les plus désagréables et les plus mesquins, rendant l’idée européenne imbuvable pour beaucoup de nos concitoyens. La montée en puissance de l’Asie, réellement perceptible à l’aube des années 90, a été freinée par la crise de 1997. L’implosion yougoslave a démontré que l’Europe de Bruxelles et de Strasbourg n’avait aucun poids militaire ou diplomatique. Il y a donc exactement 20 ans que l’Europe montre, à la face du monde, qu’elle n’est qu’un gros pantin inerte, malgré sa réunification.
Pourquoi cette faiblesse ? Le ver était dans le fruit, bien avant novembre 1989. Depuis l’avènement de Thatcher en Grande-Bretagne, le néolibéralisme — nouvelle idéologie mondialiste bien plus efficace que le communisme “spectaculaire” de mouture soviétique ou maoïste pour faire advenir les utopies et les rêvasseries “planétaristes” — marque des points au sein même d’une grande puissance nucléaire, dotée d’un droit de veto à l’ONU : n’oublions pas que ce néolibéralisme anglais 1) inaugure, à Londres, le projet général de démantèlement de toutes les structures étatiques, 2) lance la pratique des délocalisations, notamment en permettant à des entreprises japonaises d’installer des usines de montage en Écosse, où les ouvriers bénéficiaient peu ou prou des mêmes couvertures sociales que les Philippins, et 3) favorise la spéculation au détriment des investissements infrastructurels que pratiquaient les capitalismes plus patrimoniaux, ceux relevant du « modèle rhénan », selon la terminologie utilisée par Michel Albert.
Car le mondialisme actuel, baptisé “globalisation”, c’est tout cela in nuce. Les structures étatiques, produites par des continuités historiques localisées, portées par des peuples précis, sont balayées au nom du profit immédiat, comme elles auraient été balayés avec le même zèle par une sorte de communisme agissant au nom du progrès ou par des fondamentalistes estimant que les syncrétismes et les réalisations impériales/politiques sont autant d’hérésies, de trahisons de la “parole initiale”. Pour les tenants actuels de la veine utopique, désormais néolibéralisée, le progrès, c’est la dissolution de toutes les barrières politiques, géographiques et physiques et la disparition de tout ce qui recèle un résidu de « patrimonialité ». On ne peut plus qualifier cette démarche d’économie, de “nomos” d’un “oïkos”, de la gestion d’un lieu, mais c’est tout simplement la négation même de l’économie, c’est de l’anti-économie, puisqu’il n’y a plus de gestion, donc de régulation, qui soit considérée comme licite, et plus de “lieu” que l’on puisse gérer en particulier, sans être automatiquement accusé de “repli identitaire” (donc de paléocommunisme stalinien ou de fascisme).
L’entreprise thatchérienne, dans les années 80, était encore jugée comme une spécificité britannique, une originalité d’insulaires. L’Europe continentale, croyait-on, demeurerait immunisée contre cette rechute dans la “manchestérite”, d’où le vigoureux plaidoyer de Michel Albert pour le « capitalisme patrimonial et rhénan ». La construction européenne allait s’effectuer, pensait-on, selon des règles continentales/socialistes, selon les axes préconisés, entre autres, par le fameux Plan Delors : investissement dans des infrastructures, lutte contre le chômage par la mise au travail d’une vaste main-d’œuvre, etc.
Rien de cela n’est advenu ou n’advient que par à-coups, dans le désordre de politiques décidées sur fond de contradictions et de ressacs erratiques, dus aux changements réguliers de majorités, empêchant toute continuité décisionnelle. Les gauches, ou les formes diverses d’étatisme constructif, se sont avérées incapables de résister à la marée néolibérale. Tous les efforts de théorisation d’une alternative solide aux formes vermoulues du socialisme keynésien et au néolibéralisme thatchérien, entrepris par des cénacles aussi divers que les régulationnistes, les schumpéteriens, les anti-utilitaristes du MAUSS ou les collaborateurs des éditions La Découverte (ex-Maspero), n’ont rien donné sur le plan politique. La superclasse veillait. Quelle est-elle ?
Le terme a été forgé récemment par David Rothkopf, journaliste américain couvrant les rencontres de Davos et d’autres lieux : cette superclasse est celle qui domine à l’ère idéologique du néolibéralisme. Il n’est pas aisé de la définir : elle comporte évidemment les managers des grandes entreprises mondiales, les directeurs des grandes banques, des cheiks du pétrole ou des décideurs politiques (essentiellement américains tels Kissinger et Brzezinski) voire quelques vedettes du cinéma ou de la littérature (comme le Brésilien Coelho, selon Rothkopf) ou encore, en coulisses, des leaders religieux et des narcotrafiquants, qui alimentent le secteur bancaire en argent sale. Cette superclasse n’est pas stable : on y appartient pendant quelques années ou pendant une ou deux décennies puis on en sort, avec, le plus souvent, un bon “parachute doré”. Il faut ajouter qu’elle est numériquement faible : selon Rothkopf, la superclasse compterait environ 6.000 personnes sur notre planète, dont un ou deux milliers fréquenteraient assidument les assemblées de Davos ou d’ailleurs.
Le nombre très modeste des ressortissants de cette superclasse renverse la perspective classique des théories élitistes, écrit Rothkopf, telles qu’elles ont été énoncées par Vilfredo Pareto. Celui-ci avait bâti sa théorie de la circulation des élites sur un schéma masse/élite de 80% / 20%. L’élite, jadis forte de plus ou moins 20% d’une population donnée, était biologiquement enchevêtrée dans la masse. Désormais, numériquement insignifiante mais bien plus puissante que les anciennes aristocraties ou partitocraties, elle est totalement coupée des masses, dont elle détermine le destin. En dépit de tous les discours démocratiques, qui annoncent à cors et à cris l’avènement d’une liberté et d’une équité inégalées, le poids politique/économique des masses, ou des peuples, n’a jamais été aussi réduit. Son projet “globalitaire” ne peut donc pas recevoir le label de “démocratique”.
L’érosion de l’État, machine encadrée par des élites plus ou moins imbriquées dans le peuple souverain, a fait émerger, sur la scène, de nouvelles formes d’organisation sociale, auparavant marginalisées ou tenues sévèrement à l’écart de toute décision ou de toute initiative : les diasporas, les réseaux terroristes de mouture religieuse/fondamentaliste, les narcotrafiquants et les réseaux polycriminels, tous liés plus ou moins secrètement à la superclasse. En effet, l’État colmatait les brèches, où ces formes sociales auraient pu éventuellement s’engouffrer.
Le néolibéralisme a ouvert des interstices, devenus autant de niches où s’épanouissent ces formes floues, secrètes, agissant plus ou moins dans l’ombre, plus ou moins en pleine clarté. Diasporas et réseaux fonctionnent au profit de l’hypermobilité économique inaugurée par le néolibéralisme : ils n’ont aucun intérêt à voir réapparaître des structures étatiques et politiques fortes, qui mettraient rapidement un terme à leurs agissements. Ils sont donc les alliés bénis de la “superclasse” pour perpétrer certaines formes de guerre asymétrique au sein des États récalcitrants. La superclasse peut faire appel à ces formes sociales nichées dans les interstices ouverts par le déclin de l’État. Si celui-ci réagit de manière musclée, il se voit aussitôt diabolisé par l’orchestre médiatique aux ordres.
Les diabolisations perpétrées par les médias officiels constituent, elles aussi, une forme de “guerre sans espace”, définie notamment par le politologue allemand, disciple de Carl Schmitt, Rüdiger Voigt. Jadis, les médias étaient des institutions étatiques, à vocation didactique : ils informaient le peuple de la politique suivie par les dirigeants qu’il avait élus ou plébiscités. Les privatisations dans la sphère médiatique, effet pratique du néolibéralisme, ont permis l’intrusion de propagandes étrangères ou de propagandes insidieuses dans le corps populaire et parmi les gestionnaires légitimes de l’État, désorientant complètement les esprits, un peu comme le préconisait Sun Tzu à une époque où il n’y avait pas de mass-médias.
Dans l’espace linguistique francophone, ce travail insidieux d’amener une propagande étrangère, à la teneur totalement différente des idéologies en place en France, a été l’œuvre des “nouveaux philosophes”. Ceux-ci ont réussi à diaboliser toutes les idéologies considérées à tort ou à raison comme “françaises” : le communisme (à connotations parfois nationales), le gaullisme (comme synthèse réalisée autour de la personnalité d’un général posé comme vainqueur et libérateur du pays), le personnalisme (très présent dans les médias et agissant souvent comme passerelle entre gaullistes et communistes). En procédant à ce travail de dénigrement en le travestissant comme une continuité logique de la révolte de 68, immédiatement après l’élimination puis le décès de De Gaulle, la “nouvelle philosophie” s’est donné un visage “branché”, inattaquable parce qu’en l’attaquant on aurait égratigné la belle promesse d’émancipation de 68. Mais subtilement, derrière tout un dispositif intellectuel évoquant la perversité des maîtres penseurs (Hegel, Marx, Nietzsche) et sollicitant abusivement l’œuvre de Soljénitsyne, l’équipe de la “nouvelle philosophie” préparait ce que Bensadoun et Jumel appellent le « compromis historique ».
De quoi s’agit-il ? Les pseudo-révolutionnaires de mai 68 sont arrivés au pouvoir, deux décennies après les événements du quartier latin, après une bonne douzaine d’années de propagande “néophilosophique”. L’idéal de leurs jeunes années était le “socialisme autogestionnaire”. Ce n’est pas cet idéal-là qu’ils mettront en pratique. Pendant les années de leur traversée du désert, les hommes de cette génération feront ce que Bensadoun et Jumel nomment un « compromis historique » qui repose, expliquent-ils, sur :
- 1) un abandon du corpus gauchiste, libertaire et émancipateur, au profit des thèses néolibérales,
- 2) une instrumentalisation de l’idée freudo-sartrienne de la “culpabilité” des peuples européens, responsables de toutes les horreurs commises dans l’histoire (et qui ose dire que les Européens n’ont pas été des criminels tout au long de leur existence en tant que peuple, nie le mal et attaque le bien, se posant comme véritable suppôt du Malin, donc comme un être qu’il faut faire taire et empêcher de nuire)
- 3) sur un pari pour toutes les démarches “mondialisatrices”, même émanant d’instances capitalistes non légitimées démocratiquement ou d’institutions comme la Commission Européenne, championne de la “néolibéralisation” de l’Europe, dont le pouvoir n’est jamais sanctionné par une élection.
Ce « compromis historique », favorisé par la “nouvelle philosophie” dans l’espace médiatique (cf. supra), démontre que les utopistes soixante-huitards, abreuvés par les utopies antérieures de Fourier à Owen en passant par Marx et les freudo-marxistes à la Reich, ne croient pas réellement aux beaux aspects de cet utopisme classique : ils cherchent simplement un instrument commode pour arriver au pouvoir, l’angélisme étant ici substance “vaselineuse” pour mieux faire passer le schmilblick. Ils ne parient plus sur le peuple mais sur d’autres figures sociales, tels le bon banquier débonnaire et philanthrope (Attali) ou l’entrepreneur dynamique et génial (concept fourre-tout destiné à critiquer les figures de l’État, principalement le fonctionnariat).
La globalisation, et partant le néolibéralisme, ne peuvent fonctionner que s’il y a pour arrière-plan idéologique cette idée permanente de “culpabilité” : refuser, comme nous le faisons, le stigmate de cette culpabilité est donc l’indice d’une volonté de résistance et aussi d’une fidélité à un sain réalisme politique. Le discours enflé de nos ex-soixante-huitards sur la « démocratie » n’est qu’un leurre, puisque le compromis historique s’empresse de soutenir les décisions de toutes les instances qui n’ont aucune légitimité démocratique : on est loin de l’autogestion initialement chantée et promise. L’attitude récente de Daniel Cohn-Bendit et de Joschka Fischer le prouve une fois de plus, face à l’intervention occidentale en Libye, où les 2 compères ont appelés à la guerre, en même temps que l’ancien chantre du thatchérisme en Belgique, le leader de l’ex-gouvernement “arc-en-ciel”, Guy Verhofstadt. Gauchisme salace et violent, néolibéralisme passé de droite à gauche ne sont que pantomimes orwelliennes : visages de bon apôtre pacifiste, charriée par les médias, mais gueules tordues de haine, de bellicistes à tous crins, quand les maîtres l’ordonnent.
Aujourd’hui, l’équipe première de la “nouvelle philosophie”, agent d’influence du néolibéralisme globalisateur en France, s’est étoffée, si bien que l’on peut parler, avec Mona Chollet, Olivier Cyran, Sébastien Fontenelle et Mathias Reymond, d’ « éditocrates », ceux « qui parlent de (presque) tout en racontant (vraiment) n’importe quoi ». En récusant formellement les barrières géographiques et politiques, on rejette toute balise, et, sans balises, on peut effectivement raconter “n’importe quoi”. Parmi ces éditocrates : Alain Duhamel, Bernard-Henri Lévy, Christophe Barbier, Jacques Attali, Alexandre Adler, Laurent Joffrin et quelques autres.
La globalisation et sa superclasse ont donc des mercenaires, insérés dans les fameux “interstices”, dans les lézardes que présente désormais en tous lieux l’Etat national pantelant. Ces mercenaires mènent une “guerre asymétrique” particulière, et particulièrement pernicieuse, celle que Voigt appelle la « guerre des mots » et la « guerre des images », qui vise à faire triompher un impérialisme qui n’est plus nécessairement un « impérialisme spatial » mais un « impérialisme des flux » ou un « impérialisme fluide », dans la mesure où la puissance dominante, celle sur laquelle la superclasse compte pour agencer le monde à sa guise, est une thalassocratie et non une tellurocratie, que son modèle implicite est celui de la piraterie (forme non morale que l’on imite en “moralisant” outrancièrement son discours justificateur pour donner le change) et non celui du géomètre romain.
Carl Schmitt, dans son Glossarium, le volume qu’il a laissé à la postérité en demandant qu’on le publie dix ans après sa mort, annonçait et déplorait l’avènement d’un monde « fluide », résultat de la victoire incontestable de la thalassocratie américaine sur l’Europe, du Léviathan sur le Béhémoth, où le pseudo-Béhémoth soviétique, successeur à son corps défendant du Béhémoth allemand, n’a été, finalement, qu’un Béhémoth de guignol, incapable de parfaire sa tâche de Katechon, de barrage contre les affres de la décadence. La “guerre asymétrique”, menée contre les peuples par la superclasse, par “nouveaux philosophes” ou “éditocrates” interposés, sanctionne, selon Bensadoun et Jumel, un « partage des rôles » : aux États-Unis, la puissance ; à l’Europe, la faiblesse.
Nous ne pouvons accepter la faiblesse pour nous-mêmes, et pour ceux qui nous suivront. Donc, il est parfaitement logique de combattre ceux qui veulent nous imposer un statut pérenne de faiblesse, une faiblesse entretenue comme les ribauds de la vieille Rome entretenaient les plaies de leurs enfants pour susciter la pitié des chalands. La superclasse veut pérenniser cette faiblesse. Pour y parvenir, elle fait usage d’instruments médiatiques, éditocratiques, intellocratiques, etc., dans une “guerre asymétrique”, non déclarée mais menée avec obstination contre notre civilisation, que l’on culpabilise sans arrêt. Il faut donc combattre sans relâche le message véhiculé par ces instruments. Et par d’autres instruments : n’apprend-on pas que l’ambassadeur des États-Unis en poste à Paris, Jeremy Rivkin, formule le projet de manipuler les diasporas des banlieues françaises, à toutes fins utiles, si d’aventure un néo-gaullisme, un populisme de droite ou de gauche, entendaient rétablir une politique traditionnelle de défense du “Bien commun” d’aristotélicienne mémoire. Recep Tayyib Erdogan, et son ministre des affaires étrangères Davutoglu, le néo-ottoman, menacent de faire agir les réseaux mafieux turcs en cas de raidissement européen dans le dossier de l’adhésion turque, de la question des droits de l’homme en Turquie, du génocide arménien ou de l’occupation de Chypre.
On le voit : nous sommes en pleine guerre asymétrique. Depuis leurs retranchements dans les niches “intersticielles” de nos États en lambeaux, les commandos de tous poils, encouragés par la superclasse, sont présents, actifs ou dormants, pour nous maintenir en état de faiblesse pérenne. L’ennemi, jamais désigné par une classe politicienne et non plus politique, totalement déboussolée, prend de multiples visages, outre celui, évident, du bankster ou de l’entrepreneur renégat et délocalisateur : éditocrates, bandes banlieusardes, narcotrafiquants, mafieux anatoliens, illuminés prêts à croire à tous les boniments d’un discours médiatique totalement fabriqué, sans référence à un réel substantiel.
Cet ennemi, nous, nous le connaissons, et, premier acte de résistance, nous refusons de l’écouter. Également quand certains de ces éditocrates prônent de fausses “guerres justes”, contre la Serbie ou la Libye, en bénissant les guerres sans formes que mène la superclasse contre des récalcitrants de tous ordres, avec ses instruments privilégiés que sont l’US Army et l’OTAN. Le refus d’écouter, s’il se généralise en même temps que témoignages et prêches de réfutation, fera que la gouvernance mondialiste sera et restera introuvable. Et que seule notre tradition réellement politique, que notre tradition de géomètres romains, peut apporter de la véritable gouvernance. Il faut œuvrer pour qu’advienne un monde selon les vœux de ce bon vieux Carl Schmitt. Alors, du haut de son paradis catholique, rhénan et baroque, une grosse larme de joie, salée et lourde, coulera sur sa joue. Il l’aura bien méritée.
► Robert Steuckers (Forest/Flotzenberg, avril 2011), Réfléchir & Agir n°38, été 2011.
♦ Bibliographie :
- Roger BENSADOUN & Philippe JUMEL, Le compromis historique – La génération de 1968 au service de la mondialisation, Bruno Leprince éd., paris, 2003.
- Chantal BORDES-BENAYOUN & Dominique SCHNAPPER, Diasporas et nations, Odile Jacob, 2006.
- Mona CHOLLET, Olivier CYRAN, Sébastien FONTENELLE & Mathias REYMOND, Les éditocrates ou comment parler de (presque) tout en racontant (vraiment) n’importe quoi, La Découverte, 2009 (édition de poche : coll. « Pocket », n°14.516, oct. 2010).
- Daniel HILDEBRAND, « Imperialismus der Ströme statt Inperialismus der Räume ? überlegungen zum Bedeutungswandel der Raumdimension imperialer Herrschaft », in : Rüdiger VOIGT, Grossraum-denken – Carl Schmitts Kategorie der Grossraumordnung, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2008, pp. 207-217.
- Maxime LEFEBVRE, Dan ROTENBERG, avec la participation de Pascal GAUCHON, La genèse du nouvel ordre mondial, Ellipses, 1992.
- Armand MATTELART, Histoire de l’utopie planétaire – De la cité prophétique à la société globale, La Découverte/Poche n°98, 2009.
- Bernard RAQUIN, Les grandes manipulations des temps modernes, Trajectoire, Paris, 2005.
- David ROTHKOPF, De superklasse – Het onzichtbare netwerk van een wereldwijde machtselite, Balans, Amsterdam, 2008.
- Rüdiger VOIGT, Krieg ohne Raum – Asymmetrische Konflikte in einer entgrenzten Welt, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2008.
♦ Revues à consulter :
- Diplomatie – Hors série n°11, avril-mai 2010 (Géopolitique mondiale de la drogue).
- Questions internationales n°43, mai-juin 2010 (Mondialisation : une gouvernance introuvable).
- Géopolitique n°110, juillet 2010 (Histoire de la mondialisation).

Globalisation, néo-libéralisme et “homme flexible”
Les analyses du sociologue américain Richard Sennett
 La globalisation exige la flexibilité. La notion des Le besoin “flexibilité” est aussi le terme magique dont raffole l’économie néo-libérale, qui salue le processus de globalisation comme un défi positif. Cette notion de “flexibilité” est issue, au départ, de l’empirisme des naturalistes : on tire profit de l’expérience, par ex., en constatant que les arbres ploient sous la force du vent mais qu’après la tempête ils reprennent leur forme originale. La “flexibilité” est non seulement posée comme l’antonyme du “fixisme”, de la “rigidité” ou de l’absence de vitalité, mais, dans le cadre de l’idéologie néo-libérale, comme le synonyme de la “liberté” ; dans ce sens, la flexibilité apporte de nouveaux défis, de nouvelles exigences, de nouveaux boulots qui exigent des déménagements fréquents et des délocalisations : l’homme flexible devient ainsi un perpetuum mobile au sein de l’économie globale. Tout perpetuum mobile est une construction qui, une fois mise en marche, demeure éternellement en mouvement, ce qui, d’après les lois fondamentales de la thermodynamique, est une impossibilité.
La globalisation exige la flexibilité. La notion des Le besoin “flexibilité” est aussi le terme magique dont raffole l’économie néo-libérale, qui salue le processus de globalisation comme un défi positif. Cette notion de “flexibilité” est issue, au départ, de l’empirisme des naturalistes : on tire profit de l’expérience, par ex., en constatant que les arbres ploient sous la force du vent mais qu’après la tempête ils reprennent leur forme originale. La “flexibilité” est non seulement posée comme l’antonyme du “fixisme”, de la “rigidité” ou de l’absence de vitalité, mais, dans le cadre de l’idéologie néo-libérale, comme le synonyme de la “liberté” ; dans ce sens, la flexibilité apporte de nouveaux défis, de nouvelles exigences, de nouveaux boulots qui exigent des déménagements fréquents et des délocalisations : l’homme flexible devient ainsi un perpetuum mobile au sein de l’économie globale. Tout perpetuum mobile est une construction qui, une fois mise en marche, demeure éternellement en mouvement, ce qui, d’après les lois fondamentales de la thermodynamique, est une impossibilité.
Le grand sociologue américain contemporain, critique des fondements de notre culture libérale, Richard Sennett, défend la thèse que cet artifice qu’est l’homme flexible ne peut survivre biologiquement sur le long terme. Pour Sennett, les questions fondamentales qui s’adressent aujourd’hui à l’économie politique et à la science politique sont les suivantes :
- 1) dans quelle mesure peut-on permettre au système économique de plier, ployer et tordre littéralement l’homme, pour satisfaire ses besoins d’expansion ?
- 2) l’État a-t-il le droit de « donner aux hommes, à ses citoyens, cette flexibilité propre aux arbres, de façon à ce qu’ils ne se brisent pas, du moins en théorie, face aux coups permanents que lui assènent les changements imposés par la nouvelle économie néo-libérale et globaliste » ?
Sennett ne voit pas du tout comment s’ouvriraient les portes de la liberté si les hommes deviennent flexibles comme le veut l’économie globalitaire. Bien au contraire : l’homme flexible ne sera ni libre ni plus libre mais basculera dans l’impuissance à maîtriser et gérer son destin. Dans un contexte existentiel, dominé par l’économique, on exige sans cesse de faire face à de la nouveauté et à des changements, ce qui rend impossibles les liens sur le long terme : « La profession, le lieu de résidence, la position sociale, la famille, tout est désormais soumis aux exigences hasardeuses de la vie économique ; la vie personnelle de l’individu soumis à de telles pressions apparaît comme une mosaïque éparse et sans cohérence, dépourvue de but et incompréhensible, insaisissable. Le résultat n’est donc pas un surcroît de liberté, mais un sentiment profond d’impuissance, d’isolement et de perte de sens », écrit Sennett.
L’économie à l’ère de la globalisation est marquée par le court terme. Ce court terme exige de l’homme flexible d’être toujours prêt à changer, si besoin s’en faut, de travail, de cadre de travail, d’emploi et de domicile. Ce court terme est contraire, dit Sennett, à l’essence de l’être humain, car la constitution ontologique et psychologique de l’homme repose sur la longue durée, sur la sécurité que celle-ci procure, sur la continuité de mêmes modèles. La thèse centrale de Sennett est dès lors la suivante : la “flexibilisation” du monde du travail détruit l’homme en ses fondements ontologiques : des valeurs comme la fidélité et la responsabilité perdent automatiquement leur sens et leur signification, en même temps que toute éthique du travail ; des vertus comme la faculté de renoncer à la satisfaction immédiate des besoins au profit d’objectifs sur le long terme, disparaît.
Remarquons que Sennett insiste toujours pour dire que la tradition politique de sa famille, du moins depuis ses grands parents, s’ancre dans les réseaux de la gauche américaine. En dépit des évolutions ou involutions des gauches aujourd’hui, not. en Europe, Sennett demeure fidèle à des valeurs comme la fidélité, la loyauté, la confiance, l’esprit de décision et surtout à celles de la famille et de la communauté.
Richard Sennett est né en 1943 à Chicago. Il a passé sa jeunesse dans les quartiers pauvres de la ville. Après avoir obtenu son diplôme en 1964, Sennett a œuvré à Harvard, à Yale, à Rome et à Washington. Aujourd’hui, Sennett vit à Londres et enseigne la sociologie et l’histoire à la célèbre London School of Economics. Il a acquis la célébrité grâce à plusieurs ouvrages comme La tyrannie de l’intimité, L’homme flexible et La culture du nouveau capitalisme, tous traduits en allemand de 1986 à 2005.
Dans ses livres, ce sociologue désormais célèbre participe aux grands débats sur les effets de l’économie globale sur nos sociétés. Avec un courage étonnant, il défend des idées jugées totalement inactuelles, qui ont pourtant fait de ses livres des best-sellers à l’échelle planétaire et lui ont conféré une notoriété internationale. Sennett critique en effet les involutions de nos sociétés telles l’isolement progressif des individus, la perte de toute orientation dans la jungle sociale et l’impuissance de l’homme contemporain ; de même, il ne ménage pas ses critiques sur la superficialité et l’instabilité des relations interpersonnelles qui ne cessent de croître. Il défend des valeurs telles la fidélité, le sens du devoir, le sens du but à atteindre dans la vie et l’esprit de décision ; ce sont là toutes des valeurs qui postulent que l’homme conserve son caractère naturel qui lui permet d’envisager calmement la longue durée. Sennett perçoit bien la contradiction dans laquelle le « capitalisme de la flexibilité » plonge l’homme des temps présents :
« Comment peut-on protéger les relations familiales contre ces comportements basés sur le court terme, contre cette rage de toujours tout remettre en question et surtout contre ce manque chronique de loyauté et de sens communautaire, qui caractérisent le monde actuel du travail ? ».
Le « visage caméléonique » de l’économie parie aujourd’hui sur les seules capacités de l’homme à s’adapter : dans ce cas, une valeur comme la loyauté peut devenir un piège et freiner l’adaptation exigée. Le monde du travail promeut la « force qui réside dans la faiblesse des liens sociaux » et « les formes éphémères » de communauté. « Si l’on transpose cela sur la famille, cela signifie, dans une société entièrement vouée à la flexibilité : reste en mouvement, ne te lie pas et ne fais aucun sacrifice ». Sennett estime qu’une telle évolution de nos sociétés est totalement erronée, constitue une menace pour le genre humain et nous interpelle en ce sens :
« Comment peut-on viser des objectifs à long terme dans une société fixée exclusivement sur le court terme ? Comment pourra-t-on maintenir des liens sociaux sur la longue durée ? Comment un être humain dans une telle société, qui ne se compose plus que d’épisodes et de fragments épars et diffus, pourra-t-il opérer une synthèse de son existence, raconter en un récit cohérent son identité et sa vie personnelle ? ».
Sennett contre également l’opinion largement répandue qui veut que les États-Unis soient une « démocratie de consommateurs ». À rebours de cette idée toute faite, Sennett défend la thèse que les citoyens américains sont désormais complètement désorientés face aux différences réelles qui divisent leur société. Les Américains sont tellement obsédés par l’individualisme qu’ils considèrent, souvent inconsciemment, que les masses ne méritent aucun intérêt en tant qu’ensembles humains. Pour cette raison, il est important aux États-Unis de se poser comme détaché des masses ou des collectivités, de s’élever au-dessus d’elles : « Le besoin de statut s’exprime d’une manière très personnelle : on veut être respecté en tant qu’individu », écrit Sennett.
D’après lui, les Américains veulent que l’on juge leur position dans la société selon leur race ou leur ascendance, ce qui remplace souvent la conscience de classe qui subsiste en Europe. Critiquant les évolutions de la société américaine actuelle, Sennett dénonce la polarisation entre riches et pauvres qui ne cesse de croître aux États-Unis, alors que la classe moyenne s’amenuise de plus en plus, ce qui génère un sentiment général d’angoisse, de désorientation, d’instabilité et d’insécurité qui touche de vastes strates de la population. Face à ces phénomènes inquiétants, prospère une petite caste de profiteurs de la flexibilité, se hissant au-dessus d’une énorme masse de perdants.
Pour Sennett, Bill Gates, fondateur de Microsoft, constitue l’exemple paradigmatique d’un « boss de l’économie flexible » : bien que les produits de Microsoft soient, d’après Sennett, de « qualité moyenne », ils débouchent très rapidement sur le marché, pour disparaître aussi vite. Sennett cite une phrase significative de Bill Gates, pour stigmatiser son attitude face au travail : « Au lieu de s’immobiliser soi-même dans un travail aux contours bien délimités, … on devrait au contraire se mouvoir dans un réseau de possibilités ».
Cette volonté d’imposer une adaptabilité flexibiliste chez Bill Gates démontre surtout, selon Sennett, que le fondateur de Microsoft est prêt, si la situation l’exige, à détruire ce qu’il a créé. D’autres réflexions de Sennett méritent également le détour : not. celles qui concernent les systèmes d’éducation dans les pays industriels. Ces systèmes d’éducation, d’enseignement et de formation produisent un surnombre de travailleurs hautement qualifiés. Ceci nous conduit aux problèmes du chômage et du sous-emploi, où les victimes de ces effets pervers sont confrontées en permanence à un sentiment d’inutilité sociale.
Les conclusions de Sennett sont claires : les sociétés, dont les ressortissants sont majoritairement désorientés et doivent faire face à un trop grand sentiment d’inutilité sociale, et au sein desquelles des valeurs comme la confiance, la fiabilité, la fidélité, la loyauté et le sens de la responsabilité sont minées, brocardées et éradiquées en toute conscience, risquent, sur le long terme, de mettre leur existence même en péril.
► Brigitte Sob (article paru dans l’hebdomadaire viennois zur Zeit n°51-52/2007 ; tr. fr. : RS).

Désamorçons l’arme de la finance globaliste !
[Ci-contre : caricature de Frantisek Kupka, L’Assiette au Beurre, 1902]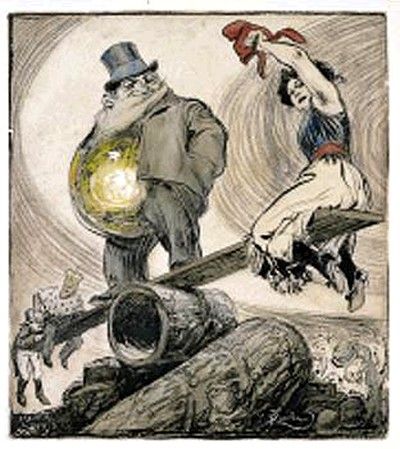 L’homme ne vit pas seulement de pain. Mais il en vit! La vieille sentence qui veut que l’économie soit notre destin devient d’autant plus valide lorsqu’une chancelière, tout en dilettantisme, se révèle personnellement comme une fatalité. L’économie s’avère souvent alambiquée, pour le commun des mortels, elle est constituée d’arcanes mystérieuses. Même les grands fiscalistes et capitaines d’industrie ne peuvent la gérer que très partiellement. Pourtant aucune personne dotée de rationalité n’ira jusqu’à dire que l’économie est aussi peu influençable que la météo ou le tirage des numéros du loto.
L’homme ne vit pas seulement de pain. Mais il en vit! La vieille sentence qui veut que l’économie soit notre destin devient d’autant plus valide lorsqu’une chancelière, tout en dilettantisme, se révèle personnellement comme une fatalité. L’économie s’avère souvent alambiquée, pour le commun des mortels, elle est constituée d’arcanes mystérieuses. Même les grands fiscalistes et capitaines d’industrie ne peuvent la gérer que très partiellement. Pourtant aucune personne dotée de rationalité n’ira jusqu’à dire que l’économie est aussi peu influençable que la météo ou le tirage des numéros du loto.
Le citoyen lambda ne peut certes pas intervenir dans le déroulement de l’économie avec autant de poids et de capitaux que l’investisseur américain George Soros mais, malgré cela, il peut agir sur l’économie, du moins de manière indirecte ou graduelle par son engagement politique. Les fanatiques du monde unifié sous l’égide du globalisme lui diront qu’il n’y a plus possibilité, aujourd’hui, de gérer des économies limitées à une seule nation, dotées d’une forte dose d’autonomie. Cette affirmation impavide nous est assénée à longueur de journées malgré que le processus de la globalisation s’avère nettement contradictoire et incohérent et n’a pas pu créer, et ne créera pas, un monde globalisé à 100%.
Les prédicateurs qui nous annoncent le paradis néo-libéral, où il n’y aura plus que du profit à l’horizon, font usage d’un vieux truc de démagogue: ils posent l’équation entre un fait (l’imbrication mondiale par la globalisation) avec une idéologie très douteuse (celle du globalisme). La méthode ressemble à celle utilisée par les néo-staliniens: ceux-ci partent de la nécessaire orientation de l’économie vers l’action sociale pour mélanger cette nécessité à leurs idées fixes qu’ils baptisent socialisme. De cette manière, toute critique à l’encontre de leurs utopies est jugée comme l’expression d’une “absence de cœur”.
À la base du globalisme se trouve une idée dépourvue de tout développement dialectique potentiel, une idée qui veut que des ensembles économiques de plus en plus grands et de plus en plus centralisés soient une valeur en soi, que tout doit absolument être exportable, importable ou achetable et qu’un gouvernement mondial tout-puissant constitue à terme l’objectif le plus élevé à atteindre. Dans les faits, selon les tenants de cette idéologie globaliste, les États nationaux démocratiques, et avec eux, la démocratie en soi, devraient être réduits à exercer les seules fonctions restantes, celles qui ne relèvent pas de l’économie et sont dès lors posées comme mineures ou subalternes, non génératrices de profits. Deux camps s’opposent: ceux qui, via l’eurocratie installée à Bruxelles, via Wall Street et la Banque Mondiale, veulent faire éponger par les peuples l’éclatement de la bulle spéculative; et ceux qui entendent organiser la résistance des nations et des autonomies humaines contre le pillage des hommes, des matières premières et de la biosphère. « Nous nous sommes approchés très très près d’une implosion totale et globale de la sphère financière » a déclaré Bernanke, chef de la banque d’émission américaine lors de la débâcle de Lehman-Brothers. Ou bien les États parviendront à désamorcer les bombes atomiques financières qui menacent de nous exploser au nez ou bien celles-ci nous éclateront à la figure lors des prochaines guerres économiques.
► Rolf STOLZ. (article paru dans Junge Freiheit n°26/2010).
Rolf Stolz fut l’un des co-fondateurs du mouvement des “Verts” allemands. Il vit aujourd’hui à Cologne et exerce le métier de journaliste libre de toute attache.

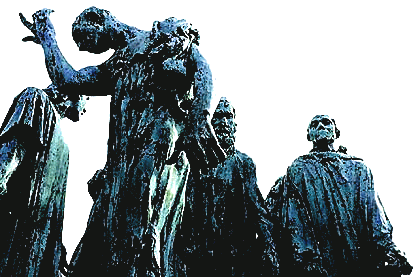 « L'homme se construit en temps de crise »
« L'homme se construit en temps de crise »
La crise n'est plus perçue comme un défi mais comme un état dans lequel l'homme s'installe pour ne pas avoir à le dépasser.
[Ci-contre : Les bourgeois de Calais, Auguste Rodin, 1895, parvis de l'hôtel de ville de Calais]
Il faut le dire haut et fort : cette époque n'est pas plus en crise que les époques antérieures. Ce n'est pas la crise qui est nouvelle : le monde est en crise depuis qu'il est monde. La crise est un facteur normal, nécessaire, indissociable de la vie. Perçue comme un défi, la crise active les énergies au lieu de les réduire comme elle active les initiatives au lieu de les neutraliser.
Or, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est une perception différente de la crise que l'homme ne semble plus envisager comme un défi mais comme une fatalité, un statu quo qui pèserait, inéluctablement, sur les affaires du monde. Il semble avoir désormais inverti les pôles de la dialectique : l'homme se définissait, hier, par rapport au défi que la crise lui posait. Autrement dit, l'homme se définissait par rapport aux bouleversements virtuels que provoquait son action sur la crise. L'homme se définissait par rapport au dépassement de la crise, donc par rapport au monde qui naîtrait après la crise.
Aujourd'hui, l'homme semble se définir, au contraire, par rapport à l'état de crise, c'est-à-dire qu'il paraît rechercher les moyens adéquats de s'installer dans la crise plutôt que de la maîtriser et de la dépasser. Hier, l'homme trouvait dans la crise la motivation de ses actions, la motivation de son engagement, la motivation de sa volonté de puissance et d'affirmation. On peut dire que la crise engageait le destin de l'homme dans la mesure où elle le forçait à ré-agir pour créer des valeurs d'où naîtrait un nouveau destin.
Aujourd'hui, l'homme semble trouver dans la crise la motivation de sa passivité, de son désengagement, de sa résignation. Là gît la nouveauté radicale qui rend cette crise si différente de toutes les autres. Mais ce qui a changé, également, c'est la nature et l'aboutissement de la crise : car pour la première fois, nous sommes entrés dans l'âge égalitaire systématisé à tous les échelons de la culture, sur tous les axes de la pensée, dans tous les hémisphères humains de ce monde.
Pour la première fois, le système égalitaire s'est planétarisé. Il menace désormais l'identité de tous les peuples de la terre. Dans le même temps, pour la première fois, la société sécurisante du dernier homme dont parlait Nietzsche a déclaré publiquement le risque hors-la-loi. On comprend donc que l'homme ne puisse plus trouver dans la crise que la matrice démente de tous ses défaitismes et de tous ses renoncements, de tous ses conformismes et de toutes ses lâchetés. Là, à n'en pas douter, sont les racines et les fondements de la société bourgeoise égalitaire qui abolit la puissance contre la sécurité, la raison contre la sensibilité, l'engagement — c'est-à-dire la foi — contre la planification — c'est-à-dire la loi.
Rien n'échappe à l'homme qui ne cesse d'y plonger ses racines
Et cependant, qui est à l'origine de ce renversement des valeurs, sinon l'homme lui-même ? Qui est à l'origine de cette résignation, sinon l'homme lui-même ? Qui est à l'origine de ce défaitisme, sinon l'homme lui-même ? Et d'où sont nés les problèmes, d'où est née la crise, sinon de l'homme lui-même ? Aussi longtemps que l'homme voudra bien croire au caractère inéluctable et incoercible de cette fatalité, il restera l'objet de la crise, impuissant à réenraciner son identité, incapable de tirer de ses appartenances organiques la force de battre l'universalisme. Aussi longtemps qu'il préférera la sécurité qui maintient au risque qui élève, la rationalité qui mécanise à la sensibilité qui dynamise, le conformisme qui égalitarise à l'engagement qui personnalise, il restera l'homme démobilisé mais exploité d'une société bourgeoise fondée sur l'utilitarisme, le consumérisme, la rentabilisation et le profit.
A contrario, il lui suffira de croire que cette fatalité n'en est plus une, que l'universalisme n'est pas irréversible, que le bourgeoisisme marchand n'est pas immuable pour retrouver la force de conjurer et de recréer ce qui n'a jamais, un seul instant, échappé à sa maîtrise et à sa mesure pour la bonne raison que rien n'échappe à l'homme qui ne cesse d'y plonger ses racines.
► Pierre Krebs, Vouloir n°45/46, 1988.


