Bergfleth
 Gerd Bergfleth : enfant terrible
Gerd Bergfleth : enfant terrible
de la scène philosophique allemande
Gerd Bergfleth : c'est le nom de l'enfant terrible de la “scène” philosophique allemande aujourd'hui. Il appartient à la tradition post-révolutionnaire, disent critiques et admirateurs. Dans le contexte allemand, cette désignation signifie la volonté de quitter le giron de l'École de Francfort, de dire adieu aux philosophies qui prétendaient représenter seules le moteur de “l'émancipation” et être détentrices exclusives de la Raison (Vernunft). Après l'effondrement du IIIe Reich, une partie des philosophes et professeurs émigrés d'avant 1940 était retournée en Allemagne. En gros, les représentants de l'empirisme logique et des philosophies connexes, et ceux de la Gestaltpsychologie, étaient demeurés dans les universités américaines et britanniques et y amorçaient une très brillante carrière. Les tenants de l'herméneutique de l'École de Francfort ne s'étaient jamais acclimatés dans le monde universitaire anglo-saxon. Laissés pour compte outre-atlantique, ils ne leur restaient qu'une solution : retourner en Allemagne et y régenter la philosophie médiatisée.
L'après-guerre allemand et surtout l'explosion soixante-huitarde ont de ce fait été dominés et déterminés par la philosophie “émancipatrice”, dont celle de Marcuse est devenue la plus populaire. Cette philosophie, que quelques simplistes ont résumé dans l'appellation “gauchiste”, partait d'un postulat dit “critique” qui visait à justifier l'action de ceux qui voulaient faire correspondre le monde réel à la raison idéale. De cet espoir a découlé un fétichisme de la raison et une néo-bigoterie stérilisante qui pourchassait toute trace de ce qu'elle appelait, dans le langage de la nouvelle inquisition qu'elle inaugurait, “l'irrationalisme”. Pour Bergfleth, cette volonté de traquer systématiquement l'irrationalisme appauvrissait la philosophie, lui ôtait sa dimension extra-rationnelle, lui subtilisait son fond mythique ou religieux, passionnel ou sensuel, érotique ou pathologique. Le fétichisme rationaliste de la troïka Horkheimer/Adorno/Habermas a conduit, affirme Bergfleth, la philosophie à l'impasse et l'a condamnée à la sclérose.
Bergfleth revêt dès lors une importance toute particulière dans l'histoire de la philosophie allemande, en ce sens qu'il ne retourne pas à l'irrationalisme allemand classique, celui qui, d'après Lukacs, avait conduit au “fascisme”, mais part en pèlerin à Paris pour y découvrir Georges Bataille, Jean Baudrillard et E.M. Cioran. Il fait là le chemin inverse des soixante-huitards français qui avaient, assez maladroitement et finalement sans grand succès, tenté d'adapter en France le culte de la Vernunft, chère à la troïka que nous venons de désigner. Bergfleth introduit ainsi la problématique de la postmodernité en Allemagne, avec les connotations moqueuses et persiflantes que lui a conférée Baudrillard. Pour les chiens de garde du fétichisme de la Raison, son travail constitue une véritable douche écossaise... !
Mais, discrètement, Bergfleth avait commencé son travail de sape en 1975, avec un essai sur Georges Bataille, le philosophe de la transgression par excellence, le surévaluateur du mal agissant dans l'histoire au détriment de la raison confortable, le théoricien du panérotisme qui se gausse des refuges du rationnel étriqué, etc. Avec un tel maître, Bergfleth pouvait partir à l'assaut de la forteresse des bigots “néo-chrétiens” qui jugulaient la pensée allemande et la mettaient au frigo. Quand il dialoguera avec Baudrillard à Tübingen en 1983 et interviewera Cioran en 1984, sa pensée accédera à une virulente maturité.
C'est alors que paraît son petit chef d'œuvre : Zur Kritik der palavernden Aufklärung. En français : Critique de la Raison palabrante. Anthologie, ce chef d'œuvre a le mérite d'être clair, limpide et agressif au bon sens du terme. Provocateur, il force l'adversaire à admettre les insuffisances de son discours. Pour Bergfleth, le culte de la raison ne génère, sur le plan politique, que la technocratie, au détriment de l'âme humaine, de la diversité intérieure de l'humain, réduites à néant, laminées par les prétentions d'une pensée petite, propre à des comptables misérabilistes sans envergure, qui n'ânonnent plus que leurs slogans éculés dans l'indifférence générale.
Bergfleth, dont l'ampleur du travail est encore modeste, jette toutefois les bases d'une rénovation. Il dresse le bilan d'un échec et annonce le retour d'un grouillement dionysiaque. D'une dissolution dans le ridicule des chimères “progressistes” qui végètent encore dans les cervelles de pas mal d'animateurs des médias. Les progressistes d'hier sont déjà les réactionnaires, les ringards, les fossiles d'aujourd'hui. Les dinosaures de demain. Des curiosités en voie de disparition...
► Robert Steuckers, Vouloir n°27, 1986.

◘ Notice biographique : Gerd Bergfleth, né en 1936 à Krumstedt au cœur des Dithmarschen, étudie de 1956 à 1964 la philosophie, les lettres anciennes et modernes à Kiel, Heidelberg et Tübingen, où il vit depuis 1971 comme écrivain et traducteur indépendant. Depuis 1975, il est éditeur (intellectuel) des essais et autres écrits théoriques ou articles de Georges Bataille en même temps que traducteur et commentateur dans les 9 volumes jusque là parus. Cette activité de plusieurs années dont entre autres « la Notion de dépense » ressort et auquel se joignaient plus de 2 douzaines d'autres traductions de Bataille se cristallisait au cours du temps comme la raison principale de son œuvre. Elle était souvent interrompue par les articles innombrables, rapports et collections de fragment qui apparaissaient d'abord dans le cadre de celui-ci qu'on désignait autrefois comme le “critique tübinguois envers la Raison”, späterhin sont orientés, donc, welthafter et comme des fragments d'une pensée cosmique peuvent être compris. Dans
[en travaux]
Diese langjährige Tätigkeit, aus der u.a. die 'Theorie der Verschwendung' hervorging und an die sich über zwei Dutzend weitere Bataille-Übersetzungen anschlossen, kristallisierte sich im Lauf der Zeit als Hauptgeschäft seines Lebenswerks heraus. Sie wurde vielfach unterbrochen durch zahllose Aufsätze, Vorträge und Fragmentsammlungen, die zuerst im Rahmen dessen entstanden, was man seinerzeit als “Tübinger Vernunftkritik” bezeichnete, späterhin jedoch welthafter orientiert sind und als Bruchstücke eines kosmischen Denkens aufgefasst werden können. In dieser zweiten Abteilung seines Lebenswerks hat Bergfleth nicht zuletzt sein Wort gesagt über Marx, Nietzsche und Heidegger, über Blanchot, Klossowski, Cioran und Baudrillard. Zur Zeit arbeitet er an einem Buch über Ernst Jünger.
◘ Bibliographie sommaire :
- « La révolte de la Terre », in : Les enjeux de l’écologie, Actes du XXVIIe colloque national du GRECE, 1993, pp. 27-38
- « Perspective de l’anti-économie », « Théorie de la révolte » in : Krisis n°15, 1993
- Ein Gespräch, entretien avec EM Cioran, Konkursbuchverla, Tübingen, 1984, tr. fr. in : Entretiens, Cioran, Gal./Arcades, 1995
- « Préface », introduction à : Scènes libertines, Alexandre Dupouy, Konkursbuch Verlag, 2003
- « Kritik der Emanzipation » (sur la réception allemande du post-structuralisme français), Konkursbuch (Zeitschrift für Vernunftkritik) n°1, 1978
- « Erde und Heimat : Über das Ende der Ära des Unheils », in : H. Schwilk & U. Schacht (Hg.), Die selbstbewußte Nation, Berlin. 1994, pp. 101-123
- « Gewalt und Leidenschaft : Anti-politische Fragmente » (sur le concept de déviance), in O. Panizza, Die kriminelle Psychose, Matthes & Seitz, 1978, p. 265 sq.
- « Der Untergang der Wahreit » (sur le constructivisme moral comme impératif de la consensualité), in Der Pfahl n°2/1988, pp. 243-287
- Hermeneutik : Eine politische Kritik (sur Gadamer), Metzler, Stuttgart, 1972
- Theorie der Verschwendung, (sur l'influence de Mauss dans La notion de dépense de Bataille), Matthes & Seitz, Berlin, 1985 [1975 in : G. Bataille, Das theoretische Werk, Bd I : pp. 289-406]
- « Das Urlicht der Natur », in : Das Echo der Bilder : Ernst Jünger zu Ehren, H. Schwilk (Hrsg.), Klett-Cotta, Stuttgart, 1990, pp. 11-42
- Für Ernst Jünger, Matthes & Seitz, Munich, 1995
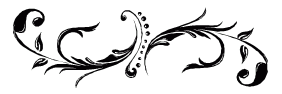
Gerd Bergfleth : critique des Lumières palabrantes
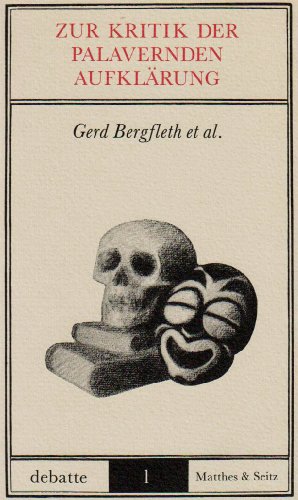 Les essais et articles de Gerd Bergfleth, philosophe et penseur d'avant-garde qui vit à Tübingen, méritent une ample attention. Quand on les lit, quand on y réfléchit, on admettra qu'ils nous offrent une réelle expérience euphorique et euphorisante. Ces textes constituent une véritable déclaration de guerre à l'Aufklärung vulgaire qui a stérilisé la pensée allemande de notre après-guerre.
Les essais et articles de Gerd Bergfleth, philosophe et penseur d'avant-garde qui vit à Tübingen, méritent une ample attention. Quand on les lit, quand on y réfléchit, on admettra qu'ils nous offrent une réelle expérience euphorique et euphorisante. Ces textes constituent une véritable déclaration de guerre à l'Aufklärung vulgaire qui a stérilisé la pensée allemande de notre après-guerre.
Comme Jean Baudrillard à Paris, Bergfleth (qui à préfacé et explicité l'édition allemande de L'échange symbolique et la mort, livre paru chez Gallimard en 1976) tente de sortir de l'impasse où nous a égaré cette pensée dominante marquée du sceau de la raison raisonnante. Bergfleth veut des thèmes nouveaux. Il résume sa pensée iconoclaste en dix thèses qu'il baptise Dix thèses pour une critique de la Raison. Il y constate la faillite de la Raison en tant qu'instance dominante de la philosophie et proclame le divorce entre sa vision personnelle et l'Aufklärung de la gauche de facture habermasienne. Bergfleth s'insurge contre cette pensée propre à la gauche libérale des années 70 et croit pouvoir annoncer la fin de l'alliance entre la Raison, couplée à ses interdits, et le pouvoir, porté par les technocrates. Il écrit : « Décisive est la Subversion de la domination de la Raison et de la Raison de la domination par la nature humaine ». Il faut pour cela redécouvrir le rêve et la folie, l'érotisme et les passions. En bref, ce qu'il faut retrouver, c'est la plénitude totale de notre nature humaine, que l'industrie de la consommation et la bourgeoisie ont domestiquée.
Bergfleth va encore plus loin : « La Vie ne se réduit pas à la pensée mais nous avons tout de même besoin de la clarté passionnée de la pensée, si nous voulons retrouver une Vie de passions ». Gerd Bergfleth se permet une révolte, s'offre le luxe d'une révolte. Tous ceux qui sentent qu'un tel destin de révolté leur est propre l'accompagneront sur la barricade qu'il dresse. L'enjeu : l'intensité sacrée de la Vie. Les réflexions de Bergfleth montrent qu'une nouvelle culture est possible. Mieux : qu'une nouvelle culture est nécessaire.
Deux essais de Bergfleth méritent le détour : 1) Der geschundene Marsyas [repris à : Konkursbuch II, 1978, pp. 45-52] qui évoque les voies qui conduiront, au-delà de la crise des valeurs, à la réconciliation entre la Raison et la Nature et 2) Über linke Ironie, ensemble de réflexions qui, par leur pertinence incisive ébranlent les idées les plus chères à la gauche philosophique, libérale, propagandiste et superficielle. Mais pour les victimes de cet assaut conceptuel, il reste une vigoureuse introduction à Nietzsche, une introduction pour débutants dont les ingrédients proviennent de France.
Dans Die zynische Aufklärung Bergfleth règle ses comptes avec les dogmes et les traditions de cette gauche libérale qui a régné en dictateur impavide depuis la “rééducation” imposée à l'Allemagne vaincue par les armées yankees. L'individuel s'est évanoui dans le néant, telle est la caractéristique la plus méprisable de notre dernière décennie. Idem pour l'idée d'égalité qui a présidé au processus de “démocratisation”, au perfectionnement, au nivellement et à l'uniformisation. Citons Bergfleth : « Dans la notion d'égalité, on trouve entière la tendance à aplatir et araser qui est inhérente à tout universalisme abstrait, dont le propre est d'exterminer toute espèce de différences ». Ou encore : « Car la domination de l'égalité équivaut à la domination de la terreur ».
Bergfleth le sage, Bergfleth l'homme qui sait, n'ignore pas, bien sûr, de quel complexe souffre la nation allemande ; il écrit à ce propos : « Car sans Heimat personne ne peut vivre, pas même l'homme de gauche ; le bourgeoisisme planétaire trouve son pendant dans l'apatridisme, l'Heimatlosigkeit ». Le misérabilisme spirituel de la Bundesrepublik méritait d'être agressé et secoué. Bergfleth s'est chargé de ce boulot salutaire. C'est son grand et immense mérite. Il est devenu un homme dont il faudra tenir compte.
♦ G. Bergfleth et al., Zur Kritik der palavernden Aufklärung, Matthes & Seitz Vg, Munich, 1984, 200 p.
► Martin Werner Kamp, Vouloir n°27, 1986.

La révolte selon Gerd Bergfleth
Il faut rendre hommage à un petit livre pratique qui n'aborde pas le mic-mac du guignol politicien mais se penche, au fond, sur le politique en soi. Ce livre est l'anthologie d'une révolte, celle de Bernd Mattheus & d'Axel Matthes. Mieux qu'une anthologie, ce livre est une symphonie à la radicalité. Ces textes, cette valse de théories et de littérature tranchée et osée feront vibrer les cœurs hardis, les cœurs qui contestent toutes les formes de médiocrité. Les grands ancêtres, les maîtres éternels de toutes les révoltes y ont contribué en fournissant leurs sentences les plus incisives, les plus mordantes : Bataille et Céline, Hölderlin et Pessoa, Nietzsche et le Marquis de Sade. Les partisans cultivés de la révolte radicale œuvrent ici en commun. Des aphorismes épiques aux essais philosophiques, nous découvrons un thème, celui de la révolte, dans une sarabande de méditations subversives, où l'on se découvre jouisseur et prospecteur. Mais ce menu, les auteurs nous l'offrent avec la prudence qui s'impose ; en effet, la lecture n'en est pas aisée.
« La révolte est signe. Signe de ce ou celui qui se trouve en dehors de toute espèce d'ordre. La révolte possède de nombreux visages. La révolte est une chose, son expression en est une autre. Il y a la révolte de l'homme sans envergure et celle du démagogue, qui visent à accentuer encore le rabougrissement de l'homme, qui se plaisent à soumettre et opprimer, qui aiment à cultiver la médiocrité et l'esprit grégaire. Mais il y a aussi la révolte de l'esseulé rebelle et rétif. Le soumis qui courbe le cap et celui qui ignore la crainte évaluent le concept de révolte d'une manière fondamentalement différente. Le fait que l'Église ait envoyé tous les grands hommes en enfer, est une sorte de “révolte” qui déplaisait déjà souverainement à Nietzsche. Ce que moi j'affirme, c'est la révolte contre tout discours établi sur la révolte ».
Et Axel Matthes poursuit :
« La radicalité doit pouvoir s'afficher, il faut pouvoir la lire dans des actes, des instants uniques, des gestes, des formes qui témoignent d'une attitude bien particulière et unique... La radicalité n'est pas en fin de compte une question de goût, mais un état d'esprit. Être radical est une chance : la chance de trouver du neuf ».
Enfin, voici quelques délicatesses de cette « symphonie à la radicalité » :
- « De tout cela, je déduirais que la voie vers la délivrance conduit à travers l'enfer lui-même, mais seul celui qui devine déjà la délivrance, pourra trouver l'issue » (Bergfleth)
- « Qu'aimes-tu donc en fait, toi l'Original ? Ma nostalgie » (Rozanov)
- « Pour l'homme vraiment religieux, rien n'est péché » (Novalis)
- « Plus l'homme progresse, moins de choses il trouvera, auxquelles il pourra se convertir » (Cioran)
- « Se donner ses propres normes et s'y tenir » (Alain de Benoist)
Le lecteur qui voudra trouver un néo-moralisme évitera de lire cette anthologie. Ceux qui, en revanche, cherchent à honorer nos vieux dieux et veulent vivre existentiellement l'audace de la révolte, devront trouver dans cet ouvrage le fil d'Ariane du parfait révolté. Comme Matthes et Mattheus, permettez-vous la révolte !
♦ Bernd Mattheus / Axel Matthes (Hrsg.), Ich gestatte mir die Revolte, Matthes & Seitz, Munich, 1985, 397 p. Contribution de Bergfleth : « Die Allheit der Welt und das Nichts : Metaphysische Fragmente », p. 66-93.
► Martin Werner Kamp, Vouloir n°27, 1986.
Nous commençons, nous, par où capitule la philosophie universitaire : nous constatons la faillite d'une domination, celle de la Raison. Et nous y voyons une chance de renouveau. Nous en avons assez des jérémiades des libéraux et des hommes de gauche et nous ne nous bornerons pas à déplorer le fait que la Raison soit devenue la Non-Raison et que la Non-Raison se soit camouflée en Raison. Nous osons faire le saut ; nous échappons d'un bond au cercle vicieux de la “dialectique des Lumières” et de ses dérivés, générateurs d'une critique fort primitive des idéologies. Car cette critique des idéologies n'est pas une critique de la Raison, ce n'est que l'organe de la domination qu'instaure la Raison.
Les Lumières, elles aussi, peuvent vieillir. C'est pourquoi, il nous semble qu'il faille quitter le terreau de cette Aufklärung, si nous voulons qu'un renouveau s'opère. Le vieillissement des Lumières, et, mieux, le vieillissement de cette “Aufklärung intransigeante” qu'exigeait un Habermas, ne se perçoit pas seulement dans le vide qui s'étend, dans la rhétorique stérile sur la “Théorie” que produit la “Raison émancipatrice”, mais aussi et surtout dans le fait que cette “Raison”, depuis longtemps, ne peut plus que réagir.
L'Humanité, le Droit, la Liberté, le Progrès, etc., toutes ces idoles, ces slogans de l'Aufklärung ont dégénéré en fictions, en simulacres, vides de sens et de contenu face au réel. Au moment même où, par exemple, l'idée d'émancipation devient l'idéologie dominante du temps, et que même le réactionnaire le plus obscurantiste ne peut plus la rejeter, on remarque qu'au fond, mis à part quelques formules de politesse un peu étriquées, cette idéologie n'a rien produit. On peut affirmer : l'Aufklärung s'est imposé sur toute la ligne, mais seulement comme fiction. Une fiction qui n'a strictement rien à voir avec la réalité de la Vie ni avec nos intérêts les plus concrets (du moins si nous en avons).
Zur Kritik der palavernden Aufkärung
L'auto-domination de l'homme est une erreur mortelle, qui ne lui a rapporté que du malheur. La force sanglante que constitue cette erreur, c'est la modernité qui, aujourd'hui, sous nos yeux, tombe à juste titre en putréfaction.
Die Allheit der Welt und das Nichts : Metaphysische Fragmente
La fin, ce n'est pas un déclin, un effondrement tragique, à partir duquel pourrait survenir un renouveau, mais une lente décrépitude qui nous accompagne quelques temps encore. L'Aufklärung, ce n'est pas un mouvement originel. De ce fait, elle n'a pas cette force, cette puissance d'émergence qui, par la suite, déclinera, retournera dans le “fond” (Grund) sans fond, dans l'origine matricielle, source éternelle de renouveaux. Aller au-delà de l'Aufklärung, c'est favoriser, susciter un tel déclin, avec toutefois le sens du renouveau. C'est là la seule chose qu'il nous reste encore à faire. Mais, cela, c'est une autre histoire...
G. Bergfleth
Les esprits les plus pertinents de la modernité se situent déjà tous au-delà de cette modernité, car ils sont précisément ceux qui ont été jusqu'au bout de leurs pensées : Nietzsche et Klages, Heidegger, Jünger et Bataille. Se situer au-delà de la modernité signifie : se hisser au-delà du geste que représente le dépassement radical car ce geste est un geste d'abrogation et redécouvrir un “élémentaire” soustrait à la temporalité en devenir de l'histoire. Ainsi, la postmodemité correspond à la posthistoire, à un évitement de l'histoire.
G. Bergfleth
Wir erhalten also zuletzt, wenn wir von hier aus zurückblicken, ein sehr paradoxes Resultat : nämlich daß einzig eine Vernunftkritik, die sich als Revolte der menschlichen Natur faßt, die Vernunft wiederherstellen kann. Es ist ein doppelter Weg notwendig, wenn die Vernunft sich wiederfinden soll : der Weg von der Herrschaftsvernunft zur Leidenschaft der menschlichen Natur und die Rückwendung von dieser Leidenschaft zu einer Vernunft, die sich als leidenschaftliches Denken begreift. Der doppelte Weg entspricht einem doppelten Aufstand, der von der menschlichen Natur ausgeht und sich von da aus nach Art einer inneren Ansteckung in die Vernunft fortpflanzt. Aber vor deren Wiedergeburt ist der Untergang gesetzt : Vernunftkritik heißt Vernichtung der Herrschaftsvernunft der Technokratie auf allen Ebenen.
« Zehn Thesen zur Vernunftkritik »
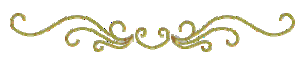
Révolte, irrationnel, cosmicité et... pseudo-antisémitisme
 [Pour Matthes, Mattheus et Bergfleth, la philosophie doit se replonger dans l'élémentaire de la vie et de la mort et quitter le petit monde politisé dans lequel les tenants de l'École de Francfort et Habermas avaient voulu l'enfermer. Le jeu d'ombre de cette photographie expressionniste de Frantisek Drtikol exprime bien l'émergence d'une féminité élémentaire où se mêlent désirs érotiques et engouements pour les puissances de le physis. Le mélange d'érotisme et de thanatomanie se répère dans les sculptures tombales : cf. infra]
[Pour Matthes, Mattheus et Bergfleth, la philosophie doit se replonger dans l'élémentaire de la vie et de la mort et quitter le petit monde politisé dans lequel les tenants de l'École de Francfort et Habermas avaient voulu l'enfermer. Le jeu d'ombre de cette photographie expressionniste de Frantisek Drtikol exprime bien l'émergence d'une féminité élémentaire où se mêlent désirs érotiques et engouements pour les puissances de le physis. Le mélange d'érotisme et de thanatomanie se répère dans les sculptures tombales : cf. infra]
Contre les pensées pétrifiées, il faut recourir à la révolte, disent les animateurs de la maison d'éditions Matthes & Seitz de Munich, éditrice des textes les plus rebelles de RFA et propagatrice de la pensée d'un Bataille et d'un Artaud, d'un Drieu et d'un Dumézil, d'un Leiris et d'un Baudrillard. Attentifs au message de cette inclassable pensée française, rétive à toute classification idéologique, Matthes, Mattheus et Bergfleth, principales figures de ce renouveau, si impertinent pour le conformisme de la RFA, estiment que c'est par ce détour parisien que la pensée allemande prendra une cure de jouvence. Mattheus et Matthes avaient, fin 1985, publié une anthologie de textes rebelles qu'ils avaient intitulée d'une phrase-confession, inspirée de Genet : “Ich gestatte mir die Revolte” (Je me permets la révolte...). Leur révolte, écrit l'essayiste hongrois Laszlo Földényi, dans une revue de Budapest, n'a rien de politique ; elle ne se réfère pas à telle ou telle révolution politique concrète ni à l'aventure soixante-huitarde ni à de quelconques barricades d'étudiants ; elle se niche dans un héritage culturel forcément marginal aujourd'hui, où notre univers est club-méditerranisé, elle campe dans de belles-lettres qui avivent les esprits hautains, s'adressent à des cerveaux choisis.
Une révolte à dimensions cosmiques
 Ces derniers, eux, doivent se réjouir d'une anthologie où Hamann et Hebbel sont voisins de Céline et de Bataille, et où tous ces esprits éternels conjuguent leur puissance pour dissoudre les pétrifications, pour sauver la culture de ce que Friedrich Schlegel nommait la « mélasse de l'humanisme » (Sirup des Humanismus). “Révolte”, ici, n'implique aucune démonstration de puissance politique, de force paramilitaire et/ou révolutionnaire, note Földényi, mais, au contraire, une retenue avisée de puissance, dans le sens où Mattheus et Matthes nous enseignent à nous préparer à l'inéluctable, la mort, pour jouir plus intensément de la vie ; de renoncer aux pensées unilatérales : « L'extrémisme politique institutionalisé transforme souvent l'État en maison d'arrêt : c'est là la forme déclinante de la radicalité... ».
Ces derniers, eux, doivent se réjouir d'une anthologie où Hamann et Hebbel sont voisins de Céline et de Bataille, et où tous ces esprits éternels conjuguent leur puissance pour dissoudre les pétrifications, pour sauver la culture de ce que Friedrich Schlegel nommait la « mélasse de l'humanisme » (Sirup des Humanismus). “Révolte”, ici, n'implique aucune démonstration de puissance politique, de force paramilitaire et/ou révolutionnaire, note Földényi, mais, au contraire, une retenue avisée de puissance, dans le sens où Mattheus et Matthes nous enseignent à nous préparer à l'inéluctable, la mort, pour jouir plus intensément de la vie ; de renoncer aux pensées unilatérales : « L'extrémisme politique institutionalisé transforme souvent l'État en maison d'arrêt : c'est là la forme déclinante de la radicalité... ».
Les réflexions cosmiques d'un Bataille, les outrances céliniennes recèlent davantage de potentialités philosophiques, affirment Matthes et Mattheus, que les programmes revendicateurs, que les spéculations strictement sociologiques qui se sont posés comme objets de philosophie dans l'Allemagne de ces 3 ou 4 dernières décennies. Contrairement à Camus, moraliste, et aux exégètes de l'École de Francfort, Matthes, Mattheus et Bergfleth pensent que la “Révolte”, moteur de toute originalité de pensée, ne vise pas à l'instauration d'un Bien pré-défini et que l'activité humaine ne se résume pas à un processus sociologique de production et de reproduction ; elle indique bien plutôt cette “Révolte” à dimensions cosmiques, l'expression des outrances les plus violentes et les plus audacieuses de l'âme humaine qu'aucune codification de moralistes étriqués et qu'aucun utilitarisme calculateur ne pourront jamais appréhender dans leur totalité, dans leur profusion cosmique et tellurique.
La “Révolte” comme force innée
La raison des philosophes et des idéologues n'est qu'un moyen pratique et commode pour affronter une quotidienneté sans reliefs importants. Dans une lettre du peintre André Masson, reproduite dans l'anthologie de Matthes et Mattheus, on trouve une réflexion qui rejoint la préoccupation du groupe éditorial munichois : aucun enthousiasme révolutionnaire n'est valable, s'il ne met pas à l'avant-plan les secrets et les mystères de la vie et de la mort. C'est pourquoi l'attitude “Révolte” détient une supériorité intrinsèque par rapport au phénomène “révolution” qui, lui, est limité dans un espace-temps : il commence et il se termine et, entre ces 2 points, une stratégie et une tactique ponctuelles s'élaborent.
La “Révolte”, elle, est “primitive” et “a-dialectique” ; elle fait irruption à des moments intenses et retourne aussitôt vers un fonds cosmo-tellurique d'où, récurrente, elle provient, revient et retourne. La “Révolte” est un principe constant, qu'une personnalité porte en elle ; elle est un sentiment, une attitude, une présence, une rébellion. La plupart des hommes, faibles et affaiblis par nombre de conformismes, oublient ce principe et obéissent aux “ordres pétrifiés” ou remplacent cette force innée par une caricature : la dialectique oppositionnelle.
Et si le dialecticien politisé croit à un “télos” bonheurisant, sans plus ni projets ni soucis, réalisable dans la quotidienneté, le “révolté”, être d'essence supérieure, sait la fragilité de l'existence humaine, et, dans la tension qu'implique ce savoir tragique, s'efforce de créer, non nécessairement une œuvre d'art, mais un ordre nouveau des choses de la vie, frappé du sceau de l'aventureux. Avec le romantique Novalis, Matthes et Mattheus croient à la créativité de ce rassemblement de forces que l'homme, conscient de sa fragilité, est capable de déployer.
Retour à l'irrationnel ?
 [Sculpture érotique d'une tombe du cimetière de Staglieno. La photographe Isolde Ohlbaum s'en est servie pour illustrer d'un superble cliché n&b la couverture de son recueil photographique consacré à cet art des cimetières (Denn alle Lust will Ewigkeit : Erotische Skulpturen auf europäischen Friedhöfen, Greno, Nördlingen). Le titre « Tout désir veut l'éternité » renvoie à ce fameux vers de Nietzsche : « Doch alle Lust will Ewigkeit – will tiefe, tiefe Ewigkeit ! » (Also sprach Zarathustra)]
[Sculpture érotique d'une tombe du cimetière de Staglieno. La photographe Isolde Ohlbaum s'en est servie pour illustrer d'un superble cliché n&b la couverture de son recueil photographique consacré à cet art des cimetières (Denn alle Lust will Ewigkeit : Erotische Skulpturen auf europäischen Friedhöfen, Greno, Nördlingen). Le titre « Tout désir veut l'éternité » renvoie à ce fameux vers de Nietzsche : « Doch alle Lust will Ewigkeit – will tiefe, tiefe Ewigkeit ! » (Also sprach Zarathustra)]
Témoignent de cette créativité foisonnante toutes les poésies, toutes les œuvres, toutes les pensées imperméables aux simplifications politiciennes. C'est précisément dans cette “zone imperméable” que la philosophie ouest-allemande doit retourner, doit aller se ressourcer, afin de briser le cercle vicieux où elle s'enferre, avec pour piètre résultat un affrontement Aufklärung-Gegenaufklärung, où l'Aufklärung adornien donne le ton, béni par les prêtres inquisiteurs du journalisme. Pour Matthes et Mattheus, tout prosélytisme est inutile et rien ne les poussera jamais à adopter cette répugnante praxis. La “Révolte” échappe à l'alternative commode “rationalisme-irrationalisme”, comme elle échappe aux notions de Bien et de Mal et se fiche de tout establishment.
Le carnaval soixante-huitard n'a conduit à aucun bouleversement majeur, comme l'avait si bien prévu Marcel Jouhandeau, criant aux étudiants qui manifestaient sous son balcon : « Foutez-moi le camp ! Dans dix ans, vous serez tous notaires ! ». La tentation politicienne mène à tous les compromis et à l'étouffement des créativités. L'objectif de Matthes et Mattheus, c'est de recréer un climat, où la “Révolte” intérieure, son “oui-non” créateur, puisse redonner le ton. Un “oui” au flot du devenir, aux grouillements du fonds de l'âme et à la violence puissante des instincts et un “non” aux pétrifications, aux modèles tout faits. C'est au départ de cet arrière-plan que se développe, à Munich, l'initiative éditoriale de Matthes. Ce dernier précise son propos dans une entrevue accordée à Rolf Grimminger :
« Le traumatisme des intellectuels allemands, c'est “l'irrationalisme”. Le concept “irrationalisme” a dégénéré en un terme passe-partout, comme le mot “fascisme” ; il ne signifie plus rien d'autre qu'une phobie, que j'aimerais, moi, baptiser de “complexe de l'irrationalisme”. Je pose alors la question de savoir dans quelle mesure la raison est si sûre d'elle-même quand elle affronte son adversaire, aujourd'hui, avec une telle véhémence d'exorciste. Fébrile, la raison diffame tout ce qui lui apparaît incommensurable et sa diffamation use des vocables “non-sens”, “folie”, “anormalité”, “perversion”, bref le “mal” qu'il s'agit d'exclure.
Par cette exclusion, on exclut l'homme lui-même : tel est mon argument personnel. La raison n'est et n'a jamais été une valeur en soi ; il lui manque toute espèce de souveraineté ; elle est et reste un pur moyen pratique. L'homme, pour moi, est certes un animal doté de raison, mais il n'est pas assermenté à la raison et ses potentialités et ses aspirations ne s'épuisent pas dans la raison. Et celui qui affirme le contraire, ne peut avoir pour idéal que le camp de travail » (Die Ordnung, das Chaos und die Kunst, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1986, p. 253).
En France : la Cité ; en Allemagne : la Raison
Le lecteur français, en prenant acte de tels propos, ne percevra pas immédiatement où se situe le “scandale”... En France, la polémique tourne autour des notions d'universalisme et de cosmopolitisme, d'une part, et d'enracinement et d'identité, d'autre part. BHL parie pour Jérusalem et la Loi, qui transcendent les identités “limitantes”, tandis qu'un Gérald Hervé, condamné au silence absolu par les critiques, parie pour Rome, Athènes et les paganités politiques (in : Le mensonge de Socrate ou la question juive, L'Âge d'Homme, 1984). Dans la querelle actuelle qui oppose philo-européens et philo-sémites (car tel est, finalement, qu'on le veuille ou non, le clivage), le débat français a pour objet premier la Cité et celui de la citoyenneté-nationalité), tandis que le débat allemand a la question plus abstraite de la raison.
La Raison, que dénoncent Bergfleth et Matthes, est, en RFA, l'idole érigée dans notre après-guerre par les vainqueurs américains et aussi la gardienne conceptuelle d'une orthodoxie et la garante d'un culpabilisme absolu. Pour provoquer l'establishment assis sur ce culte de la raison, établi par l'École de Francfort, et ce philo-sémitisme obligé, soustrait d'office à toute critique, Bergfleth écrit, au grand scandale des bien-pensants :
« La judéité des Lumières (aufklärerisches Judentum) ne peut, en règle générale, appréhender le sens de la spécificité allemande, des nostalgies romantiques, du lien avec la nature, du souvenir indéracinable du passé païen germanique... ».
Ou, plus loin :
« Ainsi, une nouvelle Aufklärung a généré un non-homme, un Allemand qui a l'autorisation d'être Européen (CEE, ndlr), Américain, Juif ou autre chose, mais jamais lui-même. Grâce à cette rééducation perpétrée par la gauche, rééducation qui complète définitivement sa défaite militaire, ce non-homme est devenu travailleur immigré dans son propre pays, un immigré qui reçoit son pain de grâce culturel des seigneurs cyniques de l'intelligentsia de gauche, véritable mafia maniant l'idéologie des Lumières ».
L'inévitable reproche d'antisémitisme
Plus pamphlétaire que Gérald Hervé, moins historien, Bergfleth provoque, en toute conscience de cause, le misérable Zeitgeist ouest-allemand ; il brise allègrement les tabous les plus vénérés des intellectuels, éduqués sous la houlette de Benjamin et d'Adorno et de leurs nombreux disciples. Son complice Matthes, qui ne renie nullement ce que Benjamin et Adorno lui ont apporté, estime que si ce philo-sémitisme est absolu et exclut, parce qu'il est asséné en overdose, des potentialités intellectuelles, philosophiques, culturelles et humaines, il limite la liberté, occulte des forces sous-jacentes que le philosophe a le devoir de déceler et de montrer au grand jour. Une telle attitude n'est pas assimilable à l'anti-sémitisme militant habituel, pense Matthes : la critique d'une pensée issue de la théologie judaïque est parfaitement légitime. Cette critique n'exclut pas d'office ce que la théologie et le prophétisme judaïques ont apporté à la culture humaine ; elle a pour objectif essentiel de ne laisser aucune culture, aucun héritage, en marge des spéculations contemporaines.
La philosophie ne consiste pas à répéter une vérité sue, déjà révélée, à encenser une idole conceptuelle par des psaumes syllogistiques, mais de rechercher au-delà de la connaissance “ce que la connaissance cache”, c'est-à-dire d'explorer sans cesse, dans une quête sans fin, le fond extra-philosophique, concret, tangible, tellurique, l'humus prolifique, la profusion infinie faite d'antagonismes, qui précèdent et déterminent toutes les idées. Où est l'anti-sémitisme propagandiste dans une telle démarche, à l'œuvre depuis les Grecs pré-socratiques ? Peut-on sérieusement parler, ici, d'anti-sémitisme ? Ce simple questionner philosophique qui interroge l'au-delà des concepts ne saurait être criminalisé, et s'il est criminalisé et marqué du stigmate de l'anti-sémitisme, ceux qui le criminalisent. sont ridicules et sans avenir fecond.
Les aphorismes de Mattheus
Criminaliser les irrationalismes, cela a été une marotte de l'après-guerre philosophique allemand, sous prétexte d'anti-fascisme. En France, il restait des espaces de pensée irrationaliste, en prise sur la littérature, avec Artaud, Bataille, Genet, etc. C'est le détour parisien que s'est choisi Bernd Mattheus, éditeur allemand d'Artaud et biographe de Bataille, pour circonvenir les interdits de l'intelligentsia allemande. Celle-ci, dans son dernier ouvrage, Heftige Stille (Matthes & Seitz, 1986), n'est pas attaquée de front, à quelques exceptions près ; le style de vie cool, soft, banalisé, consumériste, anhistorique, flasque, rose-bonbon, empli de bruits de super-marchés, de tiroirs-caisses électroniques, qu'indirectement et malgré la critique marcusienne de l'unidimensionalité, la philosophie francfortiste de la raison a généré en RFA, est battu en brèche par des aphorismes pointus, inspirés des moralistes français, qui narguent perfidement les êtres aseptisés, purgés de leur germanité, qui ont totalement (totalitairement ?) assimilé au thinking packet franfortiste, comme ils ingurgitent les lunch packets de Mac Donald.
Laissons la parole à Mattheus :
« Ô combien ennuyeux l'homme qui n'a plus aucune contradiction » (p. 102).
« Ne jamais perdre de vue la lutte contre la pollution de notre intériorité » (p. 123).
« Le désenchantement rationaliste du monde, c'est, d'après Ludwig Klages, la triste facette du travail de l'intellect humain. Pour déréaliser le monde, on peut se servir soit de la ratio soit de la folie. Mais chacune de ces deux voies indique que l'homme ne peut supporter le monde réel tel quel et cherche à s'en débarrasser. Si l'on juge ces deux voies d'après la situation dans laquelle évoluent les sujets qui leur sont livrés, la déréalisation semble plutôt accentuer les souffrances et le désespoir ; d'où le dilemme : soit bêtifié et heureux soit fou et malheureux (Ernst Jünger) » (p. 166).
« Les systèmes libéraux n'ont nul besoin de censure ; la sélection des “biens culturels” se fait aux caisses des magasins et cette sélection-là est bien plus rigoureuse que ne le serait n'importe quelle sélection politique » (p. 183-4).
« Pourquoi Artaud, pourquoi Bataille ? Parce que j'apprécie l'ivresse lucide » (p. 257).
Une stratégie de l'attention
Disloquer les certitudes francfortistes, et le “prêt-à-penser” médiatique qu'elles ont généré, passe par un plongeon dans l'extra-philosophique et par ce style aphoristique de La Rochefoucauld, déjà préconisé par Nietzsche. Prendre connaissance, dans l'espace linguistique francophone, du travail de Bergfleth, Matthes et Mattheus, et s'habituer au climat qu'ils contribuent à créer à l'aide de productions philosophiques françaises, c'est travailler à la constitution d'un axe franco-allemand autrement plus efficace et porteur d'histoire que la ridicule collaboration militaire dans le cadre de l'OTAN, où les dés sont de toute façon pipés, puisque l'Allemagne et son armée n'ont aucun statut de souveraineté. De notre part, l'initiative de Bergfleth, Matthes et Mattheus, doit conduire à une efficace stratégie de l'attention.
♦ Bernd Mattheus, Axel Matthes (Hrsg.), Ich gestatte mir die Revolte, Matthes & Seitz, München, 1985, 397 S., 22
♦ Laszlo Földenyi, article paru à Budapest, reproduit dans le catalogue 1986 de la maison Matthes & Seitz.
► Michel Froissard, Vouloir n°40-42, 1987.

pièces-jointes :
◘ Postmodernité : encore un effort !
 Postmoderne : le mot est dans toutes les bouches. Mais personne ne sait exactement de quoi il s'agit. La chose, cependant, existe. On peut même en faire la preuve empirique : quand, autour de nous (voire à l'intérieur de nous-mêmes), d'innombrables indices amènent nos contemporains, sans s'être donné le mot, à qualifier unanimement de “postmodernes” certains phénomènes ou messages, il faut bien qu'il y ait anguille sous roche. Que cette étiquette soit flatteuse pour les uns, péjorative pour les autres, ne change rien à l'affaire. À l'évidence, quelque chose se trame autour de nous. Cela croît, s'amplifie, s'enfle en permanence. Mais, faute de recul, nous n'en percevons que vaguement les contours.
Postmoderne : le mot est dans toutes les bouches. Mais personne ne sait exactement de quoi il s'agit. La chose, cependant, existe. On peut même en faire la preuve empirique : quand, autour de nous (voire à l'intérieur de nous-mêmes), d'innombrables indices amènent nos contemporains, sans s'être donné le mot, à qualifier unanimement de “postmodernes” certains phénomènes ou messages, il faut bien qu'il y ait anguille sous roche. Que cette étiquette soit flatteuse pour les uns, péjorative pour les autres, ne change rien à l'affaire. À l'évidence, quelque chose se trame autour de nous. Cela croît, s'amplifie, s'enfle en permanence. Mais, faute de recul, nous n'en percevons que vaguement les contours.
Évoquant, sur le mode badin, les onze années de sa présidence de l'université de Munich, Nikolaus Lobkowicz (Communio, éd. all., n°4/1986, pp. 352 ss.) a bien cerné les difficultés auxquelles se heurte toute première approche de l'irradiation postmoderne :
« Sans cesse me revenait à l'esprit la remarque pénétrante de A. Santos qui affirmait que les contemporains ne sont jamais capables de juger leur époque puisque tout dépend de ce qu'elle produit. On agit en fonction de telle ou telle expérience passée, de tel ou tel principe qui, en général, n'a rien d'évident, d'après certaines idées sur les périls qui nous guettent et nos possibilités. Si ces périls ne mènent pas à la catastrophe, l'historien de l'avenir sera tenté de dire que nous avons exagéré. Si au contraire les possibilités ne s'actualisent pas, on nous accusera d'aveuglement. Nous vivons dans un demi-jour, et si d'aventure nous trouvons notre chemin, c'est par instinct plus que par raison. Voilà un argument de taille contre l'idée selon laquelle nous vivons à une époque éclairée ».
Je n'ai, bien entendu, cité ces quelques brins de sagesse que pour mieux me jeter à l'eau. D'autant que l'on s'apercevra (le lecteur me pardonnera cette troisième métaphore) que dans un premier temps, au moins sur une partie du parcours, nous évoluons en terrain sûr. Je m'explique : il me semble que sur cette “postmodernité” aux contours si incertains, on peut s'accorder sur 3 points, que j'indiquerai. Nous tenterons ensuite de dégager, sur un sujet si déroutant, 3 grands axes d'interprétation dont on commence déjà à percevoir les linéaments. Une dernière foulée nous ramènera sur la terré ferme et nous présenterons un jeune éditeur et un jeune auteur qui nous paraissent incarner la “postmodernité”.
C'est appliqué à l'architecture que le terme “postmoderne” s'est sans doute révélé à la plupart d'entre nous. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans ce domaine-là que l'expression s'est rapidement imposée : on ergote moins volontiers sur une construction ou un problème d'urbanisme que sur la poésie ou la théologie : en architecture, l'objet du débat est une réalité optique évidente, et la postmodernité n'y est pas difficile à repérer : c'est une révolte contre l'architecture “fonctionnaliste” genre Bauhaus. Certes, les architectes postmodernes ont, eux aussi, pour principe que le style doit découler de la fonction de l'édifice à bâtir (“form follows function”, dit-on). Mais ils donnent au mot “fonction” un sens plus vaste. Un couloir, par ex., n'a pas simplement pour “fonction” de permettre à 2 personnes de se croiser sans se gêner (ce serait plutôt la fonction d'un mètre !) : un couloir ne doit pas donner une sensation d'oppression.
L'homme est plus que ses besoins physiques : ses besoins psychiques sont l'autre face de la “fonction” que doit remplir une construction, et c'est pourquoi l'architecte postmoderne se permet d'équilibrer la gravité d'un ensemble par des éléments articulants, nullement indispensable sur le plan technique. Et comme l'homme n'est pas seulement un homo faber mais également un homo ludens, des architectes comme Bofil, Krier, Charles Moore ou Watanabe ne négligent pas d'embellir leurs œuvres d'ornements “superflus” mais qui en rehaussent l'aspect : Ils se permettent, très naturellement, des emprunts : ici une colonnade grecque ou une corniche à la Palladio, là un axe médian d'allure princière qui rehausse la vie, l'élevant vers la joie ou le tragique. En architecture, la postmodernité est une geste libératrice qui rompt avec la sclérose du dogmatisme et de l'unilatéral. L'est-elle dans les autres domaines ?
À l'évidence, la “postmodernité” a une parenté française. C'est le second point. Et une certitude : quel que soit le volet de la postmodernité à l'étude, on rencontre à chaque pas soit des racines françaises, soit dés impulsions venues d'ailleurs mais retransmises par la France. Celle-ci, qui paraissait définitivement vouée au nombrilisme. assume, depuis quelques dizaines d'années, le rôle qui fut si longtemps celui de l'Allemagne : celui du penseur qui va jusqu'au bout des idées, celui du grand initiateur, du grand séducteur dans les choses de l'esprit et de la culture, celui du grand explorateur de nouveaux rivages.
Si les grands débats inaugurés par Nietzsche et Heidegger ne se sont pas enlisés, c'est grâce aux philosophes français. Au point qu'aujourd'hui, lorsque nos philosophes allemands crispés se prêtent à un débat avec leurs homologues français, ils ont le ridicule (et pour cause) de désavouer (parce que “fascistoïde”) un héritage intellectuel allemand redécouvert et réactivé... à Paris. Le complexe d'infériorité suscité par ce hiatus intellectuel dans les rangs du mandarinat ouest-allemand se répercute bien entendu sur l'attitude adoptée face au phénomène postmoderne. Les combats d'arrière-garde de nos mandarins ont fatalement tendance à n'être que la continuation, sous de nouveaux oripeaux, de la vieille imprécation fielleuse contre le “Franzos' mit der roten hos'” (“Le Français à culotte pourpre” : allusion au pantalon de l'uniforme français de la guerre de 1870 et du début de la Première Guerre mondiale. NDT). Même les polémiques d'une certaines tenue intellectuelle n'en sont pas tout à fait exemptes (voir par ex. l'essai de Klaus Laermann, germaniste de l'université libre de Berlin et appartenant à cette génération d'après-guerre non astreinte au service militaire : « Lacancan et Derridada : La francolâtrie dans les disciplines de l'esprit », in Kursbuch n°84, mars 1986, pp. 34 ss.).
Le troisième fait, incontestable lui aussi, est que l'ennemi visé par l'explosion volcanique de la postmodernité est facilement identifiable. Sur ce point, le consensus des esprits malicieux est renforcé par la fureur de leurs victimes. L'ennemi, c'est la “deuxième Aufklärung”, c'est-à-dire ce curieux mouvement réactionnaire qui croyait, et croit toujours, que l'on peut colmater les brèches que Georges Sorel, Nietzsche et consorts ont ouvertes dans la muraille des utopies. La “modernité”, dont se détourne le courant postmoderne, est un amalgame idéologique à l'échelle planétaire même s'il varie selon des pays ou les régions. On y rencontre au premier plan des attitudes mentales et des comportements apparemment incompatibles : un matérialisme historique édulcoré par la psychanalyse, qui remplace la lutte des classes par la lutte contre certains types de mentalité ; un discours sur la liberté et l'émancipation sans limites ; le culte de l'individu-roi et de l'ego qui ne s'embarrasse pas de devoirs vis à vis d'impératifs supérieurs.
Les idéologies n'ont jamais été affaire de logique. Il leur faut d'autres liants. Exemple : l'intérêt collectif des milieux qui se sont ralliés à cet Eintopf idéologique et forment une sorte d'internationale soudée. Ou encore le confort intellectuel du repli stratégique sur une éthique de l'intention pure qui n'engage bien entendu à rien et dispense de l'épreuve des faits. Et dans la mesure où l'on peut parler d'une assise “philosophique” de tout cela, ce n'est qu'un égalitarisme qui mesure toute réalité à l'aune de l'unidimensionnel et se réclame d'un universalisme inspiré tantôt de Spinoza tantôt de saint Thomas. Le résultat de ce réductionnisme est une pensée monolinéaire qui prétend expliquer logiquement le monde et résoudre ainsi tous les problèmes. Et lorsque le coup de baguette magique se révèle inopérant, le missionnaire vient à la rescousse, fort de la conviction d'être moralement infiniment supérieur aux “non éclairés”. Le lecteur me pardonnera cette définition en raccourci de la modernité : il en connaît déjà les divers ingrédients et peut donc les retrouver lui-même dans le tableau que j'ai brossé.
L'adversaire a senti le danger. Il existe des revues (et pas seulement le Kursbuch cité plus haut) dont le seul souci, depuis plusieurs années, est de démontrer que l'abandon de la modernité ne doit pas, ne peut pas et ne va pas avoir lieu. Instituts universitaires et organismes privés s'occupent à mettre sur fichier et (noblesse oblige) sur ordinateur les argumentaires, les personnes, les revues et publications d'un “tournant” imaginaire. Quant à l'héritier, aussi teigneux que stérile, des pères défunts de la “deuxième Aufklärung” (celle de Francfort et d'ailleurs), je veux parler de Jürgen Habermas, il consacre toute son éloquence à mettre en garde un public de plus en plus clairsemé contre le flot paresseux de la postmodernité, en laquelle il aperçoit la fin de la liberté, de la démocratie... et surtout de l'Occident (la Deutsche Forschungsgemeinschaft vient de décerner à Habermas l'un des prix du “Programme Gottfried Wilhelm Leibniz”. Commentaire de la Frankfurter Allgemeine Zeitung du 16 juillet 1986 : « Les lauréats peuvent, sans débours bureaucratiques, disposer en toute liberté de crédits de recherche pouvant atteindre les 9 millions de Francs »).
Pour rendre compte de but en blanc du phénomène postmoderne, l'image de l'éruption volcanique est plus heureuse que celle de la nuée radio-active : le courant postmoderne apparaît effectivement comme le surgissement irrésistible de ce qui tendait à la surface, de ce qui ne pouvait plus être contenu. L'édifice intellectuel qu'il met en miettes n'avait plus rien à voir avec le réel, menaçait même de devenir invivable. Or, le flot de lave compacte qui déferle du cratère béant charrie nonchalamment les éléments les plus hétéroclites : des suiveurs, qui se satisfont, comme toujours, de quelques bouchées happées ici et là ; des charlatans, toujours présents là où l'on découvre que l'homme est plus compliqué que l'on croyait ; des opportunistes, habiles à convertir en un tour de main les idées nouvelles en jargon négociable sur le marché de l'esprit. Mais les pires sont peut-être ces enthousiastes sincères qui ne s'aperçoivent pas qu'un cœur débordant a, plus qu'un autre, besoin de rigueur dans l'expression. Ce n'est pas parce qu'on lutte contre la phraséologie moderniste, superficielle et coincée, qu'on va ouvrir toutes grandes les portes au bavardage, fût-il fleuri ! Que Cioran, Clément Rosset et autres maîtres de la mise-en-forme précise de l'informel nous soient témoins !
Cependant (à la guerre comme à la guerre), ceux qui cherchent à empêcher la déconfiture de la modernité se ruent avec délice sur l'équipage il est vrai bigarré de la postmodernité. Voilà même qu'ils agitent un scalp : celui de Dietmar Kamper, sociologue de l'université libre de Berlin, dont la faconde est effectivement une aubaine pour le caricaturiste : son discours abstrus et alambiqué n'a rien à envier au charabia professionnel des pires épigones de Theodor Adorno, et si l'on feuillette les revues qui s'intitulent “postmodernes” (par ex. Konkursbuch, revue de critique de la raison, ou Tumult, revue des sciences de la communication), on est sans cesse tiraillé entre des fantaisies nombrilistes et un discours pertinent sur des observations justes. Mais ce sont là les phénomènes habituels qui accompagnent tous les changements importants. Si, en l'occurrence, ils sont plus voyants, c'est peut-être parce que le tournant en question n'obéit pas à une discipline mais insuffle un peu d'air frais dans une atmosphère irrespirable et défriche de nouveaux espaces de liberté.
Bien sûr, la définition du phénomène “postmoderne” tentée ici est elle-même affaire de perspective. L'auteur de ces lignes a été marqué par la Révolution conservatrice, premier courant intellectuel à avoir eu le courage de dire que ce qu'on appelle la “modernité” n'a en fait rien de moderne et qu'elle est au contraire un réchauffé d'Aufklärung (dans ses 2 variantes : la rationaliste et la sensualiste). Car ce qui fait la nouveauté de notre époque, à savoir la technique et l'industrialisation, n'a jamais été saisi dans son essence, encore moins maîtrisé, par la deuxième Aufklärung. La Révolution conservatrice s'est efforcée de dépasser les abstractions niveleuses de la modernité pour dégager une vision réaliste de l'homme et du monde dans sa complexité, en essayant de faire prendre conscience des conséquences concrètes qui en découlaient.
Certes, un tel positionnement pourrait facilement porter à la condescendance à l'égard de la postmodernité : on a parfois l'impression d'être un guide de haute montagne qui, après avoir péniblement taillé à grands coups de piolet des marches dans la paroi, verrait les touristes à souliers plats gravir lestement la pente en se jouant de la pesanteur. Je ne cède pas à cette tentation. Je tiens néanmoins à préciser que je ne souhaite pas être confondu avec 2 types de “compagnons de route” : tout d'abord, les “fondamentalistes” qui se contentent de remplacer un unilatéralisme par un autre ; ils ne réalisent pas qu'une vérité devient fausse dès lors que les vérités adjacentes ne sont plus perçues comme telles. Témoins ces “Verts” qui vident de leur substance les idées écologistes en les réduisant à des abstractions, ne perçoivent pas l'imbrication historique de l'homme et de la nature et songent encore moins à assumer les contraintes qu'entraîneraient les actions qu'ils réclament.
Le cas des autres compagnons de route est un peu plus complexe : ce sont, en bref, des gens qui, certes, désavouent les éléments de contrainte de la modernité mais qui en aucun cas ne voudraient renoncer à ses aménités. Il s'agit, pour la plupart, d'intellectuels de la gauche libérale. Suffisamment intelligents pour réaliser la débâcle de leurs idéaux, ils ne voudraient au grand jamais passer pour des “hommes de droite” ou tout autre forme du Mal. Exemple classique : Botho Strauss. Très en vogue actuellement, c'est l'auteur de la bouche duquel le bourgeois timoré s'entend dire des choses qu'il récuserait si elles venaient d'ailleurs. Bien sûr, Botho Strauss sait tenir des propos roboratifs :
« La génération soixante-huitarde l'a encore échappé belle. Elle continue, depuis des décennies, à exercer ses modestes talents intellectuels du haut de chaires confortables... C'est avec de telles formules incantatoires (“maîtriser le réel”) que la raison, acculée, essaie de transformer le foisonnement du vivant en un monde conceptuel vide. Voilà le véritable irrationalisme ! Sa fade prière, dominée par le tintamarre des intellos en rupture de langage, s'affirme pour ainsi dire d'office et ses blocages augmentent en proportion de son zèle. Et, n'ayant rien appris, les éducateurs délaissés par leurs ouailles ânonnent inlassablement le vocabulaire sec et défraîchi d'une analyse critique qui, à chaque répétition, apparaît un peu plus abstraite » (Paare, Passanten).
À la bonne heure. La formule fait mouche. Malheureusement, elle n'aura aucune suite parce que Strauss ne s'en prend qu'aux symptômes. La déroute qu'il nous décrit ne serait-elle, pour lui, qu'un fâcheux accident de parcours ? Croit-il qu'il aurait pu en être autrement ? Botho Strauss a un truc efficace pour éluder ces questions : il truffe son texte de citations, franches ou déguisées, extraites de la littérature universelle (et de la mythologie) : une citation coupée de son contexte a l'avantage qu'on peut à peu près toujours lui faire dire n'importe quoi.
Mais trêve de critiques. Ouvrons tout grands les bras ! Ce n'est pas par fausse modestie de l'auteur de ces lignes rejette toute condescendance à l'égard de la postmodernité : celle-ci a vraiment quelque chose à nous apporter, quelque chose qui nous manque, nous complète et nous féconde. C'est qu'elle a quelque rapport avec le travail de pionnier entrepris par la Révolution conservatrice. Celle-ci fut la première à déclarer la guerre au dogmatisme stérile de ce qu'on appelle “la modernité”. Un tel combat vous marque un homme. Il force à la réserve, à la concentration sur des tâches déterminées. Rien n'y est laissé au hasard, il faut faire l'impasse sur bien des choses, les remettre à “plus tard”. On s'acharne sur l'adversaire et même si, au nom de la plénitude et de la complexité du réel, on se bat contre la grisaille de l'abstraction, un peu de cette grisaille vous colle tout de même à la peau. On panse ses plaies et on fait l'apprentissage de la prudence. Mais le néophyte qui pénètre pour la première fois dans l'arène ignore encore combien de coups il recevra.
Nous avons déjà mentionné dans Criticón (n°85 de janvier-février 1985) un baptême du feu postmoderne : la critique par Gerd Bergfleth de cette pensée terroriste qu'est le cosmopolitisme. Mais il y a plus beau encore que les baptêmes du feu : les surprises que nous réserve l'âge postmoderne. Dans sa virginité et son innocence, la postmodernité nous ouvre de nombreuses échappées et éjecte en pleine lumière ce que l'on n'avait que pressenti, ce que l'on avait oublié, ou voulu oublier.
En Allemagne, l'édition postmoderne atteste une joyeuse diversité. Voici le portrait, rapidement brossé, d'Axel Matthes, directeur des éditions Matthes & Seitz Verlag de Munich. Si nous avons choisi celui-là, c'est parce qu'il passe actuellement pour être l'entreprise la plus intéressante en la matière : snob mais pas trop, sophistiqué mais avec modération, sans peur des compromissions ni des voisinages gênants, du flair et plus d'une surprise dans son sac. Ses livres, enfin, sont de petits délices à un prix abordable. Un coup d'œil sur sa production suscite l'étonnement : Axel Matthes fait tout tout seul, de la conception à l'expédition. L'hebdomadaire Die Zeit (16 août 1985) lui a rendu visite (avant nous) : « ... Sans lecteur ni collaborateur, avec une seule comptable qui vérifie les bilans deux fois par semaine et une productrice free lance, il “sort” quinze livres par an ».
Pourtant, à en croire l'auteur de cet article, Matthes n'a rien d'un homme à bout de souffle :
« Axel Matthes aime parler, et d'abondance, tantôt tourné vers moi, tantôt désignant le plafond, parfois le sol, prenants à témoin la fenêtre ou lui-même. Il y a en lui un peu de l'homme de lettres des cafés du XVIIIe siècle, ou d'un ETA Hoffmann que fascineraient les zones d'ombre des sciences physiques, un peu d'un existentialiste en complet noir, mélancoliquement propulsé dans l'existence, un peu d'un Jésus adepte d'une conception hédoniste de la vie. Il discute avec lui-même, ou plutôt ça discute en lui interminablement. Décidément, cette maison d'édition est un seul et unique monologue, fantastique et romantique... »
Et encore ceci : « Matthes n'édite pas les cuistres. Il n'édite que les auteurs qui prennent le risque de se tromper, pour qui la pensée risquée est un principe de travail, les auteurs chez qui l'écriture et la vie, c'est à dire l'erreur, ne font qu'un ». Ces lignes viennent à point nous rappeler quelle est la cible de la rébellion postmoderne : la pensée linéaire et figée, responsable de la pétrification du monde. Benedikt Erenz, qui a rédigé ce brillant reportage, cite à ce propos quelques phrases de Matthes :
« La contradiction, y compris avec soi-même, l'erreur, sont ce qui importe dans la vie. Et qui l'enrichit. Celui qui ne se contredit jamais est mort. L'erreur n'est pas seulement humaine, elle est l'humain. Seul l'animal ne se trompe jamais... »
Il arrive qu'Axel Matthes prenne la plume. Dans un livre produit par ses soins, il glisse ces quelques réflexions :
« Ce que nous voulons, c'est créer un pôle d'observation possible : non mettre sur pied une théorie complète, capable de contenir tout et n'importe quoi. Ce qui nous plaît, au contraire, c'est ce qui est inclassable, et le fait que cela soit inclassable. Nous valorisons des élans impopulaires, soupapes de sûreté des hommes, des valeurs et des individus. (...) La révolte est le signe d'une rupture avec tout ordre. Elle a plusieurs visages. La révolte est une chose, la façon dont elle s'exprime en est une autre. II y a la révolte de l'homme sans consistance ou du démagogue, qui aggrave encore l'étiolement de l'homme, exaspère son désir de soumission, sa mentalité d'esclave, sa recherche de la chaleur doucereuse du troupeau. Et il y a la révolte de l'individu rebelle. L'hypocrite et l'intrépide ont de la révolte une conception diamétralement opposée. L'Église a expédié aux enfers tous les “grands hommes” : cette “révolte” déplut à Nietzsche. Je proclame la révolte contre tous les discours établis de la révolte ! »
On ne saurait trouver mots plus beaux pour décrire la mentalité postmoderne. De Gerd Bergfleth, qu'il nous faut ici présenter, nous ne savons rien, pas même son âge. Nous savons seulement qu'il est particulièrement bien vu chez Axel Matthes.
Mais l'atmosphère n'est pas tout. Il est faux de croire que les auteurs postmodernes ne sont pas des bûcheurs. L'œuvre principale (à ce jour) de Gerd Bergfleth s'intitule “Théorie du gaspillage” (Theorie der Verschwendung). Il s'agit d'une analyse serrée de la pensée complexe de Georges Bataille (1897-1962), l'un des pères spirituels de la postmodernité... et de Bergfleth. Les livres de Jean Baudrillard, germaniste et sociologue né en 1929, ne sont pas, eux non plus, d'abord facile. Dans le registre des textes édités chez Matthes & Seitz, ils complètent avantageusement ceux de Bergfleth. Baudrillard est le vétéran de 1968 qui a fait passer dans la postmodernité son expérience du front. Le monumental Dictionnaires des philosophes (en 2 tomes volumineux publiés en 1984 par Denis Huisman aux PUF) indique que tous les chefs de file, ou presque, du mouvement de 1968 sont naguère passés entre ses mains. Matthes vient d'éditer la traduction allemande de sa Gauche divine qui retrace méthodiquement la façon dont la gauche française s'est suicidée entre 1977 et 1984 (donc en partie sous François Mitterrand). Cette pénible expérience a laissé chez Baudrillard un traumatisme qu'il partage avec tous les auteurs postmodernes ; il professe pour l'épouvantail appelé “société” un mépris que même un homme de droite normalement constitué n'oserait articuler :
« Le social, l'idée de social, le politique, l'idée de politique, n'ont sans doute jamais été portés que par une fraction minoritaire. Au lieu de concevoir le social comme une sorte de condition originelle, d'état de fait qui englobe tout le reste, de donnée transcendantale a priori, comme on a fait du temps et de l'espace (mais justement, le temps et l'espace ont depuis été relativisés comme code, alors que le social ne l'a jamais été — il s'est au contraire renforcé comme évidence naturelle : tout est devenu social, nous y baignons comme dans un placenta maternel, le socialisme est même venu couronner cela en l'inscrivant comme idéalité future — et tout le monde fait de la sociologie à mort, on explore les moindres péripéties, les moindres nuances du social sans remettre en cause l'axiome même du social) — au lieu de cela il faut demander : qui a produit le social, qui règle ce discours, qui a déployé ce code, fomenté cette simulation universelle ? N'est-ce pas une certaine intelligentsia culturelle, techniciste, rationalisante, humaniste, qui a trouvé là le moyen de penser tout le reste et de l'encadrer dans un concept universel (le seul peut-être), lequel s'est trouvé peu à peu un référentiel grandiose : les masses silencieuses, d'où semble émerger l'essence, rayonner l'énergie inépuisable du social. Mais a-t-on réfléchi que la plupart du temps ni ces fameuses masses, ni les individus ne se vivent comme sociaux, c'est-à-dire dans cet espace perspectif, rationnel, panoptique, qui est celui où se réfléchissent le social et son discours ? »
« Il y a des sociétés sans social, comme il y a des sociétés sans écriture. » L'ex-gauchiste Baudrillard est reconnaissable à ses “phrases à tiroirs” (nous avons souligné nous-mêmes les passages importants). Mais il nous a amenés au point qui nous intéresse : des « sociétés sans social » : cela même qui passionne Bergfleth. Pour comprendre cette nouvelle constellation, il faut s'abstraire du paysage idéologique auquel est habitué l'homme de droit moyen.
Bergfleth a été marqué par son maître Georges Bataille dont l'anthropologie repose sur la distinction entre “production” et “gaspillage”. Selon Bataille, l'activité humaine ne se réduit pas entièrement à des processus de production et de reproduction, et la consommation doit être scindée en 2 domaines distincts. Le premier, réductible, englobe la consommation minimale nécessaire aux individus qui composent une société pour maintenir la vie et assurer la continuation de l'activité productrice... Le second englobe les fonctions dites “improductives” : le luxe, la liturgie funéraire, les guerres, les cultes, la construction d'édifices de prestige, les jeux, le théâtre, les arts, la sexualité perverse (indépendante des fonctions purement reproductrices). Autant d'activités qui, au moins à l'origine, sont à elles mêmes leur propre fin.
Dès lors, l'humanité poursuit 2 objectifs : l'un, négatif, consiste à maintenir la vie (ou à éviter la mort) ; l'autre, positif, consiste à accroître son intensité. Ces 2 objectifs ne sont pas contradictoires. Mais l'intensité ne peut être accrue sans risque, si bien que l'intensité à laquelle aspire la majorité (ou le corps social) est subordonnée au désir de se cramponner à la vie et à ses œuvres...
Cette antithèse intensité/durée, chère à Georges Bataille, nous apparaît le moteur le plus puissant de la pensée postmoderne (l'opposition cioranienne entre l'Être et le Néant apparaît, elle, plus légère). Bergfleth fait sienne cette impulsion et la met en forme à sa manière. Sa “théorie du gaspillage”, telle qu'il l'expose dans Ich gestatte mir die Revolte (“Je m'offre le luxe d'une révolte”, anthologie éditée par Matthes), contient 2 réflexions capitales :
Première réflexion :
« ... Le gaspillage de l'homme par luimême reste possible. Il se distingue essentiellement du gaspillage industriel, chosifié. Dans sa forme la plus générale, l'autogaspillage est identique à la césure car celleci n'est rien d'autre que le mouvement de dépassement et de sortie de soi-même. Elle n'est pas un acte philosophique ; elle suppose à chaque fois l'engagement de l'homme total. S'il existait une chose qui s'appelât “l'essence de l'homme”, on pourrait voir dans ce sacrifice une perte d'essence mais l'auto-gaspillage signifie précisément que cette essence est perdue à jamais. C'est parce que l'homme est dénué de fondement qu'il peut transgresser lui-même. En dépit du mythe tout-puissant de la production, les possibilités de ce gaspillage de l'homme par lui-même sont, aujourd'hui encore, immensément riches. Ce sont, pour n'en citer que les formes essentielles : la catégorie des dépenses agonales : compétitions, jeux de toutes sortes ; les formes de l'investissement effectif : rire, pleurer, etc. ; les formes symboliques : la littérature, l'art et la musique ; les formes “excessives” proprement dites : les diverses formes de l'ivresse, de la danse, de l'érotisme, de l'orgie. Enfin et surtout, ce que j'appellerais les formes actuelles du sacré : la révolte, le sacrifice révolutionnaire, la fête de la mort comme vie en train de vivre, s'offrant comme expérience directe. Dans toutes ces formes, je gaspille ce que je suis, non ce que j'ai... »
Seconde réflexion :
« Le gaspillage n'a jamais été charitable, et aucune raison n'est là pour le justifier. L'absence de salut est une autre composante de l'homme, et pas seulement cette absence mais la passion de cette absence. Toute la civilisation humaine montre qu'il existe un besoin inextinguible d'excès et d'émotion, aspiration qui résulte, en définitive, de la conscience de la mort. Sachant qu'il doit mourir, l'homme doit sans cesse se prouver qu'il sait mourir, il doit introduire la mort dans l'existence et tenter l'impossible : réaliser cette absence de fondement qui est dans sa nature. Tout gaspillage est fondé sur cette absence, sur le non-espoir constitutif de l'homme, qui toujours le pousse aux extrêmes. Cependant, la menace extrême est aussi sa possibilité la plus haute et s'il ne recule pas, cette possibilité se mue en une folle béatitude. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui semble s'être produit : la mort a cessé d'être une possibilité suprême ; elle est devenue une réalité de masse, et toute une société anxieuse a les yeux fixés sur sa propre survie et celle de l'humanité. Mais la réalité n'est pas la possibilité et la survie n'est pas la vie. La mort, toute puissante sous le règne ensorceleur de la production, est toujours la mort des autres : la mort-production procède d'un refoulement de la mort sans doute sans équivalent dans l'histoire. La seule chose qui n'arrive jamais dans cette subversion presque parfaite, c'est la mort de soi, et si un renouveau de la vie est encore possible, c'est là, au point creux de cette logique, qu'il devra s'amorcer. Si la mort évacuée n'apporte que la mort, il nous faut d'abord apprendre à mourir pour pouvoir vivre. La volonté de survie à tout prix est une catégorie du darwinisme social : elle est suspecte de meurtre. La sécurité n'est pas là où l'on cherche fébrilement la sûreté, elle se trouve là où l'on est assez sûr pour se permettre de la gaspiller. » (Passages soulignés par l'auteur).
Le lecteur n'est pas tenu de souscrire aveuglément à tous les propos de Bergfleth. Il devrait pourtant prêter l'oreille à ce sermon insolite. On se demande souvent : “Que faire de la postmodernité ?” La réponse est simple : après 1945, les conservateurs ont trop misé sur la durée, négligeant l'autre pôle de la vie que Bergfleth nous rappelle avec insistance. “On ne vit pas seulement de pain”. Cette vieille sagesse a été oubliée. C'est la cause de toutes les défaites conservatrices dans notre société de bien-être.
► Armin Mohler, éléments n°60, 1986. (tr. fr. : Jean-Louis Pesteil)

◘ Quand Bataille attaquait le principe métaphysique de l’économie
[Ci-contre L'Acéphale, dessin d'André Masson pour la revue éponyme de George Bataille]
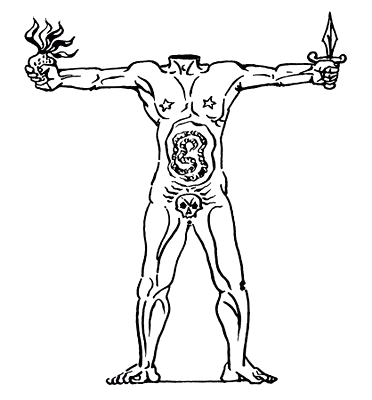 Continuité, souveraineté, intimité, immensité immanente : une seule pensée chez Bataille, une seule pensée mythique derrière ces termes multiples : « Je suis de ceux qui vouent les hommes à d’autres choses que la production sans cesse accrue, qui les provoquent à l’horreur sacrée ».
Continuité, souveraineté, intimité, immensité immanente : une seule pensée chez Bataille, une seule pensée mythique derrière ces termes multiples : « Je suis de ceux qui vouent les hommes à d’autres choses que la production sans cesse accrue, qui les provoquent à l’horreur sacrée ».
Le sacré est par excellence la sphère de « la part maudite » (l’essai central de ce septième tome des Œuvres de Bataille), sphère de la dépense sacrificielle, du luxe et de la mort ; sphère d’une économie “générale” qui contredit à tous les axiomes de l’économie proprement dite (une économie qui, en se généralisant, brûle ses limites et passe vraiment au-delà de l’économie politique, ce que celle-ci, et toute la pensée marxiste, sont impuissantes à faire selon la logique interne de la valeur). C’est aussi la sphère du non-savoir.
Paradoxalement les œuvres réunies ici sont en quelque sorte le « Livre dû Savoir » de Bataille, celui où il essaie de dresser les contreforts d’une vision qui, au fond, n’en a pas besoin, dont la pulsion vers le sacré devrait même, dans son incandescence destructrice, nier ce type d’apologie et d’exposé discursif que sont la Part Maudite et la Théorie de la Religion. « Ma position philosophique est fondée sur le non-savoir concernant l’ensemble, le savoir ne concernant jamais que les détails. » Il faut donc lire ces fragments apologétiques sur le double versant du savoir et du non-savoir.
Le principe fondamental
L’idée centrale est que l’économie qui gouverne nos sociétés résulte d’une malversation du principe humain fondamental, qui est un principe solaire de dépense. D’emblée, la pensée de Bataille s’attaque, au-delà de l’économie proprement politique (qui, pour l’essentiel, se règle sur la valeur d’échange) au principe métaphysique de l’économie : l’utilité. C’est l’utilité qui est visée à sa racine — principe apparemment positif du capital : accumulation, investissement, amortissement, etc. — en fait, principe d’impuissance, incapacité totale de dépenser, ce que savaient faire toutes les sociétés antérieures, déficience incroyable, et qui coupe l’être humain de toute souveraineté possible. Toute l’économie se fonde sur ce qui ne peut plus, ne sait plus se dépenser, sur ce qui ne peut plus devenir l’enjeu d’un sacrifice — elle est donc tout entière résiduelle, c’est un fait social restreint, et c’est contre l’économie comme fait social restreint que Bataille veut dresser la dépense, la mort et le sacrifice comme fait social total — tel est le principe de l’économie générale.
Le principe d’utilité (valeur d’usage) se confond avec la bourgeoisie, avec cette classe capitaliste dont la définition pour Bataille (contrairement à Marx) est négative : elle ne sait plus dépenser. De même la crise du capital, sa fatalité grandissante et son agonie immanente ne sont pas liées comme chez Marx à une histoire, à des péripéties dialectiques, mais à cette loi fondamentale de l’incapacité de dépenser, qui livre le capital au cancer de la production et de la reproduction illimitée. Pas de principe de révolution chez Bataille : « La terreur des révolutions n’a fait que subordonner de mieux en mieux l’énergie humaine à l’industrie ». Mais un principe de sacrifice — seul principe de souveraineté, dont le détournement par la bourgeoisie et le capital fait passer toute l’histoire humaine du tragique sacré au comique de l’utile.
Cette critique est une critique non marxiste, une critique aristocratique. Parce qu’elle vise l’utilité, la finalité économique comme axiome de la société capitaliste. Alors que la critique marxiste n’est qu’une critique du capital venue du fond des classes moyennes et petites-bourgeoises, à qui le marxisme a servi depuis un siècle d’idéologie latente : critique de la valeur d’échange mais exaltation de la valeur d’usage — critique donc en même temps de ce qui faisait encore la grandeur presque délirante du capital, de ce qui restait en lui de religieux sécularisé (1) : l’investissement à tout prix, au prix même de la valeur d’usage. Le marxiste, lui, cherche un bon usage de l’économie. Il n’est donc qu’une critique restreinte, petite-bourgeoise, un pas de plus dans la banalisation de la vie vers le “bon usage” du social ! Bataille, à l’inverse, balaie toute cette dialectique d’esclaves d’un point de vue aristocratique, celui du maître aux prises avec sa mort. On peut taxer cette perspective de pré- ou post-marxiste. De toute façon, le marxisme n’est que l’horizon désenchanté du capital — tout ce qui le précède ou le suit est plus radical que lui.
Ce qui reste incertain chez Bataille (mais sans doute cette incertitude ne peut pas être levée), c’est de savoir si l’économie (le capital), qui s’équilibre sur des dépenses absurdes, mais jamais inutiles, jamais sacrificielles (les guerres, le gaspillage…), n’est quand même pas traversé de part en part par une dynamique sacrificielle ; l’économie politique n’est-elle au fond qu’un avatar contrarié de la seule grande loi cosmique de la dépense ? Toute l’histoire du capital n’est-elle qu’un immense détour vers sa propre catastrophe, vers sa propre fin sacrificielle ? Car enfin, on ne peut pas ne pas dépenser. Une plus longue spirale entraîne peut-être le capital au-delà de l’économie, vers une destruction de ses propres valeurs, ou bien sommes-nous pour toujours dans ce déni du sacré, dans le vertige du stock, qui signifie la rupture de l’alliance (de l’échange symbolique dans les sociétés primitives) et de la souveraineté ?
Bataille eût été passionné par l’évolution actuelle du capital vers la flottaison des valeurs (qui n’est pas leur transmutation) et la dérive des finalités (qui n’est pas non plus l’inutilité souveraine ou la gratuité absurde du rire et de la mort, au contraire). Mais son concept de défense eût mal permis de l’analyser : il est encore trop économique, trop proche de la figure inverse de l’accumulation, comme la transgression est trop proche de la figure inverse de l’interdit (2). Dans un ordre qui n’est plus celui de l’utilité, mais un ordre aléatoire de la valeur, là pure dépense ne suffit plus au défi radical, tout en gardant le charme romantique d’un jeu inverse de l’économique — miroir brisé da la valeur marchande, mais impuissante contre le miroir en dérive de la valeur structurale.
Bataille fonde son économie générale sur l’« économie solaire » sans contrepartie, sur le don unilatéral que nous fait le soleil de son énergie : cosmogonie de la dépense, qui se déploie en une anthropologie religieuse et politique. Mais Bataille a mal lu Mauss : le don unilatéral n’existe pas. Ce n’est pas la loi de l’univers. Lui qui a si bien exploré le sacrifice humain des Aztèques aurait dû savoir comme eux que le soleil ne donne rien, il faut le nourrir continuellement de sang humain pour qu’il rayonne. Il faut défier les dieux par le sacrifice pour qu’ils répondent par la profusion. Autrement dit, la racine du sacrifice et de l’économie générale n’est jamais la pure et simple dépense, ou je ne sais quelle pulsion d’excès qui nous viendrait de la nature, mais un processus incessant de défi.
Bataille a “naturalisé” Mauss
L’« excès d’énergie » ne vient pas du soleil (de la nature) mais d’une surenchère continuelle de l’échange — processus symbolique lisible chez Mauss, non pas celui du don (ça, c’est la mystique naturaliste où tombe Bataille) mais celui du contre-don — seul processus véritablement symbolique et qui implique en effet la mort comme une sorte d’excès maximal — mais pas comme extase individuelle, toujours comme principe maximal d’échange social. Dans ce sens, on peut reprocher à Bataille d’avoir “naturalisé” Mauss (mais dans une spirale métaphysique tellement prodigieuse que le reproche n’en est pas un), et d’avoir fait de l’échange symbolique une sorte de fonction naturelle de prodigalité, à la fois hyper-religieuse dans sa gratuité et bien trop proche encore, a contrario, du principe d’utilité et de l’ordre économique qu’elle s’épuise à transgresser sans jamais le perdre de vue.
C’est « à hauteur de mort » qu’on retrouve Bataille, et la vraie question posée reste : « Comment se fait-il que les hommes aient tous éprouvé le besoin et ressenti l’obligation de tuer des êtres vivants rituellement ? Faute d’avoir su répondre, tous les hommes sont demeurés dans l’ignorance de ce qu’ils sont ». Il y a une réponse à cela sous le texte, dans tous les interstices du texte de Bataille, mais à mon avis pas dans la notion de dépense, ni dans cette sorte de reconstruction anthropologique qu’il essaie de faire à partir des données “objectives” de son temps : marxisme, biologie, sociologie, ethnologie, économie politique, dont il essaie quand même de rassembler le potentiel objectif, dans une perspective qui n’est ni exactement une généalogie, ni une histoire naturelle, ni une somme hégélienne, mais un peu de tout cela.
Mais l’exigence du sacré, elle, est sans faille dans son assertion mythique, et la volonté didactique est sans cesse trouée par la vision fulgurante de Bataille, par un « sujet du savoir » toujours « au point d’ébullition », qui fait que même les considérations analytiques ou documentaires ont toujours cette force de mythe qui fait la seule force — sacrificielle — de l’écriture.
1. La « rage puritaine des affaires » (l’argent gagné l’est pour être investi… n’ayant de valeur ni de sens que dans l’enrichissement sans fin qu’il engage), en ce qu’elle comporte encore une sorte de démence, de défi et de compulsion catastrophique — sorte de rage ascétique, s’oppose au travail, au bon usage des énergies dans le travail et l’usufruit.
2. La destruction (même gratuite) est toujours ambiguë, puisque figure inverse de la production, et tombant sous l’objection que pour détruire il faut d’abord avoir produit, ce à quoi Bataille ne peut opposer que le soleil.
♦ Georges Bataille, Œuvres complètes, T. VII, Gallimard, 618 p.
► Jean Baudrillard, La Quinzaine littéraire n°234, juin 1976.
◘ Échanges Bergfleth-Baudrillard :
- « Baudrillard und dit Todesrevolte », appendice de G. Bergfleth à : Der symbolische Tausch und der Tod, J. Baudrillard, Matthes & Seitz, Munich, 1982
- Der Tod der Moderne : Eine Diskussion, Jean Baudrillard, Gerd Bergfleth, Horst Folkers et al., Tübingen, Konkursbuch Verlag 1983
- « Die Fatalität der Moderne : Interview mit Jean Baudrillard », in Gerd Bergfleth et al., in : Zur Kritik der palavernden Aufklärung, Matthes & Seitz, Munich, 1984, pp. 133-144 [tr. ang. : « The Power of Reversibility That Exists in the Fatal », in : Baudrillard Live, 1993, pp. 43-49].

C'était le premier jour de vrai printemps après un long hiver pluvieux. Sur le trottoir une vieille mendiante me précédait. J'accélérai le pas. Je n'ai jamais beaucoup aimé les clochards. Question d'odorat, probablement ! Mais selon mon habitude, je me retournai sur elle lorsque je la dépassai et vis qu'elle avançait à pas lents, retenant de sa main droite en le soulevant légèrement, un pan de son haillon. Cette femme déchue avait le maintien et la démarche d'une infante d'Espagne. Le matin même, on m'avait demandé cet article sur Jean Genet qui venait de mourir, et voilà qu'il m'envoyait ce clin d'œil bien caractéristique de son œuvre.
Pauvre Jean Genet, hissé par le chœur des pleureuses au rang des écrivains officiels ! Depuis Sartre, les intellectuels bien-pensants, en bons pédagogues soucieux de normaliser un délinquant, n'ont jamais désespéré de mener cet ancien taulard sur la “voie de la socialisation”. Le temps de la récupération semblait enfin venu avec la France socialiste : l'inévitable Jack Lang lui remettait en 1983 le Grand Prix national des Lettres (mais Genet eut le bon goût de se récuser) ; la Comédie-Française l'inscrivait à son répertoire. À cet éloge funéraire tendancieux, il fallait une fausse note. Elle est venue de l'extrême-droite. Ceux qui n'ont pas encore digéré le scandale des Paravents à l'Odéon, pour y avoir vu une atteinte à l'honneur de l'armée française — qui en 1966 en avait subi bien d'autres — se sont déchaînés contre l'auteur de cette pièce plutôt ratée. Pour les inconditionnels de la “France d'abord”, celle qui ne fait pas la moue sur Peyrefitte, ce Voltaire de pissotière, mais reproche à Genet « de s'enorgueillir de ce que l'on cache », la disparition de cet écrivain laisse « un monde un peu plus propre » (Minute, 18 avril 1986). Je suis sûr que des 2 hommages, celui des embaumeurs et celui qui crache sur son cadavre, Jean Genet aurait préféré le dernier. Sous sa plume, les crachats se transfiguraient en roses.
Quand Jean-Paul Sartre assassine Genet
Il ne s'agit pas de défendre Genet pour ce qu'il a revendiqué être : homosexuel, traître, voleur, presque criminel (mais trop lâche pour cela). Avec ce palmarès il a excité les salons littéraires et conforté le masochisme de la caste intellectuelle.
Mais si Genet se prêta un peu à ce jeu au tournant des années 50, il cessa rapidement d'être l'otage de qui que ce fût. Ceux qui voyaient en lui un révolutionnaire et espéraient des manifestes pleurnichards sur l'injustice, les prisons et la peine de mort, durent ravaler très vite leur déception. Ils n'avaient découvert qu'un révolté, un solitaire taillé dans la plus belle eau.
La vie de Jean Genet offre peu d'intérêt : en fait l'écrivain a toujours transfiguré le réel. Quelques repères s'imposent cependant. Il naît en 1910 de parents inconnus, passe son enfance chez des paysans du Morvan, commet très tôt quelques vols qui le conduisent en maison de redressement. Puis, c'est l'errance d'une vie de mendiant et de prostitué dans toute l'Europe des ports, des basfonds où grouillent voleurs, trafiquants et maquereaux, et toujours, quel que soit le pays, la prison et l'expulsion.
À Fresnes, il écrit son premier poème, le Condamné à mort, à la gloire d'un assassin qu'il transforme en demi-dieu. Pour chanter l'abjection, le crime, le monde des réprouvés, il choisit la métrique la plus conventionnelle — l'alexandrin —, usant d'une langue superbe, parfois précieuse, extrêmement musicale, plus proche des symbolistes que celle des surréalistes anarchisants :
J'ai tué pour les yeux bleus d'un bel indifférent
Qui jamais ne comprit mon amour contenue,
Dans sa gondole noire une amante inconnue,
Belle comme un navire et morte en m'adorant.
Toujours prisonnier, Genet écrit en moins de 5 ans l'essentiel de son œuvre poétique et romanesque. Son lyrisme chatoyant se déploie pour magnifier les travestis (Notre-Dame des Fleurs), les délinquants du bagne d'enfants de Mettray et les condamnés de la centrale de Clairvaux (le Miracle de la Rose), les matelots et les policiers (Querelle de Brest) et, dans son roman le plus sulfureux, le plus irrécupérable, Pompes funèbres, les SS, les miliciens et les résistants. Lorsqu'il est gracié en 1948, il entreprend une autobiographie héroïsée dont seul paraîtra le premier tome, Journal du Voleur (1949). Délivré des contraintes carcérales, Genet n'a plus besoin de s'évader dans la littérature.
Pour son malheur il intéresse Sartre qui “commet” sur lui un énorme pavé, Saint Genet, comédien et martyr (1952). Mis à nu, violé par un philosophe insensible au sacré, qui nie la dimension métaphysique de sa révolte et lui explique qu'il n'y a pas d'archétype du Mal, voici Genet réduit à un pauvre garçon en délicatesse avec la société. D'un trait de plume, un professeur à lunettes a évacué ses fleurs de rhétorique et piétiné ses jardins secrets : Genet ne se livrera plus. Le romancier-poète meurt assassiné par l'Université. Après quelques années d'hébétude, de vide intérieur, il a cru trouver son salut dans le théâtre qu'il avait déjà abordé à la prison de la Santé avec Haute Surveillance et les Bonnes (1944), sa pièce la plus jouée. Le Balcon (1956), les Nègres (1958), puis enfin les Paravents (1961) ont été accueillis avec ferveur, mais non sans ambiguïté, par les partisans de l'antithéâtre.
Aujourd'hui l'audace des pièces de Jean Genet nous apparaît bien émoussée. Moins objets de divertissement que cérémonies funèbres, ses pièces visent au Sacré. En exprimant l'intention que les théâtres soient établis au milieu de cimetières afin d'associer les morts aux vivants, Genet a voulu renouer, sans en prendre tout à fait conscience, avec les origines les plus lointaines du théâtre grec, né du culte des héros morts. Malheureusement étouffée dans le moule sartrien, la langue de Genet s'intellectualise, se prend à penser et ne trouve comme lieu sacré de représentation qu'une architecture bourgeoise — l'Odéon — ou les maisons bétonnées de la culture. Dans ce monde qui a perdu le goût de la cérémonie, le théâtre de Genet, du moins tel qu'on peut le rêver, n'a guère sa place.
Conscient de son échec, Genet se réfugie dans le silence. Il n'en sort que pour défendre les plus rejetés, ceux qui ne trouvent pour s'exprimer, que la violence : les Black Panthers en Amérique, les Palestiniens, les immigrés en France et la bande à Baader en Allemagne. Il intervient sans a priori idéologique, se justifiant par cette phrase superbe qui a dû en faire sursauter plus d'un : « Ils ont le droit pour eux, puisque je les aime ». Jean Genet prônait le droit suprême à l'injustice.
Une œuvre éminemment aristocratique
Réprouvée par les tenants de l'ordre moral pour les “vices” qu'elle met en scène, jugée réactionnaire par les partisans du nouveau roman pour le classicisme de sa phrase, l'œuvre de Jean Genet occupe une place singulière. Mauriac lui reprochait de charrier de la merde dans la langue de Racine. Cette accusation de pornographie qui contribua quelque temps à sa réputation scandaleuse ne tient pas. La grossièreté, l'obscénité de Genet, constamment magnifiées par un vocabulaire somptueux, ne sont jamais vulgaires. Dans un monde intellectualisé, distancié, Genet se comporte comme un primitif (ou un enfant, c'est pareil) pour qui la sensation — surtout toucher, sentir et voir — constitue un moyen de connaissance. Toute sa relation au monde passe donc par le corps qu'il convient de nommer. En citant les lieux de son désir — la pâleur d'un teint, une main coupée, des couilles blondes et rondes — et non en les contournant par une allusion, il provoque en lui une terreur sacrée qui le met en contact avec les forces de l'Univers.
Évoquer Sade à son propos relève donc du malentendu le plus total. Pour Genet le corps est moins un objet désiré à soumettre qu'une ouverture vers la divinité du monde. Le situer dans la tradition des blasons du corps en vogue au XVIe siècle ou des stupra de Rimbaud ne m'apparaît guère plus convaincant. Il y a trop de ferveur religieuse dans son désir pour ne pas penser immédiatement aux mystères dionysiaques : rencontre, signes, exaltation qui provoque le chant poétique, tout un parcours initiatique aboutit à un dévoilement du sexe, à cet Éros qui chez les Grecs animait le monde.
On a également reproché à Genet sa préciosité. Roger Nimier l'avait surnommé « la Mademoiselle Scudéry du bagne ». Formule méchante, mais assez juste. Malgré les personnages qu'il met en scène, Genet n'a vraiment rien d'un auteur populaire. Sa phrase est mouvante, fuyante, parfois alambiquée, souvent truffée d'imparfaits du subjonctif ; son vocabulaire emprunte beaucoup aux symbolistes et à leurs excès.
L'argot, qu'il emploie presque uniquement dans les dialogues, intervient non pas pour donner une couleur locale — Genet n'a cure du réalisme — mais plutôt comme un bijou, une pierre monstrueuse (étymologiquement un barroco) destiné à rehausser ses truands. On peut juger que cette langue surchargée comme une toile de Gustave Moreau, non exempte parfois de saint-sulpiceries, de maniérismes, a parfois vieilli. Mais rien de moins gratuit que son lyrisme.
Outre qu'il maîtrise parfaitement son style, Jean Genet a besoin de sublimer, de retrouver la Beauté par l'écriture, d'inverser pour son salut en ceintures de roses, en palais, en héros ce qui en réalité n'étaient que chaînes, cellules grises et voyous minables, bref de créer comme il l'a écrit « une légende dorée ».
Est-ce l'effet d'une critique trop intellectuelle, paralysée par Sartre, on a surtout souligné chez lui certains aspects négatifs, comme la révolte sociale, la marginalité, les cris de haine, l'inversion totale des valeurs, sans se rendre compte que son œuvre retrouve d'instinct la construction mythique. Primitif, ce qui ne veut pas dire naïf, il transfigure le réel par le chant ; il ritualise.
Le Miracle de la Rose, par ex., tient plus de la chanson de geste que du roman. À partir d'une réalité sordide — l'univers des prisons rempli d'individus vomis par la société —, Genet se créé un royaume qui a ses lieux magiques (le mitard, la salle de discipline avec « sa tinette impériale »), son île merveilleuse (la Guyane), et même son Graal (la cellule du condamné à mort Harcamone, éclairée jour et nuit).
Tous ces réprouvés sont des aristocrates du Mal, des êtres nobles au sens strict du terme, qui se déplacent lentement, transforment leurs gestes en signes, portent chacun, telle une armoirie, une particularité, tatouage, cicatrice ou expression argotique. Ils calquent leur attitude sur des modèles qu'ils élèvent au rang de Puissances archétypales : le Dur, le Voleur, l'Assassin. Par toute une série de rites de passage proches de la société guerrière qu'ils reconstituent spontanément, ils vont de dureté en dureté, de mitard en mitard, subir les épreuves d'où ils sortiront purifiés. Pour Genet qui refuse de se reconnaître en tout homme, car chacun porte en soi une royauté secrète, le héros absolu, « celui qui a élevé son destin comme on élève une tour », est le Condamné à mort, modèle inaccessible, dépouillé de toutes contingences terrestres, à la fois nouveau Parsifal et victime expiatoire.
Rien de moins anarchique que ce monde clos. Les prisons de Genet sont des palais où l'étiquette pèse autant qu'à l'Escurial. On y obéit à un rituel strict dont le langage codé, les règles vestimentaires, les échelons de peine, les cortèges nuptiaux et funèbres n'ont d'autre but que d'établir une hiérarchie que nul n'envisagerait de transgresser. « Fils de rois, princes, conquistadors », les durs appartiennent à une caste noble, une sorte de garde de fer. Au-dessous d'eux, à leur service, s'agitent les favoris, les courtisans, les clodos enfin, « peuple noir et laid, chétif et rampant sans qui le patricien n'existe pas ». Tous cousins, comme les Atrides ou les princes de la Renaissance italienne, ils se désirent, s'aiment, s'injurient en formules homériques, se battent pour leur honneur, s'entretuent ou immolent l'un d'entre eux, bref portent au paroxysme leur existence « tragique et noble ».
Parce qu'elle parle d'assassins, de voleurs, de traîtres et de pédés, on a oublié que l'éthique de Jean Genet est éminemment aristocratique, à l'opposé de la sentimentalité baveuse qui fait florès depuis des décennies. « La noblesse est prestigieuse », écrit-il dans Notre-Dame des Fleurs. « Le plus égalitariste des hommes, s'il n'en veut convenir, subit ce prestige et s'y soumet. Deux attitudes en face d'elles sont possibles : l'humilité ou l'arrogance, qui l'une et l'autre sont la reconnaissance explicite de son pouvoir ». L'idée que tous les hommes puissent être frères l'écœure. Il préfère s'en tenir à une fraternité d'Ordre, proche du clan, qu'il a connue en prison. Si, plus tard, il choisira de défendre certains opprimés — les Palestiniens par ex. —, il ne justifiera pas son engagement par des raisons idéologiques, mais seulement émotionnelles : les frères qu'il entend se choisir sont maudits et debout dans la révolte. Amateurs des droits de l'homme, s'abstenir.
Tout ce qu'a écrit Genet sur la prison ou la peine de mort est à cet égard significatif. Pour lui, le casseur, le dur, en volant ou en tuant, met son corps en péril tel un guerrier. Il ne mérite pas la prison : c'est la prison qui se doit d'être à sa hauteur, d'où la nécessité d'un code sévère et strict, d'un règlement sans faille. « L'enfant criminel, c'est celui qui a forcé la porte sur un endroit défendu. Il veut que la porte ouvre sur le plus beau paysage du monde : il exige que la bagne soit féroce. Digne enfin du mal qu'il s'est donné pour le conquérir » (L'Enfant criminel, 1948 ; ce texte écrit pour la radio sera interdit).
Le rôle de la prison est donc de travailler le condamné comme la matière la plus dure, d'en faire, en le mettant à l'écart, une espèce de “supra-terrestre”, ce qui lui permettra au sommet de son ignominie d'accéder à la sainteté. Inutile d'ajouter que Genet rejette l'indulgence de la Justice. Il demanderait plutôt un surcroît de répression. Il refuse une société qui, par hypocrisie ou par lâcheté, trouve toujours une excuse aux criminels, « car c'est insulter un coupable que de le vouloir innocent » ; il regrette la suppression de Cayenne comme si on l'avait « opéré de l'infamie » ; il va même jusqu'à souhaiter qu'on rétablisse les bagnes d'enfants, « car détruits, ils seraient remontés par des enfants ».
Peut-être n'est-ce là que littérature, mais n'oublions pas qu'il écrivait ceci en prison. En fait, il estime que tout un système s'est dégradé à partir de 1940 ; en enfermant un grand nombre d'innocents, la guerre a dissous la dureté des prisons pour les transformer en « lieux de lamentations ». Depuis, l'air du temps a même contaminé les prisonniers : ils accusent, ils militent contre les QHS, ils pleurnichent. Refusant d'assumer les conséquences de leurs actes, ils sont « incapables de se tenir au-dessus de leur propre abjection ». Ils ne demandent qu'à réintégrer la société. Leur absence d'orgueil ne les rend plus dignes d'être « les enfants des anges ».
Genet revendique le droit aux honneurs du Non
Loin de lui faire horreur, la peine de mort le fascine. L'assassin, instrument du destin, porte en lui-même sa condamnation : il espère le châtiment. Devenu le grand bouc émissaire de la société, il est nécessaire qu'il meure. Mais sa mise à mort ne peut pas être accomplie sans un rituel quasi-religieux. Le lourd cérémonial de la Cour d'assises vise à recréer sur terre le jugement des Enfers. Tel un roi, le condamné à mort est à la fois seul et entouré, servi et gardé, couronné en Cour d'assises, revêtu d'insignes sacrés — ses chaînes et ses fers —, conduit en cortège funèbre jusqu'à la guillotine. À suivre Genet au bout de son raisonnement, la suppression de la peine de mort ne serait qu'un signe de plus de la désacralisation de notre société, une incapacité à isoler l'Intouchable, à désigner le tabou, en un mot à assumer l'horreur qu'est chaque crime.
S'il place le Mal et la Mort au centre de son œuvre, Genet, on le voit, n'a rien d'un écrivain contestataire. Il revendique seulement « le droit aux honneurs du Non » : non à la société américaine « qui prétend bannir le mal » ; non même à la réussite de sa révolte qui lui ôterait toute raison d'être. « Je voudrais, écrit-il, que le monde ne change pas, pour me permettre d'être contre le monde ». Être contre le monde. En érigeant la Traîtrise et l'Ignominie au rang de valeurs exceptionnelles, le poète dans sa prison voulait accéder à une sainteté monstrueuse, irrécupérable. La liberté lui ouvre une société où chacun y va de son petit reniement, se vautre dans l'infâmie comme un poisson dans l'eau. Devenu courant le mal ne présente plus aucun intérêt. Genet aurait pu gérer sa réputation d'écrivain maudit. Il a préféré le silence à la récupération de son cri. Belle destinée pour un traître que de mourir en homme d'honneur.
► Denys Magne, éléments n°59, été 1986.


