Syberberg
Contre l'esthétique des vainqueurs !
Entretien avec Hans-Jürgen SYBERBERG
 • Q : « Une nouvelle Allemagne, un nouvel art ». La fin de l'après-guerre signifie-telle aussi la fin de l'art de l'après-guerre ?
• Q : « Une nouvelle Allemagne, un nouvel art ». La fin de l'après-guerre signifie-telle aussi la fin de l'art de l'après-guerre ?
HJS : Notre situation globale, je la percevais, l'été passé, comme une impasse, surtout dans le domaine de l'esthétique. Puis est venu le fameux automne... Ce n'était plus une impasse mais une fin, la fin, la conclusion d'une époque, l'époque de l'après-guerre.
• Q. : Et l'art de cet après-guerre ?
HJS : En Allemagne, les pères fondateurs de l'intelligence officielle de notre après-guerre doivent constater leur faillite : Adorno, Bloch, Benjamin, Horkheimer, etc. Je dis cela, parce que j'ai le sentiment que la paralysie actuelle du débat intellectuel vient du fait que nous ne sommes pas en mesure de nous dresser contre cette génération d'émigrants. Mais eux le comprennent. Si quelque chose de neuf doit croître et se développer, ce qui est ancien, vermoulu, doit céder la place. Ce qui est ancien n'est pas a priori « bon » pour l'éternité. Pour me concentrer sur l'essentiel, je dirais que cette combinaison, où entrent 1) cette prétention morale, « vertuiste », affirmée par les ex-émigrants et 2) les positions des gauches, a conduit à cette paralysie de l'intelligence que l'on constate à l'Ouest, précisément parce que les positions des gauches sont devenues intouchables, ont reçu une sorte de cachet de noblesse parce qu'elles étaient défendues par des ex-émigrants.
• Q. : Voyez-vous les signes avant-coureurs d'une perestroïka dans notre monde culturel ?
HJS : Dans la partie orientale de l'Allemagne actuelle, beaucoup de choses ont changé, mais, chez nous, peu, du moins dans le domaine de la culture. Je constate qu'il y a ici, à l'Ouest, bien plus de girouettes et de staliniens qu'à l'Est. Dans le petit monde de la culture, on parle encore et toujours comme il y a vingt ans. Je n'ai pas vu un seul de nos « fonctionnaires » de la culture, ni au théâtre ni dans les journaux ni dans aucune institution qui patronne les sciences de l'esprit qui ait cédé sa place ni changer les paramètres qui régissaient son cerveau.
• Q : Est-ce l'héritage de 68 ?
HJS : Les soixante-huitards constituent, pour le moment, la génération qui a le plus d'efforts à fournir pour surmonter ses complexes. Mais je veux être clair: le processus que j'incrimine n'a pas commencé en 1968. En 68, on n'a fait que formuler clairement ce qui s'est passé depuis 1945. Je pense que la rééducation, commencée en 1945, a été une démarche erronée. Rien que le mot : aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne parle même plus d'éduquer un enfant, alors, vous pensez, vouloir transposer cela à tout un peuple... ! Un peuple qui devrait être éduqué puis rééduqué... ! Situation abominable ! Qui signifie en fait : aliéner le peuple par rapport à sa propre culture.
• Q : La culture de notre après-guerre a-t- elle été une culture des vainqueurs ?
HJS : Oui. Je vois en elle une esthétique du vainqueur. C'est simple : ce qui nous est arrivé après 1945 était une esthétique déterminée par les vainqueurs. À l'Ouest, les Allemands se sont conformés parfaitement à « cette liberté qui nous vient d'Occident »..., alors qu'ils auraient dû se demander, petit à petit, si cet apport correspondait bien à leur sentimentalité intime, aux sentiments intérieurs de leur nature profonde. C'est Aron, je crois, qui a dit que le mot « rééducation » ne lui avait pas plu dès le départ et il a toujours pensé qu'il fallait agir autrement. Mais il est l'un des rares à Paris - souvent des hommes de droite, de confession israëlite - à avoir pensé autrement. En Allemagne, nous avons subi une occupation qui nous a amené l'américanisation. Et, pour sauter quelques étapes, je trouve que les événements de l'an passé à Leipzig et dans d'autres villes nous ont fait du bien. Malheureusement, ce n'était pas une révolution culturelle mais c'était au moins une révolution née en Allemagne.
• Q : Avons-nous aujourd'hui un art sans peuple ?
HJS : L'art a toujours eu pour fonction d'affirmer la vie et non de la détruire. Au départ de cette affirmation, je pense que nous avons aujourd'hui un art qui, pour la première fois dans l'histoire, est dépourvu de « nature » ; en disant cela, je ne pense pas seulement à la nature physique, que nous sommes en train de saccager allègrement, mais à la 'nature psychique. Nous sommes en présence d'un art qui reflète les névroses de notre temps, ce qui revient à dire effectivement que c'est un art sans peuple, pire, un art qui s'impose contre le peuple. Résultat: l'art devient suspect. Les gens ne se rendent plus au théâtre, ne participent plus à rien, parce qu'ils n'ont plus confiance en rien, parce qu'ils ont le sentiment que cet art n'est pas notre art, que ce qu'ils voient représenté ne les concerne pas. Je ne dis pas que l'art doit briguer l'assentiment bruyant des masses et de la majorité mais je dis qu'il doit être accessible.
• Q : Le philosophe de l'esthétique Hans Sedlmayr a parlé de «perte du centre» (Verlust der Mitte). Le mal ne réside-t-il pas dans la « dé-localisation » (Entortung) de l'homme moderne ?
HJS : J'ai avancé une critique du « prêchi-prêcha sur la société multi-culturelle ». Ce discours est effectivement très dangereux car l'organisation multi-culturelle de la société conduit à l'élimination des valeurs propres à la population autochtone. Le vieil adage « Connais-toi toi-même » demeure, envers et contre tout, le présupposé sur lequel doit reposer toute rencontre avec l'autre. En revanche, si l'on provoque délibérément un mixage trop rapide, on jette les bases d'un monde « électronisé », où l'appréhension du monde ne s'effectue plus que par des clips, qui ne durent que quelques secondes. Tout cela, c'est une question d'écologie spirituelle. Le hommes d'aujourd'hui ne se rencontrent plus qu'au niveau du fast-food, même si l'éventail des marchandises offertes est assez large.
• Q : Comment pensez-vous que s'articulera cette « écologie spirituelle » que vous appelez de vos vœux ?
HJS : C'est en fait la question essentielle. Que se passera-t-il en effet, quand tous nos concitoyens de l'ex-RDA pourront déguster des bananes et auront troqué leurs vieilles Trabis contre des voitures d'occasion occidentales ? Leur curiosité pour ce qui est autre ne se tarira-t-elle pas ? Et nous, les intellectuels, sommes-nous capables de répondre à ce défi ?
• Q : Une dernière question : quand on vous balance l'étiquette de « fasciste », est-ce que cela vous gène ou vous amuse ?
HJS : Je me suis longtemps demandé s'il fallait que je dise les choses aussi ouvertement car une telle ouverture m'exposait, évidemment, au reproche de « fascisme ». En fin de compte, je me suis dit : « Maintenant ça suffit ! Cela n'a aucun sens de se cacher tout le temps et de mentir par confort ».
• Q : Monsieur Syberberg, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.
► propos recueillis par Ulrich Fröschle & Michael Paulwitz, Vouloir n°80/82, 1991.

Ainsi parle Hans-Jürgen Syberberg...
extraits de son ouvrage
Vom Unglück und Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege
 Après 1945, le centre de l'Europe était un désert, un monceau de ruines. Ses villes et ses campagnes avaient attiré le feu, comme l'étoupe attire la flamme. Et quand on s'est remis à construire, quelle pénible rénovation ! Tout est devenu anguleux, plat et lisse, pratique, sans âme. Tout pour l'enrichissement des masses. Les jeunes semblaient se rebiffer contre les vanités de leurs aînés ; ils semblaient vouloir rattraper les pays voisins... Ils se solidarisaient contre cette rénovation, car tout était faux en elle, elle était mensonge, elle ôtait toute motivation autre que l'enrichissement... Mais ces jeunes se sont détruit eux-mêmes par les drogues, se sont détruit le visage, se sont lacéré les vêtements, ont détruit leur langue, leur comportement, leur musique, leur moi.
Après 1945, le centre de l'Europe était un désert, un monceau de ruines. Ses villes et ses campagnes avaient attiré le feu, comme l'étoupe attire la flamme. Et quand on s'est remis à construire, quelle pénible rénovation ! Tout est devenu anguleux, plat et lisse, pratique, sans âme. Tout pour l'enrichissement des masses. Les jeunes semblaient se rebiffer contre les vanités de leurs aînés ; ils semblaient vouloir rattraper les pays voisins... Ils se solidarisaient contre cette rénovation, car tout était faux en elle, elle était mensonge, elle ôtait toute motivation autre que l'enrichissement... Mais ces jeunes se sont détruit eux-mêmes par les drogues, se sont détruit le visage, se sont lacéré les vêtements, ont détruit leur langue, leur comportement, leur musique, leur moi.
Tout cela est lisible dans l'art, dans les films, dans les pièces de théâtre, sur les sculptures... Casser le monde : une réaction au monde "sauf", "sacralisé" qu'offrait le Troisième Reich [...] On ne parle pas de détruire des cultures étrangères, ou des cultures passées, mais de détruire sa propre culture : le recours à l'élémentaire pour s'auto-détruire. La destruction la mieux réussie est l'auto-destruction de sa propre âme.
La fission de l'atome correspond à la fission de l'Europe et de l'Allemagne après la dernière guerre. Et la dislocation fondamentale du goût esthétique s'exprime dans la destruction, la mise en pièces, de l'âme. Et la mort qu'apportent les rayons correspond aux pertes psychiques de toute intériorité dans les arts et dans la culture. Il y a déclin du centre, du noyau, du foyer vif, de nos sentiments. (pp. 40-41).
La valeur suprême de l'esthétique post-hitlérienne est le postulat pluraliste de la liberté et de l'égalité de tous les styles et de toutes les orientations et de tous les individus [...]. Là où il n'y a plus de règles qui déterminent ce qui est bon et ce qui est mauvais, comme au jugement dernier, ce qui est le ciel et ce qui est l'enfer, ce qui est beau et ce qui est laid, là où ces hiérarchies nécessaires qui posent un haut et un bas, qui indiquent quels sont les intérêts centraux et les intérêts périphériques, quand les efforts humains, responsables devant le monde pour le tout, se dissolvent au profit d'éléments disparates, quand d'autres formes de décision prennent le dessus, d'autres hiérarchisations se développent et nous assistons au diktat du libre marché ou plutôt du marché prédéterminé. Prédéterminé par les modes et les pouvoirs changeants, plus imprévisibles que le Bien et le Mal, qui ressemblent aux transactions de la bourse des spéculateurs, dont les valeurs marchandes se déterminent au bruit, que tout un chacun est capable de produire. Principe de jungle, de jungle de la vie, pourrait-on dire [...]. Cette attitude négative constitue une culture contre-européenne et telle est son échelle de valeurs, échelle héritée de l'histoire, échelle qui impose un autre bien et un autre mal, un bien et un mal où l'âme n'est pas reliée à cette profondeur des choses, un bien et un mal qui conduisent au triomphe de cette égalité des marchands, à leurs intérêts, une égalité qui s'impose dans l'espace vidé des cathédrales, des châteaux, des paysages, des villes, des cerveaux, des zones épurées où s'établit le monde sans fond.
Là où triomphent les marchands et leur marché, là où ces messieurs disent ce qui doit avoir du succès, là où les médias dictent l'idéologie qu'il faut avoir, la pensée qu'il faut cultiver, la liberté de l'autre devient affaire de lobby, un lobby à tiroirs multiples, tiroirs où sont rangées toutes les idéologies : voilà le pluralisme. On parle alors de "groupes libres" ou de "cultures de quartier". Groupes et cultures qui doivent s'adapter à l'égalité dans la contestation qu'on leur permet d'acheter [...].
L'objectif : après une dissection par l'analytique, qui remplace l'approfondissement en direction de la raison du cœur, on aboutit au méli-mélo multiculturel de l'arbitraire général, où le Crépuscule des dieux de Richard Wagner vaut autant qu'un vidéo-clip pour fast-food-porno [...].
Les films émanant des multiples nations du monde sont parlés en anglais, comme si la langue était un condiment dépourvu de tout esprit qu'on pouvait saupoudrer à l'envi, pour satisfaire des intérêts financiers qui visent le plus grand marché ; ainsi les contribuables nationaux, qui financent le cinéma européen par le truchement des subventions, doivent consommer leurs propres produits en anglais, parce que les Américains ne sont pas capables de digérer autre chose. Ce qui est ici industrie, néo-colonialisme et rabougrissement de l'âme, on l'appelle "Multiculture" [...]. Et puisque le Satan de l'esthétique s'appelle Hitler et puisque la culture européenne est une culture de la beauté, qui n'entend rien au profit, et dont les héros ne procurent aucun bénéfice, et puisque cette culture, en plus, conduit à Auschwitz, il faut se venger et proclamer que l'art est business du laid, business du cul-de-jatte et de sa jactance [...].
Celui qui s'élève au-dessus de la Terre, n'a nul besoin d'un art, qui, sur la Terre, rêve du Cosmos [...]. Multiculturel, multihistorique, multipsychologique, multimoral, hourrah, nous sommes arrivés dans le méli-mélo radical, le méli-mélo des amusements, ersatz social de ceux qui ne savent plus s'amuser, sur le modèle d'un pays développé qui n'a pas de ministère de la culture,... Tout va avec tout, tout est possible, dans l'espace, dans le temps, les nations, les races, les cuisines, les plantes, les animaux, les populations. La forme politique de la démocratie correspond au mode de travail des machines, dans lesquelles on remplace des pièces quand elles ne fonctionnent plus, ... (pp. 46-48).
La beauté de la poésie et la rigueur des règles ne sont plus autorisées, quand les souvenirs deviennent objets de commerce [...]. La vulgarité comme anti-monde dans l'idéalisme classique de tradition européenne vient, dans la mémoire commercialisée, empêcher que le principe idéal, vaincu, ne finisse par vaincre même dans la mort. Le devoir de laideur, hissé au rang de principe cardinal, conduit à un refoulement de la beauté dans l'art, la promotion de tous les phénomènes pathologiques, de tous les cul-de-jattismes, faisant désormais office de "sacré" à l'heure du triomphe de la saleté, de la saleté qui éteint l'art, comme si l'on transmettait un héritage encombrant à un exécuteur testamentaire sans en avoir reçu l'ordre du légataire décédé, mort par une faute, peu importe laquelle, c'est une autre histoire (p. 57).
L'esthétique contemporaine n'a pas besoin d'arbres, ce qui s'observe dans ses aéroports et dans ses villes à gratte-ciel. Elle n'a nul besoin des racines du terroir, car des coupures rapides, commodes, peuvent se transplanter d'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre. Elle n'a pas besoin des détails de l'art historique, celui de Chartres ou de Sainte-Chapelle, l'église néo-gothique insérée entre les gratte-ciel de New York fera autant d'effet dans un film ou sur une photo... (p. 60).
► Vouloir n°80-82 (sept.-oct. 1991).
♦ Ci-haut : Imploration (Flehende, 1940, coll. privée), bronze de Richard Scheibe. Pour HJ Syberberg, la culture doit exalter le beau, le sublime et non la laideur.
 ◘ Notice sur l'ouvrage : Le livre qui a fait scandale l'année passée (1990) à la foire internationale du livre de Francfort. Le cinéaste allemand Hans-Jürgen Syberberg y dénonce, sans mâcher ses mots, les mécanismes de l'éradication de toute culture incarnée en Allemagne. L'art de notre après-guerre a dû suivre les diktats de l'idéologie de la rééducation, imposée par l'occupant américain. Résultat : un art abstrait qui insiste sur la laideur, sur la saleté, sur les mécanismes désincarnés et dépourvus d'âme. Résultat de ce résultat : le public boude les musées, les théâtres, les cinémas qui n'offrent pas que de l'amusement mais entendent faire passer un message. Ce qui signifie que le "message" proposé n'intéresse plus personne et que les temps seront bientôt mûrs pour faire advenir autre chose. C'est-à-dire un retour à un art jailli de la chair et du paysage, du cœur et de la terre.
◘ Notice sur l'ouvrage : Le livre qui a fait scandale l'année passée (1990) à la foire internationale du livre de Francfort. Le cinéaste allemand Hans-Jürgen Syberberg y dénonce, sans mâcher ses mots, les mécanismes de l'éradication de toute culture incarnée en Allemagne. L'art de notre après-guerre a dû suivre les diktats de l'idéologie de la rééducation, imposée par l'occupant américain. Résultat : un art abstrait qui insiste sur la laideur, sur la saleté, sur les mécanismes désincarnés et dépourvus d'âme. Résultat de ce résultat : le public boude les musées, les théâtres, les cinémas qui n'offrent pas que de l'amusement mais entendent faire passer un message. Ce qui signifie que le "message" proposé n'intéresse plus personne et que les temps seront bientôt mûrs pour faire advenir autre chose. C'est-à-dire un retour à un art jailli de la chair et du paysage, du cœur et de la terre.

Pièce-jointe :
LE « PARSIFAL » DE SYBERBERG
 Parsifal fut créé à Bayreuth le 26 juillet 1882. Le cinéaste allemand Hans-Jürgen Syberberg a fêté ce centenaire avec une version révolutionnaire et filmée de l’opéra de Wagner, réinterprété à la lumière de l’histoire récente de l’Allemagne et de l’Europe. Heidegger disait que l’œuvre d’art ouvre « les voies des options simples et décisives dans le destin d’un peuple ». Syberberg prend Parsifal comme un mythe, au moyen duquel il cherche à dire le sens de notre histoire, de notre destin passé et à venir. Pour lui, « seul le mythe, parce qu’il est un acte profondément humain de notre culture, permet sans doute de maîtriser notre histoire ». Ici, le mythe devient donc œuvre d’art, et des plus flamboyantes ; il ne cesse d’interroger, de peser les chances du sacré dans un monde perclus de rationalité, où les errements du IIIème Reich ont confisqué le recours à l’exaltation de l’irrationnel, qui fut la force de l’Europe et l’instrument décisif de sa grandeur.
Parsifal fut créé à Bayreuth le 26 juillet 1882. Le cinéaste allemand Hans-Jürgen Syberberg a fêté ce centenaire avec une version révolutionnaire et filmée de l’opéra de Wagner, réinterprété à la lumière de l’histoire récente de l’Allemagne et de l’Europe. Heidegger disait que l’œuvre d’art ouvre « les voies des options simples et décisives dans le destin d’un peuple ». Syberberg prend Parsifal comme un mythe, au moyen duquel il cherche à dire le sens de notre histoire, de notre destin passé et à venir. Pour lui, « seul le mythe, parce qu’il est un acte profondément humain de notre culture, permet sans doute de maîtriser notre histoire ». Ici, le mythe devient donc œuvre d’art, et des plus flamboyantes ; il ne cesse d’interroger, de peser les chances du sacré dans un monde perclus de rationalité, où les errements du IIIème Reich ont confisqué le recours à l’exaltation de l’irrationnel, qui fut la force de l’Europe et l’instrument décisif de sa grandeur.
À l’inverse du Don Giovanni que filma Losey, ou de la Flûte enchantée mise en images par Bergman, films habiles mais conventionnels, l’œuvre de Syberberg casse les limites du livret et de la scénographie voulues par le compositeur. L’imagerie de Wagner aurait un sens possible dans un monde où la conquête des armes passerait encore par la quête du sacré. Syberberg juge ce temps révolu ; son point de vue est celui d’un créateur de la fin du XXème siècle. Quel Graal aurait encore un sens pour les Européens ? Leur culture a perdu le sens de l’exaltation ; tout est achevé, ou presque. Le mythe parle-t-il encore ?
une œuvre sommée de livrer son sens
Le générique défile sur des images de cartes postales du temps de la désolation - sur l’après-guerre (laquelle ?) : Berlin en ruines, Nuremberg en cendres, Versailles lézardé, la statue de la Liberté avachie, ridicule, à demi-engloutie. Syberberg raconte : « Après mon film sur Hitler, description de l’effondrement d’un pays et d’une culture, la question se posait : que représenter par le cinéma, et comment ? (...) Lorsqu’enfin je dis : Parsifal, de Richard Wagner, les méchants de mon pays éclatèrent de rire, ne me laissant à nouveau aucune chance ; ils pensaient à un mythe germanique, vu naturellement sous l’angle étroit de leur pensée ». En fait, Syberberg féconde le mythe et lui donne une puissance d’interrogation rare. Il affirme : « Parsifal est le testament de Wagner. On ne pouvait passer à côté de quelque chose d’eschatologique : la balance, à la fin des temps, de la faute et de l’expiation. Des emblèmes utopiques de la lumière et des choses saintes et dernières nous sont donnés par la quête du Graal à travers la culture européenne (...) C’est nous-mêmes qui passons en jugement dans le sérieux de ce jeu qui nous est sacré. Quand il y va de l’essence de l’art et de la vie, que signifie encore le Graal ? Il y va du ciel et de l’enfer, bien ou mal, le Jugement dernier comme jeu, et cela n’est pas sans dangers ».
L’histoire du Graal porte deux mythes complémentaires : le mythe fondateur (la lance sacrée déposée à Monsalvat, dont les chevaliers incarnent les valeurs) et le mythe rédempteur (celui de Parsifal reconquérant pour la communauté la lance qu’elle a perdue).
L’art, pour Syberberg, est aussi une quête du Graal. Comme Parsifal cherchant la lance perdue qui redonnera son éclat et sa puissance à la Table ronde, le cinéaste cherche les images, les emblèmes et les valeurs qui exalteraient encore les Européens au fond de leur médiocrité. Son combat n’est pas directement politique, mais d’abord culturel : le politique ne retrouvera de pouvoir que si la culture exalte des devoirs.
Voici l’histoire. Au premier acte, le chevalier Gurnemanz attend son roi Amfortas. Celui-ci souffre d’une blessure inguérissable, reçue le jour où l’enchanteur Klingsor lui subtilisa la lance sacrée, symbole du pouvoir de la communauté. Depuis, il souffre le martyre à chaque cérémonie du Graal, cérémonie dont les chevaliers de Monsalvat ne peuvent se passer puisqu’ils y puisent leurs forces. La légende veut qu’un jeune homme pur et innocent arrive un jour à reprendre la lance des mains de Klingsor, et la ramène à Monsalvat ; la communauté retrouverait alors sa puissance et son identité perdues. Arrive Parsifal, en qui Gurnemanz croit reconnaître celui que l’on attend. Il le fait assister à une cérémonie du Graal, à laquelle le jeune homme ne comprend rien. Au second acte, voici l’antre de Klingsor. L’enchanteur envoie la prêtresse Kundry séduire Parsifal, qui vient de franchir les frontières du domaine maléfique. Parsifal triomphe de sa séduction et reprend la lance. Au troisième acte, il rentre à Monsalvat, retrouve Gurnemanz et Kundry repentie. C’est le jour du Vendredi saint. Parsifal est sacré roi, il guérit Amfortas ; la communauté retrouve le cours de son destin glorieux.
« Oratorio de la rédemption » selon Thomas Mann, « festival scénique sacré » selon l’orthodoxie wagnérienne, Parsifal devient avec Syberberg une œuvre à interroger, sommée en quelque sorte de livrer son sens. L’éthique et le sacré, la nature de l’art, celle du pouvoir, autant de mondes disjoints qui sont représentés dans ce film comme les manifestations d’une même âme européenne. Syberberg donne tout à voir en même temps, dans une étonnante polyphonie de symboles ; l’ambiguïté du christianisme européen et sa réinterprétation de la thématique biblique du salut voisinent avec les traditions celtiques de la résurrection des héros et les mythes germaniques des communautés de combat. Parmi les thèmes privilégiés par Syberberg : l’histoire. Dans le couloir qui mène à la salle du Graal, le cinéaste a suspendu les grands emblèmes historiques des nations européennes, présentes et passées. Les royaumes germaniques, le IIIème Reich, l’empire napoléonien et les nations actuelles sont représentés comme autant de manifestations d’un génie commun, fondé sur le sacré, exercé dans le combat. Syberberg souligne à plusieurs reprises l’importance de cette thématique politique, représentant au premier acte Amfortas assis sur le trône de Charlemagne, puis, au second acte, Kundry sur le même siège. Si les puissances maléfiques ont pu s’asseoir sur ce trône, c’est à cause d’Amfortas qui, lors de la première cérémonie du Graal (au premier acte), a tout d’abord refusé que celui-ci soit dévoilé, pour tenter d’éviter les souffrances qu’il savait devoir ressentir. Il a ainsi trahi sa mission de chef au service d’une communauté.
Autre originalité de Syberberg, et qui a fait couler beaucoup d’encre : le dédoublement de Parsifal en personnage masculin et personnage féminin, après la scène de séduction du second acte. Le procédé peut paraître gratuit, et même gênant, puisque l’on entend le second Parsifal, féminin et frêle, chanter avec une voix de ténor héroïque. Pour artificiel qu’il soit (il ne gêne plus du tout dès la seconde vision du film), le procédé permet à Syberberg de souligner l’ambiguïté de l’idée de rédemption dans la culture européenne et dans l’œuvre de Wagner. « Parsifal, dit le cinéaste, est comme l’idée scindée en deux de nos désirs de rédemption et d’unification des finalités perdues ». C’est, tout d’abord, l’idée de salut transhistorique, illustrée dans le Hollandais par le sacrifice d’une femme (Senta), dans Tannhaüser par celui d’Elisabeth, dans le Ring par Brünnhilde. Cette idée de régénérescence par intercession est assez proche, au moins dans ses formes immédiates, de celle de rédemption par le Christ que véhicule le christianisme (elle reste toutefois individuelle et sélective, non égalitaire et collective).
Seconde idée, qui complète et s’oppose à la fois à la première, celle de renaissance historique d’une communauté tombée dans la médiocrité. Dans la tradition juive, cette idée est liée à l’exode, avec des connotations suppliantes et messianiques ; dans la tradition européenne, elle est liée à l’émergence d’un chef, qui incarne les besoins d’une communauté et travaille à l’accomplissement de son destin. Renan disait : « La main qui sort du lac quand l’épée d’Arthur y tombe, qui s’en saisit et la brandit trois fois, c’est l’espérance des races celtiques ». Au troisième acte, Syberberg montre les deux Parsifal en même temps ; le féminin porte une croix, le masculin porte la lance. Il complète ainsi l’avers masculin et guerrier de la renaissance par le revers féminin et plus christianisé du salut. Ni l’un ni l’autre ne sont aujourd’hui pensables isolément dans les cultures européennes. Faut-il éliminer, à terme, le second aspect du mythe ? Le danger serait alors d’en limiter les formes aux seules représentations de seconde fonction, comme Sparte l’avait fait. En outre, si les apparences du second versant du mythe de rédemption sont, en Europe, christianisées, mieux vaut peut-être jouer avec elles temporairement, par une habile stratégie des apparences, que de se priver de toute désignation culturelle du versant féminin du sacré. Le guerrier peut accepter, par son éthique masculine, le risque personnel du combat et de la mort ; il n’est pas certain, à l’inverse, que les peuples puissent se dispenser de représentations consolatrices comme celles que la religion populaire a imposées au christianisme. Syberberg montre à plusieurs reprises dans son film des images de la Vierge, équivalant, dans le catholicisme, à la déesse-mère des Européens, liée aux sources et aux grottes (à Lourdes par exemple). Même dévié par le christianisme, cet héritage est important. Le rôle des maîtres n’est pas de le mépriser, mais de le faire revivre dans ses valeurs originelles. « Le féminin, écrit Jean Baudrillard, n’est pas ce qui s’oppose au masculin, mais ce qui le séduit » (De la séduction, Denoël, 1982, p. 16).
Troisième ligne de force du film : le personnage de Kundry, le plus complexe du théâtre wagnérien. Au premier acte de Parsifal, elle semble l’esclave infatigable des chevaliers du Graal : « Soudain, écrit Wagner, on la retrouve effroyablement épuisée, blême, horrible ; et, de nouveau infatigable, elle sert le saint Graal comme une chienne, devant ces chevaliers pour qui elle éprouve un secret mépris (...) Cette passagère fabuleusement sauvage ne doit faire qu’un avec la séductrice du deuxième acte » (lettre à Mathilde Wesendonck, août 1860). Cette servante-séductrice, Syberberg l’a représentée à deux moments-clés de son film. À la première image, elle porte un globe enfermant le labyrinthe du monde, avec un arbre de vie calciné en son centre. À la dernière image, elle tient un autre globe, avec la maquette du Festspielhaus de Bayreuth. L’œuvre d’art, selon Syberberg, est une médiation pour le retour aux forces originelles, celles qui ont fondé la communauté du Graal (l’Europe) et sa puissance. L’œuvre d’art de l’avenir devra être une clef dans la représentation du labyrinthe du monde et dans l’exaltation de la vie.
Kundry sert donc les puissances du bien comme les puissances du mal. Personnage de l’entre-deux mondes, elle nie le fait et le droit de la séparation absolue du bien et du mal, dichotomie chrétienne qui, sous la traduction charité-péché, a fondé la théologie d’un salut absolu opéré par le Christ. Kundry, personnage de chair, anéantit tout salut absolu, tout dépassement de l’histoire. Dans la scène de séduction du second acte, elle est celle qui joue en virtuose des apparences et des signes - comme s’il n’y avait pas d’autre réalité que les signes.
Le féminin, en elle comme dans le sacré en général, exprime une double vérité : il montre qu’il n’y a pas d’au-delà, que le réel se limite aux apparences ; en même temps, parce qu’il séduit, le féminin rassure et sauve du désespoir que pourrait susciter la découverte de la vacuité du monde. La maîtrise des apparences peut alors devenir une joie physique et mentale intense. (C’est d’ailleurs le sens des traditions érotiques dans l’ésotérisme indo-européen qu’a combattu le christianisme).
Syberberg étend sa dialectique des apparences et de la maîtrise des apparences au Graal lui-même, qui n’est jamais représenté directement, mais reflété dans le miroir de la cuirasse d’une femme (encore une, dans le jeu des signes) ou sur les faces miroitées d’un polyèdre, symbole de l’unité et de la diversité des nations européennes. Le cinéaste joue d’ailleurs des double sens dans de nombreux autres passages. Dans la scène de séduction des filles-fleurs, au deuxième acte, il fait alterner des diapositives des Enfers de Jérôme Bosch et des figures mystiques des van Eyck. Ailleurs, c’est un Christ à l’auréole en forme de faucille, la tempe appuyée sur un marteau. Ou encore, aux pieds de Klingsor, les marionnettes de sa puissance : Marx, Bakounine, mais aussi Louis II, Wagner et Nietzsche. Le bien et le mal, c’est tout un. La détermination des valeurs ne dépend que de la volonté ; la fécondité d’une œuvre se mesure aux résultats qu’elle suscite. à la puissance qu’elle exalte. L’enchanteur Klingsor a toujours été perçu comme l’incarnation du négatif absolu ; Syberberg en fait plus intelligemment le symbole de l’impuissance historique et physique.
Enfin, couronnement de cette œuvre, et qui renforce son caractère historico-politique : la scène du Graal qui clôt l’opéra. Wagner voulait en faire l’apothéose d’une communauté de prêtres-soldats régénérés par le retour de leur symbole fondateur, la lance. Syberberg en fait une assemblée d’incapables, assis mollement par terre, côtoyés de squelettes casqués. Le cinéaste refuse de croire que les symboles parlent encore. La quête de Parsifal ne suffit pas, à elle seule, à régénérer la communauté de Monsalvat. Il y faudra d’autres travaux et d’autres efforts. Le trône de Charlemagne, à la fin, reste vide. La couronne carolingienne repose sur une tête de squelette. La maquette du Festspielhaus, à la dernière image, indique la voie à suivre, comme une interrogation : y aura-t-il des œuvres d’art capables de parler assez fort pour reconquérir le pouvoir culturel ? Les symboles, alors, pourront de nouveau « faire signe » vers le sacré, vers le combat.
► Yves LA PLAINE, Nouvelle École n°39, 1982.
*********
Le rôle de Kundry est joué par Edith Clever. Grand adversaire de Wagner, Saint-Saëns voyait dans Parsifal une « œuvre incompréhensible ». Maurice Kufferath observe : « La légende du Graal a fait l’objet d’une quantité d’adaptations en vers et en prose, non seulement en Allemagne, mais aussi en Angleterre et en France (..) On y démêle le souvenir des mythes communs à toutes les races indo-européennes » (« Parsifal », Fischbacher).
Dans le film réalisé par H.-J. Syberberg, le personnage de Parsifal - le « simple » au sens de pur, d’ingénu (« in-genos » : de bonne lignée, cf. le vieux français « nicelot ») - est successivement incarné par Michael Kutter (à droite) et par une femme, Karin Krick (à gauche).
Parsifal avec Amfortas dans le Château du Graal à Monsalvat. Peinture murale (A. Spiess, 1883/84, château de Neuschwanstein).
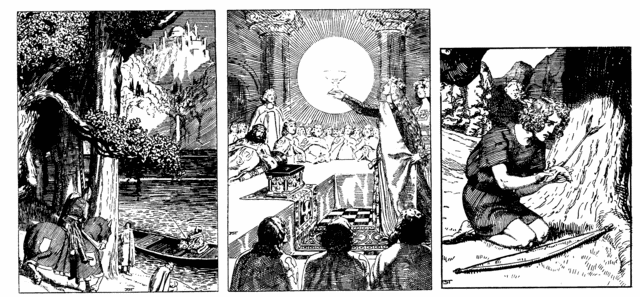

Gravures de Franz Stassen, illustrant l’histoire de « Parsifal » (d’après Hans von Wolzogen, Parzival der Gralsucher, Ludwig Schroeter, Berlin, 1922). Wagner semble en fait avoir pensé à Parsifal toute sa vie durant. Dès 1848, dans Les Wibelungen ou l’histoire universelle par le mythe, il rapproche le Graal du trésor des Nibelungen : « La recherche du Graal remplace les combats pour s’emparer de l’Or ». (On peut aussi faire un parallèle entre la lance conquise par Parsifal et la « sainte lance » de Wotan, taillée dans le bois de l’Arbre du monde). En 1854, traçant une première esquisse de « Tristan et Isolde », il songe à faire apparaître au troisième acte le Parzival de Wolfram d’Eschenbach. Cinq ans plus tard, dans une lettre à Mathilde Wesendonck, il expose pour la première fois le sujet de son drame. En août 1865, il adresse à Louis II une esquisse du poème. Le 25 janvier 1877, il déclare à Cosima : « Je commence 'Parsifal' et je ne le lâche pas avant qu’il ne soit fini ». Ce travail sera fait quelques semaines plus tard. En 1878, Wagner travaille à la musique. Il est alors, dira son biographe Carl von Glasenapp, « comme sur une île, n’ayant plus rien de commun avec le monde ». La composition des deux premiers actes est achevée fin 1878, celle du troisième en avril 1879. Wagner s’attaque aussitôt à l’orchestration, qui lui prend les années 1880 et 1881. Début 1882, sa tâche est terminée. La création du « mystère » de Parsifal a lieu à Bayreuth, le 26 juillet 1882. Richard Wagner meurt quelques mois plus tard, à Venise.
La construction du prélude du premier acte, à cet égard, n’est pas indifférente. Cordes et vents font sonner à l’unisson la première phrase, thème de la « Cène du pain », sacralisation de la troisième fonction. (Richard Wagner disait de la phrase de la Cène qu’elle « permet de nous rattacher à la terre, genèse de nouvelles naissances après un passage dans la nuit »). Développement du premier thème, puis exposition du second, la « Cène du vin », sacralisation du sacrifice et du sang, thème de seconde fonction. Après le développement du second thème, symétrique de celui du premier, voici l’exposé du troisième thème, en accords. C’est celui du Graal, d’aspect contemplatif, sans développement, thème de première fonction qui couronne l’établissement de la communauté du Graal sous ses trois aspects indo-européens traditionnels. La communauté, dès lors, peut dire ce qu’elle est : c’est la triple exposition du thème septénaire de la « batterie rituelle ». Cet appel de trombones fixe un cérémonial, c’est l’image que la communauté de Monsalvat donne d’elle-même, c’est son signe distinctif, dont le chant des chevaliers n’est qu’un dérivé mélodique. Richard Wagner aurait pu l’exposer en premier. Une logique souterraine a voulu qu’il ne vienne qu’après le triple établissement de la chevalerie de Monsalvat en ses fonctions. L’ordre des grandes œuvres procède, en Europe, des mêmes nécessités.

