Gibelin
♦ Les quelques notes qui suivent ici ne sont que les fragments d'une étude beaucoup plus vaste que nous sommes en train de préparer.
La figure et l'époque de Charles-Quint (1500-1558) ont déjà été étudiées et analysées par divers historiens espagnols, argentins, anglais et américains, dont les optiques étaient également diversifiées (libérale, progressiste, marxiste, révisionnisme argentin, traditionalisme espagnol), cependant, un aspect de son règne a été largement sous-estimé, à nos yeux, traité marginalement ou supplanté par tous les autres. C'est la perspective que nous tenterons personnellement de mettre en exergue : celle de Charles-Quint comme Empereur gibelin.
Pendant les XIIe et XIIIe siècles, l'Occident chrétien est secoué par ce que l'historiographie habituelle et superficielle appelle la “querelle des investitures” ; mais, une bonne analyse de cette querelle nous induit à ne pas la considérer comme une simple lutte politique mais comme une guerre de nature fondamentalement spirituelle. Depuis l'époque de Charlemagne, 2 pontifes sacrés se partageaient la Terre : le Pape et l'Empereur, qui devaient agir de concert. Ce qui revient à dire que Dieu avait institué 2 représentants et que tous 2 étaient sacrés. Non seulement l'Église, chapeautée par le Pape, était d'inspiration divine, mais aussi le Saint-Empire Romain, personnifié par l'Empereur. Telle était la conception gibeline.
Mais à partir du XIIe siècle — avec des antécédents plus tôt dans l'histoire — se déploie la conception guelfe, où l'Église commence à nier le caractère sacré de l'Empire et prétend assumer seule le monopole des questions spirituelles. En conséquence, un processus de désacralisation de l'État s'amorce qui, par étapes successives, conduira à l'émergence d'États nationaux, réduits aux seules dimensions temporelles et étrangers à toute spiritualité. Ce sont les États qui dominent actuellement, totalement laïcisés et séculiers. Quant à l'Église, qui perd ipso facto le soutien du Saint-Empire Romain, devient exclusivement paulinienne et tombe sous la coupe et le contrôle des monstres qu'elle a elle-même contribué à faire naître.
 Quand Charles-Quint entre en scène
Quand Charles-Quint entre en scène
Donc l'aspect du règne de Charles-Quint le moins bien traité par les historiens réside dans ses tendances gibelines. Elle se sont manifestées dans le conflit qui l'a opposé au Pape pendant tout son règne d'Empereur du Saint-Empire Romain (1519-1556) et de Roi d'Espagne, dont il hérite de la monarchie en 1517, sous le nom de Charles I. Charles-Quint, en se présentant à sa première Diète Impériale, fut très clair à ce propos. Il a dit : « Aucune monarchie n'est comparable au Saint-Empire Romain, auquel le Christ en personne à rendu honneur et obéissance, mais aujourd'hui cet Empire vit des heures sombres et n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut, mais avec l'aide des pays et des alliances que Dieu m'a donnés, j'espère le ramener à son ancienne splendeur ». Le jeune Empereur, dès le début de son règne, déclare son option catholique et gibeline et gardera la même position face à l'église que ses prédécesseurs des XIIe et XIIIe siècles.
L'ombre des Empereurs Frédéric
Les Papes de l'époque de Charles-Quint ont vu, sans aucun doute, derrière le nouveau Caesar les ombres de Frédéric Barberousse et de Frédéric II de Hohenstaufen. Par tous les moyens, ils essaieront de bloquer la restauration de l'universitas christiana. Pour arriver à leurs fins, ils utiliseront tantôt une diplomatie tordue, sinueuse, intrigante, traîtresse, un double langage, dans le plus pur style de la “raison d'État” exposée clairement par un contemporain, Nicolas Machiavel, tantôt des alliances hostiles à l'Empire et la guerre.
Les Papes s'allieront avec la France, berceau du monstre étatique moderne. Dans la foulée, ils favoriseront les menées de l'Empire ottoman, vu que tant le Grand Turc que le Pape étaient les alliés de la France. Rome s'est opposée à tout action énergique de Charles-Quint contre les Turcs et les Luthériens, qui commençaient à se manifester en Allemagne. N'oublions pas que le Saint-Empire Romain à l'époque comprenait l'Espagne et les terres du Nouveau Monde, les Flandres, la Franche-Comté, l'héritage bourguignon, le Nord de l'Italie, la Sicile, la Sardaigne, Naples, les Allemagnes, l'Autriche, la Bohème et la Hongrie.
Même pendant le règne de Philippe II, son fils, l'Église a tenté de s'allier avec les Ottomans. L'opposition du Pape Clément VII au Saint-Empire était telle que Charles-Quint a dû se résoudre à le prendre prisonnier, après l'occupation militaire de Rome par les troupes impériales. Cette capture a été suivie d'un arrangement provisoire et, dès la libération du Pape, Charles-Quint s'est fait consacrer Empereur par celui-ci, devenant de la sorte le dernier souverain du Saint-Empire à avoir été oint par l'Église.
La politique guelfe de faire obstacle à toute restauration de l'Empire catholique a empêché toute action décisive contre les luthériens. L'Église était davantage préoccupée par l'éventuelle restauration politique et l'intronisation subséquente d'un nouveau César, rival potentiel du Pape, que par l'unité du monde catholique. Profitant de l'affaiblissement de l'Empire, dû aux intrigues du Pape, les Turcs ont avancé leurs troupes le long des frontières orientales de l'Empire et envahi la Hongrie, tandis que les Français, leurs alliés, ne cessaient de guerroyer contre Charles-Quint et de soutenir les luthériens, entamant l'Empire sur ses marches occidentales.
La responsabilité de l'Église
 Charles-Quint a donc dû faire la guerre à 4 ennemis aussi funestes qu'implacables : le Pape, les Turcs, la France et les luthériens. Chacun de ces ennemis de l'Empire était allié à l'autre (la France avec les Turcs et les luthériens, le Pape avec la France, donc, implicitement avec les luthériens et les Turcs, etc.). Cependant, on peut dire que la puissance la plus responsable et la cause première de l'effondrement de l'idée impériale de Charles-Quint a été, sans aucun doute, l'Église catholique. S'il y avait eu un accord solide et sincère entre l'Empire et l'Église, renforcé par un idéal de spiritualité et de transcendance, où chacune des parties aurait reconnu le caractère sacré de l'autre, comme le voulait le catholicisme médiéval et gibelin, l'Europe (avec ses possessions américaines) aurait pu devenir un Empire catholique.
Charles-Quint a donc dû faire la guerre à 4 ennemis aussi funestes qu'implacables : le Pape, les Turcs, la France et les luthériens. Chacun de ces ennemis de l'Empire était allié à l'autre (la France avec les Turcs et les luthériens, le Pape avec la France, donc, implicitement avec les luthériens et les Turcs, etc.). Cependant, on peut dire que la puissance la plus responsable et la cause première de l'effondrement de l'idée impériale de Charles-Quint a été, sans aucun doute, l'Église catholique. S'il y avait eu un accord solide et sincère entre l'Empire et l'Église, renforcé par un idéal de spiritualité et de transcendance, où chacune des parties aurait reconnu le caractère sacré de l'autre, comme le voulait le catholicisme médiéval et gibelin, l'Europe (avec ses possessions américaines) aurait pu devenir un Empire catholique.
Mais la politique guelfe que Rome a suivie sans discontinuer a empêché l'éclosion d'une Europe bien charpentée par l'institution impériale. Les principes supérieurs ont été sacrifiés aux passions inférieures. De tous ces maux sont issus les États nationaux particularistes, la réforme protestante, la perte de l'unité européenne. Quant à l'Église, son influence diminuera sans cesse au fil du temps parce qu'elle se sera débarrassé du bras armé de l'Empire, complément traditionnel et indispensable de la caste sacerdotale.
L'Argentine, partie intégrante du Saint-Empire Romain
Aujourd'hui, pour nous Argentins, il s'agit de récapituler cette histoire de l'idée impériale de Charles-Quint et d'en tirer les leçons pour l'Argentine contemporaine. Nous ne devons pas oublier que l'Argentine s'est incorporée à l'Occident chrétien pendant le règne de l'Empereur Charles-Quint. Notre pays est né comme une partie intégrante du Saint-Empire Romain, c'est-à-dire que nous sommes les enfants d'une vocation impériale. Rappelons que l'Empire est la forme de politie qui revendique l'universalité, qui est présidée par une idée transcendante et spirituelle, dont l'objectif est de construire une échelle qui va de la Terre au Ciel, ou, en d'autres termes, de jeter un pont entre ce monde et l'autre monde. La vocation du Saint-Empire n'a donc rien à voir avec les projets purement matériels des impérialismes modernes, fruits des appétits petits-nationalistes et résultats d'intérêts purement matériels et économiques.
Pendant le règne de Charles-Quint, Solís découvre le Rio de la Plata, Alejo García entreprend ses voyages d'exploration, Magellan et Elcano font le tour du monde (et tous 2 passent plusieurs mois en Patagonie), Diego Gaboto explore les terres qui deviendront celles de notre pays et fonde Sanctus Spiritus, Francisco César réalise son grand voyage, les Espagnols fondent une première fois Buenos Aires, Irala fonde Asunción, etc. Les actes fondateurs de l'Argentine sont donc posés à l'époque de Charles-Quint. Dans d'autres parties de l'Amérique ibérique, les conquistadores conquièrent les Empires aztèque et inca, découvrent la Mer du Sud (le Pacifique).
Le symbolisme de l'or et de l'argent
Nous devons encore attirer l'attention sur quelques autres faits :
• 1. La découverte du fleuve qui s'appellera par la suite le Rio de la Plata.
• 2. La recherche de la “Cité des Césars” (Ciudad de los Cesares), couverte d'or et d'argent.
• 3. Les vieilles légendes médiévales relatives à l'héritage des terres du Saint-Graal, également recouvertes d'or.
• 4. Charles-Quint était le Grand-Maître de l'Ordre de la Toison d'Or.
Rappelons ici que la Toison d'Or nous amène à une légende mythologique de la Grèce antique, selon laquelle Jason et ses compagnons partent à la recherche d'une toison d'or pour récupérer un royaume. Si nous associons toutes ses références, nous constatons que notre destin était déjà tracé, même avant la naissance de l'Argentine ; il était placé sous les signes symboliques de l'or et de l'argent, métaux nobles symbolisant les âges primordiaux : l'Âge d'Or et l'Âge d'Argent, la noblesse, la supériorité du sacré et du divin. S'il est vrai que si l'on perd le rumb qui nous ramène à nos origines, alors notre voie est de bâtir un Empire. Le nationalisme argentin ne peut servir que de courroie de transmission pour ce projet universel. Vouloir lui donner une autre destination, c'est le condamner au néant, le conduire sur une voie de garage.
► Julián Atilio RAMÍREZ. (article tiré de la revue El Fortín n°10/11, 1998/1999)

DOSSIER GIBELIN
Par Gibelin est désigné un partisan de l'empereur (du Saint-Empire romain germanique), par opposition aux partisans du pape, les Guelfes. Si l'affrontement de ces 2 factions dans l'Italie du XIIe et XIIIe siècle manifeste d'une certaine manière un signe avant-coureur du lent processus de sécularisation qui marquera l'entrée dans la Modernité, il est aussi préfigurateur des luttes intestines qui freinent toute authentique unité européenne.
Contexte
L’origine de ces termes relatifs à ces 2 factions en lutte n’est pas italienne mais germanique. “Gibelin” (de Waiblingen, château des Hohenstaufen) rallie ceux en faveur de la maison impériale, “Guelfe” est le nom italianisé d’une famille féodale de Bavière (les “Welfs”) hostile à la maison impériale et pour cette raison favorable à un accord avec la papauté. Weiblingen et Welfen, ayant été donnés pour cri de guerre dans la bataille de Weinsberg (1140), servirent plus tard à désigner les 2 partis ennemis, dits Gibelins et Guelfes.
Mais en Italie, le conflit entre Gibelins, défenseurs de la suprématie politiques des Empereurs, et Guelfes, partisans de l’autorité papale, est devenu le prétexte à un affrontement entre Nobles et Bourgeois sur horizon de rivalités et convoitises régionales et étrangères. Empire et Papauté représentent donc des prétextes d’alliance plus que des Causes noblement embrassées pour elles-mêmes.
Dante
 Le poète florentin Dante vit douloureusement ce climat de lutte sociale et d’hostilité générale. La Cité-État italienne de Florence a déjà été quelques années aux mains des Gibelins avant que ceux-ci n'en soient définitivement évincés en 1266. Mais le parti des Guelfes s'est alors scindé alors entre Blancs et Noirs : les noirs reconnaissent à la hiérarchie papale une autorité dans les affaires temporelle ; les Blancs sont plus proches d’une conception républicaine du pouvoir. C’est comme Blanc que Dante entre sur la scène politique où il y fait l’expérience du pouvoir et de ses revers. Mais à vrai dire il reste véritablement gibelin, en témoigne le De Monarchia qui distingue (sans séparer) spirituel et temporel et plaide pour une rénovation impériale.
Le poète florentin Dante vit douloureusement ce climat de lutte sociale et d’hostilité générale. La Cité-État italienne de Florence a déjà été quelques années aux mains des Gibelins avant que ceux-ci n'en soient définitivement évincés en 1266. Mais le parti des Guelfes s'est alors scindé alors entre Blancs et Noirs : les noirs reconnaissent à la hiérarchie papale une autorité dans les affaires temporelle ; les Blancs sont plus proches d’une conception républicaine du pouvoir. C’est comme Blanc que Dante entre sur la scène politique où il y fait l’expérience du pouvoir et de ses revers. Mais à vrai dire il reste véritablement gibelin, en témoigne le De Monarchia qui distingue (sans séparer) spirituel et temporel et plaide pour une rénovation impériale.
[illustration : détail d'une gravure préparatoire de G. Doré pour l'Inferno de Dante. Parvenus au fin fond de l'enfer (IXe cercle), Dante et Virgile font face au colossal Lucifer dévorant 3 damnés à demi engouffrés dans chacune de ses 3 gueules (antithése analogique aux 3 personnes de la Trinité). Ce sont les 3 plus grands traîtres de l'histoire de l'État et de l'Église : Judas, Brutus et Cassius, rapprochement bizarre en apparence, mais qui cesse d'étonner quand on a étudié, dans le Traité de la Monarchie, le système de politique et d'histoire que le guelfe banni s'était fait en devenant gibelin, afin de justifier ses opinions nouvelles. Pour lui, les 2 puissances de la terre, presque égales en sainteté, et l'une et l'autre d'origine romaine, c'était d'une part le pape héritier de saint Pierre et vicaire de Jésus-Christ quant au spirituel, de l'autre l'empereur héritier de César et vicaire de Dieu quant au temporel. À ce point de vue, les meurtriers de César étaient aussi coupables envers le genre humain que les meurtriers du Christ. Telle était la raison profonde de cette étrange association]
Repères historiques
Lorsque l’on examine l’histoire politique européenne, on constate rapidement que l’Europe a été le lieu où se sont élaborés, développés et affrontés 2 grands modèles de politie, d’unité politique : la nation, précédée par le royaume, et l’Empire. (...)
Mais rappelons d’abord quelques dates. Romulus Augustule, dernier empereur de l’Occident latin, est déposé en 475. Seul subsiste alors l’empire d’Orient. Cependant, après le démembrement de l’empire d’Occident, une nouvelle conscience unitaire semble se faire jour en Europe occidentale. Dès 795, le pape Léon III date ses bulles, non plus du règne de l’empereur de Constantinople, mais de celui de Charles, roi des Francs et patricien des Romains. Cinq ans plus tard, le jour de Noël de l’an 800, Léon III dépose à Rome la couronne impériale sur la tête de Charlemagne. C’est la première renovatio de l’Empire. Elle obéit à la théorie du transfert (translatio imperii), selon laquelle l’empire ressuscité en Charlemagne continue l’empire romain, mettant ainsi un terme aux spéculations théologiques inspirées de la prophétie de Daniel, qui laissaient prévoir la fin du monde après la fin du quatrième empire, c’està-dire après la fin de l’empire romain, celui-ci ayant lui-même succédé à Babylone, à la Perse et à l’empire d’Alexandre.
La renovatio de l’Empire rompt du même coup avec l’idée augustinienne d’une opposition radicale entre civitas terrena et civitas Dei, qui avait pu donner à penser qu’un empire chrétien n’était qu’une chimère. Léon III inaugure une stratégie nouvelle : celle d’un empire chrétien, où l’empereur serait le défenseur de la cité de Dieu. L’empereur tient alors ses pouvoirs du pape, dont il reproduit dans l’ordre temporel les pouvoirs spirituels. Toute la querelle des investitures, on le sait, sortira de cette formulation équivoque, qui fait de l’empereur un sujet dans l’ordre spirituel, mais le place en même temps à la tête d’une hiérarchie temporelle dont on affirmera bientôt le caractère sacral.
Le traité de Verdun (843) ayant consacré le partage de l’empire des Francs entre les 3 petits-fils de Charlemagne, Lothaire Ier, Louis le Germanique et Charles le Chauve, le roi de Saxe Henri Ier est à son tour couronné empereur en 919. L’Empire devient ainsi plus nettement germanique. Après la dislocation de la puissance carolingienne, il est à nouveau restauré en 962 au profit du roi Otton Ier de Germanie. Il se reconstitue alors au centre de l’Europe avec les Othoniens et les Saliens. Il restera la principale puissance politique en Europe jusqu’au milieu du XIIIe siècle, date à laquelle il se transforme officiellement en Sacrum Romanum Imperium. On ajoutera “de nation germanique” à partir de 1442.
Il n’est évidemment pas question de retracer ici, même à grands traits, l’histoire du Saint-Empire romain germanique. Rappelons seulement que, tout au long de son histoire, il restera un mixte associant 3 grandes composantes : la référence à l’Antiquité, la référence chrétienne et la germanité.
Dans les faits, l’idée impériale commence à se désagréger à la Renaissance, avec l’apparition des premiers États nationaux. Certes, en 1525, la victoire de Pavie, remportée par les forces impériales sur les troupes de François Ier, paraît inverser le cours des choses. À l’époque, l’événement est d’ailleurs considéré comme de première grandeur, et il provoque en Italie une renaissance du gibelinisme. Mais après Charles Quint, le titre impérial n’échoit pas à son fils Philippe, et l’Empire se réduit à nouveau à une affaire locale. À partir de la paix de Westphalie (1648), celuici est de moins en moins perçu comme une dignité, et de plus en plus comme une simple confédération d’États territoriaux. Le processus de déclin durera encore 2 siècles et demi. Le 6 avril 1806, Napoléon achève la Révolution en détruisant ce qui reste de l’Empire. François II abandonne son titre d’empereur romain germanique. Le Saint-Empire a vécu.
À première vue, le concept d’Empire n’est pas facile à cerner, compte tenu des usages souvent contradictoires qui en ont été faits. Dans son dictionnaire, Littré se contente d’une définition tautologique : un empire, écrit-il, est « un État gouverné par un empereur ». C’est évidemment un peu bref. On rappellera surtout que l’Empire, comme la cité ou la nation, est une forme d’unité politique et non, comme la monarchie ou la république, une forme de gouvernement. Cela signifie que l’Empire est a priori compatible avec des formes de gouvernement assez différentes. L’article Ier de la Constitution de Weimar affirmait ainsi que « le Reich allemand est une république ». En 1973, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe n’a pas hésité à rappeler que, de nos jours encore, « le Reich allemand reste un sujet de droit international ».
La meilleure façon de comprendre la réalité substantielle de la notion d’Empire reste sans doute de la comparer à celle de nation ou d’État-nation, celui-ci représentant l’aboutissement d’un processus de formation de la nationalité dont le royaume de France représente en quelque sorte la forme exemplaire.
Au sens actuel du terme, c’est-à-dire au sens politique, la nation apparaît comme un phénomène essentiellement moderne. Nous ne suivrons donc pas Colette Beaune ou Bernard Guenée dans leur thèse, consistant à placer très haut dans le temps la naissance de la nation. Cette thèse, à notre avis, repose sur un anachronisme : elle confond “royal” et “national”, formation de la nationalité et formation de la nation. C’est au compte de la formation de la nationalité qu’il faut porter, par ex., la naissance d’un sentiment d’appartenance excédant le seul horizon natal à l’époque de la guerre contre les Plantagenêts, sentiment qui se renforce pendant la guerre de Cent ans. Mais il ne faut pas oublier qu’au Moyen Âge, le mot “nation” (du lat. natio, naissance) a un sens exclusivement ethnique, et non pas politique : les nationes de la Sorbonne sont seulement des groupes d’étudiants qui parlent une langue différente. Quant au mot “patrie”, qui n’apparaît guère en France qu’avec les humanistes du XVIe siècle (Dolet, Ronsard, Du Bellay), il ne renvoie à l’origine qu’à la notion médiévale de “pays” (païs). Le “patriotisme”, quand il n’est pas simple attachement au sol natal, s’incarne dans la fidélité au seigneur ou l’allégeance à la personne du roi. Le nom même de “France” est relativement tardif. À partir de Charles III, dit le Simple, le titre porté par le roi de France est celui de Rex Francorum. L’expression de rex Franciæ n’apparaît qu’au début du XIIIe siècle, sous Philippe-Auguste, après la défaite du comte de Toulouse au Muret, qui déboucha sur l’annexion des pays de langue d’oc et la persécution des Cathares.
L’idée de nation ne se constitue en fait pleinement qu’au XVIIIe siècle, et singulièrement sous la Révolution. À l’origine, elle renvoie à une conception de la souveraineté professée par les adversaires de l’absolutisme royal. Elle réunit ceux qui pensent politiquement et philosophiquement la même chose, à savoir que c’est “la nation”, et non plus le roi, qui doit incarner l’unité politique du pays. Elle correspond à un lieu abstrait où le peuple peut concevoir et exercer ses droits, où les individus se muent en citoyens. La nation est donc d’abord le peuple souverain en tant qu’il ne délègue au roi, dans le meilleur des cas, que le pouvoir d’appliquer la loi émanant de la volonté générale ; puis les populations qui acceptent l’autorité d’un même État, peuplent le même territoire et se reconnaissent comme membres de la même unité politique ; et enfin cette unité politique elle-même. (C’est pourquoi d’ailleurs la tradition contre-révolutionnaire, si elle exalte le principe monarchique et aristocratique, se garde bien à l’origine de valoriser la nation). L’art. 3 de la Déclaration des droits de 1789 proclame : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». Bertrand de Jouvenel ira jusqu’à écrire : « Vue après coup, la marche de la Révolution paraît avoir eu pour but la fondation du culte de la nation ».
Cette brève parenthèse était nécessaire pour bien faire comprendre que lorsque, par commodité de langage, nous opposerons “l’Empire” et la “nation”, nous aurons à l’esprit aussi bien la nation au sens moderne que le royaume d’Ancien Régime qui l’a précédée et à bien des égards préparée.
Qu’est-ce qui distingue fondamentalement l’Empire de la nation ? C’est d’abord le fait que l’Empire n’est pas avant tout un territoire, mais fondamentalement un principe ou une idée. L’ordre politique y est en effet déterminé, non par des facteurs matériels ou par la possession d’une étendue géographique, mais par une idée spirituelle ou politico-juridique. Ce serait donc une erreur de s’imaginer que l’Empire diffère de la nation avant tout par la taille, qu’il est en quelque sorte “une nation plus grande que les autres”. Certes, par définition, un empire couvre une large superficie. Mais l’essentiel n’est pas là. L’essentiel tient au fait que l’empereur tient son pouvoir de ce qu’il incarne quelque chose qui excède la simple possession. En tant que dominus mundi, il est le suzerain des princes comme des rois, c’est-à-dire qu’il règne sur des souverains, non sur des territoires, qu’il représente une puissance transcendant la communauté dont il a la direction. Comme l’écrit Julius Evola, « l’Empire ne doit pas être confondu avec l’un des royaumes et des nations qui le composent, car il est quelque chose de qualitativement différent, antérieur et supérieur, dans son principe à chacun d’eux » (RCM).
Evola rappelle également que « l’ancienne notion romaine de l’imperium, avant d’exprimer un système d’hégémonie territoriale supranationale, désigne la pure puissance du commandement, la force quasi mystique de l’auctoritas ». La distinction est précisément courante, au Moyen Âge, entre la notion d’auctoritas, de supériorité morale et spirituelle, et celle de potestas, simple pouvoir politique public s’exerçant par des moyens légaux. Dans l’empire médiéval comme dans le Saint-Empire, cette distinction sous-tend la dissociation entre l’autorité propre à la fonction impériale et l’autorité que détient l’empereur comme souverain d’un peuple particulier. Charlemagne, par ex., est d’une part empereur, d’autre part roi des Lombards et des Francs. L’allégeance à l’empereur n’est donc pas soumission à un peuple ou à un pays particulier. Dans l’empire austro-hongrois, la fidélité à la dynastie des Habsbourg constitue encore « le lien fondamental entre les peuples et tient lieu de patriotisme » (Jean Béranger) ; elle l’emporte sur les liens de caractère national ou confessionnel.
Ce caractère spirituel du principe impérial est à l’origine de la célèbre querelle des investitures, qui opposa pendant plusieurs siècles les partisans du pape aux partisans de l’empereur. Privée au départ de tout contenu militaire, la notion d’Empire reçoit dès le début, dans le monde germanique médiéval, une forte imprégnation théologique, née d’une réinterprétation chrétienne de l’idée romaine d’imperium. Se considérant comme les exécuteurs de l’histoire sainte universelle, les empereurs en déduisent que l’Empire, en tant qu’institution “sainte” (Sacrum imperium), a vocation à constituer une puissance spirituelle autonome par rapport à la papauté. Tel est le fondement de la querelle des Guelfes et des Gibelins.
Partisans de l’empereur, les Gibelins s’appuient, pour repousser les prétentions du pape, sur l’antique distinction entre imperium et sacerdotium pour y voir 2 sphères d’égale importance, toutes 2 instituées par Dieu. Cette interprétation prolonge la conception romaine des rapports entre le détenteur du pouvoir politique et le pontifex maximus, chacun étant supérieur à l’autre dans l’ordre qui lui est propre. Le point de vue gibelin ne consiste donc nullement à asservir l’autorité spirituelle au pouvoir temporel, mais à revendiquer pour le pouvoir impérial, face aux prétentions exclusives de l’Église, une autorité spirituelle égale. Ainsi, pour Frédéric II de Hohenstaufen, l’empereur représente l’intermédiaire grâce à qui la justice de Dieu se répand dans le monde. Cette renovatio, qui fait de l’empereur la source essentielle du droit et lui confère le caractère de “loi vivante sur Terre” (lex animata in terris), contient toute l’essence de la revendication gibeline : l’Empire doit être reconnu, au même titre que la papauté, comme une institution de nature et de caractère sacrés. L’opposition entre les Guelfes et les Gibelins, souligne encore Evola, « n’était pas d’ordre seulement politique, ainsi que l’enseigne l’historiographie myope qui sert de base à l’enseignement scolaire : elle exprimait l’antagonisme de 2 dignitates qui se réclamaient l’une et l’autre du plan spirituel […] Le gibelinisme, dans son aspect le plus profond, soutenait qu’à travers une vie terrestre conçue comme discipline, combat et service, l’individu peut être conduit au-delà de lui même et tend à sa fin surnaturelle par les voies de l’action et sous le signe de l’Empire, conformément au caractère d’institution “surnaturelle” qui était reconnu à celui-ci » (HMR).
Le déclin de l’Empire équivaut dès lors avant tout au déclin de son principe et, corrélativement, à sa dérive vers une définition purement terriroriale. L’empire romain germanique ne répond déjà plus à sa vocation quand on tente, en Italie comme en Allemagne, de le lier à un territoire privilégié. Cette idée, notons-le, est encore absente de la pensée de Dante, pour qui l’empereur n’est ni germanique ni italique, mais “romain” au sens spirituel, c’est-à-dire successeur de César et d’Auguste. L’empire au sens vrai ne peut se transformer sans déchoir en “grande nation”, pour la simple raison que, selon le principe qui l’anime, aucune nation ne peut assumer et exercer une fonction supérieure si elle ne s’élève pas aussi au-dessus de ses allégeances et de ses intérêts particuliers. « L’empire, au sens vrai, conclut Evola, ne peut exister que s’il est animé par une ferveur spirituelle […] Si cela fait défaut, on n’aura jamais qu’une création forgée par la violence — l’impérialisme —, simple superstructure mécanique et sans âme » (Sur les prémisses spirituelles de l'empire, 1937).
La nation, au contraire, trouve son origine dans la prétention du royaume à s’attribuer des prérogatives de souveraineté en les rapportant, non plus à un principe, mais à un territoire. On peut en placer le point de départ dans le partage de l’empire carolingien au traité de Verdun. C’est à ce moment en effet que la France et l’Allemagne, si l’on peut dire, entament des destinées séparées. La seconde va rester dans la tradition impériale, tandis que le royaume des Francs ( regnum Francorum), faisant sécession de la germanité, va lentement évoluer vers la nation moderne par le truchement de l’État royal. L’extinction de la dynastie carolingienne date du Xe s. : 911 en Allemagne, 987 en France. Hugues Capet, élu en 987, est le premier roi dont nous savons avec certitude qu’il ne comprenait pas le francique. Il est aussi le premier souverain qui se situe clairement en dehors de la tradition impériale, ce qui explique que Dante, dans sa Divine Comédie, lui fasse déclarer : « Je fus la racine funeste, qui obscurcit de son ombre toute la terre chrétienne ! ».
Au XIIIe et XIVe siècles, le royaume de France se construit contre l’Empire avec Philippe-Auguste (Bouvines, 1214) et Philippe le Bel (Agnani, 1303). Dès 1204, le pape Innocent III déclare que, « de notoriété publique, le roi de France ne reconnaît au temporel aucune autorité supérieure à la sienne ».
Parallèlement à l’instrumentalisation de la légende troyenne, tout un travail de légitimation “idéologique” conduit à opposer à l’Empire le principe de la souveraineté des royaumes nationaux et leur droit à ne connaître d’autre loi que leur seul intérêt. Le rôle des légistes, bien souligné par Carl Schmitt, est ici fondamental. Ce sont eux qui, dès le milieu du XIIIe siècle, formulent la doctrine selon laquelle « le roi de France, ne reconnaissant au temporel personne au-dessus de lui, est exempt de l’Empire et peut être considéré comme princeps in regno suo ». Cette doctrine sera développée aux XIVe et XVe siècles, avec Pierre Dubois et Guillaume de Nogaret. En s’affirmant “empereur en son royaume” (rex imperator in regno suo), le roi oppose sa souveraineté territoriale à la souveraineté spirituelle de l’Empire, sa puissance purement temporelle au pouvoir spirituel impérial. Parallèlement, les légistes favorisent un début de centralisation au détriment des libertés locales et des aristocraties féodales, grâce not. à l’institution du “cas royal”. Ils fondent ainsi un ordre juridique d’essence bourgeoise, où la loi, conçue comme norme générale pourvue d’attributs rationnels, devient le fait de la seule puissance étatique. Le droit se transforme ainsi en simple légalité codifiée par l’État. Au XVIe siècle, la formule du roi “empereur en son royaume” se trouve directement associée à la nouvelle conception de la souveraineté que théorise Jean Bodin. La France, comme le constate Carl Schmitt, sera le premier pays du monde à créer un ordre public entièrement émancipé du modèle médiéval.
► Extrait de : L'idée d'Empire, Alain de Benoist (tiré de La ligne de mire, repris dans Critiques, théoriques)
Anecdote
Enfin, pour conclure cette présentation thématique sur une note légère, signalons à titre purement anecdotique l'archéologue ésotérisant Claude-Sosthène Grasset d'Orcet (1828-1900) qui, versant dans une érudtion fantastique pour décrypter une métahistoire (hiérohistoire dirait Corbin) laissant au peuple un rôle d'acteur secret, présenta la querelle des Guelfes et des Gibelins comme le ressort essentiel de toute l'histoire de l'Europe, notamment dans son enracinement populaire (via le compagnonnage et les corporations). Cf. le recueil d'articles Histoire secrète de l'Europe (I) et ces 2 articles de JC Drouin : « L'imaginaire de la nation chez l'ésotériste G. D'Orcet », « Une interprétation ésotérique de l'histoire de la Révoluton française chez G. d'Orcet ».

◘ Dossier pédagoqique : Evola, le “dernier Gibelin” ?
◘ TRANSLATION DE L'IDÉE D'EMPIRE – LE MOYEN-ÂGE GIBELIN
 Par rapport au christianisme, la puissance de la tradition qui donna à Rome son visage apparaît dans le fait que la nouvelle foi, si elle réussit à renverser l'ancienne, ne sut pas conquérir réellement le monde occidental en tant que christianisme pur ; que là où elle parvint à quelque grandeur, ce ne fut qu'en se trahissant elle-même dans une certaine mesure et davantage à l'aide d'éléments empruntés à la tradition opposée éléments romains et classiques pré-chrétiens qu'à travers l'élément chrétien dans sa forme originelle.
Par rapport au christianisme, la puissance de la tradition qui donna à Rome son visage apparaît dans le fait que la nouvelle foi, si elle réussit à renverser l'ancienne, ne sut pas conquérir réellement le monde occidental en tant que christianisme pur ; que là où elle parvint à quelque grandeur, ce ne fut qu'en se trahissant elle-même dans une certaine mesure et davantage à l'aide d'éléments empruntés à la tradition opposée éléments romains et classiques pré-chrétiens qu'à travers l'élément chrétien dans sa forme originelle.
En réalité, le christianisme ne “convertit” qu'extérieurement l'homme occidental, dont il constitua la “foi” au sens le plus abstrait, mais dont la vie effective continua d'obéir à des formes, plus ou moins matérialisées, de la tradition opposée de l'action et, plus tard, au Moyen-Âge, à un ethos qui, de nouveau, devait être essentiellement empreint de l'esprit nordico-aryen. Théoriquement, l’Occident accepta le christianisme et le fait que l'Europe ait pu accueillir ainsi tant de thèmes relevant de la conception hébraïque et levantine de la vie, est une chose qui remplit toujours l'historien de stupeur; mais pratiquement, l'Occident resta païen. Le résultat fut donc un hybridisme. Même sous sa forme catholique, atténuée et romanisée, la foi chrétienne fut un obstacle qui priva l'homme occidental de la possibilité d'intégrer son véritable et irréductible mode d'être grâce à une conception du sacré et des rapports avec le sacré, conformes à sa propre nature. À son tour, c'est précisément ce mode d'être qui empêcha le christianisme d'instaurer réellement en accident une tradition du type opposé, c’est-à-dire sacerdotale et religieuse, conforme aux idéaux de l'Ecclesia des origines, au pathos évangélique et au symbole du corps mystique du Christ. Nous examinerons plus loin les effets de cette double antithèse sur le développement de l'histoire de l'Occident. Elle tient une place importante parmi les processus qui aboutirent au monde moderne proprement dit.
Au cours d'un certain cycle, l'idée chrétienne, en tant qu'elle mettait l'accent sur le surnaturel, sembla toutefois être absorbée par l'idée romaine sous une forme propre à redonner une remarquable dignité à l'idée impériale elle-même, dont la tradition se trouvait désormais déchue dans le centre représenté par la “Ville éternelle”. Ce fut le cycle byzantin, le cycle de l'Empire Romain d'Orient.
Mais ici, historiquement, se répète dans une large mesure ce qui s'était vérifié dans le bas Empire. Théoriquement, l'idée impériale byzantine présente un haut degré de traditionnalité. On y trouve affirmé le concept de βασιλεύς αύτοκράτωρ, du dominateur sacré dont l'autorité vient d'en haut, dont la loi, image de la loi divine, a une portée universelle, et auquel est en fait assujetti le clergé lui-même, car c'est à lui que revient la direction des choses spirituelles, aussi bien que temporelles. On y trouve affirmé également la notion de ρωμαϊοι, de “Romains”, qui exprime l'unité de ceux que le chrisme inhérent à la participation à l'œcumène romano-chrétien élève à une dignité supérieure à celle de toute autre personne. De nouveau l'Empire est sacrum et sa pax a une signification supra-terrestre.
Mais, plus encore qu'au temps de la décadence romaine, il ne s'agit là que d'un symbole porté par des forces chaotiques et troubles, car la substance ethnique, plus encore que dans le cycle impérial romain, porte le sceau du démonisme, de l'anarchie, du principe d'agitation incessante propre au monde hellénico-oriental désagrégé et crépusculaire. Là aussi, on s'imagine que le despotisme et une structure centraliste bureaucratico-administrative pouvaient recréer ce qu'avait seule pu rendre possible l'autorité spirituelle de représentants qualifiés, entourés d'hommes ayant effectivement, en vertu de leur race non seulement nominale mais surtout intérieure, la qualité de “Romains”. Là aussi, les forces de dissolution devaient donc prendre l'avantage bien qu'en tant que réalité politique Byzance réussit à se maintenir pendant près d'un millénaire. De l'idée romano-chrétienne byzantine ne subsistèrent que des échos, que l'on retrouve, soit sous une forme assez modifiée, chez les peuples slaves, soit lors de la “reprise” correspondant au Moyen-Âge gibelin.
Afin de pouvoir suivre le développement des forces qui exercèrent sur l’Occident une influence décisive, il est nécessaire de nous arrêter, un instant, sur le catholicisme. Celui-ci prit forme à travers la rectification de certains aspects extrémistes du christianisme des origines, à travers l'organisation, au-delà du simple élément mystico-sotériologique, d'un corpus rituel et symbolique, et grâce à l'absorption et l'adaptation d'éléments doctrinaux et de principes d'organisations tirés de la romanité et de la civilisation classique en général. C'est ainsi que le catholicisme présente parfois des traits “traditionnels”, qui ne doivent cependant pas, prêter à équivoque. Ce qui, dans le catholicisme, possède un caractère vraiment traditionnel n'est guère chrétien, et ce qu'il a de chrétien, n'est guère traditionnel. Historiquement, malgré tous les efforts tendant à concilier des éléments hétérogènes et contradictoires (1), malgré toutle travail d'absorption et d'adaptation, le catholicisme trahit toujours l'esprit des civilisations lunaires-sacerdotales au point de perpétuer, sous une autre forme, l'action antagoniste des influences du Sud, auxquelles elle fournit même un corps : l'organisation de l'Église et sa hiérarchie.
Cela apparaît clairement lorsqu'on examine le développement du principe d'autorité revendiqué par l'Église. Durant les premiers siècles de l'Empire christianisé et la période byzantine, l'Église apparaît encore subordonnée à l'autorité impériale. Dans les conciles, les évêques laissaient le dernier mot au prince, non seulement en matière de discipline, mais aussi en matière de dogme. Progressivement, on glisse toutefois à l'idée de l'égalité des 2 pouvoirs, de l'Église et de l'Empire. Les 2 institutions paraissent posséder à présent, l'une et l'autre, une autorité et une destination surnaturelle et avoir une origine divine. Si nous suivons le cours de l'histoire, nous constatons que dans l'idéal carolingien subsiste le principe selon lequel le roi ne gouverne pas seulement le peuple, mars aussi le clergé. Par ordre divin il doit veiller à ce que l'Église remplisse sa fonction et sa mission. Il s'ensuit que non seulement il est consacré par les mêmes symboles que ceux de la consécration sacerdotale, mais qu'il possède aussi l'autorité et le droit de destituer et de bannir le clergé indigne. Le monarque apparaît vraiment, selon le mot de Catwulf, comme le roi-prêtre selon l'ordre de Melchisédech, alors que l'évêque n'est que le vicaire du Christ (2). Toutefois, malgré la persistance de cette haute et ancienne tradition, l'idée finit par prévaloir que le gouvernement royal doit être comparé à celui du corps et le gouvernement sacerdotal à celui de l'âme. On abandonnait ainsi implicitement l'idée même de l'égalité des 2 pouvoirs et l'on préparait une inversion effective des rapports.
En réalité, si, chez tout être raisonnable, l'âme est le principe qui décide ce que le corps exécute, comment concevoir que ceux qui admettaient que leur autorité fût limitée au corps social, ne dussent pas se subordonner à l'Église, à laquelle ils reconnaissaient un droit exclusif sur les âmes et sur leur direction ? C'est ainsi que l'Église devait finalement contester et considérer pratiquement comme une hérésie et une prévarication de l'orgueil humain, la doctrine de la nature et de l'origine divine de la royauté, et voir dans le prince un laïque égal à tous les autres hommes devant Dieu et même devant l'Église, comme un simple fonctionnaire institué par l'homme, selon le droit naturel, pour dominer l'homme, et tenu de recevoir des hiérarchies ecclésiastiques la consécration nécessaire pour que son gouvernement ne soit pas celui d'une civitas diaboli (3).
Il faut voir en Boniface VIII, qui n'hésitera pas à monter sur le trône de Constantin avec l'épée, la couronne et le sceptre et à déclarer : « Je suis César, je suis Empereur », la conclusion logique d'un tournant de caractère théocratico-méridional : on finit par attribuer au prêtre les 2 épées évangéliques, la spirituelle et la temporelle, et l'on ne voit dans l'Empire qu'un simple beneficium conféré par le Pape à quelqu'un qui doit en échange à l'Église le même vasselage et la même obéissance que doit un feudataire à celui qui l'a investi. Mais, du fait que la spiritualité que le chef de l'Église romaine pouvait incarner, demeure, essentiellement, celle des “serviteurs de Dieu”, ce guelfisme, loin de signifier la restauration de l'unité primordiale et solaire des 2 pouvoirs, montre seulement comment Rome s'était éloignée de son ancienne tradition et représentait, désormais, dans le monde européen, le principe opposé, la domination de la vérité du Sud. Dans la confusion qui se manifestait jusque dans les symboles, l'Église, en même temps qu'elle s'arrogeait, par rapport à l'Empire, le symbole du Soleil par rapport à la Lune, adoptait pour elle-même le symbole de la Mère, et considérait l'Empereur comme un de ses fils. Dans l'idéal de suprématie guelfe s'exprime donc un retour à l'ancienne vision gynécocratique : l'autorité, la supériorité et le droit à la domination spirituelle du principe maternel sur le principe masculin, lié à la réalité temporelle et caduque.
C'est ainsi que s'effectua une translation. L'idée romaine fut reprise par des races de pure origine nordique, que la migration des peuples avait poussées dans l'espace de la civilisation romaine. C'est à présent l'élément germanique qui défendra l'idée impériale contre l'Église, qui éveillera à une vie nouvelle la force formatrice de l'antique romanitas. Et c'est ainsi que surgissent, avec le Saint Empire Romain et la civilisation féodale, les 2 dernières grandes manifestations traditionnelles que connut l'Occident.
Les Germains du temps de Tacite apparaissent comme des souches assez voisines des souches achéenne, paléo-iranienne, paléo-romaine et nordico-aryenne en général, qui se sont conservées, à plus d'un égard à partir du plan racial dans un état de pureté “préhistorique”. C'est la raison pour laquelle ils purent apparaître comme des “barbares” comme plus tard les Goths, les Lombards, les Burgondes et les Francs aux yeux d'une “civilisation” qui, “désanimée” dans ses structures juridico-administratives, et, s'étant effritée dans des formes “aphrodisiennes” de raffinement hédonistico-citadin, d'intellectualisme, d'esthétisme, et de dissolution cosmopolite, ne représentait plus que la décadence. Dans la rudesse de leurs coutumes, s'exprimait toutefois une existence forgée par les principes d'honneur, de fidélité et de fierté. C'était précisément cet élément “barbare” qui représentait la force vitale, dont l'absence avait été une des principales causes de la décadence romaine et byzantine.
Considérer les Germains comme des “races jeunes” représente donc l'une des erreurs d'un point de vue auquel échappe le caractère de la haute antiquité. Ces races n'étaient jeunes qu'au sens de la jeunesse que confère le maintien d'un contact avec les origines. En réalité, elles descendaient de souches qui furent les dernières à abandonner les régions arctiques et se trouvèrent, de ce fait, préservées des mélanges et des altérations subies par les peuples voisins qui avaient abandonné ces régions à une époque bien antérieure. Tel avait été le cas des souches paléo-indo-européennes établies dans la Méditerranée préhistorique.
Les peuples nordico-germaniques, à part leur ethos, apportaient ainsi dans leurs mythes les traces d'une tradition dérivée directement de la tradition primordiale. Certes, lorsqu'ils apparurent comme des forces déterminantes sur la scène de la grande histoire européenne, ils avaient pratiquement perdu le souvenir de leurs origines et cette tradition ne subsistait que sous forme de résidus fragmentaires, souvent altérés et “primitivisés”, mais cela ne les empêchait pas de continuer d'apporter, à titre d'héritage plus profond, les potentialités et la vision innée du monde d'où se développent les cycles “héroïques”.
En effet, le mythe des Eddas connaît aussi bien le destin comme déclin que la volonté héroïque qui s'y oppose. Dans les parties les plus anciennes de ce mythe persiste le souvenir d'une congélation qui arrête les douze “courants” partant du centre primordial, lumineux et ardent, de Muspelsheim, situé « à l'extrémité de la terre », centre qui correspond à l’airyanem-vaëjô, l'Hyperborée iranienne, à l'île rayonnante du nord des Hindous et aux autres représentations du lieu de “l'âge d'or” (4). Il est en outre question de l'« Île Verte » (5) qui flotte sur l'abîme, entourée par l'océan. C'est en ce lieu que se serait manifesté le commencement de la chute, l'amorce des temps sombres et tragiques, dans la mesure où le courant chaud du Muspelheim rencontre le courant glacé de Huergehrnir (les eaux, dans cette série de mythes traditionnels, symbolisent la force donnant vie aux hommes et aux races). Et de même que dans l'Avesta l'hiver glacé et ténébreux qui rendit désert l’airyanem-vaëjô fut considéré comme un acte du dieu ennemi contre la création lumineuse, de même ce mythe de l'Edda peut être considéré comme une allusion à une altération qui favorisa le nouveau cycle. L'allusion à une génération de géants et d'êtres élémentaires telluriques, de créatures ressuscitées dans le gel par le courant chaud, et contre lesquels luttera la race des Ases, vient à l'appui de cette interprétation.
À l'enseignement traditionnel relatif à la chute qui se poursuit durant les 4 âges du monde, correspond, dans l'Edda, le thème connu du ragnarök ou ragna-rökkr — le “destin” ou “obscurcissement” des dieux. Il agit dans le monde en lutte, dominé désormais par la dualité. Esotériquement, cet “obscurcissement” ne concerne les dieux que métaphoriquement. Il s'agit plutôt de l'obscurcissement des dieux dans la conscience humaine. C'est l'homme qui, progressivement perd les dieu, c'est-à-dire les possibilités de contact avec eux. Toutefois ce destin peut être écarté aussi longtemps qu'est maintenu, dans sa pureté, le dépôt de cet élément primordial et symbolique, dont était déjà fait, dans la région originelle de l'Asgard, le « palais des héros », la salle des douze trônes d'Odin : l'or. Mais cet or qui pouvait être un principe de salut tant qu'il n'avait pas été touché par la race élémentaire, ni par la main de l'homme, tombe enfin au pouvoir d'Albéric, roi des êtres souterrains, qui deviendront les Nibelungen dans la rédaction plus tardive du mythe. Il s'agit manifestement là d'un écho de ce qui correspond, dans d'autres traditions, à l'avènement de l'âge du bronze, au cycle de l'usurpation titanico-prométhéenne, à l'époque prédiluvienne des Nephelin. Il n'est peut-être pas sans rapport avec une involution tellurique et magique, au sens inférieur du terme, des cultes antérieurs (6).
En face, se trouve le monde des Ases, divinités nordico-germaniques qui incarnent le principe ouranien sous son aspect guerrier. C'est Donnar-Thor, exterminateur de Thym et Hymir, « le plus fort des forts », l'« irrésistible », le seigneur de l'« asile contre la terreur » dont l'arme terrible, le double marteau Mjöllnir, est, en même temps qu'une variante de la hache symbolique hyperboréenne bicuspide, un signe de la force-foudre propre aux dieux ouraniens du cycle aryen. C'est Wotan-Odin, celui qui octroie la victoire et possède la sagesse, le maître de formules magiques toutes-puissantes qui ne sont communiquées à aucune femme, pas même à une fille de roi, l'Aigle, hôte des héros immortalisés que les Walkyries choisissent sur les champs de bataille et dont il fait ses fils (7) ; celui qui donne aux nobles « de cet esprit qui vit et ne périt pas, même quand le corps se dissout dans la terre » (Gylfaginning, 3) ; celui auquel, d'ailleurs, les lignées royales rapportaient leur origine. C'est Tyr-Tiuz, dieu des batailles lui aussi, en même temps que dieu du jour, du ciel solaire rayonnant, auquel a été associée la rune, Y, qui correspond au signe très ancien, nordico-atlantique, de l'« homme cosmique avec les bras levés » (8).
Un des thèmes des cycles “héroïques” apparaît dans la légende relative à la lignée des Wölsungen, engendrée par l'union d'un dieu avec une femme. C'est de cette race que naîtra Sigmund, qui s'emparera de l'épée fichée dans l'Arbre divin ; ensuite, le héros Sigurd-Siegfried, qui se rend maître de l'or tombé entre les mains des Nibelungen, tue le dragon Fafnir, variante du serpent Nidhögg, qui ronge les racines de l'arbre divin Yggdrassil (à la chute duquel croulera aussi la race des dieux, et personnifie ainsi la force obscure de la décadence. Si le même Sigurd est finalement tué par trahison, et l'or restitué aux eaux, il n'en demeure pas moins le héros qui possède la Tarnkappe, c'est-à-dire le pouvoir symbolique qui fait passer du corporel dans l'invisible, le héros prédestiné à la possession de la femme divine, soit sous la forme d'une reine amazonienne vaincue (Brunhilde comme reine de l'île septentrionale) sort sous la forme de Walkyrie, vierge guerrière passée de la région céleste à la région terrestre.
Les plus anciennes souches nordiques considérèrent comme leur patrie d'origine la Gardarike, terre située à l'extrême nord. Même lorsque ce pays ne fut plus considéré que comme une simple région de la Scandinavie, il demeura associé au souvenir de la fonction “polaire” du Mitgard, du “Centre” primordial : transposition de souvenirs et passagers du physique au métaphysique, en vertu desquels la Gardarike fut, corrélativement, considérée aussi comme identique à l'Asgard. C'est dans l'Asgard qu'auraient vécu les ancêtres non-humains des familles nobles nordiques, et certains rois sacrés scandinaves, comme Gilfir, y seraient allés pour annoncer leur pouvoir et y auraient reçu l'enseignement traditionnel de l'Edda. Mais l'Asgard est aussi la terre sacrée – heilakt land – la région des olympiens nordiques et des Ases, interdite à la race des géants.
Ces thèmes étaient donc propres à l'héritage traditionnel des peuples nordico-germaniques. Dans leur vision du monde, la perception de la fatalité du déclin, des ragna-rökkr, s'unissait à des idéaux et à des figurations de dieux typiques des cycles “héroïques”. Plus tard, toutefois, cet héritage, ainsi que nous l'avons dit, devint subconscient, l'élément surnaturel se trouva voilé par rapport aux éléments secondaires et bâtards du mythe et de la légende et, avec lui, l'élément universel contenu dans l'idée de l'Asgard-Mitgard, “centre du monde”.
Le contact des peuples germaniques avec le monde romano-chrétien produisit deux effets. D'une part, si leur descente acheva de bouleverser, au cours d'un premier stade, l'appareil matériel de l'Empire, elle se traduisit, intérieurement, par un apport vivifiant, grâce auquel devaient être réalisées les conditions préalables d'une civilisation nouvelle et virile, destinée à raffermir le symbole romain. Ce fut dans le même sens que s'opéra également une rectification essentielle du christianisme et même du catholicisme, surtout en ce qui concerne la vision générale de la vie.
D'autre part, l'idée de l'universalité romaine, de même que le principe chrétien, sous son aspect générique d'affirmation d'un ordre surnaturel, produisirent un réveil de la plus haute vocation des souches nordico-germaniques, servirent à intégrer sur un plan plus élevé et à faire vivre dans une forme nouvelle ce qui s'était souvent matérialisé et particularisé chez eux sous la forme de traditions propres à chacune de ces ethnies (9). La “conversion”, au lieu de dénaturer leurs forces, les purifia souvent et les prépara à une repnaissance de l'idée impériale romaine.
Le couronnement du roi des Francs comportait déjà la formule : Renovatio romani Imperii ; en outre, Rome une fois assumée comme source symbolique de leur imperium et de leur droit, les princes germaniques devaient finalement se grouper contre la prétention hégémoniste de l'Église et devenir le centre d'un grand courant nouveau, tendant à une restauration traditionnelle.
Du point de vue politique, l’ethos congénital des peuples germaniques donna à la réalité impériale un caractère vivant, solide et différencié. La vie des anciennes sociétés nordico-germaniques se fondait sur les 3 principes de la personnalité, de la liberté et de la fidélité. Le sentiment communautaire confus, l'incapacité de l'individu à se mettre en valeur autrement qua dans le cadre d'une institution abstraite, lui étaient tout à fait étrangers. La liberté est ici, pour l'individu, la mesure de la noblesse. Mais cette liberté n'est pas anarchique et individualiste ; elle est capable d'un dévouement transcendant la personne, elle connaît la valeur transfigurante de la fidélité envers celui qui en est digne et auquel on se soumet volontairement. C'est ainsi que se formèrent des groupes de fidèles autour de chefs auxquels pouvait s'appliquer l'antique formule : « La suprême noblesse de l'Empereur romain est d'être, non un propriétaire d'esclaves mais un seigneur d'hommes libres, qui aime la liberté même chez ceux qui le servent ».
Conformément à l'ancienne conception aristocratique romaine, l'État avait pour centre le conseil des chefs, chacun libre, seigneur dans sa terre, chef du groupe de ses fidèles. Au delà de ce conseil, l'unité de l'État et, d'une certaine manière, son aspect super-politique, était incarné par le roi, en tant que celui-ci appartenait — à la différence des simples chefs militaires — à une souche d'origine divine : chez les Goths, les rois étaient souvent désignés sous le nom d'âmals, les “célestes”, les “purs”. Originellement, l'unité matérielle de la nation se manifestait seulement à l'occasion d'une action, de la réalisation d'un but commun, notamment de conquête ou de défense. C'est dans ce cas seulement que fonctionnait une institution nouvelle. À côté du rex, était élu un chef, dux ou heretigo, et une hiérarchie rigide se formait spontanément, le seigneur libre devenant l'homme du chef, dont l'autorité allait jusqu'à la possibilité de lui ôter la vie s'il manquait aux devoirs qu'il avait assumé. « Le prince lutte pour la victoire, le sujet pour son prince. » Le protéger, considérer comme l'essence même du devoir de fidélité « d'offrir en l'honneur du chef ses propres gestes héroïques » — tel était, déjà selon Tacite (Germania, XIV), le principe. Une fois l'entreprise achevée, on retournait à l'indépendance et à la pluralité originelles.
Les comtes scandinaves appelaient leur chef “l'ennemi de l'or”, parce qu'en sa qualité de chef, il ne devait pas en garder pour lui et aussi “l'hôte des héros” parce qu'il devait mettre un point d'honneur à accueillir dans sa maison, presque comme des parents, ses guerriers fidèles, ses compagnons et pairs. Chez les Francs aussi, avant Charlemagne, l'adhésion à une entreprise était libre : le roi invitait, ou procédait à un appel, ou bien les princes eux-mêmes proposaient l'action mais il n'existait en tout cas aucun “devoir” ni aucun “service” impersonnel : partout régnaient des rapports libres, fortement personnalisés, de commandement et d'obéissance, d'entente, de fidélité et d`honneur (10). La notion de libre personnalité demeurait ainsi la rase fondamentale de toute unité et de toute hiérarchie. Tel fut le germe “nordique” d'où devait naître le régime féodal, substratum de la nouvelle idée impériale.
Le développement qui aboutit à ce régime prend naissance avec l'assimilation de l'idée de roi à celle de chef. Le roi va maintenant incarner l'unité du groupe même en temps de paix. Ceci fut rendu possible par le renforcement et l'extension du principe guerrier de la fidélité à la vie du temps de paix. Autour du roi se forme une suite de fidèles (les huskarlar nordiques, les gasindii lombards, les gardingis et les palatins goths, les antrustiones ou convivae regis francs, etc.) des hommes libres, mais considérant pourtant le fait de servir leur seigneur et de défendre son honneur et son droit, comme un privilège et comme une manière d'accéder à un mode d'être plus élevé que celui qui les laissait, au fond, principe et fin d'eux-mêmes (11). La constitution féodale se réalise à travers l'extension progressive de ce principe, apparu originellement au sein de la royauté franque, aux différents éléments de la communauté.
Avec la période des conquêtes s’affirme un second aspect du développement en question : l'assignation, à titre de fief, des terres conquises, avec la contrepartie de l'engagement de fidélité. Dans un espace qui débordait celui d'une nation déterminée, la noblesse franque, en rayonnant, servit de facteur de liaison et d'unification. Théoriquement, ce développement semble se traduire par une altération de la constitution précédente ; la seigneurie apparaît conditionnée ; c'est un bénéfice royal qui implique la loyauté et le service. Mais, en pratique, le régime féodal correspond à un principe, non à une réalité figée ; il repose sur la notion générale d'une loi organique d'ordre, qui laisse un champ considérable au dynamisme des forces libres, rangées, les unes à côté des autres ou les unes contre les autres, sans atténuations et sans altérations le sujet en face du seigneur, le seigneur en face du seigneur en sorte que tout liberté, honneur, gloire, destin, propriété se fonde sur la valeur et le facteur personnel et rien, ou presque, sur un élément collectif, un pouvoir public ou une loi abstraite.
Comme on l'a justement remarqué, le caractère fondamental et distinctif de la royauté ne fut pas, dans le régime féodal des origines, celui d'un pouvoir “public”, mais celui de forces en présence d'autres forces, chacune responsable vis-à-vis d'elle-même de son autorité et de sa dignité. C'est la raison pour laquelle cette situation présenta souvent plus de ressemblance avec l'état de guerre qu'avec celui de “société” mais c'est aussi pourquoi elle comporta éminemment une différenciation précise des énergies. Jamais, peut-être, l'homme ne s'est vu traité plus durement que sous le régime féodal, et pourtant ce régime fut, non seulement pour les feudataires, tenus de veiller par eux-mêmes et continuellement sur leurs droits et sur leur prestige, mais pour les sujets aussi, une école d'indépendance et de virilité plutôt que de servilité. Dans la féodalité, les rapports de fidélité et d'honneur ressortirent plus qu'à toute autre époque de l'Occident (12).
D'une façon générale, dans cette nouvelle société, après la promiscuité du Bas Empire et le chaos de la période des invasions, chacun put trouver la place conforme à sa nature, ainsi qu'il arrive chaque fois qu'existe un centre immatériel de cristallisation dans l'organisation sociale. Pour la dernière fois en Occident, la quadripartition sociale traditionnelle en serfs, bourgeois, noblesse guerrière et représentants de l'autorité spirituelle (le clergé du point de vue guelfe, les Ordres ascétiques de chevalerie du point de vue gibelin) se constitua d'une façon presque spontanée, et se stabilisa.
Le monde féodal de la personnalité et de l'action n'épuisait pas, toutefois, les possibilités les plus profondes de l'homme médiéval. La preuve en est que sa fides sut aussi se développer sous une forme, sublimée et purifiée dans l'universel, ayant pour centre le principe de l'Empire, senti comme une réalité déjà supra-politique, comme une institution d'origine surnaturelle formant un pouvoir unique avec le royaume divin. Cependant que continuait à agir en lui l'esprit formateur des unités féodales et royales particulières, il avait pour sommet l'empereur, qui n'était pas simplement un homme, mais bien, selon des expressions caractéristiques, deus-homo totus deificatus et sanctificatus, adorandum quia praesul princeps et summus est (13). L'empereur incarnait ainsi, au sens éminent, une fonction de “centre” et il demandait aux peuples et aux princes, en vue de réaliser une unité européenne traditionnelle supérieure, une reconnaissance de nature aussi spirituelle que celle à laquelle l'Église prétendait pour elle-même. Et tout comme 2 soleils ne peuvent coexister dans un même système planétaire, image qui fut souvent appliquée à la dualité Église-Empire, de même le contraste entre ces 2 puissances universelles, références suprêmes de la grande ordinatio ad unum du monde féodal, ne devait pas tarder à éclater.
Certes, de part et d'autre, les compromis ne manquèrent pas, non plus que des concessions plus ou moins conscientes au principe opposé. Toutefois le sens de ce contraste échappe à celui qui, s'arrêtant aux apparences et à tout ce qui ne se présente, métaphysiquement, que comme une simple cause occasionnelle, n'y voit qu'une compétition politique, un heurt d'intérêts et d'ambitions, et non une lutte à la fois matérielle et spirituelle, et considère ce conflit comme celui de 2 adversaires qui se disputent la même chose, qui revendiquent chacun pour soi la prérogative d'un même type de pouvoir universel.
À travers cette lutte se manifeste au contraire le contraste entre 2 points de vue incompatibles, ce qui nous ramène à nouveau aux antithèses du Nord et du Sud, de la spiritualité solaire et de la spiritualité lunaire. À l'idéal universel de type “religieux” de l’Église, s'oppose l'idéal impérial, marqué par une secrète tendance à reconstruire l'unité des 2 pouvoirs, du royal et du hiératique, du sacré et du viril. Bien que l'idée impériale, dans ses manifestations extérieures, se bornât souvent à revendiquer le domaine du corpus et de l'ordo de l'univers médiéval ; bien que ce ne fût souvent qu'en théorie que les Empereurs incarnèrent la lex viva et furent à la hauteur d'une ascèse de la puissance (14), en fait, cependant, on revient à l'idée de la “royauté sacrée” sur un plan universel. Et là où l'histoire n'indique qu'implicitement cette aspiration supérieure, c'est le mythe qui en parle le mythe qui, ici encore, ne s'oppose pas à l'histoire, mais la complète, en révèle la dimension en profondeur.
Nous avons déjà vu que dans la légende impériale médiévale figurent de nombreux éléments qui se relient plus ou moins directement à l'idée du “Centre” suprême. À travers des symboles variés, ils font allusion à un rapport mystérieux entre ce centre et l'autorité universelle et la légitimité de l'empereur gibelin. C'est à l'Empereur que sont transmis les objets emblématiques de la royauté initiatique et qu'est appliqué le thème du héros “jamais mort”, ravi dans le “mont” ou dans une région souterraine. C'est en lui qu'on pressent la force qui devra se réveiller à la fin d'un cycle, faire fleurir l'Arbre Sec, livrer l'ultime bataille contre l'invasion des peuples de Gog et Magog. C'est surtout à propos des Hohenstaufen que s'affirma l'idée d'une “souche divine” et “romaine”, qui non seulement détenait le regnum, mais était capable de pénétrer les mystères de Dieu, que les autres ne peuvent pressentir que par des images (15). Tout cela a donc pour contrepartie la spiritualité secrète, dont nous avons déjà parlé (cf. supra I, § 14), qui fut propre à une autre culmination du monde féodal et gibelin, à savoir la chevalerie.
En formant, de sa propre substance, la chevalerie, le monde du Moyen-Âge démontra de nouveau l'efficience d'un principe supérieur. La chevalerie fut le complément naturel de l'idée impériale, vis-à-vis de laquelle elle se trouvait dans le même rapport que le clergé vis-à-vis de l'Église. Ce fut comme une sorte de « race de l'esprit », dans la formation de laquelle la race du sang eut toutefois une part qui ne fut pas négligeable : l'élément nordico-aryen s'y purifia en un type et en un idéal de valeur universelle, analogue à ce qu'avait représenté à l'origine, dans le monde, le civis romanus.
Mais la chevalerie permet aussi de constater à quel point les thèmes fondamentaux du christianisme évangélique avaient été dépassés et dans quelle large mesure l'Église fut contrainte de sanctionner, ou, du moins, de tolérer, un ensemble de principes, de valeurs et de coutumes pratiquement irréductibles à l'esprit de ses origines. La question ayant déjà été traitée dans la première partie de cet ouvrage, nous nous contenterons de rappeler ici quelques points fondamentaux.
En prenant pour idéal le héros plutôt que le saint, le vainqueur plutôt que le martyr ; en plaçant la somme de toutes les valeurs dans la fidélité et dans l'honneur plutôt que dans la charité et l'humilité ; en considérant la lâcheté et la honte comme un mal pire que le péché ; en ne respectant guère la règle qui veut que l'on ne résiste pas au mal et qu'on rende le bien pour le mal en s'attachant plutôt à punir l'injuste et le méchant ; en excluant de ses rangs celui qui s'en serait tenu littéralement au précepte chrétien de « ne pas tuer » ; en ayant pour principe non d'aimer l'ennemi, mais de le combattre et de n'être magnanime qu'après l'avoir vaincu (16) la chevalerie affirma, presque sans altération, une éthique nordico-aryenne au sein d'un monde qui n'était que nominalement chrétien.
D'autre part, “l'épreuve des armes”, la solution de tout problème par la force, considérée comme une vertu confiée par Dieu à l'homme pour faire triompher la justice, la vérité et le droit sur la terre, apparaît comme une idée fondamentale qui s'étend du domaine de l'honneur et du droit féodal jusqu'au domaine théologique, car l'expérience des armes et “l'épreuve de Dieu” fut proposée même en matière de foi. Or cette idée non plus n'est guère chrétienne ; elle se réfère plutôt à la doctrine mystique de la “victoire” qui ignore le dualisme propre aux conceptions religieuses, unit l'esprit et la puissance, voit dans la victoire une sorte de consécration divine. L'interprétation théiste atténuée selon laquelle, au Moyen-Âge, on pensait à une intervention directe d'un Dieu conçu comme personne, n'enlève rien à l'esprit intime de ces coutumes.
Si le monde chevaleresque professa également la “fidélité” à l'Église, beaucoup d'éléments font penser qu'il s'agit là d'une soumission assez voisine de celle qui était professée à l'égard de divers idéaux et à l'égard des “dames” auxquels le chevalier se vouait impersonnellement, puisque pour lui, pour sa voie, seule était décisive la capacité générique de la subordination héroïque de la félicité et de la vie, non le problème de la foi au sens spécifique et théologal. Enfin, nous avons déjà vu que la chevalerie, de même que les Croisés, posséda, en plus de son côté extérieur, un côté intérieur, ésotérique.
Pour ce qui est de la chevalerie, nous avons dit qu'elle eut ses “Mystères”. Elle connut un Temple qui ne s'identifiait pas purement et simplement à l'Église de Rome. Elle eut toute une littérature et des cycles de légendes, où revécurent d'anciennes traditions pré-chrétiennes : caractéristique entre toutes est le cycle du Graal, en raison de l'interférence du thème de la réintégration héroïco-initiatique avec la mission de restaurer un royaume déchu (17). Elle forgea un langage secret, sous lequel se cacha souvent une hostilité marquée contre la Curie romaine. Même dans les grands ordres chevaleresques historiques, où se manifestait nettement une tendance à reconstituer l'unité du type du guerrier et de celui de l'ascète, des courants souterrains agirent qui, là où ils affleurèrent attirèrent sur ces ordres le légitime soupçon et, souvent même, la persécution des représentants de la religion dominante. En réalité, dans la chevalerie, agit également l'élan vers une reconstitution “traditionnelle” dans le sens le plus élevé, impliquant le dépassement tacite ou explicite de l'esprit religieux chrétien (on se rappelle le rite symbolique du rejet de la Croix chez les Templiers). Et tout cela avait pour centre idéal l'Empire. C'est ainsi que surgirent même des légendes, reprenant le thème de l'Arbre Sec, où la refloraison de cet arbre coïncide avec l'intervention d'un empereur qui déclarera la guerre au Clergé, au point que parfois par ex. dans le Compendium Theologiae (18) on arriva à lui attribuer les traits de l'Antéchrist : obscure expression de la sensation d'une spiritualité irréductible à la spiritualité chrétienne.
À l'époque où la victoire sembla sourire à Frédéric II, déjà les prophéties populaires annonçaient : « Le haut cèdre du Liban sera coupé. Il n'y aura plus qu'un seul Dieu, c'est-à-dire un monarque. Malheur au clergé ! S'il tombe, un nouvel ordre est prêt » (19).
À l'occasion des croisades, pour la première et dernière fois dans l'Europe post-romaine, se réalisa, sur le plan de l'action, par un merveilleux élan et comme dans une mystérieuse répétition du grand mouvement préhistorique du Nord et du Sud et de l’Occident vers l'Orient, l'idéal de l'unité des nations représentée, en temps de paix, pour l'Empire. Nous avons déjà dit que l'analyse des forces profondes qui déterminèrent et dirigèrent les croisades, ne saurait confirmer les vues propres à une histoire à 2 dimensions. Dans le courant en direction de Jérusalem se manifesta souvent un courant occulte contre la Rome papale que, sans le savoir, Rome elle-même alimenta, dont la chevalerie était la milice, l'idéal héroïco-gibelin la force la plus vivante et qui devait prendre fin avec un Empereur que Grégoire IX stigmatisa comme celui qui « menace de substituer à la foi chrétienne les anciens rites des peuples païens et, en s'asseyant dans le temple, usurpe les fonctions du sacerdoce » (20). La figure de Godefroi de Bouillon, ce représentant si caractéristique de la chevalerie croisée, appelé lux monachorum (ce qui témoigne de nouveau de l'unité du principe ascétique et du principe guerrier propre à cette aristocratie chevaleresque) est bien celle d'un prince gibelin qui ne monta sur le trôle de Jérusalem qu'après avoir porté à Rome le fer et le feu, après avoir tué de sa main l'anticésar Rodolphe de Rhinfeld et avoir chassé le pape de la ville sainte (21). De plus, la légende établit une parenté significative entre ce roi des croisés et le mythique chevalier du cygne — l'Hélias français, le Lohengrin germanique (22) — qui incarne à son tour des symboles impériaux romains (son lien généalogique symbolique avec César lui-même), solaires (relation étymologique possible entre Hélias, Helios, Élie) et hyperboréens (le cygne qui amène Lohengrin de la “région céleste” est aussi l'animal emblématique d'Apollon chez les Hyperboréens et c'est un thème qui se retrouve fréquemment dans les vestiges paléographiques du culte nordico-aryen). Il résulte de ces éléments historiques et mythiques que, sur le plan des Croisades, Godefroi de Bouillon représente, lui aussi, un symbole du sens de cette force secrète dont il ne faut voir, dans la lutte politique des empereurs teutoniques et même dans la victoire d'Othon Ier, qu'une manifestation extérieure et contingente.
L'éthique chevaleresque et l'articulation du régime féodal, si éloignés de l'idéal “social” de l'Église des origines ; le principe ressuscité d'une caste guerrière ascétiquement et sacralement réintégrée ; l'idéal secret de l'empire et celui des croisades, imposent donc à l'influence chrétienne de solides limites. L'Église les accepte en partie : elle se laisse dominer se “romanise” pour pouvoir dominer, pour pouvoir se maintenir au sommet de la vague. Mais elle résiste en partie, elle veut saper le sommet, dominer l'Empire. Le déchirement subsiste. Les forces suscitées échappent çà et là des mains de leurs évocateurs. Puis les 2 adversaires se dégagent de l'étreinte de la lutte, l'un et l'autre s'engagent sur la voie d'une égale décadence. La tension vers la synthèse spirituelle se ralentit. L'Église renoncera toujours plus à la prétention royale, et la royauté à la prétention spirituelle. Après la civilisation gibeline splendide printemps de l'Europe, étranglée à sa naissance le processus de chute s'affirmera désormais sans rencontrer d'obstacles.
► Julius Evola, Révolte contre le monde moderne, ch. XI. [tr. fr. Pierre Pascal]
♦ Notes :
(1) La plupart des difficultés et apories de la philosophie et de la théologie catholiques – not. la scolastique et le thomisme – ont leur origine dans le fait que l'esprit des éléments empruntés au platonisme et à l'aristotélisme est irréductible à celui des éléments proprement chrétiens et hébraïques. Cf. L. Rougier, La scolastique et le thomisme, 1925.
(2) A. Dempf, Sacrum Imperium, trad. it., Messine-Milan, 1933, p. 87. F. de Coulanges (Les transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne, 1892) remarque à juste titre que si Pépin, Charlemagne et Louis le Pieux se donnèrent le titre de « défenseurs des églises », « nous ne devons pas nous tromper sur le sens de cette expression : elle avait alors une signification assez différente de celle qu'elle aurait de nos jours. Avoir les églises dans sa défense ou dans sa mainbour, c'était, suivant le langage et les idées du temps, exercer sur elles à la fois protection et autorité. Ce qu'on appelait défense ou mainbour était un véritable contrat qui entraînait inévitablement la dépendance du protégé (...). Il était soumis aux obligations de toute sorte que la langue du temps réunissait sous le seul mot de fidélité. Aussi devait-il prêter serment au prince ». Si Charlemagne revendique pour lui la défense de l'Église, il revendique aussi l'autorité et la mission « de la fortifier au dedans dans la vraie foi » (p. 309).
(3) Cf. Émile Bourgeois, L'État et le régime politique de la société carolingienne à la fin du IXe siècle, 1885, pp. 301-308 ; A. Solmi, Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno sino al Concordato di Worms, 1901, pp. 24-33, 101-104.
(4) En raison de son aspect fragmentaire et des nombreuses stratifications qu'elle présente, il n'est pas facile de se repérer dans la tradition des Eddas pour qui ne possède pas déjà une orientation appropriée. Ainsi, il est souvent question d'un Muspelsheim transposé, non plus localisé au Nord, et correspondant donc à l'habitat nordique par ses caractères plutôt que par sa localisation, et d'un Niflheim, avec les géants de la glace, situé au Nord. En revanche, quand les puissances du Sud sont réellement rapportées au Muspelheim, celui-ci ne tarde pas à se changer en son opposé, acquérant ainsi une valeur négative : il devient le domaine de Surtr, le “Noir”, qui attaquera les dieux et provoquera la fin d'un cycle. Les fils de Muspel sont précisément des entités ennemies des olympiens, ils font s'écrouler le pont Bifröst reliant terre et ciel (cf. Gylfaginning, 4, 5, 13, 51 ; Völuspa, 50, 51; W. Golther, Handbuch der germanischen Mythologie, 1895, p. 540).
(5) On peut rappeler que cette couleur se conserve dans les noms de l'Irlande et du Groenland (grünes Land = “terre verte”). Il semble que cette dernière était encore couverte, du temps de Procope, d'une végétation luxuriante.
(6) C'est probablement pour cela que les Nibelungen et les géants sont représentés comme les artisans d'objets et d'armes magiques, qui seront ensuite confiés aux Ases ou aux héros – par ex. le marteau-foudre de Thor, l'anneau d'or et le casque magique de Sigurd. Une légende plutôt compliquée parle du lien contracté envers les géants par les Ases, qui eurent recours à eux pour reconstruire la forteresse d'Asgard, laquelle est en même temps celle qui barre le passage aux « natures élémentaires » (Gylfanning, 42).
(7) Selon la conception nordico-germanique originelle, outre les héros choisis par les Walkyries, seuls les nobles, de par leur origine non humaine, jouissent de l'immortalité divine. Il semble que le rite de l'incinération ne s'appliquait qu'aux héros et aux nobles. De toute façon, dans la tradition nordique, seul ce rite, prescrit par Odin, permettait d'ouvrir les portes du Walhalla, tandis que ceux ensevelis (rite méridional) étaient estimés rester esclaves de la terre.
(8) Cf. W. Golther, op. cit., pp. 211-213.
(9) Cette double influence se trouve exprimée de façon typique dans le poème Heliand. D'un côté, nous est représenté un Christ aux traits guerriers et peu évangéliques ; de l'autre, on y trouve le dépassement de la sombre conception du destin – la Wurd – qui, dans la période germanique plus tardive, avait pris tant d'importance qu'elle était sensée exercer son pouvoir même sur les forces divines. Dans le Heliand, le Christ est à la source de la Wurd. Cette force trouve en lui celui qui la domine, elle devient la « puissance magnifique de Dieu ».
(10) Cf. Gobineau, op. cit., pp. 163-170 ; M. Guizot, Essai sur l'Histoire de France, cit., pp. 86, 201 ; O. Gierke, Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaften, cit., vol. I, pp. 13, 29, 105, 111, etc.
(11) Cf. Gierke, op. cit., pp. 89-105.
(12) Cf. Guizot, op. cit., pp. 261, 262, 305-307, 308-311.
(13) Cf. A. Dempf, op. cit., p. 143 ; F. Kern, Der rex et sacerdos im Bilde (Forschungen und Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit, 1913).
(14) On a relevé avec raison (cf. M. Bloch, Les Rois thaumaturges, p. 186) que, bien que puissant et superbe, aucun monarque du Moyen Âge ne se sentit capable de célébrer – comme les anciens rois sacrés – la fonction du rite et du sacrifice, passée au clergé. Si loin que soient allés les Hohenstaufen dans la revendication du caractère surnaturel de l'Empire, ils ne surent pas recouvrer pour son représentant la fonction primordiale du rex sacrorum, alors même que le chef de l'Église avait fait sien le titre de pontifex maximus propre aux empereurs romains. Dans la doctrine gibeline d'Hugues de Fleury, la primauté, fût-elle sacrale, de l'Empire, est limitée à l'ordo, donc à l'organisation extérieure de la Chrétienté, et exclue de la dignitas, qui ne revient qu'à l'Église.
(15) Cf. E. Kantorowicz, L'Empereur Frédéric II, p. 517-518, où il est question du « sang impérial » par référence aux Hohenstaufen : « Une vertu particulière résidait, selon lui [l'empereur Frédéric], dans cette race, car, à ceux qui en étaient issus, il était donné de “connaître les mystères du royaume de Dieu alors que les autres pouvaient seulement les contempler sous la forme de symboles” (...). C'est la maison divine des Césars romains qui réapparaît avec les Hohenstaufen, la “maison céleste des Divi Augusti, dont les étoiles brillent à jamais”, une race qui descend d'Enée, père du peuple romain, et, de là, conduit par-delà César, à Frédéric et à ses rejetons en descendance directe. Tous les membres de cette race impériale sont appelés divi : non seulement les prédécesseurs défunts, mais aussi les vivants et, d'une manière générale, tous les membres de la dynastie impériale des Hohenstaufen (...). À l'époque de Barberousse, c'était la fonction impériale qui avait pris un caractère divin ; désormais c'était non seulement la personne du seul Frédéric, mais la dynastie Hohenstaufen et le sang Hohenstaufen eux-mêmes qui devenaient peu à peu césariens et divins. Encore un demi-siècle de domination Hohenstaufen et avec l'apparition de Frédéric III, empereur romain promis par les Sybilles et si ardemment désiré, l’Occident aurait vu de nouveau le “Dieu Auguste” en personne faisant son entrée par les portes de Rome, et il aurait brûlé de l'encens et sacrifié à sa statue sur les autels. C'est dans les Hohenstaufen que, pour la dernière fois, l'Occident avait pu contempler une dynastie de dieux ».
(16) Cf. RN Coudenhove-Kalergi, Held oder Heiliger, 1927, p. 68-69.
(17) Cf. Evola, Le mystère du Graal et l'idée impériale gibeline, 1937 [Éd. Traditionnelles, 1967]. Si les « rois du Graal » peuvent être considérés comme le symbole central de la tradition secrète gibeline, la généalogie symbolique fournie par Wolfram von Eschenbach fait apparaître la relation de cette tradition avec l'idée du “Roi du Monde” et avec l'aspect antiguelfe des Croisades. Cette généalogie rattache les rois du Graal au « Prêtre Jean » (qui est précisément l'une des représentations médiévales du “Roi du Monde”) et au Chevalier du Cygne, lequel à son tour fut mis en relation symbolique, on va le voir, avec plusieurs chefs des croisades, dont Godefroi de Bouillon.
(18) Cf. A. Graf, Roma nella memoria e nelle immaginazioni del Medioevo, vol. II, pp. 500-503.
(19) Cf. E. Gebhart, L'Italia mistica, (tr. it.) 1934, p. 117.
(20) Ibid., p. 115.
(21) Cf. Eugène Aroux, Les Mystères de la chevalerie, 1858, p. 93.
(22) Cf. La Chanson du Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon (XIIe s.), Célestin Hippeau (éd. sc.), 2 vol. [vol. 1 — vol. 2], 1874-1877. Dans le Chevalier du Cygne, dont la patrie est la demeure céleste et qui se soustrait à l'amour d'Elise, on retrouve le thème antigynécocratique propre aux cycles héroïques (cf. les mythes d'Héraclès, Énée, Gilgamesh, Rostam, etc.).
♦ Nota bene : On pourra compléter cette lecture par ces autres courts extraits.

◘ Le mythe de la royauté future
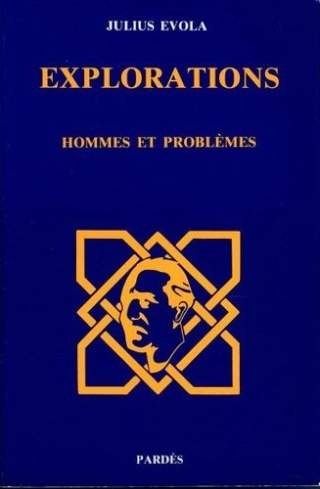 Dans un précédent article, nous avons parlé de certains pronostics sur le cours de l'histoire qui ont été faits par des philosophes comme Vico et Spengler. Ces penseurs ont reconnu que le point le plus critique de l'achèvement d'un cycle historique peut aussi être le moment où un principe d'autorité et une “monarchie”, au sens littéral de “domination d'un seul”, reprennent vigueur. Tout en dénonçant les côtés suspects que présente ce point de vue, précisément parce qu'il ne s'agirait pas d'un pouvoir ayant une légitimité supérieure, nous faisions remarquer que ces philosophes ont repris à leur façon un thème possédant un caractère d'universalité dans les traditions et dans les mythes de très nombreux peuples.
Dans un précédent article, nous avons parlé de certains pronostics sur le cours de l'histoire qui ont été faits par des philosophes comme Vico et Spengler. Ces penseurs ont reconnu que le point le plus critique de l'achèvement d'un cycle historique peut aussi être le moment où un principe d'autorité et une “monarchie”, au sens littéral de “domination d'un seul”, reprennent vigueur. Tout en dénonçant les côtés suspects que présente ce point de vue, précisément parce qu'il ne s'agirait pas d'un pouvoir ayant une légitimité supérieure, nous faisions remarquer que ces philosophes ont repris à leur façon un thème possédant un caractère d'universalité dans les traditions et dans les mythes de très nombreux peuples.
C'est sur ce point que nous désirons maintenant porter l'attention — à titre, si l'on veut, de simple curiosité — en opérant un choix parmi des matériaux très riches. On peut parler, à ce sujet, d'un “mythe de l'avènement”. Il s'agit en même temps d'un pronostic sur l'histoire. L'idée fondamentale est la même : comme par une brusque inversion, à l'apogée du désordre un nouveau principe se manifeste, qui présente parfois des traits surnaturels et sacraux, mais aussi, parfois, des traits héroïques et royaux. C'est par ex. le cas de la célèbre théorie indienne des avatâra, “descentes” ou manifestations périodiques d'une force du haut, quand dans une société la loi est violée, quand les castes n'existent plus, quand l'impiété, le désordre et l'injustice prévalent. On attend, pour une période de ce genre, dans, l'avenir, le Kalki-avatâra, qui, avec les rois de la “dynastie solaire” et ceux de la “dynastie lunaire”, combattra les forces du chaos.
Cela a pour pendant l'ancien mythe perse de l'avènement de Shaoshyant. Dans le cadre de la lutte éternelle entre le dieu lumineux Ahura-Mazda et l'antidieu Ahriman, on verra apparaître un souverain envoyé par le premier pour instaurer le règne nouveau et triomphal des hommes fidèles au principe de l'ordre, de la lumière et de la vérité. Or, il est intéressant de noter que ce fut précisément de cette conception iranienne archaïque que les Hébreux tirèrent leur idée du Messie. Il fallut attendre le prophétisme tardif pour voir celle-ci prendre des traits exclusivement mystiques et religieux, annonciateurs de la théorie chrétienne de l'avènement du regnum supraterrestre. Dans l'ancienne conception hébraïque, le Messie, en tant qu'émanation du “Dieu des armées”, devait assurer au contraire au “peuple élu” le pouvoir sur ce monde et la domination sur tous ses ennemis.
Chose peu connue, le mythe de l'avènement retrouva une force particulière durant la période impériale romaine. L'intronisation de chaque nouveau César fut précisément qualifiée d'adventus. Après que Virgile, dans sa fameuse églogue, eut annoncé, en relation avec l'avènement d'Auguste, la fin de l'âge de fer, l'apparition d'un nouvel âge d'or, se répandit une atmosphère caractérisée par une espèce d'attente messianique autour de la figure de chaque nouvel empereur, qui était salué par la formule liturgique : « Viens, toi que nous attendons ! » Dans un ouvrage intéressant (Christus und die Caesaren), Staufer met précisément en relief ces aspects de la mystique romaine du Regnum, qui ont involontairement préparé, dans une certaine mesure, le terrain à l'idéal chrétien.
Mais peut-être est-ce le Moyen Âge qui présente les formulations les plus prégnantes du thème dont nous parlons. La restauratio imperii romano-germanique et gibeline fut inséparable d'une série de légendes et de mythes où elle s’exprimait avec une force plus grande, acquérant une signification supérieure, transcendante, universelle. Ici entrent d'abord en jeu les légendes du Graal. homme nous l'avons montré dans l'un de nos livres, le noyau central de ces légendes n’a pas grand-chose à voir avec les divagations mystico-chrétiennes et romantiques de Wagner. Il s'agit essentiellement, ici, de l'attente de celui grâce auquel un royaume déchu renaît à une splendeur nouvelle.
Le mythe impérial du Moyen Âge gibelin eut beaucoup d'autres variantes. Le thème dantesque de l'Arbre de l'Empire qui refleurit, s'y rapporte. Plus intéressante encore est l'idée de la “dernière bataille”. Elle se rattache au thème de l'interregnum, de la latence de la fonction royale. Une figure royale ou impériale — identifiée dans la légende à tel ou tel personnage historique — ne serait pas morte, en réalité. Elle se serait retirée en un lieu inaccessible (par ex. Frédéric Barberousse dans le Kyffhâuser) et attendrait son heure pour se réveiller et se manifester, afin de mener avec tous ceux qui lui sont restés fidèles une bataille décisive contre les forces du désordre, de l'injustice et des ténèbres.
Il est intéressant de signaler que, dans une variante de la légende, cette heure coïnciderait avec le moment du déferlement des peuples de Gog et Magog, auxquels Alexandre le Grand avait déjà barré la route grâce à une muraille de fer. Ces peuples démoniaques peuvent en effet symboliser le monde révolté des masses matérialisées et sans Dieu, et un autre détail est significatif : il est dit que ces peuples se déchaîneront au moment où l'on s'apercevra que plus personne ne souffle dans les trompettes placées au sommet de la muraille, et que le vent seul produit le son. En somme, lorsqu'on se rendra compte qu 'il n’y a plus personne derrière les défenses apparentes d'un monde en crise pour leur fournir consistance et légitimité authentique, se produira l'explosion des forces du bas. L'usurpation et le désordre qui en découlent étant parvenus à leur limite extrême, il y a crise et le moment décisif survient : la dernière bataille, de l'issue de laquelle dépendra la possibilité, ou non, d'un nouveau cycle positif et de la remanifestation du Regnum. C'est pourquoi il se peut qu'un contenu non saugrenu soit renfermé dans toutes ces variantes du “mythe de l'avènement”, pour confirmer par les vérités d'une tradition quasi pérenne la foi de ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas encore brisés.
► Julius Evola, in : Explorations : Hommes et problèmes, Pardès, 1989, pp. 105-108. (tr. P. Baillet)

 ◘ L'ORDRE DE LA COURONNE DE FER (1)
◘ L'ORDRE DE LA COURONNE DE FER (1)

À la chute de l'Empire Romain, le besoin de conserver et de défendre les valeurs spirituelles au milieu du chaos politique et de la désagrégation morale de l'époque fit naître les premiers Ordres ascétiques.
Aujourd'hui, le fait que se présente une situation analogue et la crise profonde que traverse le monde moderne, fait apparaître opportune la constitution de formes analogues. C'est dans cet esprit qu'avait été proposée la création de l'Ordre de la Couronne de Fer. Cette dénomination n'a rien à voir avec l'antique couronne italique (2). Elle avait été suggérée par l'idée d'une souveraineté devant être définie en termes spirituels et, en même temps, en référence au métal qui symbolise le mieux la dureté, la trempe et l'inflexibilité qui doivent être les traits du caractère des hommes de l'Ordre dans la défense de l'esprit.
• (1) Les hommes de l'Ordre ont avant tout le devoir de témoigner personnellement en défendant et en affirmant de manière adaptée aux circonstances les valeurs de la spiritualité pure, comprise comme une réalité transcendante, surpassant toute valeur simplement humaine, tout lien naturel, “social” et individuel.
• (2) Les dévastations qui caractérisent le monde moderne imposent aux hommes de l'Ordre la manifestation et l'affirmation de telles valeurs, à l'écart d'institutions et de formes plus ou moins conditionnées historiquement.
Les hommes de l'Ordre conscients que dans l'état actuel des choses il n'y a pas d'ordre politique et social qui ait un caractère légitime, conforme à des principes supérieurs, gardent une distance précise face à cet état de choses. Ils pourront être présents, accepter des charges et des fonctions, mais à seule fin d'exercer une action d'inspiration supérieure, directe ou indirecte. Quant à l'éloignement où ils se tiennent à l'égard de toutes les formes religieuses particulières, hors de toutes considérations sur la décadence et la sécularisation croissante de ces formes, cela est une attitude qui trouve sa justification dans la reconnaissance des valeurs fondamentales libres de tout conditionnement.
• (3) Ceci mis à part, il est essentiel que les hommes de l'Ordre agissent sur le plan existentiel par leur présence même et par leur adhésion absolue à la vérité, par leur droiture, par leur capacité à subordonner l'homme à l'œuvre, par leur inflexibilité et la rigueur de leur idée, par leur indifférence face à toute reconnaissance extérieure et à tout avantage matériel. En vue de ce qui peut dériver de la correspondance de l'extérieur et de l'intérieur, il est désirable que les hommes de l'Ordre soient choisis parmi ceux qui également sur le plan physique, sont sans défauts, voire même qu'ils aient quelque chose qui s'impose. Du reste, cette règle vaut souvent dans les Ordres chevaleresques eux-mêmes.
• (4) Il est des distorsions spécifiques à la civilisation moderne et prendre position contre celles-ci est la condition naturelle et sans conteste pour l'appartenance à l'Ordre. Cela conduit à stigmatiser surtout toute forme de démocratie et d'égalitarisme à quoi s'oppose un principe, source spirituelle d'autorité et de hiérarchie.
Plus encore doit être combattu tout mythe “social” collectiviste et prolétarien. Le mépris pour la soi-disant “classe ouvrière” (2) est un point essentiel. Les hommes de l'Ordre s'opposent tant à toute prévarication et à toute tentative d'accession au pouvoir des forces du bas qu'à tout concept de rang, de privilège et de pouvoir défini en termes d'argent et de richesse.
Le devoir des hommes de l'Ordre est d'affirmer la primauté des valeurs spirituelles héroïques, aristocratiques et traditionnelles contre le matérialisme pratique, l'immoralisme frivole et l'utilitarisme des temps présents.
En toute occasion, ils soutiendront ce qui va dans le sens des valeurs déjà mentionnées et ils feront obstacle et saperont tout ce qui va là-contre.
• (5) L'Ordre reconnaît la Vérité comme étant l'instrument le plus puissant de son action. Le mensonge, la mystification idéologique, l'intoxication et l'action abrutissante, exercés par des moyens subtils sont en réalité à la base de l'œuvre générale de subversion et de renversement des valeurs dans le monde actuel.
• (6) Comme le centre de gravité de l'Ordre ne coïncide ni avec une confession religieuse particulière ni avec un mouvement politique, l'Ordre se tient à distance de tout ce qui est “culture” au sens moderne du terme, intellectualiste ou profane. Ce qui est fondamental pour l'homme de l'Ordre est, au contraire, une manière d'être ; en second lieu, c'est une vision donnée de la vie conçue comme l'expression de cet “être” ; en troisième lieu, les éléments de style pour un comportement personnel de droiture et de cohérence de l'existence et la norme pour la domination de l'action.
• (7) Des courants et des familles d'idées pourront être soutenus, inspirés, suscités selon les circonstances et les situations par l'Ordre sans que celui-ci se dévoile. L'Ordre tendra à agir sur le plan des causes et non sur celui des effets et de l'exotérique.
• 8) L'Ordre tout entier fait corps derrière chaque homme de l'Ordre.
Tout membre de l'Ordre aura le devoir d'apporter son soutien, par quelque moyen que ce soit, à chaque membre de l'Ordre non pas en tant qu'individu mais en tant que défenseur de l'Organisation. Tout membre de l'Ordre devrait se faire le centre d'influence d'une recherche donnée et l'unité de l'Ordre exprimera, confirmera et renforcera la relation profonde, naturelle, existant en puissance entre les éléments, cellules ou centres d'action convergents mus, intérieurement, par la même idée.
DES QUALIFICATIONS
• (1) Seuls les hommes peuvent être admis dans l'Ordre. Ils ne doivent pas être mineurs de 21 ans, ils doivent être exempts de tares physiques et de tout ce qui, sur le plan psychosomatique serait de nature à porter préjudice au prestige moral du candidat.
• (2) L'Ordre présuppose des individualités qui, possédant au moins potentiellement une même qualification intérieure, vocation et mentalité, se trouvent déjà à des degrés divers sur une même ligne.
L'appartenance à l'Ordre requiert en tout cas un engagement précis et faisant l'objet d'un serment ayant trait à la nécessité de placer en premier lieu et en toutes choses, l'idée avant tout lien sentimental, affectif et familial ; avant toute préférence individuelle, tous intérêts matériels et toutes ambitions sociales.
Il n'est pas demandé de renoncement aux hommes de l'Ordre mais un détachement intérieur en ce qui concerne sa propre situation, quelle qu'elle soit, dans le monde profane.
• 3) L'appartenance à une communauté donnée ou à une confession religieuse n'est pas incompatible avec l'appartenance à l'Ordre mais en cas de divergences, il doit être assuré à ce dernier un “droit prééminent”.
• 4) Il est souhaitable qu'en faisant référence à des principes supérieurs, les hommes de l'Ordre aspirent à des réalisations correspondantes et que dans cette vue, ils s'efforcent de rechercher les contacts avec des états supérieurs de l'être qui ont fait l'objet de disciplines opératives à caractère initiatique.
DES DIGNITÉS ET DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE
• 1) L'Ordre présente 2 aspects : l'un interne et l'autre externe. En ce qui concerne l'aspect externe, tous les membres de l'Ordre sont revêtus d'une égale dignité correspondant à la désignation ou au titre d'“Homme de l'Ordre de la Couronne de Fer”. Sur le plan de l'Organisation, l'Ordre est régi et dirigé par un Conseil des Maîtres de l'Ordre, composé de 7 membres, avec un “Grand Maître de l'Ordre”. Parmi ces membres sont répartis des devoirs de caractère général sur le plan des réalisations et de la discipline, toutes choses à définir au fur et à mesure des sessions du Conseil.
• 2) L'aspect interne de l'Ordre correspond au domaine purement doctrinal et comprend 3 degrés, en relation avec l'état de réalisation spirituelle de ceux qui en sont revêtus.
Cette articulation ne coïncide pas nécessairement avec l'articulation externe, étant entendu cependant qu'au moins 4 des membres du Conseil des Maîtres doivent être revêtus du grade le plus élevé de la hiérarchie interne de l'Ordre.
À ceci et au travail sur le plan de la connaissance de la qualification progressive à la lumière des critères de la Tradition, est consacré un chapitre spécial.
• 3) C'est au Conseil de décider de toute admission dans l'Ordre avec le choix et l'investiture directe d'éléments signalés et jugés dignes.
Il n'est pas exclu de procéder à des agrégations à l'Ordre pour ainsi dire “d'office”. Telle personnalité pouvant être déclarée comme faisant partie de l'Ordre (avec tous les effets que cela implique) même si elle n'a pas de rapport direct avec celui-ci.
• 4) L'appartenance à l'Ordre ne comporte pas d'obligations financières. Des dons libres ou des donations pourront être admis, dont disposera le Conseil des Maîtres, exclusivement pour les finalités impersonnelles de l'Ordre.
• 5) Le titre d'“Homme de l'Ordre” est potentiellement héréditaire en ce sens que celui qui en est revêtu peut décider de le transmettre à l'aîné de sa famille. Ceci afin que la tradition de son sang soit aussi celle d'une forme donnée et d'une influence spirituelle, dans la continuité d'une même action.
• 6) Les membres du Conseil des Maîtres sont les fondateurs de l'Ordre. Le Conseil lui-même prendra les décisions pour ce qui est de la succession de tel de ses membres en cas de décès ou de disqualification. Chacun des membres du Conseil a le droit de proposer à qui il désire de lui succéder dans sa fonction et d'être le continuateur de son œuvre. C'est au Conseil qu'il appartiendra de décider en dernier ressort à ce sujet.
• 7) L'Ordre a essentiellement le caractère d'une société virile (Männerbund). De ce fait, ce qui a trait à la notion de famille lui est indifférent.
• 8) Les hommes de l'Ordre peuvent suivre une ligne de liberté sexuelle, étant bien entendu que celle-ci ne doit pas constituer une servitude (3).
• 9) Si les femmes peuvent faire partie de l'Ordre comme membres, de jeunes filles pourraient constituer une formation de “tertiaires” à la disposition des hommes de l'Ordre, pour un usage communautaire et non possessif (nous renvoyons à ce que Platon expose, dans l'idéal de son État, au sujet de la caste des guerriers, en prenant bien toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir la fécondation) (4).
► Julius Evola, 1973, in : Kalki n°2, 1987.
◘ Nota bene : Ce texte a été publié en italien dans la revue Arthos n°2 (janv.-avril 1973). Première publication en français dans cette traduction due à JF d'Heurtebize : Le Devenir Européen n° 20/21 (mai-juil. 1974).
◘ Notes :
(1) Il y a quelques années, des milieux intéressés par l'idée d'un Ordre s'adressaient à Julius Evola pour qu'il en esquissât les grandes lignes. Ce texte est le schéma proposé par Evola et, dans les circonstances actuelles, peut-être n'est-il pas dénué d'intérêt. (Note de Renato del Ponte, directeur d'Arthos).
(2) La couronne de fer des anciens rois lombards, à laquelle il est fait allusion au début de ce récit, est aujourd'hui conservée dans le Trésor de la cathédrale de Monza, en Italie. Datant de la première moitié du IXe siècle, cette couronne est en réalité un bandeau d'or assez large orné d'émaux et de pierreries ; à l'intérieur, une tige de fer circulaire passe pour avoir été forgée avec un “vrai clou” de la crucifixion du Christ. Symbole des rois d'Italie depuis le XIIIe siècle, Napoléon-Bonaparte la ceignit à Milan en mai 1805 en sa qualité de roi d'Italie. (Note de J.-F. d'H.).
(3) Pour bien comprendre la signification de cette déclaration évolienne, le lecteur devra se reporter à ce qu'écrivait récemment le Maître dans son appendice à la dernière édition de Gli uomini e le rovine [Les hommes au milieu des ruines] (Rome, 1972), IV : Tabous de notre temps, § 2 : « La classe ouvrière » (p. 279-282) :
« Aujourd'hui le travailleur se présente à nous seulement comme un vendeur de la “marchandise-travail”, vente dont il cherche à tirer tout le profit possible sans scrupules, en visant seulement à accéder à un niveau de vie bourgeoise ».
« Le temps est passé du prolétariat misérable de la première époque de l'humanité (...), aujourd'hui un “travailleur” se porte mieux que beaucoup d'intellectuels, qu'un enseignant ou qu'un petit fonctionnaire (...). Le travailleur moderne ne pense qu'à soi-même, et ses organisations veillent uniquement aux intérêts de la catégorie (à laquelle il appartient). » (p. 281)
Sur le concept du “travail” en tant qu'aberration des temps modernes, voir l'éditorial « L'action et le travail » du même Evola dans La Torre, n° 7 de mai 1930 et l'essai « L'affaiblissement des mots » (Labor, p. 46-47), dans L'Arc et la Massue, Trédaniel/Pardès, 1984. (Note de Renato del Ponte).
(4) Ces déclarations pourront paraître étranges ou pour le moins surprenantes à bon nombre de lecteurs. Il convient toutefois d'avoir présente à l'esprit la signification qu'a eue le sexe, dans le passé, dans un contexte non “profane”, mais normal, c'est-à-dire conforme aux principes de la Tradition. En particulier, l'Auteur fait ici référence à des pratiques de magie opérative à base sexuelle, telles qu'on en trouve dans l'Antiquité ou, à des époques assez récentes, au sein de groupes comme la Myriam de Kremmerz ou la Thelema de Crowley. À ce propos, voir le chap. VI de Métaphysique du sexe : « Le sexe dans le domaine de l'initiation et de la Magie ». Il est certain qu'en ce qui concerne des organisations du type de celles envisagées dans le présent document, l'utilisation de pratiques de ce genre est peu connue (il faudrait peut-être se tourner vers les Templiers, mais avec peu d'éléments documentaires), même s'il semble qu'aujourd'hui encore il existe, en Occident, des résidus de sociétés initiatiques (...) qui mettent en pratique de tels enseignements. Cependant, le côté le plus problématique n'est pas représenté par la plus ou moins grande valeur, sur le plan des principes, de ces opérations, mais par la possibilité effective que des esprits occidentaux modernes puissent leur donner une orientation correcte, au-delà de toute “déformation” profane. (Note de Renato del Ponte). Par une pudibonderie excessive, le traducteur de ce texte d'Evola n'a pas osé livrer au public français le point 9 de ce document, ce qui l'a obligé à escamoter la note 4. Nous les traduisons tout de même. (Georges Gondinet).

Lectures critiques
◘ Evola, une éthique chevaleresque au service de l'Europe
 Spiritualité et politique
Spiritualité et politique
C’est à mon avis une relation problématique. Contrairement à d’autres théoriciens de la Tradition, comme René Guénon, Frithjof Schuon ou Coomaraswamy, Evola a au cours de sa vie presque constamment pris position sur les problèmes politiques, not. dans ses articles de journaux ou de revues. De ce point de vue, des livres comme Gli uomini e le rovine ou Orientamenti sont également significatifs. Cette particularité est à mettre en rapport avec sa volonté de s’affirmer comme un “guerrier” (kshatriya) plutôt que comme un “prêtre”, et aussi avec son affirmation, si contraire aux vues de Guénon, selon laquelle le guerrier ou le roi est porteur, au sein des sociétés traditionnelles, d’un principe spirituel de dignité égale à celle du sacerdoce.
En quoi cette volonté d’engagement politique est-elle problématique ? Elle l’est d’abord du fait que J. Evola aborde la politique en métaphysicien. La politique ne résulte pas chez lui, comme chez Carl Schmitt, du fait de la diversité des aspirations humaines et du caractère potentiellement conflictuel de cette diversité. Elle n’est pas non plus, comme chez Aristote, une conséquence de ce que l’homme est un « animal social ». Elle est de la métaphysique appliquée. Contrairement à un politologue comme Julien Freund, pour qui le politique est « originairement substantiel à la société en tant qu’essence » et qui soutient le caractère strictement autonome de cette essence, Evola fait partie de ces auteurs qui reconduisent ou ramènent le politique à une autre instance que la sienne propre.
Selon lui, la politique relève en dernière analyse de la métaphysique : elle ne représente que l’application dans un domaine particulier de principes qui, loin de la caractériser ou de lui appartenir en propre, trouvent en dehors d’elle leur origine, leur signification et leur légitimité. Tandis que pour J. Freund, la politique est « l’activité sociale qui se propose d’assurer par la force, généralement fondée sur le droit, la sécurité extérieure et la concorde intérieure d’une unité politique particulière en garantissant l’ordre au milieu de luttes qui naissent de la diversité et de la divergence des opinions et des intérêts », elle est pour Evola l’« application des directives du supra-monde », c’est-à-dire une activité mise en œuvre par une autorité dont le fondement ne peut être que « métaphysique », autorité assimilée à une « qualité transcendante et non uniquement humaine ». « Le fondement de tout véritable État, écrit Evola, c’est la transcendance de son principe ». Il s’en déduit que les règles de l’action politique ne sont pas autonomes, mais dérivées. La politique n’est pas en son fond politique, mais métaphysique : elle n’a pas d’essence propre.
Une telle approche a pour conséquence d’amener Evola à prôner une « politique de l’idéal », qui semble bien ne pas être autre chose qu’une politique idéale. Toute la question est de savoir si une telle politique a encore quelque chose à voir avec la politique réelle, ou si elle n’est que l’une des formes les plus typiques de ce que J. Freund a très justement appelé l’impolitique. Si l’on pose, comme je le crois, que la politique est d’abord l’art du possible, et que le possible est affaire de contexte et de situation, une politique idéale risque fort d’apparaître comme une contradiction dans les termes. Sans doute est-il louable de rappeler l’importance des principes en politique. Mais encore faut-il que ces principes soient distingués des idées pures, qui ne peuvent rester pures que dans la mesure où elle ne se concrétisent jamais dans la réalité.
Il est à cet égard très révélateur que, chez Evola, la politique soit constamment tirée du côté de l’éthique. Dans Gli uomini e le rovine, ce qu’il cherche à donner, plus encore que des orientations politiques, ce sont des consignes à valeur existentielle. Ce trait ne lui appartient pas en propre. Si la gauche a généralement une approche morale (ou moralisante) de la politique, la droite, elle, en a bien souvent une approche éthique — cette éthique versant elle-même fréquemment dans l’esthétique. Mais la morale ou l’éthique est une chose, la politique en est une autre, à savoir le service du bien commun. Et c’est en tant que telle qu’elle a ses règles propres.
Tradition et histoire
Un autre problème tient à la conception évolienne de l’histoire. Cette conception est elle-même paradoxale. D’un côté, Evola manifeste une nette hostilité envers la notion même d’historicité. Il pense que les sociétés traditionnelles, définies comme « anhistoriques » ou indifférentes à l’histoire, ont cessé d’être traditionnelles lorsqu’elles sont entrées dans l’histoire, et il assimile cette entrée à une sorte de chute (“l’âge d’or” apparaissant alors comme l’équivalent du Jardin d’Eden judéo-chrétien), allant jusqu’à écrire que « penser en termes d’histoire est absurde ». Ce qui l’amène à critiquer avec force toute forme d’historicisme. D’un autre côté, cependant, il adhère à la théorie des cycles, qui n’est nullement incompatible avec l’historicisme.
Evola critique avec force, et aussi avec beaucoup de justesse, l’idéologie du progrès, mais c’est pour lui opposer une vision qui en constitue le symétrique inverse, puisqu’elle revient à interpréter l’histoire des derniers millénaires, non comme mouvement progressif perpétuellement ascendant, mais comme mouvement constamment et inéluctablement descendant, comme déclin toujours plus accentué. Dans les 2 cas, la nécessité historique est conservée : l’homme subit le cours de l’histoire au lieu de pouvoir la diriger. Je ne partage pas cette conception. Pour moi, l’existence de l’homme est intrinsèquement sociale-historique : ce qui distingue l’espèce humaine des espèces animales, c’est qu’elle devient historiquement. Je pense en outre que, par-delà les processus historiques ponctuels, l’histoire est toujours ouverte, ce qui la rend imprévisible.
Si l’on adhère à la théorie des cycles, la question se pose immédiatement de savoir quels peuvent être le sens et la portée de l’action historique humaine. Comment peut-on agir politiquement pour enrayer un processus dont on affirme par ailleurs qu’il excède la volonté humaine, c’est-à-dire qu’il est inévitable ? Pour Evola, le moment actuel est celui d’une fin de cycle, phase crépusculaire qu’il assimile au kali-yuga des Indiens ou à “l’Âge du loup” de la tradition nordique. Cette idée a de toute évidence quelque chose d’incapacitant ou de paralysant.
L’action politique impliquant par définition la réversibilité des situations jugées indésirables, quel but assigner à l’action collective dans un monde voué à sa fin ? Si l’on vit une fin de cycle et que rien ne peut empêcher ce cycle d’aller à son terme, où peut résider la liberté fondementale de mouvement, sinon dans le for intérieur ? C’est là, me semble-t-il, une seconde limitation de la “politique évolienne”. Evola me paraît d’ailleurs l’avoir reconnu implicitement, notamment en 1961 dans Cavalcare la tigre, puis en 1963 dans Il cammino del Cinabro, lorsqu’il écrit que de nos jours « il n’existe plus rien, dans le domaine politique et social, qui mérite vraiment un total dévouement et un engagement profond ». Il ne reste alors plus aux « hommes différenciés » qu’à se réfugier dans l’apoliteia *, c’est-à-dire dans le détachement.
Maurras et Evola : royauté nationale et royauté sacrée
Evola défend une monarchie d’inspiration métaphysique, par quoi il faut entendre, non pas tant une monarchie “de droit divin”, au sens classique de cette expression, qu’une monarchie fondée sur des principes dérivant eux-mêmes de ce qu’Evola appelle la « Tradition primordiale ». Cette « Tradition primordiale » reste à mes yeux aussi nébuleuse qu’hypothétique, mais là n’est pas la question. Ce qui est sûr, c’est que J. Evola se fait de la monarchie une idée assez différente de celle de la plupart des théoriciens royalistes contemporains. Une étude comparative des idées de Charles Maurras et d’Evola, étude qui n’a pas encore été réalisée, serait de ce point de vue des plus utiles.
Certes, entre Maurras et Evola, il y a un certain nombre de points communs. Sur un plan plus anecdotique, on peut aussi rappeler que Pierre Pascal, réfugié en Italie après 1945 et qui fut jusqu’à la fin de sa vie assez actif dans certains milieux évoliens, avait dans sa jeunesse été un proche collaborateur de Maurras. Mais il n’en est pas moins vrai que le royalisme maurrassien, tout empreint de positivisme au point que Maurras put être qualifié de « Jacobin blanc » par Georges Bernanos et Edouard Berth, diffère profondément de l’idée monarchique tel que la conçoit Evola.
Ce dernier s’affirmait avec hauteur un Gibelin, tandis que Maurras était un Guelfe. Evola ne faisait guère la différence entre la royauté et l’Empire, qu’il défendait avec la même vigueur, tandis que Maurras, conformément à la tradition française, voyait dans la « lutte contre l’Empire » le principal mérite de la dynastie capétienne. Evola a toujours manifesté à la fois de l’intérêt pour les doctrines orientales et de la sympathie pour l’Allemagne ou le Nord « hyperboréen », alors que Maurras le Provençal, comme Henri Massis, opposait radicalement l’Orient à l’Occident et n’avait que mépris pour les « Barbares » établis de l’autre côté du Rhin.
En outre, Evola peut être considéré comme un théoricien des origines, puisqu’il rappelle sans cesse que le mot archè [principe] renvoie à la fois au plus ancien passé, à l’« archaïque », mais aussi à ce qui, de ce fait même, commande le présent. Maurras, au contraire, professe (de manière d’ailleurs assez paradoxale) un complet mépris des origines et ne s’intéresse aux grandes entreprises politiques qu’au travers de leur final accomplissement. Quant à leur conception de la politique, elle diffère elle aussi du tout au tout, Maurras (qui n’a jamais lu Evola) se réclamant de l’« empirisme organisateur » et du « nationalisme intégral » là où J. Evola (qui a lu Maurras) se réclame de la métaphysique et fait du nationalisme une critique féroce largement justifiée.
État : de la force à la forme
Plus encore qu’un théoricien de l’État, J. Evola en est avant tout un partisan résolu. Rejetant toutes les doctrines classiques qui font de l’État la forme organisée de la nation, le produit de la société ou la création du peuple, il affirme et réaffirme sans cesse que c’est au contraire l’État qui doit fonder la nation, mettre le peuple en forme et créer la société. « Le peuple, la nation, écrit-il, n’existent qu’en tant qu’État, dans l’État et, dans une certaine mesure, grâce à l’État ». Bien entendu, cet État doit selon lui se fonder sur des principes supérieurs, spirituels et métaphysiques, car c’est seulement ainsi qu’il sera un « État vrai », un « État organique », non pas transcendant par lui-même, mais fondé sur la transcendance de son principe.
Cet « étatisme » est certainement ce qu’il y a de plus frappant dans la pensée politique d’Evola. C’est aussi l’un des points sur lesquels il sympathise le plus nettement avec le fascisme, qui donnait à l’État la même importance que la tradition allemande attribuait au contraire au peuple (Volk). Sans doute cet étatisme est-il assorti d’un certain nombre de précisions destinées à dissiper tout malentendu. Evola prend ainsi le soin de dire que la « statolâtrie des modernes », telle qu’on la trouve par ex. chez Hegel, n’a rien à voir avec l’« État vrai » tel qu’il l’entend. Il souligne aussi que bien des États forts ayant existé dans l’histoire ne furent que des caricatures de celui qu’il appelle de ses vœux. Il critique d’ailleurs avec vigueur le bonapartisme, qu’il qualifie de « despotisme démocratique », comme le totalitarisme, dans lequel il voit une « école de servilité » et une « extension aggravante du collectivisme ». Le primat qu’il attribue à l’État n’en est pas moins significatif, surtout lorsqu’on le rapporte à ce qu’il dit du peuple et de la nation.
Ce qui pose problème, c’est la formule d’« État organique ». Les théoriciens politiques de l’organicisme — à la possible exception d’Othmar Spann — ne parlent en effet pratiquement jamais d’« État organique ». Ils parlent plutôt de société organique, de culture organique, de communautés organiques, etc. Et le modèle auquel ils se réfèrent est incontestablement un modèle emprunté aux sciences de la vie : une société en bonne santé est une société où il y a, dans les rapports sociaux, autant de souplesse qu’il en existe entre les organes d’un être vivant. On comprend bien, évidemment, que si Evola préfère parler d’« État organique », c’est que pour lui l’État est incommensurablement supérieur à la société.
Mais un État peut-il être lui-même organique ? Pour les théoriciens classiques de l’organicisme, la réponse est généralement négative : seule la société peut être organique, précisément parce qu’un organisme se définit comme un tout et qu’il ne saurait donc se ramener ou s’identifier à l’une quelconque de ses parties, fût-elle la plus éminente. Dans une telle perspective, l’État ne peut pas être un organisme à lui tout seul. Au contraire, il est même souvent ce qui menace le plus l’organicité de la société. Dans Gli uomini e le rovine, Evola écrit qu’« un État est organique lorsqu’il a un centre et que ce centre est une idée qui modèle efficacement, par sa propre vertu, ses diverses parties ». Mais, pour l’organicisme classique, une société a d’autant moins besoin d’un « centre » qu’elle est précisément organique, car ce qui définit l’organicité du corps social, ce n’est pas sa dépendance par rapport à un centre (la “tête”), mais bien la complémentarité naturelle de toutes ses parties.
L’« organicisme » d’Evola est donc très différent de l’organicisme classique. Ce dernier tend généralement à dévaloriser l’État et les institutions étatiques, considérées comme intrinsèquement « mécanistes », et à donner le rôle principal aux collectivités de base et au peuple. L’organicité, chez les théoriciens de l’organicisme, est toujours associé à ce qui est « en bas » et à ce qui est « spontané ». Leur critique, en général, consiste à opposer à une conception mécanique, rationalisée, abstraite, voire excessivement « apollinienne » de l’existence sociale, les prérogatives du vivant, du sensible, du charnel, manifestées dans l’esprit « dionysiaque » et dans l’« âme du peuple ». Or, c’est précisément la démarche inverse qu’adopte Evola, puisque pour lui l’âme, le sensible, le peuple, le collectif, etc. renvoient systématiquement aux dimensions les plus « inférieures » de l’existence. Dans la mesure où il implique une déconnection radicale de l’organique et du biologique, l’exacte portée d’un « organicisme d’en haut » reste donc à établir.
Un « État vrai » qui se veut affranchi de tout conditionnement naturaliste peut-il être véritablement « organique » ? L’organicité peut-elle être le résultat de l’autorité, de la puissance et surtout de la volonté ? Pour répondre à ces questions, l’expérience historique incite pour le moins à la prudence. Au cours de l’histoire, en effet, chaque fois qu’un État s’est affirmé titulaire d’un pouvoir souverain absolu, l’organicité du social n’a pas augmenté, mais décru.
Le cas de la France est à cet égard frappant. Evola a très justement noté que, dans sa volonté de s’affranchir de l’autorité du pape et de l’empereur, le pouvoir royal s’est en France coupé de tout principe spirituel supérieur. Mais il n’en est pas moins vrai que c’est aussi la France qui constitue le modèle le plus achevé d’une création de la nation par l’État. Or, c’est aussi le pays où l’autorité souveraine de l’État, définie depuis Jean Bodin comme indivisible et inaliénable, a le plus appauvri l’organicité sociale et détruit les autonomies locales, tandis que les libertés locales ont toujours été mieux préservées là où c’est au contraire le peuple ou la nation qui ont créé l’État.
Le contre-modèle de l’Empire, auquel Evola a consacré quelques-unes de ses meilleures pages, est tout aussi parlant. L’empire romain-germanique a incontestablement mieux respecté l’organicité de la société que l’État-nation. Mais il l’a mieux respectée dans la mesure où son pouvoir était, non pas absolu et inconditionné, mais au contraire relativement faible, où la souveraineté y était partagée ou répartie, et où le pouvoir se souciait moins d’imposer sa « forme » aux différentes collectivités locales que de respecter le plus possible leur autonomie. Le principe même de toute construction impériale est en effet le principe de subsidiarité ou de compétence suffisante. On ne saurait oublier que ce principe implique de laisser à la base le maximum de pouvoir possible et de ne faire remonter vers le « haut » que la part d’autorité et de décision qui ne peut s’y exercer. Or, pour Evola, tout doit au contraire venir du « haut », précisément parce que ce « haut » est étranger à tout naturalisme. La question est alors de savoir comment l’antinaturalisme rigoureux d’Evola peut se concilier avec son organicisme.
Élite et ordre européen
Ce n’est évidemment pas une élite au sens que les libéraux donnent à ce mot, ni au sens que lui donne l’école « élitiste » de politologie, représentée not. par Roberto Michels ou Pareto. C’est tout d’abord une élite au sens éthique du terme. Pour Evola, appartient à l’élite, non le « meilleur » au sens darwinien ou le plus performant au sens de Pareto, mais celui chez qui l’ethos domine sur le pathos, celui qui a « le sens d’une supériorité vis-à-vis de tout ce qui n’est que simple appétit de “vivre” », celui qui a fait siens « le principe d’être soi-même, un style activement impersonnel, l’amour de la discipline, une disposition héroïque fondamentale ». L’élite est donc d’abord chez lui une aristocratie. Elle incarne une « race de l’esprit », un type humain particulier qu’Evola définit comme « homme différencié », et dont il pose l’avènement (ou la renaissance) comme un préalable indispensable à toute action dans le monde.
C’est d’autre part une élite qui s’oppose fondamentalement, non seulement à la masse, mais aussi au peuple, à la façon dont le « haut » s’oppose au « bas ». Il faut ici rappeler que, chez Evola, contrairement à la notion d’« État », toujours positive, les notions de « peuple » ou de « nation » ont presque toujours une valeur négative. L’État représente l’élément « supérieur », tandis que le peuple et la nation ne sont que des éléments « inférieurs ». Qu’il soit demos ou ethnos, plebs ou populus, le peuple n’est aux yeux d’Evola que « simple matière » à mettre en forme par l’élite. Il en va de même de la nation et de la société. Des termes comme « peuple », « nation », « société », apparaissent même dans ses écrits comme pratiquement interchangeables : tous correspondent à la dimension purement physique, « naturaliste », indifférenciée, fondamentalement passive, de la collectivité, à la dimension de la « masse matérialisée » qui, par opposition à la forme que seule peut conférer l’État, reste de l’ordre de la matière brute. Evola se situe de ce point de vue à l’exact opposé des théoriciens du Volksgeist [esprit du peuple] comme Herder : le peuple ne saurait représenter pour lui une valeur en soi, il ne saurait être le dépositaire privilégié de l’« esprit » créateur d’une collectivité donnée. Evola est tout aussi indifférent à la question du lien social, voire au social lui-même, qu’il englobe volontiers dans l’« économico-social », autre désignation chez lui du monde de l’horizontal ou du règne de la quantité. « Tout ce qui est social, écrit-il, se limite, dans la meilleure des hypothèses, à l’ordre des moyens ». C’est pourquoi l’on ne trouve pas chez lui de pensée sociologique, ni d’ailleurs de véritable pensée économique.
Enfin, c’est une élite masculine et virile. Ce point est à mon sens extrêmement important, si important même qu’il me semble y avoir de bonnes raisons de penser que l’ouvrage-clé de toute la pensée évolienne n’est pas Rivolta contro il mondo moderno [1934], comme on le croit généralement, mais bien sa Metafisica del sesso [1958]. Evola est obsédé par la double polarité masculin-féminin, qu’il assimile analogiquement à la polarité du haut et du bas. L’État, chez lui, est au peuple ce que l’homme est à la femme : l’incarnation d’un principe actif supérieur qui, comme tel, s’oppose au principe féminin, principe passif assimilé à tout ce qui est de l’ordre de la matière, de la nature, du social, etc. L’opposition de l’esprit et de l’âme, tout comme l’opposition entre la tradition « hyperboréenne », porteuse d’un ethos viril et lumineux, et les cultures du Sud, correspondant au « monde lunaire et chtonien » de la Mère ou de la Femme, se déduit du même schéma. Cette représentation d’une « lutte incessante » entre le masculin et le féminin, lutte que l’on pourrait transposer sur tous les plans, n’est certes pas sans intérêt (d’autant qu’Evola est l’un des rares auteurs de droite, avec Raymond Abellio, à avoir théorisé ce problème), mais elle n’en est pas moins éminemment contestable à mes yeux, pour toute une série de raisons que je n’exposerai pas ici. Le fait est, en tout cas, qu’elle joue un rôle de premier plan dans la pensée d’Evola, et qu’elle inspire directement sa conception de l’élite. Pour Evola, les hommes ne peuvent appartenir à l’élite qu’en se séparant des femmes, ou du moins de ce qu’il appelle l’« ordre féminin ». D’où chez lui l’idéal d’une « société d’hommes », qui trouve son aboutissement symbolique dans la notion d’« Ordre ». Sans doute faudrait-il – horresco referens ! – une psychanalyse pour expliquer ce systématisme.
L'Europe comme destin
Evola avait très bien compris que la désunion des nations européennes était l’une des causes principales de leur impuissance à constituer dans le monde un pôle de puissance autonome et un creuset de civilisation. « La mesure de la liberté concrète, de l’indépendance et de l’autonomie est, avant tout, la puissance », écrit-il. Par opposition au modèle de la « nation européenne », il en tient par ailleurs pour le modèle de l’Empire, seul capable à ses yeux de concilier l’unité et la multiplicité.
La structure de cet Empire, ajoute-t-il, pourrait être « celle d’un fédéralisme, mais organique et non acéphale, un peu comme celui que réalisa Bismarck dans le deuxième Reich », étant entendu que « ce qui devrait être exclu, c’est le nationalisme (avec son prolongement tératologique, l’impérialisme) et le chauvinisme, c’est-à-dire l’absolutisation fanatique d’une communauté particulière ». En même temps, J. Evola est bien conscient de l’impossibilité, dans le monde actuel, de donner à cette Europe unie un fondement spirituel correspondant à ses vœux. Son appel à la formation d’un groupe « constitué par des descendants de vieilles familles européennes qui tiennent encore debout » laisse à ce propos pour le moins rêveur.
En fait, Evola conçoit principalement l’Europe à la lumière de l’« idée impériale » héritée du Moyen Âge, et plus spécialement du Saint-Empire romain-germanique dans sa version gibeline. Cette référence me paraît plutôt bien venue, et je partage pour ma part tout à fait la critique du nationalisme que fait Evola, critique qui me paraît l’un des points les plus forts de sa pensée. Il me semble néanmoins que la pensée évolienne achoppe ici encore sur un certain nombre d’apories ou de contradictions.
Evola, je l’ai déjà dit, se prononce à la fois pour la monarchie et pour l’Empire, comme si les fonctions royales et impériales étaient plus ou moins interchangeables, ce qui est assez curieux, puisque dans l’histoire c’est au nom des monarchies nationales que le principe impérial a le plus été contesté. Il en tient d’autre part pour un modèle étatique dont l’expérience historique nous montre qu’il a été beaucoup plus fortement incarné dans les nations que dans les empires : ce qui caractérise l’Empire, c’est que l’autorité de l’État y est toujours partagée.
Evola semble en outre oublier que l’État a été le principal acteur politique de la modernité qu’il dénonce, et que l’État moderne s’est construit, en même temps d’ailleurs que le marché, sur les ruines de l’ordre féodal qu’il admire. Tout en reconnaissant implicitement que le fédéralisme est aujourd’hui le système qui peut le plus légitimement se réclamer du modèle impérial, il n’en affirme pas moins que l’ordre politique ne peut se construire qu’à partir du « haut », alors que le fédéralisme intégral implique au contraire que cet ordre politique s’établisse à partir du « bas », c’est-à-dire à partir de la base. Raisonnant au niveau des principes abstraits, Evola ne paraît pas conscient de ces contradictions. Métaphysique et politique, décidément, ne font pas bon ménage !
► Alain de Benoist, extraits de l'entretien avec M. Iacona, 2007.
• Note en sus sur l'apoliteia :
* : « Dans la situation politique actuelle, dans un climat de démocratie et de “socialisme”, les conditions obligatoires du jeu sont telles que l'homme en question ne peut absolument pas y prendre part s'il admet ce que nous avons dit, à savoir qu'il n'y a aujourd'hui aucune idée, aucune cause ni aucun but qui mérite que l'on engage son être véritable, aucune exigence à laquelle on puisse reconnaître le moindre droit moral et le moindre fondement en dehors de ce qui, sur le plan purement empirique et profane, découle d'un simple état de fait. Mais l'apoliteia, le détachement, n'entraîne pas nécessairement des conséquences particulières dans le domaine de l'activité pure et simple. Nous avons parlé de l'ascèse consistant à s'appliquer à la réalisation d'une tâche déterminée, par amour de l'action en elle-même et dans un esprit de perfection impersonnelle. En principe, il n'y a pas de raison d'exclure ici le domaine politique et de ne pas l'envisager comme un cas particulier parmi beaucoup d'autres, puisque le genre d'action dont nous venons de parler ne requiert aucune valeur objective d'ordre supérieur, ni aucune impulsion provenant des couches émotives et irrationnelles, de l'être. Mais si l'on peut éventuellement se consacrer de la sorte à une activité politique, il est clair que puisque seuls importent l'action en soi et le caractère entièrement impersonnel de cette action, cette activité politique ne peut offrir, pour qui voudrait s'y livrer, une valeur ni une dignité plus grandes que si l'on se consacrait, dans le même esprit, à des activités tout à fait différentes, à quelque absurde œuvre de colonisation, à des spéculations boursières, à la science, et l'on pourrait même dire – pour rendre l'idée crûment évidente – à la contrebande d'armes ou à la traite des blanches.
Telle qu'elle est conçue ici, l'apoliteia n'impose aucun préalable spécial sur le plan extérieur, n'a pas nécessairement pour corollaire un abstentionnisme pratique. L'homme vraiment détaché n'est ni l'outsider professionnel et polémiste, ni “l'objecteur de conscience”, ni l'anarchiste. Après avoir fait en sorte que la vie, avec ses interactions, n'engage pas son être, il pourra éventuellement faire preuve des qualités du soldat qui, pour agir et accomplir une tâche, n'exige auparavant aucune justification transcendante ni aucune assurance quasi théologique quant à la justice de la cause. Nous pourrions parler dans ce cas d'un engagement volontaire concernant la “personne” et non l'être, engagement en vertu duquel on reste isolé même en s'associant. Nous avons déjà dit que le dépassement positif du nihilisme consiste précisément en ce que le manque de signification ne paralyse pas l'action de la “personne”. Il devient seulement existentiellement impossible d'agir sous l'emprise et l'impulsion d'un quelconque mythe politique ou social actuel, parce que l'on a considéré comme sérieux, significatif ou important ce que représente toute la vie politique actuelle. L'apoliteia, c'est l'irrévocable distance intérieure à l'égard de la société moderne et de ses “valeurs”, c'est le refus de s'unir à celle-ci par le moindre lien spirituel ou moral. Ceci étant bien établi, les activités qui, chez d'autres, présupposent au contraire l'existence de ces liens, pourront être exercées dans un esprit différent. Il reste en outre la sphère des activités que l'on peut faire servir à une fin supérieure et invisible, comme nous l'avons indiqué par ex. à propos des 2 aspects de l'impersonnalité et de ce que l'on peut retenir de certaines formes de l'existence moderne.
Un point particulier mérite d'être précisé : cette attitude de détachement doit être maintenue même à l'égard de la confrontation des 2 blocs qui se disputent aujourd'hui l'empire du monde, “1'Occident” démocratique et capitaliste et “l'Orient” communiste. Sur le plan spirituel, en effet, cette lutte est dépourvue de toute signification. “L'Occident” ne représente aucune idée supérieure. Sa civilisation même, basée sur une négation essentielle des valeurs traditionnelles, comporte les mêmes destructions, le même fond nihiliste qui apparaît avec évidence dans l'univers marxiste et communiste, bien que sous des formes et à des degrés différents. » (Chevaucher le tigre, IV, 25)
◘ Actualité de l'idée d'Empire européen
À partir du XIIe siècle, l'Europe a été le tableau d'une lutte de pouvoir entre le Pape et l'Empereur, entre l'Eglise et l'Empire. Les partisans de l'Empire s'appelaient les gibelins et ceux du Pape étaient les guelfes. Par analogie, l'Europe connaît depuis 1945 une lutte entre les partisans de 2 concepts très différents de l'Europe : aux guelfes se sont substitués les libéraux, les défenseurs d'une Europe “marché commun”, avec des structures faibles et une procédure décisionnelle purement inter-gouvernementale. Leur font face, tout comme par le passé, les gibelins, mutatis mutandis les partisans d'une union politique qu'ils estiment d'un ordre supérieur, bien au dessus du “marché” proprement dit. Cette union suppose des structures européennes fortes, ce qui n'est assurément pas synonyme d'administrations d'envergure, et un ancrage solide dans le patrimoine culturel européen avec toutes ses variantes et sa formidable diversité : « Den Europa kan politisch nur erstehen und bestehen wenn as seine Vietfalt in der Einheit lebt » (Hugo Bütler). C'est l'idée de l'Empire européen dans sa forme la plus pure. Même un homme d'affaires international tel que André Leysen va dans le même sens lorsqu'il affirme estimer que « l'Europe de l'Oural à l'Océan Atlantique jouera un rôle central dans l'ordre mondial à venir. Qu'elle n'occupera pas seulement une position importante sur le plan économique mais que, grâce à elle, la diversité dans l'unité restera le réservoir à penser du monde ».
La conception traditionnelle de l'Empire allait naturellement encore plus loin que le “réservoir à penser” ou le pouvoir politique : « De façon générale, les Gibelins affirmaient le caractère sacral de l'autorité temporelle, en continuité avec l'héritage de la Rome Antique et de la tradition européenne la plus pure », remarque A. de Benoist (Krisis n°3, 1989) qui s'inscrit ici dans la lignée de Julius Evola.
Le concept de l'Empire est, par essence, le prolongement de la tradition impériale romaine adaptée par Charlemagne à l'entité plus grande et plus germanique sur laquelle il règnait, et transposé dans un mode d'administration dynamique qui a élevé au rang de principe l'adaptation continue aux évolutions du monde. La tâche de notre génération consiste en une nouvelle transformation de l'impérialité européenne pour en faire un concept exploitable pour une nouvelle Europe. Le développement d'un pareil sujet est impossible en un seul exposé. C'est pourquoi nous nous contenterons de ces quelques principes fondamentaux.
► Luc Pauwels, extrait de l'article L'Europe impérieuse, 1993.
◘ Le gibelinisme : signification et héritage
 Dans un de ses principaux livres, Julius Evola définit le gibelinisme comme l’affirmation doctrinale de la supériorité du pouvoir temporel sur l’autorité spirituelle. Il flétrit la « tentative théocratique guelfe » de renversement de ce qu’il prend pour l’état normal. Il attribue la querelle du Sacerdoce et de l’Empire au machiavélisme de l’Église incapable de supporter la présence d’une autorité supérieure à la sienne. Son analyse est très voisine de celle d’un Robert Dun dans Le Message du Verseau [1977] : après s’être érigé initialement en “contre-société”, le christianisme a ensuite appelé à la rescousse la puissance temporelle de l’Empire romain, tout en refusant néanmoins que celui-ci soit trop considérable.
Dans un de ses principaux livres, Julius Evola définit le gibelinisme comme l’affirmation doctrinale de la supériorité du pouvoir temporel sur l’autorité spirituelle. Il flétrit la « tentative théocratique guelfe » de renversement de ce qu’il prend pour l’état normal. Il attribue la querelle du Sacerdoce et de l’Empire au machiavélisme de l’Église incapable de supporter la présence d’une autorité supérieure à la sienne. Son analyse est très voisine de celle d’un Robert Dun dans Le Message du Verseau [1977] : après s’être érigé initialement en “contre-société”, le christianisme a ensuite appelé à la rescousse la puissance temporelle de l’Empire romain, tout en refusant néanmoins que celui-ci soit trop considérable.
J. Evola estime également que, pour expliquer le conflit médiéval des guelfes et des gibelins, il faut remonter jusqu’aux débuts du christianisme et à ses rapports avec la romanité antique.
« La décadence intérieure et finalement l’écroulement politique de la romanité antique marquèrent l’arrêt de la tentative de former l’Occident selon le modèle impérial. La pénétration du christianisme, en raison du type particulier de dualisme qu’il affirme et en raison de son caractère de tradition simplement religieuse, fit rapidement progresser le processus de dissociation, jusqu’au moment où, après l’irruption des races nordiques, la civilisation médiévale prit forme et où ressurgit le symbole de l’Empire. Le Saint Empire Romain fut restauratio et continuatio, (…) son sens final fut celui d’une reprise du mouvement romain vers une synthèse solaire œcuménique, reprise qui impliquait logiquement le dépassement du christianisme et devait entrer en conflit avec cette hégémonie que l’Église de Rome revendiquait sans cesse davantage. L’Église de Rome ne pouvait en effet admettre que l’Empire correspondît à un principe supérieur à celui qu’elle représentait elle-même : tout au plus essaya-t-elle, en contradiction manifeste avec ses prémisses évangéliques, d’en usurper et d’en absorber le droit, et c’est ainsi que prit naissance la tentative théocratique guelfe ».
Dans les pages qui suivent, J. Evola énumère des cas concrets où se manifesta, sous une forme répressive, cette « tentative théocratique » : accusation d’hérésie portée par le pape Grégoire IX contre l’ordre de Saint Jean (1238), condamnation de l’ordre des chevaliers teutoniques par l’archevêque de Riga (1307), etc.
« Mais ce furent les Templiers qui constituèrent le principal objectif de l’attaque. La destruction de cet Ordre coïncide avec l’interruption de la tension métaphysique du Moyen Âge gibelin ? C’est le point de départ de la rupture, du « déclin de l’Occident ».
Plus tard, J. Evola admettra que si le gibelinisme est en quelque sorte un phénomène supertraditionnel, sa « métaphysique non dualiste de l’imperium » n’en est pas moins présente dans le christianisme lui-même, ainsi qu’en témoigne la célèbre formule de Saint Paul : « non est potestas a Deo », et, de manière plus péremptoire encore, ce passage de l’Épître aux Romains : « qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit ». Il y a là une conception qui reconnaît, à tout le moins, l’existence d’une « influence spirituelle » s’exerçant sur les détenteurs du pouvoir temporel. Cette influence spirituelle n’est rien d’autre que ce que les traditions musulmanes et extrême-orientales désignent respectivement par la barakah et le « mandat du Ciel ». Le rite de l’imposition des mains par lequel se transmet la barakah correspond exactement au sacre des rois et des empereurs tel que l’a connu l’Occident traditionnel chrétien. Mais la barakah, tout comme le mandat du Ciel peut se perdre. L’influence spirituelle ne demeure que si le détenteur du pouvoir temporel reste digne de sa fonction. Dans son investiture comme dans son exercice, le pouvoir temporel est soumis à l’autorité spirituelle. Le sacerdoce a la primauté sur la royauté et J. Evola aurait, contrairement à R. Guénon, inverti l’ordre normal des 2 pouvoirs. Telles sont les données du problème. R. Guénon et J. Evola représentent-ils respectivement le guelfisme et le gibelinisme, ou 2 approches du phénomène gibelin dont l’une — en l’occurrence celle de J. Evola — secrète, par sa déviation même, la « tentative théocratique » guelfe ?
(…) En tant qu’il prône la synthèse des 2 pouvoirs, leur distinction impliquant néanmoins leur commune origine surnaturelle, le gibelinisme est le reflet politique du dualisme distinctif propre à l’orthodoxie traditionnelle. Quant au guelfisme, il est le reflet politique du dualisme séparatif qui n’est pas, à proprement parler, hétérodoxe par rapport à la Tradition, mais qui résulte des conditions cycliques particulières dans lesquelles le christianisme a dû remplir sa mission exotérico-sociale.
De même, il existe entre le gibelinisme et le guelfisme [un] rapport de complémentarité et non d’opposition (…) Le gibelinisme est l’héritage politique de la Tradition, par la survivance de celle-ci dans le christianisme, et plus particulièrement dans la doctrine paulinienne du pouvoir. Le guelfisme est le legs politique du christianisme institutionnalisé sous la forme ecclésiale et appelé avant tout à combattre dans le monde d’ici-bas les tentatives usurpatrices de la puissance temporelle.
L’opposition dialectique du gibelinisme et du guelfisme ne peut s’expliquer que par un autre antagonisme opposant cette fois, à l’intérieur même de la synthèse primordiale et traditionnelle des 2 pouvoirs, l’autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Outre la distinction de 2 éléments ayant cependant la même origine, toute synthèse postule la primauté d’un des 2 éléments constitutifs qui est en quelque sorte, pour reprendre l’expression aristotélicienne, le « moteur immobile » de l’autre. Il est évident que la synthèse de l’autorité spirituelle et du pouvoir temporel n’est que le reflet, sur le plan spécifiquement politique, de la synthèse plus générale des idéaux de connaissance et d’action, ou, si l’on veut, de l’indissociabilité traditionnelle des voies gnostique et héroïque d’accès à la transcendance. Or, la connaissance est bel et bien le moteur immobile de l’action. La modalité héroïque de la découverte du supra-monde ne peut s’exercer qu’à travers la modalité gnostique, en quelque sorte au second degré, sans quoi elle se confond avec la simple “volonté de puissance” matérielle. Donc, à l’intérieur de la synthèse traditionnelle des 2 pouvoirs, l’autorité spirituelle a, dans la perspective idéale, la primauté sur le pouvoir temporel. Si, conformément à la doctrine gibeline contenue en germe chez Saint Paul, le pouvoir temporel « vient de Dieu », au même titre que l’autorité spirituelle, il ne peut s’agir que d’une origine surnaturelle au second degré. Seule l’autorité spirituelle est dépositaire du « mandat du Ciel » au premier degré, d’une façon directe et immédiate qui légitime son rôle de moteur immobile du pouvoir temporel.
Il découle de tout ceci que seul le gibelinisme guénonien est orthodoxe. La conception évolienne du gibelinisme est déjà le produit d’une inversion de la norme traditionnelle. La pensée de J. Evola est toujours une pensée gibeline dans la mesure où elle affirme la source surnaturelle commune aux 2 pouvoirs et leur nécessaire synthèse. Mais c’est une pensée gibeline inorthodoxe dans la mesure où elle inverse, à l’intérieur même de la synthèse traditionnelle, la hiérarchie normale de ses éléments constitutifs (…) C’est l’inorthodoxie même du gibelinisme, tel que le conçoit J. Evola, qui alimente le dualisme séparatif guelfe. Car, une fois inversée la hiérarchie normale des 2 pouvoirs, la puissance temporelle ne tarde pas à s’émanciper de l’autorité spirituelle. Il devient alors, non seulement légitime de souligner l’origine différente des 2 pouvoirs, mais aussi nécessaire d’insister sur la primauté de l’autorité spirituelle, afin de raviver chez les puissants de ce monde le sentiment de la transcendance et de favoriser le retour à la norme.
Pour situer les choses sur le plan historique et rattacher les considérations doctrinales ci-dessus aux grands personnages qui marquèrent de leur empreinte l’histoire médiévale, disons que le gibelinisme orthodoxe est incarné, sur un plan impérial, par un Charlemagne, ou, sur le plan de la royauté française, par un Saint-Louis, alors qu’un Frédéric II de Hohenstaufen, précisément encensé de façon tout à fait significative par J. Evola, incarne déjà le gibelinisme inversé (…).
Pendant la majeure partie de son histoire, le Moyen Âge occidentalo-chrétien se caractérisa par une tension métaphysique vers un gibelinisme bien compris. Dans la phase suivante vit le jour une tension dialectique entre le gibelinisme inversé et la réaction guelfe soucieuse de rétablir l’équilibre hiérarchique des 2 pouvoirs. Enfin le monde moderne, antitraditionnel, offrit une tension dialectique, cette fois désintégratrice, entre un pouvoir temporel toujours plus prévaricateur et un guelfisme dégénérant ipso facto en théocratie (…).
Telle est la signification profonde du gibelinisme : la synthèse de l’autorité spirituelle et du pouvoir temporel, leur commune origine surnaturelle, une métaphysique de l’imperium à base de dualisme distinctif, l’équilibre hiérarchique des 2 pouvoirs par la primauté du spirituel. Tel est son double héritage dans le cadre du traditionalisme intégral : d’un côté le gibelinisme orthodoxe de R. Guénon, de l’autre le gibelinisme inversé de J. Evola où la primauté hétérodoxe du temporel, instaurant ipso facto le jeu de l’alternance dialectique, secrète le dualisme séparatif et la « tentative théocratique » guelfes.
► Daniel Cologne, Julius Evola, René Guénon et le christianisme, ch. III, 1978.

♦ Addenda :
L'entretien qui suit est un témoignage autant d'une époque, d'une génération que d'une certaine réception d'Evola. Alors que ce dernier n'eut pendant l'entre-deux-guerres qu'une audience marginale, il exerça une influence, non dénuée d'équivoques au demeurant, sur une partie de la jeunesse italienne, en manque d'orientations, de la droite radicale des années 50 au début des années 70. À cet égard on peut considérer le cas de Giogio Freda comme emblématique d'une certaine lecture “traditionnelle” marquée surtout par un romantisme pessimiste et aspirant à un activisme débridé comparable au gauchisme révolutionnaire (d'où le surnom oxymorique d'évolien de gauche parfois donné à Freda) ou au mysticisme désespéré des nihilistes russes : il n'y a pas de solution à l'intérieur du système, la seule solution qui reste est sa destruction. En vérité est abandonné le terrain du politique au profit d'un esthétisme littéraire perdue dans ses nuées olympiennes ou d'un aventurisme sans suite. On retrouve le même complexe de sujet (du pouvoir) en mal de reconnaissance que celui ayant touché une noblesse libertine au XVIIe siècle qui considérait le pouvoir comme un mal nécessaire pour croire s'en distancier. Il ne suffit pas en effet de critiquer les mythes bourgeois XIXe siècle du progressisme ou du modernisme pour échapper à toute aliénation idéologique. Car au fond cette dernière met en question, comme l'a rappelé justement Julien Freund, le pouvoir de décision dans nos sociétés. Si l'imperium romain a su montrer une historicité, c'est bien parce qu'il a fait du droit un principe d'organisation sociale (et économique) incarné dans ses institutions et pratiques. Et s'il garde une actualité, c'est bien pour bâtir un Grand Espace européenn comme l'a souligné le juriste Schmitt. Si, pour nous autres Européens, Evola reste une étoile solitaire dans une époque trouble, c'est non tant en ce qu'il évoquerait à notre époque de post-militantisme une chevalerie virtuelle pareille à celle des war-games sur console ou qu'il offrirait une consolation métaphysique aux individualistes cherchant un supplément d'âme voire un adjuvant aux byzantinismes de civilisation fatiguée, mais bien parce qu'il invite à une éthique de résistance pour servir au devenir européen. La royauté intérieure, celle qui lutte, ne peut que se plonger ou prolonger dans le fait d'assumer enfin le moment machiavélien...
◘ Les non-conformistes des années 70
Entretien avec Daniel Cologne
Philippe Baillet
• Q. : Daniel Cologne, vous avez collaboré au Cahier de l'Herne sur René Guénon (en 1986). On a vu votre signature, il y a plus de 20 ans, dans la revue de Georges Gondinet, Totalité ; on l'a retrouvée ensuite dans Vers la Tradition de Roland Goffin. Mais jamais vous n'avez révélé les origines de vos démarches, les débuts de votre trajectoire intellectuelle. Pouvez-vous nous en parler aujourd'hui ?
DC : Je suis né en 1946 et j'ai fait mes études à l'Université Libre de Bruxelles, à la faculté de philosophie & lettres, section “philologie romane”. Je suis sorti en 1969. En 1970, je pars en Suisse, où des places d'enseignants sont vacantes. Je garde toutefois mes attaches et mes contacts en Belgique, où je reviens toujours pour les vacances. En 1972, j'ai collaboré ainsi au journal belge La Relève, organe des jeunes sociaux-chrétiens. Mon premier article s'intitulait « La critique littéraire à l'Université de Genève », où j'ai évoqué la figure du Professeur Jean Starobinsky, spécialiste de Rousseau. Mon deuxième article était consacré à David Scheinert. À Genève, un théâtre venait de jouer une de ses pièces, L'homme qui allait à Götterwald. J'en ai fait un compte-rendu. Et puis j'ai rencontré David Scheinert, qui habitait Bruxelles, à un jet de pierre de la Basilique de Koekelberg.
Je me suis toujours intéressé au théâtre puisque j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études sur 3 dramaturges français : Jean Anouilh, Jean Giraudoux et Gabriel Marcel. À propos de cet engouement pour le théâtre, je voudrais vous raconter une petite anecdote : ma mère est au fond une actrice ratée ; son désir de jeune fille était de monter sur les planches, mais son milieu social, très puritain, l'en a empêchée. Est-ce une explication de mon engouement personnel, qui se serait transmis de mère à fils ? Je me suis ensuite intéressé à l'œuvre théâtrale de Félicien Marceau et de Michel de Ghelderode, auxquels j'ai consacré des articles dans Les Écrits de Paris et dans Défense de l'Occident.
L'homme qui allait à Götterwald
Mais revenons à la pièce de Scheinert jouée à Genève. Elle tournait autour de la thématique de l'échec, thématique que j'avais déjà abordée dans mon étude sur Anouilh, Giraudoux et Marcel. Il s'agissait plus exactement de l'échec du couple, préfiguration d'un échec de la vie. Dans L'homme qui allait à Götterwald, Scheinert met en scène l'histoire de Jérôme, personnage qui a effectivement tout raté dans sa vie. Le musicien Marcel Mortier avait justement composé pour David Scheinert une complainte, La complainte du pauvre Jérôme, dont je me rappelle les paroles : « Plaignez, plaignez le pauvre Jérôme, il n'a jamais été heureux, pas un succès, pas un diplôme, rien que la mort devant les yeux ». L'ambiance du théâtre de Scheinert est un sombre pessimisme, même si par ailleurs le dramaturge mettait sa plume au service de la gauche et de son euphorie progressiste.
• Q. : La personnalité de David Scheinert semble vous avoir profondément marqué...
DC : En un certain sens, oui. Cette personnalité est en tout cas fort intéressante. Il est né en 1916 et est décédé en 1996. David Scheinert était originaire de Pologne, issu d'une famille juive de Tschenstochau/Czestochowa. Il arrive en Belgique à l'âge de 8 ans. Homme de gauche engagé, il est devenu plus tard critique littéraire du journal communiste Le Drapeau rouge, sous le pseudonyme de “Vingtras”. Il m'a fasciné pour 2 raisons : premièrement, il défendait la qualité de la littérature belge d'expression française et s'engageait ainsi contre le parisianisme littéraire ; deuxièmement, d'une manière très objective, il reconnaissait le talent littéraire de certains écrivains collaborationnistes, surtout 3 d'entre eux : Pierre Hubermont, René Verboom et Constant Malva.
R. Verboom était un ami de Michel de Ghelderode. Félicien Marceau en parle dans ses mémoires, Les années courtes. Verboom était un personnage haut en couleurs, une grande gueule de Bruxellois. Il est actuellement réhabilité et figure enfin dans l'anthologie de la littérature belge francophone de Michel Joiret. C. Malva est également réhabilité, comme pionnier de la littérature prolétarienne. Hubermont est réédité dans la collection “Espace Nord”, notamment son roman prolétarien Treize hommes dans la mine. Ainsi, le pronostic formulé par Scheinert, concernant la réhabilitation de ces auteurs, s'est avéré exact. Il était audacieux pour l'époque. Nous étions en 1974.
• Q. : Mais en dépit de tout cela, vous restiez beaucoup plus attiré par les écrivains de droite que par les écrivains de gauche, fussent-ils des écrivains prolétariens passés à la collaboration. En fait, quel déclic, ou quel hasard, a fait de vous un traditionaliste ?
DC : J'ai d'abord découvert Julius Evola à travers Les Hommes au milieu des ruines, ouvrage paru aux Sept Couleurs, une petite structure éditoriale dirigée par Maurice Bardèche. C'est une recension de ce livre, parue dans Rivarol, qui a attiré mon attention, provoqué le déclic. J'étais un lecteur de Rivarol, par attirance pour les idées de droite, une attirance qui s'était renforcée au cours des années 73 et 74, à cause du terrorisme intellectuel qui sévissait dans l'enseignement. À Genève, ville de tradition calviniste et puritaine, bon nombre d'enseignants viraient au gauchisme ultra-permissif : comme en Hollande à la même époque, le balancier passait de l'autre côté, sans juste mesure. On passait du rigorisme moral le plus strict à la promiscuité la plus débridée. Par réaction, mes tendances se confirmaient. Pendant mes études universitaires, comme je viens de vous le dire, j'avais choisi de travailler sur 3 dramaturges qui étaient loin d'être des “progressistes”. Chez Anouilh, je suis tombé sur une idée importante, qui anticipait un peu sur la notion de “race de l'esprit” que j'allais découvrir plus tard chez Evola.
Les pièces noires d'Anouihl
Dans l'œuvre théâtrale d'Anouilh, nous rencontrons des couples, des jeunes gens et des jeunes filles donc, qui n'arrivent pas à l'harmonisation à cause de leurs différences sociales. Cet état de choses peut déboucher sur des situations comiques comme dans Le rendez-vous de Senlis, où le jeune homme pauvre invite sa riche fiancée dans une villa luxueuse qu'il a louée, pour faire croire que c'est la sienne, et engage des acteurs pour jouer le rôle de ses parents. Mais il y a aussi, dans les “pièces noires” d'Anouilh, le tragique de cet échec du couple. Le jeune homme pauvre se dépeint « comme un homme auquel les femmes ne sourient pas, qui ne sait pas parler aux maîtres d'hôtel et pour qui chaque geste naturel est une étude ». Cette réplique reflète une situation socio-économique en termes psychologiques. Ou encore : « Nous sommes pauvres, c'est pour nous qu'on a écrit les livres de morale ». Un communiste aussi aurait pu écrire cela (par ex. Aragon dans Les beaux quartiers). Anouilh apparaît parfois comme un “révolté sans bannière”, mais une pièce comme Les poissons rouges, par ex., le situe en fin de compte parmi les anarchistes de droite. Ironie, distance, détachement : tels sont les traits d'Antoine de Saint-Flour, un hobereau qui prend tout à la légère, alors que son ami, l'homme du peuple, râle constamment et revendique de manière stérile. La pièce a été magistralement interprétée par Marielle et Galabru. La sympathie d'Anouilh va manifestement au personnage incarné par Marielle.
• Q. : Et Giraudoux, que vous a-t-il apporté dans le cadre de votre travail ?
DC : Giraudoux est tout d'abord un magicien du verbe, un maître apollinien de la belle apparence. Ensuite, au-delà de toute considération philologique, Giraudoux fut aussi un artisan du rapprochement franco-allemand. Personnellement, j'ai été élevé dans la défiance de l'Allemagne, à 2 doigts de la haine que l'on a cultivée à l'Ouest contre ce pays. Fait prisonnier lors de la campagne des 18 jours de mai 1940, mon père avait été en captivité Outre-Rhin, et n'avait pas gardé un bon souvenir de cette période noire. Ses sympathies allaient au Général De Gaulle plutôt qu'aux puissances anglo-saxonnes et, quand j'ai eu seize ans, en 1962, j'ai entendu le discours du Général, le 9 septembre, appelant à la réconciliation franco-allemande avec Adenauer. Le vainqueur idéalisé faisait le premier pas de l'amitié européenne retrouvée. En fait, De Gaulle réalisait au niveau politique ce que Giraudoux avait réclamé en filigrane dans ses créations littéraires.
Ondine & Hans
Dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, Giraudoux met également en scène un personnage professant l'égalité et la démocratie, Demokos, qu'il place sous un jour peu sympathique. Il tient des propos démagogiques, il fait figure d'illuminé, de chef de secte. Giraudoux, c'était clair, se défiait, de ce genre de discours. Dans Ondine, que j'ai mieux étudiée puisqu'il s'agit de l'histoire d'un couple, thème de mon mémoire de fin d'études, il exprime ses idées personnelles sur la nécessaire réconciliation franco-allemande. Ondine est la nymphe, la divinité aquatique, symbolisant la légèreté française. Hans, son amour, est un chevalier sérieux, fidèle, qui représente l'esprit germanique tout en étant quelques fois balourd. Dans cette présentation des caractères de ses personnages, Giraudoux reste français, colle aux clichés que les Français s'attribuent et attribuent aux Allemands. Sa germanophilie est donc une germanophilie française : il exprime sa sympathie pour la germanité, sans abandonner son image très idéalisée de la France.
• Q. : Et le dernier des dramaturges que vous avez étudiés, Gabriel Marcel, que vous a-t-il apporté ?
DC : Gabriel Marcel m'a surtout fait prendre conscience de l'opposition entre Être et Avoir, avant-goût — j'y reviendrai — de l'opposition guénonienne entre qualité et quantité. Dans ses pièces où l'échec d'un couple est mis en scène, Gabriel Marcel nous livre un message constant : ne pas objectiver le partenaire, ne pas transformer le partenaire en objet, comme s'il était quelque chose que l'on possède. L'idée de la femme-objet lui était insupportable. En ce sens, G. Marcel n'était nullement le réactionnaire que l'on a parfois dépeint. Il était en quelque sorte un féministe avant la lettre. En 1977, j'ai publié dans Écrits de Paris, un article sur cette problématique du théâtre marcellien : “Gabriel Marcel, aspects d'un anti-conformiste méconnu”.
J'ai voulu montrer que Gabriel Marcel était loin d'être ce réactionnaire figé dans son passéisme et dans un catholicisme conformiste. C'est évidemment la dernière image que l'on a de lui. Cet homme, d'origine juive, passé au protestantisme puis à l'intégrisme catholique de Saint-Nicolas du Chardonnet, a toujours été un anti-conformiste. En 1919, dans Un homme de Dieu, il nous narre l'histoire d'un pasteur protestant, marié et dont le couple va à l'échec. Gabriel Marcel critique justement l'objectivation de la femme, dont ce pasteur se rend coupable. La trajectoire de Gabriel Marcel nous enseigne que les clivages ne sont jamais nets, les étiquettes sont collées sur le dos des écrivains de manière totalement arbitraire. Je pense, depuis ma pratique de Gabriel Marcel, qu'il faut toujours aller aux textes pour voir ce que sont réellement les écrivains.
Simone de Beauvoir me fait découvrir Guénon
• Q. : Vous nous dites que la distinction de Gabriel Marcel entre Être et Avoir vous a donné un avant-goût de la distinction opérée par Guénon entre qualité et quantité. Mais comment avez-vous découvert Guénon ?
DC : Je vais sans doute vous étonner, mais j'ai découvert Guénon par un livre de Simone de Beauvoir, Faut-il brûler Sade ?. Ce livre est composé de plusieurs essais, dont un sur Sade. Mais il y en avait un autre, intitulé “La pensée de droite aujourd'hui”, texte qui date des années 50. Cet essai est d'une violence rarement égalée et d'une mauvaise foi patente. S. de Beauvoir traîne dans la boue toute la génération des Hussards. Elle s'en prend à Jules Monnerot et à Paul Sérant, et ce dernier a d'ailleurs riposté avec “La Droite de cette dame”, article paru dans La Parisienne. Mais S. de Beauvoir attaque également Guénon. D'après elle, la droite se pense comme une classe décadente à travers les idées de Guénon. La bourgeoisie, poursuit-elle, a besoin de croire au déclin de l'Occident et à la fin du monde pour justifier ou cacher son propre déclin. Par réaction, cela m'a donné envie d'en savoir plus sur Guénon. Je me suis procuré La crise du monde moderne. Mais ce ne sera que quelques années plus tard que je lirai Le règne de la quantité, qui me marquera profondément. Il est important de noter cette distance de quelques années dans mon itinéraire, car c'est à ce moment que commence pour moi une aventure, celle du journal Le Huron.
Q. : En effet, qu'est-ce que Le Huron ?
DC : Georges Neri et moi-même fondons Le Huron à Genève en 1974. 8 numéros sont parus. Le titre est tiré d'une nouvelle de Voltaire. Nous voulions jeter sur le monde un regard analogue à celui du Huron de Voltaire sur le Paris du XVIIIe siècle. Le Huron était un journal satirique et polémique. Nous écrivions au vitriol. Nous proposions à nos lecteurs un mélange de polémique, parfois de bas étage, je l'avoue, et de réflexion métapolitique. L'idée était de se servir d'Evola et de Guénon pour donner à la droite de nouvelles assises philosophiques, d'éviter de faire du “réchauffé”, du “néo”. Je ne prétends pas que nous avons réussi. Nous voulions aussi dépasser les insuffisances du NOS (Nouvel Ordre Social), un mouvement d'extrême-droite genevois qui se réclamait de Georges Oltramare. À l'époque, le NOS volait très bas. Nous voulions lui donner des bases doctrinales plus solides, attirer ces jeunes vers Guénon et Evola. Dans cette démarche, il est évident que nous avons tous 2 commis des erreurs : notamment de trop axer nos réflexions sur l'anti-égalitarisme.
Le “Cercle Culture et Liberté”
Parallèlement au Huron, nous avons créé le CCL (Cercle Culture et Liberté), qui organisait des cycles de conférences ; ainsi, en 1976, nous avons invité Édouard Labin, époux de Suzanne Labin, qui a prononcé un exposé sur la problématique du QI (quotient intellectuel). C'était dans l'air du temps. Louis Pauwels, dans la foulée de ce culte du génie, venait de publier Blumroch l'admirable. L'ensemble de nos conférenciers présentait un éventail très électique. Nous avons également obtenu l'accord de Maître Gérard Hupin, de Bruxelles, qui est venu prononcer une conférence intitulée “Allons-nous vers la troisième guerre mondiale ?”. Les Soviétiques, prétendait-il, étaient sur le point de nous envahir, tandis que nous basculions, avec l'idéologie permissive de mai 68, dans les “paradis artificiels de la drogue et du sexe”. Après son passage, j'ai pu écrire quelques articles dans son journal, La Nation belge.
• Q. : Y a-t-il eu d'autres conférenciers à Genève ?
DC : Bien sûr. Je me rappelle surtout de Jean-Gilles Malliarakis et d'Yves Bataille. Quand Malliarakis est venu, nous avons eu une bagarre homérique avec des trotskistes genevois envoyés par Jean Ziegler, actuellement collaborateur occasionnel de Krisis, le nouvel organe d'Alain de Benoist. C'était en décembre 1976. Chauffés à blanc par Ziegler, ces garçons d'extrême-gauche ont attaqué le service d'ordre du NOS qui protégeait la salle. Le lendemain, en relatant l'événement, la presse genevoise a révélé que cette même salle Saint-Germain avait accueilli en 1904, une conférence d'un certain Benito Mussolini et que, parmi les auditeurs les plus attentifs, figurait Vladimir Illitch Oulianov, le futur Lénine.
Le titre de la conférence d'Yves Bataille était tout un programme : “Ni Washington ni Moscou” (2). Il n'y a pas eu de bagarre mais de simples menaces sans suite. Nous avions entre-temps adhéré aux GNR (Groupes Nationalistes-Révolutionnaires), structurés par François Duprat. Nous voulions constituer un GNR pour la Suisse romande et la Haute Savoie. Nous avions préparé minutieusement la venue de Bataille, pour éviter toute réédition des incidents survenus lors du passage de Malliarakis. Nous disions : “On prépare la conférence de Bataille et la bataille de la conférence”.
Dans le cadre du CCL, j'ai fait la connaissance de Georges Gondinet, lecteur de mes articles dans Le Huron. Une sorte de synergie s'est opérée alors : Gondinet était attiré à cette époque par les idées de Bataille ; ensemble, ils organisaient à Paris des séances de travail, où ils confrontaient leurs points de vue. Ainsi, en janvier 1978, Gondinet, Bataille, Vatré et moi-même avons discuté des “groupes géopolitiques” de l'Armée Rouge autour d'une succulente galette des Rois ! Bataille voulait infléchir le nationalisme révolutionnaire de Duprat (qui vivait encore) vers un national-communisme, qu'il exprimait déjà dans un bulletin, Correspondance européenne. Bataille était influencé par Jean Parvulesco et par Jean Thiriart. Il a également attiré notre attention sur la personnalité de Philippe Baillet.
Bataille et Gondinet : une Europe nationale-communiste portée par une élite de Kshatriyas
Pendant ces années 75, 76 et 77, nous étions dans l'indétermination, prêts à mordre à n'importe quel hameçon, pour sortir de l'ornière des vieilles droites. Avec Gondinet, Neri et moi-même restions sur des positions évoliennes. Pour G. Gondinet, le niveau d'exigence traditionnel d'Evola était plus élevé que celui de Guénon, parce qu'il réclamait l'action et refusait la pure contemplation. C'est en fait la fameuse distinction entre le Guerrier (Kshatriya) et le Brahmane. Evola se voulait Kshatriya. Et Guénon, Brahmane. C'est à cette époque que nous avons également connu la Nouvelle droite autour d'Alain de Benoist, où l'on spéculait également sur cette orientation héroïco-guerrière de la psyché européenne. Des portraits de Mishima et de Montherlant ornaient la tribune lors des colloques du GRECE ; et la ND venait également de sortir un ouvrage d'initiation à la pensée d'Evola, Le visionnaire foudroyé [Copernic, 1978].
De la “défense de l'Occident” à la “Plus Grande Europe”
Gondinet travaillait à l'époque à Défense de l'Occident, au sein de l'équipe de Maurice Bardèche. Il voulait donner un coup de jeunesse aux thématiques abordées dans la revue et, surtout, sortir du “romantisme du souvenir”, très présent chez Bardèche à cause des liens familiaux qui l'avaient uni à Brasillach. Le titre Défense de l'Occident ne plaisait pas à Gondinet. Celui estimait à juste titre que l'Occident devait être défendu avant tout contre lui-même. Il voulait faire glisser le discours vers l'idée d'Europe et même de “Plus Grande Europe”, notion héritée, via Bataille, de Jean Parvulesco et de Jean Thiriart, auteur d'un livre qui l'avait enthousiasmé, L'Europe, un Empire de 400 millions d'hommes.
Nous fréquentions aussi, à l'époque, l'équipe d'Horizons européens, animée par Fabien Régnier. Lui aussi défendait l'idée d'une plus grande Europe, élargie à l'Est, mais dans une perspective fédéraliste, proche des idéaux d'Alexandre Marc, de Guy Héraud et de Yann Fouéré. Je me souviens aussi de Jean-Paul Rebattet, celtisant farouche, et de Patrice Faget, homme de terrain.
• Q. : Quel était le dénominateur entre tous ces hommes, car, finalement, leurs options respectives sont dissonantes sinon divergentes ? Comment avez-vous réussi à harmoniser cet ensemble en apparence hétéroclite ?
DC : L'ensemble ne s'est jamais vraiment harmonisé. Nous formions une nébuleuse anti-égalitariste. Notre dénominateur commun se définissait par la négative : l'hostilité au nivellement par le bas, le rejet de la médiocratie post-soixante-huitarde. Éric Vatré de Mercy, futur biographe de Maurras, de Daudet et de Rochefort, futur auteur d'un essai sur Montherlant, était maurrassien. G. Gondinet était évolien. Bataille travaillait dans le sillage de Parvulesco et de Thiriart. Fabien Régnier était un européiste fédéraliste venu de la gauche. Bernard Dubant, qui deviendra un spécialiste des Sioux et des Amérindiens du Nord en général, avait été stalinien avant d'occuper Saint-Nicolas du Chardonnet avec les intégristes. Parmi nous, dans des circonstances très diverses, on remarquait souvent la présence de Jean-François Mayer, étudiant fribourgeois, qui deviendra historien des sectes, mais dont la personnalité se laissait à l'époque difficilement cernée. C'était une sorte de caméléon donnant l'impression d'avoir le don d'ubiquité. Il y avait enfin Bernard Paqueteau, un jeune Niçois très attachant, fils de militaire de carrière, admirateur de Berdiaev et de Dostoïevski, auteur du premier mémoire universitaire en langue française sur Evola.
Le Centre d'Études Évoliennes
• Q. : Tous ces gens sont donc encore en activité aujourd'hui ?
DC : Presque tous. Malheureusement, quelques-uns nous ont quitté prématurément. Je rends hommage à 3 d'entre eux que je n'ai pas connus. Jean-Claude Cuin animait avec Bernard Dubant la revue catholique ésoterique Narthex. Il est mort à 32 ans. Adriano Romualdi s'est tué dans un accident d'auto en 1973, la même année et de la même façon que Jef Vercauteren. Avec ce dernier, nous pouvons aborder la question des Centres d'Études Julius Evola, car Evola était le seul noyau doctrinal dur par-delà l'écorce très hétéroclite de notre mouvement.
En Italie, le Centre était dirigé par Renato del Ponte, l'homme qui avait porté les cendres d'Evola au sommet du Monte Rosa, selon les dispositions testamentaires du défunt. En Belgique, le relais de Vercauteren a été pris par Marc Eemans. En France, le responsable était un certain Léon Colas, mais c'était Philippe Baillet qui se chargeait de la majeure partie des tâches. Baillet était d'une intelligence remarquable et avait un énorme volume de travail. Il s'était brouillé avec Colas, car quand nous demandions à Colas comment contacter Baillet, Colas nous répondait : « Baillet s'est complètement garé des voitures » (sic). Nous en étions désolés. Mais voilà que Bataille vient démentir cette affirmation.
En 1977, nous décidons d'organiser un colloque sur l'anarchisme de droite à Paris. À la tribune : Gondinet, Vatré de Mercy, Dubant, Colas et moi. Le colloque étant fixé un samedi, nous décidons de tenir une réunion préparatoire le jeudi, où nous convions Baillet, qui répond présent. Colas n'était pas content, mais n'a rien dit.
Baillet : “Chevaucher le Tigre” avec les Tupamaros et le Vietcong
 Baillet a eu la courtoisie de ne pas monter à la tribune, afin de ne pas embarrasser Colas. Lors du débat, il est intervenu de manière particulièrement brillante. Son argumentation était de tendance nationale-communiste, comme celle de Bataille qui, lui aussi, était dans la salle. Baillet nous disait — nous étions en 1977 — que le Tupamaro d'Amérique latine ou le combattant du Vietcong étaient les modèles auxquels nous devions nous référer, si nous voulions véritablement “chevaucher le Tigre”. On sentait clairement l'influence de l'Italien Franco Giorgio Freda (2) [ci-contre]. Chevaucher le Tigre d'Evola était paru en version originale italienne en 1958. Freda est l'homme qui a fait le lien entre les idées qu'Evola avait développées dans ce livre — la volonté d'être actif dans un sens traditionnel, même dans une époque de déclin et au milieu des ruines — et les groupes activistes nationaux révolutionnaires de la péninsule italique dans les années 70. Donc, au-delà de la dispute qui venait d'opposer Baillet à Colas, ce colloque nous a apporté une nouvelle piste idéologique importante, grâce à l'intervention dans le débat de P. Baillet.
Baillet a eu la courtoisie de ne pas monter à la tribune, afin de ne pas embarrasser Colas. Lors du débat, il est intervenu de manière particulièrement brillante. Son argumentation était de tendance nationale-communiste, comme celle de Bataille qui, lui aussi, était dans la salle. Baillet nous disait — nous étions en 1977 — que le Tupamaro d'Amérique latine ou le combattant du Vietcong étaient les modèles auxquels nous devions nous référer, si nous voulions véritablement “chevaucher le Tigre”. On sentait clairement l'influence de l'Italien Franco Giorgio Freda (2) [ci-contre]. Chevaucher le Tigre d'Evola était paru en version originale italienne en 1958. Freda est l'homme qui a fait le lien entre les idées qu'Evola avait développées dans ce livre — la volonté d'être actif dans un sens traditionnel, même dans une époque de déclin et au milieu des ruines — et les groupes activistes nationaux révolutionnaires de la péninsule italique dans les années 70. Donc, au-delà de la dispute qui venait d'opposer Baillet à Colas, ce colloque nous a apporté une nouvelle piste idéologique importante, grâce à l'intervention dans le débat de P. Baillet.
• Q. : Cette nouvelle piste idéologique était-elle l'apanage de votre petit groupe ou d'autres la suivaient-ils également ?
DC : En Suisse aussi, dans le NOS et les GNR, il y avait des garçons qui faisaient l'éloge de la “troisième voie libyenne” de Khadafi. Gilbert Duart (1), un des plus sympathiques membres des GNR, s'engageait à fond dans la ligne de Thiriart, Parvulesco et Bataille. À Lausanne, dans la même mouvance, Daniel Bättig animait des journaux comme L'Insurgé et Lutte du peuple.
Quand l'antenne était à nous...
Le 24 novembre 1976, G. Gondinet et moi-même arrivons à Bruxelles, où nous vous rencontrons pour la première fois, ainsi que le regretté Alain Derriks (1952-1987), lors d'une soirée organisée dans les locaux du Helder, rue de Luxembourg, par Georges Hupin, le GRECE-Bruxelles, et quelques animateurs de La Nation Belge, dont Maître Gérard Hupin et son épouse. Le CCL avait une antenne à Bruxelles, en la personne d'Alain Derriks, que vous alliez aider dans sa tâche, tout en poursuivant votre activité dans la rédaction de Pour une renaissance européenne de Georges Hupin.
Le 27 novembre 1976, jour de mon trentième anniversaire, nous sommes invités à une émission télévisée hebdomadaire à Genève, 'L'Antenne est à vous'. Le CCL recevait 15 minutes d'antenne pour exprimer ses idées, comme d'autre organisations ou cercles, chaque semaine. Gondinet est arrivé de Paris. Sur le plateau, outre G. Gondinet, il y avait le futur avocat Pascal Junod, Duart et moi-même. Junod et Duart avaient été recrutés in extremis, car, normalement, c'était Régnier et Faget qui auraient dû prendre la parole, mais ils en ont été empêchés au dernier moment. La performance de Junod a été éblouissante. Il était très jeune, il avait 19 ans. Il avait juste eu le temps de lire une seule fois en vitesse son texte avant d'arriver sur le plateau, mais il l'a restitué avec le brio du futur membre du barreau.
• Q. : Cette émission fut donc le clou de votre carrière genevoise. Après commence votre période parisienne. Pouvez-vous nous en toucher un mot ?
DC : En 1978, je m'installe effectivement à Paris. J'avais donné ma démission d'enseignant à Genève. Avant de quitter les bords du Lac Leman, j'avais travaillé pendant 18 mois dans un magazine grand public, Impact, organe de la droite libérale musclée, dans lequel j'essayais de faire passer des idées évoliennes ! À mes yeux, et rétrospectivement, le meilleur article que j'ai réussi à publier dans ce canard s'intitulait “L'Europe, patrie idéale”. C'était en octobre 1976. L'idée centrale de cet article venait de G. Gondinet, qui développait à l'époque une théorie très séduisante, celle des “trois patries” et de leur hiérarchisation. Il y avait, à la base, la “patrie charnelle”, qui constituait un socle, puis la “patrie historique” et, enfin, au sommet, la “patrie idéale”, c'est-à-dire, pour nous, l'Europe. Dans cet article d'Impact, je n'avais fait que développer une conception de G. Gondinet.
Mais fin 1977, je suis viré d'Impact. N'ayant plus de ressources, étant marqué à l'extrême-droite du fait de mes liens avec le NOS et les GNR, je décide de partir à Paris, où j'avais davantage de relations. C'est ainsi que je suis devenu journaliste à Rivarol, du temps de Maurice Gaït, un ancien du cabinet de Jérôme Carcopino à Vichy. Tous les latinistes connaissent l'excellente introduction de Carcopino au monde de la Rome antique, La vie quotidienne à Rome. Gaït, pour avoir été le compagnon de route de cet ami de tous les latinistes, mais qui fut aussi un réprouvé, avait été déchu de ses droits d'enseigner. Comme j'avais volontairement abandonné un enseignement qui allait à vau-l'eau, il m'accordait volontiers sa sympathie, sorte de solidarité entre universitaires marginalisés par un pouvoir qui rejetait la culture.
Pierre Lance : pour l'alliance d'un vrai régime des libertés et des technologies de pointe
• Q. : Dans votre période parisienne, vous avez aussi collaboré à L'Ére nouvelle de Pierre Lance, et vous avez connu le lancement des éditions Pardès.
DC : Effectivement, j'ai travaillé de 1980 à 1982 à L'Ére nouvelle de Pierre Lance. Celui-ci m'a fait découvrir l'astrologie, application de la doctrine guénonienne de l'espace-temps qualifié, dont je dirais quelques mots tout à l'heure. La démocratie de P. Lance était à mille lieues du jacobinisme, mais très proche de votre “démocratie organique”, ou encore de la synthèse “archéofuturiste” d'un Guillaume Faye : alliance d'un vrai régime des libertés et des technologies de pointe. Il y avait matière à réflexion pour un anti-démocrate viscéral comme moi ! À L'Ére nouvelle, j'ai rencontré des jeunes intellectuels prometteurs et en pleine recherche : Pierre de la Crau, fasciné par le monde celtique, et Emmanuel Lévy, fils d'un historien juif.
En 1982 et 1983, je fais un bref passage aux éditions Pardès qui démarrent à l'époque. Ce fut très enrichissant. Je suis rétrospectivement fier d'avoir travaillé au lancement d'une entreprise éditoriale qui est toujours présente en librairie aujourd'hui, plus florissante que jamais, avec des collections didactiques bien adaptées au public actuel comme les “B.A.BA” et les “Qui suis-je ?”. Depuis leurs débuts, les éditions Pardès ont changé, certes, mais elles sont restées fidèles au concept de la permanence de la Tradition, toujours présente même au cœur de la décadence, comme un providentiel flambeau dans l'épaisseur de la nuit.
Pendant ma “période Pardès”, Gondinet et sa dynamique compagne Fabienne Pichard du Page ont publié une excellente Histoire des Vendéens. Ils ont présenté ce livre sur les ondes de Radio Alouette, où j'ai aussi été interviewé pendant une heure dans l'émission “L'invité au Pays” (6 juillet 1982). Cette station libre avait un directeur aujourd'hui bien connu : Philippe de Villiers. Malheureusement, Georges, Fabienne et moi, nous nous sommes brouillés. J'assume aujourd'hui l'entière responsabilité de cette brouille. Roland Goffin m'a alors contacté pour travailler avec lui à Vers la Tradition.
La “nouvelle droite”, Jérémie et l'Écclésiaste
• Q. : Est-ce à cette époque que vous allez approfondir votre connaissance de l'œuvre de Guénon et développer, dans ce sillage, une critique de la ND française et de ses aspects modernes et prométhéens ?
DC : J'avais effectivement découvert Le Règne de la quantité, puis les autres livres de Guénon. En prenant connaissance de cette œuvre, je prends en effet la “nouvelle droite” en grippe. Ma réaction, qui fut polémique et épidermique, je l'avoue aujourd'hui, était comparable à celle que j'avais eue vis-à-vis du gauchisme à Genève au début de ma courte carrière de professeur. L'arrogance du discours de la “nouvelle droite” me semblait insupportable, j'estimais que c'était un élitisme à base d'orgueil dominateur. C'est sur de tels sentiments que se fondait ma réaction épidermique.
Ensuite, ce qui m'a choqué également, c'est cette mise entre parenthèse systématique de la tradition judéo-chrétienne. Pour moi, la ND jetait sur le passé un regard myope, doublé d'une mauvaise foi, car il me semble toujours que la tradition biblique (l'Ancien et le Nouveau Testaments) présente un tel foisonnement et une telle diversité qu'elle ne permet pas un tel rejet total et manichéen. Par ex., il n'y a pas de commune mesure entre un livre comme l'Écclésiaste et les livres des prophètes Isaïe ou Jérémie. Chez Jérémie, par ex., il y a un côté larmoyant et pleurnichard (d'où les “jérémiades”) qui me déplait aussi. L'Ecclésiaste, en revanche, nous dit qu'« il y a un jour pour aimer, un jour pour haïr, un jour pour rire, un jour pour pleurer ». Ou nous inculque des vérités éternelles comme Nihil sub sole novi (Rien de nouveau sous le soleil) ou Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Vanité des vanités et tout est vanité). Là transparaît une sagesse fort proche de celle de Lao Tse.
Accepter ou rejeter en bloc la tradition biblique me semble les 2 faces d'une même erreur. En l'occurrence, le Janus Bifrons, ce sont d'un côté les sectes apocalyptiques et fondamentalistes, qui prennent la tradition biblique à la lettre, et de l'autre, un mouvement comme la ND qui la rejette en bloc, pour la remplacer par un paganisme caricatural et parodique, et surtout complètement artificiel. De ce fait, le rejet du réel par les fondamentalistes bibliques équivaut au rejet du réel par les païens parodiques. On peut aussi se demander s'il n'y a pas une sorte d'animation dialectique entre ces 2 pôles, qui se renforceraient l'un l'autre.
En plus, la ND faisait dériver le communisme et le nazisme de la matrice judéo-chrétienne. Le Christ a certes dit : « Qui n'est pas avec moi est contre moi ». Mais pour Alain de Benoist, cette parole était “le mot d'ordre de tous les totalitarismes”. Pour moi, c'est le genre de raccourci inacceptable. Je ne conteste pas que des gens sérieux développent la conception de l'Évangile poison hors de l'Église, ou encore la thèse que les idées de gauche sont « des idées chrétiennes devenues folles » (Chesterton). Mais dans l'anti-judéo-christianisme de la ND, il y a une mauvaise foi, qui n'est peut-être pas tout à fait innocente, mais qui m'a incité à me distancier, en dépit de l'indéniable séduction de la ND. Celle-ci m'a tenté jusqu'en 1978, surtout en raison de son anti-égalitarisme.
Dé-qualification et désenchantement
• Q. : Mais que vous a apporté la lecture du Règne de la quantité ?
DC : Quand j'ai lu Le Règne de la quantité de René Guénon, j'ai constaté que sa dénonciation du monde moderne va beaucoup plus loin que les analyses de type marxiste et que les critiques de la ND à l'encontre de la société marchande. Du côté marxiste, on oppose les prolétaires aux bourgeois ; du côté de la ND, les héros aux marchands (selon une terminologie héritée de Werner Sombart). Ces oppositions m'avaient toujours paru un peu simplistes en regard de la finesse d'analyse de Guénon, pour qui le problème tournait autour des pôles de la “qualité” et de la “quantité”. J'irai jusqu'à dire que la quantité ne peut se définir que négativement, que par l'absence de qualité, de sorte que la décadence moderne se définit comme une dé-qualification du monde. D'autres, comme Max Weber, parlent de « désenchantement », terme plus poétique repris en Flandre et aux Pays-Bas par le néo-païen contemporain Koenraad Logghe. Ce dernier est de plus en plus inspiré par Guénon et se différencie ipso facto de la multitude des néo-païens de pacotille.
À partir de cette notion de “dé-qualification”, je me suis surtout intéressé à la dé-qualification du temps. Le monde de la Tradition a connu un temps qualifié. Le monde moderne veut lui substituer un temps dé-qualifié. Ce qui revient à instaurer en quelque sorte l'égalitarisme de tous les instants qui composent la ligne du temps. On peut dire la même chose de l'espace. Du point de vue traditionnel, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi, à n'importe quel moment et dans n'importe quel lieu.
L'homme qualifié doit agir dans un temps et dans un espace qualifié, d'où mon intérêt principal pour la doctrine des cycles et dans un second temps pour la géographie sacrée.
Mon étude de Guénon se limite en gros à la cyclologie, aux rapports Brahmane/Kshatriya (spiritualité/puissance) et à quelques considérations sur la “guerre occulte”. Je ne me permetrai pas de discourir sur l'initiation, car je n'ai franchi aucun “seuil” au sens initiatique du terme. Je ne suis pas un grand connaisseur de l'islam, qui est la tradition dans laquelle Guénon s'est installé à partir de 1930. Mais comme l'a très bien souligné R. Goffin dans Vers la Tradition : être guénonien n'aboutit pas nécessairement à devenir musulman. Goffin parle de la Guerre sainte ; il dit que la Grande Guerre Sainte doit toujours prévaloir sur la petite guerre sainte et il ajoute en substance : “si tant est que la petite guerre sainte ait jamais eu une signification”. Le guénonisme ne peut pas être prétexte à une guerre de religion.
La critique guénonienne de Bergson et de Teilhard
Ma rupture avec la nouvelle droite s'est consommée au fil des années sur la question du sens de l'histoire, qui me paraît fondamentale, parce qu'il faut répondre au progressisme linéaire, issu du libéralisme, qui est évidemment une aberration.
Il faut préciser, à ce niveau, que Guénon a aussi pris position contre Bergson et Teilhard de Chardin, pour lesquels l'histoire n'est pas bêtement linéaire mais est plutôt un mouvement de spirale ascendante, que l'on retrouve dans le New Age actuel. Ce mouvement de spirale ascendante postule une montée vers un Christ cosmique (Teilhard) ou vers un état de plénitude vitale (l'idée de croissance personnelle du New Age californien). Pour s'opposer à cela, il ne faut évidemment pas prendre stupidement le contre-pied des conceptions linéaires progressistes, car cela donne alors un décadentisme linéaire, une philosophie de l'histoire, débouchant sur un dépérissement catastrophique. La meilleure réponse réside dans une conception de l'histoire fondée sur une spirale descendante, allant de la Tradition primordiale aux parodies modernes, mais avec la possibilité récurrente d'un redressement (cf. la doctrine hindoue des avatars de Vishnu qui descend dans le monde pour atténuer les effets de la chute). Un exemple de réponse tout à fait inadéquate était, me semble-t-il, celle d'un Michel Marmin qui parlait de “non-sens” de l'histoire.
Ne pas abandonner à la gauche les idéaux d'utopie et d'universalité
Pour résumer mes propos, il ne fallait pas, dans mon esprit, abandonner à la gauche libérale ou marxiste l'idée d'un sens de l'histoire et il ne fallait pas non plus lui abandonner les idéaux d'utopie et d'universalité. L'erreur de la droite a toujours été d'abandonner ces idées-là à la gauche, de s'enfoncer voire de s'enliser dans le particularisme, de prôner ce non-sens de l'histoire cher à Marmin, et de ne jamais imaginer une société idéale. J'ai vu dans la Tradition une sorte d'utopie non progressiste. Je me définirais volontiers comme un utopiste de droite.
• Q. : Une droite inconnue qui attendait son heure...
 DC : On peut le dire ainsi. Baillet voulait intituler de la sorte un texte destiné à un ouvrage collectif des éditions Belfond. Mais grâce à R. Goffin, j'ai appris à dépasser les clivages. En tête de son numéro double pour le 50ème anniversaire de la mort de Guénon [Vers la tradition n° 83-84, 2001, ci-contre], il a judicieusement placé un texte du jeune Guénon. Nous sommes en 1910. Guénon à 24 ans. Il compare la Tradition primordiale à un tronc d'arbre au pied duquel poussent des végétations parasitaires qui se nourrissent du tronc mais finissent pas l'étouffer. Telles sont les formes traditionnelles particulières qui se succèdent dans l'histoire et dans lesquelles on ne retrouvent plus, au fil du temps, que des bribes de la doctrine universelles des origines. Concluons en toute honnêteté. Normalement, le rattachement à la Tradition universelle ésotérique doit s'accompagner de l'installation dans une tradition particulière exotérique. Guénon est formel sur ce point. Or, moi, je ne pratique aucune religion. Peut-être mon traditionalisme n'est-il inconsciemment qu'un agnosticisme qui n'ose pas dire son nom. Peut-être suis-je resté au fond de moi un libre-penseur issu de l'Université Libre de Bruxelles.
DC : On peut le dire ainsi. Baillet voulait intituler de la sorte un texte destiné à un ouvrage collectif des éditions Belfond. Mais grâce à R. Goffin, j'ai appris à dépasser les clivages. En tête de son numéro double pour le 50ème anniversaire de la mort de Guénon [Vers la tradition n° 83-84, 2001, ci-contre], il a judicieusement placé un texte du jeune Guénon. Nous sommes en 1910. Guénon à 24 ans. Il compare la Tradition primordiale à un tronc d'arbre au pied duquel poussent des végétations parasitaires qui se nourrissent du tronc mais finissent pas l'étouffer. Telles sont les formes traditionnelles particulières qui se succèdent dans l'histoire et dans lesquelles on ne retrouvent plus, au fil du temps, que des bribes de la doctrine universelles des origines. Concluons en toute honnêteté. Normalement, le rattachement à la Tradition universelle ésotérique doit s'accompagner de l'installation dans une tradition particulière exotérique. Guénon est formel sur ce point. Or, moi, je ne pratique aucune religion. Peut-être mon traditionalisme n'est-il inconsciemment qu'un agnosticisme qui n'ose pas dire son nom. Peut-être suis-je resté au fond de moi un libre-penseur issu de l'Université Libre de Bruxelles.
Agnostique à option traditionnelle
Mes professeurs se définissaient comme des “agnostiques à option (ou hypothèse de travail) athée”. Moi, je serais un agnostique à option (ou hypothèse de travail) traditionnelle ou guénonienne. Dans “agnosticisme”, il y a l'alpha privatif. Un “agnostique” est d'abord un “privé de connaissance”. L'avoir compris constitue ma dette envers Guénon. Je lui dois d'avoir appris à distinguer le savoir rationnel, “lunaire” (sorte de “connaissance par reflet”), et la gnose véritable, l'intuition “solaire”, l'intelligence du cœur (sans connotation sentimentale). La “libre pensée” a du mal a dépasser le stade “lunaire”. Quand elle en prend modestement conscience, elle devient une merveilleuse école d'humilité.
► Nouvelles de Synergies européennes n°52, 2001.
[illustration ci-haut : Josek Sudek, Cathédrale de San Guido, 1924-1928]
◘ Notes en sus :
• 1 - Gilbert Duart, d'Onex a signalé, outre avoir bien connu D. Cologne, n'avoir jamais appartenu aux GNR ni d'ailleurs à aucune autre organisation politique.
• 2 – « Toutefois, au fil du temps, j’ai découvert que, parallèlement à la judicieuse distanciation par rapport aux États-Unis, sévissait dans nos rangs, en dépit de la guerre froide, une dangereuse fascination de la Russie soviétique. “Ni Washington ni Moscou”. C’était le mot d’ordre de façade. C’était le thème d’un conférencier que j’avais invité à Genève en 1977. Les gardes du corps dont il était flanqué avaient caché des cocktails Molotov dans les toilettes au cas où, comme quelques mois auparavant, les ouailles pacifistes de Jean Ziegler descendraient de leurs auditoires pour venir nous taper dessus. Mais excepté le passage à tabac d’un diplomate africain dont les coupables sont restés introuvables et impunis, la soirée fut calme. Notre hôte ne sortit guère de la double négation du monde bipolaire de l’époque. C’est pourtant le même qui, en janvier 1978, tente de nous intoxiquer, quelques compagnons et moi-même, avec de prétendus “groupes géopolitiques” de l’Armée Rouge tout disposés à soutenir les nationalistes-révolutionnaires d’Europe de l’Ouest et leur désignation de “l’ennemi américain”. Pour ceux qui voulaient infléchir notre fragile nébuleuse dans la direction du national-bolchévisme, toutes les occasions étaient bonnes. Subtils argumentaires développés autour d’une galette des Rois dont la fève était difficile à avaler pour le maurrassien égaré à notre table. Débats enfiévrés à Genève, avec participation des Lausannois et des Italiens (à l’époque de Freda), et avec l’inoubliable intervention de Ferraglia : “Pourquoi ne parlons-nous jamais d’amour ?”. Discussions passionnées à Bruxelles, où un militant cite Chesterton et devance Guillaume Faye, assimile le traditionalisme à une “démocratie des morts” et préconise la fuite en avant vers un avenir rouge comme le sang que répandent à l’Est la faucille et le marteau. Enfin, last but not least, vigoureuses interventions dans les colloques semi-mondains de Paris, sous le regard enamouré d’une Madame Papon sans autre rapport qu’homonymique (que les belles âmes se rassurent) avec le tristement célèbre Maurice. Désintégrons le Système avec des guerriers authentiques, de vrais “individus absolus” dont même l’Evola de Chevaucher le Tigre ne soupçonnait pas le “visage originel” derrière les masques du Tupamaro d’Uruguay ou du Vietcong attaquant par derrière le Sammie englué dans la rizière. Entre-temps, le Figaro-Magazine était investi par les meilleurs d’entre nous, à moins que ce ne fussent les plus chanceux et les plus à l’aise dans les cocktails non Molotov. À leur tête, un Louis Pauwels expert en raccourcis : le nazisme = Guénon + les divisions Panzer, le communisme russe = 1789 + le froid. Comme l’a pertinemment rappelé Robert Steuckers, 1979 fut l’apothéose de la Nouvelle Droite. Mais 2 ans plus tard commençait le double septennat de Mitterrand. » (extrait de l'article Les raccourcis du prêt-à-penser)
• 3. Pour une approche contextuelle, cf. aussi, outre l'article donné en lien, celui de F. Ferraresi paru dans Politica Hermetica n°1 « J. Evola et la droite radicale de l'après-guerre » (pp. 94-111). Pour une critique de Freda du point de vue du réalisme politique, cf. Conscience Européenne n°12, mai 1985, « L'anarchisme mystique ou la paralysie de l'action révolutionnaire : révolution européenne ou Tradition ? ». Pour la revue Totalité, « La ligne radicale définie par Freda [not. dans La désintégration du système] et ses amis des Ed. di Ar est, en réalité, moins difficile à comprendre qu'il n'y paraît. Elle est tout simplement une des pratiques – la pratique politique – de la théorie exposée dans Chevaucher le tigre. Son grand mérite est d'avoir énoncé clairement le principe selon lequel, pour reprendre une expression d'Evola lui-même, être “traditionaliste intégral” aujourd'hui est la meilleure façon d'être radicalement révolutionnaire. En cela, Freda a été le premier à ne pas se contenter de commenter Evola, mais à tirer de la théorie évolienne de la pratique a pratique de la théorie ou, pour continuer à parler comme Marx, à passer de la critique des armes aux armes de la critique. Pour peu qu'on veuille vraiment réfléchir, tout est clair en effet : celui qui s'est reconnu dans les valeurs de la Tradition, celui qui a compris que le monde de la Tradition est un “paysage” de la civilisation, un paradigme fixé dans les cieux de toute éternité pour l'homme qui peut et veut le voir, celui-là se rend compte qu'il est aujourd'hui dans ce que Freda a très justement appelé “le monde des autres”. Un monde qui est pour lui comme un lieu d'exil, un univers avec lequel il n'a plus rien à partager, un ennemi absolu avec lequel toute espèce de compromis est inacceptable. Deux voies s'offrent alors à cet homme : la retraite, ou l'action révolutionnaire complètement désenchantée. Le choix d'une voie plutôt que l'autre n'est qu'une question de nature propre (...), et n'affecte aucunement l'essentiel. Si c'est la seconde voie qui est choisie, il est évident qu'elle ne tendra pas à préserver quoi que ce soit du monde moderne, mais qu'elle visera à accélérer encore plus sa chute, sa destruction totale. L'homme vraiment différencié – celui pour qui le rattachement aux valeurs de la Tradition n'est pas compensation subtile, alibi destiné à cacher sa misère existentielle – est aujourd'hui spontanément porté vers une sorte de “nihilisme actif” : il n'a rien à perdre dans la fin de ce monde et, si dire qu'il a tout à y gagner serait encore une façon de retomber dans un messianisme parodique, du moins cet homme sait-il, avec une certitude absolue, que toute restauration traditionnelle sera impossible tant que le monde moderne n'aura pas entièrement disparu. Ceux qui voient l'Occident menacé de partout, ceux qui redoutent l'entrée de l'Europe au musée de l'histoire, ceux qui s'étouffent encore devant le spectacle courant des mariages interraciaux, ceux là sont des démocrates et des humanistes qui s'ignorent. Ils raisonnent encore en termes de quantité et sont incapables de définir “l'aryanité” autrement que par la négation. Ils oublient que le fait de naître “aryen” implique d'abord des devoirs, et ensuite seulement des droits. Ils oublient qu'un individu foncièrement sain n'a pas besoin, même au milieu d'une époque livrée au chaos, de brillantes théories pour préserver l'intégrité de sa race, et ne voient pas que ceux ou celles qui s'abâtardissent prononcent par là-même le verdict de leur propre condamnation. Ce n'est pas l'avenir de la race blanche dans son ensemble qui importe. Ce qui importe, c'est de faire en sorte que se forme un Ordre spirituel d'hommes européens unis par le haut, par une même vision du monde et un même style de vie ; un Ordre qui incarnera le type de la race, et non pas sa quantité arithmétique, et à qui il sera donné de passer, seul, indemne à travers les ruines de ce monde. Tant que l'on n'aura pas compris que telle est la tâche prioritaire, le reste, tout le reste ne sera que bavardage, pose et mise en scène. Poser des questions sur la manière dont cet Ordre résistera concrètement à la décomposition générale, ou s'inquiéter de sa survie biologique – alors que, plus que jamais, la paternité spirituelle doit l'emporter sur la paternité biologique – témoignerait d'un matérialisme inconscient et ignorant du primat inaliéniabie de l'Esprit, qui souffle où il veut, quand il veut et comme il veut » (Aquarius).
***
E.M. : Et aujourd’hui, un quart de siècle plus tard, comment jugez-vous l’évolution de la ND ?
D.C. : N’étant pas internaute, et personne n’ayant tenu sa promesse de m’envoyer des documents, je me garderai bien de formuler un quelconque jugement sur la Nouvelle Droite d’aujourd’hui. Lorsque j’ai rencontré Steuckers en 2001 pour répondre à son questionnaire de Synergies européennes, j’ai eu l’impression qu’il pataugeait dans la même gadoue qu’il y a 30 ans. J’admire ce type pour sa puissance de travail et son immense érudition de germaniste, mais en 2001, sa pensée n’avait pas varié d’un iota par rapport à l’année 1976 de notre premier contact. C’était toujours la même chimère [sic] d’un Empire eurasien, au noyau germano-russe nostalgique du pacte Ribbentropp – Molotov, englobant une aire indo-persane retournée au régime des castes, le tout assaisonné des délires de Jean Parvulesco.
E.M. : Restez-vous attaché à l’idée impériale européenne ? N’est-elle qu’un mythe (au sens sorélien du terme) pour les Européens ou bien leur ultime forme de recours (et donc de survie) en ces temps de péril accrus ?
D.C. : Je suis moins attaché qu’autrefois à l’idée impériale européenne. Elle ne peut servir de “mythe mobilisateur” qu’à des nostalgiques de régimes anciens. Une Europe fédérale pyramidale peut carrément se substituer à l’imperium, et non pas lui servir de transition. La vision du monde servirait d’élément unificateur sans qu’il soit nécessaire d’avoir, au sommet de la pyramide, une oligarchie impressionnante ou un “empereur” charismatique.
► Court extrait de : « Jalons pour une biographie intellectuelle (Entretien avec Daniel Cologne) », sur la revue en ligne Europe Maxima (30 oct. 2007).

Ouverture :
◘ Notre objectif : L'IMPERIUM EUROPÉEN !

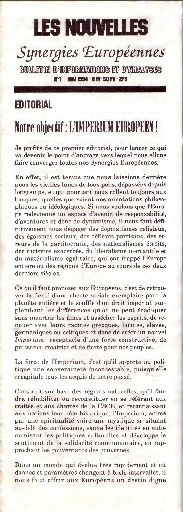 Je profite de ce premier éditorial, pour lancer ce qui va devenir le point d'ancrage vers lequel nous allons faire converger toutes nos Synergies Européennes.
Je profite de ce premier éditorial, pour lancer ce qui va devenir le point d'ancrage vers lequel nous allons faire converger toutes nos Synergies Européennes.
En effet, il est temps que nous laissions derrière nous les vieilles lunes de tous poils, dépassées depuis longtemps, et qui pourtant nous collent toujours aux basques, quelles que soient nos orientations philosophiques ou idéologiques. Si nous voulons que l'Europe redevienne un espace d'avenir, de responsabilité, d'aventures et donc de dynamisme, il nous faut définitivement nous dégager des dogmatismes religieux, des égoïsmes sociaux, des réflexes partisans, des erreurs de la partitocratie, des nationalismes étroits, des racismes exacerbés, du libéralisme mercantile et du matérialisme égalitaire, qui ont frappé l'Europe entière ou des régions d'Europe au cours de ces deux derniers siècles.
Ce qu'il faut proposer aux Européens, c'est de retrouver la fierté d'une charte sociale exemplaire pour la planète entière et le souffle d'un droit impérial, surplombant les différences qu'on ne peut éradiquer sans meurtrir les âmes et assécher les esprits, de renouer avec leurs racines grecques, latines, slaves, germaniques ou celtiques et donc de créer un nouvel Imperium réceptacle d'une force constructive, de puissance créatrice et de fierté pour nos peuples.
La force de l'Imperium, c'est qu'il apporte au politique une souveraineté incontestable, puisqu'elle récapitule tous les acquis de notre passé.
Construit sur base des régions naturelles, qu'il faudra réhabiliter ou reconstituer en se référant aux traités et aux chartes de la CSCE, et reconnaissant aux nations leur rôle historique, l'Imperium, animé par une spiritualité voire une mystique se situant au-delà des confessions, sauve les identités en autonomisant les politiques culturelles et développe le sentiment de la solidarité communautaire, en rapprochant les gouvernants des gouvernés.
Dans un monde qui évolue très rapidement et où donnes et paramètres changent à brefs intervalles, il nous faut offrir aux Européens un destin digne d'eux, un avenir commun plein de promesses et porté par un souffle mythique. En proposant l'Imperium comme point d'orgue au devenir de notre continent, nous ouvrons une perspective vraiment neuve, une réorganisation de notre espace et une formidable révolution de l'esprit qui justifient pleinement notre union. Nous nous donnons ainsi les moyens de retrouver notre rang, notre influence, notre indépendance et donc notre souveraineté.
En accord avec mes amis de Synergies, partout en Europe, j'appelle tous les Européens à nous rejoindre pour construire ensemble une Europe vraiment nouvelle, pour offrir à nos enfants une aventure pleine de créativité et d'enthousiasme, pour retrouver les racines de nos meilleures traditions politiques, et donc à nous unir pour l'IMPERIUM EUROPÉEN.
► Gilbert SINCYR, édotorial de Nouvelles de Synergies Européennes n°1, mai 1994.

« Il n'y a pas de pays où les associations soient plus nécessaires, pour empêcher le despotisme des partis ou l'arbitraire du Prince, que ceux où l'état social est démocratique » (Alexis de Tocqueville)
 Le citoyen, conscient de son devenir, se doit de reprendre l'initiative face à des partis qui ont savamment pris l'État en otage depuis 2 siècles. En effet, le jacobinisme a répandu parmi toutes les strates de la société, son armée zélée de fonctionnaires, paralysant ainsi tout le pays sur plusieurs niveaux. Le citoyen se retrouve seul devant la toute-puissance de l'État et de son administration hermétique. Comme beaucoup d'entre nous ont pu le constater, l'initiative d'un fonctionnaire est quasiment nulle. Il sert l'intérêt général, non le bien commun. L'association est un de ces corps intermédiaires permettant à une société de se dynamiser en outrepassant le cadre purement politique.
Le citoyen, conscient de son devenir, se doit de reprendre l'initiative face à des partis qui ont savamment pris l'État en otage depuis 2 siècles. En effet, le jacobinisme a répandu parmi toutes les strates de la société, son armée zélée de fonctionnaires, paralysant ainsi tout le pays sur plusieurs niveaux. Le citoyen se retrouve seul devant la toute-puissance de l'État et de son administration hermétique. Comme beaucoup d'entre nous ont pu le constater, l'initiative d'un fonctionnaire est quasiment nulle. Il sert l'intérêt général, non le bien commun. L'association est un de ces corps intermédiaires permettant à une société de se dynamiser en outrepassant le cadre purement politique.
Le citoyen doit cesser d'être un spectateur repu pour devenir acteur et remplir son rôle au sein de structures organiques différenciées. L'association est le plus souvent porteuse d'un projet concret. On y entre pour agir et non pour penser. Elle se transforme en une sorte d'outil social servant à restructurer le cadre de vie au-delà des oppositions idéologiques. La volonté, le savoir, les compétences de chacun se concentrent sur un objectif précis qui ne profite pas seulement aux simples membres.
L'association apporte à la vie un sens dans une société marchande qui en est complètement dépourvue. Le consommateur, même avec le droit de vote, n'a pas d'avenir.
Ainsi, la sphère associative doit devenir le foyer de l'offensive et de la résistance culturelle, identitaire, écologique... Un fonctionnement synergétique, réunificateur, intégrateur, régulateur, permettra d'inscrire ces diverses associations complémentaires au coeur même de la modernité et non plus à sa périphérie. L'homme doit pouvoir maîtriser son outil pour se perfectionner.
Le XXIe siècle devra être celui du réenracinement, d'une nouvelle fraternité que les hussards noirs, sans cesse délocalisés, déracinés, ont écarté car elle sentait trop le sang, qu'il soit reçu ou bien versé. Nous sommes “libres et égaux en droit”, mais frères de “fait”. En ce sens, la République n'a jamais pu instrumentaliser la Fraternité comme arme idéologique. Nous nous mettrons donc en route pour elle, afin que périsse l'individualisme et le mercantilisme, les 2 mamelles de la déliquenscence européenne.
Par l'association, nous avons l'espoir de filtrer la masse populaire pour qu'elle redevienne un peuple responsable participant activement à l'essor d'une nouvelle civilisation continentale enracinée.
► Stéphane GAUDIN (Association Euroffensive, Touraine), Nouvelles de Synergies Européennes n°1, mai 1994.
