Aristocratie
 Quelques notes sur la notion d' “aristocratie”
Quelques notes sur la notion d' “aristocratie”
Un projet politique, projet culturel, reposant nécessairement sur un certain nombre de choix éthiques qui expriment, à l'aide de références choisies tenues pour cohérentes, les aspirations, les idéaux, la culture de leurs promoteurs.
De toutes ces références, de ces “mots-clés” qui s'affrontent, s'appuient et se repoussent au gré des “combats d'idées”, il en est une, pas la plus employée ni la plus claire, qui mérite qu'on s'y arrête : celle d'“aristocratie” qui poursuit, çà et là, une carrière idéologique déjà ancienne. Le terme est suffisamment vague pour qu'on l'admette sans examen et, de plus, il est évocateur d'histoire(s). C'est cependant un terme suspect, au contenu ambigu et dont l'usage ne va pas de soi. Son insignifiance politique présente contraste plaisamment avec l'abus que l'on en peut faire dans certains milieux droitistes. C'est pourquoi tout débat sur la notion d'“aristocratie” doit commencer par une clarification sémantique. Ce faisant, on n'échappera pas, et l'on s'en excuse, aux déterminations intellectuelles de l'espace francophone. Mais si le mot est d'introduction récente en français (le terme aristocratie, latinisé dans les traductions d'Aristote, n'est usuel qu'à partir de 1750 ; l'aristocrate date du XVIe s. et ne se vulgarise, si l'on peut dire, qu'à la veille de la révolution [1778, Linguet] [1]), la notion est ancienne.
Il faut donc s'attacher à donner des points de repère historiques relatifs à l'origine de cette notion, tant il est vrai que le “style aristocratique”, quelles que soient les analogies que peuvent présenter sur ce point différentes civilisations, ne se laisse définir que dans un milieu culturel donné, en relation avec une situation historique précise. “L'aristocratie chinoise”, ou pharaonique, ou inca, mais on risquerait alors de méconnaître l'univers mental particulier qui les explique.
Aussi ces quelques notes s'attachent-elles aux données de la tradition indo-européenne, reconnues comme fondement de la notion européenne d'“aristocratie”. On a ainsi accès moins aux réalités des aristocraties historiques qu'à l'image que nous permettent d'atteindre les textes les plus anciens des cultures indo-européennes.
◘ 1.1. Le vocabulaire
 Le sens du terme ayant varié au cours des temps, il convient de rechercher les valeurs premières. Si l'on se reporte au grec ancien, on se rend compte que les composés en aris- sont extrêmement nombreux, de même que les noms de personnes. C'est l'indice d'une notion traditionnelle conservée par le formulaire et comme telle révélatrice des idéaux du peuple qui l'utilise, donc une notion fondamentale.
Le sens du terme ayant varié au cours des temps, il convient de rechercher les valeurs premières. Si l'on se reporte au grec ancien, on se rend compte que les composés en aris- sont extrêmement nombreux, de même que les noms de personnes. C'est l'indice d'une notion traditionnelle conservée par le formulaire et comme telle révélatrice des idéaux du peuple qui l'utilise, donc une notion fondamentale.
Le terme áristos sert de superlatif à ágathós (bon), et s'applique à “l'excellent”, au “meilleur”, au “plus brave”, au “plus noble”. L'aristocrate est donc celui qui se distingue dans un emploi précis, jugé essentiel par la tradition nationale. À l'origine, l'emploi devait être guerrier, l'áristeus étant “celui qui tient le premier rang”, le “chef le plus distingué, le plus brave”. Chez Homère, le terme s'applique à la suite ou à l'entourage des rois (Iliade 15, 363 ; 23, 236, etc…), d'où l'épique ándres áristèes. L'áristeía est la supériorité, notamment la vaillance et, au pluriel, les hauts faits, les exploits qui procurent la gloire ári-prepéoos “impérissable”. Aussi trouve-t-on l'adverbe ári-prepréoos (avec distinction, supérieurement). La notion de hiérarchie, ou mieux de hiérarchisation (active) des mérites n'est pas loin et se traduit dans le vocabulaire du gouvernement : áristarxéoo est “exercer la magistrature avec distinction”, on classe les hommes áristíndèn (par rang de noblesse ou de mérite). L'idéal social d'áristeúoo (exceller) entretient les espérances lignagères, d'où le composé áristogónos (qui enfante les plus nobles fils). L'áristokratía est donc le “gouvernement des plus puissants ou des meilleurs”. “L'aristocratie” est donc une notion issue de l'expérience sociale, vérifiée et somme toute relative. Elle n'est pas un concept métaphysique.
◘ 1.2. Dans la tradition indo-européenne
♦ 1.2.1. L'individu dans le groupe
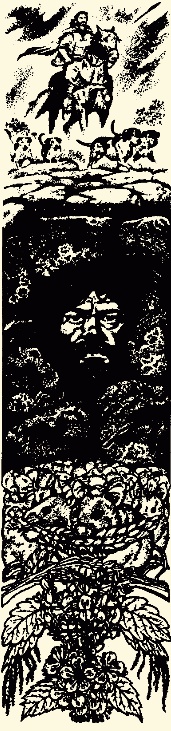 On remarque l'association de “l'aristocratie”, qui est un terme composé et donc secondaire par rapport à la notion d'aristeia, constatée, éprouvée dans les faits, avec les valeurs guerrières et la compétition sociale. Le rapport avec l'indien arya- est probable mais le sens de ce dernier terme est discuté (2) : l'arí- (avec sa personnification le dieu Aryaman) désigne la confédération des tribus qui constitue la “nation”, tous ceux qui se revendiquent du même “naître” ; mais en même temps qu'il désigne la communauté nationale par opposition aux non-aryens, arí- désigne l'étranger à la famille, au clan et à la tribu. Émile Benvéniste a pu écrire que le style indo-européen était “aristocratique” et Meillet n'a pas dit autre chose : l'analyse du vocabulaire hérité montre que l'indo-européen « est une langue de chefs et d'organisateurs imposée par le prestige d'une aristocratie » (3). L'étude du formulaire traditionnel confirme cette impression d'ensemble : « on y trouve l'image d'une fière aristocratie guerrière, qui aime la vie, les larges espaces, les biens de ce monde et par-dessus tout la gloire, et qui consacre à l'élevage, aux sports équestres et à la chasse les loisirs du temps de paix. Aristocratie pour qui le “caractère” (*ménos) est la qualité essentielle de l'homme, et la gloire (*kléwos, ce qu'on entend) le but suprême de l'existence » (4). Nul doute que l'organisation distendue de la “nation” entre clans rivaux et compétiteurs a favorisé la sélection de ces “aristocraties” guerrières. Tel est encore le mode d'organisation de plusieurs peuples indo-européens historiques, en particulier les Celtes de l'Antiquité et du Haut Moyen Âge irlandais.
On remarque l'association de “l'aristocratie”, qui est un terme composé et donc secondaire par rapport à la notion d'aristeia, constatée, éprouvée dans les faits, avec les valeurs guerrières et la compétition sociale. Le rapport avec l'indien arya- est probable mais le sens de ce dernier terme est discuté (2) : l'arí- (avec sa personnification le dieu Aryaman) désigne la confédération des tribus qui constitue la “nation”, tous ceux qui se revendiquent du même “naître” ; mais en même temps qu'il désigne la communauté nationale par opposition aux non-aryens, arí- désigne l'étranger à la famille, au clan et à la tribu. Émile Benvéniste a pu écrire que le style indo-européen était “aristocratique” et Meillet n'a pas dit autre chose : l'analyse du vocabulaire hérité montre que l'indo-européen « est une langue de chefs et d'organisateurs imposée par le prestige d'une aristocratie » (3). L'étude du formulaire traditionnel confirme cette impression d'ensemble : « on y trouve l'image d'une fière aristocratie guerrière, qui aime la vie, les larges espaces, les biens de ce monde et par-dessus tout la gloire, et qui consacre à l'élevage, aux sports équestres et à la chasse les loisirs du temps de paix. Aristocratie pour qui le “caractère” (*ménos) est la qualité essentielle de l'homme, et la gloire (*kléwos, ce qu'on entend) le but suprême de l'existence » (4). Nul doute que l'organisation distendue de la “nation” entre clans rivaux et compétiteurs a favorisé la sélection de ces “aristocraties” guerrières. Tel est encore le mode d'organisation de plusieurs peuples indo-européens historiques, en particulier les Celtes de l'Antiquité et du Haut Moyen Âge irlandais.
“L'aristocratie” se laisse ainsi définir comme la recherche et la maîtrise d'une perfection technique dans les activités caractéristiques de son mode de vie et génératrices de hauts faits. Les exploits du guerrier lui valent la gloire, la “bonne réputation” qui fait que l'on parlera de lui. C'est le seul moyen de conquérir l'immortalité, car la gloire est “impérissable” (formule reconstruite à partir de védique áksitan ´srávah et grec homérique kléos áphthiton [5]). Le meilleur échappera ainsi à l'anonymat de la “seconde mort” qui est le lot commun de ceux que guette l'oubli.
Comment cette idéologie d'apparence très “individuelle” s'inscrit-elle dans une doctrine sociale éminemment communautaire, entretenue par une tradition orale nécessairement supra-individuelle ? C'est d'abord que la recherche de gloire profite au groupe tout entier, puisqu'elle lui assure la maîtrise du “large espace”, de “l'espace pour vivre”. Ainsi les cosmogonies vantent les exploits du héros qui a fixé le soleil et repoussé les Ténèbres (Indra), servant en cela l'Ordre divin et rendant possible la vie du peuple et de l'univers (libération des eaux / vaches / aurores). La victoire militaire permet aussi l'instauration du sacrifice, l'organisation mystique de l'espace, la maîtrise distinctive des champs de pouvoir (les différents ager de Rome). C'est aussi parce que la réussite individuelle renforce le sens de la lignée dont la famille, le premier des cercles de l'appartenance sociale, est l'expression synchronique :
« Les devoirs envers la lignée sont ceux du système que les sociologues nomment trustee, caractérisé par la croyance que la race, la lignée étaient la réalité métaphysique, et que l'individu n'était qu'un maillon transitoire d'une chaîne permanente de la famille idéalement éternelle, gardant le nom, la réputation, le statut et la propriété de la famille en dépôt (in trust) pendant son temps de vie. C'était la responsabilité de l'individu de transmettre ce dépôt non diminué et si possible accru par sa propre conduite. L'individu acquérait l'immortalité quant la postérité et en particulier ses propres descendants se rappelaient son nom avec orgueil et honneur » (6).
Cette conception est inséparable de la solidarité clanique (famille étant ici à entendre comme “grande famille”, élargie à l'ensemble de la parenté, pratiquement l'unité réelle de la vie nationale). C'est d'ailleurs la reconnaissance de la solidarité-dépendance qui seule permet l'existence sociale. On peut résumer ainsi É. Benvéniste (7) : « En latin et en grec, l'homme libre, *(e)leudheros, se définit positivement par son appartenance à une “croissance”, à une “souche” ; à preuve, en latin, la désignation des “enfants” (bien nés) par liberi : naître de bonne souche et être libre, c'est tout un. En germanique, la parenté encore sensible par ex. entre all. frei (libre) et Freund (ami), permet de reconstituer une notion primitive de la liberté comme appartenance au groupe fermé de ceux qui se nomment mutuellement “amis”. À son appartenance au groupe — de croissance ou d'amis — l'individu doit non seulement d'être libre, mais aussi d'être soi : les dérivés du terme *swe, gr. idiotes (particulier), lat. suus (sien), mais aussi gr. étes, hetaîros (allié, compagnon), lat. sodalis (compagnon, collègue), font entrevoir dans le *swe primitif le nom d'une unité sociale dont chaque membre ne découvre son “soi” que dans “l'entre-soi”.
On n'est libre que dans le mesure où on reconnaît sa dépendance de nature, on n'est une personne que dans la mesure où le groupe vous reconnaît. L'aristocratie, la première à suivre le modèle social des sodalités et des unions de lignages, avec le système complexe d'engagements réciproques qu'elles supposent, participe entièrement de cette idéologie de la cohésion sociale, de type pourrait-on dire génétique.
♦ 1.2.2. Hiérarchie des valeurs et mobilité sociale
Les différentes sociétés issues des Indo-Européens ont conservé et cette exaltation de l'excellence sociale et le sens corollaire de la hiérarchisation :
« Un ensemble formulaire constitué à partir de la racine *kens- (qualifier, porter un jugement de valeur sur) évoque ces mécanismes complémentaires (la louange et le blâme). Ainsi la notion indo-européenne de *nára(m) ou *nárya-´sámsa (qualification des seigneurs) est personnifiée en une entité à la fois crainte et aimée ; on en retrouve peut-être le nom dans les anthroponymes grecs comme kássandros, kassándra. On se fait une mauvaise réputation (*dus-klewes) en manquant au code d'honneur de la communauté ou à l'un des devoirs de sa condition » (8).
Les idéaux, les valeurs qui permettent la sélection, l'orientation, la fixation d'un idéal type, celui d'un homme qui tient son “honneur”, sont codifiés par la tradition, ensemble des formules et des schèmes notionnels transmis intangiblement (et considérés comme vrais parce que d'origine divine), qui sous-tendent les mythes, les épopées, l'onomastique, etc… (9). La qualité d'“aristocrate”, si elle est favorisée par une bonne naissance, n'en est pas moins soumise à un jugement de valeur communautaire, celui du code social lui-même, et tout manquement à ce code signe le déclassement du fautif : si les dirigeants ont des privilèges, ils ont de lourds devoirs, ressorts de la fatalité historique.
À Rome, une même exigence se retrouve dans le cursus honorum et les distinctions de la titulature, amplissimus, cum primis honestus, bonus, infimo loco (10). Chez les Celtes, c'est la distinction irlandaise entre les dee (dieux) et les andee (non dieux), ces derniers étant les cultivateurs, les premiers tous les possesseurs d'un “art”.
Dans tous les cas, l'homme bien doué par la nature ou les dieux chargés de la distribution des dons (nordique gaefumadhr) doit en faire la preuve et les mettre au service de son lignage et donc de son clan.
Lorsque l'homme d'exception, dont le type “littéraire” le plus connu est le héros homérique, vient à succomber sous les coups des hommes, des dieux, ou de quelque alliance des deux voulue par le destin, le drame prend des proportions démesurées et dévoile brutalement le tragique de la “valeur mortelle”. Ainsi dans le récit irlandais de La Mort tragique des Enfants de Tuireann, le vieux père qui se lamente sur la mort héroïque mais injuste de ses 3 fils laisse échapper cette plainte : « le pire est qu'ils n'aient pas d'égaux vivants ». Même personnelle, la douleur humaine ne prend tout son sens que par le drame plus général dont elle participe : le drame de la qualité, l'atteinte irréparable faite à “ce qu'il y a de meilleur” dans l'humanité.
♦ 1.3. Hommes qualifiés et hommes du commun
 Une dualité remontant à la période commune, celle des Indo-Européens indivis, est celle des hommes supérieurs par leur qualification, les *neres, et des hommes du commun, les *wiro–. Les premiers sont associés au sacré, les seconds au bétail. À Rome, le patriciat était détenteur des sacra face à la plèbe occupée à la troisième fonction. On se souviendra utilement que le chef de famille était à l'origine le maître du sacrifice (essentiellement familial). Remarquable est cependant la mobilité sociale des sociétés indo-européennes historiques : faible importance de l'esclavage en dehors de la Méditerranée, importance à Rome des homines noui, selon le mérite : « les Romains de la fin de la République sont persuadés de l'existence dès l'époque royale, d'une hiérarchisation fondée sur les qualités. Tite-Live prête à Tanaquil l'idée que Rome est le lieu où la noblesse et le premier rang sont promis forti ac strenuo viro (…) Tant et si bien que l'histoire de Rome apporte toujours en première ligne des individualités nouvelles : patriciens d'abords, plébéiens ensuite, alienigenas méritants même sont succesivement et progressivement amenés à jouer les premiers rôles » (11).
Une dualité remontant à la période commune, celle des Indo-Européens indivis, est celle des hommes supérieurs par leur qualification, les *neres, et des hommes du commun, les *wiro–. Les premiers sont associés au sacré, les seconds au bétail. À Rome, le patriciat était détenteur des sacra face à la plèbe occupée à la troisième fonction. On se souviendra utilement que le chef de famille était à l'origine le maître du sacrifice (essentiellement familial). Remarquable est cependant la mobilité sociale des sociétés indo-européennes historiques : faible importance de l'esclavage en dehors de la Méditerranée, importance à Rome des homines noui, selon le mérite : « les Romains de la fin de la République sont persuadés de l'existence dès l'époque royale, d'une hiérarchisation fondée sur les qualités. Tite-Live prête à Tanaquil l'idée que Rome est le lieu où la noblesse et le premier rang sont promis forti ac strenuo viro (…) Tant et si bien que l'histoire de Rome apporte toujours en première ligne des individualités nouvelles : patriciens d'abords, plébéiens ensuite, alienigenas méritants même sont succesivement et progressivement amenés à jouer les premiers rôles » (11).
Il s'ensuit que les distinctions sociales sont marquées. Elles se fondaient à l'origine sur l'exercice de la puissance et la capacité de faire durer le groupe clanique dans les vicissitudes de l'histoire. Dans les sociétés historiques, elle s'exprime par un compromis entre la nécessaire stabilité (conservatrice) et l'appétit des nouvelles élites (dynamique). Dans tous les cas, la renommée, la gloire, la bonne réputation, héritage d'une civilisation sans écriture et d'une “shame culture” proto-historique, restent le moteur de la sélection. Significativement, le “prix de l'honneur” est en celtique brittonique l'enebwerth, le “prix du visage”, un visage qu'une satire bien décochée peut à tout jamais flétrir.
♦ 1.4. Justification des hiérarchies : l'aristocratie comme principe “diurne”
Une chose est de constater l'existence d'individus mieux doués que les autres (dans un système donné, selon des critères donnés), une autre de l'expliquer. Dans leur plus ancienne religion, les Indo-Européens ont mis en rapport les comportements, les domaines éthiques avec des couleurs symboliques issues de la cosmologie. Ce rapport a été récemment souligné par le Pr. Jean Haudry dans un série d'études relatives à la cosmologie reconstruite (12). Il sert en quelque sorte de “justification” naturelle et supra-humaine au “principe d'aristocratie”.
Selon la plus ancienne cosmologie indo-européenne, reconstruite, 3 cieux tournent autour de la terre. Un ciel diurne blanc (*dyew), un ciel auroral et crépusculaire rouge (régwos) et un ciel nocturne noir (*ne / okwt). De ces 3 cieux viennent les “trois couleurs” cosmiques :
« Qu'il s'agisse du monde, de la société ou de l'être individuel, nous trouvons invariablement, à la base de la conception indo-européenne, une triade de couleurs : le blanc, le rouge et le noir. Pour l'être individuel, on parle de 3 “qualités”, de 3 “principes spirituels” : les Indiens disent “trois fils” (guna) mais à chacun de ces “fils” est attachée une couleur : le sattva (bonté) est un principe luminueux, blanc éclatant ; le rajas (ardeur, passion) est un principe rouge ; le tamas (inertie spirituelle) est un principe noir, la “ténèbre”. Pour la société, on parle de 3 “fonctions” à la suite de G. Dumézil, qui a jadis postulé imprudemment 3 “classes sociales” correspondantes, comme si la vision du monde était nécessairement le reflet de la réalité sociale. En fait, comme l'indiquent le terme indien de varna et le terme avestique de pistra [groupe social] — désignant les 3 castes aryennes —, ces castes sont fondamentalement des “couleurs” » (13).
En chacun se mêlent plus ou moins heureusement ces 3 composantes. Dans le Chant de Rígr de l'Edda, Noble est blond, pâle, Karl (Paysan libre) est roux et Thraell (Serviteur) a la peau sombre. Diverses valeurs, des éthiques et des devoirs différents traduisent ces différences de participation aux 3 couleurs cosmiques (qui se retrouvent aussi chez les héroïnes “aurorales” de nos contes populaires). D'autres faits (14) confirment que “l'allure” est une caractéristique du rang social. De fait, dans toutes les provinces du monde indo-européen, l'opposition des castes ou des classes est d'abord celle des caractères. Ainsi s'expliquent toutes ces légendes de fils de rois ou de nobles élevés modestement, loin de leur milieu d'origine, mais qui parvenus à l'adolescence font la preuve de leurs vertus intrinsèques : ce qui est “par nature” ne peut se cacher longtemps. La racine *men ne désigne pas particulièrement les activités de l'intellect, mais s'applique à la puissance de la vie psychique traduite en actes, d'où l'équivalence grecque ieron ménos Alkinóoio = Alkinoos lui-même. Celui qui possède cette ardeur, cette force, est dit avoir “le caractère d'un seigneur” (*nr-menes–).
De tout cela se dégage une hiérarchie que l'on peut schématiser en l'ordonnant sur les 3 “domaines d'activité” reconnus par la tradition : la pensée, la parole et l'action (15) :
1. Principe clair, relatif au ciel-diurne :
- La pensée est fidèle à la tradition, droite, sans arrière-pensée, réfléchie, consciente de sa fin.
- La parole est rare, sensée, efficace, “bien ajustée” (16), parfois énigmatique (thème de la “langue des dieux”).
- L'acte est techniquement irréprochable.
2. Principe rouge, relatif au ciel-crépusculaire (et auroral) :
- L'esprit est peu réfléchi, sensible aux sollicitations, tourné vers l'acte.
- La parole, parfois imprudente, provoque l'action dont elle peut être un agent (défi héroïque).
- L'action est la raison d'être de l'individu.
3. Principe noir, relatif au ciel-nocturne dans son aspect négatif :
- L'esprit est vide, irréfléchi, lent.
- La parole est pauvre ou se réduit à un vain bavardage.
- L'action est tout entière dans l'obéissance, dépourvue d'initiative personnelle.
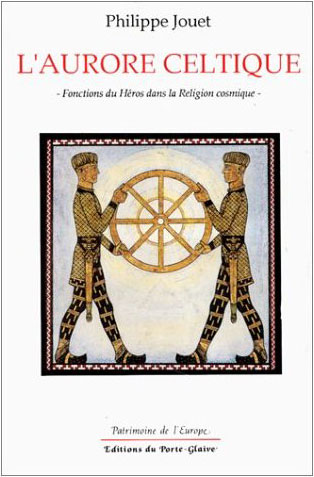 Ce tableau ne se confond pas avec celui de la “tripartition fonctionnelle” dégagée par G. Dumézil, pas plus qu'avec le système quadriparti indien (3 castes aryennes, qui sacrifient, + les śūdra). Le type supérieur qui tend vers la clarté diurne est ici celui de l'aristocratie guerrière détentrice des sacra (l'invention d'une classe sacerdotale peut être récente chez les Indo-Européens. Quoi qu'en aient dit certains auteurs, les druides celtiques ne sont que les auxiliaires de la royauté sacrée [17]). C'est à cette aristocratie que se rapportent les qualités diurnes : la perfection technique du dire et du faire, le physique irréprochable, qui signalent aux yeux de tous l'être “porteur du vrai”, celui qui rayonne de la puissance magique de ce qui est “bien ajusté”.
Ce tableau ne se confond pas avec celui de la “tripartition fonctionnelle” dégagée par G. Dumézil, pas plus qu'avec le système quadriparti indien (3 castes aryennes, qui sacrifient, + les śūdra). Le type supérieur qui tend vers la clarté diurne est ici celui de l'aristocratie guerrière détentrice des sacra (l'invention d'une classe sacerdotale peut être récente chez les Indo-Européens. Quoi qu'en aient dit certains auteurs, les druides celtiques ne sont que les auxiliaires de la royauté sacrée [17]). C'est à cette aristocratie que se rapportent les qualités diurnes : la perfection technique du dire et du faire, le physique irréprochable, qui signalent aux yeux de tous l'être “porteur du vrai”, celui qui rayonne de la puissance magique de ce qui est “bien ajusté”.
Il est facile de retrouver dans les protagonistes du mythe et de l'épopée la mise en œuvre de ces principes d'organisation. La classe aristocratique, en dépit de son endogamie protectrice et de son système d'éducation par fosterage, garant de ses alliances et de son homogénéité (d'où le sens de Germ. Edel et d'Irl. aite), n'apparaît pas figée une fois pour toutes, mais soumise elle aussi aux exigences du renouvellement comme au principe de “décadence”.
Elle est d'abord, ou se doit d'être, une réalité constatée et estimée pour les services qu'elle peut rendre. Estimée d'abord par les chefs eux-mêmes, dépositaires de la tradition, et exaltée par les poètes gardiens de la mémoire nationale, mais aussi par la communauté des hommes libres. La conciliation des 3 ordres de comportements, des 3 natures de l'être individuel, leur mise en harmonie, leur “attelage” se manifestent dans un personnage supérieur, le roi, incarnation de son peuple. Position risquée, car le roi, qui par son nom di-rige, est le premier responsable de l'ordre cosmique. De fait, une disette, une atteinte naturelle au bien-être de la communauté, la défaveur des dieux, sont souvent interprétées comme un affaiblissement du charisme royal, de son efficacité mystique, d'où la “mort sacrificielle du roi” celtique, si bien commentée par Mme Clémence Ramnoux (18).
♦ 1.5. La décadence
La décadence est causée par l'éloignement du principe diurne, dans l'ordre biologique, politique, moral. Chacun connaît la doctrine hésiodique des Âges du Monde et la conception indienne des Âges, le dernier étant le kali-yuga [âge de discorde], dominé par le principe noir. Pour Platon (République 547 ss.) on passe de la “timocratie” (gouvernement de l'honneur) aristocratique à l'oligarchie ploutocratique, puis à la démocratie. L'anarchie engendre ensuite la tyrannie. La disparition, la perversion de l'aristocratie marque donc la dégradation des principes de “l'Âge d'or”. En outre, la décadence est liée au devenir cosmique : ce qui s'efface dans tous les ordres, c'est la capacité à reconnaître la supériorité du principe diurne (19).
♦ 1.6. Idéaltype hérité
“L'aristocratie” indo-européenne est, pour autant qu'on se la puisse représenter, un idéal éthique, esthétique, moral, qui se retrouve à l'époque historique dans les littératures européennes qui ont hérité de la communauté originelle le fonds et souvent la forme de leurs constructions.
Mais cet “idéal” contraignant résulte bien d'un choix initial, probablement issu d'une sélection culturelle et biologique, celle qui a donné naissance, à partir d'un fond commun prénéolithique, à un peuple particulier qui en a été le propagateur. Il est permis de penser que la communauté indo-européenne indivise représente assez largement ce type moral (psychique, physique).
◘ 2. Aristocratie et forme sociale
 L'aristocratie est donc au mieux la partie “active” et “rayonnante” du peuple. Au pire, lorsque les liens sociaux sont distendus et que le sentiment de la solidarité sociale se défait, elle peut devenir une caste parasitaire, ressentie comme telle, et combattue en conséquence par un peuple qui la considère comme un “corps étranger” (ce fut le sort des aristocrates “usés” de l'Ancien Régime français).
L'aristocratie est donc au mieux la partie “active” et “rayonnante” du peuple. Au pire, lorsque les liens sociaux sont distendus et que le sentiment de la solidarité sociale se défait, elle peut devenir une caste parasitaire, ressentie comme telle, et combattue en conséquence par un peuple qui la considère comme un “corps étranger” (ce fut le sort des aristocrates “usés” de l'Ancien Régime français).
Dans les sociétés de l'Europe préchrétienne, les devoirs des différentes “fonctions” reflètent la grande variété de “l'excellence” sociale. De même, le charisme solaire nommé xvar°nah– dans l'Avesta est triple : il y a celui des prêtres, celui des guerriers, celui des éleveurs, et c'est la perte de ces 3 charismes qui entraîne la décadence du royaume de Yima.
♦ 2.1. Aristocratie / Peuple
À dire vrai, l'“aristocratie” est ce qui porte à leur perfection les qualités latentes dans l'ensemble du corps social (la*teuta). Elles sont donc l'expression d'une qualification globale, celle qui relie tous les membres de la nation, quelle que soit par ailleurs leur activité sociale. Il n'est d'aristocratie que par rapport à un ensemble qui lui donne son sens. La stérile dialectique de “l'élite” et de la “masse”, qui a pris une si grande ampleur dans la pensée française (conséquence des difficultés identitaires de la “nation française” elle-même), relève d'une conception viciée du corps social. Trop souvent on définit l'élite (ce qui est “hors du rang”) contre le peuple, alors que l'aristocratie, conformément à l'étymologie, devrait être le “meilleur du peuple” dans l'exercice de son “pouvoir” formateur (kratos). Comme telle il s'agit d'un faisceau de qualités, d'une veine qui peut être recouverte par d'autres courants, d'autres représentations, d'autres “aristocraties”, autres par leur éthique, leur système de pensée, leur “outillage mental” et parfois mais pas nécessairement leur origine ethnique.
♦ 2.2. Finalité de l'aristocratie ?
Le conflit des peuples, des classes, des idées, tout cela se recoupant de toutes les façons, est toujours, en dernière analyse, une lutte destinée à établir une aristocratie destinée à servir de modèle social et devant tôt ou tard conformer à son image les groupes dirigés, ses tributaires. Les grands systèmes égalitaires n'échappent pas à ce schéma : Prophètes, dirigeants politiques, “fondateurs” de millénarismes, il y a toujours un groupe “en avance”. La supériorité spatiale des anciennes élites s'est simplement transformée en supériorité temporelle : C'est la logique des “avant-gardes”.
C'est précisément la nature égalitaire ou inégalitaire de l'idéologie dominante qui fonde la raison d'être de l'aristocratie, sa finalité. Le contraste entre les sociétés égalitaires qui imposent à tous un stéréotype d'humanité, et les sociétés différentialistes de type holiste qui tolèrent et requièrent le jeu de plusieurs idéaltypes à l'intérieur de la même “vue-du-monde” (type des “trois fonctions”) se traduit dans l'appréhension même du temps et du devenir. Alors que les premières sont généralement progressistes et entendent trouver la fin de l'espèce dans la fin de l'histoire, les secondes, sensibles à la notion cyclique de décadence, recherchent leur fin dans une réalisation historique vouée à de perpétuelles métamorphoses. Pour elles, la fin de l'humanité ne se trouve pas dans un au-delà inaccessible, mais dans la difficile réalisation d'un idéal humain tenu pour supérieur (i.e. aristocratique). Un tel idéal est par nature soumis à l'usure du temps, il n'est jamais “achevé”, il doit donc toujours être “construit”. C'est pourquoi l'appel aux forces divines et les qualités supra-humaines du héros sont fréquemment exposés sur le mode tragique dans les mythes et les épopées de l'Europe antique : réduit à lui-même, privé du secours de ses dieux, l'individu ne pourrait se hausser jusqu'à la surnature que sa tradition nationale lui fait un devoir d'atteindre. Mais l'humanité “ordinaire” n'est pas tenue à une telle “héroïsation”, qui reste exceptionnelle. On sait qu'elle a, par nature, d'autres préoccupations.
◘ 3. Recours à la tradition ?
 Il n'est pas illégitime de s'interroger sur le sens que peut garder aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, ce que nous pouvons atteindre de la “tradition indo-européenne”. On peut le faire, conscient qu'une tradition ne s'efface jamais tout à fait pour peu qu'elle soit transmise, (et à la condition de ne pas se laisser enfermer dans la systématique du “traditionnalisme” intégral et universel d'un René Guénon ou d'un A.K. Coomaraswamy). On constatera qu'à l'évidence, les fins de la société occidentale sont fort peu compatibles avec les “valeurs héritées”. Cas de figure expressément prévu par la tradition elle-même, sous les vocables d'“âge noir”, d'“âge de fer” ou de “mauvais temps” (olc aimser irlandais de la Prédiction de la Bodb), d'ailleurs équilibré par la croyance, elle aussi cyclique, au retour progressif de “l'âge d'or” (20).
Il n'est pas illégitime de s'interroger sur le sens que peut garder aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, ce que nous pouvons atteindre de la “tradition indo-européenne”. On peut le faire, conscient qu'une tradition ne s'efface jamais tout à fait pour peu qu'elle soit transmise, (et à la condition de ne pas se laisser enfermer dans la systématique du “traditionnalisme” intégral et universel d'un René Guénon ou d'un A.K. Coomaraswamy). On constatera qu'à l'évidence, les fins de la société occidentale sont fort peu compatibles avec les “valeurs héritées”. Cas de figure expressément prévu par la tradition elle-même, sous les vocables d'“âge noir”, d'“âge de fer” ou de “mauvais temps” (olc aimser irlandais de la Prédiction de la Bodb), d'ailleurs équilibré par la croyance, elle aussi cyclique, au retour progressif de “l'âge d'or” (20).
Mais enfin, les questions fondamentales auxquelles toute tradition se veut une réponse — à cet égard, l'humanité n'est qu'un concert d'imprécations —, n'ont pas changé : quelle configuration donner à la cité ? Quelles limites dessiner ? Quels interdits formuler ? À qui attribuer le titre de bonus vir, de vir integer ? Par quoi définir le sens d'un “bien”, qui doit être aussi celui d'un “mal” ? Et, dans ce cas, quelles définitions donner d'une éventuelle “aristocratie” ? À cela, quelques remarques et 2 textes anciens serviront non de “réponse” (il n'y a pas de réponse à ces questions) mais d'accompagnement :
• a) Si “l'aristocratie” est le “gouvernement des meilleurs”, on se souviendra qu'aristos est utilisé comme superlatif d'agathos (bon). L'aristos n'est qu'une concentration exceptionnelle de “ce qui est bon”. Les aristoi sont les individus qui manifestent avec le plus de force ce “bien” qui donne à leur cité force et éclat. Le “gouvernement” des meilleurs révèle en fait, qu'il se traduise ou non en institutions politiques, la puissance d'attraction de “ce qu'il y a de meilleur dans le peuple”. En ce sens, la reconnaissance d'une aristocratie est intimement liée à la conscience du bien commun.
• b) Considérée non comme une caste mais comme un principe de vie, l'aristocratie échappe à la définition sommaire. Chaque fonction a son idéal, chaque ordre a ses aspirations. Mais la figure de l'aristocrate, échappant aux catégorismes étroits, surmonte l'histoire et lui survit comme un regret, un sarcasme ou une menace.
• c) L'aristocrate n'est donc pas nécessairement celui qui dit les valeurs, les décrit, les représente ; ce n'est pas celui qui les explique, c'est celui qui les incarne.
• d) C'est par l'aristocratie que le peuple a connu ses dieux et s'est constitué en puissance. L'aristocratie est ainsi la face claire du peuple, ce qui lui donne son immortalité et sa mémoire, lui rappelle son origine, lui dicte ses espérances.
• e) L'acte aristocratique par excellence est donc celui qui étend au sein du peuple le pouvoir du bien, tel que le définit la tradition, dans son vocabulaire, ses mythes, ses exempla.
Mot usé et galvaudé, lié à des moments parfois bien douteux de l'histoire, et généralement manié à tort et à travers, sans doute vaut-il mieux réduire l'usage argumentaire de l'“aristocratie” et de son “aristocratie”. Chacun peut se passer du mot. Mais chacun peut aussi entretenir en lui la part de bien qui lui est fixée, et veiller à protéger, à garantir, à étendre au sein du peuple la part divine qui le rendra meilleur (21). C'est cela qui est indispensable.
Est-il tellement vain ou audacieux de penser que l'Aristocratie, c'est notre peuple quand nous l'aurons rappelé à l'existence ?
◘ 4. Deux textes pour s'éclairer
Pour comprendre et méditer, rien de mieux qu'un recours à notre mémoire la plus ancienne. Voici un passage de l'Avesta iranien qui nous dévoile la sollicitude du “Seigneur sage” pour ses créatures menacées par l'arrivée du grand hiver cosmique. (Zend–Avesta, Vendidad, fargard 2, traduction Darmesteter, Paris 1892, p.20 ss.).
Ahura-Mazda dit à Yíma fils de Vîvanhat (§ 22 ss.) :
« Voici que sur le monde des corps vont fondre les hivers de malheur, apportant le froid dur et destructeur. (…) Et tout ce qu'il y a d'animaux dans les lieux les plus désolés et sur le sommet des montagnes et dans les profondeurs des campagnes se réfugiera de ces trois lieux dans des abris souterrains (…). Fais-toi donc un var (abri) long d'une course de cheval sur chacun des quatre côtés. Porte là les germes du petit bétail et du gros bétail, et des hommes, et des chiens, des oiseaux, et des feux rouges et brûlants (…) (§ 27). Tu apporteras là des germes d'homme et de femme, les plus grands, les meilleurs, les plus beaux, qui soient sur cette terre (…) (§ 28) (…). Et ces germes, tu les mettras là par couples pour y rester sans périr, aussi longtemps que ces hommes resteront dans les vars (§ 29). Il n'y aura là ni difforme par devant ni difforme par derrière, ni impuissant, ni égaré ; ni méchant, ni trompeur ; ni rancunier, ni jaloux ; ni homme aux dents mal faites, ni lépreux qu'il faut isoler ; ni aucun des signes dont añgra Mainyu (le mauvais esprit) marque le corps des mortels » (§ 39). « Quelles sont les lumières, ô saint Ahura-Mazda, qui éclairent dans le var qu'a fait Yíma ? » (§ 40). « Ahura-Mazda répondit : “les lumières faites d'elles-mêmes et des lumières faites dans le monde. La seule chose qui manque là, c'est la vue des étoiles, de la lune et du soleil et une année ne semble qu'un jour”. (§ 41) (…) et ces hommes vivent de la plus belle des vies dans le var fait par Yíma ».
Et un passage triparti de la Grèce ancienne : Tyrtée, fragment 12 :
« Je ne songe pas — dit Tyrtée — à louer un homme parce qu'il court vite et qu'il est bon lutteur, ni s'il a la taille et la force de Cyclones, ni s'il vainc Borée à la course, ni s'il est plus beau que Tithonos, plus riche que Midas, que Cinyras, ni s'il est roi plus que Pélops, plus éloquent qu'Adraste, ni s'il se targue de quelque gloire que ce soit, en dehors du courage. Tenir bon dans la bataille, au moment où l'ennemi serre de près, c'est cela, la valeur, et cette louange-là, plus belle que toute autre, est celle qu'un jeune homme doit souhaiter ». Cité par M. Delcourt, Légendes et cultes de héros en Grèce, PUF, 1942, p. 74.
► Philippe Jouët, Orientations n°13, 1991.
♣ L'auteur : Historien des religions, diplômé docteur de l'École pratique des Hautes Études. Il a collaboré aux travaux de l'Institut d'études indo-européennes de Lyon III. Il a consacré plusieurs études au monde celtique dont certaines dans divers ouvrages collectifs : Dictionnaire de la mythologie celtique (J. Picollec, 2004), Atlas historique des pays et terroirs de Bretagne (Skol Vreizh, 2007).
♣ Bibliographie :
- Chez Archè (Milan) : Religion et mythologie des Baltes : une tradition indo-européenne (1989) [compte-rendu de B. Sergent – polémique sur cet élève d'Haudry – in : A.E.S.C. n°1/1992, vol. 47]
- Chez Label LN : Études de symbolique celtique : Rythmes et nombres (2012)
- Chez Yoran Embanner (Fouesnant) : Aux sources de la mythologie celtique (2007) ; L’Aurore celtique dans la mythologie, l'épopée et les traditions (2006) ; L'Europe aux mille blasons (2011).
♣ Notes :
- Dauzat, Dubois, Mitterand, Dict. étym. de la langue fr., Paris, 1971.
- É. Benveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, I, Minuit, 1969, p. 367 s., G. Dumézil, « L'arî et les Aryas » in Les Dieux souverains des Indo-Européens, Gal., 1977, p. 233-251.
- Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, 1937, p. 47.
- J. Haudry, Les Indo-Européens, PUF/QSJ, p.15.
- Kuhn, in K. Zeitschrift, 2, p. 467 ; relevée dans Schmitt, Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit.
- C.C. Zimmerman, in J. Haudry, op. cit., p. 32.
- op. cit., I, p. 321 s.
- Haudry, op. cit., p. 17.
- On trouvera une excellente définition de la “tradition indo-européenne” dans le n° 21 de la revue Études Indo-Européennes (Institut d'études indo-européennes de l'Université de Lyon III). Ici abrégé EIE [parue de 1981 à 2001].
- Guy Achard, « La société romaine à la fin de la République, une société de classes ? », EIE 15, p. 33-42.
- G. Achard, loc. cit., p. 40-41.
- L'Information grammaticale n°29, p. 3-11, « La tradition indo-européenne au regard de la linguistique », La Religion cosmique des Indo-Européens, Archè / Belles Lettres, 1987.
- Haudry, art. cit., p. 5-6.
- Dans EIE 15, p. 43-50. Une étymologie nouvellement proposée interprète par 3 verbes de mouvement les noms des 3 classes de la société germanique : °erla d'une racine signifiant “s'élever”, le nom de l'Homme libre de °ger- (se mouvoir), le nom du Serviteur de °trek- (courir, se hâter), donc 3 manières de se déplacer, perçues différentiellement.
- Schème notionnel indo-européen. Voir B. Schlerath, Gedanke, Wort und Werk im Veda und im Awesta, in Antiquitates Indogermanicas, Gedenkschrift für H. Güntert, Innsbruck, 1974. Nouvelles attestations dans EIE 9, p. 36.
- Lalies, 2, revue, Paris, 1981.
- Cf. P. Jouët, L'Aurore celtique : Fonctions du héros dans la religion cosmique, Porte-Glaive, 1993.
- Dans une série d'études remarquables récemment rééditées : Le Grand Roi d'Irlande, éd. L'Aphélie, Perpignan, 1989.
- La notion de décadence a été récemment revisitée par J. Haudry, EIE 1990, p. 99 s. Il semble bien qu'initialement une phase “ascendante” répondait à la phase “descendante” des cycles ; cette phase de “progrès” comportait elle-même plusieurs “âges”.
- Voir la note précédente et les considérations relatives au “roi caché du monde à venir” dans Haudry, Religion cosmique.
- Lire P. Simon, « Le sacré : unité du monde et destin du peuple », in Nouvelle École n° 37. [Voir ci-dessous]

Pièces complémentaires
Le sacré : Unité du monde et destin du peuple
 Le problème posé ici est le suivant : que peut signifier la locution « unité du monde », que certains ont déjà élevée au rang de concept fondamental (1) et dans laquelle, apparemment, se trouve beaucoup plus qu'un antidote au dualisme métaphysique et chrétien ? En d'autres termes : comment penser “l'unité du monde” ? Pour répondre à cette question, considérons d'abord la formule grecque panta : en, « tout : un ». C'est, pourrait-on dire, sur ces simples mots d'Héraclite d'Éphèse que s'ouvre la pensée européenne. Toute sa vie, Heidegger n'a cessé de “tourner” autour d'eux en s'en rapprochant. « Tout : un » : que peut vouloir dire cela ?
Le problème posé ici est le suivant : que peut signifier la locution « unité du monde », que certains ont déjà élevée au rang de concept fondamental (1) et dans laquelle, apparemment, se trouve beaucoup plus qu'un antidote au dualisme métaphysique et chrétien ? En d'autres termes : comment penser “l'unité du monde” ? Pour répondre à cette question, considérons d'abord la formule grecque panta : en, « tout : un ». C'est, pourrait-on dire, sur ces simples mots d'Héraclite d'Éphèse que s'ouvre la pensée européenne. Toute sa vie, Heidegger n'a cessé de “tourner” autour d'eux en s'en rapprochant. « Tout : un » : que peut vouloir dire cela ?
“Tout” est la multiplicité changeante de ce qui est, c'est-à-dire de ce qui se manifeste, se présente à nous : tout ce qui change et devient, tout ce qui coule. Panta rhei, « tout coule », dit une autre maxime d'Héraclite. Tout coule, et pourtant tout est un. Comment ce qui constitue la multiplicité même peut-il être “un” ? Qu'est-ce que cette unité du divers ? “Unité” signifie-t-il ici “totalité”, “globalité” ? Est-il ici seulement question de cette évidence ensembliste qui veut que chaque chose soit un élément de l'ensemble de toutes les choses, contribue à l'unicité de cet ensemble ? Certes non. Panta : En pourrait également s'énoncer : chaque étant : un. La question qui surgit alors est : comment ce qui à chaque instant se manifeste comme pluralité peut-il être un ?
L'unité, par ailleurs, ne saurait être conçue en tant que “principe unifiant”, causal ou non. Une telle conception resterait enfermée dans le dualisme métaphysique, auquel d'ailleurs elle s'apparente, puisqu'elle ne permettrait jamais de résoudre la dualité de l'étant et du principe. La réponse souvent invoquée par la théologie chrétienne, qui postule l'unité du monde en Dieu, n'est en rien satisfaisante, dans la mesure où elle ne produit qu'une pseudounité surajoutée à la dualité fondamentale du monde et de Dieu.
En fait, si nous voulons véritablement saisir ce que contient le panta : en héraclitéen, il nous est demandé, autant que possible, de sortir du “règne” de l'essence platonicienne, de l'essence comme principe ultime constituant le “soi” de chaque étant. Une telle conception des essences fondatrices accessibles à la ratio pèse, on le sait, sur la plupart des modes explicatifs en usage aujourd'hui. Cependant, elle ne va pas “de soi” : elle n'est venue qu'après la pensée présocratique (qui, à l'exception du poème de Parménide, nous est parvenue sous forme de fragments) et avant celle de Heidegger, qui s'est d'ailleurs constamment appuyée sur la précédente.
Mais revenons-en au “paradoxe” évoqué plus haut : panta : en / panta rhei. On interprète souvent maladroitement l'image héraclitéenne du fleuve. « On ne se baigne jamais deux fois dans la même eau (du fleuve) », dit en substance Héraclite. On en déduit que le fleuve n'est qu'en tant que devenir — en se gardant bien de se demander ce que peut signifier ce “devenir” —, et l'on conclut que, hors du devenir, il n'y a rien (à penser). On passe alors à côté de ce que voulait dire Héraclite, et à côté de ce qui, dans ce “devenir”, se présente comme question.
Tout dans le fleuve est courant, changement, devenir. Mais qu'est-ce qui fonde ce devenir comme devenir-du-fleuve, et, plus précisément, devenir-de-ce-fleuve-ci ? Autre formulation (qui est plus qu'une boutade) : si le fleuve est devenir, il faut bien qu'il soit. De fait, pour que soit pensable le devenir du fleuve, il faut qu'une entité rassemble en soi ce devenir, ou plutôt (pour éviter de penser à une entité “agissante”) que ce devenir se rassemble en une entité : on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, mais cette eau qui coule est toujours celle du fleuve. Le fond de l'image du fleuve réside en ceci que le devenir voile ce qui est, dirons-nous par approximation, sa condition essentielle de possibilité : l'unité, celle-là même en laquelle sont assemblées les diverses et changeantes apparences (c'est-à-dire : manifestations de la présence) de l'étant.
Cette unité où sont assemblés les divers modes de l'apparaître d'un étant, Heidegger la nomme Wesen. Ce mot est généralement traduit par “essence”. (Il n'est d'ailleurs pas une des nombreuses inventions terminologiques de Heidegger, mais appartient à la langue philosophique allemande, qui l'utilisa pour rendre le latin essentia). Il ne faut pas oublier néanmoins toute la distance qui sépare ce Wesen de l'essence platonicienne. Osons une définition : Wesen (“essence d'un étant”), “unité rassemblante de ses modes de présence (de ses manifestations phénoménales)”. Être veut alors dire “déployer” son essence, apparaître de manière multiple, changeante, ambiguë, dans (et à partir de) l'unité de son essence. Il apparaît alors clairement que l'essence-unité rassemblante n'est “extérieure” ni à l'étant ni au temps, qu'elle n'induit aucune coupure entre un monde dit “sensible” et un monde dit “intelligible”. L'essence étant unité rassemblante des apparences, elle ne saurait être “au-delà” de ces apparences. Ne pouvant être pensée hors de son “déploiement” en présence, hors de son surgissement en un devenir, elle ne saurait non plus être “au-delà” du temps.
les messagers de la “divinité”
 Loin d'induire une coupure entre le “sensible” et “l'intelligible”, la notion heideggérienne de Wesen réduit celle-ci à néant. L'essence se manifeste en présence ; elle n'est pas accessible hors de cette manifestation. Les présocratiques, d'ailleurs, étaient incapables de concevoir la moindre distinction entre le sensible et l'intelligible pour la simple raison que, pour eux, le penser et le sentir n'étaient que des modes d'un même “faire face à la présence”. En allemand, “briller” et “apparaître” se disent tous deux scheinen. L'éclat, la lueur, l'apparence : der Schein. Paraître, c'est briller, laisser se déployer la totalité des signes de soi. Être et (ap)paraître ne sont donc nullement antinomiques. Être, c'“est” paraître, tout comme pour le soleil, être, c'“est” briller. Panta : en signifierait alors d'abord ceci : la pluralité des phénomènes est toujours rassemblée dans l'unité d'une essence (Wesen). La coupure entre “l'intelligible” et le “sensible” n'est qu'un sous-produit de la pensée socrato-platonicienne.
Loin d'induire une coupure entre le “sensible” et “l'intelligible”, la notion heideggérienne de Wesen réduit celle-ci à néant. L'essence se manifeste en présence ; elle n'est pas accessible hors de cette manifestation. Les présocratiques, d'ailleurs, étaient incapables de concevoir la moindre distinction entre le sensible et l'intelligible pour la simple raison que, pour eux, le penser et le sentir n'étaient que des modes d'un même “faire face à la présence”. En allemand, “briller” et “apparaître” se disent tous deux scheinen. L'éclat, la lueur, l'apparence : der Schein. Paraître, c'est briller, laisser se déployer la totalité des signes de soi. Être et (ap)paraître ne sont donc nullement antinomiques. Être, c'“est” paraître, tout comme pour le soleil, être, c'“est” briller. Panta : en signifierait alors d'abord ceci : la pluralité des phénomènes est toujours rassemblée dans l'unité d'une essence (Wesen). La coupure entre “l'intelligible” et le “sensible” n'est qu'un sous-produit de la pensée socrato-platonicienne.
Il vaut la peine d'insister. L'essence (Wesen) n'“est” aucun principe, ni actif (l'unité est toujours, pourrait-on dire, intrinsèque et implicite) ni explicatif (expliquer est toujours re-présenter ; or, par l'unité, on ne re-présente rien, et l'unité elle-même est sans doute absolument non re-présentable). Heidegger a parfois utilisé l'image de la coupe pour faire sentir que cette unité n'“est” pas un lien, causal ou non, qui unirait en interdisant on ne sait quel éparpillement. Bien au contraire, il faut s'exercer à penser la coupe comme recueillant en elle la multiplicité, tout en n'étant pas “extérieure” au recueillement. (La coupe du Wesen est à la fois “recueillante” et “recueillement”).
Heidegger parlait des dieux (die Götter) en les appelant « les divins » (die göttlichen). Il voyait en eux les messagers de la « divinité » (die Gottheit). Maître Eckart, Angelus Silesius et d'autres ont aussi parlé de Gott ou de Gottheit en termes d'unité, de consubstantialité, de co-propriation. En fait, Gottheit ne signifie rien d'autre que cette « unité du monde » au sein de l'unité-recueillante que nous venons d'évoquer. Qu'est-ce alors que le sacré ? Il est le dévoilement de cette unité, et l'homme, en tant que faisant — face-à-l'étant (Da-sein), en est le dépositaire.
Essayons maintenant d'approcher l'unité-recueillante du monde en certains de ses modes de dévoilement. L'un des modes les plus importants est constitué par le peuple (das Volk). Qu'est-ce qu'un peuple ? Ce n'est ni une somme d'individus ni une structure évoluant dans un temps linéaire. Un peuple est une entité qui rassemble les ancêtres, c'est-à-dire le passé-origine surgissant dans l'immédiat d'une présence-au-monde, les présents, c'est-à-dire ceux qui vivent aujourd'hui et qui font la présence du monde, et les hommes-à-venir, notion qui représente l'anticipation dans la présence au monde d'un être-en-projet.
pas d'opposition entre le sacré et le profane
 L'unité-peuple est pour nous l'un des modes où se dévoile la Gottheit, la divinité de l'unité du monde. Nous dirons, par suite, que le sacré ne se laisse appréhender authentiquement qu'au sein d'une communauté populaire qui en constitue le « lieu de surgissement ». En ce sens, il n'y a pas de médiateur entre l'homme-d'un-peuple et la divinité ; celle-ci constitue pour lui le plus immédiat. Autrement dit, l'homme n'a accès à l'unité-du-monde qu'à partir (et dans) l'unité-du-peuple. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il n'y ait d'accès au sacré que dans la “religion collective”. Cela signifie que la personne individuelle ne peut s'ouvrir au sacré sans que l'ensemble du peuple soit “présent”, c'est-à-dire délimite le lieu de venue du sacré.
L'unité-peuple est pour nous l'un des modes où se dévoile la Gottheit, la divinité de l'unité du monde. Nous dirons, par suite, que le sacré ne se laisse appréhender authentiquement qu'au sein d'une communauté populaire qui en constitue le « lieu de surgissement ». En ce sens, il n'y a pas de médiateur entre l'homme-d'un-peuple et la divinité ; celle-ci constitue pour lui le plus immédiat. Autrement dit, l'homme n'a accès à l'unité-du-monde qu'à partir (et dans) l'unité-du-peuple. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il n'y ait d'accès au sacré que dans la “religion collective”. Cela signifie que la personne individuelle ne peut s'ouvrir au sacré sans que l'ensemble du peuple soit “présent”, c'est-à-dire délimite le lieu de venue du sacré.
Cette notion de co-propriation de l'homme authentique et de la communauté populaire dans l'unité-recueillante de l'être est à la fois très immédiate, car elle s'adresse à une sensibilité originaire, et très difficile à saisir, car elle s'exprime difficilement au travers d'un langage bâti sur l'effectivité du concept. Heidegger la développe à partir d'un certain nombre de considérations sur l'idée de monde.
Pour Heidegger, un « monde » est un « existential », autrement dit un mode d'être de l'homme historial, c'est-à-dire de l'homme en tant qu'il est engagé dans le déploiement du destin de la communauté dont il relève. Qu'est-ce à dire ? Que cet homme ne vit jamais dans un “monde” qui lui serait indifférent et pré-existant, comme une boîte contenant un objet, mais qu'à proprement parler, il fonde sans cesse le “monde” en prenant sa part du destin communautaire. Heidegger dit : der Welt ist nicht, sondern weltet (le monde n'est pas, il mondifie). Le monde mondifie : il se manifeste comme une unité rassemblant d'une manière toujours progressante l'homme d'une communauté, cette communauté elle-même, les étants qui viennent à la “rencontre” de l'homme et les modes existentiels généralement représentés comme des fonctions culturelles. Cette unité de tout ce qui est dans un monde et de ce qui le fonde (l'homme historial) constitue à nos yeux un mode de la divinité.
Un temple n'est sacré que dans la mesure où il est un lieu de co-appartenance de la communauté du peuple et des hommes de cette communauté. S'il est ainsi, ainsi est-il immédiatement perçu. Cette immédiateté est le signe de l'unité qui se manifeste dans la rencontre de l'homme et du temple, par laquelle le temple est livré à son être, et l'homme révélé au sien. Quand, au contraire, le temple devient un “médiateur” entre l'homme et le dieu, il a déjà cessé d'être sacré. (Une réflexion sur la notion d'“idole” pourrait être développée à partir de là). Que nous le voulions ou non, nous ne pourrons plus jamais voir le temple d'Apollon à Delphes ainsi que le voyait un Grec contemporain de ceux qui l'ont bâti. Pour celui-ci, la place du temple à l'intérieur de la polis allait de soi. Or, c'est précisément cet “allant de soi” qui signale l'étant mondain (la Chose) en opposition à l'étant hors-du-monde (l'Objet). On comprend, dès lors, que pour un paganisme authentique, il ne saurait y avoir de “lieux saints” en opposition à des “lieux profanes” (tout comme il ne saurait y avoir, en général, d'opposition entre le profane et le sacré). Est sacré, relève de la Gottheit, de l'Un, tout lieu “mondain”, toute chose, toute région du monde en tant que ce dernier est sans cesse fondé et soutenu par la communauté du peuple. Tacite disait à propos des Germains : « Ils nomment Dieu le secret des bois ». On pourrait traduire : « Le sacré est partout où se fonde le monde de la communauté du peuple ».
Ce qui se manifeste dans la divinité, comme l'unité du monde, se manifeste partout, mais ne s'institue nulle part comme pouvoir (2). De même, la divinité n'étant aucun principe, elle n'est source également d'aucun principe, et en particulier d'aucune morale. Plutôt que d'“homme bon”, il vaudrait donc mieux, dans la perspective où nous nous plaçons, parler d'homme “bien destiné”, au sens que Heidegger a su retrouver chez les présocratiques. L'homme bien destiné est celui qui est “tout-un” avec le destin lui-même, c'est-à-dire avec l'Un de tous les tenants du peuple.
Il ne saurait pour nous y avoir de doute sur ce point : l'homme n'existe qu'en tant qu'homme-du-peuple. Le peuple en tant qu'unité à penser ne se définit pas par l'homme. Le peuple est ce dans quoi se trouve réalisée une unité essentielle, en même temps que le mode d'approche de cette unité. Comme “lieu” (topos) de réalisation d'un passé, d'un présent et d'un “à-venir”, le peuple n'est rien qui se laisse définir par l'homme. C'est au contraire l'homme qui ne se trouve révélé comme homme que par son appartenance à un peuple. Et si l'on tient à parler de “volonté de puissance”, on doit admettre que celle-ci tient son être de l'être du peuple, et non l'inverse.
Mais qu'en est-il de l'être du peuple ? Notre formulation, loin de régler les problèmes, les fait au contraire surgir avec force. Certes, on peut conjecturer un lien fondamental avec ce que Heidegger appelle la temporalité de l'être, et qu'on peut appeler aussi tridimensionnalité du temps historique. Mais des interrogations surgissent, en particulier dès que l'on parle d'« auto-affirmation de la volonté de l'homme » ou d'« auto-affirmation de l'homme dans la volonté ».
L'image d'un homme en pamoison devant sa propre marche vers la puissance, c'est-à-dire finalement devant lui-même, est à la fois puérile et bien commune : le réalisme socialiste l'a multipliée à l'infini. Ce n'est pas sur une telle image que l'on peut fonder le sacré, bien au contraire. Le mot “auto-affirmation” signifie-t-il affirmation de l'homme en tant que “porteur d'une volonté” ? Supposons cela. Les difficultés auxquelles on se heurte sont tout de suite insurmontables. Définir l'homme comme “sujet voulant” n'est rien d'autre qu'utiliser un mode “moderne” de la définition métaphysique de l'homme comme “animal rationnel”. Déplacer le centre de gravité de la raison vers la volonté ne change rien quant au fond (surtout si l'on pense la volonté comme projection de la raison dans un univers de pensée nominaliste). L'homme comme “animal doué de volonté” reste un fantasme métaphysique. En outre, une telle définition revient à se couper définitivement l'accès au peuple en tant que phénomène fondateur, et donc, à l'essence de la volonté comme pro-venant de celle du peuple. L'homme en tant que porté-par-un-peuple ne saurait donc se définir, et encore moins s'affirmer, comme “sujet voulant”. Tout au plus peut-il interpréter la volonté comme ouverture au destin du peuple et lien à son essence. Un tel homme ne dit “je” que secondairement.
homme-du-peuple et liberté-pour fonder-un-monde
[Les métaphores heideggériennes restituent « l'appel silencieux de la terre », sol sur lequel prend pied notre liberté. Ci-dessous : gravure de Bodo Zimmermann (1902-1945)]
 Allons plus loin. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'homme comme “animal-doué-de-volonté” ressemble à s'y méprendre à l'homme du nihilisme achevé, c'est-à-dire à l'homme de la technique mondiale. En effet, l'homme du nihilisme achevé se constitue comme tel en tant que, dans son “faire”, il se reconnaît lui-même comme seule réalité. “Poétiquement”, il est cet étant solitaire à qui l'existant dans son ensemble ne renvoie plus que sa propre image, tellement vidée de substance qu'elle n'est plus qu'un leurre. Poser l'homme comme “animal voulant”, après qu'il l'eut été comme “animal rationnel”, c'est-à-dire, en fin de compte, comme individu absolu, c'est s'enfermer à terme dans cette fatalité de l'homme seul parmi ses avatars. Or, si l'essence de la technique n'est rien de technique, l'essence de l'homme n'est rien d'humain. L'homme comme “animal voulant” est précisément celui qui a perdu tout lien avec le “non-humain en l'homme”, qui a totalement oublié l'être.
Allons plus loin. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'homme comme “animal-doué-de-volonté” ressemble à s'y méprendre à l'homme du nihilisme achevé, c'est-à-dire à l'homme de la technique mondiale. En effet, l'homme du nihilisme achevé se constitue comme tel en tant que, dans son “faire”, il se reconnaît lui-même comme seule réalité. “Poétiquement”, il est cet étant solitaire à qui l'existant dans son ensemble ne renvoie plus que sa propre image, tellement vidée de substance qu'elle n'est plus qu'un leurre. Poser l'homme comme “animal voulant”, après qu'il l'eut été comme “animal rationnel”, c'est-à-dire, en fin de compte, comme individu absolu, c'est s'enfermer à terme dans cette fatalité de l'homme seul parmi ses avatars. Or, si l'essence de la technique n'est rien de technique, l'essence de l'homme n'est rien d'humain. L'homme comme “animal voulant” est précisément celui qui a perdu tout lien avec le “non-humain en l'homme”, qui a totalement oublié l'être.
Nous dirons, au contraire, que le non-humain est peut-être ce en quoi résident l'essence du sacré comme celle du peuple. Nous prendrons alors le mot d'“auto-affirmation” dans le sens que lui donne Heidegger, en parlant, par ex., de « l'auto-affirmation de l'université allemande » (die Selbstbehauptung der deutschen Universität). Ce sens est celui d'un retour à l'essence ou, pour employer un vocabulaire plus expressif, d'une compréhension et d'une explicitation (d'un déploiement) de ce qui appartient en propre à l'homme, de son essentiellement possible. La possibilité essentielle de l'homme, dit Heidegger, est sa liberté. Cette liberté est liberté-pour-fonder-un-monde, c'est-à-dire — si l'on considère les textes que Heidegger a pu écrire “en situation” — liberté que l'homme en tant que porté-par-un-peuple reçoit de la pro-venance, du destin du peuple. La liberté humaine est liberté pour la fidélité à ce destin. Dès lors, la volonté peut être sortie du cadre métaphysique. Il suffit de la penser comme résolution de soi dans le déploiement du destin d'un peuple.
Cette définition peut être difficile à recevoir en tant que notion à penser. Nous sommes, de toute évidence, encore trop conditionnés à penser la volonté comme l'attribut d'un ego absolu. Que dans une pensée radicalement différente de la volonté, l'ego doive se dissoudre (au moins en apparence) dans ce qui ne saurait se ramener à aucun “je”, le destin d'un peuple, voilà qui ne peut que troubler. Ceux qui, les premiers, ont reçu l'appel d'un peuple n'en ont-ils pourtant pas déjà fait l'expérience ? Le peuple dont nous relevons n'est pas en tant que présence ; il est en tant que venant. Nous ressentons son appel, et l'essence de notre action réside dans notre réponse à cet appel. Cette réponse n'est autre que l'expérience que nous faisons déjà de la liberté comme fidélité au destin d'un peuple. Chacun à un moment tragique de leur existence, Heidegger et René Char se sont retrouvés pour reconnaître que « toute grandeur est dans le départ qui oblige ». Cette simple phrase dit tout. L'engagement est fidélité résolue au destin du peuple qui nous appelle en tant qu'“à-venir”.
Quels sont les rapports existant entre le sacré et l'auto-affirmation telle que nous la concevons ? Plus précisément, quelle expérience du sacré avons-nous en tant que nous manifestons cette auto-affirmation ? Répondre à cette question, ce n'est pas dire ce qu'est le sacré aujourd'hui, tâche peut-être impossible, mais dire où il est. Panta : en : voilà Héraclite et voilà où est le sacré. Gott ist in mir das Feuer, ich bin ihm der Schein (Dieu est en moi le feu, je suis en lui l'éclat lumineux) : voilà Silesius et voilà où est le sacré. L'intuition que nous avons du sacré est qu'il réside dans une unité essentielle, et que c'est dans sa lumière que se déploie cette unité. Les textes sacrés indo-européens ne disent pas autre chose : ils disent la lumière dans laquelle un peuple se maintient en tant que peuple, c'est-à-dire la lumière dans laquelle se fait l'unité d'un monde. (Ainsi dans les Védas, où le sacrifice est pris comme acte de soutien du monde).
Que le sacré puisse ou non se passer de dieux, c'est là une question qui vient trop tard ou trop tôt. Quand un dieu est reconnu comme figure, c'est qu'il a déjà cessé d'être en tant que dieu. Qu'est-ce donc qu'un dieu ? Voilà une interrogation face à laquelle la prudence s'impose. Lorsque Friedrich Georg Jünger évoque Apollon [in : Nouvelle école n°35, 1979], il parle d'un dieu qui n'est rien d'humain, qui ne symbolise en aucune façon quelque chose d'humain. Le seul Apollon dont il a voulu s'approcher est celui dont les Grecs de la haute époque avaient l'expérience, qui aussi le seul qui puisse nous concerner. Tout questionnement sur la “réalité effective” du dieu, questionnement nécessairement métaphysique, car refusant d'emblée de prendre en compte ce par quoi le dieu se tourne vers les hommes pour mieux pouvoir le mesurer à un seul critère d'existence “objective”, nous semble oiseux. Relisons ce texte. Apollon y est délivré comme énigme. Cette énigme n'a rien à voir avec les mystères des religions révélées ; elle ne contient ni n'inspire aucun credo, et même elle rejette tout credo comme lui étant essentiellement étranger. Mais elle n'en a pas moins ce caractère incontournable d'inconnu, où Heidegger a cru retrouver le signe premier de la divinité. Quelle est donc l'énigme qui a nom “Apollon” ? Elle n'est pas tel ou tel caractère, tel ou tel attribut, telle ou telle apparence du dieu. L'énigme est l'unité des aspects du dieu, le rassemblement de ses aspects, de ses Scheinen, de ses “apparaître” au sein d'un même. Cette unité est le divin dans Apollon, et la divinité elle-même.
L'unité qui a pour nom “peuple” est aussi un tel mode d'approche de la divinité. Plus précisément, elle est à la fois le mode par lequel la divinité s'approche de l'homme dans le peuple, et le chemin par lequel l'homme en tant que porté-par-un-peuple s'approche de la divinité. Cette unité — qu'encore une fois il serait absurde de penser comme « unité d'un ensemble » — est le non-humain en l'homme. On pourrait alors reprendre, en la modifiant à peine, la sentence de Silesius : Das Volk ist in mir das Feuer, ich bin in ihm der Schein. Considérant le mot Schein dans le sens du grec phainestai, sa signification deviendrait la suivante : « Le peuple est en moi le feu, la flamme » (il est ce qui m'anime, me fait moi, me donne accès à mon essence, ce en quoi j'ai liberté de m'affirmer en tant que l'homme que je dois être), « Je suis en lui l'éclat de l'apparaître » (en tant qu'homme, je suis un aspect, un mode de l'apparaître du peuple, et ceci, en moi, est l'énigme et aussi, peut-être d'abord, le sacré).
On dira encore : quel rapport y-a-t-il entre l'expérience que nous faisons du sacré dans la “nature”, face à (et dans nos rapports avec) l'existant dans son ensemble, et l'unité ? Cette question est assez vaine. Car où donc se réalise l'unité du monde sinon dans une perception de l'existant dans son ensemble, qui, est, comme le dit Heidegger, une “prise en garde” ? Il nous faut en fait réapprendre à penser le monde comme destin, et dépasser autant qu'il est possible la perception comme “activité d'un sujet”. Tant que l'homme demeure en son essence, le monde n'est jamais un “dehors” auquel l'homme aurait accès en tant que sujet. L'homme ne voit le monde en tant que monde qu'autant qu'il est lui-même l'apparaître d'un peuple. Unité du peuple et unité du monde sont deux modes d'un même.
Nous autres aussi, bien que vivant en une époque où règne en maître la perception “objective” propre à l'individu (c'est-à-dire à ce que Heidegger appelait le « semi-homme »), nous faisons cette expérience. Si nous trouvons du sacré dans la “nature”, c'est que nous la voyons, non en tant qu'individus, non en “sujets-voulants-décidant-de-l'investir”, mais en hommes portés-par-un-peuple, le peuple européen, qui, rassemblé sur son essence (le “passé”), nous enjoint par son appel de le faire-venir à une nouvelle présence. Si la “nature”, pour nous, contient du sacré, ce n'est pas parce que nous y en avons mis, et pas non plus parce qu'elle nous renverrait l'image, au moins potentielle, de notre propre “volonté de puissance”, mais bien parce qu'un peuple est encore quelque peu en nous le « feu », même si nous n'en sommes encore que confusément l'« éclat ». Et c'est ce « feu » (das Feuer), constitutif de notre identité essentielle, de notre « hespérialité », qui est ce en quoi se dépose notre perception du monde, et donc aussi ce par quoi se réalise l'unité de notre monde.
matin passé et matin venant sont les mêmes
 Que le sacré ait donc beaucoup à faire avec l'auto-affirmation de l'homme en tant que mode de l'apparaître d'un peuple, c'est ce que l'on ne saurait nier. Unité du monde, unité du peuple : le même. Le même, mais pas « la même chose » — et, sur ce point, nous renverrons à ce que Heidegger a pu écrire dans le texte, essentiel, intitulé Identité et différence. En tant que le même, unité du monde et unité du peuple se trouvent dans un rapport de co-propriation, ce qui revient à dire qu'ils s'y cherchent pour y trouver ce qui est à chacun son propre. Le point, le “nœud” autour duquel s'enroulent ces “deux” unités est proprement pour nous le plus proche et le plus lointain. Il est, au sens le plus profond, le lieu de venue du sacré.
Que le sacré ait donc beaucoup à faire avec l'auto-affirmation de l'homme en tant que mode de l'apparaître d'un peuple, c'est ce que l'on ne saurait nier. Unité du monde, unité du peuple : le même. Le même, mais pas « la même chose » — et, sur ce point, nous renverrons à ce que Heidegger a pu écrire dans le texte, essentiel, intitulé Identité et différence. En tant que le même, unité du monde et unité du peuple se trouvent dans un rapport de co-propriation, ce qui revient à dire qu'ils s'y cherchent pour y trouver ce qui est à chacun son propre. Le point, le “nœud” autour duquel s'enroulent ces “deux” unités est proprement pour nous le plus proche et le plus lointain. Il est, au sens le plus profond, le lieu de venue du sacré.
Ce “nœud”, qui correspond peut-être à ce que Heidegger a interrogé sous le nom d'Ereignis, nous apparaît, à nous aussi, comme question. Il ne s'agit pas d'une question à résoudre, mais d'une question à déployer. Que signifie ce terme ? Certainement pas aligner des propositions logiques ou paralogiques. Déployer la question du lieu de venue du sacré, c'est fonder le sacré en tant que sacré, et, du même coup, le peuple en tant que peuple. Heidegger en était arrivé à dire : Ereignis ereignet ; et il ajoutait : « c'est tout ». Ce « c'est tout » ne pose pas une fin, mais ouvre un horizon, en ce sens qu'il est un ordre de « départ pour l'assaut » ; et dans ce départ, est toute grandeur. Il signifie, si l'on peut dire, laisser Ereignis ereignen, c'est-à-dire répondre à l'appel qui nous enjoint de prendre en notre garde la « croissance de ce qui est petit » — la venue d'un peuple que nous nommerons peut-être hespérial. Là et là seulement est l'auto-affirmation.
Que dire maintenant de la technique ? Pour beaucoup, aujourd'hui, la technique reste quelque chose de “mécanique”, de “machinal” : un zu-Hand, dont l'homme aurait usage en tant que sujet, et sur lequel il pourrait agir. Une telle conception nous semble erronée. Cette apparence que prend la technique d'objet à la disposition d'un homme-sujet n'est qu'un leurre, ou plutôt un masque. (Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit fausse, car il n'y a jamais d'apparence “fausse”). Quitte à tout décrire en termes de sujet et d'objet, c'est bien plutôt la technique qu'il faudrait considérer comme “sujet”, et l'homme désintégré du “on” qu'il faudrait voir comme “objet”. La technique n'est un outil pour le bien-être ou la puissance que pour les hommes du nihilisme achevé. En fait, elle n'est pas un outil du tout. Elle est ce qui nous enjoint de voir l'étant comme objet, et l'être comme efficience. Cette injonction se confond avec la nuit où les peuples se sont perdus eux-mêmes, et le danger — ce « désert qui croît », ainsi que Nietzsche nous en a avertis — est que, dans cette nuit de la technique mondiale, l'homme finisse par perdre tout lien avec son essence.
Relisons Nietzsche. S'il y a, aujourd'hui, un “seigneur de la terre”, c'est bien le « dernier homme » dont parle Zarathoustra, le « semi-homme » évoqué par Heidegger dans son texte sur le Service du Travail. C'est lui l'engeance aveugle et oublieuse qui règne en maître dans la nuit de la technique mondiale. Qui règne sur quoi ? Non pas sur la terre, qui, en tant que phénomène, qu'entité ou mode du Geviert, lui est interdite, mais sur le désert.
Quel est alors le salvateur qui vient avec l'ère de la technique ? On dira : l'être, en tant que lumière du matin qui se dévoile comme telle aux hommes du soir (Jean Beaufret). C'est dire trop et pas assez. On dira encore : l'Ereignis, en tant que signalé, devancé dans notre pensée, par le Gestell. Cette réponse, identique en fait à la précédente, ne nous mène pas plus loin. Il faut rappeler, en effet, que l'expérience que l'homme de l'aurore grecque avait de l'être ne s'est déployée en un monde que pour autant que l'être a pris cet homme en tant que son Dasein, c'est-à-dire, finalement en tant que peuple. Et de même, l'Ereignis implique la conjonction de l'unitépeuple et de l'unité intérieure de l'homme en tant que liberté pour l'accomplissement du destin du peuple.
Que deviennent alors la poiésis et la téchnè ? En quoi sont-elles, identifiées comme au cœur de la technique, de l'ordre de ce qui sauve ? Sûrement pas dans le sens où nous aurions le pouvoir d'investir d'un “sens nouveau” la production d'objets techniques. On ne peut asseoir sur la technique la tâche « destinale » de faire-venir d'un peuple. La poiésis nous regarde dans la mesure seulement où elle n'est au cœur de toute production technique d'objets que parce qu'elle est au cœur de tout faire-venir, de toute éclosion à la présence. Elle nous regarde d'abord en ceci que nous savons, comme on a savoir d'une évidence secrète, que vers nous s'est tourné ce qui « est encore petit », ce qui appelle à croître dans le danger. Et cela qui nous “appelle”, étant encore petit, pour qu'en son « faire-venir » nous trouvions notre liberté et notre destin, est un peuple et rien d'autre.
Le monde n'est jamais fait d'objets. Le monde est destin de l'homme en tant que Dasein, ce qui signifie : le monde est monde pour autant qu'il est demeure de l'homme, et l'homme, lui, n'est homme qu'en tant que porté-par-un-peuple. Nous ne ferons pas venir à la présence le peuple qui nous appelle en tant qu'« à-venir » en nous efforçant de donner un autre “sens” à des objets, quels qu'ils soient. Les étants ne seront rendus disponibles pour un usage poiétique qu'une fois délivrés à cet usage par un peuple. Ne confondons donc pas les racines et les derniers rameaux de l'arbre. C'est un peuple — nos racines — qui est à « pro-duire », et non pas une “nouvelle technique”.
Mais comment “pro-duit”-on un peuple ? On ne peut, à cet égard, qu'envisager un horizon appelé, une fois atteint, à disparaître pour céder la place à un autre. La pro-duction d'un peuple ne saurait en effet avoir de “fin”. Elle est un acte continu. Dans l'immédiat, il faut lutter par tous les moyens contre l'idée de l'homme-sans-peuple, du « semi-homme », de cet individu moral qui peut d'autant mieux se construire un “humanisme” qu'il a oublié l'être et s'est ainsi détourné de l'essence de l'homme. Sur notre chemin, nous sommes guidés par une lumière qui, n'étant aucune lueur nocturne, ne peut être que celle du matin. Matin passé et matin venant sont pour nous les mêmes. Ma certitude la plus profonde est que nous sommes voués à ce matin.
► Patrick Simon, Nouvelle École n°37, 1982.
◘ Notes :
(1) Cf. not. Alain de Benoist, Comment peut-on être païen ?, Albin Michel, 1981.
(2) Là réside l'erreur de ceux qui, tel Pierre Chaunu dans La mémoire et le sacré, tirent argument de la non-opposition entre sacré et profane pour affirmer, de façon plutôt légère, que le paganisme est fondamentalement théocratique.

Commentaires
Bonjour
Ces [ Quelques notes sur la notion d' “aristocratie”] sont passionnantes.
Elles élargissent de manière constructive le sens restrictif, communément admis pour ce mot.
J'ai noté ceci à retenir, entre autres citations : [Les aristoi sont les individus qui manifestent avec le plus de force ce “bien” qui donne à leur cité force et éclat. Le “gouvernement” des meilleurs révèle en fait, qu'il se traduise ou non en institutions politiques, la puissance d'attraction de “ce qu'il y a de meilleur dans le peuple”. En ce sens, la reconnaissance d'une aristocratie est intimement liée à la conscience du bien commun.]
Je vous remercie pour cette analyse très intéressante et les deux textes cités (à méditer) qui nous viennent de l'Iran et de la Grèce antiques
Cordialement
Euro-synergies n'existe plus?
C'est à craindre, tout dépendra de la réponse de la plate-forme
Merci.
Ouch, j'aurai dû copier le site. Encore hier je chercher un texte. Vouloir et Euro-synergies. Haut et fort ne veulent plus héberger le site. Ils vont le remonter ailleurs?
Cordialement
http://telecharger.tomsguide.fr/Resurrect-Pages-,0301-35316.html
Merci, déjà tenté. N'aide pas vraiment...
cliquer sur le lien associé au pseudo
Merci beaucoup!
Bonjour.
Juste pour dire qu'il existe encore ce site et il est même à jour. (dernier post : aujourd'hui).
L'URL : http://euro-synergies.hautetfort.com/actualite/
Si ce lien n'est pas souligné, demander à un moteur de recherches.
En espérant que cette adresse vous sera d'une utilité, je vous souhaite de passer une bonne journée.
BISOUS.
Bonne fin de journée
Paraquestion : pourriez-vous m'indiquer quelle est cette très belle musique en tête de cet article aristocratique ?
www.fileden.com/files/2010/5/7/2851925/01-VNV%20Nation-Pro%20Victoria.mp3