Chasse fantastique
Le mythe de la Grande Chasse
« L'important reste seulement d'entendre la voix du dieu aux corbeaux et, dans les nuages, le grondement des huit sabots de son cheval Sleipnir, menant inlassablement sa Chasse Sauvage » (Jean Mabire, Les dieux maudits)
 Dans maints villages, on rapportait autrefois que, par certaines nuits, l'on pouvait entendre et même voir, à travers les bois et les champs, déferler à toute vitesse ce qui était tantôt dénommé grande chasse, tantôt chasse sauvage ou chasse fantastique. Selon les endroits, la composition de cette chasse pouvait varier, mais généralement, on y trouvait une meute impressionnante et nombreuse, laquelle précédait — dans une course folle — un ou plusieurs chasseurs montés à cheval. Parfois, ces cavaliers étaient des squelettes ou des espèces de cadavres, tandis que leurs montures étaient généralement étincelantes et crachaient le feu. Parfois encore, cette démoniaque équipée poursuivait un gibier qui se révélait presque toujours être un cerf. Le tout se déroulait dans un vacarme épouvantable et terrifiant, constitué par les aboiements de la meute, les sons des cors et les bruits des tirs. Il va de soi que ceux qui, par malheur, trouvèrent sur leur chemin nocturne la course de la grande chasse, n'eurent pas à s'en féliciter. Ils pouvaient déjà bien s'estimer heureux lorsqu'ils s'en tiraient vivants.
Dans maints villages, on rapportait autrefois que, par certaines nuits, l'on pouvait entendre et même voir, à travers les bois et les champs, déferler à toute vitesse ce qui était tantôt dénommé grande chasse, tantôt chasse sauvage ou chasse fantastique. Selon les endroits, la composition de cette chasse pouvait varier, mais généralement, on y trouvait une meute impressionnante et nombreuse, laquelle précédait — dans une course folle — un ou plusieurs chasseurs montés à cheval. Parfois, ces cavaliers étaient des squelettes ou des espèces de cadavres, tandis que leurs montures étaient généralement étincelantes et crachaient le feu. Parfois encore, cette démoniaque équipée poursuivait un gibier qui se révélait presque toujours être un cerf. Le tout se déroulait dans un vacarme épouvantable et terrifiant, constitué par les aboiements de la meute, les sons des cors et les bruits des tirs. Il va de soi que ceux qui, par malheur, trouvèrent sur leur chemin nocturne la course de la grande chasse, n'eurent pas à s'en féliciter. Ils pouvaient déjà bien s'estimer heureux lorsqu'ils s'en tiraient vivants.
En Basse-Semois, la grande chasse la plus connue est la chasse infernale de Bohan (1). Elle a été rapportée par de nombreux auteurs de livres de folklore et de guides touristiques, et la description qu'ils en donnent correspond assez à ce qui a été indiqué ci-dessus. Mais ce qui, à propos de cette grande chasse, mérite une particulière attention, c'est qu'elle se produisait non loin d'un lieu dénommé Bois Artus. En effet, dans une étude récente et fondamentale sur le mythe de la grande chasse (2), il a été relevé qu'une des appellations essentielles de celle-ci dans diverses provinces de France, est chasse du roi Artus ou chasse Artus.
En l’occurrence, ces dénominations ne font pas difficulté puisqu'elles font simplement référence au nom — Artus — d'un personnage légendaire que le mythe a intégré. Par contre, il est d'un intérêt prodigieux de constater qu'à Bohan, la grande chasse se déroule près d'un lieu appelé Bois Artus, et qu'à des centaines de kilomètres de la Basse-Semois, on retrouve la même grande chasse mais s'appelant, elle, chasse Artus. On peut donc en déduire qu'il ne s'agit pas de souvenirs légendaires propres à l'Ardenne et qu'il serait possible d'expliquer par l'histoire et le folklore locaux. Par ex., on a fait du chasseur maudit de Bohan un mauvais seigneur — lequel a d'ailleurs réellement existé à la fin du XVIIIe siècle — qui reviendrait, la nuit, expier ses méfaits. Or, la très grande diffusion des récits de grande chasse au travers de l'Europe, particulièrement de l'Ouest et du Nord, contrarie toute interprétation régionale et témoigne, à l'inverse, de ce que l'on se trouve en face des restes épars d'un mythe fondamental.
En définitive, qu'évoque la grande chasse ? C'est, selon moi, le souvenir du plus important des dieux des anciennes religions nordique et germanique. Odin (ou Wodan), puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pu survivre au christianisme que sous la forme d'un chasseur fantastique. Dans son excellent livre sur les dieux et la religion des Germains, le professeur Derolez l'indique d'ailleurs clairement : « Nous trouvons peut-être, écrit-il, une dernière trace du Wodan du continent dans la croyance populaire très répandue concernant le chasseur sauvage » (3). Toutefois, il ne s'agit pas de n'importe quel souvenir du dieu Odin. En effet, les récits mythologiques relatifs à celui-ci sont nombreux et lui confèrent différents rôles. Parmi ceux-ci, deux sont particulièrement importants et pourraient avoir survécu dans la grande chasse.
En effet, on se rappellera que, dans le vieux monde nordique, la plus heureuse destinée qui pouvait être assignée à la vie d'un guerrier, était de tomber un jour ou l'autre au champ d'honneur, les armes à la main. L'âme du combattant était alors saisie par une Walkyrie et entraînée vers cette espèce de paradis militaire qu'était le Walhala. Là régnait aussi Odin, qui se trouvait ainsi à la tête d'une armée de fantôme. Or, on a vu justement dans la grande chasse une survivance de cette troupe d'âmes guerrières, hantant, la nuit, le monde entier. Il n'est donc pas étonnant que l'on décrive souvent les cavaliers qui accompagnent ou même qui mènent la grande chasse comme des fantômes ou des cadavres, voire des squelettes. Bref, une première interprétation — et peut-être la plus juste — ferait de la grande chasse ce bataillon fantôme de soldats nordiques, conduits par Odin à travers toute la terre.
Mais il pourrait exister une autre interprétation, et, quant à moi, je la préfère. En effet, il ne faut pas perdre de vue, ainsi que le souligne fort bien l'écrivain normand Jean Mabire, qu'« Odin est avant tout un dieu voyageur. Aucun élément de l'immense Nature ne lui est étranger. Il chevauche dans les nuages, il galope dans les chemins et il plonge sous les vagues. Au fond des mers ou au sommet des collines, il cherche toujours la sagesse. Sa vie est une quête perpétuelle. Car la sagesse n'est pas immobile mais mouvante. L'esprit ne reste jamais en repos. Il souffle avec le vent, légère bise ou forte rafale. C'est lui qui fait frissonner les arbres ; les idées voltigent parmi les feuilles mortes emportées par la tempête. Il faut se hâter de les saisir » (4). La grande chasse serait alors le souvenir de cette course du dieu Odin, toujours à la recherche d'un savoir plus grand ou d'une connaissance plus approfondie de la Nature. Au vrai, ce ne serait plus, dès lors, seulement à la divinité païenne mais aussi à l'esprit qu'elle incarne — à savoir : le questionnement perpétuel et la soif d'apprendre et de découvrir sans cesse — que ce serait attaqué le christianisme missionnaire et totalitaire de nos régions. Ainsi c'est dans la légende qu'était confiné l'Esprit par des prêtres qui pensaient détenir la Vérité, totale et exclusive de toute autre.
Mais le mythe a survécu et l'Esprit n'est pas mort. Et bientôt, aux fantômes de la grande chasse pourraient bien succéder de nouveaux guerriers, en pleine possession de leurs forces, et combattant, non plus à la suite d'Odin, mais toujours aux côtés de l'Esprit et de la Nature.
► Jérôme Breballe, Combat païen n°31, 1993.
Notes et références :
- (1) Sur les manifestations de la grande chasse à Bohan-sur-Semois, voir not. : PIMPURNIAUX Jérôme, Guide du voyageur en Ardenne, 2ème partie, Bruxelles, 1858, pp. 231-234 ; MONSEUR, Eugène, Le folklore wallon, Bruxelles, s.d., pp. 1-2 ; DELOGNE, Théodule, L'Ardenne méridionale belge, Bruxelles, 1914, pp. 62-63 ; ROUSSEAU, Félix, « La chasse infernale de Bohan », extrait des Légendes et coutumes du pays de Namur, Bruxelles, 1920, dans Le Sanglier n°51, 16 sept. 1960 ; LUCY, Gaston, « La chasse infernale de Bohan », in Presses-Annonces n°33, 8 sept. 1972.
(2) Il s'agit de : MOURREAU Jean-Jacques, « La chasse sauvage, mythe exemplaire », in Nouvelle École n°16, pp. 9-43. On lira aussi avec intérêt : BOURRE, Jean-Paul, « La chasse sans armes », dans L'Autre Monde n°12, pp. 10-17. Et bien sûr, on n'oubliera pas Victor HUGO, Le Rhin, tome II, Bruxelles, 1842, pp. 104 et ss.
(3) DEROLEZ, R., Les dieux et la religion des Germains, Payot, 1962, p. 74.
(4) MABIRE, Jean, Les dieux maudits : Récits de mythologie nordique, Copernic, 1978, pp. 79-80.
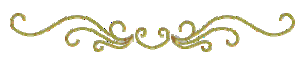
LA CHASSE SAUVAGE, MYTHE EXEMPLAIRE
[Ci-dessus : La Chasse sauvage, Franz Von Stuck, vers 1889. Ci-dessous : Couverture du tiré à part du n°16 de Nouvelle École, 1972. Dessin de JJM (d'après la pierre tombale d'Alskog Tjängvide, Suède) représentant Sleipnir, le coursier d'Odhinn, chevauchant dans les nuits du Vieux monde. Il entraîne derrière lui une Chasse sauvage. Le mythe a 3.000 ans et vit encore]
 Dans un passé encore très proche de nous, on a cru voir de nuit des cortèges fantastiques : chasseurs, soldats, nègres, damnés, cavaliers avec leurs meutes, surgissaient avec fracas du néant pour disparaître sans laisser de traces, comme une nuée d’orage. Menée par un géant, un seigneur ou un roi, la chasse fantastique se lançait parfois à la poursuite d’un animal sauvage, généralement un cerf, à grands renforts d’abois, de « sonnailles » et de « hurlements » (Raymond Christinger & Willy Borgeaud, Mythologie de la Suisse ancienne, Genève, 1963, tome I, p. 16).
Dans un passé encore très proche de nous, on a cru voir de nuit des cortèges fantastiques : chasseurs, soldats, nègres, damnés, cavaliers avec leurs meutes, surgissaient avec fracas du néant pour disparaître sans laisser de traces, comme une nuée d’orage. Menée par un géant, un seigneur ou un roi, la chasse fantastique se lançait parfois à la poursuite d’un animal sauvage, généralement un cerf, à grands renforts d’abois, de « sonnailles » et de « hurlements » (Raymond Christinger & Willy Borgeaud, Mythologie de la Suisse ancienne, Genève, 1963, tome I, p. 16).
C’est en ces termes que 2 auteurs contemporains résument, dans ses grandes lignes, l’un des mythes les plus répandus, les plus significatifs et les plus féconds du folklore européen : la “Chasse sauvage”.
Dans son Manuel du folklore français (tome IV), Arnold Van Gennep cite à propos de la Chasse sauvage une abondante bibliographie. Il recense près de 120 titres pour le seul domaine français, ce qui situe l’importance du sujet. Malheureusement, faute d’avoir replacé le mythe dans son cadre d’origine, rares sont les auteurs parvenus à l’éclairer complètement.
Le thème de la Chasse sauvage connaît d’innombrables variantes, et a reçu diverses explications. Ces dernières peuvent être ramenées à 3 catégories, selon qu’elles furent proposées par des auteurs naturalistes, historicistes ou mythistes.
Certains chercheurs, comme E. Henry Carnoy (« Les Acousmates et les chasses fantastiques », in Revue de l’histoire des religions, tome IX, 1884, pp. 370-78), n’ont vu dans ces récits que les fruits d’une imagination populaire impressionnée par les phénomènes météorologiques et les “bruits d’animaux”. Les Chasses sauvages seraient, selon eux, à ranger parmi les superstitions. D’autres, comme Gaston Raynaud (« La Mesnie Hellequin, II : Le poème perdu du comte Hennequin », in Études romanes dédiées à Gaston Paris, 1892) se sont employés à fournir une base historique à l’une ou l’autre version du mythe. Cette tentative, déjà ancienne, fut sévèrement critiquée et finalement réduite (Ferdinand Lot, « La Mesnie Hellequin et le comte Ernequin de Boulogne », in Romania, tome XXXII, 1903, pp. 423-41).
En fait, l’analyse des allusions littéraires, l’examen des coutumes populaires, la comparaison des diverses formes de la tradition orale, leur confrontation avec des données de l’archéologie et de l’histoire des religions indo-européennes, permettent de penser que les thèses naturalistes et historicistes ne permettent pas d’interpréter à elles seules la somme des légendes de la Chasse sauvage
Car il ne s’agit pas d’une simple fable née à la veillée, de la peur de nuits trop longues, de forêts trop épaisses et du récit des anciens. Il ne s’agit pas non plus de l’écho, déformé et lointain, de la renommée de quelque illustre personnage. Mais bien d’un mythe. D’un mythe dont il faudrait pouvoir retracer les phases critiques, et qui, au cours d’une longue histoire, a perdu les traits fondamentaux qui devaient être les siens lorsqu’il participait à son idéologie d’origine.
Contrairement à une opinion trop souvent répandue, un mythe n’est pas quelque chose de flou et d’informel. Il est étroitement lié à un système, un ensemble social, un sentiment religieux, une idéologie. Rappelons à ce sujet l’excellence définition donnée par M. Georges Dumézil :
« Le mythe est essentiellement un récit que les usagers sentent dans un rapport régulier, d’ailleurs quelconque, avec un rite positif ou négatif de la vie magico-religieuse, ou juridico-religieuse, ou politico-religieuse. Peu importe que ce récit fasse intervenir des dieux, des héros fabuleux, ou des personnages crus “historiques” : du moment que le récit accompagne ou justifie, ou illustre un rite, il mérite le nom de mythe » (Mythes et dieux des Germains : Essai d’interprétation comparative, PUF, 1939, p. XI).
Une troupe de porte-morts
Le mythe a laissé de nombreuses traces dans la littérature européenne. C’est tout d’abord, au XIe siècle, le récit d’une chasse nocturne ayant suivi la mort du roi breton Alain Barbe-Torte. L’histoire, tirée d’une chronique nantaise, a été analysée par M. Henri Dontenville et ses collaborateurs, dans La France mythologique (Payot, 1966, pp. 163-64). En voici les principales périodes :
Décédé en sa résidence nantaise, l’an 952, Alain Barbe-Torte est enterré dans l’église des saints Donatien et Rogatien, édifice situé à l’extérieur de la cité. Le lendemain, son cadavre est retrouvé sur le sol. On l’enterre à nouveau et, sur sa tombe, on amasse des pierres et des troncs d’arbre. Mais rien n’y fait. Quatre jours durant, le défunt s’obstine à sortir de son tombeau. Du crépuscule au chant du coq, la peur règne dans la ville. La nuit, les comtes locaux, accompagnés d’une troupe de soldats, parcourent à cheval les hameaux entourant la cité, et mènent grand tapage. Certains, s’étant souvenus de la grande dévotion de Barbe-Torte pour la Vierge Marie, le cadavre est alors inhumé à l’intérieur des remparts, dans l’église qu’il avait fait construire en son honneur. Aussitôt, le tumulte prend fin.
À la même époque, un texte d’Orderic Vitalis relate la vision d’un certain Gauchelin, prêtre normand :
« Une nuit de janvier 1092, le prêtre de Bonneval, revenant de visiter un malade, entend venir une armée. Il veut se retirer vers 4 néfliers, mais un homme d’énorme stature armée d’une massue le contraint de rester près de lui. Passent d’abord des fantassins chargés du produit de leurs pillages, et qui s’encouragent à redoubler de vitesse ; ensuite, chargée de 50 cercueils, une troupe de porte-morts à laquelle le géant se réunit à l’instant ; puis des femmes à cheval, qui blasphèment et confessent leurs crimes ; des clercs, abbés, évêques en noir, qui supplient le prêtre de prier pour eux ; une grande armée de chevaliers noirs, armés pour la bataille, portant des enseignes noires et montés sur des chevaux gigantesques, enfin des chevaux libres, sellés. Le prêtre se dit : “Voilà sans aucun doute les gens de Herlechin (haec sine dubio familia Herlechini). J’ai ouï dire que quelques personnes les ont vus parfois. J’étais incrédule. Maintenant, je vois les mânes des morts”... » (H. Dontenville, op. cit., pp. 164-65).
Au XIIe siècle, un écrivain anglais, Gautier Map, contant l’histoire de Herla, légendaire roi breton, rapporte une chevauchée fantastique, intervenant après une descente aux enfers. Herla vient d’assister, dans une caverne, au mariage du roi des nains. Il en sort à cheval, accompagné de sa suite. C’est alors qu’il apprend, avec stupeur, que 2 siècles ont passé durant sa visite, et que l’île est tombée aux mains des Saxons.
Herla voudrait bien descendre de sa monture, mais il hésite. En effet, le roi des nains lui a confié un chien, et lui a interdit de quitter son cheval avant que le petit animal n’ait de lui-même sauté à terre. Or, le brachet n’en manifeste pas l’intention. Herla et sa suite se condamnent ainsi à une chevauchée sans fin. L’an premier du règne de Henri II, rapporte Gautier Map, cité par F. Lot (art. cit., p. 441), on a vu cette troupe s’engloutir près de la Wye, dans le comté de Herford.
Peu après, au XIIIe siècle, Adam de La Halle, dit le Bossu, célèbre trouvère d’Arras, évoque à son tour la « Mesnie Hellekin ». La scène a pour cadre une loge de verdure (la feuillée), élevée pour célébrer le retour du printemps. Elle se situe durant l’une de ces nuits privilégiées où les fées ont coutume d’apparaître aux mortels. Les personnages attendent Dame Morgue (la fée Morgane) et sa compagnie.
« Gillot : J’entends la Mesnie Hellekin, à mon avis, qui vient devant, avec maintes clochettes sonnant ; je crois bien qu’elles sont près d’ici.
— La grosse femme : Les fées viendront donc après ?
— Gillot : Que Dieu m’aide, je crois que oui .
Arrive ensuite un dénommé Croque-Sot, qui n’est autre que l’émissaire du roi Hellekin. Il s’enquiert de la venue des fées, apprend qu’elles ne sont pas encore arrivées, et décide de les attendre.
— Rikeche : À qui es-tu, dis, petit barbu ?
— Croque-Sot : Qui ? Moi ?
— Rikeche : Oui !
— Croque-Sot : Au roi Hellekin, qui m’a envoyé en messager à Dame Morgue la Sage, que mon sire aime d’amour. Je l’attendrai par ici, car elles m’indiquèrent le lieu... » (1).
Au début du XIVe siècle, un notaire à la chancellerie royale, Gervais du Bus, originaire de Normandie, imagine Le Roman de Fauvel. On y trouve, aux vers 604-770, la description d’un charivari organisé par un cortège que mène un géant barbu du nom de Hellequin. Celui-ci, monté sur un grand cheval de trait dont on peut compter les côtes, est accompagné de personnages étranges, dont les habits portent des clochettes. Dans le cortège, figure un chariot surmonté d’un bruyant engin, composé de roues de charrettes.
« L’un montrait son cul au vent, / L’autre rompait un auvent, / L’un cassait fenêtres et huis, / L’autre jetait sel aux puits ; / L’un jetait bran aux visages. / Trop étaient laids et sauvages. / Il y avait un grand jaïant / Qui allait fortement brayant, / Vêtu était de son broussequin. / Je crois que c’était Hellequin / Et tous les autres sa mesnie, / Qui le suivent tout enragie ».
Dans Renart le Nouvel, paru sensiblement à la même époque, Jakemars Giélée évoque un cavalier qui, lui aussi, porte plus de 500 clochettes : « À sa selle et à ses forains, Eut cinq cents clochettes au moins, / Qui démenaient tel tintin / Comme li maisnie Hierlekin ».
Fifres, tambours et sonnailles
Loin de disparaître au XVIe siècle, le mythe reste toujours vivace. À Strasbourg, le prédicateur alsacien Geiler von Kaysersberg (1445-1510) s’empare du thème de la “Chasse infernale” pour sermonner ses contemporains. Hans Sachs (1496-1576), salué comme le dernier des Maîtres-Chanteurs de Nuremberg, décrit dans plusieurs poèmes, notamment dans Gesprech von der Himmelfart Margraff Albrechtz Anno 1557 et Das Wütend Heer der Kleynen dieb, « l’armée sauvage s’avançant dans un charivari de fifres, de tambours et de sonnailles » (R. Christinger & W. Borgeaud. op. cit., p. 17). Et l’on peut lire, dans la Zimmerschen Chronik : « Im jar 1550 hat man das wutteshere zy Mösskirch gehört. Das ist in ainer nacht zu herpstzeiten nach den zehen uhren vorm Banholz mit einer grosen ugestimme über die Ablach uf Minchsgereut gefaren, und als das ain guete weil daselbs umbner terminiert, ist es die Herdtgassen herabkommen und dann neben dem siechenhaus und unser Frawen über die Ablachbrucken, dem bach nach an der stat, die Katzenstaig hinauf, mit aim wunderbarlichen gedöss, lauten geschrai, clingln, und aim grosen luft, so das getriben... » (2).
En France, il faut encore citer un poème de Ronsard, L’hymne des Démons (passage ne figurant que dans l’édition originale de 1555, publié par Albert-Marie Schmidt dans une thèse complémentaire de 1939, et reproduit par Gustave Cohen, « Survivances modernes de la Mesnie Hellequin », in : Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, t. XXXIV, séance du 5 janvier 1948, p. 34) :
« Un soir vers la Minuit, guidé de la jeunesse, / Qui commande aux Amans, j’allois voir ma Maistresse, / Tout seul outre le Loir, et passant un destour / Joignant une grand’croix, dedans un carrefour, / J’ouy, ce me sembloit, une aboyante chasse / De chiens qui me suyvoit pas-à-pas à la trace. / Je vy auprès de moy sur un grand cheval noir / Un homme qui n’avoit que les ôs, à le voir, / Me tendant une main pour me monter en crope : / J’advisay tout-au-tour une effroyable trope / De picqueurs, qui couroient une Ombre qui bien fort / Sembloit un Usurier qui naguère estoit mort, / Que le peuple pensoit, pour sa vie meschante, / Être puny là-bas des mains de Rhadamante. / Une tremblante peur me courut par les ôs / Bien que j’eusse vestu la maille sur le dos... »
Un autre témoignage nous est donné par Maximilien de Sully, ministre de Henri IV. Celui-ci rapporte dans ses Mémoires qu’un jour où le roi chassait à Fontainebleau, un bruit de chiens et de trompes se fit entendre brusquement. « C’estoit un fantôme environné d’une meute de chiens — écrit Sully —, dont on entendoit les cris et qu’on voyoit de loin, mais qui disparaissoit ors qu’on s’approchoit » (cité par Lazare Sainéan, « La Mesnie Hellequin », in : Revue des traditions populaires n°5/1905, tome XX, p. 181).
Soit des diables, soit des esprits
Pour le XVIIe siècle, on peut produire un passage des Mémoires du cardinal de Retz (cité par G. Cohen, art. cit., pp. 35-36), relatant un incident survenu au cours d’un voyage en carrosse, que l’auteur faisait en compagnie de personnages de son temps. Il s’agit d’une « compagnie de diables » que le cocher croit avoir aperçue. « M. de Turenne se tourna vers moi, raconte le cardinal, de l’air dont il eût demandé un dîner et de l’air dont il eût donné une bataille, avec ces paroles : “Allons voir ces gens-là !”. “— Quelles gens ?”, lui répartis-je, et, dans le vrai, je croyais que tout le monde avait perdu le sens. Il me répondit : “Effectivement, je crois que ce pourrait bien être des diables”. Comme nous avions déjà fait cinq ou six pas du côté de la Savonnerie, et que nous étions, par conséquent, plus proches du spectacle, je commençai à entrevoir quelque chose, et ce qui m’en parut fut une longue procession de fantômes noirs, qui me donna d’abord plus d’émotion qu’elle n’en avait donné à M. de Turenne... ».
En fin de compte, les « esprits » se révèlent être un groupe de capucins vêtus de noir. Cependant, comme l’a remarqué G. Cohen, il est évident que les 2 hommes « trouvaient tout naturel de rencontrer soit des diables, soit des esprits, et d’aller au-devant d’eux l’épée à la main. Ils connaissaient la Chasse sauvage ou la Mesnie Hellequin : la chose, sinon le mot ».
Enfin, vers 1668, Joh. Praetorius décrit ainsi la “troupe infernale” : « Beaucoup sont décapités, beaucoup ont la tête sur la poitrine, d’autres ont perdu mains ou bras, certains n’ont plus qu’un pied et boîtent, alors que d’autres ont mis leurs deux jambes sur les épaules et parviennent encore à courir, pendant que d’autres encore sont attachés à de grandes roues qui tournent sans axe » (cité par Alfred Endter, « Die Sagen vom Wilden Jäger und von der Wilden Jagd », in Studien über den deutschen Daimonen Glauben, Frankfurt a.M., 1934, p. 28).
La Mesnie Hellequin
Dans toutes ces descriptions, un nom revient souvent : celui de Hellequin, ou de Mesnie Hellequin. En 1140, Orderic Vitalis rapporte la rencontre du prêtre Gauchelin avec la famille Herlechini. À la fin du XIIe siècle, Pierre de Blois fait allusion aux milites Herlewini. À la même époque, Gautier de Map parle des phalanges noctivagae quas Herlethingi dicebant. Jusqu’au XVIe siècle, on trouve les formes “Herlequin” et “Harlequin”, que l’on pense être primitives, quoique la forme “Hellequin” soit plus usitée depuis le XIIIe siècle. En vieux français, une mesnie (ou maisnie) désigne une suite “menée”, un cortège, un équipage. Le mot peut aussi avoir le sens « de train de chasse, de valets de meute » (Lazare Sainéan, art. cit., p. 185), ce qui convient d’ailleurs parfaitement au contexte. Mais qui est donc Hellequin ?
Comme nous l’avons indiqué plus haut, certains auteurs se sont employés à “historiciser” le personnage de Hellequin. G. Raynaud (art. cit.), par ex., a évoqué la figure du comte Ernequin de Boulogne. Mais F. Lot n’a pas eu grand mal à réfuter l’hypothèse. « Le thème de la Chasse fantastique, écrit-il, est trop répandu pour qu’on puisse croire qu’il soit parti d’une petite région de la France, et sa signification mythique ne peut découler du souvenir d’une bataille historique du IXe siècle. Un témoignage antique, celui de Virgile, montre que la Germanie le possédait dès avant l’ère chrétienne… ». (art. cit., p. 433).
Une rapide étude étymologique montre qu’en réalité Hellequin (ou Hellekin, Hennequin, Hannequin, Herlequin, et par suite Arlequin) (2 bis) est un terme d’origine germanique, ayant des rapports certains avec Herle, Heer et Haari (Walter von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, pp. 200-02), dont la pénétration en France se serait opérée à partir des sphères culturelles anglo-normandes.
Toutes les fois que se trouvent mis en scène le Wütende Heer (en Allemagne) ou la Maisnie Hellequin (en France), c’est par le bruit (le vacarme, le tumulte, le charivari) que se caractérise l’apparition. La troupe, généralement à cheval, mène grand tapage. Son chef (Hellequin, ou encore Wode) a une voix retentissante, qui glace d’effroi le voyageur égaré. À cet égard, remarque F. Lot, certains rapprochements s’imposent (art. cit., pp. 440-41), notamment avec le vieux-français herle ou harle, bruit, tumulte. Ce mot a donné naissance au verbe herler (ou heller, ou hellir), qui signifie “faire du tapage”. En Normandie, herlant voulait dire “bruyant”, “tracassier”. Sonner une cloche à herle, c’est “sonner le tocsin” (idées de mort et de bruit associées). Il semble bien que les verbes modernes héler (angl. hail) et, peut-être, hurler (3) proviennent aussi de herle, de même que le cri de haro, par lequel, dans l’ancien duché souverain de Normandie, un citoyen pouvait introduire directement une plainte en justice (« Haro, nos ducs ! On m’a fait tort ! »). La thèse selon laquelle haro serait l’abrégé de Ha Raoul ! (Ha Rolf !, Ha Rollon !) est en effet loin de faire l’unanimité. « Des exemples recueillis par Littré montrent que haro, loin d’être toujours pris dans le sens judiciaire, se disait de n’importe quelle clameur » (Lorédan Larchey, Dictionnaire des noms, contenant la recherche étymologique de 20 200 noms relevés sur les annuaires de Paris, 1880, p. 223). De Normandie, le mot passe d’ailleurs chez Marie de France à la fin du XIIe siècle (harou), l’expression crier haro sur quelqu’un se généralisant au début du XVIIe siècle (A. Oudin, Recherches italiennes et françoises, 1640-42). Dauzat fait dériver haro du francique hara, qui est aussi à l’origine de l’ancien français harer, exciter les chiens en criant, et de hare, cri pour exciter (terme de vénerie) (A. Dauzat, J. Dubois & H. Mitterand, op. cit., p. 366). En langue d’oil, harauder signifiait “interpeller bruyamment” (et souvent injurieusement).
Quatre notions relatives au wütende Heer se trouvent constamment associées par l’étymologie : la guerre (et le cheval), la chasse (et le chien), le bruit ou la fureur, le harcèlement. Le francique hara, cité plus haut, et le vieux français harer, ont abouti au verbe moderne harasser (angl. to harass), à rapprocher du francique harmjan, tourmenter, et du verbe harceler. En matière de vénerie, on peut signaler le français harde (couple de chiens courants attachés ensemble dans une chasse à courre) et le v. fr. herde (F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècles, Bouillon, Paris, 1880-1902), dérivés du francique herda et de l’all. herde, troupeau (angl. herd ; cowherd, vacher) ; et aussi le mot harloup, attesté chez Gauchet en 1583, qui est une altération de hare-loup, terme utilisé dans la chasse au loup. En anglais, on a harrier, chien courant (plur. harriers, meute, équipage), qu’on retrouvera plus loin dans un passage consacré à Heer-hari.
La terminaison quin correspond à la forme dialectale normande de “chien” (4). Lazarre Sainéan écrit à ce sujet : « Hellequin n’est que la forme normande et primitive, dont l’aspect moderne est hèle-chien, c’est-à-dire chien qu’on hèle, qu’on lance sur le gibier, chien bruyant. Les synonymes ancien-français helle, herle, hierle, bruit, tumulte (primitivement de chasse), et hellir, herlir, faire du tapage (au fonds identiques à haller, harer, exciter un chien), rendent compte des variantes (...), de sorte que Mesnie Hellequin paraît signifier “équipage dé chiens bruyants”... » (art. cit., pp. 184-85).
D’une région à l’autre
À partir du XVIIe siècle, semble-t-il, on ne trouve plus d’allusions à la Chasse sauvage dans les grands textes littéraires du temps. Mais les traditions populaires, conservées jusqu’à nos jours, mainhiennent lé thème bien vivant. « Cette chasse fantastique a autant de noms qu’il y a de cantons dans l’univers », remarquait à juste titre George Sand. Pour le seul territoire français, M. Claude Seignolle n’a pas relevé moins de 60 dénominations (5).
Ces appellations peuvent être classées en 2 catégories. D’une part, celles qui utilisent, pour caractériser la Chasse ou celui qui la mène (le Grand Veneur), des noms de personnages historiques ou légendaires intégrés au mythe : Chasse du roi Artus, Charrette de David, Chasse à Caillaud, etc. D’autre part, celles qui donnent à la Chasse un qualificatif qui lui est propre : Chasse sauvage, Chasse galopine, etc.
Au-delà des limites de l’hexagone, la diffusion du mythe s’étend sur la plus grande partie de l’Europe. D’après le relevé systématique établi par A. Endter, on peut affirmer qu’à quelques exceptions près, comme l’Espagne (Exercito antiqua) ou la Corse (Squadra d’Arezzo), sa répartition correspond pratiquement aux aires d’influences celtiques et germaniques (op. cit., pp. 11-17).
L’examen des coutumes locales met en lumière certaines variations. C’est ainsi que, dans le Berry, le mythe s’intitule tantôt Chasse à baudet, tantôt Chasse à Rigaut. « La Chasse à baudet est une chasse nocturne qui traverse les airs avec des hurlements, des miaulements et des aboiements épouvantables, auxquels se mêlent des cris de menace et des accents d’angoisse » (Laisnel de La Salle, Légendes et croyances du Centre, Chaix, Paris, 1876, vol. I, p. 168). « La Chasse à Rigaut est un bruit qu’on entend à n’importe quelle heure de la nuit. On dirait un nombre considérable de voix de chiens de différente grosseur et, par dessus tout, la voix forte et grave d’un gros dogue accompagnant par intervalles égaux ce concert discordant » (L. Martinet, Légendes et superstitions du Berry, Bourges, 1879, p. 3).
On connaît la Chasse à Rigaut (Chasse Rigaud) dans le Poitou, mais on y parle aussi de Chasse Galopine. « Ce seraient des bêtes invisibles, poursuivies par des démons, qui passent dans les airs. On contait, dans les environs de Lussa-lès-Châteaux, qu’un garde-chasse audacieux, ayant tiré une nuit sur la Chasse Galopine, une bête fantastique tomba, car il avait fait bénir sa balle. Mais il pensa mourir de peur quand il fut invisiblement poursuivi par des voix qui lui criaient : — Rends-moi ma chasse ! Rends-moi ma chasse ! » (Roger Dévigne, Le légendaire des provinces françaises à travers notre folklore, 1950).
À Rochesson, dans les Vosges, « on dit que ce sont les cris des enfants morts sans avoir été baptisés », tandis qu’à Ventron, « on l’appelle la Remolière » (Richard, Traditions de la Lorraine, 1848, p. 222). Dans la vallée de Cleurie, « c’est la Manihennequin, en patois Mégnéye Hennequin, qui emporte les âmes qui sont dévolues aux démons » (Thiriat, La vallée de Cleurie, p. 351). À Dompaire, « c’est la Mesnie Hellequin » (L. Adam, Patois lorrains. Cité par Eugène Rolland, « La Chasse sauvage », in Mélusine, tome XI, 1912, col. 177), etc.
Le plus souvent, l’accent est mis sur l’étrange et terrifiante personnalité du chef de la troupe. « Si le voyageur attardé a eu le temps de faire oraison à saint-Hubert quand passe la Chasse du Grand Veneur, dit-on dans le Cantal, il est témoin du plus étrange spectacle : la meute, composée d’un nombre infini de chiens fantômes, fuit, muette, haletante... Des piqueurs en costume écarlate suivent, puis le Grand Veneur, vêtu d’écarlate, un fouet en main, et dont les mouvements rendent un bruit d’ossements » (Roger Dévigne, op. cit., p. 185). En Côte d’Or, « on voit le Chasseur noir près du château d’Entre-deux-Monts, commune de Concœur, tout vêtu de noir, monté sur un cheval noir, et entouré d’une meute couleur d’ébène. Il chasse toutes les nuits » (Clément-Janin, Traditions populaires de la Côte d’Or, 1884, p. 17). Au Bitcherland, le Chasseur se nomme Hudada. Il a les pieds fourchus, et porte un habit vert. Parfois, il apparaît à la tête d’un troupeau de chèvres. C’est un être bizarre, et quelque peu farceur. Il se promène avec sa tête sous le bras, pousse des cris effrayants, etc. On l’a vu souvent au Schlossberg, surgissant des rochers et des endroits brumeux. De nos jours, au cours des chasses, le gibier est encore rabattu au cri de “Hudada”.
“Huhde, huhdada !”
Les identifications historiques, on l’a vu, sont nombreuses. Parmi les personnages les plus souvent cités figure “Artu” (Arthu, Artus). Il s’agit évidemment du roi Arthur, héros celtique du cycle de la Table Ronde. Le roi Salomon, mentionné dans plusieurs régions, est peut-être l’un des 3 souverains bretons ayant porté ce nom.
Dans les Charentes et en Vendée, la Chasse Gallery (ou Chasse du Sieur de Gallery) est une « bande de seigneurs impies, dont on a voulu identifier le Grand Veneur avec Guillery, brigand fameux du temps de Henri IV » (R. Dévigne, op. cit., p. 185). On chante : « Entendez-vous la sarabande ? / O l’é la Chasse-Gallery ; Ici, au long, va passer pre bande / Et la garache (garou) et l’alouby (vampire ? ) / Gallery va-t-en-tête, / Monté sus un cheveau / Qu’a le cou d’ine bête / Et la péa d’un crapaud ! ».
En Côte d’Or, « les habitants de Pagny racontent que leurs ancêtres, chaque nuit qui précédait Noël, entendaient, dans la direction du bois de Chassagne, l’amiral Chabot chassant le cerf dans ses forêts. Cette chasse était une punition infligée à l’amiral parce que, assistant une fois à la messe de minuit dans sa chapelle, et ayant appris qu’un cerf venait de passer près de là, il quitta le service divin pour aller le chasser. Si le même bruit ne se fait plus entendre aujourd’hui à pareille époque, c’est que le temps du châtiment est expiré. Il a eu lieu, dit-on, pendant 140 ans » (Clément-Janin, op. cit.). L’idée selon laquelle l’équipage de la Chasse est formé de défunts ayant contrevenu aux règles religieuses (ou, plus rarement, laïques), et qui ont été condamnés à errer indéfiniment, est d’ailleurs l’une de celles qui reviennent le plus souvent.
En Alsace, où la Chasse reçoit encore le nom de Pfaffengejägd (dans la vallée de Munster), de Breithut ou Blauhüttel, le Nachtjäger (Chasseur de nuit) « passait avec fracas, suivi de sa troupe folle ; il venait du Nord, allant à l’Ouest jusque vers Illzach. Bien des gens l’ont entendu. Son cri de chasse était : “Huhde, Huhdada !”, et ses chiens rugissaient plutôt qu’ils n’aboyaient » (tradition orale recueillie par Auguste Stöber, et publiée par Jean Variot, Légendes et traditions orales d’Alsace, 1919, p. 59). En d’autres endroits, le Grand Veneur se nomme Hupéri, Hubi (6), ou encore Hütcher : il porte alors un immense chapeau noir, rabattu sur les yeux. En Basse-Alsace, c’est dans la forêt de Modern, et à l’automne, qu’il fait son apparition. « Venant du Nord, il passe au-dessus des cimes, hurlant et soufflant. Après avoir parcouru les plaines labourées, il met ses chevaux à paître sur la pente et descend vers Utwiller (..). Au milieu du tapage déchaîné, le piéton solitaire s’entend parfois appeler par son nom. Il ne doit pas répondre, sinon il serait saisi par les puissances des ténèbres et s’égarerait toute la nuit dans la forêt. Au moment où le Chasseur sauvage approche, le piéton doit simplement prendre son mouchoir (qui, de préférence, sera blanc, de lin ou de chanvre), l’étaler à terre et se placer dessus : ainsi il est à l’abri de tout danger » (Ibid, pp. 338-39).
L’apparition du Chasseur a parfois valeur prémonitoire. Dans le Périgord, à Exiceuil et dans les environs, il existe une Chasse volante. « Lorsque cette chasse paraît, c’est un signe certain qu’il doit se passer de grands événements, tels que la guerre, la famine, etc. C’est bien pis encore, lorsqu’elle descend jusqu’à terre. C’est ainsi qu’on l’a vue au commencement de la Révolution. En effet, elle se fit entendre peu de temps avant ce qu’on a nommé la peur ; elle reparut ensuite en l’année 1792, avant la Terreur » (W. de Taillefer, Antiquités de Vésone, 1822, tome I, p. 244).
Connue dans le Bourbonnais sous le nom de Chasse Gayère, la suite infernale passe pour être menée par le Diable, qui poursuit avec sa meute les âmes des mourants. « Un homme, couché dans son lit, entendant la chasse nocturne, dit : — Apporte-moi de ta chasse. — Tiens, voilà ta part ! répondit une voix, et au même moment un bras humain ensanglanté tomba aux pieds de l’imprudent » (Ach. Allier, L’Ancien Bourbonnais, tome II, 2ème partie, p. 12).
Ce mythème se retrouve en différentes régions. Par ex. dans le Forez, où la Chasse royale passe aussi pour être menée par les démons. « Quand vous l’entendrez passer, ne criez pas pour insulter le Diable, car une voix infernale vous dirait : — Veux-tu chasser avec nous ? Tiens, voilà ta part de la curée ! Et vous verriez tomber des nuages des membres humains ensanglantés. Conservez, au contraire, tout votre calme, et tracez vivement une croix sur le sol. L’âme poursuivie viendra s’y réfugier, et vous la sauverez peut-être » (L.P. Gras, Évangiles des quenouilles foréziennes, Montbrison, 1865, p. 93. Cité par E. Rolland, op. cit., col. 176).
Saint-Hubert, saint-Eustache
[Ci-dessous : Hubert de Liège, manuscrit bourguignon du XVIe s. Dans l'iconographie chrétienne, le cerf crucifère est l'attribut de 4 saints : Eustache, Jean de Matha, Félix de Valois, et Hubert d'Ardenne]
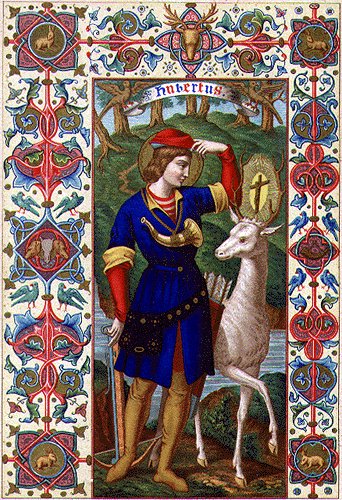 L’examen comparatif des textes littéraires et des récits conservés par la tradition populaire permet de penser que la Chasse sauvage n’est rien d’autre qu’un mythe dégradé. Et point n’est besoin d’être grand clerc pour se douter que cette dégradation n’est pas intervenue spontanément, la mythologie indo-européenne étant toujours restée identique à elle-même (sous différents avatars), aussi longtemps que se maintenait son cadre de référence socio-idéologique.
L’examen comparatif des textes littéraires et des récits conservés par la tradition populaire permet de penser que la Chasse sauvage n’est rien d’autre qu’un mythe dégradé. Et point n’est besoin d’être grand clerc pour se douter que cette dégradation n’est pas intervenue spontanément, la mythologie indo-européenne étant toujours restée identique à elle-même (sous différents avatars), aussi longtemps que se maintenait son cadre de référence socio-idéologique.
La dégradation du mythe se caractérisant, non seulement par l’altération du thème et la confusion des éléments, mais aussi par l’inversion des valeurs qui s’y trouvent contenues, on y verra plutôt, non sans raison, l’un des effets du véritable bouleversement mental provoqué par l’intrusion du christianisme en Europe. Ce bouleversement, dont le bilan définitif est encore loin d’avoir été dressé, a entraîné tout un processus de fractionnement, d’éclatement et d’aliénations au niveau des croyances populaires. Du jour au lendemain, les divinités tutélaires se trouvèrent rejetées du côté des puissances infernales, leurs serviteurs pourchassés (7), leurs sanctuaires détruits, tandis que les mythes qui ne pouvaient être expurgés étaient assimilés et privés de sens. Modifiés en fonction de la morale nouvelle, ou de la tradition biblique, les mythes se trouvèrent ainsi enrichis ou appauvris selon des critères n’ayant plus aucun rapport avec leur idéologie d’origine. Ils cessèrent de s’appartenir.
Dans la plupart des cas, les mythes n’ont donc pas disparu. Ils sont, au contraire, restés bien ancrés dans l’esprit des populations rurales (pagani, “paysans”, et par suite “païens”), qui les ont conservés jusqu’à nos jours. Mais leur portée n’est plus la même. Leur signification a changé.
Intégré au légendaire chrétien, le thème de la Chasse sauvage a pris les allures d’un fabliau moralisant. Le Grand Veneur a été assimilé au Malin ; et sa troupe, au long cortège des âmes en peine qui ne peuvent trouver le repos.
Il s’agit, dans certains cas, d’un personnage réputé pour sa dureté ou ses crimes. C’est ainsi qu’en Lorraine thioise, un certain Naltitz, noble intendant ayant réellement existé, aurait été condamné à chevaucher sans fin pour expier ses méfaits. Dans le Roussillon, on parlera de “Mauvais Chasseur”, en Normandie, de “Chasse Caïn”, au Pays de Bresse, de “Chasse du roi Hérode”. Ailleurs, le mythème est plus explicite encore. Il met en scène un seigneur ayant préféré traquer le cerf, c’est-à-dire sacrifier au rite païen (les condamnations religieuses relatives au cerf seront évoquées plus loin), plutôt que d’assister à un office chrétien. Pour souligner le contraste, la Chasse se déroule à l’occasion d’une solennité particulière, généralement le Vendredi saint (jour de jeûne, d’abstinence et de deuil). Le seigneur ne se contente pas de manquer la messe. Il se rend à la chasse. Pis, à la chasse au cerf. Il est alors maudit, et condamné à “chasser éternellement”.
La “récupération” s’étend parfois au cerf lui-même. Il en est ainsi dans le récit de Hugo der Rote, comte de Dagsburg, qui, d’un même coup d’épieu, aurait mis à mort un cerf et l’ermite qui voulait le protéger, et surtout dans les légendes, étrangement semblables, de saint-Hubert et saint-Eustache.
Eustache (fête le 20 septembre) aurait été un général romain, ayant servi sous le règne de l’empereur Trajan. Possédant une immense fortune, il se serait rendu célèbre par ses exploits. Ce fut en courant le cerf qu’il se convertit. Un jour qu’il poursuivait un daguet, celui-ci se retourna soudain. Eustache aperçut alors entre ses bois une éclatante image de la Croix, et entendit une voix qui lui « tint un long discours propre à transformer son âme » (Omer Englebert, La Fleur des saints, Albin-Michel, 1962, p. 404). Il décida sur le champ d’embrasser le culte chrétien, avec sa femme, Théopiste, et ses enfants. L’abbé Englebert ajoute : « C’est peut-être un martyr oriental, inconnu de nous, qui a donné naissance à cette légende ».
L’histoire d’Hubert (657-727), saint patron des Chasseurs, est encore plus caractéristique. « Hubert chassait, un Vendredi saint, dans la forêt des Ardennes, ce qui était chose peu convenable pour un chrétien. Soudain, un beau cerf, qu’il poursuit avec ardeur, s’arrête et lui fait face. Entre les cornes de l’animal brille une croix éclatante, et une voix prononce ces paroles : — Hubert ! Hubert ! si tu ne te convertis pas et ne mènes pas une vie sainte, tu descendras bientôt en enfer ! » (L. Jaud, Vie des saints pour tous les jours de l’année, Mame, 1950, p. 480). Dûment averti, Hubert se rend à Rome. Il succédera par la suite à l’évêque Lambert, à la tête du diocèse de Tongres. On l’invoque contre la rage et la peur. Sa fête est fixée au 3 novembre.
Fort curieusement, les auteurs ne s’entendent pas sur les origines d’Hubert. L’abbé Jaud fait de lui « un prince de la lignée de Clovis, roi de France », qui aurait renoncé, après sa conversion, à ses droits sur la couronne d’Aquitaine. Robert Dévigne le décrit comme un prince franc élevé, dès la petite enfance, pour le métier des armes (op. cit., p. 182). D’autres le croient d’humble extraction, et le font naître au pays de Liège. L’abbé Englebert préfère ne pas se prononcer (7 bis).
Deux aspects
Au travers de ses différentes variantes, le thème de la Chasse sauvage semble présenter 2 aspects principaux. Tantôt la Chasse est une troupe de guerriers à cheval, généralement vêtus de noir, qu’accompagne une troupe bruyante et disparate ; c’est le wütende Heer, “l’armée infernale”, qui devient parfois un simple cortège d’âmes en peine, une troupe de damnés, quand elle ne dégénère pas en danse macabre (8). Tantôt il s’agit d’un véritable équipage de chasse, conduit par un chasseur-fantôme (le Grand Veneur), et qui comporte des montures, des chiens, une proie, une suite, etc. La proie est généralement un cerf ou un sanglier, ou encore une femme (nue, vêtue d’une robe blanche, etc.). C’est la Wilde Jagd, la “Chasse sauvage”.
Ces 2 aspects coexistent sur toute l’aire de diffusion du mythe, et notamment sur le territoire français. Dans le cadre germanique, le wütende Heer semble toutefois plus répandue dans les contrées méridionales, alors qu’on rencontre plus fréquemment la Wilde Jagd dans les parties septentrionales (cette distinction étant d’ailleurs très relative, puisque les 2 formes sont souvent juxtaposées).
Quoi qu’il en soit, le mythe comporte d’évidence des éléments culturels caractéristiques de l’idéologie indo-européenne des origines, et notamment des croyances funéraires (Totenzug, train de la mort), des Männerbunde (sociétés d’hommes), et des rites de renouvellement.
Les “sociétés d’hommes”
C’est le mérite d’Otto Höfler d’avoir établi que les traditions populaires liées à la Chasse sauvage n’étaient pas le produit d’une quelconque « mythologie naturelle » (Naturmythologie), comme de nombreux historiens des religions ou folkloristes étaient enclins à le penser sous l’influence des conceptions de Mannhardt, mais qu’elles reflétaient au contraire de très anciennes croyance indo-européennes, liées aux activités des « sociétés d’hommes traditionnelles ».
Exposées dans l’ouvrage intitulé Kültische Geheimbünde der Germanen (Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt a.M., 1934), les conceptions de Höfler avaient été annoncées et préparées par les travaux de H. Güntert (Ueber altisländische Berserkergeschichten, Heidelberg, 1912), Axel Olrik (Danmarks Keltedugtning, I, 2, Kobenhavn, 1903), Lilly Weiser (« Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbunde », in E. Fehrle (dir.), Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft, Baden, 1927), et K. Meuli (Archiv für Volkskunde, Schweiz, 1928). Par la suite, Georges Dumézil (Mythes et dieux des Germains : Essai d’interprétation comparative, op. cit.) et Stig Wikander (Der arische Männerbund, Lund, 1938) devaient montrer à leur tour toute l’importance des confréries d’hommes dans les plus anciennes sociétés indo-européennes.
Il ne saurait être question de traiter ici de ce que furent les Männerbunde (9). On se contentera seulement d’énumérer quelques faits en rapport avec la Chasse sauvage. La comparaison de ce que nous savons sur le wütende Heer et de certains témoignages des auteurs antiques laisse en effet penser que le mythe a, entre autres, agrégé des rites propres aux sociétés guerrières du monde indo-européen.
Tacite, dans sa Germania, évoque le comportement d’une troupe de guerriers germains, les Haries (Harii). « En plus d’une puissance par laquelle ils dépassent les peuples que je viens d’énumérer, écrit-il, leur âme farouche enchérit encore sur leur sauvage nature, en empruntant les secours de l’art et du moment : boucliers noirs, corps peints ; pour combattre, ils choisissent des nuits noires ; l’horreur seule et l’ombre qui accompagnent cette armée de lémures suffisent à porter l’épouvante, aucun ennemi ne soutenant cette vue étonnante et comme infernale, car en toute bataille les premiers vaincus sont les yeux » (Germania, 43).
Le nom de “l’armée”
Le nom des Haries semble vouloir dire “les guerriers”, ou plus précisément, note A. Endter, « ceux qui appartiennent à la troupe », « ceux qui en font partie » (op. cit., p. 8). Ils ne constituaient probablement pas un peuple, mais plutôt une fraternité d’armes, un Kriegsbund, « compagnonnage guerrier ». L’usage de « peindre leur corps » (tincta corpora) ne serait pas tant une ruse de guerre qu’« une identification magique à l’armée des esprits, l’armée de la Chasse sauvage » (Jacques Perret, Tacite : La Germanie, 1962, p. 97) (10).
La dénomination de ces guerriers nous renvoie d’ailleurs au nom de l’armée (Heer), et à travers lui à Herle-Hellequin. Ce nom, rappelle Émile Benveniste, « est un terme commun aux dialectes germaniques : got. harjis, v.isl. herr, v.h.a. hari. Il se rencontre déjà plusieurs fois sous la forme hari- dans les inscriptions runiques. On le trouve en outre comme Hario-, Chario-, dans des noms propres germaniques transmis par les auteurs classiques » (Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Minuit, 1969, I, p. 111). Une multitude de noms et de prénoms en dérivent : Herod, Harald, Herdegen, Harward, Harwig, Harloff, Harring, Harling, Herke, Herrmann, Harrich, Herrmuth, Harlepp, Hariman, Herbrand, Harifrid, Herigaud, Hebert, Harprecht, Haribald, Hariard, etc. (Albert Heintze, Die deutschen Familienrnamen : Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle a.S., 1908, p. 159). Le gotique harjis, ajoute Benveniste, « se définit comme une troupe dévastante : l’activité propre au Heer est caractérisée par le verbe dérivé isl. herja, v. h.a. herian, faire une razzia, all. heeren, verheeren, dévaster... » (op. cit., p. 113). En vieux français, le mot haraux — enlèvement des chevaux pris à l’ennemi — évoque également l’idée de rapine. Citons encore le harnais, qui désigne d’abord (vers 1155) l’ensemble de “l’équipement d’homme d’armes”, et provient du scand. hernest, provision d’armées ; la haridelle (cheval) et la harangue (fr. médiéval harenga), qui apparaît en 1395 chez Christine de Pisan, et dérive du francique hari-hring, réunion de l’armée. En anglais, le mot harrier — chien courant —, cité plus haut, veut aussi dire “dévastateur” et “pillard”. On a également to harry, harceler, piller, pourchasser, tourmenter, dévaster, harridan, vieille sorcière (à rapprocher de harpy, mégère ; fr. harpie), et surtout l’expression populaire et significative old Harry, qui est l’un des surnoms du Diable (to play old Harry somewhere : hanter une maison ; to play old Harry with somebody : en faire voir de dures à quelqu’un).
“Fureur de Berserkir”
Tacite parle aussi des Chattes (11), peuple germanique dont il rapporte les usages. « Dès qu’ils sont parvenus à l’âge d’homme — écrit-il —, ils laissent pousser cheveux et barbe, et c’est seulement après avoir tué un ennemi qu’ils déposent un aspect pris par vœu et consacré à la vertu. Sur leurs sanglants trophées ils se découvrent le front, alors ils croient avoir payé le prix de leur naissance, être dignes de leur patrie et de leurs parents ; les lâches et les poltrons restent dans la saleté. Les plus braves portent en outre un anneau de fer — ce qui est ignominieux chez cette nation — en guise de chaîne, jusqu’à ce qu’ils se rachètent par la mort d’un ennemi (12) (…). C’est à eux qu’il appartient d’engager tous les combats ; ce sont eux qui forment toujours la première ligne, étonnante à voir. Car même en temps de paix, ils n’adoptent pas des manières plus douces, ni plus traitables : aucun d’eux n’a maison ou terre, ou souci de rien ; selon qu’ils viennent chez l’un ou chez l’autre, on les nourrit, prodigues du bien d’autrui, dédaigneux du leur... » (op. cit., 31).
Les Chattes ouvrent le combat, et forment la première ligne. Les Haries jettent l’épouvante autour d’eux. Les uns et les autres forment des sections d’assaut, dont les membres constituent une véritable élite guerrière. Ce sont des sociétés vivant en marge, coupées en droit comme en fait des autres communautés, qui leur doivent assistance et secours. Elles sont à l’image de la « troupe des combattants infernaux », menée par Odhinn (Odin-Wodan).
La conception germanique de l’au-delà est bien connue : « Dans la demeure fabuleuse d’Odhinn, dans la Valhöll (Valhalla), vivent à jamais les hommes qui, depuis le début du monde, sont morts dans les combats » (G. Dumézil, op. cit., p. 79). Ce sont les « élus d’Odhinn », les Einherjar (13), que le dieu souverain a fait chercher par les Walkyries. Ils partagent leur temps entre l’hydromel de la chèvre Heidhrûn, qui arrose la chère du sanglier Saehrmnir, et des combats prodigieux. Combattants d’élite, ils prendront les armes avec Odhinn, Herjan, “seigneur des guerriers”, le jour où l’appel du coq sonnera l’heure du Ragnarök. Et c’est avec lui qu’ils périront dans l’incessant recommencement du crépuscule des dieux.
Les Einherjar constituent tout naturellement le modèle des sociétés guerrières de Germanie. Dans un passage “historicisant” le dieu souverain, l’Ynglingasage (la saga des Ynglings, premier chapitre de la Heimskringla, histoire des rois de Norvège) décrit les compagnons d’Odhinn en des termes que Tacite n’aurait pas reniés : « Ils allaient sans cuirasse, sauvages comme des chiens ou des loups. Ils mordaient leurs boucliers et étaient forts comme des ours et des taureaux. Ils massacraient les hommes, et ni le fer ni l’acier ne pouvaient rien contre eux. On appelait cela fureur de Berserkir » (Snorri Sturluson, Heimskringla, American-Scandinavian Foundation & Univ. of Texas Press, New-York & Austin, 1964, p. 10). L’hypothèse a même été avancée selon laquelle la mort du dieu Baldr (Balder) serait un mythe correspondant à un rituel d’initiation destiné aux jeunes guerriers (14).
Quête et tapages
Des rapprochement non moins significatifs peuvent être établis entre “l’armée infernale”, les “confréries de jeunes gens” du folklore européen, et les sociétés masculines de l’Antiquité germanique. Les unes et les autres présentent des traits communs : règles éthiques qui leur sont propres, activités “en marge”, tapages nocturnes, droit de rapine (ou de quête), etc. Évoquant les sociétés d’hommes, Dumézil a pu écrire :
« Par un abâtardissement dont notre siècle a vu les derniers effets, elles ont donné dans tout le monde germanique une partie des mascarades d’hiver ; à l’occasion et à l’abri des déguisement animaux (ours, loups, boucs...), la “société des garçons” du village se reforme et, récemment encore, faisait régner une petite terreur : maisons envahies, quêtes impérieuses, huches pillées, filles troussées, femmes poursuivies, ces élémentaires scénarios du “déchaînement” qui, à travers leur déchéance, rappellent encore si clairement les légendes des Centaures grecs et les rituels des Luperques romains, sont le dernier témoignage de tout ce que pouvaient, de tout ce que devaient faire, dans leur Uebermut, les jeunes Hommes-Bêtes de l’antique Germanie » (op. cit., p. 89).
R. Christinger et W. Borgeaud ont montré, au travers d’exemples pris dans le folklore suisse contemporain, que les mascarades des « confréries de jeunes gens », bien des siècles plus tard, sont sensiblement restées les mêmes (op. cit., pp. 13-15).
Dans la vallée du Lötschental, la tradition veut que les Roitscheggeten, dont le nom signifie “ceux qui sont tachés de suie”, pénètrent dans les maisons par les cheminées. Ce sont des jeunes gens d’une vingtaine d’années, qui doivent subir certaines épreuves avant d’être admis dans la confrérie. Jusqu’à une date récente, ils se répandaient dans les villages peu avant le Mercredi des Cendres. Vêtus de peaux de bêtes, imitant le mugissement du taureau et agitant une clochette suspendue à leur ceinture, ils pillaient le boucher et le boulanger, et recevaient, dans les maisons qu’ils visitaient, abondance de victuailles. À leur passage, les femmes se cachaient, sous peine d’être poursuivies et aspergées de purin, de sang ou d’eau mêlée de suie.
 Les Klausen, autre confrérie de jeunes gens, quêtent en Appenzell de maison en maison, à la fin de l’année ou au début de l’an nouveau. À Urnäsch, dans les Rhodes-Extérieures, ils se manifestent dans la nuit de la saint-Sylvestre, puis lors du Carnaval, dans la nuit du 13 au 14 janvier. Les quêteurs sont généralement déguisés en femmes. Leur tournée s’accompagne de cris, de sons de cloches et de clochettes, parfois de danses.
Les Klausen, autre confrérie de jeunes gens, quêtent en Appenzell de maison en maison, à la fin de l’année ou au début de l’an nouveau. À Urnäsch, dans les Rhodes-Extérieures, ils se manifestent dans la nuit de la saint-Sylvestre, puis lors du Carnaval, dans la nuit du 13 au 14 janvier. Les quêteurs sont généralement déguisés en femmes. Leur tournée s’accompagne de cris, de sons de cloches et de clochettes, parfois de danses.
D’après A. Van Gennep, l’analyse des édits de police diocésains ou municipaux de la fin du XIVe et des XVe et XVIe siècles montre qu’il existait en Alsace, à la fin du Moyen-Âge, au moins 4 catégories de quêtes, lesquelles, « à cause de leur caractère comminatoire, déterminaient parfois des abus et des désordres». On les nommait Bechten ou Bechtmunzüge. Les textes contiennent parfois des détails révélateurs. Ainsi cet édit, promulgué à Strasbourg en 1483, qui défend « que personne, soit homme ou femme, ecclésiastique ou laïque, ne se présente pour quémander revêtu d’oripeaux ou en manière de paysan, ou autrement déguisé ou méconnaissable, aux chambres et aux maisons, que ce soit de jour ou de nuit ». Pourtant, au XIXe siècle, les jeunes gens de Kaltenhouse (Bas-Rhin, canton de Haguenau) avaient encore coutume, durant l’Avent, de jeter du blé ou du maïs contre les fenêtres, et d’organiser des charivaris devant les maisons (Manuel de folklore français contemporain, tome premier, VII : Cycle des douze jours, A. & J. Picard, 1958, p. 2875).
Au XVe siècle, quêtes et tapages caractérisaient aussi les activités des confréries bâloises. Durant les nuits de Noël et de Nouvel An, les quêteurs, agitant des sonnailles et bâton à la main, se déguisaient, comme au temps de Carnaval, en boucs (Böckerweise) ou en diables cornus. La jeunesse d’Affoltern, canton de Zurich, usait des mêmes déguisements.
Cette coutume rappelle les “quêtes de Noël” (Flandre, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas), les “battages de printemps” allemands (A. Schulte, « Germanisches Kulturerbe im Frühlingsbrauchtum Westfalens », in Germanien, Berlin, mars 1939, pp. 116-29), et aussi les Schembartläufer, qui parcouraient durant le Carnaval les rues de la ville de Nuremberg, une fourche à la main, des clochettes à la ceinture, et le visage recouvert d’un masque de bouc.
 Au Moyen-Âge, la Fête des Fous, présidée généralement par un “évêque” ou un “prince des Fous”, donnait lieu à de véritables Saturnales. Le clergé était parodié, et les églises bafouées. Des personnages masqués se livraient à toutes sortes d’excentricités, lançaient des ordures au visage des passants, et menaient grand tapage, au scandale des autorités ecclésiastiques et séculières. Jusqu’au XVIe siècle, début janvier, on célébrait à Zurich la Bechtelistag. Les jeunes buvaient et festoyaient abondamment. On appelait cela “aller chez Berchtold”. En Suisse alémanique et dans les Grisons, ces groupes d’adolescents s’érigeaient même en tribunaux, et se donnaient le droit de pillage : le Putzen ou Butzenrecht.
Au Moyen-Âge, la Fête des Fous, présidée généralement par un “évêque” ou un “prince des Fous”, donnait lieu à de véritables Saturnales. Le clergé était parodié, et les églises bafouées. Des personnages masqués se livraient à toutes sortes d’excentricités, lançaient des ordures au visage des passants, et menaient grand tapage, au scandale des autorités ecclésiastiques et séculières. Jusqu’au XVIe siècle, début janvier, on célébrait à Zurich la Bechtelistag. Les jeunes buvaient et festoyaient abondamment. On appelait cela “aller chez Berchtold”. En Suisse alémanique et dans les Grisons, ces groupes d’adolescents s’érigeaient même en tribunaux, et se donnaient le droit de pillage : le Putzen ou Butzenrecht.
Toutes ces expressions sont évidemment de même origine. Bechtelistag, “Berchtold”, sont à rapprocher de l’expression alsacienne Bechten ou Bechtmunzüge. L’Allemagne du sud, le Tyrol, l’Autriche et la Suisse alémanique connaissent d’ailleurs berchten et perchten, où certains mythologues ont vu une allusion à Berchta et Perchta (divinités dont il sera parlé plus loin). Le droit de rapine (Putzen, Butzenrecht) caractérise aussi bien les sociétés guerrières du vieux monde germanique (Roitscheggeten, Lötschentaler, etc.) que les modernes « confréries de jeunes gens ». Putzen, en dialecte autrichien, veut dire stehlen, c’est-à-dire “voler” (anglais to steal, stole, stolen). Otto Höfler, qui rappelle que les jeunes Spartiates possédaient aussi le droit de rapine, pense que les membres des sociétés guerrières obéissaient à des mobiles sacrés. Masqués, circulant « comme des démons en action de rapiner », ils allaient rencontrer la Mort et ses esprits (op. cit., pp. 257-64).
Christinger et Borgeaud évoquent également ces « fêtes de la jeunesse » qui se nomment Chalandamars en Engadine, Calonda Mars, Clendamars ou Ondamarasa, dans les Grisons. Elles ont lieu le 1er mars, en pleine période de renouvellement (c’est à cette date que les charges officielles prennent fin, que les autorités sont élues, et les contrats révisés). Des jeunes garçons défilent alors, portant des cloches et des sonnailles (au val Misox, le bruit est censé réveiller la nature, et favoriser la croissance de l’herbe). Ils sont parfois déguisés, comme à Carnaval, font des quêtes, chantent des airs de circonstance, et souhaitent prospérité aux donateurs. Il arrive même qu’ils luttent à qui fera le plus de bruit.
Des coutumes analogues ont été observées en Alsace. Le lundi de Pentecôte, les Pfirtgstknecht (ou Pfingstfledderi), déguisés et en cortège, vont quêter de maison en maison. Ils chantent des airs traditionnels, où il est question d’« envoyer la martre dans le poulailler » des pingres (Robert Redslob, À travers les villages d’Alsace, Woerth, 1956, p. 44).
Männerbunde et “confréries” ont donc une fonction précise. Au sein des sociétés indo-européennes, dont l’ordre est la loi, elles assument un rôle indispensable de défoulement conventionnel. Cette « fonction de fantaisie, de tumulte et de violence — écrit Dumézil — n’est pas moins nécessaire à l’équilibre collectif que la fonction conservatrice (ordre, tradition, respect des tabous) qu’assument les hommes mûrs, et éventuellement les vieux » (op. cit., p. 85).
C’est donc dans les périodes de transition et de renouvellement (les équinoxes et les solstices) que se manifestent les scénarios mythico-rituels des confréries exhubérantes. Il s’agit, en quelque sorte, de conjurer la mort (la fin du cycle) par la vie dans ce qu’elle a de plus démonstratif. C’est pourquoi l’on voit aller de pair les cortèges de masques carnavalesques, l’apparition des animaux, des motifs, des divinités chtonico-funéraires. À ces époques de l’année, les ancêtres reviennent visiter les vivants : « Les affiliés rencontrent les morts qui, surtout aux environs du solstice d’hiver, reviennent sur la terre » (M. Eliade, Naissances mystiques, 1959, p. 178) (15). La chaîne biologique des générations se scelle dès initiations marquant l’entrée dans l’âge adulte. Le vacarme, les sons de trompe, les abois, marquent ces solennelles retrouvailles. La Chasse sauvage en est le plus présent symbole (M. Eliade, Le mythe de l’éternel retour, 1949, pp. 107-12).
Odhinn, dieu terrible et inquiétant
[Ci-dessous : Gravure d'Otto Ubbelohde, Grimmsche Märchen, Elwert Verlag, Marburg/L., 1922. Les voleurs étaient autrefois pendus ou étranglés. Étaient-ils consacrés à Odhinn ? Ils attiraient en tout cas les « mouettes d’Ygg », les corbeaux]
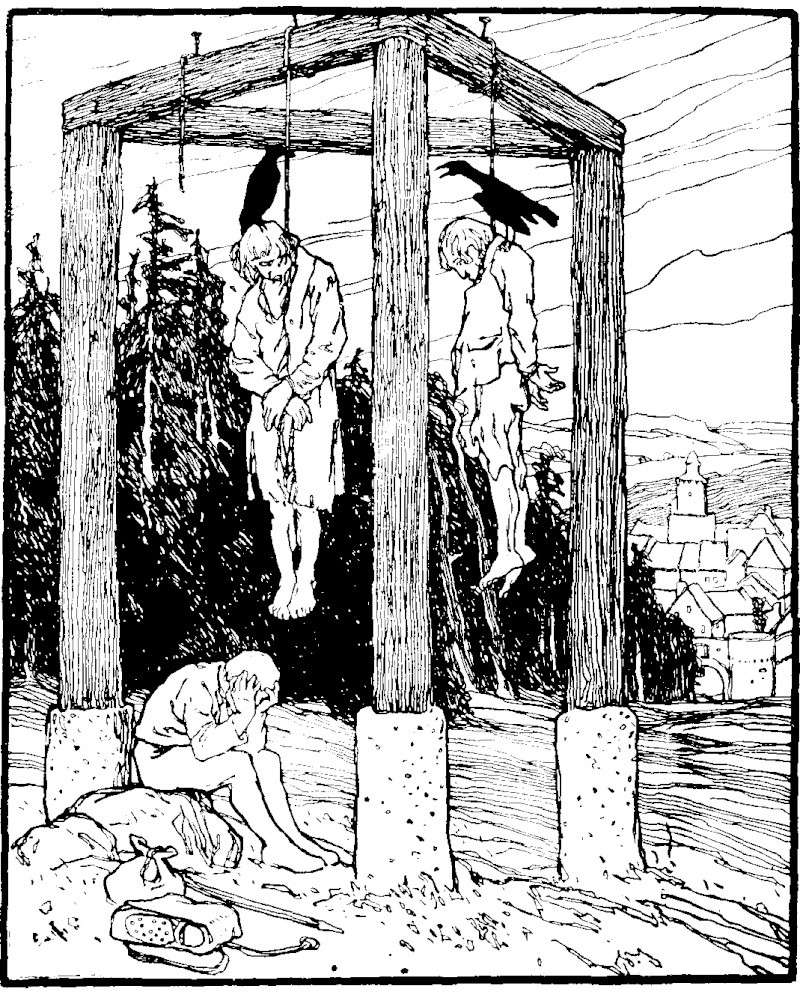 L’existence de liens étroits entre le wütende Heer et les sociétés masculines de l’Antiquité nord-européenne conduit, tout naturellement, à poser la question des relations pouvant exister entre le Chasseur sauvage (le Grand Veneur) et le chef des Berserkir et des Einherjar, le dieu Odhinn.
L’existence de liens étroits entre le wütende Heer et les sociétés masculines de l’Antiquité nord-européenne conduit, tout naturellement, à poser la question des relations pouvant exister entre le Chasseur sauvage (le Grand Veneur) et le chef des Berserkir et des Einherjar, le dieu Odhinn.
Dans sa Deutsche Mythologie, parue en 1835, Jacob Grimm avançait déjà l’hypothèse selon laquelle le Chasseur serait la représentation d’un Odhinn-Wodan plus ou moins déchu. En 1895, Wolfgang Golther, dans son Handbuch der Germanischer Mythologie, édité à Leipzig, se rangeait à la même opinion. Aujourd’hui, nombreux sont les ethnographes à s’être laissés convaincre par les brillantes démonstrations d’O. Höfler (16). Il est maintenant reconnu, écrit M. F. Lot, « que le conducteur de la Chasse sauvage n’est autre, à l’origine, que le grand dieu germanique Wodan. Sur ce point, la question peut être considérée comme réglée » (art. cit., p. 433).
Le nom même d’Odhinn, « dieu terrible et inquiétant » (Dumézil dixit), vient renforcer cette hypothèse. Il dérive en effet du vieux-scandinave ôdhr, qu’Adam de Brême a traduit par furor, et qui correspond au gotique wôds, possédé, et à l’allemand Wut, fureur (angl. wuthered : fr. envoûté ?). Pris comme adjectif, le mot peut signifier “violent”, “furieux”, “rapide”. Substantivé, il exprime l’ivresse, l’excitation, le génie poétique, le mouvement de la mer, de l’orage et du feu (G. Dumézil, Les dieux des Germains, op. cit., pp. 57-59). « Odhinn, c’est le possesseur de l’ôdhr multiforme, de cette Wut volontiers nocturne qui anime aussi sur le continent les chevauchées de la Chasse fantastique (das wütende Heer), dont Wôde, Wôdan est parfois le chef » (Mitra-Varuna, Gallimard, 1948, p. 146).
Pour É. Benveniste, ce nom, formé de Woda-naz : chef de la Woda, dit bien qu’Odhinn est à la tête de la “fureur” ou de “l’armée furieuse”, c’est-à-dire de ce qu’on appelé plus tard la Wuotanes heri (all. wütendes Heer). Son surnom de Herjan, seigneur des guerriers, renvoie lui aussi à la direction de l’armée (op. cit., II, pp. 112-13). Dans l’un et l’autre cas, nous voyons donc se confirmer qu’Odhinn-Wodan est un dieu du tumulte (17).
« Le caractère d’Odhinn est complexe et peu rassurant — écrit Dumézil. Le visage dissimulé sous son capuchon, dans son manteau bleu sombre, il circule à travers le monde, à la fois maître et espion » (Les dieux des Germains, op. cit., p. 46).
Sa complexité (dans une étude intitulée Odensheite, parue en 1924 à l’Université d’Oslo, M. Hialmar Falk n’énumérait pas moins de 169 noms, surnoms et qualificatifs attribués à Odhinn) tient au fait qu’il exerce une double fonction, à la fois souveraine et guerrière. Seigneur du peuple des Ases, il est le roi des dieux, le dieu des rois (18), le dieu d’une partie des morts (19) et le dieu magicien. Dieu du seid, maître de la magie, il tient sa sagesse de la tête parlante du géant Mimir. Dieu de la poésie, c’est par ruse, en empruntant l’apparence d’un aigle, qu’il s’empare de « l’hydromel des scaldes ». On lui doit aussi la découverte des runes. Pour en connaître les secrets, il est resté 9 jours et 9 nuits suspendu à un arbre agité par le vent, offert en sacrifice à lui-même, sans boire ni manger. De là, probablement, le fait qu’il soit aussi le dieu des pendus (20).
Tout cela lui vaut une quantité de pouvoirs : pouvoir d’ubiquité ou de translocation (il adopte alors des formes animales : aigle, cheval, ours, loup, etc.), pouvoir d’aveugler, d’assourdir, de paralyser ses adversaires. Sa magie lui sert à l’administration du monde. Il peut éteindre le feu, calmer la mer, tourner les vents, prévoir les événements et le destin des hommes. Intervenant dans les batailles, il « lie d’un lien » les guerriers dont il a décidé la perte (21).
Odhinn possède une lance de fer, Gungir, sur laquelle sont gravées de puissantes runes magiques. Il est le dieu-au-javelot (22). Il est aussi « Ase-aux-corbeaux », car 2 corbeaux, Hugin (l’esprit) et Munnin (la mémoire), volent à ses côtés, qui lui rapportent le fruit de leurs observations. Sleipnir, son cheval à 8 pattes, est le plus rapide des coursiers. Sa femme s’appelle Friga, ses enfants, Thor et Baldr. Odhinn est borgne. La version méridionale de son nom, Wodan, se retrouve dans la forme anglo-saxonne du mot “mercredi” (“jour de Mercure”) : Wednesday, de Wôdnesdaeg (23).
Le Chasseur sauvage a tous les traits d’Odhinn. Son allure est inquiétante, voire effrayante : corps velu, parfois couvert de mousse, plus généralement livide et grisâtre (A. Endter, op. cit., p. 33). Il arrive qu’il soit borgne (n’a-t-il pas le “mauvais œil” ?). La tradition lui prête le pouvoir de rendre fou, aveugle ou sourd, de paralyser les importuns et les voyageurs égarés (Ibid., p. 48).
“Corbeau de nuit”
 Dans les pays de culture germanique, le Wilde Jäger porte d’ailleurs le nom de Wodan ou d’Odhinn. Pour désigner la Chasse sauvage, en Suède, on parle d’Odenjagar ou d’Odensjagd. Au Danemark, il est question d’un Odinsjäger, en Norvège, de l’Asgardreit, la “chevauchée d’Asgard” (24). Au Schlesvig-Holstein, le Nachtjäger (Chasseur de nuit) se nomme Wod ou Wode, dénominations également utilisées au Mecklenbourg, où l’on évoque le passage de la Wodensheer ou de la Wodensjagd, et en Poméranie. Aux Pays-Bas, le Chasseur s’appelle Nachtrabe (corbeau de nuit) (25), mais aussi Woedende Leger (Ibid., pp. 11-17).
Dans les pays de culture germanique, le Wilde Jäger porte d’ailleurs le nom de Wodan ou d’Odhinn. Pour désigner la Chasse sauvage, en Suède, on parle d’Odenjagar ou d’Odensjagd. Au Danemark, il est question d’un Odinsjäger, en Norvège, de l’Asgardreit, la “chevauchée d’Asgard” (24). Au Schlesvig-Holstein, le Nachtjäger (Chasseur de nuit) se nomme Wod ou Wode, dénominations également utilisées au Mecklenbourg, où l’on évoque le passage de la Wodensheer ou de la Wodensjagd, et en Poméranie. Aux Pays-Bas, le Chasseur s’appelle Nachtrabe (corbeau de nuit) (25), mais aussi Woedende Leger (Ibid., pp. 11-17).
D’autres faits, puisés dans le folklore européen, accréditent l’identité du Chasseur sauvage et d’Odhinn. Ainsi cette coutume danoise, encore observée au XIXe siècle, que signale Axel Olrik. Durant la période du Jul (Noël, fin d’année), les couteaux de la maison doivent être disposés de façon à présenter le tranchant en l’air. Auparavant, les lames auront été bien affûtées « pour protéger efficacement contre la Chasse sauvage ». Le bruit court, en effet, que « König Hans et sa suite » vont venir, en volant dans les airs, s’emparer du Julschwein (le porc de Noël).
On pense évidemment au sanglier aux soies d’or du dieu Freyr, Saehrmnir, qui est dévoré chaque jour et renaît chaque soir dans la Valhöll. On pense aux festivités collectives du Jul païen, « fête d’Odhinn par excellence » (G. Dumézil, Mythes et dieux des Germains, op. cit., p. 37), durant lesquelles le porc est consommé en commun.
Mais on pense aussi au dicton qui remémore les visites faites par Odhinn à ses sujets : « Quinconque veut devenir riche invite publiquement Oden comme hôte, et le fait venir chez lui » (dicton répandu au XVIIe siècle en Suède méridionale ; cité par Dumézil, ibid., p. 142). Car Odhinn, en bon souverain, est reçu par les seigneurs de son royaume. Ceux-ci, considérant sa présence comme contraignante, offrent des présents à leur hôte. Ils s’assurent ainsi l’assistance du roi (c’est-à-dire la bienveillance du dieu). La coutume citée plus haut montre simplement l’inversion des valeurs intervenue à l’intérieur du mythe. La venue d’Odhinn n’est plus attendue, elle est même redoutée. Mais on continue à prévoir que le dieu viendra chercher son dû (le porc des réceptions solennelles, véritable mets de l’hospitalité).
On prit ainsi l’habitude de faire des cadeaux au Wilde Jäger, pour conjurer sa fureur, comme on en faisait auparavant à Odin, pour s’attirer ses bienfaits. L’offrande, le plus souvent, consiste en bétail, en objets symboliques, en petits animaux.
Le chien de Hakelberg
Walter K. Kelly rapporte qu’au siècle dernier, dans un petit village de l’Ostenholz, situé entre l’Elbe et la Weser, une vache était offerte tous les ans au Helljäger (Chasseur des enfers), à la veille du jour de Noël. Les habitants savaient quel était l’animal qui devait être sacrifié, car, passé la saint-Martin, il se mettait à engraisser beaucoup plus que la normale. À peine l’avait-on sorti de son étable qu’il disparaissait mystérieusement. Avait-on la mauvaise idée de le laisser dans son enclos ? Il se produisait alors un vacarme effrayant. La vache se mettait à sauter sur place, comme folle, jusqu’à ce qu’on l’ait menée dehors (Curiosities of Indo-European Traditions and Folk-Lore, London, 1863, p. 278). Des exemples analogues, concernant des vaches et des bœufs, sont cités par O. Höfler.
Lorsqu’il passe dans les maisons, le Chasseur sauvage emprunte toujours le même itinéraire. C’est pourquoi l’on dit que certains villages anglais fondés par les Saxons se trouvent on Woden’s way (sur la route de Wodan). En ces endroits, disait-on au siècle dernier, la Wilde Jagd passe de préférence dans les granges, et par les portes situées en vis-à-vis dans les habitations (W. K. Kelly. op. cit., p. 269).
Après son passage, Woden-Wodan laisse souvent un chien derrière lui. Durant la période du Jul, Hakelberg, c’est-à-dire Odhinn (26), a coutume d’envoyer un chien dans les foyers. L’animal se couche près du feu, et aboie toute la nuit. C’est une bête étrange, parfois borgne comme son maître, tantôt grosse et grasse (dans les périodes d’épidémies), tantôt très maigre, qu’on prétend à la fois nécrophage et vorace. On dit aussi qu’elle se nourrit de cendres, de braises et de fumées, qu’elle apporte le feu, la maladie et la mort. Au bout du cycle des douze jours de fin d’année, Hakelberg revient généralement chercher son chien (A. Endter, op. cit., pp. 27-32). Mais il arrive aussi qu’il disparaisse de lui-même, au petit matin, et qu’on ne trouve plus qu’une pierre à sa place. Une pierre magique d’ailleurs, car on aura beau la rejeter, elle reviendra toujours dans la maison.
Pendant cette période, qui est celle du solstice d’hiver, il n’est pas recommandé de faire sécher du linge dehors, ni même d’en laver. Car les chiens du Chasseur pourraient le mettre en morceaux (W. K. Kelly, op. cit., p. 270). Aujourd’hui encore, dans la région de Hambourg et le Schlesvig-Holstein, certaines personnes évitent de laver du linge et de le suspendre dehors durant les “douze nuits”. Enfreindre cette coutume pourrait irriter des voisins.
Ce rôle joué par le chien n’est pas accidentel. Dans l’Europe antique, une fonction funéraire lui est constamment dévolue. « Il n’est sans doute pas une mythologie qui n’ait associé le chien au monde du dessous, à la mort, aux enfers, aux empires invisibles que régissent les divinités chtoniennes ou séléniques (...). La première fonction mythique du chien est celle de psychopompe, guide de l’homme dans la nuit de la mort, après avoir été son compagnon dans le jour de la vie. D’Anubis à Cerbère, par Thoti, Hécate, Hermès, il a prêté son visage à tous les grands guides des âmes, à tous les jalons de notre histoire culturelle occidentale » (Jean Chevalier & Alain Gheerbrant (dir.), Dictionnaire des symboles, Robert-Laffont, 1969, p. 197).
« Chez les Germains — écrit Alexandre H. Krappe —, les chiens seuls voyaient Hel, déesse de la mort, quand elle parcourait le pays » (op. cit., p. 44). C’est d’ailleurs un chien, nommé Garm, qui garde l’entrée du Niflheim, royaume des morts, des glaces et des ténèbres. Dans la Grimnismàl, poème eddique, seuls les chiens reconnaissent Odhinn lorsqu’il fait son apparition à la cour du roi Geirröd, déguisé en mendiant. Dans le monde celtique, le chien, associé au monde des guerriers, est particulièrement à l’honneur (26 bis). Cependant, il prend parfois une couleur maléfique. En Bretagne, le chien noir des Monts d’Arrée représente les damnés. « De nos jours encore, ajoute Jan de Vries, dans les superstitions irlandaises, le chien passe pour être un démon, voire un dévoreur de cadavres » (La religion des Celtes, op. cit., p. 190).
Dans le pays de Bade, à l’époque de Noël, on prépare d’ailleurs des petits pains représentant des chiens singuliers : ils n’ont que 3 pattes, comme le chien de la Wilde Jagd. Disposés dans la maison ou jetés dans le foyer, ces Hundchen protègent de la foudre et de la tempête. Il n’est pas difficile d’y retrouver d’anciennes offrandes aux compagnons de Hakelberg (O. Höfler, op. cit., p. 127).
Le rôle cultuel du cheval
[Ci-dessous : dessin archéologique reconstitutiant en état originel le char solaire découvert à Trundholm, en Seeland, Danemark]
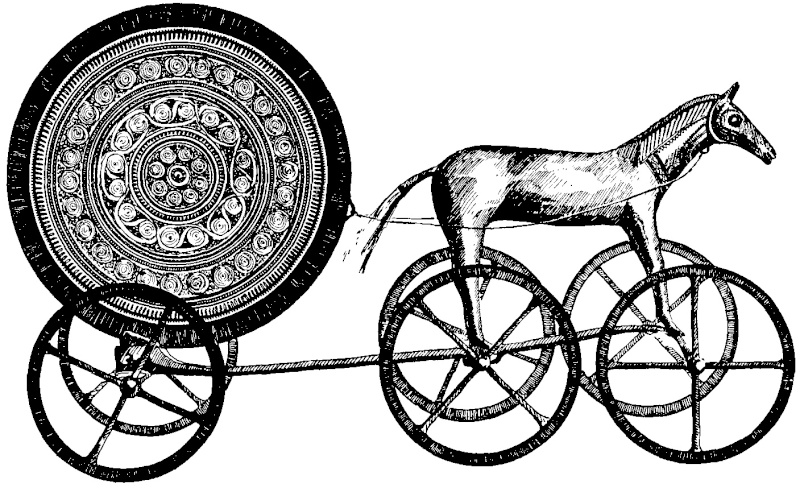 À l’instar de Sleipnir, le coursier à 8 pattes que chevauche Odhinn-Wodan (27), le cheval de la Chasse sauvage possède toutes sortes de pouvoirs. Invulnérable, il n’a pas d’ombre et ne laisse aucune trace de son passage. Il a souvent 3 têtes, parfois 3 ou 8 pattes. Sa robe est blanche, comme celle des chevaux sacrés des Celtes et des Germains. Mais il prend aussi l’aspect d’un squelette, et apparaît fréquemment sans cavalier. Il se substitue alors au Chasseur, tout comme Sleipnir se substitue à Odhinn.
À l’instar de Sleipnir, le coursier à 8 pattes que chevauche Odhinn-Wodan (27), le cheval de la Chasse sauvage possède toutes sortes de pouvoirs. Invulnérable, il n’a pas d’ombre et ne laisse aucune trace de son passage. Il a souvent 3 têtes, parfois 3 ou 8 pattes. Sa robe est blanche, comme celle des chevaux sacrés des Celtes et des Germains. Mais il prend aussi l’aspect d’un squelette, et apparaît fréquemment sans cavalier. Il se substitue alors au Chasseur, tout comme Sleipnir se substitue à Odhinn.
Dans les traditions se rapportant à la Wilde Jagd, les faits relatifs au cheval sont nombreux. Il est fréquent qu’un voyageur, ayant interpellé le Chasseur pour lui demander “sa part”, se voit gratifié sur le champ d’une cuisse de cheval. Celle-ci, suivant le cas, se transformera en or, pourrira sur place, ou tombera sanguinolente à ses pieds.
Ce mythème a inspiré différents commentaires. Il faudrait y voir, selon Höfler, la réminiscence d’un sacrifice du cheval bien caractéristique des sociétés indo-européennes (op. cit., p. 147). On sait qu’un culte d’une spéciale importance était rendu au cheval, tant chez les Indo-Aryens que les Romains, les Celtes et les Germains (Jaan Puhvel, « Aspects of Equine Functionality », in J. Puhvel (dir.), Myth and Law Among the Indo-Europeans : Studies in Indo-European Comparative Mythology, Univ. of California Press, 1970, pp. 160-72). Le sacrifice du cheval, avec ses répercussions dans le domaine du commandement et du pouvoir, était beaucoup plus qu’une simple offrande propitiatoire. Chez les Aryens védiques, l’Açvamedha prend même un caractère cosmogonique. « Le cheval est identifié au Cosmos, et son sacrifice symbolise, c’est-à-dire reproduit, l’acte de la création » (M. Eliade, Traité d’histoire des religions, 1949 & 1964).
En Scandinavie, nous savons par Adam de Brême qu’au cours des grandes cérémonies ayant lieu tous les 9 ans, « neuf créatures mâles de chaque classe » étaient solennellement pendues dans le bois sacré du temple d’Uppsala. Leur sang devait, selon l’usage, rendre les dieux favorables, et nous savons que les chevaux tenaient une place importante dans le lot. La consommation rituelle de la viande de cheval accompagnait d’ailleurs tous les sacrifices importants.
Le rôle cultuel du cheval remonte très loin dans le temps. L’un des premiers témoignages que nous en ayions est antérieur à l’âge du Bronze. Il s’agit d’un cheval sacrifié au moyen d’un poignard de pierre, qui fut découvert à Ulltorpa, dans la province suédoise de Scanie (H. Ringgren & A.V. Ström, op. cit., p. 343). C’est également en Scanie que l’on peut voir, sur les fresques du tombeau de Kivik, des scènes rituelles associant des personnages masqués et des chevaux de l’âge du Bronze. Le magnifique chariot de Trundholm (Danemark), représentant un cheval tirant le disque solaire, date de la même période. Mais la tradition s’est maintenue beaucoup plus tard. Le navire de Gokstad, découvert dans le tumulus de Vestfold (Norvège), contenait les squelettes de 12 chevaux et de 6 chiens sacrifiés à l’occasion des funérailles d’un chef viking (J-J. Mourreau, « Les navires vikings », in Nouvelle École n°7, 1969, p. 54). L’une des tombes-bateaux mises au jour à Valsgärde (Suède) comportait également 2 chevaux à l’avant, et 2 chiens à l’arrière, ainsi qu’un jeune bœuf et un vieux sanglier (Birgit Arrhenius, « La sépulture du “bateau-tombe” de Vendel », in L’or des Vikings, 1969, p. 104).
Suspects de paganisme
[Bâtiment viking, portant des chevaux stylisés au fronton. Centre Viking Rosala en Finlande]
 La consommation de la viande du cheval, procédure à vrai dire exceptionnelle, avait bien un caractère rituel. Elle suscita une violente réprobation dans les milieux chrétiens. « La nouvelle foi, écrit le comte Oxenstierna, n’acceptait aucun compromis, ne souffrait aucune adaptation. Au sacrement païen du cheval sacrifié s’opposait la Cène chrétienne » (Les Vikings, op. cit., p. 194). Immundim enim est atque..., s’écriait le pape Grégoire III, en évoquant le rite détesté (Monumenta Germanica Historica. Epist., t. III, Lettre de 732). La Heimskringla rapporte que le roi de Norvège Haakon le Bon, après sa conversion, se refusa formellement à manger de la viande de cheval ; il n’en absorba qu’une fois, au cours d’une fête sacrificielle, encore était-ce contraint et forcé. De même en Islande, au temps de saint-Olaf, la disparition du rite alla de pair avec l’interdiction du culte païen en privé (Lucien Musset, Les peuples scandinaves au Moyen-Âge, Paris, 1951, p. 136).
La consommation de la viande du cheval, procédure à vrai dire exceptionnelle, avait bien un caractère rituel. Elle suscita une violente réprobation dans les milieux chrétiens. « La nouvelle foi, écrit le comte Oxenstierna, n’acceptait aucun compromis, ne souffrait aucune adaptation. Au sacrement païen du cheval sacrifié s’opposait la Cène chrétienne » (Les Vikings, op. cit., p. 194). Immundim enim est atque..., s’écriait le pape Grégoire III, en évoquant le rite détesté (Monumenta Germanica Historica. Epist., t. III, Lettre de 732). La Heimskringla rapporte que le roi de Norvège Haakon le Bon, après sa conversion, se refusa formellement à manger de la viande de cheval ; il n’en absorba qu’une fois, au cours d’une fête sacrificielle, encore était-ce contraint et forcé. De même en Islande, au temps de saint-Olaf, la disparition du rite alla de pair avec l’interdiction du culte païen en privé (Lucien Musset, Les peuples scandinaves au Moyen-Âge, Paris, 1951, p. 136).
La coutume sacrée devint peu à peu l’objet d’une répugnance, organisée d’abord, quasi-spontanée ensuite. En Allemagne, où encore de nos jours les boucheries hippophagiques sont inconnues, on fait valoir que “le cheval est un animal trop noble pour être mangé”. Ainsi, en l’espace de quelques siècles, le même argument aura justifié des comportements rigoureusement opposés.
« Il n’y a pas si longtemps que ceux qui abattaient les chevaux étaient encore suspects de paganisme, et de ce fait méprisés et exclus de la communauté chrétienne. Des détenus et des gens aux mœurs dépravées trouvèrent en cet emploi l’objet de subvenir à leurs maigres besoins. Mais ils étaient l’objet de la malédiction et de la crainte populaires. Tout ce qu’ils touchaient devait être récuré ou brûlé. On raconte qu’un pasteur suédois se servit même pour eux de calices eucharistiques spéciaux, en étain. Mais l’évêque interdit vite cet usage. Toujours est-il que leurs corps ne pouvaient entrer au cimetière par la porte : on les passait par dessus les murs. C’est à peine si ces successeurs des prêtres païens pouvaient reposer en terre bénite » (Éric Oxenstierna, op. cit., pp. 195-96) (28).
Le culte du cheval n’en a pas moins survécu, sous des formes marginales il est vrai. Les Romains trouvèrent des crânes de chevaux cloués aux arbres de la forêt de Teutobourg (Teutoburger Wald) lorsqu’ils pénétrèrent pour la première fois dans ce sanctuaire naturel où, en l’an 9, Varus avait connu sa terrible défaite (R.L.M. Derolez, op. cit., p. 71 ; N. de Pierrefeu, « Irminsul et le livre de pierre des Exsternsteine en Wesphalie », in Ogam, Vol. VII, pp. 363-86). C’est un usage qui s’est maintenu dans le monde germanique, et tout particulièrement chez les Saxons (29). On cloue toujours des têtes de chevaux sur les portes des granges, tout comme l’on place des fers à cheval à l’entrée des maisons.
Le cheval étant l’animal de guerre par excellence, le compagnon de l’homme et l’instrument de ses conquêtes, sa présence dans la tombe du héros s’explique au même titre que celle du char ou du bateau, du casque ou de l’épée. Mais son rôle funéraire n’est pas seulement passif. Le cheval est psychopompe introduit le défunt dans la Valhöll.
Ce rôle apparaît clairement dans la Thidreksaga (chap. 393). Thidrek, qui n’est autre que Théodoric le roi des Goths (Dietrich von Bern), est au soir de sa vie. Un jour qu’il se baigne dans l’eau d’une rivière, l’un de ses compagnons lui signale le passage d’un cerf splendide. Sans attendre ni ses gens ni ses chiens, le roi s’entoure d’un manteau de bain, se jette sur un grand cheval noir, qui n’est pas le sien mais se trouve sur les lieux, et se lance à la poursuite du bel animal. Thidrek s’aperçoit bientôt que sa monture mène un train d’enfer, et qu’il ne parviendra pas à l’arrêter. Il s’écrie alors : « Je vais à ma perte, ce cheval est un démon ! » (J.O. Plassmann, « Dietrich von Bern als Wilder Jäger », in : Germanien, Heft 5, mai 1940, pp. 170-80).
Il est à noter que Sleipnir, le coursier d’Odhinn, occupe également une fonction psychopompe sur 2 pierres tombales de l’île de Gotland (30). Il s’agit des pierres historiées d’Alskog Tjängvide (VIIIe ou IXe siècle) et d’Ardre VIII (fin du VIIIe siècle). Une inscription runique relevée sur la première indique qu’elle fut érigée, par son frère, à la mémoire d’un certain Jurulv, tué au cours d’un voyage en mer. La pierre est divisée en 2 parties. Celle du bas représente un navire viking et son équipage. Dans celle du haut, le défunt arrive à la Valhöll. Il est monté sur Sleipnir, qu’on reconnaît à ses 8 pattes, et précédé d’un chien. Une Walkyrie le salue, et lui offre le breuvage de bienvenue contenu dans une corne à boire. On aperçoit aussi la Valhöll, grande enceinte circulaire aux portes cintrées, et des scènes de bataille rappelant l’occupation favorite des élus d’Odhinn. À quelques détails près, les mêmes dessins se retrouvent sur la seconde pierre tombale.
La guerre et la mort sont tout naturellement associées. « La valorisation négative du symbole chtonien fait du cheval une kratophanie infernale, une manifestation de la mort, analogue à la faucheuse de notre folklore. En Irlande, le héros Conal I Cernach possède un cheval à tête de chien, le Rouge de Rosée, qui déchire le flanc de ses ennemis. Les chevaux de Cùchulainn, le Gris de Macha (c’est le roi des chevaux d’Irlande) et le Sabot Noir, ont une intelligence humaine : le Gris refuse de se laisser atteler au char du héros qui se prépare pour son dernier combat, et verse des larmes de sang ; un peu plus tard, il guidera le vengeur Conal I Cernach, vers le corps de son maître ; le Noir, lui, va se noyer de désespoir » (J. Chevalier & A. Gheerbrant (dir.), op. cit., p. 187). On a retrouvé dans un trésor celtique, à Neuvy-en-Sullias (Loiret) un cheval votif, accompagné d’une inscription à Rudiobus (“le Rouge”), qui semble appartenir, lui aussi, à la famille des chevaux guerriers.
Dans l’Antiquité classique, les chevaux funéraires sont légion. Démeter d’Arcadie, identifiée avec l’une des terribles Érinnyes, exécutrices de la justice infernale, est généralement représentée avec une tête de cheval. De ses amours avec Poséidon, naît un autre cheval, Aréion, qui devient la monture d’Héraclès. Les Harpies, « démons de la tempête, de la dévastation et de la mort » (H. Jeanmaire, Dionysos : Histoire du culte de Bacchus, 1951), sont à la fois des femmes-oiseaux et des juments. L’une d’elles est la mère des chevaux d’Achille, une autre celle des coursiers offert aux Dioscures par Hermès. Chez les Indo-Iraniens, c’est sous la forme d’un cheval qu’Ahriman se présente pour enlever ou tuer ses victimes.
Le cheval blanc des récits de la Chasse sauvage est sans nul doute cet animal nocturne, dont la robe a l’absence de couleurs des froideurs séléniques. C’est lui qui accompagne Arthur à la poursuite du lièvre magique. C’est le Schimmel Reiter du folklore franco-allemand, qui détruit les digues pendant la tempête, la Blanque Jument du Pas-de-Calais, le Bian Cheval de Celles-sur-Plaine, le Drac, qui saisit les voyageurs et les noie dans le Doubs (H. Dontenville, La mythologie française, 1948 ; Les rites et récits de la mythologie française, 1950). C’est, au sens propre du terme, l’animal des nuits blanches et des cauchemars (all. Mahr, cauchemar, Mähre, jument ; angl. nightmare, cauchemar, mare, jument ; néerl. mare, fantôme nocturne ; v. sl. mora, sorcière ; russe mora, “spectre” ; tchèque mura, “cauchemar” ; v. irl. marah, “mort”, “épidémie” ; lit. maras, “mort”, “peste” ; let. meris, peste), termes qu’A. H. Krappe rapproche de la Mor(r)igain irlandaise, et du March-Malaen (lat. malignus), fléau de l’île de Bretagne (op. cit., p. 229).
Le char du soleil
Bien entendu, le cheval n’est pas seulement un animal funéraire. Il y a même une ambiguïté dans sa fonction. Tantôt associé aux ténèbres lunaires du monde chtonien, tantôt symbole du règne de l’esprit et de la beauté accomplie, il est à la fois porteur de mort et de vie.
« La représentation de têtes de cheval sur quelques menhirs contenus dans le tumulus de Mané-Lud — écrit Jan de Vries — donne à penser qu’elles étaient censées avoir un pouvoir tutélaire, en particulier celui de repousser les démons (...). Mais le cheval est aussi un animal solaire. Quand il est dessiné à côté d’un bateau, il est difficile de savoir ce que cela veut dire ; le bateau, en effet, est lui aussi ambivalent : il peut être soit la barque du soleil, soit celle des morts » (op. cit., p. 189).
Dans la mythologie grecque, la figure de Pégase combine les 2 aspects. Pégase porte sa foudre à Zeus ; c’est donc un cheval céleste (Zeus réunissant, comme Odhinn, les fonctions guerrière et de souveraineté). Mais son origine est également chtonienne, puisqu’il est né, soit des amours de Poséidon et de la Gorgone, soit de la Terre fécondée par le sang de celle-ci.
Ce sont les chevaux qui tirent le char du soleil, ce qui fait d’eux, en Grèce, les attributs d’Apollon. Le chariot de Trundholm, déjà cité, n’est donc pas un exemple isolé. « Dès les temps préhistoriques, le soleil est représenté sur un char pour signifier son déplacement. Ce char deviendra celui d’Apollon » (J. Chevalier & A. Gheerbrant (dir.), op. cit., p. 190). Mithra remonte au ciel dans un chariot solaire. Et l’on voit, dans une miniature de l’Hortus deliciarum de Herrade de Landsberg, le char du soleil tiré par 2 ou 4 chevaux (Le “Jardin des délices” de Herrade de Landsberg : Un manuscrit alsacien à miniatures du XIIe siècle, Oberlin, Strasbourg, 1945, pl. 4). Lumineux également sont les chevaux ailés du Rig-Véda, le cheval aryen asha (c’est-à-dire “le pénétrant”) et les Ashvin, Dioscures issus des amours d’un cheval et d’une jument, qui incarnent la Connaissance et la Loi.
Le poème eddique de Valthrunder mentionne l’existence d’un cheval brillant, Skinfaxe, qui ramène le jour, et Hrimfaxe, qui étend la nuit (R. Christinger & W. Borgeaud, op. cit., p. 116). C’est peut-être le coursier solaire de Trundholm. Dans la saga islandaise de Hrafnkel, l’intrigue est nouée autour d’un cheval consacré à Frey, « le grand dieu solaire des anciens Scandinaves » (A.H. Krappe, op. cit., p. 86) (31). Le rite du völsi (32) est, lui aussi, étroitement lié au dieu Frey. Le rôle solaire appartiendrait donc aux chevaux dépendant de Frey, dieu de la troisième fonction, qui fut effectivement considéré comme “protecteur des chevaux”.
Après la disparition du paganisme, la tradition cultuelle fut intégrée par la nouvelle religion. « Dans la Suède médiévale et moderne, le jour de la Saint-Étienne (successeur chrétien de Frey) est toujours consacré aux chevaux» (A.H. Krappe. op. cit., p. 86). Ce jour-là (le 26 décembre, soit en pleine période de Jul), des courses de chevaux sont organisées sous le patronage de saint-Staffan (Étienne), devenu protecteur des écuries. Dans le nord de la France, c’est saint-Éloi, patron des orfèvres et des forgerons, qu’on invoque « pour les chevaux malades et contre les chevaux méchants » (Orner Englebert, op. cit., p. 564). Sa fête, le 1er décembre, donne lieu à des défilés et des bénédictions de chevaux (C. Leroy, « Le culte de saint-Éloi en Artois et dans le nord de la France », in Les traditions populaires dans le nord de la France, Arras, 1945, I, pp. 34-68). Courses et défilés avaient également lieu à la fin de l’année. En Suède, on se rendait auprès des sources, et les chevaux devaient y boire, « par dessus la monnaie » que le cavalier jetait dans l’eau (É. Oxenstierna, op. cit., p. 189). Des courses du même genre avaient lieu au printemps et à l’automne. On en trouve la survivance dans les cavalcades de Pentecôte, et dans les défilés de la saint-Georges (autre saint militaire et cavalier, fête le 23 avril). Ces rites païens christianisés étaient autrefois suivis de combats et de poursuites d’étalons. La saga de Viga-Glum rappelle d’ailleurs l’importance qu’on accordait à ces tournois. Toutes ces manifestations associaient, comme à Rome (33), les sacrifices de chevaux aux rites de fertilité et de renouveau.
Jul, sous le signe du sacré
 Ainsi qu’on vient de le voir, la période du Jul, située à la fin de l’année, revêt une importance capitale pour la compréhension des légendes et des coutumes relatives à la Chasse sauvage. Cette période, que les ethnographes appellent « cycle des douze jours », est celle où les journées sont les plus courtes et les nuits les plus longues. C’est un temps d’attente et de renouveau, où le soleil disparaît pour renaître. On y a vu la préfiguration des 12 mois de l’année à venir (M. Eliade, Le mythe de l’éternel retour, op. cit., 1949, p. 107). Chez les Celtes (34) comme chez les Germains, il est placé sous le signe du sacré.
Ainsi qu’on vient de le voir, la période du Jul, située à la fin de l’année, revêt une importance capitale pour la compréhension des légendes et des coutumes relatives à la Chasse sauvage. Cette période, que les ethnographes appellent « cycle des douze jours », est celle où les journées sont les plus courtes et les nuits les plus longues. C’est un temps d’attente et de renouveau, où le soleil disparaît pour renaître. On y a vu la préfiguration des 12 mois de l’année à venir (M. Eliade, Le mythe de l’éternel retour, op. cit., 1949, p. 107). Chez les Celtes (34) comme chez les Germains, il est placé sous le signe du sacré.
Dans les langues nordiques, le mot Jul (v. germ. guili, décembre-janvier, got. fruma jiuleis, novembre) est toujours employé pour désigner Noël. En Angleterre, les mots Yule (Noël) et Yuletide (période de Noël) sont peu usités, mais connus. Joel se rencontre en pays flamand (« Joelfeest – Winterzonnewende », in Eugeen Verstraete (dir.), Volksche Feesten, Vlaamsch Instituut voor Volkskunst, Brussel, 1942, p. 14).
On dit Weihnachten en Allemagne, où les festivités, comme autrefois, s’étendent toujours sur plusieurs jours (le mot Weihnachten signifie “dans les nuits saintes”. Voir Eugen Fehrle, Deutsches Volkstum in Elsass, Berlin, 1942, p. 34). La fête chrétienne de la Nativité n’a fait que prendre le relais des solennités païennes du solstice d’hiver (35).
Jul est une « fête du solstice et du clan », souligne le comte Oxenstierna. Or, le clan ne comprend pas seulement les vivants, mais aussi les morts qui reviennent parmi eux. Noël est donc le temps des ancêtres (36), dont les générations s’enchaînent les unes aux autres comme l’enfance à la vieillesse, le printemps à l’hiver, et le jour à la nuit. Leur venue est attendue. Un sacrifice, l’alfablot (blot : sacrifice ; s’adressant aux Albes ou Elfes, ancêtres, isl. Alfr, pluriel Alfar), leur est réservé. À l’époque des Vikings, « on dressait une magnifique table de Jul sur le tumulus des parents. Dans la salle servant à la toilette, on chauffait le bain de vapeur ; on dressait des lits, et les paysans se couchaient par terre, sur la paille, pour que les autres, les «étrangers» entrent dans la bonne chambre, s’y réconfortent, s’y chauffent et s’y rassasient de toutes les friandises préparées » (É. Oxenstierna. op. cit., p. 190). Du reste, on craignait le mécontentement des défunts. Ceux-ci, sortis de la montagne ou du tumulus, ne s’en retournaient pas à la terre avant d’avoir séché leurs habits. La Saga de Grettir donne un exemple de la terreur que ces êtres surnaturels, surgissant au milieu de nuit hivernale, inspiraient aux paysans islandais » (L. Musset, op. cit., p. 135).
On craignait aussi la ronde interminable des lutins, des elfes et des korrigans, des gnomes et des nains de la forêt, tous esprits bienfaisants ou malfaisants, plus ou moins apparentés aux ancêtres, qui, tel Lusse (ou Lussi) le 13 décembre (37), envahissaient la maison pour y jouer des tours.
C’est encore à la Noël que Holda et Berchta faisaient leur apparition. Holda était une déesse protectrice, veillant particulièrement au sort des femmes et des petits enfants. Habitant dans la montagne ou les cavernes, elle venait chaque année apporter prospérité et bonheur. Les enfants morts en bas âge (plus tard, les enfants non-baptisés) entraient dans son cortège. C’est probablement elle qui, apparaissant dans la Chasse sauvage, la dirige parfois, sous les traits de la “dame blanche”, notamment en Norvège où elle se nomme Huldra (Eckart Peterich, Götter und Helden der Germanen : Kleine Mythologie, München, 1963, p. 43). Par la suite, Holda est devenue une sorte de fée (ou de vieille femme) bienfaisante, qu’on retrouve dans les contes germaniques sous le nom de Frau Holle. Quant à Berchta, elle n’est autre que la grande déesse fileuse des Germains, connue en France sous le nom de “Berthe la brillante” ou “Berthe la fileuse”.
C’est également une divinité protectrice et chtonienne, déesse de la fertilité végétale et des femmes en mal d’enfant. Dans les contrées jurassiennes, elle apparaissait la baguette à la main, pour réprimander les enfants désobéissants. Elle veillait aussi à la tenue du ménage, et emmêlait le chanvre ou le lin des ménagères peu soigneuses. Berchta n’est plus aujourd’hui que la fée protectrice des fileuses. Mais c’est pour elle que le rouet s’arrête encore durant les “douze nuits”.
Toutes ces croyances ont mis longtemps à disparaître. M. L. Musset rapporte qu’en Scandinavie, « l’imagination populaire resta jusqu’à l’époque moderne hantée par les trodls, généralement des morts mécontents de leur sépulture, qui reviennent troubler les vivants et même, à l’occasion, les tuer ». Le toast qu’on porte aujourd’hui “à la santé des absents” n’est d’ailleurs que « le souvenir atténué d’une libation faite en l’honneur des morts » (op. cit.) (38).
Souvenir des morts, chaos naturel, fureur et renouveau : le solstice d’hiver est bien, selon la formule de M. Dumézil, « la fête d’Odhinn par excellence ». Wodan, comme le Chasseur sauvage, rassemble ses guerriers et les entraîne à la rencontre des démons. C’est le temps des luttes et des rapines rituelles, des masques (39), des dépouilles de carnassiers et des tumultes. Le dieu veille au déchaînement des forces et à l’ordre du monde. Il attire sur lui les puissances chtoniennes et démoniaques qui rôdent dans la nuit, et lorsque les sonnailles de l’Armée infernale s’élèvent dans les nuits d’hiver, les hommes savent qu’il est là, qui chasse sans fin dans les tempêtes du vieux monde. Alors, rassurés, ils songent aux saisons à venir, à l’année qui commence, aux glaces qui vont fondre, à la fertilité des femmes et des champs. Ils songent au soleil qui renaîtra toujours, jusqu’à ce qu’Odhinn affronte le loup Fenrir. Jusqu’au jour où le frère de Hel et le roi des Ases se déchireront, comme Heimdall et Loki. Jusqu’au Ragnarök.
Le symbolisme du cerf
 La Chasse sauvage se lance le plus souvent à la poursuite d’un cerf. C’est aussi en chassant le cerf qu’Eustache et Hubert sont “sauvés”, que Dietrich von Bern est “maudit”. Le cerf, lointain descendant du “dieu-renne” des antiques sociétés européennes de chasseurs, est en effet, avec le cheval et le porc, l’un des principaux « animaux européens », l’un de ceux auxquels, dès l’origine, fut affectée une valeur symbolique et consacré un culte (40).
La Chasse sauvage se lance le plus souvent à la poursuite d’un cerf. C’est aussi en chassant le cerf qu’Eustache et Hubert sont “sauvés”, que Dietrich von Bern est “maudit”. Le cerf, lointain descendant du “dieu-renne” des antiques sociétés européennes de chasseurs, est en effet, avec le cheval et le porc, l’un des principaux « animaux européens », l’un de ceux auxquels, dès l’origine, fut affectée une valeur symbolique et consacré un culte (40).
La fonction cultuelle du cerf (all. Hirsch, néerl. hert ; le mot hère apparaît chez Buffon, en 1750, pour désigner le “jeune cerf” ; à rapprocher du fr. harde et de l’angl. hart, cerf de plus de 5 ans) remonte à la préhistoire (Karl Theodor Weigel, « Der Hirsch : Zur Verbreitung und Bedeutung eines Sinnbildes », in : Germanien, Berlin, juil. 1939, pp. 313-19). On connaît, par ex., l’étrange figure de la Grotte des Trois-frères (Ariège), qui représente un homme-cerf et date du paléolithique. Viennent ensuite, en Italie, les gravures rupestres de Val Camonica, où des représentations du soleil sont fréquemment associées avec des cerfs ; et, en Suède, celles du Bohuslän, comprenant des scènes de chasses de l’Âge du Bronze, des bovidés, des bateaux, des guerriers, des roues solaires et des cervidés. Plus tard, à l’époque de Hallstatt, on retrouve un certain nombre de figurines sacrées, parmi lesquelles un cavalier et un cerf sur l’urne à décor peint de la riche tombe de Gemeinlebarn (Basse-Autriche). Le char cultuel de Streetweg, découvert en Styrie (Autriche), qui se trouve actuellement au musée de Saint-Germain-en-Laye, date de la même période. On y voit des cavaliers et des hommes armés, groupés autour d’une divinité géante portant une vasque sur sa tête, et des massacres de cervidés. Plus tard encore, au VIIe siècle de notre ère, on trouve un cerf à la pointe de l’étendard du bateau funéraire (ship burial) de Sutton Hoo, dans le Suffolk (Grande-Bretagne).
Le cerf est en lui-même un symbole de la chasse. Dans l’Antiquité classique, il est consacré à Diane-Artémis. Ce sont d’ailleurs des cerfs, dans l’iconographie gréco-romaine, qui sont attelés au char de la déesse. Celle-ci les dirige avec des rênes d’or. Diane de Poitiers, généralement représentée en compagnie d’un cerf (glissement “historicisant” du mythème), avait une devise qui pourrait être celle de la vierge chasseresse : quodcumque petit consequitur, « elle obtient tout ce qu’elle désire ».
« En Irlande, le fils du grand héros du cycle ossianique, Find, s’appelle Oisin (faon), tandis que saint-Patrick se métamorphose et métamorphose ses compagnons en cerfs (ou en daims) pour échapper aux embûches du roi païen Loegaire : il agit ainsi en vertu de l’incantation ou procédé magique appelé feth fiada, lequel procurait normalement l’invisibilité. Au retour de sa première expédition sur la frontière d’Ulster, Cûchulainn enfant capture plusieurs cerfs, et il les contraint à courir à côté de son char. Il faut citer encore l’histoire de Tuan Mac Cairill, transformé successivement, entre la première invasion de l’Irlande et l’arrivée de saint-Patrick, en cerf, en sanglier, en faucon et en saumon. Le symbolisme du cerf dans le monde celtique est donc très vaste, et il a trait certainement aux états primordiaux » (J. Chevalier & A. Gheerbrant (dir.), op. cit., p. 163).
Un guide funéraire
Comme le cheval, le cerf est un animal funéraire. De nombreuses traditions attestent qu’il est également psychopompe, et c’est sans doute la raison pour laquelle les Gaulois possédaient de nombreux talismans en bois de cerf. La croyance selon laquelle les morts apparaîtraient parfois sous la forme de cerfs, a donné naissance à la coutume consistant à envelopper les défunts dans des dépouilles de cervidés (Mircéa Eliade, De Zalmoxis à Gengis Khan, 1970, pp. 146-47). C’est ainsi que le Morholt d’Irlande, oncle d’Yseult, occis par Tristan en un combat singulier, est dépeint gisant mort « cousu dans une peau de cerf » (Joseph Bédier, Le roman de Tristan et Iseut, 1946, p. 20).
Des découvertes archéologiques ont apporté confirmation. Dans la région bâloise, une tombe alémanique, de l’époque mérovingienne renfermait un guerrier paré de son épée, avec un cheval et une biche (Henri-Paul Eydoux, Hommes et dieux de la Gaule, Plon, 1961, p. 170). Dans un puits funéraire des environs de Bernay (Eure), au milieu d’une grande quantité d’ossements, plusieurs cerfs entiers, ainsi que des têtes et des bois de cerfs, ont été dénombrés. Les plus anciens enfouissements remonteraient aux Gallo-Romains, les plus récents aux Mérovingiens (Ibid., p. 170). Mais la découverte la plus sensationnelle est celle qui fut effectuée en 1956, lors des fouilles menées sous la direction de M. André Brisson, au Mont Granet (Marne). Il s’agit d’un important cimetière gaulois, où l’on a retrouvé la tombe d’un cerf, inhumé à la façon d’un être humain. L’animal avait été sacrifié, et couché encore chaud dans la fosse. Il était doté d’une bride et d’un mors, ce qui laisse à penser qu’il avait été attelé. « L’animal était couché sur le côté droit, la tête repliée. Les andouillers avaient été sciés à leur base du vivant de la bête, qui ne possédaient donc plus que ses deux perches » (Ibid., p. 166).
 Bien entendu, la fonction funéraire ne saurait, là encore, expliquer à elle seule l’importance du cerf. Son rôle est ambivalent. À l’instar du cheval, il conjugue les symboles de mort et de renaissance, les aspects chtoniens et les aspects lumineux. Ce double caractère apparaît clairement sur les gravures de Val Camonica. En relation, dans l’Edda, avec Odhinn et Yggdrasil (“l’arbre du monde”), le cerf devient “solaire” dans une poésie islandaise datant du XIIIe siècle. Ses pieds restent sur terre, tandis que ses bois atteignent jusqu’au ciel (M. Eliade, De Zalmoxis à Gengis Khan, op. cit., pp. 146-47).
Bien entendu, la fonction funéraire ne saurait, là encore, expliquer à elle seule l’importance du cerf. Son rôle est ambivalent. À l’instar du cheval, il conjugue les symboles de mort et de renaissance, les aspects chtoniens et les aspects lumineux. Ce double caractère apparaît clairement sur les gravures de Val Camonica. En relation, dans l’Edda, avec Odhinn et Yggdrasil (“l’arbre du monde”), le cerf devient “solaire” dans une poésie islandaise datant du XIIIe siècle. Ses pieds restent sur terre, tandis que ses bois atteignent jusqu’au ciel (M. Eliade, De Zalmoxis à Gengis Khan, op. cit., pp. 146-47).
Un épisode de l’Histoire des Francs (Livre II), de Grégoire de Tours, élargit encore ses fonctions. La scène se déroule durant la campagne contre les Goths. L’armée de Clovis vient d’arriver sur les bords de la Vienne, qu’une forte pluie a grossie, et cherche vainement comment franchir le fleuve. Survient alors une biche d’une grandeur extraordinaire, qui s’engage dans l’eau sous les yeux des Francs, et localise ainsi le seul passage à gué. Le cerf (ou la biche) apparaît donc également comme un guide (et pas seulement comme un guide funéraire).
À ce titre, le cerf peut être à l’origine de la découverte d’un nouveau territoire, ou d’un acte de fondation. Dans la Chasse sauvage, son apparition correspond à un changement de niveau (commencement ou fin). On peut y voir, avec Mircéa Eliade, la réactualisation d’un mythe originel des sociétés de chasseurs : l’ancêtre mythique, c’est-à-dire le carnassier poursuivant un cervidé, conquiert et délimite la future patrie de son clan (De Zalmoxis …, op. cit., p. 153). Comme dans la Grèce antique, le cerf est l’animal de la renovatio périodique (Ibid., p. 152).
Cernunnos, dieu de fertilité
 Plusieurs conciles dénoncèrent et interdirent les « mascarades des calendes », survivances de rites celtiques au cours desquelles des masques de cerfs étaient portés par les participants. Or, ces mascarades n’étaient pas sans rappeler les activités des sociétés guerrières masculines et des « confréries de jeunes gens ».
Plusieurs conciles dénoncèrent et interdirent les « mascarades des calendes », survivances de rites celtiques au cours desquelles des masques de cerfs étaient portés par les participants. Or, ces mascarades n’étaient pas sans rappeler les activités des sociétés guerrières masculines et des « confréries de jeunes gens ».
De quoi s’agissait-il ? « Au moment des calendes de janvier, hommes et femmes se déguisaient en cerfs et en biches, en taureaux et en génisses, et se livraient à des danses rituelles » (Jean-Jacques Hatt, « Essai sur l’évolution de la religion gauloise », in Revue des études anciennes n° 1-2/1965, t. LXVIII, p. 118). Ces processions ressemblaient au Perchtenlauf, pratiqué en Haute-Bavière : on suppose, écrit J. de Vries, « que les masques servaient à métamorphoser les participants en morts-démons, ceux-ci étant souvent représentés comme des animaux ». Il s’agissait d’évoquer les morts, et d’assurer de bonnes récoltes pour l’année à venir. « C’est pourquoi il a été difficile de faire renoncer les paysans à de telles coutumes : s’ils s’abstenaient de célébrer le rite, il était à craindre que la prochaine récolte fût mauvaise » (J. de Vries. op. cit., p. 182).
« Les hommes d’Église — ajoute de Vries — n’ont pourtant cessé de vitupérer le rite appelé cervelum (ou cervula) facere. Cela semble indiquer qu’ils y voyaient, non pas un divertissement populaire, mais une faute grave. Césaire d’Arles va jusqu’à condamner cette coutume comme sordidissimam turpidunem. Plus précis encore, saint-Hilaire dit, au sujet d’un rite célébré, en plein IVe siècle, au mois de janvier dans le Gévaudan (Lozère) : « Praefixo quidem cervi capite ad imitandum ferae forman conditionem humanam persuasionis diabolicae scelus inclinat ». Au VIIIe siècle encore, Saint-Pirminius interdit « in cervulos et veculas (lat. vitulas) in Kalandas vel aliud tempus nolite ambulare » (ibid., p. 182).
Cette hostilité s’explique par le fait que les mascarades calendaires célébraient l’un des avatars du dieu celtique Esus-Cernunnos, le dieu aux ramures de cerf, personnage faisant l’objet d’une intense vénération chez les Celtes, et dont on possède de nombreuses représentations.
L’une des gravures de Val Camonica représente un dieu aux bois de cerf, brandissant du bras droit un torques, et du bras gauche un serpent cornu assez peu distinct. Il s’agit, sans aucun doute, de Cernunnos. On le retrouve sur le chaudron de Gundestrup, assis “à l’orientale” (41), présentant ostensiblement un collier celtique et un serpent à tête de bélier. Il est escorté de 4 grands quadrupèdes, dont un cerf magnifique, et semble commander au monde animal. On le retrouve sur les autels de Saintes, de Vendeuvres, de Dennevy. Un bas-relief parisien, trouvé en 1711 sous le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris (il s’agit du célèbre “pilier des Nautes”, sculpté sous le règne de Tibère), le représente chauve et barbu, paraissant âgé. Des torques pendent à chacun de ses bois. C’est encore lui qu’il faut reconnaître dans le dieu tricéphale de Condat (Dordogne), dans la statuette de Reims, où il figure assis entre Mercure et Apollon, et très probablement dans la figurine de bronze dite d’Autun (elle provient de Savigny, en Saône-et-Loire), qui montre un personnage barbu, accroupi sur un coussin, et tenant dans ses mains 2 serpents à têtes de bélier. « Sur le haut de sa tête se remarquent deux trous, avec traces de plomb, qui ont probablement servi à sceller des bois de cerf » (Émile Thévenot, Divinités et sanctuaires de la Gaule, Fayard, 1968, p. 146).
Cernunnos est un dieu solaire et de fertilité. D’âge indifférent (quoique ce ne soit jamais un vieillard), tantôt imberbe, tantôt barbu, il a pour attributs le torques, la bourse et le sac de graines. Les animaux secondaires en relation avec lui sont le serpent, le rat, le taureau et le sanglier. Mais « son seul et véritable caractère spécifique est la présence, ou les traces, de la ramure de cerf » (Ibid., p. 147).
On sait que les bois du cerf ressemblent étrangement aux feuilles du chêne. En outre, un symbolisme spécifique oppose les bêtes à cornes caduques, ayant « l’étonnant privilège de perdre chaque année et de voir repousser avec le printemps leur ramure, signe de renouveau » (Paul-Marie Duval, Les dieux de la Gaule, PUF, 1957, p. 33), et les bêtes à cornes persistantes. « Cernunnos est donc le soleil du printemps, éveilleur des sèves et excitateur des fonctions biologiques. Ses cornes (...) sont une allusion à son influence sur l’instinct de reproduction, caractère déjà rencontré avec d’autres nuances chez le Liber italique » (A. Savoret, De quelques symboles druidiques, I : Le ciel et les saisons, Heugel, 1947, p.57). Ainsi s’expliquent les « danses rituelles » (et probablement obscènes) signalées plus haut. M. Jean-Jacques Hatt précise à ce propos : « Chaque année, au moment où Cernunnos était censé redevenir Esus, les Gaulois allaient chasser des cerfs et des biches dans la forêt. Ils les sacrifiaient, les dépouillaient, s’affublaient de leurs peaux encore fraîches, se livraient ainsi déguisés à des danses effrénées. Puis ils déposaient leurs oripeaux, pour célébrer le retour sur terre d’Esus » (« Essai sur l’évolution de la religion gauloise », art. cit., p. 119).
Mythes celtiques
D’autres liens existent entre la Chasse sauvage, le cerf et la religion gauloise. Rappelant que « les scènes de chasse au sanglier ou au cerf jouent un très grand rôle dans la décoration des stèles et des sarcophages gallo-romains », M. Hatt ajoute :
« On trouve dans les littératures galloises et irlandaises des récits de Chasse fantastique, où la poursuite du cerf est le point de départ d’une série de tribulations, ouvrant accès à un monde imaginaire, qui n’est qu’une autre forme de l’outre-tombe. Il est probable que les Celtes continentaux ont connu des légendes analogues. La poursuite mouvementée du cerf et du sanglier qui figure sur les monuments funéraires correspondrait donc également chez eux à une forme de mythe de la mort. Nous nous expliquerions de la sorte la fréquence de ces scènes sur les monuments funéraires de la Gaule du Nord-Est » (« Les croyances funéraires des Gallo-Romains d’après la décoration des tombes », art. cit.).
La Chasse sauvage aurait ainsi des correspondances dans les mythes celtiques relatifs à la mort. On peut en trouver confirmation dans l’histoire exemplaire du prince Pwyll. « Comme c’est souvent le cas dans les romans de la Table Ronde — écrit M. Jean Markale —, tout commence par une chasse au cerf ». Pwyll s’écarte de ses compagnons, et suit ses chiens dans une forêt mystérieuse. Tout à coup, il entend les cris d’une autre meute. Il se précipite alors, et voit cette meute étrangère terrasser le cerf qu’il poursuivait. L’aspect extraordinaire des chiens qui la composent ne manque pas de l’étonner : « Ils étaient d’un blanc éclatant et lustré, et ils avaient les oreilles rouges, d’un rouge aussi luisant que leur blancheur ». Mais Pwyll s’en moque. Il appelle sa meute à la curée. Apparaît alors un cavalier, qui lui reproche vertement son manque de courtoisie et réclame réparation du dommage. Ce cavalier finit par dévoiler son identité. Il n’est autre qu’Arawn, roi d’Annwfn. Or, annfwn signifie “abîme”, et par extension “royaume des morts”. Pwyll se trouve donc en face du souverain de l’autre monde. M. Markale écrit à cet endroit : « Au Pays de Galles, on entend parfois les chiens d’Annfwn aboyant dans l’air, à la recherche d’une proie comme dans les campagnes françaises on entend le passage de la Mesnie Hellequin, sorte de Chasse infernale d’un gibier qui ne peut jamais être rejoint » (L’épopée celtique en Bretagne, Payot, 1971, pp. 27-29).
Les guerriers celtes, à l’exemple des Germains, ne considéraient pas l’autre monde autrement que comme le prolongement de leur existence terrestre. Dans les légendes celtiques, les morts continuent à se battre après la fin des combats, ou bien, comme dans la célèbre bataille de Mag Tured, ils ressuscitent le lendemain. Pour eux, (de monde inférieur est aussi une sorte de Valhalla » (J. de Vries, op. cit., p. 264) (42).
Jusqu’à l’heure du réveil
Il reste à évoquer un dernier aspect de la Chasse sauvage, c’est son historicisation.
L’incessante conversion du mythe et de l’histoire est un trait caractéristique de la protohistoire indo-européenne. Certains dieux, au fil des générations, ont pris une dimension historique (exemples des dieux borgne et manchot, historicisés chez les Romains sous les noms d’Horatius Coclès et Mucius Scaevola). Inversement, des personnages ayant réellement existé, et ayant joué un rôle particulièrement important dans les épopées nationales (rois, empereurs, héros populaires et nationaux), se sont vu dotés des attributs divins (d’où de fréquentes et graves erreurs d’interprétation). Le Chasseur sauvage, on le sait, n’a pas échappé à la règle.
Une tradition légendaire veut que les personnages historiques ayant atteint une certaine dimension aux yeux du commun se voient conférer une sorte d’immortalité. Quand se répand la nouvelle de leur mort, nombreux sont ceux qui se refusent à y croire. Des rumeurs se mettent alors à circuler. Le roi (ou le héros) est « parti pour un pays lointain » (parfois pour la Croisade), il est « retenu prisonnier » (Richard Cœur de Lion), il sommeille en quelque endroit éloigné. Ceux qui lui ont succédé profitent de son absence, dilapident ses biens, démolissent ce qu’il avait construit. Mais un jour, il reviendra dans toute sa gloire et sa fureur, rétablir l’ordre et la loi, châtier les traîtres, et récompenser les siens. C’est alors qu’il prendra, bien souvent, les traits du Wilde Jäger.
Selon la légende, Arthur (bien identifié par M. Dontenville comme un « homologue celtique » de Wodan) et ses chevaliers reposent ainsi, avec leurs chevaux et leurs armes, dans le sein d’une montagne. Un jour, les trompes sonneront. Les chevaux se mettront à piaffer, et l’on entendra le cliquetis des épées. Ce jour là, Arthur s’apprêtera pour la dernière bataille. Vision du Ragnarök. Dans l’intervalle, comme le héros irlandais Finn, il chasse le sanglier mythique et chevauche dans la nuit (H. Dontenville, Les dits et récits de mythologie française, 1950, pp. 28-29 et 34-36 ; W. K. Kelly, op. cit., pp. 286-87).
Plusieurs souverains germaniques, héroïsés de leur vivant, se sont endormis de la même façon. Entouré de ses hommes d’armes et de ses écuyers, Frédéric Barberousse (1123-1190) sommeille au cœur du Kyffhäuser, sommet de l’Allemagne septentrionale, en Thuringe. Il attend, « dans les cavernes ténébreuses de la montagne, le réveil de l’unité et de la puissance des Germains ». Quand les corbeaux cesseront de survoler la région, il sortira de sa retraite pour sauver l’Empire menacé (Fluard Hugo Meyer, Deutsche Volkskunde, Strassburg, 1898, pp. 346-47 ; Martin Ninck, Wodan und Germanischer Schicksalsglaube, Jena, 1935 & Köln, 1967, pp. 133-38). Une autre tradition, alsacienne celle-là (ayant été duc de Souabe avant de devenir empereur, Frédéric Ier s’était rendu très populaire en Alsace), prétend qu’il repose sous un roc de l’Ochsenfeld, le Bibelstein (Jean Variot, op. cit., pp. 89-90).
Charlemagne attend son heure à l’Odenberg (c’est-à-dire à la “montagne d’Oden-Odhinn”), en Basse-Hesse. Quant à Kaiser Karl (Charles V ou Charles-Quint), on dit qu’il dort sous l’Unterberg ou Wunderberg, près de Salzbourg (Martin Ninck, op. cit., pp. 133-38).
L’Empereur
 Il y a d’autres exemples, plus près de nous. L’annonce de la mort de Napoléon, par ex., rencontra dans les milieux les plus divers une incrédulité absolue. « Napoléon peut-il mourir ? Une légende évasionniste se développa, qui prenait naissance sur des rumeurs, des confidences, des projets plus ou moins vagues. Dans sa Vie de Napoléon, Walter Scott raconte qu’un contrebandier écossais aurait imaginé un submersible qui aurait permis à l’Empereur de s’évader de son île-prison. Théophile Gautier reprendra l’anecdote dans Partie carrée. La survie de Napoléon : un thème très exploité après 1821. On en retrouve l’écho jusque dans Les Burgraves de Victor Hugo : Frédéric Barberousse sorti de sa retraite pour régénérer l’Allemagne ne préfigure-t-il pas Napoléon ? » (Jean Tulard, Le mythe de Napoléon, Armand-Colin, 1971, p. 59).
Il y a d’autres exemples, plus près de nous. L’annonce de la mort de Napoléon, par ex., rencontra dans les milieux les plus divers une incrédulité absolue. « Napoléon peut-il mourir ? Une légende évasionniste se développa, qui prenait naissance sur des rumeurs, des confidences, des projets plus ou moins vagues. Dans sa Vie de Napoléon, Walter Scott raconte qu’un contrebandier écossais aurait imaginé un submersible qui aurait permis à l’Empereur de s’évader de son île-prison. Théophile Gautier reprendra l’anecdote dans Partie carrée. La survie de Napoléon : un thème très exploité après 1821. On en retrouve l’écho jusque dans Les Burgraves de Victor Hugo : Frédéric Barberousse sorti de sa retraite pour régénérer l’Allemagne ne préfigure-t-il pas Napoléon ? » (Jean Tulard, Le mythe de Napoléon, Armand-Colin, 1971, p. 59).
Le thème fut popularisé par Béranger : « À moi soldat, à vous gens du village, / Depuis huit ans on dit : “Votre Empereur / A dans une île achevé son naufrage ; / Il dort en paix sous un saule pleureur”. / Nous sourions à la triste nouvelle, / Ô Dieu puissant qui le créas si fort, / Toi qui d’en haut l’a couvert de ton aile, / N’est-il pas vrai, mon Dieu, qu’il n’est pas mort ? » (Jean Touchard, La gloire de Béranger, Armand-Colin, 1968). « Un phénomène identique — ajoute M. Tulard — a suivi la mort de Hitler, dont la présence fut signalée un peu partout dans le monde après 1945 » (op. cit., p. 59).
Allant jusqu’au bout du processus, certains auteurs font même de Napoléon un mythe solaire. La thèse est soutenue en 1827 par J.B. Pérès, dans un livre intitulé Comme quoi Napoléon n’a jamais existé ou grand erratum, source d’un nombre infini d’errata à noter sous l’histoire du XIXe. Reprenant la méthode employée par Charles Dupuis dans son Origine de tous les cultes, Pérès montre « que Napoléon n’a jamais existé, qu’il s’agissait en réalité du soleil (Apollon-Apoléon) ; la mère d’Apollon s’appelait Leto, celle de Napoléon Laetitia ; l’Empereur avait 4 frères, en réalité les 4 saisons ; il était venu de l’Est (l’Égypte) pour se coucher à l’Ouest (Sainte-Hélène), au terme d’un règne de 12 ans (les 12 heures du jour). N’était-ce pas là la course du soleil ? » (Jean Tulard. op. cit., pp. 87-88 ; texte complet in : J. Tulard (dir.), L’Anti-Napoléon : La légende noire de l’Empereur, Julliard, 1964, pp. 16-24).
Tandis que la légende impériale prenait le relais de l’histoire, le thème du “réveil des héros” inspirait de nombreux artistes, parmi lesquels Détaille, et surtout Auguste Raffet, dont au moins 2 lithographies (Le Réveil, en 1848 ; La Revue nocturne, en 1836) mettent en scène une sorte de cavalcade mortuaire et héroïque. L’une d’elles porte le commentaire suivant : « La caisse sonne, étrange, / Fortement elle retentit, / Dans leur fosse, en ressuscitent / Les vieux soldats péris ».
Toujours vivant
Ces croyances populaires sont à rapprocher de la « Chasse du cardinal de Rohan », qui, au début de ce siècle, défrayait encore la chronique. On lisait ainsi, le 31 décembre 1901, l’écho suivant dans les colonnes du Petit Journal :
« La population des environs de Heiligenberg (43), en Alsace, est depuis quelques jours en proie à une vive émotion. Des paysans croient avoir rencontré plusieurs fois le spectre du cardinal de Rohan, errant sur la route de Still, à la poursuite du diable, qui fait son apparition sous la forme d’un chien noir. Le souvenir du cardinal de Rohan, qui était coadjuteur de Strasbourg et qui avait des droits seigneuriaux dans la vallée de Boersch, est encore très vivace dans cette partie de l’Alsace. Une légende populaire veut que l’ombre du cardinal apparaisse toutes les fois qu’un événement heureux pour l’Alsace-Lorraine se prépare. On interprète d’une façon particulière la chasse qu’il est censé faire, depuis Noël, au chien noir. Des gens sceptiques croient cependant qu’il ne s’agit là que de simples manœuvres de contrebandiers » (cité in Revue des traditions populaires n°1, t. XVII, 1902).
Le mythe se perpétuait encore.
►Jean-Jacques Mourreau, Nouvelle École n°16, 1972.
♦ Notes :
- (1) Adam de La Halle, « Le jeu de la feuillée », in Les classiques français du Moyen-Âge n°6, Paris, 1911. Texte de E. Langlois ; trad. Jean-Claude Rivière.
- (2) « L’année 1550, l’armée infernale (wütteshere) s’est fait entendre à Mösskirch. C’était pendant une nuit d’automne, après dix heures. Tandis qu’une grosse et très ancienne voix résonnait sur l’Ablach, l’armée, venant de Banholz, s’est d’abord arrêté d’abord arrêtée quelques instants à Minchsgereut. Puis elle a descendu la Herdtgassen, est passée à côté de l’hospice des incurables, près de nos femmes massées sur le pont de l’Ablach, a longé la rivière jusqu’à la ville et la montée des chats : sa marche s’accompagnait de du bruits étranges, de cris perçants, de tintements de sonnettes et de bourrasques de vents… » (trad. Doris Christians ; cité par Otto Höfler, Kültische Geheirnbunde der Germanen, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt a.M., 1934, p. 11).
- (2 bis) Le mot Arlequin fait son apparition en 1324, dans les Archives de la ville de Dijon. Ce n’est qu’en 1585 qu’un acteur italien en fera l’un des personnages les plus populaires de la Comedia dell’Arte (Arlecchino). Sa première orthographe est Harlequin, « de Hellequin, nom d’un diable » (Albert Dauzat, Jean Dubois & Henri Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, 1971, p. 46). En 1726, on trouve l’expression arlequinade dans le Dictionnaire universel françois et latin de Trévoux.
- (3) Le titre du célèbre roman d’Emily Brontë (1818-48), Wuthering Heights (1847), « œuvre puissante et passionnée qui rappelle les scènes d’orage de King Lear » (Ifor Evans, Histoire de la littérature anglaise, Payot, 1965, p. 130), a été traduit en français par Les Hauts de Hurle-vent. Cette traduction est très caractéristique. Le verbe to wuther, peu courant en anglais, est de même origine que l’allemand wüten. On retrouve dans les 2 termes l’idée de fureur, de rage forcenée, d’éléments naturels déchaînés, d’orage, de hurlement lugubre, etc. contenue dans l’expression das wütende Heer, “la Chasse infernale”.
- (4) Y compris à la forme plus spécialisée du langage maritime, où le quin, ou “chien”, désigne la boule située à l’extrémité d’un filet dérivant : « fous tan quin à l’iau », mets tes filets à l’eau (M. Billard, « Glossaire des mots employés par les pêcheurs professionnels de la Seine normande », in Parlers et traditions populaires de Normandie, t. II, fasc. 7, Saint-Lô, 1970, p. 64). Voir aussi Hans Goebl, Die Normandische Urkundensprache : Ein Betrag zur Kenntnis der nordfranzösischen Urkundensprachen des Mittelalters, Hermann Böhlaus Nachf., Wien, 1970.
- (5) Alsace : la Chasse sauvage, la Haute chasse. — Anjou : la Chasse Hannequin ou Helquin, la Chasse Galerie. — Auvergne : le Grand Veneur du Cantal. — Pays basque : la Chasse du roi Salomon. — Béarn : la Chasse du roi Artus. — Berry : la Chasse à baudet conduite par Georgeou (le Diable), la Chasse Maligne conduite par Gayère, la Chasse à Rigaut (ou à Ribaud), la Chasse Briguet, la Chasse à Bader conduite par Lucifer. — Bourbonnais : la Chasse Gayère. — Bourgogne : la Mesnie Hellequin, le Chasseur Noir, la Chasse du Peût (Diable), le Chasseur des Avents (avec son chien Gavelo, ou Garelaut). — Bresse : la Chasse volante du roi Hérode. — Bretagne : la Menée ankine (poursuivie par Jeanne Malobe, la filandière de la nuit), le Chariot de David, la Chasse Arthu, la Chasse de saint-Hubert, le Chariot volant, la Chasse à l’Hulaine. — Champagne : la Chasse à roquets. — Corse : la Bourrasque des morts. — Franche-Comté : Chasse de la Dame de Moissey, Chasse d’Oliferne. — Gascogne : Chasse Artus (ou Charroie, ou Carré), le Chasseur Clécus. — Île-de-France : le Grand Veneur, la Chasse du Roy. — Limousin : la Casso-Galiero ou Casso-Galerino. — Lorraine : le Chasseur du bois de Krombesch, la Chasse de la Bête du Rondet, le Mouhinnequin, la Mégnéye Hennequin, la Grande chasse, la Chasse de Jean des Baumes. — Lyonnais : La Chasse Maligne. — Maine : la Chasse Artu, la Chasse Malé (ou Maré, ou Mao), la Chasse Valory. — Nivernais : la Chasse du Piqueur noir, la Chasse des revenants (dite de saint-Hubert), la Chasse saint-Eustache, la Chasse du Peût. — Normandie : la Chasse du Diable, la Chasse Caïn, la Chasse Proserpine, la Chasse Chéserquine, la Chasse Héletchien. — Orléanais : la Chasse Macchabée, ou Macabre. — Poitou : la Chasse Galopine, la Chasse Rigaud, la Chasse à Beurlin, la Chasse à Guérriou, la Chasse à Caillaud, la Chasse à Griot, la Chasse Cailanne. — Roussillon : le Mauvais Chasseur. — Savoie : le Racheron, la Charrette de David. — Touraine : la Chasse Briquette, la Chasse du roi Huguet (d’après Claude Seignolle, Les évangiles du diable selon la croyance populaire, Maisonneuve & Larose, 1964, pp. 612-13).
- (6) L’étymologie de ces termes n’est pas très aisée à établir. On peut rapprocher Hupéri du cri de Huhdada (Huhde, Hudada), lequel désigne parfois le Grand Veneur en personne, et contient une idée de chasse (angl. to hunt, chasser, huntsman, chasseur, hunter, cheval de chasse, hound, chien de chasse ; all, hund, chien, hündchen, petit chien).
- (7) L’élimination physique des pasteurs chargés de la fonction sacerdotale (les druides essentiellement, dans le domaine celtique, et les godhis germaniques dans une moindre mesure), accéléra le processus. Celui-ci avait commencé très tôt. La Bretagne s’étant révoltée dans la deuxième moitié du Ier siècle, rapporte Tacite (Annales, XIV, 29-30), le Romain Paulinus Suetonius, chargé de réprimer le soulèvement, se mit en mesure d’investir l’île sacrée de Mona. Il n’eut pas à livrer bataille. Les druides, le corps immobile, les membres comme paralysés (quasi haerentibus membris, immobile corpus), n’opposèrent nulle résistance, et furent massacrés jusqu’au dernier. « Pour se défendre, note Mme Françoise Le Roux, les druides n’ont disposé en cette affaire que de leur magie et de leurs malédictions » (Les druides, PUF, 1961, p. 6). Deux siècles plus tard, les premières églises chrétiennes commençaient à s’élever sur les fondations mêmes des temples païens, et le pape Grégoire le Grand, s’adressant aux “missionnaires”, déclarait : « Il faut que les sanctuaires voués au culte des faux dieux soient consacrés au culte véritable pour que les païens convertis l’adorent dans les lieux mêmes où ils avaient l’habitude de venir » (cité par Bède le Vénérable, Hist. Ecclesiast. Anglorum, I, XXX ; et saint-Grégoire. Epist. XI, 56).
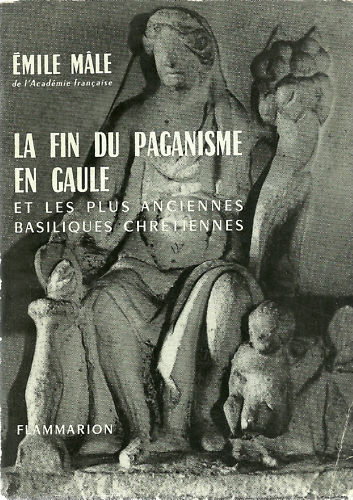 Au IVe siècle, les destructions devinrent systématiques. « En démolissant les temples et en brisant les statues dès 375, écrit complaisamment M. Émile Mâle, saint-Martin nous apparaît comme un audacieux novateur, du moins en Occident » (La fin du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrétiennes, Flammarion, 1950, p. 45). Ce qui fut sauvé dut être caché. C’est sous un lit de briques que fut découverte la Minerve de Poitiers. En Bourgogne (à Fragnes, à Saint-Marcel-des-Rues), on a retrouvé des statuettes sacrées qui avaient été enfermées dans des coffres, puis ensevelies, etc.
Au IVe siècle, les destructions devinrent systématiques. « En démolissant les temples et en brisant les statues dès 375, écrit complaisamment M. Émile Mâle, saint-Martin nous apparaît comme un audacieux novateur, du moins en Occident » (La fin du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrétiennes, Flammarion, 1950, p. 45). Ce qui fut sauvé dut être caché. C’est sous un lit de briques que fut découverte la Minerve de Poitiers. En Bourgogne (à Fragnes, à Saint-Marcel-des-Rues), on a retrouvé des statuettes sacrées qui avaient été enfermées dans des coffres, puis ensevelies, etc.- (7 bis) Il existe au Musée des Arts & Traditions Populaires, une représentation de saint-Edern (ou Helleau), chevauchant un cerf. Il s’agit probablement d’une transposition bretonne de la légende de saint-Hubert.
- (8) L’hypothèse a été soulevée dans le Bulletin de la Société de mythologie française (n° LXXX, I-III, 1971, p. 77). Question méritant une étude : la danse macabre est-elle d’inspiration chrétienne ?
- (9) Mais on ne peut passer sous silence l’hypothèse selon laquelle ces Männerbunde seraient en partie d’origine pré-indo-européenne. Elles se seraient alors identifiées aux confréries semi-secrètes réunissant les jeunes guerriers des sociétés matriarcales. Cette opinion serait à examiner avec attention. On saurait ainsi comment ces confréries se sont transformées après l’apparition des Indo-européens (note N. E.).
- (10) On trouvera d’intéressants commentaires chez Eduard Norden, Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania, Verlag B.G. Teubner, Stuttgart, 1920.
- (11) On rencontre dans les textes anciens différentes graphies du nom des Chattes : Chatti chez Tacite, Kàttai chez Ptolémée, Catti, Catthi, etc. Sur le plan étymologique, les auteurs le font dériver tantôt du got. hatan, haïr, détester (Müllenhoff, Kögel, Laistner), tantôt de l’an. hoettr, garde, surveillance (Grimm, Braune). À ce sujet : M. Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen - und Völkernamen. Reprod. photoméc. : Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1965, pp. 130-31).
- (12) À ce sujet, M. Jacques Perret a proposé l’explication suivante : « À Rome, l’anneau de fer était honorifique, et symbolisait à l’origine la vertu guerrière (Pline, N.H. XXXIII, 9). Il pourrait bien en avoir été de même chez les Chattes, où cet anneau eût signifié consécration, appartenance aux dieux de la guerre. Tacite a pu interpréter à contre-sens un usage réel » (op. cit., p. 189). Rappelons que chez les Celtes, les torques (colliers rigides) avaient également une signification religieuse.
- (13) G. Dumézil a rapproché le second élément du mot Einherjar (aina-harija) du nom Harii (Haries) et de Heer, armée (op. cit., p. 80).
- (14) Cette opinion fut soutenue par Jan de Vries (« Der Mythos von Balders Tod », in : Arkiv för Nordisk Filologi, vol. 70, 1955, pp. 41-60). Elle a été critiquée par Georges Dumézil, qui souligne que « Baldr ne “ressuscite” pas comme il devrait le faire dans un mythe d’initiation, après une mort simulée », et ajoute : « Baldr, dont le nom signifie Herr, est bien odinique, seulement il ne se rattache pas à l’aspect guerrier d’Odhinn, mais à son aspect souverain, dont il offre une conception plus pure, présentement irréalisable, réservée à l’avenir » (Les dieux des Germains : Essai sur la formation de la religion scandinave, PUF, 1959, p. 104).
- (15) A. Van Gennep signale qu’à Strasbourg, « on croyait encore vers la fin du XVIe siècle, que se promenaient pendant les Avents les âmes de ceux qui avaient péri de mort subite ou violente » (op. cit. ; p. 2870).
- Au temps du Carnaval, la Guetigsheer, “l’Armée des revenants”, parcourait l’Argovie, enlevant les plus belles vaches et les meilleurs veaux. En échange du bétail qu’on leur avait pris, les fermiers s’assuraient la prospérité. Les champs traversés par la Wilde Fare du peuple de la nuit devenaient d’une remarquable fertilité. Dans certaines localités, ces nuits de tapage s’appelaient Posterlijagd ou Stregglenjagd, “chasse aux fantômes” ou “aux sorcières” (R. Christinger & W. Borgeaud, op. cit., p. 15).
- (16) Chez les folkloristes français, il y a lieu cependant de noter les réticences d’A. Van Gennep. Contrairement à des auteurs tels que Saintyves (Émile Nourry) ou Sébillot, Van Gennep, pour des raisons difficiles à discerner, se montre très hostile à l’idée que le folklore contemporain puisse contenir des survivances païennes (et plus hostile encore, lorsqu’il s’agit de survivances germaniques). Établir des rapprochements entre les croyances d’hier et les traditions d’aujourd’hui ne semble pourtant pas la plus mauvaise façon d’aboutir à des conclusions valables.
- Les historiens des religions sont plus catégoriques. M. G. Dumézil pose la question : « Ces représentations de l’au-delà (la Valhöll), et aussi celles d’Odhinn chevauchant sa monture à huit pieds, le démoniaque Sleipnir, sont-elles à l’origine des croyances modernes, surtout attestées au Danemark et dans le Sud de la Suède, où Oden est le meneur de la Chasse fantastique ? » (Les dieux des Germains, op. cit., pp. 45-46). R.L.M. Derolez ajoute : « Nous trouvons peut-être une dernière trace du Wodan du continent dans la croyance populaire très répandue concernant le “Chasseur sauvage”, le chef de la “bande sauvage”, l’armée des fantômes, qui parcourt le monde lors de la nuit de Jul, et peut-être en d’autres moments de l’année » (Les dieux et la religion des Germains, Payot, 1962, p. 74). C’est aussi le sentiment de M. Gonzague de Reynold, qui évoque « le Wotan-Odin proscrit et maudit par le christianisme, venu se réfugier dans les traditions populaires ». « Ce détrôné, écrit-il, n’est plus qu’un démon, un être malfaisant, incarnation du vent et de la tempête, incarnation de Satan (..) On entend passer dans la nuit, avec sa meute hurlante, le Chasseur noir que Victor Hugo a si puissamment évoqué dans Le Rhin, lorsqu’il a suspendu le récit de son voyage pour nous raconter la légende du beau Pécopin et de la belle Bauldour » (La formation de l’Europe, V : Le monde barbare et sa fusion avec l’Europe antique ; 2 : Les Germains, Plon, 1953, pp. 345-46).
- Même conclusion chez Pierre Grappin : « Les anciens Germains pensaient entendre dans le ciel une chevauchée fantastique durant les nuits d’orage. Un galop endiablé traversait alors le ciel, mené par les guerriers morts en combattant. Cette troupe mystérieuse et glorieuse, qui traînait après elle le souvenir de combats sans nombre, emportée au galop de chevaux furieux, avait un chef, le maître de la fureur, celui qui souffle au cœur des hommes l’enthousiasme guerrier : Wode, qui devint Wotan, et dans le Nord Odin » (« Mythologie germanique », in : Pierre Grimal (dir.), Mythologie des montagnes, des forêts et des îles, Larousse, 1963, p. 47).
- (17) Dérivent de wuotan un certain nombre de noms et de prénoms : Wuth, Wüttig, Wuttrich, Wutz, Wodja, Wodrig, Woderich, Wüdiger, Woldaric, Wothe, Wottke, etc. (A. Heintze, op. cit., pp. 276-77).
- (18) De là, probablement, l’habitude des Scandinaves et des Anglo-Saxons d’en faire le « premier roi » de leurs dynasties (Michel de Boüard (dir.) et alia, Les Vikings, Paris, 1968, p. 142), ce qui n’a pas manqué de susciter des interprétations évhéméristes assez contestables. A. H. Krappe a pu écrire : « Le roi George VI (serait ainsi) le descendant lointain, mais direct, du dieu Woden, all. Wuotan, v. nor. Othin » (La genèse des mythes, 1952, p. 58).
- (19) L’hypothèse a été émise selon laquelle, à un premier niveau, celui de l’Allvater et de l’administration du monde, tous les défunts sans distinction auraient appartenu à Odhinn. Mais cette vue quasi-monothéiste est loin d’avoir reçu confirmation. Au second niveau, celui où le dieu souverain s’efface devant le magicien et le guerrier, ne reviennent à Odhinn que les combattants tombés sur les champs de bataille, et ceux dont une blessure symbolique (le « signe d’Odhinn ») a provoqué la mort. Dans le Chant de Hârbardhr, strophe 24, Odhinn précise ses attributions par rapport à celles de Thor : « Odhinn possède les jarl (nobles) qui tombent dans le combat ; tandis que Thor possède la race des valets » (G. Dumézil, Mythes et dieux des Germains, op. cit., p. 32 ; Les dieux des Germains, op. cit., p. 65). Loin de les effacer, la mort maintient et accentue les différences entre les hommes. Les sujets d’Odhinn rejoignent la Valhöll, où ils combattront jusqu’au Ragnarök, tandis que les sujets de Freyr, liés à la terre et au bétail, gagnent le domaine souterrain de Hel. D’un côté survie par les combats, de l’autre dissolution dans le cycle vital. Conception aristocratique (G. Dumézil, Du mythe au roman, PUF, 1970, p. 139).
- (20) En Allemagne septentrionale et méridionale, comme en Scandinavie, les voleurs étaient autrefois pendus ou étranglés. Cela a conduit Otto Höfler à se demander si certains criminels de droit commun n’étaient pas en quelque sorte “consacrés” à Odhinn au moment qu’on les châtiait. La question s’est à nouveau posée en 1952, lorsque des hommes de l’âge du Fer furent retrouvés, conservés presque intacts dans des tourbières du Schlesvig danois (homme de Tollund, de Grauballe, etc.). En effet, certains de ces hommes avaient été étranglés ou pendus. P. V. Glob, qui leur a consacré un ouvrage très documenté, rappelle qu’en Scandinavie des sacrifices humains furent associés au culte de Nerthus, déesse de la fertilité, et de Mercure, dieu des voleurs, que les Romains assimilèrent à Wodan. « Il apparaît clairement, écrit-il, que les circonstances d’inhumation des hommes des tourbières n’ont rien de commun avec les habitudes funéraires de l’époque, et qu’elles présentent au contraire de nombreuses caractéristiques d’inhumations sacrificielles » (The Bog People : Iron-Age Man Preserved, Paladin / Granada Publ., London, 1971, p. 108).
- (21) Alors qu’il combattait aux premiers rangs de sa dernière campagne, rapporte la Saga des Volsungs, le roi Sigmund vit apparaître un homme portant un chapeau profondément enfoncé sur la tête, les épaules couvertes d’un manteau de couleur bleue, borgne et brandissant un javelot. Voulant éviter d’être atteint par l’arme de jet, Sigmund brisa son épée. Dès cet instant, le destin des armes se retourna contre lui. Blessé, on lui demanda s’il espérait se relever bientôt. « Plus d’un a survécu, répondit-il, bien qu’il n’ait subsisté qu’un faible espoir à un moment donné ; mais de moi, le bonheur s’est détourné ; aussi, je ne veux pas me laisser soigner. Odin ne veut pas que je manie encore le glaive ; il l’a en effet brisé. J’ai livré la bataille aussi longtemps qu’il l’a permis » (R.L.M. Derolez, op. cit., p. 79).
- (22) Le culte du dieu-au-javelot est connu dès l’âge du Bronze (R.L.M. Derolez. op. cit., p. 81). Il est en rapport avec la coutume de jeter une lance par-dessus l’armée ennemie, au moment d’entamer le combat. Il s’agit, en fait, de répéter le geste d’Odhinn lançant son javelot, et provoquant ainsi «une fatale panique» chez l’ennemi (G. Dumézil, Les dieux des Germains, op. cit., p. 37). L’une des plus anciennes représentations cultuelles de cette scène bien connue figure peut-être sur l’une des 2 cornes d’or découvertes à Gallehus, près de Tondern (en Schlesvig nord). En 1956, le comte Éric Oxenstierna a cru reconnaître, dans l’une des figures de la corne de Hlewagast, une représentation d’Odhinn porteur du javelot. Il situe le personnage dans une scène de « mascarade », dérivée du cycle annuel des solennités religieuses. La corne remonte au Ve siècle de l’ère. Elle porte une inscription gothique en caractères runiques, dont le vocabulaire extrêmement archaïque « peut-être considéré comme l’ancêtre des langues scandinaves ou de l’anglais moderne » (John Geipel, The Viking Legacy : The Scandinavian Influence on the English Language, David & Charles, Newton Abbot, 1971, p. 48).
- (23) Sur la personnalité d’Odhinn-Wodan, consulter : Gonzague de Reynold, op. cit., pp. 323-55 (« Odin et ses interprètes ») ; Ernest Tonnelat, Les religions des Celtes, des Germains et des anciens Slaves, 1948, p. 363 ; G. Dumézil, Mythes et dieux des Germains, op. cit., pp. 26-28 ; R.L.M. Derolez, op. cit., pp. 70-92 ; H. Ringgren & A. V. Ström, Les religions du monde, Payot, 1966, pp. 346-51 ; Martin Nick, Wodan und Germanischer Schicksalsglaube, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1967 ; Eckart Peterich & Pierre Grimal, Götter und Helden : Die Klassischen Mythen und Sagen der Griechen, Römer und Germanen, Walter-Verlag, Olten & Freiburg i.Br., 1971, pp. 210-15 et 315-16.
- (24) Asgard (de gard : all. garten, angl. garden, fr. jardin) est la demeure des Ases, peuple sur lequel règne Odhinn (dans la version “historicisée”), et, par suite, le séjour des dieux.
- (25) Le corbeau, qu’un scalde nommait « la mouette d’Ygg » (autre dénomination du dieu), est, comme on l’a vu, l’un des principaux attributs d’Odhinn. Sur la plaque décorative d’un casque découvert à Vendel (Suède), se trouve un cavalier armé d’un javelot, qui, très probablement, se confond avec le dieu. Un corbeau vole devant lui, un autre derrière lui. À ses pieds, se trouve un serpent. Sur d’autres représentations, ce sont 2 loups qui accompagnent les oiseaux. Les 2 corbeaux symboliseraient alors le principe de création, et les loups, le principe de destruction (P. Grappin. art. cit., pp. 47-51).
- Encore une fois, nous nous trouvons en présence d’un animal funéraire et devin (i.e. d’augure et de mauvais augure). Chez les Aryens, le Mahâbhârata appelle les corbeaux les « messagers de la mort». En Perse, ils figurent parmi les attributs de Mithra. Chez les Celtes, la déesse irlandaise de la guerre, Bodb, porte le nom de la corneille. Le corbeau joue par ailleurs un rôle essentiel dans le récit gallois intitulé Breudwyt Ronabwy (Le songe de Ronabwy) : après avoir été taillés en pièces par les soldats d’Arthur, les corbeaux d’Owein les massacrent à leur tour. Selon Mme Françoise Le Roux, « le corbeau est l’oiseau divin par excellence, celui qui, disait-on même, avait enseigné aux Gaulois le remède contre un poison redoutable dont ils imprégnaient leurs flèches » (Les druides, op. cit., p. 58). Le Pseudo-Plutarque affirme que le nom de la ville de Lyon (Lug-dunum : colline de Lug) voudrait dire en réalité “colline aux corbeaux”. Alors qu’on creusait les fossés des fondations de la cité, rapporte-t-il, « apparurent tout à coup des corbeaux qui, volant çà et là, couvrirent les arbres des alentours. Momoros, qui était habile dans la science des augures, appela la ville nouvelle Lugdunum. Car, dans leur langue, le corbeau se nomme lougos ». Cette étymologie n’a pas été retenue par les spécialistes. Mais l’idée de présage n’en est pas moins liée au vol du corbeau. En Grèce, où l’animal était consacré à Apollon (la corneille étant un attribut d’Athéna), et s’il faut en croire Strabon, ce seraient des corbeaux qui auraient déterminé l’emplacement de l’omphalos de Delphes (sanctuaire précisément voué au culte d’Apollon).
- En Basse-Saxe, et dans quelques autres régions, le corbeau tient un rôle assez important dans la légende de la Chasse sauvage. On rapporte que le père du Chasseur aurait changé son fils en corbeau. L’animal a des ailes de fer. Carnivore et nécrophage, il tue ceux qui se moquent de lui (A. Endter, op. cit., p. 37). Ailleurs, le vol du corbeau est interprété comme un présage. De très vieux récits rapportent que la montagne du Kyffhaüser est survolée par des corbeaux. L’empereur Barberousse, qui sommeille à cet endroit (voir plus loin), se réveille parfois et s’inquiète de leur présence. Lorsqu’il apprend qu’ils sont toujours là, il affirme qu’il doit « encore dormir cent ans». En Grande Bretagne, une antique tradition veut que l’Empire britannique soit condamné à s’écrouler du jour où les corbeaux de la Tour de Londres disparaîtront. Aussi les oiseaux sont-ils nourris et protégés par l’administration royale.
- (26) Hakelberg ou Hakelbärend, selon Walter K. Kelly (op. cit., p. 268), voudrait dire « qui porte un manteau ». On sait qu’il s’agit là d’une caractéristique vestimentaire d’Odhinn.
- (26 bis) « Le chien, chez les Celtes, est toujours l’objet de comparaisons ou de métaphores flatteuses. Le plus grand héros, Cùchulainn, est le chien de Culann, et nous savons que tous les Celtes, aussi bien insulaires que continentaux, ont eu des chien dressés pour le combat et la chasse. Comparer un héros à un chien était faire honneur, rendre hommage à sa valeur guerrière. Toute idée péjorative est absente » (Jean Chevalier & Alain Gheerbrant (dir.), op. cit., p. 199). Cùchulainn ne mange jamais de viande de chien ; pour le condamner à périr, des sorcières qu’il a rencontrées sur sa route l’obligent à en consommer (voir à ce sujet Ogam, vol. XI, Rennes, 1959, pp. 213-15). Ce respect du chien contraste avec les sentiments professés dans certains pays du Tiers-monde. En Syrie, le chien est considéré comme l’impur par excellence. L’Islam, qui lui reproche notamment d’aboyer contre les scribes, en fait l’image de ce que la création comporte de plus vil.
- (27) Sleipnir est né de l’accouplement de Loki, métamorphosé en jument, et de Svaldilfari, étalon d’un géant. Son caractère est quelque peu démoniaque, et c’est à juste titre que Mircéa Eliade l’a décrit comme le « cheval chamanique » par excellence. Christinger et Borgeaud, qui voient dans ce coursier fabuleux 2 chevaux jumeaux accolés signalent avoir trouvé une représentation d’un cheval à 8 pattes à Val Camonica. Les gravures rupestres de ce site sont d’ailleurs du plus haut intérêt, et présentent de nombreux points communs avec celles, fort nombreuses, que l’on connaît en Scandinavie (R. Christinger & W. Borgeaud, op. cit., pp. 28-29. Voir aussi Fred Gudnitz, Broncealderens Monumentalkunst, Bohusläns Hällristnings-Forskningsarkiv, Tanumshede, 1962).
- (28) À rapprocher de la réprobation dont les équarrisseurs ont longtemps fait l’objet dans les campagnes. Rappelons qu’en France la consommation de la viande de cheval est relativement récente. Il fallut les nécessités du siège de Paris, en 1870, pour en vulgariser l’usage, d’abord dans la capitale, puis dans les autres régions.
- (29) Le cheval blanc était l’emblème national des Saxons. On le retrouve encore aujourd’hui dans leur patrie d’origine, l’Allemagne du nord-ouest, en Angleterre, et dans les provinces orientales des Pays-Bas. Des villes britanniques fondées par les Saxons, telles que Canterbury, l’ont pris pour blason ; des clubs sportifs en ont fait leur fanion. Les hôtels allemands Zum weissen Rossel sont aussi nombreux que les auberges anglaises The White Horse (et l’on y sert, bien entendu, du whisky du même nom) (Jan Kruls, « The Saxon Horses », in Northern World,n°1, vol. VII, Coventry, 1962, pp. 20-24).
- Chez les Germains, rapporte Tacite, les chevaux passaient pour être « dans l’intimité des dieux ». Il arrivait, au cours des expéditions, que les hommes leur laissent le soin de “décider” de la direction à suivre, et dans les combats, leur hennissement était interprété comme un présage de victoire (Paul Herrmann, Das altgermanische Priesterwesen, E. Diederichs Verlag, Jena, 1929, pp. 35-36). Il est remarquable, à cet égard, que les chefs légendaires qui menèrent les Saxons et les Jutes à l’assaut de l’Angleterre, soient connus sous le nom de Hengist et Horsa. Hengst est en effet le nom de “l’étalon” en allemand et en néerlandais, tandis que Horsa est évidemment horse, cheval (angl. horse, flam. hors, néerl. ros, all. Ross, v. fr. rosse, d’où Rossinante ; le nom du «poulain» est également commun : angl. foal, néerl. veulen, all. Fullen). Christinger et Borgeaud voient dans ces 2 personnages des dioscures mythologiques «historicisés», éponymes de chevaux jumeaux (op. cit., pp. 28-29). Le fait serait en rapport avec la coutume germanique de placer des figures stylisées (2 têtes de chevaux croisées) sur les fermes, les granges, et au faîte des maisons.
- (30) L’île de Gotland (Suède) est l’une des plus grandes îles de la Baltique. C’est un ancien sanctuaire. Got-land : terre des dieux, terre sacrée.
- (31) Il s’agit d’un grand cheval à robe claire, portant une crinière noire. Son nom est Freyfaxi, ce qui signifie littéralement “l’étalon de Frey à crinière noire”. « Hrafnkel avait une telle passion pour ce cheval — lit-on dans la saga — qu’il avait fait le serment de tuer celui qui monterait l’étalon sans sa permission ». On trouve dans la Valnsdoela Saga (ch. 34) un autre cheval portant le nom de Freyfaxi, et l’une des versions de l’Olaf Tryggvason’s Saga mentionne aussi un troupeau de chevaux consacrés au dieu Frey (Hermann Pàlsson (dir.), Hrafnkel’s Saga and other Icelandic Stories, Penguin Books, 1971, pp. 37-38).
- (32) « Un phallus d’étalon, appelé völsi, enveloppé avec des oignons dans un linge, passe de main en main chaque soir, les membres de la famille récitant une strophe obscène avec le refrain : “Que les Maurnir acceptent cette offrande” (Flateyarbok) (...) Völsi est Frey, et les Maurnir sont vraisemblablement les Dises » (H. Ringgren & A.V. Ström, op. cit., p. 355). À vrai dire, ce rite ne s’explique pleinement que dans le cadre d’un fonds commun indo-européen. Il rappelle le sacrifice du cheval chez les Indo-Aryens, et les procédures d’intronisation du roi chez les Celtes (J. de Vries, op. cit., pp. 252-53 ; Jaan Puhvel, art. cit., pp. 160-72).
- (33) Dans le monde romain, les equirria (27 février, 14 mars) et l’equus october (15 octobre) voyaient se dérouler des courses en l’honneur de Mars, suivies de sacrifices de chevaux. À l’issue de l’equus october, « le cheval de droite dans l’attelage vainqueur était sacrifié sur le Champ de Mars. On passait une couronne de pain au cou de l’animal, a pour la prospérité de la récolte » ; le sang était recueilli et remis à la garde des Vestales, la tête et la queue étaient portées à la regia, l’ancien palais royal » (H. Ringgren & A.V. Ström, op. cit., p. 316). Dumézil a vu dans cette coutume une sorte de « capitalisation royale de la victoire ».
- (34) Les Celtes célébraient Samuhin (ou Samhain, Samonios dans le calendrier de Coligny) le 1er novembre, au début de l’hiver. La Toussaint et la Fête des Trépassés, avec les visites au cimetière, en sont les survivances christianisées. On célébrait à Samuhin l’union d’un dieu avec la déesse des enfers, Morrigu. Des bûchers étaient dressés et embrasés sur les collines. « Le monde des esprits s’entrouvrait, et des personnages de cauchemar en sortaient » (J. de Vries. op. cit., p. 238). Les morts revenaient à leurs anciennes demeures, pour s’y réchauffer et s’y alimenter. « Pour un moment, le monde des puissances mystérieuses revenait se mêler au monde des humains» (Joseph Vendryès, « La religion des Celtes », in : Les religions de l’Europe ancienne, PUF, 1948, III, p. 314 ; Marie-Louise Sjoestedt, Dieux et héros des Celtes, p. 65).
- (35) On sait qu’à l’origine, les seules fêtes à date fixe de l’Église primitive étaient celles qui rappelaient la mort des saints et des martyrs. Fêter une naissance relevait de mœurs païennes. Mais en dépit de leurs efforts, les chrétiens ne parvinrent pas à remplacer l’anniversaire (naissance biologique, entrée dans la vie) par la fête du saint patron (souvenir du baptême, entrée dans l’Église), ni même à lui donner la même importance. Les Pères de l’Église se mirent donc en devoir de fixer une date calendaire et liturgique, correspondant à la naissance supposée de Jésus. Cela les contraignit à « se livrer à toutes sortes de calculs, sans aboutir à un même résultat » (A. Van Gennep. op. cit., pp. 2858-59). Les textes évangéliques brillaient en effet par leur imprécision. On proposa donc successivement le 18 avril (Clément d’Alexandrie), le 25 mars, le 6 janvier (saint-Épiphane), etc. Ce n’est qu’au IVe siècle (sur l’initiative du pape Liberus, d’après les uns, de Jules ler, selon les autres), que l’on retint la date du 25 décembre. Entre temps, on s’était aperçu de la tenacité avec laquelle les païens défendaient leurs coutumes. En fixant au 25 décembre la naissance de Jésus, l’Église s’annexait du même coup les festivités indo-européennes du solstice d’hiver, les libations du Jul et la grande cérémonie annuelle du culte de Mithra (Jean Mabire & Alain de Benoist, « Les fêtes du solstice d’hiver », in Nouvelle École n°6, 1968, pp. 49-54).
- (36) Non seulement le temps des pères, mais aussi de ces matres celtiques ou pré-indo-européennes, considérées comme les « protectrices tutélaires des vivants, mais aussi de la tombe et des morts » (JJ Hatt, « Les croyances funéraires des Gallo-Romains d’après la décoration des tombes », in : Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est, Thèse complémentaire, 1948, T. XXI, fasc. 1-2). Au cours de la nuit solsticiale, en Gaule et en Germanie méridionale, le culte des matres comportait un réveillon où « la place était marquée pour les Mères et pour les morts » (Ibid.). Bède le Vénérable (672-735) rapporte que, vers l’an 700, les Anglo-Saxons appelaient la nuit de Noël modranight, c’est-à-dire la “nuit des mères”. En allemand, l’expression Mütternacht, nuit des mères, est restée dans le langage courant ; elle correspond à Weihnachten (E. Fehrle, Deutsches Volkstum in Elsass, op. cit., p. 34).
- (37) De nos jours, le 13 décembre est dédié à sainte-Lucie. En Suède, cette date, véritable fête de la lumière, revêt toujours une grande importance. « La jeune fille de la maison, portant une longue chemise de nuit blanche et la couronne aux bougies allumées, doit faire le tour du foyer et offrir à chacun de ses habitants une tasse de café et des petits pains, aux formes curieuses, où l’on retrouve la roue du soleil » (C.G. Bjurström, « Santa Lucia en Suède », in Viking, Paris-Cherbourg, déc. 1955, p. 15). Lucie n’a fait que succéder à un démon (Lucifer : lux-fero, “j’apporte la lumière”).
- (38) L’usage païen de boire en l’honneur des morts fut d’abord prohibé par l’Église. Mais, dans un second temps, « le droit ecclésiastique sanctionna la coutume de ces libations solennelles (ölgerdh) de la mi-hiver ». En Norvège, elles « devinrent même l’objet d’obligations, dans les lois provinciales (...) La bière devait être bénie et bue par au moins trois familles ensemble, une fois par an ; la négligence de ce rite entraînait l’amende ecclésiastique typique de trois marks, et la récidive une confiscation des biens » (L. Musset, op. cit., pp. 135-36).
- (39) Dans les pays de langue allemande, la “période des Douze” (Zwölften) reçoit parfois le nom de Rauhnächte. Ce mot dériverait de Rauch, en dialecte Rauch, garni de poils, velu, sauvage, lequel renverrait aux Haries revêtus de peaux de bêtes (Hedi Lehmann, Volksbrauch im Jahreslauf, München, 1964, p. 151).
- (40) Le cerf apparaît comme un animal sacerdotal, de même que le cheval est essentiellement guerrier, tandis que le porc, dont l’élevage a commencé très tôt dans l’histoire, correspond à la troisième fonction. Le vocabulaire qui leur est propre montre que ces 3 animaux ont toujours occupé une place à part, plus proche des hommes parfois que des autres bêtes. C’est ainsi qu’en français pour désigner les membres inférieurs servant à la locomotion, on parle plus souvent des pieds du cheval, de la biche ou du cochon, que de leurs pattes (le mot s’employant également, en fauconnerie, pour désigner les pattes des oiseaux de proie). Aux Pays-Bas, où l’on emploie aussi de préférence le mot benen (all. beine), au lieu du mot poten (all. pfoten), on raconte qu’une jeune recrue, ayant parlé à son officier des poten de son cheval, se vit répondre : «Que voulez-vous dire ? Il n’y a que vous qui ayiez des poten ici, stupide animal ! » (Jan Kruls. art. cit., pp. 23-24).
- (41) « J. Mowat (Remarques sur les inscriptions antiques de Paris) a fait justice de cette attitude prétendue “bouddhique” en rappelant à propos que les Gaulois ne se servaient pas de sièges proprement dits, mais qu’ils s’asseyaient à terre sur des bottes de paille ou sur des peaux de bêtes, conséquemment en croisant les jambes » (A. Savoret, De quelques symboles druidiques, 1 : Le ciel et les saisons, Heugel, 1947, p. 53).
- (42) « Il y a une grande familiarité, chez les Celtes, entre les Vivants et les Morts, et partant, entre les Dieux et les Hommes. Pas de noir Achéron, pas de sombres cavernes, pas de lac Averne aux émanations sulfureuses, juste une rivière, un bras de mer, une forêt, et c’est l’irruption du fantastique dans le quotidien» (J. Markale, op. cit., p. 28). M. Hatt ajoute : « Il est probable que les Gallo-Romains imaginaient la vie d’outre-tombe comme partagée entre la chasse et les banquets. Le Lingon, dans sa tombe, emporte tout son attirail de chasse. Des armes de chasse se trouvent figurées sur certaines stèles funéraires. Les Gallo-Romains auraient vu dans les scènes de chasse représentées sur leur tombeau l’évocation d’une des joies de la vie d’outre-tombe » (« Les croyances funéraires … », art. cit.).
- (43) Ici encore, l’étymologie vaut la peine d’être notée. Heiligenberg, c’est évidemment heiliges berg, montagne sacrée.
 L'auteur : Jean-Jacques Mourrau (né en 1943) est un romancier, journaliste et essayiste français. Sur un plan politique, il relie combat régional alsacien et Europe fédérale. En 1968, il est à la fois l'un des membres fondateurs de la société de pensée GRECE et, avec Bernard Wittmann et Jean Dentinger, d'Elsa, « journal d’action alsacienne-lorraine thioise et fédéraliste européenne ». Il collabore à la Nouvelle revue d'histoire. Notons : « Les chevaliers teutoniques » in : Les corps d'élite du passé, Balland, 1972 ; La Perse des Grands Rois et de Zoroastre, Famot, 1977 ; « La Droite et la politique » in : Aux sources de la droite, Âge d'Homme, 2000 ; Dictionnaire sincère de l'Alsace singulière, Séguier, 2002 ; Un été rhénan : Destins alsaciens dans les années vingt, Séguier, 2001.
L'auteur : Jean-Jacques Mourrau (né en 1943) est un romancier, journaliste et essayiste français. Sur un plan politique, il relie combat régional alsacien et Europe fédérale. En 1968, il est à la fois l'un des membres fondateurs de la société de pensée GRECE et, avec Bernard Wittmann et Jean Dentinger, d'Elsa, « journal d’action alsacienne-lorraine thioise et fédéraliste européenne ». Il collabore à la Nouvelle revue d'histoire. Notons : « Les chevaliers teutoniques » in : Les corps d'élite du passé, Balland, 1972 ; La Perse des Grands Rois et de Zoroastre, Famot, 1977 ; « La Droite et la politique » in : Aux sources de la droite, Âge d'Homme, 2000 ; Dictionnaire sincère de l'Alsace singulière, Séguier, 2002 ; Un été rhénan : Destins alsaciens dans les années vingt, Séguier, 2001.
