Participation
Participation gaullienne et « ergonisme » :
deux corpus d'idées pour la société de demain
Beaucoup de livres, d'essais et d'articles ont été écrits sur l'idée de participation dans le gaullisme des années 60. Mais de toute cette masse de textes, bien peu de choses sont passées dans l'esprit public, dans les mentalités. En France, une parcelle de l'intelligentsia fit preuve d'innovation dans le domaine des projets sociaux quand le monde industrialisé tout entier se contentait de reproduire les vieilles formules libérales ou keynésiennes. Mais l'opinion publique française n'a pas retenu leur message ou n'a pas voulu le faire fructifier.
On ne parle plus, dans les salons parisiens, de la participation suggérée par De Gaulle, ni de l'idée séduisante d'« intéressement » des travailleurs aux bénéfices des entreprises, ni des projets « pancapitalistes » d'un Marcel Loichot ou d'un René Capitant. Lors des commémorations à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Charles De Gaulle, ces projets, pourtant très intéressants et, aujourd'hui encore, riches de possibles multiples, n'ont guère été évoqués. Couve de Murville, sur le petit écran, a simplement rappelé la diplomatie de « troisième voie » amorcée par De Gaulle en Amérique latine, au Québec et à Phnom Penh (1966). Si la « troisième voie » en politique extérieure suscite encore de l'intérêt, en revanche, la "troisième voie" envisagée pour la politique intérieure est bel et bien oubliée.
Outre les textes de René Capitant ou l'étude de M. Desvignes sur la participation (1), il nous semble opportun de rappeler, not. dans le cadre du Club Nationalisme et République, un texte bref, dense et chaleureux de Marcel Loichot, écrit en collaboration avec le célèbre et étonnant Raymond Abellio en 1966 : Le cathéchisme pancapitaliste. Loichot et Abellio constataient la faiblesse de la France en biens d'équipement par rapport à ses concurrents allemands et japonais (déjà !). Pour combler ce retard — que l'on comparera utilement aujourd'hui aux retards de l'Europe en matières d'électronique, d'informatique, de création de logiciels, en avionique, etc. — nos deux auteurs suggéraient une sorte de nouveau contrat social où capitalistes et salariés se partageraient la charge des autofinancements dans les entreprises.
Ce partage, ils l'appelaient « pancapitaliste », car la possession des richesses nationales se répartissait entre toutes les strates sociales, entre les propriétaires, les patrons et les salariés. Cette diffusion de la richesse, expliquent Loichot et Abellio (2), brise les reins de l'oligo-capitalisme, système où les biens de production sont concentrés entre les mains d'une petite minorité (oligo en grec) de détenteurs de capitaux à qui la masse des travailleurs « aliène », c'est-à-dire vend, sa capacité de travail. Par opposition, le pancapitalisme, ne s'adressant plus à un petit nombre mais à tous, entend « désaliéner » les salariés en les rendant propriétaires de ces mêmes biens, grâce à une juste et précise répartition des dividendes, s'effectuant par des procédés techniques dûment élaborés (condensés dans l'article 33 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises si celles-ci attribuent à leur personnel des actions ou parts sociales).
L'objectif de ce projet « pancapitaliste » est de responsabiliser le salarié au même titre que le patron. Si le petit catéchisme pancapitaliste de Loichot et Abellio, ou le conte de Futhé et Nigo, deux pêcheurs japonais, dont l'histoire retrace l'évolution des pratiques économiques (3), peuvent nous sembler refléter un engouement utopique, parler le langage du désir, les théoriciens de la participation à l'ère gaullienne ne se sont pas contentés de populariser outrancièrement leurs projets : ils ont su manier les méthodes mathématiques et rationnelles de l'économétrie.
Mais là n'est pas notre propos. Nous voudrions souligner ici que le projet gaullien global de participation s'est heurté à des volontés négatives, les mêmes volontés qui, aujourd'hui encore, bloquent l'évolution de notre société et provoquent, en bon nombre de points, son implosion. Loichot pourfendait le conservatisme du patronat, responsable du recul de la France en certains secteurs de la production, responsable du mauvais climat social qui y règnait et qui décourageait les salariés.
Deuxième remarque : qui dit participation dit automatiquement responsabilité. Le fait de participer à la croissance de son entreprise implique, de la part du salarié, une attention constante à la bonne ou la mauvaise marche des affaires. Donc un rapport plus immédiat aux choses de sa vie quotidienne, donc un ancrage de sa pensée pratique dans le monde qui l'entoure. Cette attention, toujours soutenue et nécessaire, immunise le salarié contre toutes les séductions clinquantes des idéologies vagues, grandiloquentes, qui prétendent abolir les pesanteurs qu'impliquent nécessairement les ancrages dans la vie. Jamais les modes universalistes, jamais les slogans de leurs relais associatifs (comme SOS-Racisme par ex.), n'auraient pu avoir autant d'influence, si les projets de Loichot, Capitant, Abellio, Vallon s'étaient ancrés dans la pratique sociale quotidienne des Français.
Ceux-ci, déjà victimes des lois de la Révolution, qui ont réduit en poussière les structures professionnelles de type corporatif, victimes une nouvelle fois de l'inadaptation des lois sociales de la IIIe République, victimes de la mauvaise volonté du patronat qui saborde les projets gaulliens de participation, se trouvent systématiquement en porte-à-faux, davantage encore que les autres Européens et les Japonais, avec la réalité concrète, dure et exigeante, et sont consolés par un opium idéologique généralement universaliste, comme le sans-culottisme de la Révolution, la gloire de l'Empire qui n'apporte aucune amélioration des systèmes sociaux, les discours creux de la IIIe bourgeoise ou, aujourd'hui, les navets pseudo-philosophiques, soft-idéologiques, de la médiacratie de l'ère mitterandienne.
Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, les Allemagnes restauraient leurs associations professionnelles ou les maintenaient en les adaptant, Bismarck faisait voter des lois de protection de la classe ouvrière, les fascismes italiens ou allemands peaufinaient son œuvre et imposaient une législation et une sécurité sociales très avancées, la RFA [ex-Allemagne de l'Ouest] savait maintenir dans son système social ce qui avait été innovateur pendant l'entre-deux-guerres (Weimar et période NS confondues), le Japon conservait ses réflexes que les esprits chagrins décrètent "féodaux"... Toutes mesures en rupture avec l'esprit niveleur, hostile à tout réflexe associatif de nature communautaire, qui afflige la France depuis l'émergence, déjà sous l'Ancien Régime, de la modernité individualiste.
L'idée de participation est un impératif de survie nationale, identitaire et économique, parce qu'elle implique un projet collectif et non une déliquescence individualiste, parce qu'elle force les camarades de travail d'une entreprise à se concerter et à discuter de leurs vrais problèmes, sans être doublement "aliénés": et par les mécanismes économiques du salariat et par les discours abrutissants des médias qui remplacent désormais largement l'opium religieux, comme l'entendaient Feuerbach, Marx et Engels, dont les idées sont trahies allègrement aujourd'hui par ceux qui s'en revendiquent tout en les figeant et les dénaturant. La réalité, qui n'est pas soft mais hard, contrairement à ce qu'affirment les faux prophètes, a déjà dû s'adapter à cette nécessité de lier le travailleur immédiatement à sa production : l'éléphantiasis tant des appareils administratifs étatisés de type post-keynésiens que des énormes firmes transnationales ont généré, à partir de la première crise pétrolières de 1973, une inertie et une irresponsabilité croissantes de la part des salariés, donc une perte de substance humaine considérable.
Il a fallu trancher stupidement, avec gâchis, au nom de chimères opposées, en l'occurrence celles du néo-libéralisme reaganien ou thatchérien. Renvoyer des salariés sans préparation au travail indépendant. Résultat, dans les années 80 : accroissement exponentiel du chômage, avec des masses démobilisées n'osant pas franchir ce pas, vu que les législations de l'ère keynésienne (qui trahissaient Keynes) avaient pénalisé le travail indépendant. Autre résultat, au seuil des années 90 : une inadaptation des structures d'enseignement aux besoins réels de la société, avec répétition sociale-démocrate des vieux poncifs usés, avec hystérie néo-libérale destructrice des secteurs universitaires jugés non rentables, alors qu'ils explorent, souvent en pionniers, des pans entiers mais refoulés du réel ; et produisent, du coup, des recherches qui peuvent s'avérer fructueuses sur le long terme.
Les vicissitudes et les dysfonctionnements que nous observons dans notre société contemporaine proviennent de ce désancrage permanent qu'imposent les idéologies dominantes, privilégiant toutes sortes de chimères idéologiques, transformant la société en un cirque où des milliers de clowns ânonnent des paroles creuses, sans rien résoudre. La participation et l'intéressement sont les aspects lucratifs d'une vision du monde qui privilégie le concret, soit le travail, la créativité humaine et la chaîne des générations. Ce recours au concret est l'essence même de notre démarche.
Au-delà de tous les discours et de toutes les abstractions monétaires, de l'étalon-or ou du dollar-roi, le moteur de l'économie, donc de notre survie la plus élémentaire, reste le travail. Définir en termes politiques notre option est assez malaisé : nous ne pouvons pas nous définir comme des "identitaires-travaillistes", puisque le mot "travailliste" désigne les sociaux-démocrates anglais ou israëliens, alliés aux socialistes de nos pays qui claudiquent de compromissions en compromissions, depuis le programme de Gotha jusqu'à celui de Bad Godesberg (4), depuis les mesures libérales du gouvernement Mitterand jusqu'à son alliance avec Bernard Tapie ou son alignement inconditionnel sur les positions américaines dans le Golfe.
Jacob Sher, économiste qui a enseigné à l'Institut polytechnique de Léningrad avant de passer à l'Ouest, participationniste sur base d'autres corpus que ceux explorés par les gaulliens Loichot, Vallon ou Capitant, a forgé les mots qu'il faut — ergonisme, ergonat, ergonaire (du grec ergon, travail) — pour désigner sa troisième voie basée sur le Travail. Issu de la communauté juive de Vilnius en Lithuanie, Jacob Sher partage le sort de ces Israëlites oubliés par nos bateleurs médiatiques, pourtant si soucieux d'affirmer et d'exhiber un philosémitisme tapageur. Oublié parce qu'il pense juste, Sher nous explique (5) très précisément la nature éminement démocratique et préservatrice d'identité de son projet, qu'il appelle l'ergonisme. Il est démocratique car la richesse, donc le pouvoir, est répartie dans l'ensemble du corps social. Il préserve l'identité car il n'aliène ni les masses de salariés ni les minorités patronales et fixe les attentions des uns et des autres sur leur tâche concrète sans générer d'opium idéologique, dissolvant toutes les formes d'ancrage professionnel ou identitaire.
La participation gaullienne et l'ergonat sherien : deux corpus doctrinaux à réexplorer à fond pour surmonter les dysfonctionnements de plus en plus patents de nos sociétés gouvernées par l'idéologie libérale saupoudrée de quelques tirades socialistes, de plus en plus rares depuis l'effondrement définitif des modèles communistes est-européens. Pour ceux qui sont encore tentés de raisonner en termes reagano-thatchériens ou de resasser les formules anti-communistes nées de la guerre froide des années 50, citons la conclusion du livre de Jacob Sher :
« Et ce n'est pas la droite qui triomphe et occupe le terrain abandonné par la gauche, malgré les apparences électorales. Certes, la droite profite de la croissance du nombre des voix anti-gauche, mais ces voix ne sont pas pro-droite, elle ne s'enrichit pas d'adhésions à ses idées. Car la droite aussi est en déroute, son principe de société a aussi échoué. Ce sont les nouvelles forces qui montent, les nouvelles idées qui progressent, une nouvelle société qui se dessine. Non pas une société s'inscrivant entre les deux anciennes sociétés, à gauche ou à droite de l'une ou de l'autre, mais CONTRE elles, EN FACE d'elles, DIFFÉRENTE d'elles. TROISIÈME tout simplement. Comme un troisième angle d'un triangle ».
► Robert Steuckers, Nationalisme & République, janv. 1992.
Notes
(1) Cf. M. Desvignes, Demain, la participation. Au-delà du capitalisme et du marxisme, Plon, 1978 ; René Capitant, La réforme pancapitaliste, Flammarion, 1971; Écrits politiques, Flammarion, 1971; Démocratie et participation politique, Bordas, 1972.
(2) « Le catéchisme pancapitaliste » a été reproduit dans une anthologie de textes de Marcel Loichot intitulée La mutation ou l'aurore du pancapitalisme, Tchou, Paris, 1970. [nota bene : Les deux articles de 1966 signés Raymond Abellio pour soutenir le projet Capitant d’intéressement des travailleurs à l’autofinancement des entreprises seront la seule exception à un apolitisme revendiquant l’abstention électorale.]
(3) Le conte de Futhé et Nigo se trouve également dans Marcel Loichot, La mutation..., op. cit., pp. 615-621.
(4) Au programme de Gotha en 1875, les socialistes allemands acceptent les compromissions avec le régime impérial-libéral. À Bad Godesberg en 1959, ils renoncent au révolutionnarisme marxiste, donc à changer la société capitaliste. Le marxisme apparaît comme un compromis permanent face aux dysfonctionnements du système capitaliste.
(5) Jacob Sher, Changer les idées. Ergonisme contre socialisme et capitalisme, Nouvelles éditions Rupture, 1982.

La participation : une idée neuve ?
La participation n'est pas une simple technique sociale de réglementation des rapports salariés dans l'entreprise. Pour son inspirateur, le Général De Gaulle, c'est une vision de l'homme qui refuse la dépendance à l'égard de la machine. L'objectif qui est poursuivi est clair : « ...que chaque homme retrouve dans la société moderne sa place, sa part et sa dignité » (Charles de Gaulle, discours prononcé le 1er mai 1950).
Il faut en effet aller au-delà des textes législatifs et réglementaires qui constituent la traduction juridique de l'idée. Il s'agit surtout des ordonnances du 7 janvier 1959, tendant à favoriser l'association ou l'intérêt des travailleurs à l'entreprise, de la loi du 27 décembre 1973, qui est relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés. Le cœur du projet réside dans les ordonnances du 17 août 1967, relatives à la participation des salariés à l'expansion de l'entreprise (modifiant et complétant la loi de 1966 sur les sociétés commerciales) et relatives aux Plans d'Épargne d'entreprise.
I — L'idéologie de la participation : les sources...
Pour l'écrivain Philippe de Saint-Robert, le général de Gaulle a « inventé » la participation, comme il a « réinventé » la légitimité (les guillemets sont de nous). Soucieux de consolider l'unité nationale, et désireux de ne pas laisser aux syndicats marxistes le soin de contrôler l'idéologie prolétarienne, le gaullisme s'attache très vite à la question sociale. Et c'est en ce sens que Michel Jobert a pu écrire dans ses Mémoires d'avenir que la participation était un moyen d'assurer l'indépendance de la Nation. Pour construire cette France indépendante, et, plus largement, donner à l'Europe l'idée de son unité face à l'adversité extérieure symbolisée par la politique de Yalta et le système des blocs (cf. à ce sujet : Yalta et la naissance des blocs de JG Malliarakis).
Pour mieux cerner la genèse de cette idée, une méthode nous apparaît privilégiée : analyser les influences intellectuelles qui ont présidé à l'éducation et à la conception politique du chef de l'État français de 1958 à 1969. On peut alors comprendre les raisons profondes qui déterminèrent le fondateur du gaullisme à se préoccuper des questions sociales.
Remarquons que, dans l'introduction à l'ouvrage, P. de Saint-Robert rappelle dans cette genèse le rôle de René de la Tour du Pin (un représentant éminent du « catholicisme social » qui, dans les années 1890, en France, regroupait des courants différents, tous préoccupés des problèmes sociaux. Le courant de le Tour du Pin (dit du « légitimisme social »), traditionnaliste et contre-révolutionnaire, avait développé une idéologie sociale qui s'inspirait des idées de l'Église.
Il s'appuyait sur les travaux d'hommes comme Albert de Mun (1841-1914), Armand de Melun, Alban de Villeneuve-Bargement, qui dénonçaient avec passion les conséquences désastreuses du libéralisme triomphant. À côté de ce légitimisme social coexistaient d'autres cercles exprimant des idées voisines : le socialisme chrétien de Buchez (1769-1865), fondateur, avec Bazard, de la Charbonnerie de France. Le catholicisme libéral, synthèse de la doctrine libérale et du catholicisme et, enfin, le catholicisme social proprement dit, pensé par Lamennais, dont les écrits soulignent les valeurs anti-libérales (sur le catholicisme social, cf. Duroselle, ref. infra).
L'influence de La Tour du Pin sur de Gaulle résultait de ce que ce penseur du social avait compris que le système de propriété privée des moyens de production, que la société capitaliste bourgeoise avait développé, risquait de dégénérer en une quasi-souveraineté qui déposséderait l'État de son rôle arbitral. En d'autres termes, le capitalisme tendait à confisquer le politique au profit de l'économico-financier. Le résultat de ce processus dégénératif fut cette IIIe République conservatrice, dont l'arriération sur le plan social fut effrayante. On pourra retirer de cette première analyse une constatation liminaire : la participation est une idée anti-libérale par excellence !
Capitalisme et « contrat »
La société moderne capitaliste (c'est-à-dire née de la Révolution industrielle et scientifique du XIXe siècle) donne l'image d'un champs conflictuel permanent. Ce conflit social, où "capital" et "travail" s'affrontent, résulte d'un mode de relations juridiques de nature contractuelle et économique : le contrat de louage de services. Ce contrat, qui n'est pas un mode de justice mais de rentabilité, induit un procès inégalitaire entre les travailleurs et les "capitalistes-entrepreneurs". Devant l'impuissance des travailleurs-contractuels, trois solutions se sont jusqu'à présent présentées :
◊ Le maintien du statu quo instauré : le libéralisme propose cette solution accompagnée de palliatifs réformistes.
◊ Le transfert des moyens de production entre les mains de l'État, qui transpose par là même l'aliénation du travailleur sans pour autant la supprimer. C'est la solution préconisée par le socialisme étatique marxiste et social-démocrate.
◊ Enfin, la troisième voie de l'association capital-travail aux trois niveaux de la propriété, des résultats et des décisions. Étudions les racines de l'idéologie fondatrice de cette troisième voie.
L'idée essentielle se trouve dans les préoccupations du fondateur de la Ve République : l'objectif final n'était pas seulement une « façon pratique de déterminer le changement, non pas (le) niveau de vie, mais bien la condition ouvrière » (cf. Lettre du 11 avril 1966 du Général De Gaulle à Marcel Loichot). L'ampleur de ce changement proposé dépasse de ce fait la pure et simple aliénation économique, mais recherche toutes les causes d'aliénation économique et politique des travailleurs. Pour reprendre les termes de l'économiste François Perroux : « ce n'est pas le seul capitalisme qui aliène, c'est l'industrie et les pouvoirs politiques de l'âge industriel » (Aliénation et Société industrielle, p. 75). Une conception du monde totale soutient donc l'idée de la participation, qui s'oppose à l'idéologie social-libérale et ses avatars. Quels sont alors les sources de cette conception ?
Proudhon et Lamennais
Une révolution a déterminé les idéologues à rénover la pensée sociale : c'est la révolution industrielle et ses conséquences sociales. On peut dire que deux penseurs français ont, au cours du XIXe siècle, renouvelé cette pensée. Il s'agit de Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) et de Lamennais (1782-1854).
a) Pour Proudhon, auteur en 1840 d'un ouvrage intitulé Qu'est-ce que la propriété ?, la réponse est claire : « la propriété, c'est un vol ». Proposition volontairement provocante qui a pour objet d'amorcer le débat réel, celui des relations entre le « droit naturel de propriété » et l'« occupation », le travail et l'égalité.
Quelques mots d'introduction sur cet auteur nous apparaissent nécessaires. D'origine paysanne, Proudhon est un des auteurs les plus féconds de la pensée sociale du XIXe siècle. Son œuvre est éminemment politique, puisqu'elle tend à une contestation radicale de l'idéologie de la propriété bourgeoise. La propriété n'est pas une valeur neutre. Elle peut à la fois constituer un système d'exploitation et un vol légal et devenir une force révolutionnaire formidable. Car la propriété est un « produit spontané de l'être collectif », ce qui implique qu'elle s'insère étroitement dans l'idéologie collective du peuple.
De cela nous pouvons donc déduire un couple antagoniste : d'une part, idéologie bourgeoise, où la propriété tend à établir la domination d'une minorité possédante sur une majorité impuissante, ou, d'autre part, idéologie du peuple (le socialisme fédéraliste) qui investit la propriété d'une fonction communautaire et organique. Par « idéologie du peuple », nous entendons, chez Proudhon, deux valeurs politiques essentielles : le fédéralisme qui innerve l'État, formé de groupes destinés « chacun pour l'exercice d'une fonction spéciale et la création d'un objet particulier, puis ralliés sous une loi commune et dans un intérêt identique » (De la Justice, 4e étude).
Ensuite, le mutuellisme, concrétisé par une « Banque du peuple », et qui, pour Proudhon, est « une formule, jusqu'alors négligée, de la justice ». De la synthèse des deux concepts, on peut alors déboucher sur une nouvelle organisation de la société, qui est avant tout le contraire de « toute solution moyenne », entendez de toute voie réformiste. Et Proudhon d'opposer le juste milieu matériel qui est le socialisme, au juste milieu théorique des pseudo-socialistes. Car le socialisme proudhonien n'est pas un socialisme libéral ou égalitaire.
Dans Les confessions d'un révolutionnaire (1849), il peut écrire avec fougue : « Je suis noble, moi ! Mes ancêtres de père et de mère furent tous laboureurs francs, exempts de corvée et de main-morte depuis un temps immémorial ». Et contre les partisans du nombre, contre les intellectuels rousseauistes, ces « parasites révolutionnaires », Proudhon propose un nouvel ordre social qui conteste la loi de la majorité et que nous retrouvons exposé dans L'idée générale de la Révolution (1851). Ce principe aristocratique et populaire de l'idéologie proudhonienne est unique en son genre. Il ne veut rien avoir à faire avec le « fouriérisme » utopique, qu'il traitera de « plus grande mystification » de son époque. Charles Fourier (1772-1837) est le fondateur du Phalanstère, que l'on considère souvent à l'origine du mouvement coopératif.
Proudhon, théoricien d'un socialisme anarchique et fédératif, enraciné dans les libertés traditionnelles des peuples d'Europe. Proudhon, veut détruire le pouvoir des bourgeois, classe usurpatrice qui s'est hissée au haut de l'échelle sociale en s'appropriant les biens des aristocrates et de l'Église lors de la Révolution, sans les partager avec le paysannat et les ouvriers urbains. De là, sa formule-choc, répétée à satiété : « la propriété est un vol ». Pour Proudhon, il aurait fallu redistribuer terres et propriétés aux entités collectives que sont les communautés villageoises, qui se seraient organisées en fédérations et en mutuelles, pour faire face aux innovations techniques, sociales et industrielles.
Proudhon contre les Saint-Simoniens
Le socialisme de Proudhon ne veut rien retirer du saint-simonisme, qu'il accuse de relations étroites avec la haute finance internationale. Henri de Saint-Simon (1760-1825) qui, pendant la Terreur, s'enrichit par de coupables spéculations sur les biens nationaux, engendra une idéologie « industrialiste », qui contient une apologie sans réserve de l'entrepreneur capitaliste. Pour Saint-Simon, les industriels sont les véritables chefs du peuple. Comme première classe de la société, la nouvelle organisation les mettra à la direction des affaires temporelles. Parmi les industriels, Saint-Simon cherchait à souligner le rôle plus positif des banquiers ! On conçoit l'hostilité de Proudhon à cette apologie de l'affairisme cosmopolite et du capitalisme international.
Face à ces déviations utopiques, anti-socialistes ou « terroristes » (la Révolution française contient en germe et en action ces tendances terroristes, pense alors Proudhon), notre penseur propose une Révolution de l'anarchie. Il est bien entendu que cette "anarchie" n'a que peu de rapports avec les idées bourgeoises d'une anarchie de la licence et de l'absence de morale. C'est une anarchie organisée que propose Proudhon, antidémocratique et antilibérale, contestant l'idéologie rousseauiste et ses succédanés. Et la révolution ? Elle doit détruire le plus possible et le plus vite possible. Tout détruire ? Non, car, écrit Proudhon, « ne résistera dans les institutions que ce qui est fondamentalement bon ».
Le socialisme proudhonien apparaît ainsi comme un vaste discours contestataire qui veut rétablir les libertés naturelles des hommes. Ces libertés qui soutiennent les valeurs populaires de liberté et de dignité. Une société féodale, a pu écrire Jean Rouvier (in Les grandes idées politiques, Bordas, 1973), que Proudhon exprime « génétiquement » (J. Rouvier, op.cit., T. II, p.187), qui veut restaurer cette « honnête liberté française » invoquée par les vignerons d'Auxerre et de Sens entre 1383 et 1393. Il écrira, dans son Carnet du 5 Décembre : « Démocratie est un mot fictif qui signifie amour du peuple, mais non du gouvernement du peuple ».
Ces idées en feront aussi un opposant farouche aux idées de Marx et du marxisme proclamé infaillible. Il est évident qu'entre le "franc laboureur" attaché aux libertés communautaires qu'est Proudhon et ce "sous-officier de la subversion" que fut Marx, il y a peu de choses en commun. L'amour que portait Proudhon, de par ses racines, aux peuples de France, ne pouvait se satisfaire des attaques grossières de K. Marx contre les ouvriers parisiens (qu'il traita, le 20 juillet 1870, d'ordures ...). Si, pour Marx, Proudhon fut le « ténia du socialisme », le marxisme fut a contrario pour Proudhon une « absurdité anté-diluvienne ».
Face au libéralisme qui nie dans les faits la dignité des travailleurs, tout en voulant reconnaître fictivement leurs "droits fondamentaux", face aux discours pseudo-socialistes des Saint-Simon et Fourier qui veulent détourner les revendications sociales et politiques du peuple, face enfin au marxisme qui constitue un avatar préhistorique du terrorisme d'État, Proudhon pose en principe un idéal de justice qui se veut enraciné dans les libertés traditionnelles des peuples de France. Sa révolution est une révolte aristocratique, qui ennoblit et ne se traduit pas comme un mouvement « de brutes devenues folles sous la conduite de sots devenus fous » (H. Taine, La Révolution française, T. I, L. 3).
Lamennais : croyant et ruraliste
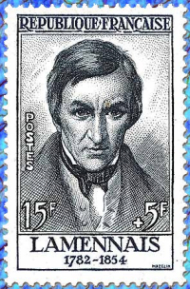 b) Tout comme Proudhon, Lamennais ne propose pas un corps de doctrine. Une analyse superficielle de son œuvre fait paraître sa pensée comme contradictoire. Dans un premier temps, Lamennais est un théocrate intransigeant (Essai sur l'indifférence en matière de religion, 1817/1824), puis un démocrate (L'avenir, 1830/1831 ; Les paroles d'un croyant, 1834 ; Livre du peuple, 1837). Entre la dénonciation extrême des valeurs issues du rationalisme révolutionnaire, et son attachement à défendre le "socialisme", qu'il oppose au communisme d'État et à l'égalitarisme terroriste, il est sans aucun doute difficile de trouver un référent universel explicatif.
b) Tout comme Proudhon, Lamennais ne propose pas un corps de doctrine. Une analyse superficielle de son œuvre fait paraître sa pensée comme contradictoire. Dans un premier temps, Lamennais est un théocrate intransigeant (Essai sur l'indifférence en matière de religion, 1817/1824), puis un démocrate (L'avenir, 1830/1831 ; Les paroles d'un croyant, 1834 ; Livre du peuple, 1837). Entre la dénonciation extrême des valeurs issues du rationalisme révolutionnaire, et son attachement à défendre le "socialisme", qu'il oppose au communisme d'État et à l'égalitarisme terroriste, il est sans aucun doute difficile de trouver un référent universel explicatif.
Certains historiens ont voulu comparer les œuvres de Péguy et de Bernanos à celles de Lamennais. Lamennais est un romantique en politique. Sa passion politique est un dérivé de son amour de la nature. Quand il écrit avec nostalgie : « Je n'aime point les villes », il nous fait indirectement saisir les fondements de sa personnalité. Ceux d'un homme rempli de passion, « prêtre malgré lui », et qui défendra dans la seconde partie de son existence le peuple avec autant d'engagement qu'il avait mis à défendre la foi dans la première partie. Le projet démocratique de Lamennais n'est pas en rupture avec sa foi catholique. Pour lui, la démocratie est un régime étranger à l'idéologie libérale et au discours marxiste.
c) Chez l'un et l'autre de nos penseurs, un point commun : l'opposition absolue aux valeurs qui soutiennent la révolution industrielle. Un souci profond et sincère de protéger les libertés fondamentales des peuples et, par-delà ce souci temporel, de préserver l'âme collective. Ces valeurs, qui constituent la matrice unique du libéralisme et du communisme, ont assuré le pouvoir des entrepreneurs sur les ouvriers. Ce pouvoir que ne détruit pas le communisme, puisqu'il engendre un système où la pluralité formelle des patrons capitalistes est remplacée par l'unité de direction du patron absolu qu'est l'État. Pour Lamennais, « le communisme substitue aux maîtres particuliers, l'État comme seul maître ». Ce maître communiste est plus abstrait, plus inflexible, plus insensible, sans relation directe avec l'esclave. En une phrase, l'État représente la coalition universelle et absolue des maîtres. Moralité : ici point d'affranchissement possible. Solution : « armer la propriété contre le communisme » (Proudhon, 1848).
Travailler pour soi
Proudhon, comme Lamennais, s'oppose à l'étatisme communiste. C'est une parenté d'esprit profonde qui les sépare de K. Marx. Leur dénonciation de l'ordre économique est aussi virulente que leur refus des constructions dogmatiques. Diffuser la propriété, qui n'est pas la conservation bourgeoise du statu quo. Traduisons : pour Lamennais, la propriété est le résultat d'une répartition équitable des produits du travail, et cela, par deux moyens : l'abolition des lois de privilège et de monopole ; la diffusion des capitaux et des instruments de travail. On trouve dans un programme un pré-capitalisme populaire. La combinaison de ces deux moyens, combinée avec un troisième facteur, qui est l'ASSOCIATION, aboutirait à une justice plus large.
Dans son ouvrage intitulé : La Question du travail, Lamennais écrit : « Ainsi le problème du travail, dans son expression la plus générale, consiste à fournir aux travailleurs, les moyens d'accumuler à leur profit une portion du produit de leur travail » (p. 567). Travailler pour soi et non pour autrui (le patron, le maître, l'entrepreneur, le capitaliste, l'État-maître) est une exigence de justice et une revendication sociale prioritaire. Mais cette répartition n'est pas seulement une question matérielle, c'est aussi une question intellectuelle (acquérir l'instruction) et spirituelle. Mettre le crédit à portée de tous est un aspect de la révolution sociale, ce n'est pas le seul.
Les associations de travailleurs que propose Lamennais, en supprimant le travail forcé au service d'une minorité de possédants, sont aussi des cercles où peuvent s'éveiller de nouvelles forces morales (On retrouve chez G. Sorel la même idée, sous la forme d'une culture prolétarienne). Proudhon dénonce lui aussi les multiples abus de la propriété bourgeoise. Ainsi, la propriété foncière, la propriété sur les capitaux mobiliers et, plus largement, celle qu'exerce « le propriétaire absentéiste ». Et Proudhon de combattre les idéologies de la propriété privée, qui sont précisément des idéologies libérales. Face aux abus de la propriété, Proudhon construit le discours de la propriété sociale.
Les « structures libératrices »
Les valeurs libérales traditionnelles impliquent : le morcellement progressif du travail, la concurrence égoïste, la répartition arbitraire ; pour mieux répartir les produits, Proudhon prônera la solidarité des travailleurs. Car il ne s'agit pas, dans l'idée de Proudhon, d'une œuvre de bienfaisance que les maîtres accorderaient aux ouvriers, mais, écrit Proudhon, « c'est un droit naturel, inhérent au travail, nécessaire, inséparable de la qualité de producteur jusque dans le dernier des manœuvres » (Qu'est-ce que la propriété ?).
En effet, pour le travailleur, le salaire n'épuise pas ses droits. Le travail est une création, et la valeur de cette création est une propriété des travailleurs eux-mêmes. Le contrat de travail n'implique pas pour le travailleur la vente de cette valeur. C'est un contrat partiel, qui permet au capitaliste d'exercer son droit sur les fournitures fournies et les subsistances procurées mais n'entraîne pas pour le partenaire qu'est l'ouvrier, une aliénation totale ; exemple : « Le fermier en améliorant le fonds, a créé une valeur nouvelle dans la propriété, donc il a droit à une portion de la propriété ».
Mais ce problème de la plus-value n'est qu'une partie du problème du statut du travailleur. Pour assurer définitivement son existence, Proudhon est partisan du partage de la propriété. Sur un plan plus global, on a vu que Proudhon était favorable à une organisation mutualiste, qui engendrerait une économie contractuelle : organisation coopérative des services (assurance, crédit), mutualisation de l'agriculture, constitution de propriétés d'exploitation, socialisation progressive de l'industrie par participation et co-gestion. Proudhon nomme ces institutions les "structures libératrices".
Il est difficile aujourd'hui de parler de socialisme sans évoquer et se rattacher aux idées sociale-démocrates. Pourtant cette confiscation est un leurre. Il n'y a pas de confusion entre le socialisme, qui est une conception politique issue du monde industriel du travail, et la social-démocratie qui est une branche bourgeoise du socialisme née du marxisme (sur le réformisme des sociaux-démocrates, cf. Schorske, ref. infra).
Pour Lamennais, le socialisme se définit comme la reconnaissance du « principe d'association », fondement de l'ordre social. Définition large, qui a le mérite de refuser toute espèce de dogmatisme théorique. Proudhon quant à lui définit le socialisme comme le refus de transformer l'univers comme « une lice immense dans laquelle les prix sont disputés, non plus, il est vrai, à coups de lances et d'épée, par la force et la trahison, mais par la richesse acquise, par la science, le talent, la vertu même ». On aura reconnu une critique des discours fouriéristes et saint-simoniens. Car le socialisme de Proudhon est anti-technocratique. On se souvient que Saint-Simon confiait le pouvoir aux chefs d'industrie, leur laissant le soin d'organiser la société. Proudhon conteste cette vision technocratique de la société future, sans pour autant rejoindre ceux que l'on a appelés les "socialistes de l'imaginaire".
d) Dans un ouvrage remarquable, le professeur François Georges Dreyfus, directeur honoraire de l'Institut d'Études Politiques de Strasbourg, et directeur de l'Institut des Hautes Études européennes de Strasbourg, tente de définir les sources intellectuelles du Gaullisme. Nous nous arrêterons pour quelques instants sur le chapitre II de cet ouvrage, De Gaulle et le Gaullisme, intitulé : « Les sources de la pensée gaullienne » (p. 44-66), qui tente de nous résumer la genèse de l'idée politique gaullienne.
II — L'IDÉOLOGIE GAULLIENNE :
la participation est un aspect d'une conception politique globale
 Avant d'aborder l'analyse de la participation proprement dite comme troisième voie spécifique, il nous paraît utile d'essayer de mieux repérer les sources du gaullisme comme idéologie originale. Pour FG Dreyfus, 1940 est l'année où se fixe définitivement la pensée du général De Gaulle. Les traits principaux de cette pensée sont au nombre de quatre : sens de la Nation (personnalisée dans l'esprit du général), volonté d'être techniquement de son temps (refus d'une attitude passéiste), profonde méfiance à l'égard des politiciens (la partitocratie), conscience de la nécessité d'une élite. Pour cela, l'analyse interdit tout rattachement exclusif à un courant idéologique précis. Pour les uns, De Gaulle est un maurrassien, pour les autres, un jacobin, un chrétien nietzschéen, un nationaliste, etc. Devant l'impossibilité de rattacher cette pensée à un mouvement ou à un parti, FG Dreyfus retient trois éléments : l'élément religieux, le Nationalisme populaire, et la thématique des « non-conformistes des années 30 ».
Avant d'aborder l'analyse de la participation proprement dite comme troisième voie spécifique, il nous paraît utile d'essayer de mieux repérer les sources du gaullisme comme idéologie originale. Pour FG Dreyfus, 1940 est l'année où se fixe définitivement la pensée du général De Gaulle. Les traits principaux de cette pensée sont au nombre de quatre : sens de la Nation (personnalisée dans l'esprit du général), volonté d'être techniquement de son temps (refus d'une attitude passéiste), profonde méfiance à l'égard des politiciens (la partitocratie), conscience de la nécessité d'une élite. Pour cela, l'analyse interdit tout rattachement exclusif à un courant idéologique précis. Pour les uns, De Gaulle est un maurrassien, pour les autres, un jacobin, un chrétien nietzschéen, un nationaliste, etc. Devant l'impossibilité de rattacher cette pensée à un mouvement ou à un parti, FG Dreyfus retient trois éléments : l'élément religieux, le Nationalisme populaire, et la thématique des « non-conformistes des années 30 ».
a) L'élément religieux : de famille catholique, élevé dans un milieu très pieux, ayant suivi enfin ses études dans un collège de jésuites, il est marqué par ses convictions religieuses. Et l'on retrouve dans cet attachement, l'influence de ce catholicisme social évoqué plus haut. L'Église est dans les années 1900, productrice de textes "engagés", portant sur les questions sociales : ce sont les Encycliques Rerum Novarum (1891), marquée par les idées de Lamennais et de Montalembert, Quadragesimo Anno de Pie XI (1931), et enfin Pacem in Terris de Jean XXIII et Populorum Progressio de Paul VI.
On trouve en germe dans les textes des groupes de catholiques sociaux du XIXe siècle, la notion de participation. Ainsi, les œuvres de la Tour du Pin, où l'on trouve une condamnation du salariat, marquera la pensée gaullienne. On se souviendra de la phrase prononcée par le général De Gaulle dans son discours du 7 juin 1968 : « Le capitalisme empoigne et asservit les gens ». La source de cette hostilité au capital tout puissant se tient dans son éducation catholique : respect de la hiérarchie traditionnelle (Église, Armée), dédain de l'argent (cf. les textes de Péguy), gallicanisme comme attitude d'esprit (Barrès, Bossuet).
b) Le nationalisme populaire : refusons d'abord l'affirmation un peu hasardeuse de FG Dreyfus selon laquelle le général De Gaulle était un homme de droite (p.45). S'il est évident que de Gaulle n'était pas un homme de gauche, et qu'il n'avait aucune sympathie pour les politiciens de la IIIe république, radicaux-socialistes ou républicains de gauche. Il n'avait par ailleurs que peu de sympathie pour la droite d'affaires, cosmopolite et réactionnaire (au sens social), et on peut se demander si le nationalisme populaire de De Gaulle n'est pas très proche sur bien des points de la « droite révolutionnaire » explorée par Sternhell.
Cette « droite révolutionnaire » apparaît avant tout comme une contestation violente et radicale de l'ordre libéral. Le boulangisme constitue la première modalité idéologique et pratique de ce mouvement. C'est un mariage détonnant de nationalisme et de socialisme. C'est aussi et surtout un mouvement populaire qui, selon Sternhell, est « le point de suture » 1) du sens de la nation idéologisé et 2) d'une certaine forme de socialisme non marxiste, antimarxiste ou déjà postmarxiste (p. 35). La « droite révolutionnaire » est une synthèse ; on peut rappeler ces quelques réflexions du socialiste Lafargue : « Les socialistes (...) entrevoient toute l'importance du mouvement boulangiste, qui est un véritable mouvement populaire pouvant revêtir une forme socialiste si on le laisse se développer librement » (F. Engels et L. Lafargue, Correspondance).
Le souvenir du boulangisme
Ce ralliement des masses ouvrières françaises au mouvement boulangiste s'accompagne aussi du ralliement des nombreux militants socialistes, et des victoires dans les quartiers populaires des candidats boulangistes (Paulin Mery dans le XIIIe arrondissement de Paris, Boudeau à Courbevoie, etc.). Le socialisme boulangiste est un socialisme national. Il n'y a pas en réalité une idéologie boulangiste, construite comme un dogme intangible et cohérent. Là encore, il y a absence totale de dogmatisme, et même refus de construire un système. C'est là un trait caractéristique des socialistes français que nous avons déjà signalé.
Le boulangisme prend en considération la question sociale avec sa tradition de luttes et de revendications — la Commune est un mythe que les boulangistes introduisirent dans le débat politique au niveau d'un mythe national — tout en retenant les paramètres nationaux. Question sociale essentielle, dans une société où les difficultés économiques se développent, le chômage frappe les ouvriers, la croissance économique insatisfaisante crée un climat de malaise. Ce climat nourrit la révolte contre le libéralisme et le gouvernement centriste bourgeois au pouvoir. L'idéologie boulangiste, nationaliste, socialiste et populiste trouve un écho profond dans les milieux ouvriers. La contestation boulangiste se veut totale. Ce n'est pas seulement le monde bourgeois qui est refusé, mais la société industrielle ; ce que Maurice Barrès appelle « le machinisme ». L'homme moderne est un esclave « des rapports du capital et du travail », écrit Barrès (articles de La Cocarde, 8 et 14 septembre 1894 et 1890).
Appuyés sur une conception du monde qui est loin d'être optimiste, les socialistes boulangistes, et Barrès en tête, ont un sens aigu de la misère et de l'exploitation. Pour faire la révolution souhaitée, ils songent à regrouper tous ces exclus de la croissance industrielle : des bas-fonds des grandes villes aux « déchets » de la société. L'ennemi est alors défini et repéré au travers de cette bourgeoisie française que Barrès accuse avec virulence de n'avoir jamais, depuis 1789, considéré le peuple autrement que comme un simple moyen, un moyen commode, pour abattre l'Ancien Régime et établir sa suprématie (Sternhell, ref. infra, p.66).
La mystique de Péguy
Pour le jeune De Gaulle, baignant dans une atmosphère de revanche consécutive à la défaite de la guerre de 1870, de la perte des provinces de l'est, l'Alsace-Lorraine, le nationalisme est une valeur naturelle qui, conjugué avec une certaine hostilité au régime républicain, produit chez C. De Gaulle un attachement profond à la Nation. L'influence des grands auteurs nationalistes (Barrès, Maurras principalement) est aussi complétée par la grande figure de Péguy. Ancien élève de l'École Normale Supérieure, disciple du socialiste Lucien Herr, la pensée très riche de Péguy apparaît dans toute son originalité dans la revue qu'il fonde en 1910 : Les Cahiers de la Quinzaine. Hostile à tout système universitaire, adversaire de la république parlementaire, laïque et anticléricale, Péguy est avant tout un mystique, pétri de contradictions bienfaisantes.
Si le nationalisme de De Gaulle est très proche des courants ouvertement nationaux et monarchistes de son époque, exaltant la patrie française et réclamant le retour des provinces perdues (le mythe de la revanche est une idée qui transcende toutes les oppositions traditionnelles politiciennes), la mystique d'un Péguy le sensibilise aux misères de la société industrielle bourgeoise. Le peuple est une réalité de chair et de sang et la nation doit se préoccuper de son sort. Ce souci n'est pas seulement un souci matériel, mais aussi spirituel. L'influence de Péguy joue ici à fond.
c) Les non-conformistes des années 30 (cf. Loubet del Bayle). Nos ne parlons ici ni d'un parti, ni non plus d'un mouvement.
Ces « non-conformistes » regroupent des intellectuels de tous milieux, de toutes tendances, qui ont été influencés par les écrits de Proudhon, Bergson, La Tour du Pin ; ce mouvement sera surtout connu par ses revues et est marqué par la pensée catholique (celle de Maurras, Maritain, Péguy). On peut citer quelques-unes de ces revues prestigieuses : Esprit, Ordre Nouveau fondé par Robert Aron et fortement constitué par des transfuges de l'Action Française (signalons au passage que le groupe Esprit de Strasbourg était dirigé par deux futurs collaborateurs de De Gaulle : Marcel Prelot et René Capitant).
Dans tous ces milieux, on retrouve un certain nombre de thèmes communs : une volonté marquée de construire en France un système politique nouveau, hostile au parlement souverain ; ainsi Esprit réclame l'institution du référendum et proclame que « le pouvoir parlementaire doit être limité dans l'État, même du côté de l'exécutif » ; position qui, dans les années 30, constituait en soi une petite révolution intellectuelle. Un autre thème courant est l'exigence d'une décentralisation, et la mise en place d'un pouvoir régional (le référendum de 1969 proposait cette réforme historique).
De cette analyse des origines de la pensée gaullienne, nous pouvons enfin dégager quelques constantes : d'abord une volonté de restaurer la Nation comme valeur universelle. Le "nationalisme" de de Gaulle est une mystique (les premières lignes de ses mémoires sont explicites à cet égard) et une politique (renforcer la souveraineté nationale face aux impérialismes modernes, et organiser le pays selon un système politique stable et fort).
Ensuite, aborder la question sociale de front. La pensée gaullienne, marquée par les écrits des socialistes du début du siècle, rejette l'attitude lâche et peureuse de la bourgeoisie sur les problèmes essentiels que sont la condition ouvrière et la paix sociale. D'autre part, la présence en France d'un parti communiste puissant et organisé incite le pouvoir gaullien à ne pas laisser les syndicats inféodés au PC occuper seuls le terrain des entreprises. Pour ne pas laisser le prolétariat se détacher de la Nation, il faut lui donner les moyens d'apprécier et de réfléchir sur sa communauté. La Nation bourgeoise est une image fausse que l'ouvrier ne peut pas ne pas rejeter. À l'État, doit être dévolu le rôle de réintégrer la classe ouvrière dans la Nation. Cette volonté de modifier les rapports capital/travail débouche en dernier lieu sur une série de réformes que nous étudierons dans les paragraphes suivants.
Péguy, haute figure sublime de la pensée française à l'aube de ce siècle. Mystique, sa pensée veut plonger dans l'humus fécond qu'est l'honnêteté et le bon sens populaires, dans une France encore largement rurale et socialement intacte. Il tombera sur le front de la Marne en 1914, en même temps et presque au même endroit que le poète Hermann Löns, correspondant de guerre de 48 ans, et enrôlé dans le camp d'en face. Le doux philosophe mystique qui comprenait les dangers de toute pensée détachée des glèbes et des cœurs rejoignait ainsi celui qui avait si tendrement chanté sa lande de Lünebourg. Leur mort scellait la fin d'une humanité équilibrée que la disparition de la paysannerie française dans les charniers de Verdun et de la Somme allait faire basculer dans les folies pseudo-intellectuelles et les vulgarités consuméristes.
III — LA PARTICIPATION
À la base de la pensée gaullienne sur la question sociale, nous avons vu qu'il y avait deux phénomènes concomitants : le machinisme et la société mécanique moderne. Ces deux phénomènes constituent les fondements de la révolution industrielle du XIXe siècle. Dans un discours prononcé le 25 novembre 1941 à l'université d'Oxford, le Général analyse avec intelligence les conséquences sociales de cette révolution : agrégation des masses, conformisme collectif gigantesque, destruction des libertés, uniformisation des habitudes de vie (les mêmes journaux, les mêmes films), qui induit une « mécanisation générale » qui détruit l'individu.
Cette société mécanique moderne exige un régime économique et social nouveau. Ce thème s'inscrit dans une réflexion plus vaste qui est celle de la crise de civilisation. Pour De Gaulle, la France moderne a été trahie par ses élites dirigeantes et privilégiées. D'où la pressante obligation d'un vaste renouvellement des cadres de la Nation. D'où aussi la lutte contre le capitalisme aliénant qui génère la lutte des classes et favorise les menées marxistes. Au vrai, c'est une révolution que le général De Gaulle propose, qui combat le capitalisme et résout la question sociale. La classe ouvrière est dépossédée de ses droits, au profit du capital qui confisque la propriété, la direction et les bénéfices des entreprises. La lutte des classes est la réaction spontanée de cette classe salariée. C'est, écrit De Gaulle, un fait, un « état de malaise ruineux et exaspérant » qui détruit l'unité du peuple, mais correspond en même temps à un sentiment croissant d'aliénation et de dépossession.
Dès novembre 1943, De Gaulle prévoyait la fin d'un régime (le capitalisme) économique « dans lequel les grandes sources de la richesses nationale échappaient à la Nation » (Discours prononcé à Alger, 1943). En 1952, il établissait une liaison nécessaire entre le régime politique représentatif (la démocratie bourgeoise) et le régime social et économique (le capitalisme). Contre ce système, il faut associer le peuple à un mouvement révolutionnaire, puisque c'est par là même l'associer au destin national. Et il pouvait alors ajouter, touchant ainsi le nœud du problème : « Non, le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'offre pas de solution satisfaisante ». (7 juin 1968). Et il poursuivait : « Non, du point de vue de l'homme, la solution communiste est mauvaise... ».
Entre le capitalisme qui réduit le travailleur dans l'entreprise à être un simple instrument et le communisme, « odieuse machine totalitaire et bureaucratique », où est la solution ? Avant d'apporter une réponse à cette angoissante question, De Gaulle répond négativement : « ni le vieux libéralisme, ni le communisme écrasant » ne sont des solutions humaines. Pour résoudre le dilemme, il faut construire un régime nouveau. Ce régime sera bâti sur une question essentielle : la question sociale. Car c'est de cette question non résolue que sont issues les grands drames politiques du XXe siècle. En ce qui concerne la France, c'est la question sociale qui alimente les succès des mouvements "séparatistes" (entendez communistes). Ce régime nouveau doit s'appliquer à intégrer les travailleurs à la nation, en participant à son expansion économique, donc à son destin politique. Le régime économique et social doit être rénové pour que les travailleurs trouvent un intérêt direct, moral et matériel aux activités des entreprises.
La coopération des partenaires sociaux assure la santé de la Nation
Au-delà des réformes juridiques et politiques, de Gaulle veut s'attacher à définir des valeurs originales, qui seront des valeurs humaines. Comme Proudhon et Lamennais, De Gaulle est soucieux d'assurer aux travailleurs la sécurité et la dignité. À plusieurs occasions (le 15/11/1941, le 25/11/1941 à Oxford, le 18/O6/1942), il rappelle que la France veut « que soient assurées et garanties à chaque Français la liberté, la sécurité et la dignité sociale ». Il faut assurer aux Français, ouvriers, artisans, paysans, ..., la place qui leur revient dans la gestion des grands intérêts communs (20/04/1943). Cette place qui concerne tous les travailleurs français (les chefs d'entreprise, les ingénieurs compris) modifiera la "psychologie" de l'activité nationale (Discours du 31/12/1944). Il est certain que ce nouveau système ne sera pas parfait, mais l'idée de coopération des partenaires de la production est, selon de Gaulle, une idée nationale qui améliorera le régime économique et social. C'est en ce sens un principe fondamental de la révolution exigée par la France.
La réforme prioritaire est celle du salariat. De Gaulle refuse de considérer le salariat comme la base définitive de l'économie française. Pour les mêmes raisons que celles énoncées auparavant, il faut abolir le salariat. Pourquoi ? Parce que, dit De Gaulle, le salariat est une source de révolte, qui rend insupportable la condition ouvrière actuelle. En modifiant le régime du salariat, il faut permettre à l'ouvrier, au travailleur, d'accéder à la propriété. Comment y parvenir? En créant une association réelle et contractuelle, qui n'aurait que peu de rapports avec les réformes accessoires des gérants du libéralisme (exemples : primes à la productivité, actionnariat ouvrier, etc.). Cette idée de l'association, précise De Gaulle, est une idée française, une de ces idées que les socialistes français ont avancée au XIXe siècle (ce socialisme qui, écrit De Gaulle, n'a rien à voir avec la SFIO...). L'association réunit dans une relation complémentaire les possesseurs du capital et les possesseurs du travail.
Dans ce cadre, la participation met en commun ces deux forces dans l'entreprise ; les ouvriers sont des sociétaires, au même titre que la direction, le capital et la technique. Cette implication des divers partenaires entraîne un partage des bénéfices et des risques. Les diverses parties fixeront ensemble les modalités de rémunérations et de conditions de travail. Dans un second temps, on pourra imaginer une association plus étendue du personnel à la marche de l'entreprise.
Enfin, dans une conférence de presse du 21 février 1966, De Gaulle parle de « l'association des travailleurs aux plus-values en capital résultant de l'autofinancement ». L'entreprise apparaît de plus en plus comme une "société" (la nation étant la communauté par excellence), œuvre commune des capitaux, des dirigeants, des gestionnaires et des techniciens, enfin des travailleurs, catégorie qui englobe les ouvriers. Unis par un intérêt commun, qui est le rendement et le bon fonctionnement de cette société, les travailleurs ont un droit égal à l'information et à la représentation. Ce sont les « comités d'entreprise » en 1957, et l'« intéressement » en 1967. Quant au point de vue de l'État, la participation est une réforme « organisant les rapports humains ... dans les domaines économique, social et universitaire ». Les trois niveaux de la participation sont : la Nation, la région, l'entreprise.
Intéressement et planification
La participation dans l'entreprise revêt trois formes distinctes :
- Pour les travailleurs, l'intéressement matériel direct aux résultats obtenus.
- L'information ouverte et organisée sur la marche et les résultats de l'entreprise.
- Le droit à la proposition sur les questions qui regardent la marche de l'entreprise.
 En ce qui concerne le premier point, la législation se compose de l'ordonnance de 1959, de la loi de 1965 sur les droits des salariés, sur l'accroissement des valeurs de l'actif dû à l'autofinancement, et enfin l'ordonnance de 1967 instituant la participation aux bénéfices.
En ce qui concerne le premier point, la législation se compose de l'ordonnance de 1959, de la loi de 1965 sur les droits des salariés, sur l'accroissement des valeurs de l'actif dû à l'autofinancement, et enfin l'ordonnance de 1967 instituant la participation aux bénéfices.
Pour le second, on doit se référer à l'ordonnance de 1945 (dont le rédacteur fut René Capitant, ancien membre du groupe Esprit) sur les comités d'entreprise. Quant au troisième, il concerne aussi une législation répartie dans les ordonnances de 1967. Pour appliquer ce nouveau régime, le général De Gaulle excluait tout recours à la force, que ce soit celle des pouvoirs publics ou celle de la rue. La révolution par la participation n'est pas une vulgaire "exhibition", elle ne se constitue pas de tumultes bruyants ni de scandales sanglants.
L'État a néanmoins et sans aucun doute un rôle essentiel à jouer. Il faut, en toutes circonstances, qu'il tienne les leviers de commande. Tenir ces leviers, c'est prendre toutes les décisions qui favorisent la mise en place de ce nouveau régime. La nationalisation est un moyen. Ce n'est pas le seul ni le plus efficace. Ce que retient comme méthode privilégiée le Général De Gaulle, c'est la planification. Le Plan est le résultat de la coopération de plus en plus étendue des organismes qui concourent à l'activité nationale, la décision restant en dernier ressort aux pouvoirs publics. La question importante que pose à ce moment le Général De Gaulle est celle du régime apte à lancer ce vaste mouvement de réforme. En effet, si la question du régime politique est alors une question d'actualité, il n'est pas interdit de croire qu'elle est aussi et surtout une question permanente.
Le rôle des syndicats
Comme toute grande réforme, la participation demande beaucoup de temps et de volonté, et ces qualités sont celle, que l'État peut seul offrir. En accord avec les travailleurs eux-mêmes et certaines organisations "représentatives", l'État peut associer les partenaires sociaux aux responsabilités économiques françaises. À cette époque de l'immédiat après-guerre, De Gaulle croit encore aux vertus de ces syndicalistes qui furent aussi des cadres de la résistance. Si certains sont membres de féodalités inféodés à l'étranger (De Gaulle pense alors aux syndicalistes qui sont des militants du parti communiste), il fait en dernier lieu confiance aux vrais syndicats, attachés aux intérêts des travailleurs.
Quant à ces syndicats, dont la fonction est de protéger la classe salariale, il faut que leur rôle soit transformé. Il ne faut pas que ceux-ci soient au service des partis politiques et de leurs intérêts partisans. Il ne faut pas que les communistes puissent contrôler leurs activités au sein de l'entreprise. Le syndicat doit subir une profonde rénovation spontanément et librement. Ils pourront ensuite assumer leur rôle, qui est d'éclairer leurs mandants et de participer aux contrats de société. Ils pourront aussi organiser le rendement dans l'entreprise, soutenir la formation technique, l'apprentissage et les qualifications.
De Gaulle est aussi conscient des limites de ces réformes. Elles ne doivent pas détruire les autres piliers de l'économie, que sont l'investissement des capitaux pour l'équipement des entreprises, ni l'autorité et l'initiative des dirigeants. L'objectif final sera atteint par des modalités et des procédures échelonnées dans le temps. L'étape préliminaire étant celle de l'intéressement. Le rôle des entreprises publiques est aussi essentiel ; c'est dans cette catégorie nouvelle des entreprises nationalisées, où sont exclues les questions de répartition des capitaux, l'État étant majoritaire, que l'on pourra appliquer cette première réforme. Cette stratégie progressive et prudente, se doublera d'autre part d'un système d'arbitrage « impartial et organisé qui assurera la justice des rapports ».
Ce « régime organique d'association » connaît trois niveaux d'arbitrage :
- 1) Le Sénat économique et social, qui en est l'instance suprême ; le Sénat est la chambre des représentants des diverses catégories d'intérêts du pays ; il peut conseiller le gouvernement dans l'ordre économique et social, à propos du Budget et du Plan
- 2) Le Conseil Régional, représentant les collectivités locales et les mandataires des diverses activités économiques, sociales et universitaires ; il a compétence pour ce qui touche l'équipement et le développement de la région, notamment le plan régional. Enfin dans l'entreprise
- 3) l'institution des « délégués de la participation », chargés de négocier les contrats de participation.
À côté de ces délégués seront institués des « comités de participation », à caractère consultatif. Les modalités de la participation sont : l'intéressement, l'actionnariat, les méthodes de gestion participatives, la cogestion et l'autogestion.
La nationalisation des monopoles
Pour permettre d'établir les meilleures conditions d'application de ces réformes, un moyen intéressant fut la méthode des nationalisations. L'objectif des nationalisations était purement politique. Il fallait interdire toute concentration excessive qui prenne la forme d'un monopole économique. L'intérêt général justifiait cette politique. On sait les méfaits des grandes puissances économiques et financières dans les nations d'Amérique centrale, où, sous la forme de multinationales aux budgets formidables, celles-ci peuvent s'opposer avec succès aux décisions des gouvernements légitimes et légaux (en fait, nous connaissons ce phénomène sur les cinq continents et les pays occidentaux soumis au système capitaliste n'y échappent pas plus que les jeunes nations du Tiers-Monde).
Cette nationalisation des monopoles privés ne résout pas la question sociale. Elle est une condition favorable aux réformes nécessaires. C'est, écrit M. Desvignes, « un moyen négatif ». La politique envisagée n'implique pas une volonté de détruire le secteur dit libre. Elle confirme le rôle prioritaire de l'État, qui doit assurer lui-même l'exploitation des activités nationales, à savoir dans l'immédiat après-guerre : l'énergie (charbon, électricité, pétrole), le transport (chemins de fer, transports maritimes, aériens), les moyens de transmission (radio, plus tard télévision) ; le crédit (banques, établissement financiers). Il ne s'agit pas d'une étatisation, qui transformerait toutes ces sociétés en services publics, mais d'assurer le contrôle réel de l'État sur ces entreprises (par ex. sous la forme d'établissements publics à caractère industriel et commercial).
Ainsi le Général De Gaulle précise-t-il plus tard (25/11/1951) que l'État ne doit pas être là pour financer la marche de ces entreprises. Il fixe pour cela des règles de fonctionnement et de gestion à ces entreprises nationales : respect des règles commerciales (transports par ex.), participation des usagers, fixation autonome des tarifs et des traitements, responsabilité entière du conseil d'administration et des directeurs. Il ajoute aussi que ces nationalisations sont souvent dévoyées en ce sens qu'elles se transforment en de puissantes féodalités à l'intérieur même de l'État. Il reste qu'il y a là un moyen privilégié d'assurer les réformes.
Revenons à l'analyse des modalités pratiques de la participation.
L'autogestion est un mot qui n'a jamais été prononcé par De Gaulle. Si l'autogestion est un moyen offert au personnel de participer à la direction de l'entreprise, par le biais de l'appropriation de l'autofinancement, et la constitution de minorité de blocage, de contrôle ou même d'une majorité au sein du conseil dirigeant, alors la participation est une méthode d'autogestion. Mais cette participation n'est pas l'autogestion puisqu'elle conserve au chef d'entreprise le pouvoir de décision. Car, l'écrit de Gaulle : « Délibérer, c'est le fait de plusieurs, agir c'est le fait d'un seul ». L'idée autogestionnaire précisée, analysons les trois systèmes de participation qui furent proposés.
Trois objectifs sont retenus : favoriser la participation du personnel aux résultats, aux responsabilités et au capital.
La participation aux responsabilités : elle fut envisagée la première. Il s'agit d'associer le personnel à ce qui est gestion, organisation et perfectionnement des entreprises (discours du 2/03/1945). Ce sont les « Comités d'entreprise ».
« Casser le processus de la termitière »
 Le 7 avril 1947, il préconise l'association aux bénéfices, qui prévoit l'intéressement des travailleurs au rendement, contrôlé par un système d'arbitrage impartial et organisé. Cet intéressement sera calculé selon une échelle hiérarchique déterminée par les textes législatifs. L'idée est la rémunération des travailleurs au delà du "minimum vital", selon une technique analogue à la rémunération des capitaux mobiliers et immobiliers, qui sont rémunérés au delà de leur conservation et de leur entretien. À l'association dans l'industrie, De Gaulle veut faire correspondre la coopération dans l'agriculture. Par la création de mutuelles (souvenons nous de ce qu'écrivait Proudhon), de coopératives, de syndicats, soit par régions et localités, soit par branches de production, on peut assurer aux agriculteurs liberté et indépendance. La méthode ayant pour finalité de casser le processus de la « termitière » typique de la société libérale industrielle.
Le 7 avril 1947, il préconise l'association aux bénéfices, qui prévoit l'intéressement des travailleurs au rendement, contrôlé par un système d'arbitrage impartial et organisé. Cet intéressement sera calculé selon une échelle hiérarchique déterminée par les textes législatifs. L'idée est la rémunération des travailleurs au delà du "minimum vital", selon une technique analogue à la rémunération des capitaux mobiliers et immobiliers, qui sont rémunérés au delà de leur conservation et de leur entretien. À l'association dans l'industrie, De Gaulle veut faire correspondre la coopération dans l'agriculture. Par la création de mutuelles (souvenons nous de ce qu'écrivait Proudhon), de coopératives, de syndicats, soit par régions et localités, soit par branches de production, on peut assurer aux agriculteurs liberté et indépendance. La méthode ayant pour finalité de casser le processus de la « termitière » typique de la société libérale industrielle.
Pour introduire dans les faits cette participation des travailleurs aux résultats dans les entreprises, il est proposé dès 1948 la création de « contrats d'association » destinés à :
- Fixer la rétribution de base des ouvriers
- L'intérêt de base pour le capital qui procure les installations, les matières premières, l'outillage
- Le droit de base pour le chef d'entreprise qui a la charge de diriger.
L'idée qui soutient la création de ces contrats est la nécessaire égalité des divers partenaires de l'entreprise qui participent à ce qui est produit (travail, technique, capital, responsabilité) à la propriété et au partage de l'autofinancement. L'Association capital-travail crée un système de copropriété de l'entreprise. Les plus-values qui proviennent de l'autofinancement ne sont plus des modes exclusifs de rémunération du capital, mais doivent aussi être distribuées aux autres parties de la production.
L'association capital/travail
L'association est, dans l'idée gaullienne, une des idées-forces de l'avenir. En établissant cette association capital/travail, de Gaulle vise non pas seulement à motiver les travailleurs dans le destin économique de leur entreprise respective, mais il veut atteindre des objectifs plus ambitieux : consolider l'unité française, assurer le redressement national, donner un exemple à l'Europe.
Nous avons parlé jusqu'à présent de la participation en tant que traduction de l'idée gaullienne. Mais ainsi que celui-ci le rappelait lui-même dans une de ses allocutions, si la décision est le fait d'un seul, la délibération doit être le fait de plusieurs. Pour cela, il fut entouré d'hommes de valeur associés à sa recherche d'une résolution de la question sociale : sociologues, juristes, gestionnaires, économistes, juristes, syndicalistes, philosophes, etc... Nous voudrions évoquer maintenant quelques figures marquantes qui ont soutenu cette œuvre. Trois hommes se dégagent, qui furent des figures marquantes : René Capitant, Louis Vallon et Marcel Loichot.
 Il faut évoquer la figure de René Capitant. Professeur de droit et homme politique, René Capitant a énoncé, dans son cours de doctorat de droit public, ce qui fut le fondement de la participation : ce principe est la liberté, qu'il définit comme une autonomie et qui « consiste non pas à n'être soumis à aucune obligation juridique, auxquelles on est habituellement soumis, mais qui garantit à chaque associé son autonomie personnelle ». Le contrat d'association est le garant d'une vraie participation puisqu'il est un contrat démocratique. Il écrit : « En régime capitaliste, la démocratie est... limitée aux relations qui s'établissent entre possédants et ne s'étend pas aux relations entre possédants et travailleurs ».
Il faut évoquer la figure de René Capitant. Professeur de droit et homme politique, René Capitant a énoncé, dans son cours de doctorat de droit public, ce qui fut le fondement de la participation : ce principe est la liberté, qu'il définit comme une autonomie et qui « consiste non pas à n'être soumis à aucune obligation juridique, auxquelles on est habituellement soumis, mais qui garantit à chaque associé son autonomie personnelle ». Le contrat d'association est le garant d'une vraie participation puisqu'il est un contrat démocratique. Il écrit : « En régime capitaliste, la démocratie est... limitée aux relations qui s'établissent entre possédants et ne s'étend pas aux relations entre possédants et travailleurs ».
Le contrat démocratique sera le garant de la nouvelle démocratie sociale. Son adhésion au concept de la triple participation résulte de ce souci de « démocratie sociale ». En matière de participation, R. Capitant est partisan du « système Sommer », qui lie l'augmentation des salaires non à l'accroissement de la production nationale, mais à la productivité concrète des entreprises. De la sorte, les salariés sont des copropriétaires de l'accroissement d'actifs résultant de l'autofinancement. Leurs parts sociales sont représentatives de leur part de propriété dans l'entreprise. (Il est favorable de ce fait à une révision de l'ordonnance de 1967 qui permet le remplacement des simples titres de créances au profit d'actions à part entière).
René Capitant est aussi favorable à une « responsabilité organisée de la direction devant les travailleurs ». En d'autres termes, il s'engage dans la voie d'une autogestion ouvrière. Il préconise deux types d'assemblées générales dans l'entreprise : l'Assemblée générale des actionnaires, et l'Assemblée générale des salariés. La direction serait responsable devant ces deux assemblées et on constituerait un organe permanent des salariés, le comité d'entreprise, parallèle au conseil de surveillance des actionnaires.
Les projets de Louis Vallon
On retrouve ces idées dans le célèbre amendement Capitant-Le Douarec de 1966, qui prévoyait :
Pour les sociétés anonymes, la création d'un « Directoire » assurant les pouvoirs de direction, et d'un « conseil de surveillance », chargé de contrôler le précédent. Ce conseil peut constituer, avec le comité d'entreprise, une commission paritaire mixte qui examinera toutes les questions relatives à la marche de l'entreprise. L'entreprise deviendrait une « coopérative ouvrière », mais ayant la possibilité de faire appel à des capitaux extérieurs, ce qui la rendrait compétitive face aux entreprises capitalistes. À côté de René Capitant, on trouve Louis Vallon [alors Rapporteur Général de la Commission des Finances de l'assemblée Nationale], auteur du fameux « Amendement Vallon », modifiant la loi du 12/07/1965. L'amendement faisait obligation au gouvernement de déposer un projet de loi sur la « participation des salariés à l'accroissement des valeurs d'actifs des entreprises dues à l'autofinancement ».
 Pour L. Vallon, le mécanisme à mettre en place doit être un mécanisme juridique : l'octroi d'un droit aux salariés sur l'accroissement des valeurs d'actifs dû à l'autofinancement, droit qui est garanti par une obligation légale faite aux entreprises. Cette participation a un autre avantage : elle favorise l'investissement et l'augmentation de la surface financière, parce qu'elle augmente les garanties fournies aux tiers par l'incorporation de réserves au capital. Enfin, il propose de compenser la moins-value des titres anciens par un système d'encouragement fiscal. En fait, ces projets se heurteront à l'hostilité des féodalités économiques, patronales et syndicales.
Pour L. Vallon, le mécanisme à mettre en place doit être un mécanisme juridique : l'octroi d'un droit aux salariés sur l'accroissement des valeurs d'actifs dû à l'autofinancement, droit qui est garanti par une obligation légale faite aux entreprises. Cette participation a un autre avantage : elle favorise l'investissement et l'augmentation de la surface financière, parce qu'elle augmente les garanties fournies aux tiers par l'incorporation de réserves au capital. Enfin, il propose de compenser la moins-value des titres anciens par un système d'encouragement fiscal. En fait, ces projets se heurteront à l'hostilité des féodalités économiques, patronales et syndicales.
En résumé, Louis Vallon énonce quatre conditions essentielles : Les salariés doivent posséder de véritables titres de propriété, analogues à ceux des actionnaires antérieurs. La base du calcul de la participation comprend et le bénéfice fiscal et les plus-values implicites. Pour calculer avec réalisme l'accroissement des actifs, il faut une réévaluation régulière des bilans.
Il serait néfaste que soit créé un organisme central de gestion chargé de contrôler les titres de propriété des travailleurs. Il signifierait une perte d'identité des entreprises. D'où la critique ouverte de Louis Vallon contre l'ordonnance de 1967, qu'il juge trop modeste dans ses réalisations.
[codicille en forme d'épilogue : « L'amendement Vallon va devenir immédiatement l'objet d'une polémique publique qui aura des conséquences importantes sur l'évolution publique car il s'agissait de poser en principe que l'épargne des entreprises — l'autofinancement — devait désormais être partagée, au fur et à mesure de sa formation, entre les actionnaires et les salariés. Le mécanisme ainsi monté était beaucoup plus dangereux qu'une nationalisation puisqu'il n'était pas question d'indemniser ceux qui perdaient ainsi chaque année une partie de la valeur de leur capital. Le vote de ce texte déclencha une vigoureuse campagne du CNPF et des milieux d'affaire qui firent le siège des députés de la majorité et du gouvernement. Celui-ci, pour gagner du temps, décida de créer une commission. Malgré la pression des gaulliste de Gauche, le délai fixé par la loi de 1965 [1er mai 1966] était dépassé lorsque la commission Malthey — du nom de son président — fut mise en place. Habilement composée, elle ne risquait pas d'aboutir à des suggestions constructives ; le rapport remis au gouvernement contestait qu'il puisse y avoir un lien entre l'autofinancement et le droit des salariés à en obtenir une part, la situation des salariés étant la même que lorsque le financement des investissements est fait par voie d'emprunt. Le rapport insistait aussi sur la difficulté de calculer l'autofinancement et sur le coût de gestion du système. Seul Alfred Sauvy vota contre le rapport, Raymond Barre l'approuva. Pour Arnaud de Vogüé le projet découlait "d'une conception statique de l'entreprise qui, depuis longtemps, a été largement dépassée par les faits et qui ne correspond plus à aucune réalité actuelle". Il admet, en faisant référence à l'Encyclique Mater et Magistra que le personnel doit bénéficier de la prospérité de l'entreprise et il en donne quelques exemples : "les rpimes de fin d'année, les allocations pour éducation d'enfants, les contributions aux frais de vacances..." Tous les succédanés que repoussait le Général. C'étaient deux conceptions parfaitement antinomiques qui s'affrontaient ; le projet emportait ce qu'on a appelé plus tard un changement de société alors qu'on était à moins d'un an des élections législatives. Entre le mois de juin 1965 et la fin de 1966, le gouvernement Pompidou n'avait cherché qu'à renvoyer à plus tard le débat sur la participation ; ensuite, la proximité des élections le rendait inopportun. », G. Dumas, La dérive de l'économie française : 1958-1981, Harmattan, 2003, pp. 126-127. Archive vidéo ina de Louis Vallon en 1969 au sujet de sa crainte d'une transition des principes de l'économie mixte et du rassemblement national vers un libéralisme accru, représenté par Pompidou.]
Marcel Loichot et le « pancapitalisme »
Enfin Marcel Loichot, polytechnicien, surnommé le « père du pancapitalisme ». Ce « pancapitalisme », il en résume ainsi les principes : L'homme, en tant que fabricant d'outils, est un capitaliste. Parce que l'outil est en soi un capital. La question est de savoir qui sera le possesseur du capital : les oligarchies économiques, l'État, les ouvriers ou les épargnants ?
Pour supprimer l'aliénation capitaliste, la dernière solution est retenue. C'est celle des « épargnants conjoints » (ouvriers, entrepreneurs, État, etc.).
Car, pour Loichot, le capitalisme néo-libéral reste un oligopartisme, tandis que le communisme est un monocapitalisme. Dans ce cadre, les biens de production sont abusivement confisqués par la classe possédante. S'il y a partage des biens de consommation, ce partage n'est qu'un trompe-l'œil, qui perpétue la « spoliation des salariés ». Pour faire cesser cette spoliation, il faut diffuser la propriété, dans le cadre d'une société dite « pancapitalisme ». Dans ce système, un projet de loi présenté devant le Parlement prévoyait, entre autres projets, que les droits d'attribution d'actions gratuites, par voie de réévaluation de l'actif, réservent au moins 50% aux travailleurs ayant au moins 10 ans de présence dans l'entreprise, proportionnellement aux salaires perçus.
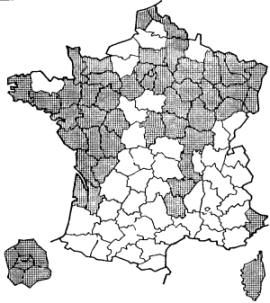
Tirée du livre magistral de François G. Dreyfus (De Gaulle et le Gaullisme, PUF, 1982), cette carte nous montre l'implantation du vote gaulliste en 1951, au lendemain des événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale. C'est un vote du Nord-Est et de l'Ouest, ancré tant des régions rurales que dans des régions de haute concentration industrielle. Il faut croire, effectivement, que les lois gaulliennes sur l'association des salariés à l'accroissement de la productivité aient séduit une partie de l'électorat.
IV — Les textes instituant la participation
Nous ne présenterons pas l'ensemble de ces textes, dont l'analyse serait longue et fastidieuse. Historiquement, nous avons souligné le retard de la France en matière sociale sous la IIIe République, retard qui fut comblé partiellement par les réformes instituées par le gouvernement du Front Populaire. En ce qui regarde la question de la participation, on peut citer quelques textes, imparfaits et sans grands résultats (Loi du 18/12/1915 sur les sociétés coopératives de production, loi du 26/04/1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière et actions de travail, loi 25/02/1927 sur les sociétés coopératives ouvrières de production). Il faudra ensuite attendre les ordonnances de 1945 (22 et 25/02/1945) pour voir s'instituer les premiers comités d'entreprise, et le Décret-Loi du 20/05/1955 sur l'association des salariés à l'accroissement de la productivité.
La naissance de la Ve République allait engager ce vaste mouvement législatif qui prétendait aborder la question sociale. On compte, entre l'ordonnance de 1959 et la loi de 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par les salariés, pas moins de 4 ordonnances, 3 décrets et 8 lois pour organiser la participation. On retiendra le cœur de ce projet, constitué par les 3 ordonnances du 17 août 1967, relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise (ordonnance n°1), relative aux Plans d'Épargne d'entreprise (ordonnance n°2), et relative aux modifications et compléments de la loi du 24 juillet 1966.
Quelle est la portée de ces ordonnances ? On trouve une présentation de sa portée dans la présentation du rapport au Président de la République.
Elles ont pour objet de permettre une amélioration de la condition des travailleurs, et de modifier les rapports dans les entreprises entre les travailleurs et les patrons.
Pour réaliser ces objectifs, l'ordonnance n°67.693 institue :
- Un partage des bénéfices, sur la base du bénéfice fiscal net (on remarquera qu'est rejeté ici le projet Loichot, qui incluait, dans la base du calcul, les plus-values implicites). La rémunération forfaitaire du capital est donc déduite du bénéfice net au taux de 5% après impôt. De plus est appliqué un coefficient (rapport des charges sociales à la valeur ajoutée) qui évite aux entreprises à forte capitalisation et faible main d'œuvre que les salariés ne perçoivent une rémunération disproportionnée sur base des bénéfices. Autrement dit, le partage entre les actionnaires et le personnel est effectué après rémunération à taux élevé (10% avant impôt), et l'application d'un coefficient aux effets cumulatifs avec ceux de la rémunération forfaitaire des capitaux.
- Elle institue aussi le caractère légal et obligatoire de l'ordonnance. Toutes les entreprises de plus de 100 salariés sont concernées. Le système de la cogestion en République Fédérale allemande concerne les entreprises de plus de 500 salariés. Le système français s'inspire en fait des expériences de cosurveillance appliquées en Suède et en Hollande.
- Elle règle ensuite la forme juridique des contrats d'association. Trois possibilités sont accordées aux entreprises françaises : le cadre de la convention collective ; l'accord passé entre le chef d'entreprise et les syndicats dits "représentatifs", obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ; l'accord passé dans le cadre du comité d'entreprise.
Avant de présenter quels objets licites l'ordonnance prévoit, formulons quelques remarques quant aux positions des divers syndicats à l'endroit de la participation.
La position des syndicats patronaux et ouvriers
Le Général De Gaulle avait prévu, dès le départ, le problème majeur qui risquait de supprimer les effets positifs du projet. Ce problème était celui des syndicats, ouvriers et patronaux. L'opposition de ces féodalités, que l'on a pu constater depuis lors, était un obstacle essentiel que craignait le chef de l'État. Pour les syndicats, deux catégories de réactions étaient à prévoir. Celle des syndicats affiliés au parti communiste, pour qui faction syndicale est une œuvre de division nationale, et les revendications des travailleurs un moyen de développer l'agit-prop.
À leur égard, il n'y avait aucune illusion à se faire ; pour la Confédération Générale du Travail (CGT), proche du Parti communiste français, il y avait une opposition absolue aux ordonnances. Cette opposition était naturelle, si on veut bien se rappeler tout l'arrière-plan idéologique que les promoteurs de la participation défendaient. Les tentatives, réussies pendant un temps, de détacher le monde ouvrier de l'influence du PCF, étaient mal vues de sa courroie syndicale. Pour Henri Krasucki, le projet Capitant était « un des innombrables systèmes qui se sont essayés à enjoliver le capitalisme et à mélanger l'eau et le feu », pour ajouter : « la notion de participation correspond à un problème réel ».
Pour la CGT, la participation est un slogan qui ne brise pas les féodalités économiques et financières. Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), proche des courants autogestionnaires, la participation dans l'entreprise n'est pas a priori mauvaise en soi. Elle demande à être élargie. Au cours d'un débat tenu le 5 juin 1972, entre Marcel Loichot et le président de la CFDT, fut posée la question essentielle : celle de la propriété des moyens de production. Les questions posées furent celles-ci : l'usine à Rothschild ? L'usine à l'État ? Ou l'usine à ceux qui y travaillent ?
Pour le syndicat Force Ouvrière, réformiste, elle prend une position moyenne, tout à fait dans sa ligne social-démocrate.
Les syndicats patronaux, quant à eux (en tête, le Conseil National du Patronat Français), sont hostiles au projet qui, selon leurs analyses, ne répond pas à la vraie question qui est la suivante : « Qui doit commander ? ». Enfin les syndicats de cadres, en principe non hostiles à la participation, restent proches des positions du patronat.
À l'exception notable du courant autogestionnaire, très timide face à cette réforme, il y a donc une conjonction spontanée des féodalités syndicales contre la participation. Du patronat libéral à la centrale communiste, l'idée apparaît comme dangereuse, pour la simple raison qu'elle envisage une société beaucoup plus attentive à la question sociale.
Le test est révélateur ...
Mais revenons aux ordonnances de 1967. L'objet de l'accord doit ensuite être licite. Il peut également prévoir : l'attribution d'actions de l'entreprise, l'affectation des sommes de la réserve spéciale de participation à un fonds d'investissements, etc.
* Enfin elle traite de l'attribution des droits du personnel : ces droits seront malheureusement limités, puisque seront exclus en dernière instance les droits de participation au capital, et aux décisions au sens de la directive du 31 juillet 1968.
On voit que le projet "idéologique" de la participation demeura bien au-delà des réalisations législatives. La France de la croissance des années 1960/1970 est une France prospère où l'expansion constitue un manteau épais qui relègue les grandes questions au second plan. Pour les organisations syndicales, le projet politique ne constitue plus un enjeu. Les discussions se greffent plus souvent sur des questions alimentaires ou, plus largement, sur la gestion d'une société de consommation euphorique. Les grands débats sont abandonnés, à quelques exceptions près. L'idéologie bourgeoise battue en brèche par les contestataires, telle Protée, resurgie sous la forme plus subtile d'une mentalité imprégnant toutes les couches sociales. L'ouvrier rêve de devenir bourgeois, et les syndicats sont des partenaires bien éduqués, siégeant à des tables de négociations. Le projet de la participation a été digéré par ces féodalités que dénonçait le Général De Gaulle dès l'immédiat après-guerre.
CONCLUSION
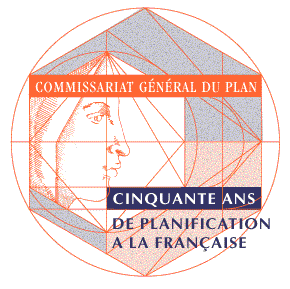 La participation a voulu proposer un lieu de dépassement du capitalisme et du marxisme. L'évolution du régime économique et social, qui devait résoudre la question sociale, a abouti à un semi-échec. La société occidentale, libérale et capitaliste, la société de la "liberté" bourgeoise, ont étouffé le projet. Il n'y a pas eu confrontation directe, et De Gaulle avait pressenti le rôle dangereux parce que discret des féodalités. L'idée ambitieuse et poétique de forger l'unité nationale par la résolution de la question du salariat n'était pas supportable pour tous ceux qui ont fait profession de la politique. La ligne de clivage entre partisans et adversaires de la participation passait en effet dans l'intérieur des partis traditionnels.
La participation a voulu proposer un lieu de dépassement du capitalisme et du marxisme. L'évolution du régime économique et social, qui devait résoudre la question sociale, a abouti à un semi-échec. La société occidentale, libérale et capitaliste, la société de la "liberté" bourgeoise, ont étouffé le projet. Il n'y a pas eu confrontation directe, et De Gaulle avait pressenti le rôle dangereux parce que discret des féodalités. L'idée ambitieuse et poétique de forger l'unité nationale par la résolution de la question du salariat n'était pas supportable pour tous ceux qui ont fait profession de la politique. La ligne de clivage entre partisans et adversaires de la participation passait en effet dans l'intérieur des partis traditionnels.
La participation pouvait en réalité constituer le point de départ d'une vaste subversion des cadres conservateurs de la société bourgeoise d'après 1945. La révolution industrielle était aussi une révolution culturelle. Elle avait créé une société brisée, scindée selon des critères socio-économiques. D'un côté, la bourgeoisie possédante, industrielle et financière, qui bénéficie des profits du changement. C'est une bourgeoisie triomphante, propriétaire exclusive des moyens de production, qui construit une société et un régime à son image. De l'autre côté, la création d'une classe de salariés, attirée par les grandes manufactures qui donnent des emplois.
Face au capital qui investit, le travail n'est pas une valeur positive. Elle n'est pas productrice de bénéfices, mais seulement de rémunérations salariales. Pourtant, de tous les côtés, des hommes se lèvent, et osent dénoncer ce système politico-économique dominé par les valeurs de la révolution dite "française". Le socialisme français de Proudhon, et de Sorel est rejoint dans sa contestation de l'ordre bourgeois libéral et républicain par les penseurs du catholicisme social.
Plus tard, des mouvements plus radicaux, élèves du socialisme national, exigent une réforme plus vaste. Ils exigent la Révolution. C'est l'époque de Barrès, du premier Maurras (celui de La Revue Grise), des socialistes révolutionnaires travaillant côte à côte avec de jeunes monarchistes soréliens (le Cercle Proudhon). Tous ces groupes constituent cette "droite révolutionnaire" qui allient le sens de la Nation et celui des libertés réelles. En réalité, ce creuset n'engendre pas un parti de droite, mais quelque chose de nouveau, qui va plus loin.
Contre la république opportuniste et radicale, qui n'hésite pas à tirer sur les ouvriers en grève, il y a une conjonction historique. Il est dommage que celle-ci n'ait point abouti. Il reste que, beaucoup mieux que le bourgeois Marx, elle a dégagé dans ses écrits la question essentielle. Le salariat est le système juridique et social qui symbolise le monde bourgeois. Avec son idée d'une triple participation (aux capitaux, aux résultats, aux décisions), le Général De Gaulle se situait dans le droit fil de cette tradition socialiste française. Il a fallu la réunion de toutes les oppositions féodales pour briser le projet. Il reste un exemple à méditer. Ce peut-être le sujet de nos réflexions futures. Car il faudra bien un jour, en dépassant les vieilles idéologies capitalistes et marxistes, résoudre la question sociale.
► Ange SAMPIERU, Orientations n°12, 1990.
BIBLIOGRAPHIE (par ordre de consultation)
I) INTRODUCTION :
- M. DESVIGNES, Demain, la participation, au-delà du capitalisme et du marxisme, 1978.
- Charles DE GAULLE, Discours et Messages, Plon, 1970.
II) L'IDÉOLOGIE DE LA PARTICIPATION :
- Michel JOBERT, Mémoires d'avenir, Grasset, 1975.
- Jean-Gilles MALLIARAKIS, Yalta et la naissance des blocs, Albatros, 1982.
- Jean TOUCHARD, Histoire des idées politiques (tome II : Du XVIIIe siècle à nos jours), PUF, 1975.
- J. IMBERT, H. MOREL, R.J. DUPUY, La pensée politique des origines à nos jours, PUF, 1969.
- Jean ROUVIER, Les grandes idées politiques, de Jean-Jacques Rousseau à nos jours, Plon, 1978.
- J.B. DUROSELLE, Les débuts du catholicisme social en France (1822-1870), PUF, 1951.
- François PERROUX, Aliénation et société industrielle, Gallimard, coll. "Idées", 1970.
- Œuvres de PROUDHON : les principaux ouvrages de PROUDHON sont édités aux éditions Marcel Rivière (Diffusion Sirey) : De la justice dans la Révolution et dans l'Église (4 volumes, 1858) ; Les confessions d'un révolutionnaire (1849) ; L'idée générale de la Révolution (1851) ; Qu'est-ce que la propriété ? (1840 et 1841) ; Carnets (6 volumes dont 2 publiés par P. HAUBTMANN aux éditions Rivière, 1960/ 1961).
- Hippolyte TAINE, La Révolution française (tome II : Des Origines de la France contemporaine), Laffont, 1972.
- Œuvres de LAMENNAIS : les principaux ouvrages sont édités aux éditions Le Milieu du Monde, Genève : Essai sur l'indifférence en matière de religion (1817/1824) ; L'avenir (1830/1831) ; Les paroles d'un croyant (1834) ; Le livre du peuple (1837) ; La question du travail, etc.
- Carl E. SCHORSKE, German Social Democracy (1905-1917), Cambridge, Mass., 1955.
- F.G. DREYFUS, De Gaulle et le Gaullisme, PUF, coll. "politique d'aujourd'hui", 1982.
III) L'IDÉOLOGIE GAULLIENNE :
- Zeev STERNHELL, La droite révolutionnaire 1885-1914, Seuil, 1978.
- F. LAFARGUE & Friedrich ENGELS, Correspondance, éditions sociales, 1956.
- Maurice BARRÈS, articles de La Cocarde, cités par Z. STERNHELL, n° du 8/09/1894 et du 14/09/1890.
- J.-L. LOUBET del BAYLE, Les non-conformistes des années 30, Seuil, 1969.
IV) LA PARTICIPATION :
- Œuvres de René CAPITANT : La réforme pancapitaliste (1971), Écrits politiques (1971), Démocratie et participation politique (1972).
- Sur ce sujet, consulter aussi la revue Espoir, éditée par l'Institut Charles de Gaulle (5, rue de Solférino, 75007 PARIS), n° 10/11, 5, 17, 28, 35.

pièces-jointes :
Charles de Gaulle,
la « Révolution conservatrice »
et le personnalisme du mouvement l’Ordre nouveau
 Jean Lacouture, dans le premier tome de son De Gaulle, fait la part belle au colonel Mayer et à son cercle dans la formation intellectuelle du général. Certaines bonnes pages de cette somme sont d’ailleurs parues dans Le Nouvel Observateur sous le titre « L’homme qui a fait de De Gaulle un rebelle ». Cette annonce est quelque peu exagérée. Certes, le saint-cyrien de 1913 peut donner de lui une image assez conventionnelle dans ses carnets et correspondances, celle d’un jeune officier de la droite catholique.
Jean Lacouture, dans le premier tome de son De Gaulle, fait la part belle au colonel Mayer et à son cercle dans la formation intellectuelle du général. Certaines bonnes pages de cette somme sont d’ailleurs parues dans Le Nouvel Observateur sous le titre « L’homme qui a fait de De Gaulle un rebelle ». Cette annonce est quelque peu exagérée. Certes, le saint-cyrien de 1913 peut donner de lui une image assez conventionnelle dans ses carnets et correspondances, celle d’un jeune officier de la droite catholique.
Pourtant, son adhésion résolue à la République traduit déjà une évolution nette par rapport à sa famille. Il est abonné aux Cahiers de la quinzaine (1900-1914) de Péguy, l’auteur de Victor-Marie, comte Hugo et de la Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne. Les convergences entre de Gaulle et Péguy ont été maintes fois soulignées sans qu’il soit nécessaire de revenir sur ce sujet. Péguy, déçu par la gauche des combats dreyfusards, ne rejoint pas le camp des conservateurs. Il privilégie la mystique de l’idée républicaine et c’est sur ce terrain que de Gaulle peut le rejoindre.
Par la suite, de Gaulle va subir l’épreuve de la guerre et de l’emprisonnement, cette école des révolutionnaires. Celle-ci explique pour une part sa convergence intellectuelle avec ceux qui tentèrent de tirer les conséquences des conditions de la Première Guerre mondiale : doctrinaires de la Révolution conservatrice et personnalistes. La Révolution conservatrice et le personnalisme ont développé leurs thèmes pendant les années tournantes (1) : 1925-1935, au cours desquelles la pensée politique du général de Gaulle semble avoir reçu des influences déterminantes et s’être précisée.
En donner une définition n’est pas chose facile. La Révolution conservatrice, tout d’abord, dénommée également révolution allemande ou national-bolchevisme, est un courant radical apparu en 1919 en Allemagne et issu de l’extrême-droite. Une série de penseurs peut y être rattachée : Ernst Niekisch, Keyserling, Walter Rathenau, Thomas Mann, Oswald, Spengler, Moeller Van Den Bruck et surtout Ernst Jünger (2).
Leurs théories sont multiples et leurs positions politiques font davantage penser à une nébuleuse qu’à un courant très structuré, de Goebbels qui en fut proche à Otto Buhse qui adhéra au parti communiste allemand, de Gregor Strasser et son Manifeste de la gauche nazie à son frère, Otto Strasser, l’animateur du « Front noir » clandestin, socialiste, national et révolutionnaire : la totalité du champ compris entre les franges du NSDAP et celles du parti communiste sera couverte. Jünger, quant à lui, s’isolera dans le détachement aristocratique de « l’Anarque » (3). Il n’est pourtant pas impossible de sérier les thèmes réducteurs, valables pour l’ensemble, qu’on peut mettre en parallèle avec la pensée gaullienne pour y voir des convergences apparentes et des divergences réelles.
En politique étrangère, l’originalité des nationaux-bolcheviques se manifeste dès 1919 (4) par l’analyse qu’ils font de la Révolution russe. À l’opposé de la quasi-totalité de la droite et de l’extrême-droite mondiale, ils ne voient pas, dans l’Union soviétique, le danger révolutionnaire qui nécessite un cordon sanitaire. Ils considèrent essentiellement la Russie essentielle éternelle, celle qui se développe de façon efficace dans le monde moderne en ployant le communisme à ses propres fins par une ruse de l’histoire. Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette idée de base. Tout d’abord, l’idée de nation peut, sans risque pour elle, être mêlée à celle de révolution socialiste et même en tirer avantage. Ensuite, nationalisme et bolchevisme, Russie et Allemagne, se trouvent objectivement en position d’alliés contre le système bourgeois.
En politique intérieure, le national-bolchevisme présente des thèses qui se détachent nettement de celles de l’extrême-droite traditionnelle. Cette dernière est élitiste, terrienne, passéiste. Le national-bolchevisme est, quant à lui, favorable au rôle des masses dans la vie politique et se révèle un partisan enthousiaste de la modernité technique (5). La direction de l’économie par l’État, la planification, la constitution de vastes ensembles industriels, la multiplication des machines et des cités nouvelles, lui paraissent constituer une série de données positives. Il reste enfin au national-bolchevisme à concevoir l’idée d’un communisme à base aristocratique et hiérarchique, d’un socialisme communautaire et national, le vocabulaire en ce domaine étant signe d’un certain confusionnisme. Moeller Van Den Bruck est très représentatif de ce courant de pensée. Admirateur des économistes List et Rodbertus, il recherche une troisième voie au-delà du libéralisme et du collectivisme.
Convergences apparentes et divergences réelles
En apparence, les positions de la Révolution conservatrice et les thèses gaulliennes semblent s’accorder sur trois points :
• prééminence du fait national sur le communisme (notamment en Russie) ;
• nécessité de bâtir un État moderne et technicien ;
• enfin, nécessité d’une troisième voie sociale, du communisme national à la participation.
En fait, cet accord est très artificiel.
L’analyse de la Russie soviétique par le national-bolchevisme se conçoit en terme de décadence de la société occidentale. Il y a un déficit énergétique, une absence de mythes mobilisateurs dans nos sociétés. Le communisme, par opposition, a permis en Russie la construction d’un État fort et d’une dictature patriotique. Il ne faut donc pas hésiter à utiliser l’énergie du communisme pour faire prospérer la tradition nationale. Cette analyse n’est pas du tout celle de C. de Gaulle. D’une part, la façon dont il appréhende l’URSS (6) s’inscrit dans la tradition capétienne. Les nations et les États ont des rapports avec la France essentiellement liés à des constantes géopolitiques. Les relations entretenues par la France avec ces nations et ces États tiennent évidemment compte de ces mêmes constantes. La France s’adresse par ailleurs à ces États et à ces nations, quelles que soient les idéologies ou les religions qui les régissent.
D’autre part, le général de Gaulle ne pense pas en termes spenglériens. Il ne croit pas à la « décadence de l’Occident ». Il pense plus sereinement que le communisme peut éventuellement s’installer, mais qu’il passera comme toutes les idéologies et que les nations resteront elles-mêmes. Son attitude vis-à-vis de la modernité reste empreinte de la même absence de frénésie. Il admet la civilisation des masses, la technique. Il incitera l’armée à se moderniser avant la guerre et fera entrer la France dans la société industrielle sous la Ve République.
Chez lui, on ne relève donc aucune de ces nostalgies pastorales chères à l’Action française et à Pétain. Les pages consacrées à l’analyse de la société moderne sont assez connues pour que l’on évite de les citer à nouveau. Il n’empêche que s’il ne donne pas dans le refus, à l’image de G. Duhamel dans les années 30, ses écrits témoignent cependant d’une conscience des risques oppressifs du système marchand et mécanique. Son point de vue est en cela nettement plus mesuré que celui du national-bolchevisme. Par ailleurs, les thèmes de « civilisation des masses » et de « société technicienne » sont traités par de nombreux intellectuels (Gramsci, Ortega y Gasset...) pendant l’entre-deux guerres et ne relèvent pas seulement de la Révolution conservatrice.
Enfin, la participation gaullienne diffère notablement du national-bolchevisme en ce que ce dernier envisage l’intégration des travailleurs dans une perspective organiciste, quasi biologique et totalitaire : l’État doit mettre chacun à sa place. L’esprit plus contractuel de la participation s’oppose nettement à cette tendance corporatiste.
De Gaulle a-t-il pu avoir connaissance des théories du national-bolchevisme ? Il semble que oui, et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, une tradition chez les officiers formés avant la guerre de 14-18 voulait qu’ils possèdent une sérieuse information sur l’Allemagne et maîtrisent la langue du pays. Nous pouvons ainsi noter à ce sujet que C. de Gaulle obtient à l’École supérieure de guerre, en 1923-1924, l’appréciation suivante : « Connaît à fond la langue allemande et la parle parfaitement » (7). De Gaulle a d’ailleurs attendu, avant de faire publier La Discorde chez l’ennemi, la parution des mémoires des protagonistes allemands.
En 1924 également, le 18 juin, paraît le premier article de la presse allemande (8) consacré à Charles de Gaulle, intitulé « Un jugement français sur les causes de la défaite allemande dans la guerre mondiale » et signé par le général d’infanterie Von Kuhl dans la revue berlinoise Militärwochenblatt (hebdomadaire de la Wehrmacht). Nous pouvons également remarquer que le principal théoricien de la Révolution conservatrice, Ernst Jünger, avait écrit en 1919 son premier livre, Orages d’acier, pour relater son expérience de la Grande Guerre. Cet ouvrage n’est sûrement pas resté inconnu de De Gaulle. Cette série de faits nous entraîne à penser qu’il dut suivre avec intérêt, attention et prévention, le mouvement des idées en Allemagne et, très certainement, dans la presse allemande.
Un autre élément nous semble déterminant : C. de Gaulle a été en contact avec plusieurs des « non-conformistes des années 30 » (9), dont les revues rendaient compte des thèses de différents mouvements étrangers et en particulier du national-bolchevisme. Les membres de l’Ordre nouveau ont d’ailleurs été en liaison directe avec eux, en France et en Allemagne, et aussi avec Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle et le mouvement l’Ordre nouveau
Le destin des sigles et des slogans est parfois curieux. L’Ordre nouveau est le nom de la revue fondée en 1919 par Antonio Gramsci [Ordine Nuovo] et celui du mouvement personnaliste créé par Alexandre Marc-Lipiansky. Le terme circulera dans les milieux nationaux-bolcheviques et sera repris par le nazisme.
Le mouvement l’Ordre nouveau appartient à ces groupes « non conformistes des années 30 » qui tentèrent de renouveler la pensée politique française (10). Leur refus de la droite et de la gauche n’empêche pas de classer Esprit à « gauche », que la tendance de Réaction ou de La Revue française est d’une droite néo-traditionnaliste et qu’Ordre nouveau occupe une position « centrale », intermédiaire dans ce dispositif.
Il convient tout d’abord de s’interroger sur les circonstances qui ont amené le général de Gaulle à s’intéresser à ce mouvement (11). Pour cela, il est nécessaire de faire un bref rappel historique de la chaîne d’amitiés et d’affinités qui relie, avant 1940, la carrière littéraire de De Gaulle, les campagnes pour ses conceptions en matière de défense et sa réflexion politique.
Nous trouvons dans ce milieu plusieurs personnalités aux traits communs : officiers ou anciens officiers, indépendants d’esprit, humanistes, écrivains ou journalistes, originaires du Nord ou de l’Est (12). C’est en 1912, à Arras, que de Gaulle rencontre le premier d’entre eux, Étienne Repessé. Il a ensuite l’occasion de le retrouver en 1915 auprès du colonel Boudhors. La publication de La Discorde chez l’ennemi et du Fil de l’épée aux éditions Berger-Levrault doit beaucoup à sa position de directeur littéraire dans cette maison. Il présentera de Gaulle à Lucien Nachin et ce dernier l’introduira auprès du colonel Émile Mayer (13).
Jean Lacouture n’hésite pas à définir ce dernier comme « un homme étonnant, qui est peut-être le seul, avec André Malraux, à avoir exercé une influence directe sur l’esprit et la vie de Charles de Gaulle (14) ». Il est en effet à noter que les dédicaces de livres ou de conférences faites par de Gaulle à Émile Mayer ne sont pas courantes : de Gaulle va jusqu’à se dire « son élève ». Il participe aux réunions de son cercle en 1932-1936, chaque dimanche matin, chez son gendre, M. Grunebaum-Ballin, ou le lundi à la brasserie Dumesnil de Montparnasse.
Le colonel Mayer l’introduira auprès du Club du Faubourg, proche de la gauche socialiste, où il aurait prononcé plusieurs conférences. C’est chez lui qu’il connut Jean Auburtin. Ce dernier lui fera rencontrer un certain nombre d’hommes politiques : Paul Reynaud, Joseph Paul-Boncour, Marcel Déat, Frédéric-Dupont, Pierre Olivier Lapie, Camille Chautemps, Alexandre Millerand et enfin Léon Blum. Par ce biais, il put défendre ses conceptions sur l’armée de métier. C’est enfin grâce au colonel Mayer qu’il rentrera en contact avec Daniel-Rops (15) et sera présenté par ce dernier aux membres de l’Ordre nouveau.
 Selon J.-L. Loubel del Bayle, « "L’Ordre nouveau"... fut le mouvement le plus original de ces années 30 (16) ». Sa création revient à Alexandre Marc-Lipiansky. Né en 1904, à Odessa, dans une famille israélite, il doit quitter la Russie après la Révolution. Après des études au lycée Saint-Louis à Paris, il suit les cours de Husserl à Fribourg-en-Brisgau et des études de philosophie à l’université d’Iéna. En 1927, il termine en France ses études de droit et sera diplômé de l’École libre des sciences politiques.
Selon J.-L. Loubel del Bayle, « "L’Ordre nouveau"... fut le mouvement le plus original de ces années 30 (16) ». Sa création revient à Alexandre Marc-Lipiansky. Né en 1904, à Odessa, dans une famille israélite, il doit quitter la Russie après la Révolution. Après des études au lycée Saint-Louis à Paris, il suit les cours de Husserl à Fribourg-en-Brisgau et des études de philosophie à l’université d’Iéna. En 1927, il termine en France ses études de droit et sera diplômé de l’École libre des sciences politiques.
C’est en 1929 qu’il fonde le Club du Moulin vert, première version de l’Ordre nouveau, créé en 1930 avec Robert Aron et Arnaud Dandieu. À cette première équipe vinrent s’ajouter Daniel-Rops, R. Dupuis, J. Naville, J. Jardin, Denis de Rougemont, G. Rey, Claude Chevalley, A. de Chauron, L. Deschizeau, R. Kiefe, P.O. Lapie, P. Mardrus, A. Poncet, etc. Le groupe travailla avec les revues Mouvements, Plans, un certain nombre de personnalités proches de G. Valois ou de G. Sorel, André Philip, Le Corbusier, et en liaison avec les polytechniciens d’« X Crise ».
En 1934, C. de Gaulle émet le désir de rencontrer les membres de l’Ordre nouveau par l’intermédiaire de Daniel Halévy ou du colonel Mayer (17). Les détails concernant les deux réunions de l’Ordre nouveau fréquentées par C. de Gaulle nous ont été donnés, sous toutes réserves, par M. A. Marc qui n’a pas conservé d’archives. Les dates en seraient décembre 1934 et/ou janvier 1935. La première aurait eu lieu dans l’appartement de Daniel Halévy. C. de Gaulle aurait évoqué ses conceptions en matière de défense et esquissé une vision de la future guerre mondiale, allant jusqu’à préciser des détails étonnants, comme l’heure de l’attaque allemande... Il se serait par ailleurs vivement intéressé aux conceptions fédéralistes et européennes de l’Ordre nouveau.
À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, l’Ordre nouveau adressera à tous les parlementaires un document pour dénoncer l’aggravation de la situation et l’impréparation de la France pour faire face à la guerre moderne. Le texte faisait expressément référence au général de Gaulle et à ses thèses.
La réalité de ces rencontres est attestée par Robert Aron (18) dans son Charles de Gaulle paru en 1964 à la Librairie académique Perrin : « ... Malgré la considération qui entoure notre équipe où se trouvent Denis de Rougemont, Daniel-Rops, A. Marc, Jean Chauveau... Malgré l’attention que portent les jeunes aux travaux de notre revue, malencontreusement dénommée Ordre nouveau... Nous ne faisions pas le poids. C’est donc lui qui va parler : le commandeur s’animait, dit et répète ce qu’à l’époque il répétait inlassablement... Il faut des tanks à la France, il faut des divisions blindées, il faut une conception de la guerre qui puisse les utiliser pour percer le front ennemi et percer ses arrières... ».
Robert Aron rapporte aussi que les membres de l’Ordre nouveau furent tout de suite informés de la première rencontre entre C. de Gaulle, Albert Ollivier et lui-même. Henri Lauga en fait la relation suivante : « Vous êtes entré et vous avez dit que grâce à Daniel Halévy, vous veniez de faire la connaissance d’un colonel de Gaulle, qui vous avait fortement impressionné par une ampleur de vue extrêmement rare en matière d’armée et de politique. Vous avez ajouté que, sur le plan social, il vous paraissait extrêmement en avance sur ses contemporains... » (p. 43, cité par R. Aron).
Le procès d’une civilisation
Un des points de départ de l’Ordre nouveau fut : « ni droite ni gauche », et le groupe respecta cette règle, même s’il fut ouvert aux courants non conformistes de la droite et de la gauche. Ses membres se présentaient comme « traditionalistes mais non conservateurs, réalistes mais non opportunistes, révolutionnaires mais non révoltés, constructeurs mais non destructeurs, ni bellicistes ni pacifistes, patriotes mais non nationalistes, socialistes mais non matérialistes, personnalistes mais non anarchistes, humains mais non humanitaires (19) ». Leur analyse partait de la crise de civilisation au cœur de la « décadence de la nation française » (20), que J.-L. Loubel del Bayle résume ainsi : « Un rationalisme desséché, écrasant toute spontanéité vitale et affective, des idéologies qui méconnaissaient radicalement le réel, telles leur semblaient être les causes profondes du mal dont souffrait la France... ».
En 1931, ils firent paraître Le Cancer américain (21), procès d’une civilisation dominée par l’économie, où l’homme se réduit à ses fonctions de production et de consommation. Leur dénonciation visait « la tentation de l’Amérique », telle que Daniel-Rops l’exprimait dans son ouvrage Le Monde sans âme : « l’acceptation d’un mode de vie où la quantité prime la qualité, où la satisfaction matérielle dicte à l’individu sa conduite, où l’esprit n’a pas d’autre tâche que de justifier l’exigence de confort et de l’accroître par un optimisme de commande ». L’Ordre nouveau se réclame du personnalisme dans un manifeste de novembre 1931 et précise que cela implique des conséquences philosophiques, économiques et politiques.
Philosophiquement, c’est la rupture aussi bien avec l’individualisme abstrait des libéraux qu’avec toute doctrine plaçant l’État, quelle qu’en soit la forme, au rang de valeur suprême. L’Ordre nouveau se prononce donc pour une « révolution » au-delà du capitalisme, du marxisme et du fascisme.
Dans le domaine économique, il s’agit de subordonner la production à la consommation et de pourvoir au remplacement d’un système qui soumet l’œuvre qualitative et créative de valeurs nouvelles au travail parcellaire et indifférencié. Pour eux, en effet, « le travail n’est pas une fin en soi (22) ».
La question des institutions a également été évoquée. Les membres de l’Ordre nouveau, et notamment A. Marc, se défient de l’État, mais réclament en même temps dans leurs manifestes un pouvoir fort : « Un pouvoir sain ne peut être que fort et limité. » L’autre idée de base est la représentation des communes et des groupements professionnels au sein d’une série de conseils (suprême, administratif, économique, assez proche d’un conseil économique et social ou d’un sénat à base professionnelle). Il faut noter qu’une des raisons de création de ces conseils réside dans un désir de démocratie directe et un sentiment de défiance à l’égard des parlements traditionnels.
L’Ordre nouveau, enfin, rejette aussi bien la propriété économique libérale que la propriété étatique marxiste. Ses vœux se portent vers un mode d’organisation où les moyens de production seraient la propriété commune des différents associés de l’entreprise : entrepreneurs, ingénieurs, ouvriers. Les rémunérations comporteraient – outre un minimum vital garanti – une participation aux bénéfices. L’économie, enfin, comprendrait à la fois un secteur libre et un secteur soumis à la planification.
Il n’est nul besoin de multiplier les citations de C. de Gaulle pour constater une nette convergence des thèmes sur les plans philosophique, économique et institutionnel. Jean-Louis Loubet del Bayle constate également que « ... le Rassemblement du peuple français, créé en 1949 par le général de Gaulle, ne fut pas lui non plus, quoique d’une manière plus vague et plus imprécise, sans emprunter à certaines thèses des années 1930... » (23). Le RPF compta d’ailleurs dans ses cercles dirigeants deux anciens collaborateurs de l’Ordre nouveau : Jean Chauveau (Xavier de Lignac) et Albert Ollivier (24). Ainsi, une partie du personnel politique de la Ve République est, peu ou prou, tributaire de « l’esprit des années 30 » et il semble que Raoul Girardet n’ait pas tout à fait tort d’estimer « qu’une partie de l’idéologie du pouvoir se nourrit d’un certain nombre de [ses] thèmes » (25).
L’esprit des années 30
La rencontre entre le personnalisme de l’Ordre nouveau et la pensée gaullienne peut s’expliquer de différentes façons.
L’Ordre nouveau se réclame de Péguy, Proudhon, Bergson et Barrès (26), c’est-à-dire de penseurs ayant largement inspiré le général de Gaulle. L’Ordre nouveau et les autres mouvements non conformistes comme Esprit sont largement issus d’un effort de recherche des milieux intellectuels catholiques, même si beaucoup d’entre eux (27) ne se réclament pas d’une religion et si l’adhésion à ces groupes ne nécessite la reconnaissance d’aucun dogme religieux.
C. de Gaulle, sympathisant du Sillon de Marc Sangnier, participa à des réunions et à des colloques de la Jeune République (28). Il écrivit dans L’Aube. Il fut ensuite un des abonnés de la revue chrétienne de gauche Sept, où A. Marc tenait la rubrique politique sous le pseudonyme de Scrutator. Il fit également partie des Amis de Temps présent, hebdomadaire de même tendance lancé par A. Marc. Nous avons pu, grâce à ce dernier, avoir confirmation des relations entretenues par l’Ordre nouveau avec les « non-conformistes » allemands et certains partisans du national-bolchevisme. De Gaulle a très bien pu prendre connaissance des organisations et de leurs thèses, soit dans la revue L’Ordre nouveau, soit dans le livre qu’A. Marc et R. Dupuis ont consacré à divers mouvements de jeunesse sous le titre Jeune Europe (30).
A. Marc et certains de ses amis avaient même mis au point un plan de contrebande d’armes destinées à ceux qui, en Allemagne, avaient décidé de mener une résistance armée contre Hitler. Il s’agissait pour l’essentiel du Front noir. Une réunion fut organisée en 1931, à Paris, vraisemblablement dans l’appartement de Pierre-Olivier Lapie, avec son principal dirigeant, Otto Strasser. Son caractère de dissident de trop fraîche date du national-socialisme empêcha cependant tout accord avec l’Ordre nouveau (31). Un des éléments constitutifs du Front noir était le groupe Die Tat (L’Action) (32), qui intéressait beaucoup A. Marc et l’Ordre nouveau. Die Tat était marqué d’une tendance spiritualiste et religieuse d’origine protestante, et cela l’écartait du national-socialisme.
Ses théoriciens, E. Rosenstock, Carl Schmitt, Hans Zehrer, Leopold Dingräve et surtout l’économiste Ferdinand Fried, étaient partisans d’une sorte de communisme national (33), rejetant à la fois le « libéralisme périmé » et les césarismes fasciste ou bolchevique. Ordre nouveau eut enfin des contacts suivis avec le mouvement « Gegner » (Les Adversaires) (34) dont le dirigeant était Harro Schulze Boysen, futur dirigeant du plus important réseau de résistance allemande, membre de l’Orchestre rouge », et qui mourra décapité par les nazis.
Là s’arrête la description du réseau de relations qui associe Charles de Gaulle aux groupes des années 30.
Robert Aron nota en 1964, dans l’ouvrage consacré au général et à propos de sa conviction ancienne que son arrivée au pouvoir porterait aussi les idées de l’Ordre nouveau : « J’en suis moins convaincu aujourd’hui. » Certes, en 1963-1964, les idées sociales du gaullisme, participation, régionalisation, avaient été peu ou prou mises sous le boisseau. Mais il avait toujours existé des divergences entre le général de Gaulle et les personnalistes de l’Ordre nouveau. Notamment si l’ensemble constitutionnel prévu par l’O.N., avec sa hiérarchie fédérative et proudhonienne, était trop vague pour constituer une zone sérieuse de désaccord avec de Gaulle, dont les idées étaient peu fixées en cette matière, surtout à cette époque (35).
En revanche, une question devait éloigner beaucoup d’anciens membres de l’Ordre nouveau du général de Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale : celle du fédéralisme européen. A. Marc et Robert Aron furent en effet les fondateurs de la Fédération et du Mouvement fédéraliste européen. Le contentieux allait s’alourdir au congrès de La Haye en 1948 et aux propos du général de Gaulle sur les « cabris », en passant par la Communauté européenne de défense. A. Marc nous a précisé, à ce sujet, que le général de Gaulle ne lui avait pas tenu rigueur de ses articles des années 50 et 60. Il aurait même empêché, en 1962, que l’on ne supprime les crédits du Centre international de formation européenne, dirigé par A. Marc à Nice et dont les thèses étaient pourtant très éloignées des siennes.
L’influence de « l’esprit des années 30 » apparaît donc important sur la formation de la pensée politique gaullienne. Ce type de recherche d’influences possède bien entendu ses limites. Il n’en reste pas moins que nous pouvons estimer que de Gaulle a pu élaborer une ébauche de doctrine politique qui va dans le même sens que celle des personnalistes, notamment dans la volonté de dépasser la droite et la gauche et d’intégrer dans la démocratie même la critique de la démocratie, celle de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. En cela, il a su dépasser un patriotisme traditionnel et a permis plus tard, sous la Ve République, d’opérer l’entrée de la France dans le monde moderne.
► Pascal Sigoda, article tiré de la revue fédéraliste L’Europe en formation n° 301, été 1996. Texte extrait de Charles de Gaulle, un non-conformiste parmi les siens (les intertitres sont de la rédaction).
◘ Notes :
1. Suivant le titre du livre de Daniel-Rops, Éd. du siècle, 1932, qui leur est consacré.
2. À ce sujet, voir : « Ernst Jünger et le National Bolchevisme », L. Dupeux, Magazine littéraire n° 130 (dossier Jünger), nov. 1977 ;
– Stratégie communiste et dynamique conservatrice, L. Dupeux, thèse, diffusion H. Champion, 1976, 626 p., 2 vol. ;
– Doctrinaires de la révolution allemande (1918-1938), Edmont Vermeil, éd. F. Sorlot, 1938, 391 p. ;
– La Révolution du nihilisme, H. Rauschning, Gal., 1938 ;
– Hitler m’a dit, H. Rauschning, Pluriel poche, 1979, 384 p. (1ère édit.1940) ;
– Le Front noir contre Hitler, Otto Strasser, Victor Alexandrov, Marabout, 1969, 305 p.
– Langages totalitaires, Jean-Pierre Faye, La Raison critique de l’économie narrative, Hermann, 1980, 784 p.
3. « La contrepartie positive de l’anarchiste, c’est l’Anarque. Celui-ci n’est pas le partenaire du monarque mais son antipode, l’homme que le puissant n’arrive pas à saisir, bien que lui aussi soit dangereux. Il n’est pas l’adversaire du monarque mais son pendant » (entretien avec Marcel Jullian). Consulté, E. Jünger ne nous a pas répondu sur la question d’éventuels liens entre sa pensée et celle de Charles de Gaulle. Il est vrai que toute question relative à la « Révolution conservatrice » s’est considérablement obscurcie depuis une dizaine d’années. Cette ligne politique est, en effet, utilisée par le néo-fascisme comme plus « présentable ».
4. « Le député national-allemand Paul Eltzbacher appelle ses compatriotes à se placer en toute honnêteté sur le terrain du bolchevisme pour échapper à "l’esclavage" promis par le futur traité de paix, mais aussi pour parvenir à une reconstruction complète de l’État », L. Dupeux (se référer à la note 2).
5. C'est un des points qui rapprochent le national-bolchevisme et le fascisme italien. Le Manifeste du futurisme dû à Filippo Tommaso Marinetti, publié en français dans Le Figaro du 20 février 1909, est prémonitoire à cet égard : « Nous affirmons que la magnificence du monde s’est enrichie d’une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course, le capot entouré de gros tubes semblables à des serpents au souffle explosif..., une automobile rugissante qui semble courir sur la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace... ».
6. « Il y a là une réalité politique et affective, aussi ancienne que nos deux pays, qui tient à leur histoire et à leur géographie, au fait qu’aucun grief fondamental ne les opposa jamais... », discours à Moscou, 20 juin 1966.
7. 10 mai 1924, voir exposition « Le Fil de l’épée », Musée de l’Ordre de la libération, avril-juin 1983, Plon (catalogue).
8. L’Allemagne et le général de Gaulle (1924-1970), J. Binoche, l’Appel, Plon, 1975, 227 p.
9. Suivant le titre de l’ouvrage de J.-L. Loubet del Bayle, Le Seuil, 1969, 495 p.
10. Sur l’Ordre nouveau, voir notamment Lipiansky (E.), « L’Ordre nouveau (1930-1938) » dans l’ouvrage Ordre et démocratie, PUF, 1967.
11. À ce sujet, voir :
– « Les sources de la pensée sociale du général de Gaulle », 1890-1914, Études gaulliennes n° 7/8, 1974 ;
– « Les sources de la pensée sociale du général de Gaulle », Pascal Sigoda, Mémoire D.E.S. Paris II, 1977, 146 p. ;
– « De Gaulle et le gaullisme », F.-G. Dreyfus, Les Sources de la pensée gaullienne, Plon, p. 55 à 65.
12. Sur cette période, voir :
– Charles de Gaulle, général de France, Lucien Nachin, Éd. Colbert, 1944, 124 p. ;
– Hommage à Lucien Nachin, Berger-Levrault, 1951 ;
– De Gaulle, Jean Aubertin, Seghers, 1966, 190 p. ;
– De Gaulle, J. Lacouture, Le Seuil, 1965, 188 p. ;
– Mon général, Olivier Guichard, Grasset, 1980 ;
– Lettres et carnets (1919-juin 1940), C. de Gaulle, Plon, 1970.
13. Sur ce dernier :
– « Le colonel Mayer et son cercle d’amis », Henri Lerner, Revue historique, 1966, p. 75-94.
14. De Gaulle, Le Seuil, p. 38.
15. Celui-ci publiera plus tard La France et son armée, dans la collection qu’il dirige chez Plon après 1935. Le colonel Mayer assurera la correction des épreuves de ce livre.
16. Ouvrage cité (p. 79).
17. Entrevue avec Alexandre Marc, le 26 février 1983.
18. Il n’a pas été possible de trouver d’autres témoins. P.O. Lapie et Louis Joxe, qui auraient pu disposer d’informations, n’ont pu nous donner de confirmation.
19. P. Andreu, La Nation française, n° 336, cité par J.-L. Loubet del Bayle.
20. Titre du premier ouvrage dû aux réflexions de l’Ordre nouveau, Robert Aron et Arnaud Dandieu, 1931, Éd. Rieder.
22. Éditions Rieder.
22. – Revue Plans, n° 7, juillet 1931, p. 6 ;
– Dans Les chênes qu’on abat, Malraux fait dire à de Gaulle : « Le travail n’est pas la vie. »
23. Œuvre citée, p. 420.
24. Proches des « non-conformistes », nous retrouvons aussi François Perroux, P.O. Lapie, André Philip, Louis Vallon, Le Corbusier, Louis Terrenoire...
25. « Tendances politiques dans la vie française depuis 1789 », p. 131.
26. On peut également noter à un moindre degré les influences de Sorel, Nietzsche et Maurras.
27. Arnaud Dandieu et Alexandre Marc ne deviendront catholiques qu’après la formation de l’Ordre nouveau.
28. À ce sujet, voir :
– Jamais dit, Raymond Tournoux (témoignage de Joseph Folliet), Plon, 1971.
– « Les sources de la pensée sociale de Charles de Gaulle », Études gaulliennes n° 7/8, 1975.
29. – Sept, Aline Coutrot, éd. Cana, 1982.
– Temps présent (1937-1947), un hebdomadaire d’inspiration chrétienne, Maurice Neyme, Mémoire de sciences politiques, Lyon, 1970.
30. Paris, Plon, 1933.
31. Et amena des difficultés avec Esprit.
32. Voir Les Doctrinaires de la révolution allemande (déjà cité), E. Vermeil, p. 175-220.
33. « Pour un communisme national », Alexandre Marc, La Revue d’Allemagne, 15 oct. 1932.
34. « Les Adversaires », Alexandre Marc, La Revue d’Allemagne, 5 avril 1933.
35. Selon un témoignage recueilli, le général de Gaulle aurait effectué, après la Deuxième Guerre mondiale, quelques recherches dans le domaine constitutionnel et demandé des conseils bibliographiques à René Capitant, qui l’aurait orienté not. vers Rousseau, Carré de Malberg, etc.
• Pour approfondir : Révolution conservatrice allemande / non-conformistes des années 30 français... Que peut-nous apprendre une analyse comparative ? C'est cet exercice ardu que tente l'ouvrage collectif dirigé par Gilbert Merlio, publié en 1995 par la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine et intitulé : Ni gauche, ni droite : les chassés-croisés idéologiques des intellectuels français et allemands dans l'Entre-deux-guerres (24 €, 314 p.). La préface de Gilbert Merlio et la conclusion de Hans Manfred Bock abordent précisément cette question de la comparaison de ces 2 constellations idéologiques. Et les convergences identifiées sont nombreuses : idéologie de la crise, communauté des refus, recherche d'une autre modernité...
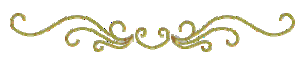
De Gaulle, visionnaire de l'Europe

À l'heure où les sirènes de l'atlantisme redonnent de la voix et où la France se laisse gagner par l'hystérie anti-allemande, il n'est pas inutile de retrouver le fil de la pensée gaullienne. Face à l'hégémonie américaine, De Gaulle s'est fait le champion de l'indépendance nationale. À l'européisme technocratique et marchand il a préféré l'amitié franco-allemande. Et il fut l'un des premiers à percevoir que le communisme n'avait pas réussi à briser l'âme des peuples.
Contre vents et marées, De Gaulle a soutenu une vision européenne de l'Europe. Face à l'atlantisme dominant, il s'est fait le champion de l'indépendance nationale et de la continentalité de l'Europe. Face à l'européisme technocratique et marchand, il a affirmé la permanence des peuples et le primat du politique. Seul ou presque, il a contesté l'ordre bipolaire instauré à Yalta. En appelant de ses vœux « l'Europe de l'Atlantique à l'Oural », il a non seulement refusé l'hémiplégie du statu quo, mais permis nos retrouvailles avec la totalité de l'espace européen. Par un détour en apparence étrange, le centième anniversaire de sa naissance lui donne raison, car il coïncide avec le dégel de l'Est européen. À l'heure où les sirènes de l'atlantisme redonnent de la voix, ajoutant à la confusion engendrée par une classe politico-médiatique française qui se laisse gagner par l'hystérie anti-allemande et la peur d'une Europe en mouvement, il convient de retrouver le fil de la pensée gaullienne (1).
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe aspire, comme l'a noté Paul Valéry, à être administrée par les États-Unis. De Gaulle est parmi les premiers à proposer qu'elle s'organise elle-même. Alors que le réflexe de nombreux dirigeants français est de chercher à vivre sur le dos du vaincu, il plaide pour le rapprochement franco-allemand. Dès septembre 1949, il déclare à Bordeaux : « L'homme de bon sens voit les Allemands là où ils sont, c'est-à-dire au centre de notre continent. Il les voit tels qu'ils sont, c'est-à-dire nombreux, disciplinés, dynamiques, dotés par la nature et par leur travail d'un très grand potentiel économique, largement pourvus de charbon, équipés pour la grande production malgré les ruines et les démantèlements, aptes à s'élever jusqu'au sommet de la pensée, de la science et de l'art, dès lors qu'ils cessent d'être dévoyés par la rage des conquêtes ». Il voit aussi l'Europe amputée par la domination soviétique d'une part très vaste et très précieuse d'elle-même. Il voit encore l'Angleterre s'éloigner, attirée par la masse d'Outre-Atlantique. Il en conclut que l'unité de l'Europe doit, si possible, et malgré tout, « incorporer les Allemands ».
De Gaulle connaît l'Allemagne. Au cours de la Grande Guerre, sa captivité de 32 mois l'a conduit de Stettin à Rosemburg, de Friedberg à Magdebourg, de Ludwigshaffen à Ingolstadt. C'est dans ce fort de Bavière où il se lie d'amitié avec Toukhatchevski, qu'il lit les journaux allemands et rédige les notes qui serviront à préparer La discorde chez l'ennemi, un essai entièrement consacré à l'Allemagne et aux causes de sa défaite. Il a lu Nietzsche, mais aussi les auteurs de la Konservative Revolution comme Spengler (2). Il a participé à l'occupation de la Rhénanie. Il a été en garnison dans les villes édifiées à proximité de ce qui fut le limes : Mayence sur le Rhin et, surtout, Trèves sur la Moselle, l'une des plus vieilles cités allemandes dont les vestiges remontent au temps où elle était la capitale de Constantin et des empereurs gaulois. Il parle déjà des Germains et des Gaulois. Chez lui, l'admiration se mêle au réalisme. L'homme de guerre sait lire une carte : la centralité de l'Allemagne ne lui échappe pas. Le politique mesure le parti que la France peut tirer d'une Allemagne à la souveraineté limitée. Seule la France et l'Allemagne peuvent briser l'ordre bipolaire instauré à Yalta.
Venant de Mourmelon où ils ont passé en revue une division blindée française et une division blindée allemande, Konrad Adenauer et Charles De Gaulle arrivent à la cathédrale de Reims, le 8 juillet 1962. En ce haut lieu de la dynastie capétienne, où la France se souvient de ses origines franques, la présence des deux hommes d'État prend valeur de symbole.
Quinze rencontres De Gaulle-Adenauer
Revenu au pouvoir pour rendre à la France son rang, De Gaulle surprend en recevant chez lui, à La Boisserie, dès septembre 1958, Konrad Adenauer qui a souhaité le mieux connaître. Le chancelier allemand est l'ami de Robert Schuman et d'Alcide de Gasperi, sans lesquels Monnet n'aurait pu mener à bien ses projets. En charge d'un État organisé sur des bases voulues par les Alliés occidentaux, il ne partage pas l'hostilité du Général pour la supranationalité, encore moins sa défiance pour l'hégémonie américaine. Il sait que De Gaulle et ses partisans se sont opposés au projet d'une Communauté européenne de défense (CED) qui prévoyait la mise sur pied d'une armée européenne supranationale sous commandement américain. Il soupçonne son hôte de nationalisme étroit. Dissemblables par leurs origines et leurs passés, les deux hommes appartiennent tous deux à l'espace lotharingien. Ils se comprennent d'emblée. Au terme de leur rencontre de deux jours, un communiqué indique : « Nous croyons que ce doit en être fini à jamais de l'hostilité d'autrefois et que Français et Allemands sont appelés à vivre d'accord et à travailler côte à côte ».
« Le premier contact est si bon, note Alfred Grosser, que 14 autres rencontres suivront, la dernière en septembre 1963, à un mois du moment où, à 87 ans, l'interlocuteur allemand quittera le pouvoir exercé depuis 1949 » (3). De Gaulle et Adenauer se verront le plus souvent à Paris, Marly et Rambouillet, ou à Baden-Baden et Bonn. Dans ses Mémoires, De Gaulle précisera : « Nous nous entretiendrons plus de cent heures, ou en tête-à-tête, ou aux côtés de nos ministres ou en compagnie de nos familles (...) Plus tard et jusqu'à la mort de mon illustre ami, nos relations se poursuivront suivant le même rythme et avec la même cordialité. En somme, tout ce qui aura été dit, écrit et manifesté entre nous n'aura fait que développer et adapter aux événements l'accord de bonne foi conclu en 1958. Certes, des divergences apparaîtront à mesure des circonstances. Mais elles seront toujours surmontées » (4).
De Gaulle, qui s'est employé à débarrasser la France de la sanglante épine algérienne, entend qu'elle puisse jouer son rôle dans le monde et dans l'unité européenne. Parce qu'il a le sens de l'espace, il affirme le primat de la politique extérieure. Hostile à la supranationalité des « aréopages » et du « volapük », ce qui scandalisera la composante atlantiste de son gouvernement, il se déclare partisan de l'Europe des « réalités », c'est-à-dire de l'Europe des peuples et des États. Dans cette perspective, il mise sur le couple France-Allemagne dont il entend faire le « môle de puissance et de prospérité » d'une « Europe européenne ».
Lors de sa première rencontre avec Adenauer en qui il va apprécier le Rhénan, De Gaulle a clairement posé ses conditions : que l'Allemagne sache patienter pour sa réunification, qu'elle se garde de marquer une trop forte hostilité à l'Union soviétique, qu'elle renonce à l'armement atomique et, en même temps, à la révision des frontières que la guerre lui a imposées. En échange, il assure Adenauer de son soutien. Il va tenir parole face à Khrouchtchev, qui accuse l'Allemagne fédérale de « militarisme ». Il va encourager John F. Kennedy à la fermeté lors de la crise de 1961 qui voit Moscou revendiquer la totalité du contrôle de Berlin.
 « De la solidarité entre l'Allemagne et la France dépend le destin de l'Europe tout entière depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural », tient-il à souligner le 15 mai 1962, lors d'une conférence de presse qui lui permet de redire avec force son hostilité à une supranationalité qui favoriserait l'hégémonie américaine. Un mois plus tard, il offre au chancelier allemand un voyage officiel d'une particulière solennité. Du 2 au 8 juillet, Adenauer est reçu « avec honneur et joie ». Une imposante cérémonie militaire a lieu au camp de Mourmelon où, tous deux, « debout côte à côte dans une voiture de commandement, passent en revue une division blindée française et une division blindée allemande qui font assaut de belle tenue » (5). Dans la nef de la cathédrale de Reims, haut lieu de la dynastie capétienne où la France se souvient de ses origines franques, la présence des deux hommes d'État prend valeur de symbole. Pour De Gaulle, la réconciliation franco-allemande est un acte fondateur.
« De la solidarité entre l'Allemagne et la France dépend le destin de l'Europe tout entière depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural », tient-il à souligner le 15 mai 1962, lors d'une conférence de presse qui lui permet de redire avec force son hostilité à une supranationalité qui favoriserait l'hégémonie américaine. Un mois plus tard, il offre au chancelier allemand un voyage officiel d'une particulière solennité. Du 2 au 8 juillet, Adenauer est reçu « avec honneur et joie ». Une imposante cérémonie militaire a lieu au camp de Mourmelon où, tous deux, « debout côte à côte dans une voiture de commandement, passent en revue une division blindée française et une division blindée allemande qui font assaut de belle tenue » (5). Dans la nef de la cathédrale de Reims, haut lieu de la dynastie capétienne où la France se souvient de ses origines franques, la présence des deux hommes d'État prend valeur de symbole. Pour De Gaulle, la réconciliation franco-allemande est un acte fondateur.
Quelques semaines plus tard, du 4 au 9 septembre, c'est le voyage triomphal du Général en Allemagne fédérale. De Gaulle parle en allemand à Bonn, du balcon de l'hôtel de ville, à Duisbourg devant les ouvriers de Thyssen. Le 7 septembre, il surprend en célébrant les vertus militaires allemandes à Hambourg, devant les élèves officiers de la Bundeswehr. De Gaulle, qui s'est découvert un ancêtre allemand, car il entend marquer la fraternité entre les deux peuples, se dira « touché jusqu'au tréfonds de [son] âme par les ovations allemandes ». Le Spiegel s'exclame : « De Gaulle est venu en Allemagne comme président des Français. Il repart en empereur d'Europe ».
Au terme de ce voyage qui a soulevé l'enthousiasme des Allemands et étonné quelque peu les Français, le communiqué officiel annonce que des « dispositions pratiques seront prises par les deux gouvernements pour resserrer effectivement les liens qui existent déjà dans un grand nombre de domaines ». Le 14 janvier 1963, au cours d'une conférence de presse où il commente la rupture des négociations avec la Grande-Bretagne et décline les propositions de Kennedy de créer, avec les Anglais, une force nucléaire multilatérale sous commandement américain, De Gaulle annonce la conclusion prochaine d'un traité de coopération franco-allemand. Avec cette formule : « Les Germains et les Gaulois constatent qu'ils sont solidaires ».
Le traité franco-allemand est signé solennellement le 22 janvier à l'Élysée. Pour la circonstance, De Gaulle, que l'on sait avare d'effusions, embrasse les joues ridées du vieux chancelier allemand. Le traité, qui instaure notamment l'Office franco-allemand de la jeunesse, reprend surtout les principes du Plan Fouchet qui, proposant une « Union politique des États », a été refusé par les Cinq. Il prévoit leur mise en œuvre bilatérale, avec des consultations régulières : les chefs d'État et de gouvernement se réuniront « en principe au moins deux fois par an », les ministres des Affaires étrangères « au moins tous les trois mois », tandis que « des réunions régulières entre autorités responsables des deux pays dans les domaines de la défense, de l'éducation et de la jeunesse » se feront à un rythme bimestriel.
Tant en France qu'en Europe, les critiques s'élèvent. De Gaulle est accusé de vouloir instaurer un « condominium franco-allemand » et de torpiller la « construction » européenne. Le camp atlantiste dont L'Aurore est alors l'une des voix, s'inquiète surtout de l'ombrage que Washington pourrait prendre de l'émergence de cette ossature d'« Europe européenne », troisième force entre les États-Unis et l'URSS. Le veto de la France à l'adhésion anglaise, mais aussi la tension entre Américains et Soviétiques, vont inciter les Allemands à prendre leurs distances avec l'Europe gaullienne.
Ils le feront par le biais d'un « long préambule », à tonalité explicitement atlantiste, adopté le 8 mai 1963, lors de la ratification du traité franco-allemand par le Bundestag. Certes, les formes seront respectées : les 4 et 5 juillet à Bonn, les entretiens De Gaulle-Adenauer inaugurent la première des consultations régulières prévues par le traité. Malgré les divergences, l'amitié entre les deux signataires subsiste : Adenauer, qui va démissionner en octobre, effectue à la fin septembre sa visite d'adieu au Général. Mais le grand dessein gaullien d'une Europe fondée sur l'appui allemand à la politique française, débouche sur un demi-échec. Le poids de Washington a été plus fort.
En 1962, Jean-Jacques Servan-Schreiber se fait le porte-parole des milieux atlantistes pour accuser De Gaulle « d'œuvrer à l'isolement de la France ». Les adversaires du Général voient dans l'amitié franco-allemande un obstacle à l'idée qu'ils se font de la construction européenne. En Ludwig Ehrard (ci-dessus) [1897-1977, considéré comme le "père" de l'économie sociale de marché], qui succède à Adenauer en octobre 1963. De Gaulle discerne « le courtier des États-Unis ». De fait, Bonn ne cessera alors de resserrer ses liens avec Washington.
L'Europe de l'Atlantique à l'Oural
En Ludwig Ehrard, l'homme du « miracle économique », qui succède à Adenauer le 16 octobre, De Gaulle voir le « courtier » des États-Unis. Entre Paris et Bonn, la lune de miel est terminée et les incompréhensions se multiplient. De Gaulle en prend acte bientôt : « Ce n'est pas notre fait si les liens préférentiels, contractés en dehors de nous et sans cesse resserrés par Bonn et Washington, ont privé d'inspiration et de subsistance cet accord franco-allemand... Ils appliquaient non pas notre traité bilatéral, mais le préambule unilatéral qui en changeait le sens ».
Adenauer disparaît en avril 1967. Deux ans plus tard, De Gaulle se retire à Colombey. L'effet de leurs actes et de leurs paroles sur les esprits et les comportements sera mesuré par le temps. Tandis que le rapprochement des deux peuples deviendra plus que tangible, l'illustre couple fondateur servira périodiquement de modèles aux dirigeants des deux États. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, François Mitterand et Helmut Kohl, chacun à leur façon, mettront leurs pas dans l'empreinte laissée par De Gaulle et Adenauer.
« Nous croyons bon que notre continent organise lui-même, d'un bout à l'autre de son territoire, la détente, l'entente et la coopération », a déclaré De Gaulle en octobre 1966. La réconciliation franco-allemande s'inscrit dans une perspective plus large qui est, non seulement de transformer les rapports de sujétion à l'égard des États-Unis, mais aussi de remplacer les deux alliances militaires qui se disputent l'Europe par un système de sécurité paneuropéen (6). Dans la logique gaullienne, l'affirmation de la continentalité de l'Europe passe par le refus des blocs et le dépassement de la « guerre froide ».
« Il s'agit que l'Europe, mère de la civilisation moderne, s'établisse de l'Atlantique à l'Oural dans la concorde et dans la coopération en vue du développement de ses immenses ressources et de manière à jouer, conjointement avec l'Amérique, sa fille, le rôle qui lui revient quant au progrès de deux milliards d'hommes qui en ont terriblement besoin ». Cette longue phrase, prononcée au cours d'une conférence de presse donnée le 4 février 1965, ne dévoile qu'une partie du dessein. Pourtant, elle est aussitôt interprétée comme le signe d'un renversement des alliances. Elle suscite l'ire du clan atlantiste qui domine alors l'échiquier politique français. Pour l'extrême droite où certains considèrent De Gaulle comme « l'agent de Moscou », elle constitue une sorte de preuve par neuf.
Cinq ans plus tôt, le Général a reçu Nikita Khrouchtchev à Paris. C'est durant le séjour du numéro un soviétique que la France a expérimenté sa deuxième bombe nucléaire. Un an plus tôt, De Gaulle a reconnu la Chine populaire, en expliquant que « le monolithisme du monde totalitaire est en train de se disloquer » (7). Un an plus tard, il s'est rendu en URSS et a écrit, au préalable, à Lyndon B. Johnson pour lui signifier le retrait de la France de l'organisation militaire de l'OTAN.
« De l'Atlantique à l'Oural » : la formule est une constante de la vision gaullienne. Elle ne date pas de la Ve République. De Gaulle l'utilise bien avant : pour la première fois, semble t-il, au cours d'une conférence de presse tenue le 16 mars 1950 (8). Il va l'employer ensuite à de très nombreuses occasions, tant en sa qualité de chef du RPF qu'après son retour au pouvoir en 1958. Dix ans plus tard, lors de sa visite à la Roumanie de Ceausescu, alors modèle des actions futures qui connaîtront nouvelle fois, en l'associant à une apologie de l'« indépendance nationale ».
De Gaulle sur la passerelle du « De Grasse » le 12 septembre 1966, lors d'un essai nucléaire dans le Pacifique. C'est parce qu'il refuse la tutelle américaine qu'il a voulu doter la France de l'arme nucléaire et d'une Défense indépendante. Un grand dessein dont ses successeurs ou « héritiers » ne sont pas toujours à la hauteur.
« Sous la dictature, il y a toujours la Russie »
Qu'importe si l'Oural ne marque pas véritablement la césure entre l'Europe et l'Asie, l'invocation de cette limite signifie un refus et un choix. Son refus porte sur « la double hégémonie convenue entre les deux grands rivaux » (octobre 1966) et sur l'impossible oubli de « l'énorme morceau d'Europe que les accords de Yalta abandonnaient par avance au Soviets » (9). Lui qui parle de « l'Europe des réalités », préfère s'en tenir à la traditionnelle frontière des atlas et des manuels de géographie de sa jeunesse. Lui qui a misé sur l'alliance avec Staline lors du dernier conflit mondial, croit aux héritages historiques, à l'alliance franco-russe comme à l'amitié franco-polonaise. Lecteur de l'amiral Castex (10), il tient la Russie pour européenne, parle de la « Russie soviétique » plutôt que de l'URSS. Il n'ignore rien du totalitarisme communiste, mais refuse de négliger l'éternelle Russie qui se cache derrière les dogmes, les slogans et les appareils : « À mon sens, ce qui au fond domine surtout dans le comportement de Moscou, c'est le fait russe au moins autant que le fait communiste » (11).
Significatifs sont les mots que De Gaulle utilise pour accueillir Khrouchtchev, le 23 mars 1960 : « La Russie et la France ont eu besoin de se voir. Je 34 dis bien la Russie et la France ont eu besoin de se voir. Je dis bien la Russie et la France. C'est bien d'elles deux en effet qu'il s'agit ». Cette même logique caractérise le discours que De Gaulle va tenir tout au long d'un séjour qui lui permettra d'admirer la métropole sibérienne de Novosibirsk, de découvrir à la fois Akademgorod, la cité des savants, et le cosmodrome de Baïkonour. À Léningrad, il citera en russe des vers de Pouchkine. À Kiev, il évoquera Anne de France, la fille de Yaroslav le Sage qui devint l'épouse d'Henri II, et saluera le rôle de la vieille cité « dans la dure et dramatique fondation de la grande Russie ». Le 30 juin, avant son départ, il dira devant la télévision soviétique : « La visite que j'achève de faire à votre pays, c'est une visite que la France de toujours rend à la Russie de toujours ».
La vision gaullienne est celle d'un homme convaincu de l'importance de l'histoire et de la persistance des peuples. Volontiers pédagogue, il expliquera au général Eisenhower que « les rapports entre l'Ouest et l'Est ne doivent pas être traités sous le seul angle de la rivalité des idéologies et des régimes. Certes, le communisme pèse très lourd dans l'actuelle tension internationale. Mais, sous sa dictature, il y a toujours la Russie, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie, l'Albanie, la Prusse, la Saxe, comme aussi la Chine, la Mongolie, la Corée et le Tonkin » (12). Révélateur de cette façon de penser le monde et d'interpréter ses conflits, le commentaire qu'il livre du conflit sino-soviétique : « L'étendard de l'idéologie ne recouvre en réalité que des ambitions » (29 juillet 1963).
Dès 1960, De Gaulle a reçu Nikita Krouchtchev à Paris, mais ce n'est qu'en 1966 qu'il se rendra en Union soviétique (ci-dessus : aux côtés d'Alexis Kossyguine qui a succédé à Krouchtchev en 1964), où il évoquera « l'Europe de l'Atlantique à l'Oural » - une formule qu'il avait utilisée pour la première fois en 1950. Pour lui, la Russie est une puissance européenne à part entière.
Briser la bipolarité de Yalta
De Gaulle raisonne en termes d'espace et de temps, de puissance et de continent. Sa politique est fondée sur une vision des grands ensembles planétaires. Elle ne peut se limiter aux conflits locaux. Elle est globale et ambitieuse, car son souci est de rendre à la France sa « responsabilité mondiale ». Ses adversaires critiquent cette politique « de grandeur ». Dès 1962, Jean-Jacques Servan-Schreiber l'accuse d'œuvrer à « l'isolement » de la France (13). De Gaulle passe outre.
Pour donner à la France les moyens de son indépendance nationale, il la dote de l'arme nucléaire et prend ses distances avec l'OTAN. Dès le 3 novembre 1959, dans son fameux discours à l'École militaire, il a souligné cet impératif de la souveraineté : « Il faut que la défense de la France soit française. C'est une nécessité qui n'a pas toujours été très familière au cours de ces dernières années. Je le sais. Il est indispensable qu'elle le redevienne. Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Il faut que son effort soit son effort. S'il en était autrement, notre pays serait en contradiction avec tout ce qu'il est depuis ses origines, avec son rôle, avec l'estime qu'il a de lui-même, avec son âme. Naturellement, la défense française serait, le cas échéant, conjuguée avec celle d'autres pays. Cela est dans la nature des choses. Mais il est indispensable qu'elle nous soit propre, que la France se défende elle-même, pour elle-même et à sa façon. S'il devait en être autrement, si on admettait pour longtemps que la défense de la France cessât d'être dans le cadre national et qu'elle se confondît, ou fondît, avec autre chose, il ne serait pas possible de maintenir chez nous un État ».
S'il secoue la tutelle américaine, c'est qu'il veut à la fois la souveraineté nationale et une « Europe européenne », et qu'il croit au rôle des peuples et en la nécessité de briser la bipolarité de Yalta. Attentif aux mouvements du monde, il transgresse partout où il le peut le statu quo d'un dualisme artificiel. La reconnaissance de la Chine populaire s'inscrit dans cette logique (27 juin 1964). S'il se fait le porte-parole des peuples du Tiers-monde, comme à Pnom-Penh (1er septembre 1966), c'est pour ouvrir une « troisième voie ». S'il magnifie le « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » qu'il a reconnu aux peuples algérien et africain, s'il condamne au passage l'intervention américaine au Vietnam, visite l'Amérique latine et lance son célèbre : « Vive le Québec libre ! » à l'adresse des « Français canadiens », c'est pour défier la doctrine Monroe et conjuguer le refus des blocs avec le souci de réveiller les peuples.
Pour sortir de l'hémiplégie européenne, De Gaulle va conduire une Ostpolitik active et hardie. D'octobre 1965 à juin 1967, Maurice Couve de Murville, son ministre des Affaires étrangères, franchit à huit reprises le « rideau de fer », mais ne traverse qu'une seule fois l'Atlantique. Cette distance avec les États-Unis qui rompt avec les usages établis sous la IVe République, qui voyait les chefs de gouvernement se rendre régulièrement à Washington pour tendre la main ou recevoir l'approbation de leurs politiques, va surprendre et inquiéter la classe politique française. De Gaulle, qui s'est montré totalement solidaire des États-Unis au moment de la crise de Berlin (août 1961) et à propos de Cuba (octobre 1962), s'en irritera et fustigera les tenants du « renoncement ». D'un revers, il repoussera les critiques de ses détracteurs atlantistes : « Il n'y a pas de renversement des alliances, mais seulement la volonté de dépasser la politique des blocs » (1er janvier 1968).
Aller « de la détente à l'entente et à la coopération ». À cette fin, De Gaulle lui-même n'hésite pas à traverser plusieurs fois le « rideau de fer » : séjour en URSS du 20 juin au 1er juillet 1966, visite à la Pologne du 6 au 12 septembre 1967 et voyage en Roumanie du 14 au 18 mai 1968. Dès son arrivée en Pologne, il évoque, avec lyrisme, les liens qui unissent la patrie de Chopin à la France : « Comme deux rochers, éloignés, mais que le même océan a tour à tour ou à la fois battus de ses tempêtes, voici que la Pologne et la France se 36 voient l'une et l'autre debout, toujours pareilles à elles-mêmes et décidées à le rester. Voici qu'elles sont, plus amicalement et résolument que jamais, disposées à s'entendre et à se joindre » (6 septembre).
De Gaulle rappelle son attachement personnel à la Pologne où, dans les années vingt, il a servi sous les ordres du général Weygand dans le cadre d'une mission d'assistance militaire française. Il s'agissait alors d'aider l'armée polonaise du maréchal Pilsudski qui tentait de s'emparer de l'Ukraine, à repousser les troupes soviétiques commandées par Toukhatchevski, son compagnon de captivité à Ingolstadt. De Gaulle souligne « la nécessité, en même temps que la difficulté » pour la France et la Pologne « de sauvegarder et de développer leur substance, leur influence et leur puissance nationales, quel que puisse être le poids des colosses de l'univers, qui les engagent tous les deux au rapprochement et à l'entraide » (6 septembre).
À l'université de Cracovie, De Gaulle qui précise la nature de la coopération à établir entre la France et la Pologne, souligne le refus des blocs : « Mais pour vous, comme pour nous, il est essentiel que cette coopération en soit une et non pas l'absorption par quelque énorme appareil étranger » (8 septembre). Près de l'ancienne Dantzig, il engage la Pologne à oser une politique d'indépendance nationale : « La France espère que vous verrez un peu plus loin, un peu plus grand peut-être que ce que vous avez déjà été obligés de faire jusqu'à présent. Les obstacles qui vous paraissent aujourd'hui insurmontables, sans aucun doute, vous les surmonterez. Vous comprenez tous ce que je veux dire » (10 septembre).
De Gaulle a choisi de se rendre en Roumanie en mai 1968 parce qu'il a compris que Ceaucescu voulait affirmer l'indépendance de son pays à l'égard de Moscou. Devant l'Assemblée nationale, il appelle la France et la Roumanie à se retrouver côte à côte pour surmonter « la division de l'Europe telle qu'elle fut accomplie à Yalta » et « mettre un terme au système des deux blocs ». Tout au long de ce voyage, De Gaulle reçut un accueil particulièrement chaleureux.
De Gaulle mise sur la dissidence roumaine
Devant la Diète polonaise, De Gaulle va plus loin encore, affirmant que la Pologne a « repris, vis-à-vis du dehors, la totale disposition d'elle-même, ce qui lui permet de traiter chaque problème sans entraves et sans préjugés » (11 septembre). Le même jour, s'adressant au peuple polonais par le canal de la télévision et la radio, il rappelle les grands principes de sa politique européenne : « La paix ne peut véritablement s'établir en Europe que par la détente, puis par l'entente, enfin par la coopération, pratiquées entre tous les peuples de notre continent, quelles que puissent être les blessures laissées par les conflits et les barrières dressées par leurs régimes ».
Un an plus tard, alors même que la fièvre estudiantine monte dans les rues de Paris, De Gaulle s'envole pour Bucarest. Ce voyage - il le dira à Michel Droit dans un entretien télévisé - lui paraît « très important » même « essentiel ». La Roumanie de Ceausescu apparaît alors comme « une petite puissance dissidente » qui tente, face à Moscou, de jouer la carte de l'indépendance nationale (14). Elle ne l'est pas seulement aux yeux de Paris qui la considère comme « la France de l'Est », mais aussi de Washington qui essayera de la mettre dans son jeu.
Pour De Gaulle, la Roumanie prend les allures d'un atout maître dans sa lutte contre les blocs. Dès son arrivée à l'aérodrome de Bucarest, il soulève un extraordinaire enthousiasme. Le lendemain, il s'adresse à l'Assemblée nationale roumaine, puis aux universités. Comme il l'a fait en Pologne, il souligne les liens tissés par l'histoire. Il rappelle le soutien accordé par Napoléon III à l'Union des principautés de Moldavie et de Valachie d'où sortira la Roumanie indépendante. Il évoque l'association de la Roumanie à l'Entente dans les combats contre les Empires centraux, mais aussi la politique de défense commune adoptée par Paris et Bucarest dans l'Europe de l'entre-deux guerres. Bref, il inscrit son propos « dans cette tradition occidentale de la Roumanie » (15) pour en arriver à l'état de l'Europe contemporaine : « Aujourd'hui, ce sont les mêmes liens, qui, dans le but de réparer les conséquences des bouleversements infligés à notre continent par la guerre que déchaîna le Reich, de remédier à la division de l'Europe telle qu'elle fut accomplie à Yalta, de mettre un terme au système des deux blocs, conduisent la Roumanie et la France à se retrouver côte à côte ».
Tout en appelant de ses vœux l'« union de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural », De Gaulle lance un violent réquisitoire contre l'ordre bipolaire : « Comment admettre que puisse durer, pour les pays de notre Europe, une situation dans laquelle beaucoup d'entre eux se trouvent répartis en deux blocs opposés, se plient à une direction politique, économique et militaire provenant de l'extérieur... Non ! Chez vous comme chez nous, on considère que, de cette guerre froide succédant au partage de Yalta, il ne saurait résulter qu'une séparation artificielle et stérile, à moins qu'elle ne devienne mortelle. En conséquence, il n'y a plus pour l'Europe, d'idéologies ni d'hégémonies qui vaillent en comparaison des bienfaits de la détente, de l'entente et de la coopération entre toutes les parties d'elle-même ».
Le 18 mai, avant de regagner Paris, De Gaulle s'adresse une dernière fois aux Roumains et les invite à « aider notre Europe à respirer enfin plus librement ». La veille, devant l'Assemblée nationale, il a cité le poète Eminescu et pris à son compte sa formule - « l'État national et non l'État cosmopolite » - pour affirmer : « Roumains et Français, nous voulons être nous-mêmes ».
Le « printemps de Prague » semble lui donner raison. Mais l'intervention soviétique, soutenue par les troupes bulgares, hongroises et est-allemandes, montre que l'URSS n'entend pas perdre le contrôle de ses satellites et qu'elle reste fidèle à la pratique de la « normalisation » par les chars ». De Gaulle n'en est pas autrement surpris. Le 21 août 1968, le communiqué français laisse tomber ce laconique commentaire : « L'intervention armée de l'Union soviétique en Tchécoslovaquie montre que le gouvernement de Moscou ne s'est pas dégagé de la politique des blocs imposée à l'Europe par l'accord de Yalta ». En conseil des ministres, trois jours plus tard, De Gaulle est plus volubile : « Nous continuerons à parler de l'Europe. Si la Russie, un jour, a des histoires avec la Chine, elle a besoin de ne pas avoir l'Europe contre elle. Il faut continuer dans notre voie. L'incident actuel est déplorable. Gardons-nous cependant des excès de langage. Tôt ou tard, la Russie reviendra. Il faut faire l'Europe. Avec les Six, on peut construire quelque chose, même bâtir une organisation politique. On ne fait pas l'Europe sans Varsovie et sans Moscou » (16).
► Jean-Jacques MOURREAU, éléments n°68, été 1990.
• Notes :
- L'atlantisme refleurit dans les déclarations de la classe politique française, y compris dans celles de personnalités se réclamant du gaullisme, comme Édouard Balladur (point de vue donné au Monde du 1er décembre 1989). Il est exalté dans le rapport publié le 16 mars dernier, par un groupe d'experts dénommé Renouveau Défense et composé de personnalités proches de Raymond Barre (Jean-Marie Benoist, Jean-Marie Soutou, André Monteil, amiral Paul Delahousse, généraux Guy Mery, Claude Grigaut, Jean Delaunay, Bertrand de Montaudoin et Jean Thiry), demandant à la France de réintégrer le comité des plans de l'OTAN. Avec cette argumentation : « L'Alliance atlantique, c'est-à-dire le "couplage" entre les défenses du Vieux Continent et de l'Amérique, et la dissuasion nucléaire ont maintenu la paix en Europe pendant quarante ans. Ces deux môles de notre sécurité doivent être conservés à tout prix. Toute autre démarche risquerait de déboucher sur l'aventure » (Le Monde des 18 et 19 mars 1990).
- Selon François-Georges Dreyfus : De Gaulle et le gaullisme, 1982.
- Affaires extérieures - La politique de la France 1944-1984, 1984.
- Mémoires d'Espoir, tome I, Paris, 1970.
- Ibid.
- Voir les documents présentés dans Politique étrangère n°3 (1989) par Walter Schütze, secrétaire général du comité d'étude des relations franco-allemandes : « Vingt-deux ans après : un concept français pour un règlement panallemand dans le cadre paneuropéen ».
- Conférence de presse du 23 juillet 1964.
- Selon Jean Touchard : Le Gaullisme - 1940-1969 , 1978.
- Mémoires de Guerre, tome III, Paris, 1959.
- Auteur de Théories stratégiques (5 volumes, publiés à partir de 1929) et not. d'un article sur « Moscou, rempart de l'Occident » publié par La Revue de la Défense nationale (fév. 1955), l'amiral Castex a trouvé un autre lecteur attentif en la personne de Carl Schmitt. Voir à ce sujet l'introduction de Julien Freund à Terre et Mer (1985).
- Le Renouveau - 1958-1962, tome l, 1970.
- Ibid.
- L'Express du 24 mai 1962.
- Catherine Durandin et Despina Tomesco : La Roumanie de Ceausescu, 1988.
- Ibid.
- Selon André Fontaine : Un seul lit pour deux rêves, 1981.










