Afghanistan
Karzaï s’éloigne du Pakistan et se rapproche de l’Inde
Le Président afghan rencontre Singh pour renforcer les rapports bilatéraux
[Ci-dessous : Le président afghan Hamid Karzaï (à g.) et le Premier ministre indien Manmohan Singh, le 4 octobre 2011 à New Delhi. Le “partenariat stratégique” signé avec l'Inde permettra notamment à New Delhi d'aider à entraîner les forces de sécurité afghanes. Cet accord, le premier du genre signé par l'Afghanistan, vise à approfondir la coopération en matière de sécurité, les liens commerciaux et économiques ainsi que les échanges sociaux et culturels. Il pourrait ouvrir la voie à de futurs accords avec les États-Unis : compte tenu des grandes oppositions intérieures et extérieures à un accord sécuritaire de l’Afghanistan avec les États-Unis, le gouvernement de Kaboul espèrerait ainsi que la signature de son premier accord stratégique avec l’Inde pourra réduire les oppositions à la signature d’un accord stratégique avec les États-Unis. Sans doute les États-Unis ont-ils eu un rôle-clé dans la signature de cet accord stratégique, car en fortifiant la situation stratégique de l’Inde dans la région, ils affaiblissent par la même occasion le Pakistan, adversaire traditionnel et atomique de l’Inde. C’est pour cette raison que Hamid Karzaï, tout de suite après la signature de l’accord stratégique avec l’Inde, a affirmé, pour ne pas froisser les susceptibilités, que cette coopération n’était, en aucun cas, dirigée contre le Pakistan ; cela montre que les gouvernements de Kaboul et de New Delhi sont quelque peu inquiets de la réaction d’Islamabad, face à leur coopération stratégique]
 Le Président de l’Afghanistan, Hamid Karzaï, revient d’une mission en Inde, à un moment plutôt délicat pour les équilibres et les alliances qui sont en train de se modifier dans la région. La visite du leader afghan — qui, le 4 octobre 2011, a rencontré le Premier ministre indien Manmohan Singh et le ministre des Affaires étrangères S. M. Krishna — revêt une signification particulière, à la lumière des tensions récentes entre les Afghans et leurs voisins pakistanais, ennemis historiques de la Nouvelle Dehli.
Le Président de l’Afghanistan, Hamid Karzaï, revient d’une mission en Inde, à un moment plutôt délicat pour les équilibres et les alliances qui sont en train de se modifier dans la région. La visite du leader afghan — qui, le 4 octobre 2011, a rencontré le Premier ministre indien Manmohan Singh et le ministre des Affaires étrangères S. M. Krishna — revêt une signification particulière, à la lumière des tensions récentes entre les Afghans et leurs voisins pakistanais, ennemis historiques de la Nouvelle Dehli.
Tout en rappelant qu’Islamabad est l’unique interlocuteur plausible pour chercher à faire avancer un processus de paix avec les Talibans (vus les rapports présumés et privilégiés des services secrets pakistanais de l’ISI avec les miliciens islamistes et vu le fait que « tous les sanctuaires des terroristes se trouvent sur le territoire pakistanais »), Karzaï et quelques autres ministres de son gouvernement ont accusé le gouvernement du Pakistan de « ne pas soutenir nos efforts pour ramener la paix et la sécurité en Afghanistan ». L’assassinat récent [le 20 septembre dans un attentat suicide à Kaboul] de Burhanuddin Rabbani, chef du Haut Conseil de Paix afghan en charge des négociations avec les Talibans, a refroidi les rapports entre l’Afghanistan et le Pakistan. Une commission d’enquête afghane a affirmé que le fauteur de l’attentat est venu du Pakistan ; hier, Kaboul a accusé les Pakistanais de ne pas collaborer à l’enquête.
Et tandis que le gouvernement afghan envoie des inspecteurs à Islamabad, Karzaï s’envole vers la Nouvelle Dehli, pour la deuxième fois en un an, avec la ferme intention de renforcer dans l’avenir la coopération entre son pays et l’Inde. L’Inde ne peut certes étendre “militairement” son influence sur l’Afghanistan (du fait qu’elle n’a pas de frontière commune avec ce pays) mais pourrait très bien devenir un important partenaire commercial de Kaboul. Ce n’est pas un hasard si l’Inde est de fait l’un des principaux donateurs pour l’Afghanistan, où elle a investi plus de 2 milliards de dollars depuis 2001. Cet effort semble avoir donné ses fruits, si l’on considère qu’au cours de l’année fiscale 2009-2010, le volume des échanges commerciaux entre les 2 pays a atteint le chiffres de 588 millions de dollars. Il faut souliger tout particulièrement que l’Inde est aujourd’hui l’un des plus importants marchés pour les exportations afghanes de produits agricoles, un secteur sur lequel le gouvernement de Kaboul mise beaucoup. Cette nouvelle visite de Karzaï devrait renforcer ultérieurement l’implication indienne en Afghanistan. Certaines sources évoquent d’ores et déjà un “accord de partenariat stratégique”, qui impliquerait les Indiens dans l’entraînement et la formation des forces de sécurité afghanes.
Mais l’Inde n’est pas le seul pays à vouloir occuper une place de première importance en Afghanistan, dès que les troupes de l’OTAN auront quitté le pays. Par sa position stratégique, tant économique que militaire, l’Afghanistan, comme depuis toujours, suscite bien des convoitises. Mis à part les États-Unis, qui sont en train de négocier avec Kaboul le droit de maintenir leurs bases pendant quelques décennies, il y a aussi la Russie et, surtout, la Chine qui investissent déjà dans la reconstruction du pays, dans l’espoir de s’accaparer des riches ressources du sous-sol afghan et de se réserver une présence garantie et stable sur le territoire. Il ne faut pas oublier non plus 2 autres puissances régionales, l’Iran et l’Arabie Saoudite, dont la présence potentielle n’est certes pas aussi affichée, mais qui ne voudront sûrement pas courir le risque d’être exclus de tout contact avec l’Afghanistan dans les prochaines décennies.
Enfin, et ce n’est certainement pas là le moins important des facteurs en jeu, le Pakistan continue à voir dans les massifs montagneux afghans un éventuel refuge inaccessible, tout comme sont inaccessibles les dangereux sanctuaires des groupes armés islamistes, en cas de nouvelle guerre avec l’Inde.
► Ferdinando Calda. (article paru dans Rinascita, 5 octobre 2011)

Obama a adopté la “Doctrine Nixon”
Bombardements aériens, opérations secrètes et vietnamisation du conflit : c’est ainsi que les États-Unis étaient sortis du conflit vietnamien !
La comparaison qui s’impose entre le conflit qui secoue aujourd’hui l’Afghanistan et la guerre du Vietnam a été faite à maintes reprises au cours de ces dernières années. Souvent, cette comparaison a été émise de manière inflationnaire et hors de propos, dans les descriptions que faisaient les observateurs du bourbier sanglant dans lequel les États-Unis semblent empêtrés depuis peu. Quoi qu’il en soit, Barack Obama lui-même, dans son discours tenu à la fin de l’année 2009 à l’Académie militaire de West Point, a bien dû reconnaître qu’il y avait plus d’un parallèle à tracer entre les 2 conflits.
Il est tout aussi vrai que les différences entre les 2 guerres sont nombreuses ; d’abord, parce que l’époque n’est plus la même et parce que les équilibres internationaux et les acteurs en jeu ont changé. On demeure dès lors stupéfait de constater que les stratégies adoptées par les locataires successifs de la Maison Blanche sont fort similaires. Cette similitude frappe d’autant plus que nous avons, d’une part, le démocrate Barack Obama, Prix Nobel de la Paix, et d’autre part, le républicain Richard Nixon, considéré comme le président belliciste par excellence.
Nixon avait hérité de son prédécesseur démocrate Lyndon B. Johnson (qui avait accédé à la Maison Blanche après l’assassinat de John F. Kennedy) une guerre toujours plus coûteuse et impopulaire. Nixon avait donc élaboré la fameuse “Doctrine Nixon” pour tenter d’obtenir en bout de course une “paix honorable”, permettant aux États-Unis de se “désengager” sans perdre la face. La nouvelle stratégie visait à réduire les pertes en hommes, toujours mal acceptées par l’opinion publique, en recourant massivement à l’utilisation des forces aériennes, y compris pour bombarder des pays voisins comme le Laos ou le Cambodge (ce qui n’a jamais été reconnu officiellement ; le scandale a éclaté ultérieurement à la suite de la publication des Pentagon Papers). Parallèlement aux bombardements, la “Doctrine Nixon” prévoyait des opérations secrètes dirigées contre des objectifs stratégiques et doublées d’une vaste opération de renseignement pour identifier et frapper les combattants du Vietcong (c’est ce que l’on avait appelé le “Programme Phoenix”).
Dans le Quadriennal Defence Review, le rapport du Pentagone qui paraît tous les 4 ans, le ministre de la défense américain Robert Gates présentait, début février 2010, les principales lignes directrices de la nouvelle stratégie de guerre, annonçait l’augmentation du financement des opérations spéciales et secrètes et un recours croissant aux bombardements par drones (avions sans pilote). Ces avions sans pilote ont mené à bien des centaines d’attaques “non officielles” en territoire pakistanais. Toutes ces manœuvres ont été flanquées d’un renforcement général des appareils destinés à glaner du renseignement.
Mais les analogies entre la “Doctrine Nixon” et l’“exit strategy” d’Obama ne s’arrêtent pas là. Il y a aussi la tentative d’acheter le soutien de la population par l’intermédiaire de “projets de développement”, comme l’était le Civil Operations and Rural Development Support (CORD ; Opérations civiles et soutien au développement rural) au Vietnam et comme l’est actuellement son équivalent afghan, le Provincial Reconstruction Team (PRT ; Équipe de reconstruction des provinces). On constate aussi que se déroulent des tractations secrètes avec le parti ennemi (ou, du moins, des tentatives de dialogue), qui se font en dehors de toutes les rencontres officielles. Il y a ensuite et surtout le programme mis en œuvre pour un retrait graduel qui implique de transférer les missions proprement militaires à l’armée du “gouvernement local”.
Selon la stratégie vietnamienne élaborée en son temps par le Secrétaire d’État Henry Kissinger, le renforcement de l’armée sud-vietnamienne et la vietnamisation du conflit devaient assurer aux États-Unis un “espace-temps satisfaisant”, un “decent interval”, entre le retrait américain et l’inévitable victoire du Vietcong ; ou, pour reprendre les paroles mêmes de Henry Kissinger : « avant que le destin du Sud-Vietnam ne s’accomplisse ». Tout cela était mis en scène pour que le retrait américain ne ressemble pas trop à une défaite. Comme prévu, l’armée nord-vietnamienne est entrée à Saigon, 4 années après le départ des troupes américaines.
Aujourd’hui cependant, Obama doit se contenter d’une armée afghane à peine capable de tenir pendant le “decent interval” envisagé, c’est-à-dire pendant l’espace-temps entre le retrait définitif des troupes américaines et la rechute terrible et prévisible de l’Afghanistan dans une guerre civile où s’entre-déchireront les diverses ethnies qui composent le pays.
► Ferdinando Calda. (article paru dans Rinascita, 27 mai 2011)
• Autres brèves sur l'Afghanistan

Les États-Unis modifient leur stratégie en Afghanistan
À partir de 2014, le gouvernement afghan devra lui-même assurer la sécurité sur son propre territoire. Cette intention a été confirmée au Président Hamid Karzaï fin juillet 2010, lors de la Conférence internationale sur l’Afghanistan, tenue à Kaboul. Dès l’été 2011, les premières troupes américaines quitteront le pays, ce qui, d’après les paroles d’Hillary Clinton, ministre américaine des affaires étrangères, constituera « le commencement d’une phase nouvelle de notre engagement et non sa fin ». En fin de compte, les États-Unis entendent participer, après le retrait de leurs troupes, à la formation des forces afghanes de sécurité.
Le Président américain Barack Obama cherche ainsi à se débarrasser du vieux fardeau afghan, hérité de son prédécesseur George W. Bush, juste avant les présidentielles de 2012. Mais derrière les plans de retrait hors d’Afghanistan, que l’on concocte aux États-Unis, se profile le constat que la guerre dans ce pays, qui dure maintenant depuis 9 ans, ne pourra pas être gagnée. À cela s’ajoute le coût très élevé de cette guerre, qui se chiffre à quelque 100 milliards de dollars par an. Une telle somme ne peut plus raisonnablement s’inscrire désormais dans le budget américain, solidement ébranlé. Richard N. Haass, Président du très influent Council of Foreign Relations (CFR) tire la conclusion : « Nous devons reconnaître que cette guerre a été un choix et non pas une nécessité ». Il y a surtout que le coût militaire de l’entreprise est trop élevé, dans la mesure où elle mobilise des ressources qui, du coup, manquent en d’autres points chauds. Haass cite, dans ce contexte, l’Iran et la Corée du Nord, 2 États étiquetés “États voyous”, qui se trouvent depuis longtemps déjà dans le collimateur de Washington.
Si les États-Unis se retirent du théâtre opérationnel de l’Hindou Kouch, l’Afghanistan, ébranlé par la guerre, n’évoluera pas pour autant vers des temps moins incertains. Ensuite et surtout, les États-Unis ne disposent pas de moyens adéquats pour trancher le nœud gordien afghan, constitué d’un entrelacs très compliqué de combattants talibans, de divisions ethniques et de structures claniques traditionnelles. Il y a ensuite le voisin pakistanais, disposant d’armes nucléaires, qui est tout aussi instable que l’Afghanistan. Rien que ce facteur-là interdit aux États-Unis de laisser s’enliser l’Afghanistan dans un chaos total. D’après Haass, « les deux objectifs des États-Unis devraient être les suivants : empêcher qu’Al Qaeda ne se redonne un havre sécurisé dans les montagnes afghanes et faire en sorte que l’Afghanistan ne mine pas la sécurité du Pakistan ». C’est pourquoi, malgré le retrait annoncé, on peut être certain que des troupes américaines demeureront en permanence en Afghanistan, fort probablement en vertu d’un accord bilatéral qui sera signé entre Washington et Kaboul. Les Américains, finalement, n’ont que fort peu confiance en les capacités du Président afghan Karzaï, homme corrompu, qui, au cours des années qui viennent de s’écouler, n’a pu assurer sa réélection que par une tricherie de grande envergure.
La situation en Afghanistan et aussi en Irak indique aujourd’hui qu’il y a changement de stratégie à Washington, comme l’atteste les nouvelles démarches des affaires étrangères américaines. Hier, nous avions les “guerres préventives” pour généraliser sur la planète entière les principes de la “démocratie libérale” ; les cénacles et les “boîtes à penser” des néo-conservateurs les avaient théorisées. Aujourd’hui, nous assistons à un retour à la Doctrine Nixon. Richard Nixon, Président des États-Unis de 1969 à 1974, après le désastre du Vietnam, avait parié, surtout en Asie, sur le renforcement des économies des pays alliés et sur le soutien militaire à leur apporter. Aujourd’hui, le ministre de la défense américain Robert Gates déclare « qu’il est peu vraisemblable que les États-Unis répètent bientôt un engagement de l’ampleur de celui d’Afghanistan ou d’Irak, pour provoquer un changement de régime et pour construire un État sous la mitraille ». Mais parce que le pays doit faire face à toutes sortes de menaces, en premier lieu celle du terrorisme, l’efficacité et la crédibilité des États-Unis doivent demeurées intactes aux yeux du monde. Ces réalités stratégiques exigent, dit Gates, que le gouvernement de Washington améliore ses capacités à consolider les atouts de ses partenaires. Il faudra donc, poursuit-il, « aider d’autres États à se défendre eux-mêmes et, si besoin s’en faut, de lutter aux côtés des forces armées américaines, dans la mesure où nous aurons préparé leurs équipements, veillé à leur formation et apporté d’autres formes d’assistance à la sécurité ». Gates justifie aussi le changement de stratégie comme suit : l’histoire récente a montré que les États-Unis ne sont pas prêts de manière adéquate à affronter des dangers nouveaux et imprévus émanant surtout d’États dits “faillis”.
L’Afghanistan recevra donc une « assistance à la sécurité », mais on peut douter qu’elle enregistrera le succès escompté. Toutefois la nouvelle stratégie américaine nous montre que Washington n’est pas vraiment prêt à renoncer à ses visées hégémoniques. En effet, l’armement d’alliés et de partenaires, en lieu et place de l’envoi de troupes propres, offre un grand avantage : les moyens peuvent être utilisés de manière beaucoup plus diversifiée. En fin de compte, il y a, dispersés sur l’ensemble du globe, bon nombre de pays qui peuvent être mobilisés pour faire valoir les intérêts américains. Exemples : la Colombie, pour tenir en échec le Président vénézuélien Hugo Chavez, ennemi des États-Unis ; ou les petits émirats du Golfe Persique pour constituer un avant-poste menaçant face à l’Iran. Comme l’exprime le ministre des affaires étrangères Gates : « Trouver la manière d’améliorer la situation qu’adoptera ensuite le gouvernement américain pour réaliser cette tâche décisive, tel est désormais le but majeur de notre politique nationale ».
► Bernhard Tomaschitz (article paru dans zur Zeit n°30/2010).

◘ À lire : Ahmed RASHID : L'ombre des taliban, éd. Autrement, 2001, 20 €.
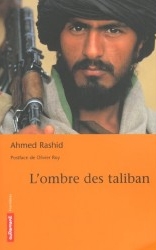 Ahmed Rashid est un journaliste pakistanais, correspondant de la BBC et de CNN. Il n'empêche que son ouvrage nous révèle des aspects intéressants du phénomène taliban. D'abord, Rashid croque une histoire de ce mouvement dans l'Afghanistan en proie à des dissensions civiles graves, consécutives de l'évacuation du pays par les troupes soviétiques. Cette histoire commence en 1994 et se termine à la suite de l'intervention américaine en octobre 2001. Pour Rashid, le mouvement taliban est un défi à l'islam, car il interdit absolument toute forme de compromissions avec des idéologies musulmanes moins rigides ou, a fortiori, avec l'Occident. Mais ce mouvement a été “dopé” à l'héroïne, sans le trafic de cette substance, jamais il n'aurait tenu le coup. Rashid nous explique d'un point de vue pakistanais quels sont les nouveaux éléments dans le “Grand Jeu”, montre que l'affaire des oléoducs trans-afghans a été déterminante dans l'évolution des rapports entre les États-Unis et les Talibans. Dans un chapitre 15, Ahmed Rashid analyse un conflit au sein de l'Islam, entre Chiites et Sunnites, soit entre 2 puissances antagonistes, l'Iran et l'Arabie Saoudite, cette dernière, plus fondamentaliste et plus rigoriste, étant un allié privilégié des États-Unis. L'intérêt de cet ouvrage est de montrer que drogues et pétrole sont les enjeux majeurs du conflit en cours, que les unes et l'autre vont servir à asseoir la puissance financière des États-Unis (comme les guerres de l'opium contre la Chine avaient permis de remplir les caisses de certaines banques londoniennes au XIXe siècle) et leur donner la maîtrise du commerce des hydrocarbures, au détriment des puissances énergétiquement faibles et pauvres, en dépit de leurs immenses potentialités industrielles et commerciales : l'Europe et le Japon.
Ahmed Rashid est un journaliste pakistanais, correspondant de la BBC et de CNN. Il n'empêche que son ouvrage nous révèle des aspects intéressants du phénomène taliban. D'abord, Rashid croque une histoire de ce mouvement dans l'Afghanistan en proie à des dissensions civiles graves, consécutives de l'évacuation du pays par les troupes soviétiques. Cette histoire commence en 1994 et se termine à la suite de l'intervention américaine en octobre 2001. Pour Rashid, le mouvement taliban est un défi à l'islam, car il interdit absolument toute forme de compromissions avec des idéologies musulmanes moins rigides ou, a fortiori, avec l'Occident. Mais ce mouvement a été “dopé” à l'héroïne, sans le trafic de cette substance, jamais il n'aurait tenu le coup. Rashid nous explique d'un point de vue pakistanais quels sont les nouveaux éléments dans le “Grand Jeu”, montre que l'affaire des oléoducs trans-afghans a été déterminante dans l'évolution des rapports entre les États-Unis et les Talibans. Dans un chapitre 15, Ahmed Rashid analyse un conflit au sein de l'Islam, entre Chiites et Sunnites, soit entre 2 puissances antagonistes, l'Iran et l'Arabie Saoudite, cette dernière, plus fondamentaliste et plus rigoriste, étant un allié privilégié des États-Unis. L'intérêt de cet ouvrage est de montrer que drogues et pétrole sont les enjeux majeurs du conflit en cours, que les unes et l'autre vont servir à asseoir la puissance financière des États-Unis (comme les guerres de l'opium contre la Chine avaient permis de remplir les caisses de certaines banques londoniennes au XIXe siècle) et leur donner la maîtrise du commerce des hydrocarbures, au détriment des puissances énergétiquement faibles et pauvres, en dépit de leurs immenses potentialités industrielles et commerciales : l'Europe et le Japon.

 1979 : les troupes soviétiques en Afghanistan
1979 : les troupes soviétiques en Afghanistan
24 décembre 1979 : Les troupes soviétiques entrent en Afghanistan
Le 27 avril 1978, le Parti Démocratique Populaire d’Afghanistan avait pris le pouvoir sous la direction de Muhammad Taraki. Le pays se rapproche de l’URSS afin de parfaire un programme de réformes sociale, surtout dans les domaines de l’éducation et de la réforme agraire. Notons, au passage, que l’Afghanistan avait bien dû se tourner vers l’URSS, les puissances anglo-saxonnes, qui soutenaient alors Khomeiny, voyaient d’un mauvais œil les tentatives iraniennes de venir en aide aux Afghans.
Ce nouveau régime, en observant la situation chaotique dans laquelle se débattait l’Iran, met immédiatement les agitateurs religieux au pas. La CIA décide tout de suite de soutenir une trentaine de groupes de moudjahhidins. La situation devient alors bien vite critique. Dans les troubles qui agitent l’Afghanistan, Taraki est assassiné. En septembre 1979, Hafizullah Amin prend le pouvoir, ce qui déclenche une guerre civile, amenant, le 24 décembre, les troupes soviétiques à intervenir, pour rétablir l’ordre. Amin est exécuté. Babrak Karmal accède alors au pouvoir et demande à Brejnev l’appui permanent de troupes soviétiques. Ce qui lui est accordé. L’Occident capitaliste (l’américanosphère) et l’Islam radical condamnent l’intervention et forgent une alliance qui durera jusqu’aux attentats du 11 septembre (qui n’y mettront fin qu’en apparence).
Le 21 mars 1980, les Afghans hostiles aux Soviétiques forment une Alliance islamique pour la liberté de l’Afghanistan, qui comprends des fondamentalistes et des monarchistes. Cette alliance, dont le nom contient les vocables “islamistes”, pour plaire aux bailleurs de fonds saoudiens, et “liberté”, pour plaire aux Américains, comptait 7 partis islamistes, dont 4 étaient jugés fondamentalistes et 3, plus ou moins modérés. Ces partis installent leur QG sur le territoire pakistanais voisin. Dans la longue guerre qui s’ensuivra, les services pakistanais, dont surtout l’ISI, recevront et distribueront l’argent et les armes venus des États-Unis, d’Arabie Saoudite et d’organisations “privées” arabo-musulmanes.
Zbigniew Brzezinski, artisan de cette stratégie, avouera, dans un entretien accordé au Monde, que la version officielle d’une aide aux moudjahhidins à partir de 1980 est fausse. D’après le stratège, c’est le 3 juillet 1979 que la décision a été prise d’armer les moudjahhidins, pour attirer l’URSS dans un piège, afin de la déstabiliser par une opération coûteuse et de lui donner une mauvaise image médiatique, tant dans le monde arabo-musulman que dans l’américanosphère.

Afghanistan : une guerre programmée depuis 210 ans
♦ Conférence prononcée par Robert Steuckers le 24 novembre 2001 à la tribune du Cercle Hermès de Metz, à la tribune du MNJ le 26 janvier 2002 et à la tribune commune de Terre & Peuple-Wallonie et de Synergies Européennes-Bruxelles le 21 février 2002
 Depuis que les troupes américaines et occidentales ont débarqué en Afghanistan, dans le cadre de la guerre anti-terroristes décrétée par Bush à la suite des attentats du 11 septembre 2001, un regard sur l'histoire de l'Afghanistan au cours de ces 2 derniers siècles s'avère impératif ; de même, joindre ce regard à une perspective plus vaste, englobant les théâtres et les dynamiques périphériques, permettrait de juger plus précisément, à l'aune de l'histoire, les manœuvres américaines en cours. Il nous induit à constater que cette guerre dure en fait depuis au moins 210 ans. Pourquoi ce chiffre de 210 ans ? Parce que les principes, qui la guident, ont été consignés dans un mémorandum anglais en 1791, mémorandum qui n'a pas perdu de sa validité dans les stratégies appliquées de nos jours par les puissances maritimes. Seule l'amnésie historique, qui est le lot de l'Europe actuelle, qui nous est imposée par des politiques aberrantes de l'enseignement, qui est le produit du refus d'enseigner l'histoire correctement, explique que la teneur de ce mémorandum n'est pas inscrite dans la tête des diplomates et des fonctionnaires européens. Ils en ignorent généralement le contenu et sont, de ce fait, condamnés à ignorer le moteur de la dynamique à l'œuvre aujourd'hui.
Depuis que les troupes américaines et occidentales ont débarqué en Afghanistan, dans le cadre de la guerre anti-terroristes décrétée par Bush à la suite des attentats du 11 septembre 2001, un regard sur l'histoire de l'Afghanistan au cours de ces 2 derniers siècles s'avère impératif ; de même, joindre ce regard à une perspective plus vaste, englobant les théâtres et les dynamiques périphériques, permettrait de juger plus précisément, à l'aune de l'histoire, les manœuvres américaines en cours. Il nous induit à constater que cette guerre dure en fait depuis au moins 210 ans. Pourquoi ce chiffre de 210 ans ? Parce que les principes, qui la guident, ont été consignés dans un mémorandum anglais en 1791, mémorandum qui n'a pas perdu de sa validité dans les stratégies appliquées de nos jours par les puissances maritimes. Seule l'amnésie historique, qui est le lot de l'Europe actuelle, qui nous est imposée par des politiques aberrantes de l'enseignement, qui est le produit du refus d'enseigner l'histoire correctement, explique que la teneur de ce mémorandum n'est pas inscrite dans la tête des diplomates et des fonctionnaires européens. Ils en ignorent généralement le contenu et sont, de ce fait, condamnés à ignorer le moteur de la dynamique à l'œuvre aujourd'hui.
Louis XVI : l'homme à abattre
Quel est le contexte qui a conduit à la rédaction de ce fameux mémorandum ? La date-clef qui explique le pourquoi de sa rédaction est 1783. En cette année-là, à l'Est, les armées de Catherine de Russie prennent la Crimée et le port de Sébastopol, grâce à la stratégie élaborée par le Ministre Potemkine et le Maréchal Souvorov (cf. : Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie - Des origines au nucléaire, Laffont/Bouquins, 1990). À partir de cette année 1783, la Crimée devient entièrement russe et, plus tard, à la suite du Traité de Jassy en 1792, il n'y aura plus aucune troupe ottomane sur la rive septentrionale de la Mer Noire. À l'Ouest, en 1783, la Marine Royale française écrase la Royal Navy anglaise à Yorktown, face aux côtes américaines. La flotte de Louis XVI, bien équipée et bien commandée, réorganisée selon des critères de réelle efficacité, domine l'Atlantique. Son action en faveur des insurgés américains a pour résultat politique de détacher les 13 colonies rebelles de la Couronne anglaise. À partir de ce moment-là, le sort de l'artisan intelligent de cette victoire, le Roi Louis XVI, est scellé. Il devient l'homme à abattre. Exactement comme Saddam Hussein ou Milosevic aujourd'hui. Paul et Pierrette Girault de Coursac, dans Guerres d'Amérique et libertés des mers (cf. infra), ont décrit avec une minutie toute scientifique les mécanismes du complot vengeur de l'Angleterre contre le Roi de France qui a développé une politique intelligente, dont les 2 piliers sont : 1) la paix sur le continent, concrétisée par l'alliance avec l'Empire autrichien, dépositaire de la légitimité impériale romano-germanique, et 2) la construction d'une flotte appelée à dominer les océans (à ce propos, se rappeler des expéditions de La Pérouse ; cf. Yves Cazaux, Dans le sillage de Bougainville et de Lapérouse, Albin Michel, 1995).
L'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, battue à Yorktown, menacée par les Russes en Méditerranée orientale, va vouloir inverser la vapeur et conserver le monopole des mers. Elle commence par lancer un débat de nature juridique : la mer est-elle res nullius ou res omnius, une chose n'appartenant à personne, ou une chose appartenant à tous ? Si elle est res nullius, on peut la prendre et la faire sienne ; si elle est res omnius, on ne peut prétendre au monopole et il faut la partager avec les autres puissances. L'Angleterre va évidemment arguer que la mer est res nullius. Sur terre, l'Angleterre continue à appliquer sa politique habituelle, mise au point au XVIIe siècle, celle de la “Balance of Powers”, de l'équilibre des puissances. En quoi cela consiste-t-il ? À s'allier à la seconde puissance pour abattre la première. En 1783, cette pratique pose problème car il y a désormais alliance de facto entre la France et l'Autriche : on ne peut plus les opposer l'une à l'autre comme au temps de la Guerre de Succession d'Espagne. C'est d'ailleurs la première fois depuis l'alliance calamiteuse entre François Ier et le Sultan turc que les 2 pays marchent de concert. Depuis le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, il est donc impossible d'opposer les 2 puissances traditionnellement ennemies du continent. Cette union continentale ne laisse rien augurer de bon pour les Anglais, car, profitant de la paix avec la France, Joseph II, Empereur germanique, frère de Marie-Antoinette, veut exploiter sa façade maritime en Mer du Nord, dégager l'Escaut de l'étau hollandais et rouvrir le port d'Anvers. Joseph II s'inspire des projets formulés quasiment un siècle plus tôt par le Comte de Bouchoven de Bergeyck, soucieux de développer la Compagnie d'Ostende, avec l'aide du gouverneur espagnol des Pays-Bas, Maximilien-Emmanuel de Bavière. La tentative de Joseph II de forcer le barrage hollandais sur l'Escaut se termine en tragi-comédie : un canon hollandais tire un boulet qui atterrit au fond de la marmite des cuisines du bateau impérial. On parlera de “Guerre de la Marmite”. L'Escaut reste fermé. L'Angleterre respire.
Organiser la révolution et le chaos en France
Comme cette politique de “Balance of Powers” s'avère impossible vu l'alliance de Joseph II et de Louis XVI, une nouvelle stratégie est mise au point : organiser une révolution en France, qui débouchera sur une guerre civile et affaiblira le pays, l'empêchant du même coup de financer sa politique maritime et de poursuivre son développement industriel. En 1789, cette révolution, fomentée depuis Londres, éclate et précipite la France dans le désastre. Olivier Blanc, Paul et Pierrette Girault de Coursac sont les historiens qui ont explicité en détail les mécanismes de ce processus (cf. : Olivier Blanc, Les hommes de Londres - Histoire secrète de la Terreur, Albin Michel, 1989 ; Paul et Pierrette Girault de Coursac, Guerre d'Amérique et liberté des mers 1718-1783, F.X. de Guibert/OEIL, Paris, 1991). En 1791, les Anglais obtiennent indirectement ce qu'ils veulent : la République néglige la marine, ne lui vote plus de crédits suffisants, pour faire la guerre sur le continent et rompre, par voie de conséquence, l'harmonie franco-impériale, prélude à une unité diplomatique européenne sur tous les théâtres de conflit, qui avait régné dans les vingt années précédant la Révolution française.
Trois stratégies à suivre
À Londres, on pense que la France, agitée par des avocats convulsionnaires, est plongée pour longtemps dans le marasme et la discorde civile. Reste la Russie à éliminer. Un mémorandum anonyme est remis, la même année, à Pitt ; il s'intitule Russian Armament et contient toutes les recettes simples et efficaces pour abattre la seconde menace, née, elle aussi, en 1783, qui pèse sur la domination potentielle des mers par l'Angleterre. Ce mémorandum contient en fait 3 stratégies à suivre à tout moment :
• 1) Contenir la Russie sur la rive nord de la Mer Noire et l'empêcher de faire de la Crimée une base maritime capable de porter la puissance navale russe en direction du Bosphore et au-delà ; cette stratégie est appliquée aujourd'hui, par l'alliance turco-américaine et par les tentatives de satelliser la Géorgie de Chevarnadze.
• 2) S'allier à la Turquie, fort affaiblie depuis les coups très durs que lui avait portés le Prince Eugène de Savoie entre 1683 et 1719. La Turquie, incapable désormais de développer une dynamique propre, devait devenir, pour le bénéfice de l'Angleterre, un verrou infranchissable pour la flotte russe de la Mer Noire. La Turquie n'est donc plus un “rouleau compresseur” à utiliser pour détruire le Saint Empire, comme le voulait François Ier ; ni ne peut constituer un “tremplin” vers la Méditerranée orientale et vers l'Océan Indien, pour une puissance continentale qui serait soit la Russie, si elle parvenait à porter ses forces en avant vers les Détroits (vieux rêve depuis que l'infortunée épouse du Basileus, tombé l'épée à la main à Constantinople en 1453 face aux Ottomans, avait demandé aux Russes de devenir la “Troisième Rome” et de prendre le relais de la défunte Byzance) ; soit l'Autriche si elle avait pu consolider sa puissance au cours du XIXe siècle ; soit l'Allemagne de Guillaume II, qui, par l'alliance effective qu'elle scelle avec la Sublime Porte, voulait faire du territoire turco-anatolien et de son prolongement mésopotamien un “tremplin” du cœur de l'Europe vers le Golfe Persique et, partant, vers l'Océan Indien (ce qui suscita la fameuse “Question d'Orient” et constitua le motif principal de la Première Guerre Mondiale ; rappelons que la “Question d'Orient” englobait autant les Balkans que la Mésopotamie, les 2 principaux théâtres de conflit à nos portes ; les 2 zones sont étroitement liées sur le plan géopolitique et géostratégique).
• 3) Éloigner toutes les puissances européennes de la Méditerranée orientale, afin qu'elles ne puissent s'emparer ni de Chypre ni de la Palestine ni de l'isthme égyptien, où l'on envisage déjà de creuser un canal en direction de la Mer Rouge.
La réouverture de l'Escaut
En 1793, la situation a cependant complètement changé en France. La République ne s'enlise pas dans les discussions stériles et la dissension civile, mais tombe dans la Terreur, où les sans-culottes jouent un rôle équivalent à celui des talibans aujourd'hui. En 1794, après la bataille de Fleurus remportée par Jourdan le 25 juin, les armées révolutionnaires françaises s'emparent définitivement des Pays-Bas autrichiens, prennent, avec Pichegru, le Brabant et le port d'Anvers, de même que le Rhin, de Coblence — ville prise par Jourdan en même temps que Cologne — à son embouchure dans la Mer du Nord. Ils réouvrent l'Escaut à la navigation et entrent en Hollande. Le delta des 3 fleuves (Escaut / Meuse / Rhin), qui fait face aux côtes anglaises et à l'estuaire de la Tamise, se trouve désormais aux mains d'une puissance de grande profondeur stratégique (l'Hexagone). La situation nouvelle, après les soubresauts chaotiques de la révolution, est extrêmement dangereuse pour l'Angleterre, qui se souvient que les corsaires hollandais, sous la conduite de l'Amiral de Ruyter, avaient battu 3 fois la flotte anglaise et remonté l'estuaire de la Tamise pour incendier Londres (1672-73) (1). En partant d'Anvers, il faut une nuit pour atteindre l'estuaire de la Tamise, ce qui ne laisse pas le temps aux Anglais de réagir, de se porter en avant pour détruire la flotte ennemie au milieu de la Mer du Nord : d'où leur politique systématique de détacher les pays du Bénélux et le Danemark de l'influence française ou allemande, et d'empêcher une fusion des Pays-Bas septentrionaux et méridionaux, car ceux-ci, unis, s'avèreraient rapidement trop puissants, vu l'union de la sidérurgie et du charbon wallons à la flotte hollandaise (a fortiori quand un empire colonial est en train de se constituer en Indonésie, à la charnière des océans Pacifique et Indien).
Lord Castlereagh proposa à Vienne en 1815 la consolidation et la satellisation du Danemark pour verrouiller la Baltique et fermer la Mer du Nord aux Russes, la création du Royaume-Uni des Pays-Bas (car on ne perçoit pas encore sa puissance potentielle et on ne prévoit pas sa future présence en Indonésie), la création du Piémont-Sardaigne, État-tampon entre la France et l'Autriche, et marionnette de l'Angleterre en Méditerranée occidentale ; Homer Lea théorisera cette politique danoise et néerlandaise de l'Angleterre en 1912 (cf. infra) en l'explicitant par une cartographie très claire, qui reste à l'ordre du jour.
Nelson : Aboukir et Trafalgar
Les victoires de la nouvelle république, fortifiées à la suite d'une terreur bestiale, sanguinaire et abjecte, notamment en Vendée, provoquent un retournement d'alliance : d'instigatrice des menées “dissensionnistes” de la révolution, l'Angleterre devient son ennemie implacable et s'allie aux adversaires prussiens et autrichiens de la révolution (stratégie mise au point par Castlereagh, sur ordre de Pitt). Résultat : un espace de chaos émerge entre Seine et Rhin. Dans les années 1798-99, Nelson va successivement chasser la marine française de la Méditerranée, car elle est affaiblie par les mesures de restriction votées par les assemblées révolutionnaires irresponsables, alors que l'Angleterre avait largement profité du chaos révolutionnaire français pour consolider sa flotte. Par la bataille d'Aboukir, Nelson isole l'armée de Bonaparte en Égypte, puis, les Anglais, avec l'aide des Turcs et en mettant au point des techniques de débarquement, finissent par chasser les Français du bassin oriental de la Méditerranée ; à Trafalgar, Nelson confisque aux Français la maîtrise de la Méditerranée occidentale.
Géostratégiquement, notre continent, à la suite de ces 2 batailles navales, est encerclé par le Sud, grâce à la triple alliance tacite de la flotte anglaise, de l'Empire ottoman et de la Perse. La thalassocratie joue à fond la carte turco-islamique pour empêcher la structuration de l'Europe continentale : une carte que Londres joue encore aujourd'hui. Dans l'immédiat, Bonaparte abandonne à regret toute visée sur l'Égypte, tout en concoctant des plans de retour jusqu'en 1808. Par la force des choses, sa politique devient strictement continentale ; car, s'il avait parfaitement compris l'importance de l'Égypte, position clef sur la route des Indes, et s'il avait pleine conscience de l'atout qu'étaient les Indes pour les Anglais, il ne s'est pas rendu compte que la maîtrise de la mer implique ipso facto une domination du continent, lequel, sans la possibilité de se porter vers le large, est condamné à un lent étouffement. La présence d'escadres suffisamment armées en Méditerranée ne rendait pas la conquête militaire — coûteuse — du territoire égyptien obligatoire.
Dialectique Terre/Mer
Depuis cette époque napoléonienne, notre pensée politique, sur le continent, devient effectivement, pour l'essentiel, une pensée de la Terre, comme l'attestent bon nombre de textes de la première décennie du XIXe siècle, les écrits de Carl Schmitt et ceux de Rudolf Pannwitz.
[cf. R. Steuckers : « Rudolf Pannwitz : “Mort de la Terre”, Imperium Europæum et conservation créatrice », in : Nouvelles de Synergies Européennes n°19, avril 1996 ; « L'Europe entre déracinement et réhabilitation des lieux : de Schmitt à Deleuze », in : Nouvelles de Synergies Européennes n°27, 1997 ; « Les visions d'Europe à l'époque napoléonienne - Aux sources de l'européisme contemporain », in : Nouvelles de Synergies Européennes n°45, 2000]
C'est contre cette limitation volontaire, contre cette “thalassophobie”, que s'insurgeront des hommes comme Friedrich Ratzel (cf. : R. Steuckers, « F. Ratzel (1844-1904) : anthropogéographie et géographie politique », in : Vouloir n°9/ns, 1997) et l'Amiral von Tirpitz. Le Blocus continental, si bien décrit par Bertrand de Jouvenel (cf. : B. de Jouvenel, Napoléon et l'économie dirigée - Le blocus continental, Ed. de la Toison d'Or, Bruxelles, 1942), a des aspects positifs et des aspects négatifs. Il permet un développement interne de l'industrie et de l'agriculture européenne. Mais, par ailleurs, il condamne le continent à une forme dangereuse de “sur place”, où aucune stratégie de mobilité globale n'est envisagée. À l'ère de la globalisation— et elle a commencée dès la découverte des Amériques, comme l'a expliqué Braudel — cette timidité face à la mobilité sur mer est une tare dangereuse, selon Ratzel.
Le plan du Tsar Paul Ier
En 1801, il y a tout juste 200 ans, l'Angleterre doit faire face à une alliance entre le Tsar Paul Ier et Napoléon. L'objectif des 2 hommes est triple :
- 1) Ils veulent s'emparer des Indes et les Français, qui se souviennent de leurs déboires dans ce sous-continent, tentent de récupérer les atouts qu'ils y avaient eus,
- 2) Ils veulent bousculer la Perse, alors alliée des Anglais, grâce aux talents d'un très jeune officier, le fameux Malcolm, qui, enfant, avait appris à parler persan à la perfection, et qui fut nommé capitaine à 13 ans et général à 18,
- 3) Ils cherchent les moyens capables de réaliser le Plan d'invasion de Paul Ier : acheminer les troupes françaises via le Danube et la Mer Noire (et nous trouvons exactement les mêmes enjeux qu'aujourd'hui !), tandis que les troupes russes, composées essentiellement de cavaliers et de cosaques, marcheraient à travers le Turkestan vers la Perse et l'Inde. Dans les conditions techniques de l'époque, ce plan s'est avéré irréalisable, parce qu'il n'y avait pas encore de voies de communication valables. Le Tsar conclut qu'il faut en réaliser (en germe, nous avons le projet du Transsibérien, qui sera réalisé un siècle plus tard, au grand dam des Britanniques).
En 1804, malgré qu'elle ne soit plus l'alliée de la France napoléonienne, la Russie marque des points dans le Caucase, amorce de ses avancées ultérieures vers le cœur de l'Asie centrale. Ces campagnes russes doivent être remises aujourd'hui dans une perspective historique bien plus vaste, d'une profondeur temporelle immémoriale : elles visent, en réalité, à parfaire la mission historique des peuples indo-européens, et à rééditer les exploits des cavaliers indo-iraniens ou proto-iraniens qui s'étaient répandu dans toute l'Asie centrale vers 1600 av. JC. Les momies blanches du Sinkiang chinois prouvent cette présence importante et dominante des peuples indo-européens (dont les Proto-Tokhariens) au cœur du continent asiatique. Ils ont fort probablement poussé jusqu'au Pacifique. Les Russes, du temps de Catherine II et de Paul Ier, ont parfaitement conscience d'être les héritiers de ces peuples et savent intimement que leur présence attestée en Asie centrale avant les peuples mongols ou turcs donne à toute l'Europe une sorte de droit d'aînesse dans ces territoires. L'antériorité de la conquête et du peuplement proto-iraniens en Asie centrale ôte toute légitimité à un contrôle mongol ou turc de la région, du moins si on raisonne sainement, c'est-à-dire si on raisonne avec longue mémoire, si on forge ses projets sur base de la plus profonde profondeur temporelle. Des Proto-Iraniens à Alexandre le Grand et à Brejnev, qui donne l'ordre à ses troupes de pénétrer en Afghanistan, la continuité est établie.
La ligne Balkhach/Aral/Caspienne/Volga
L'analyse cartographique de Colin MacEvedy, auteur de nombreux atlas historiques, montre que lorsqu'un peuple non européen se rend maître de la ligne Lac Balkhach, Mer d'Aral, Mer Caspienne, cours de la Volga, il tient l'Europe à sa merci. Effectivement, qui tient cette ligne, que Brzezinski appelle la “Silk Road”, est maître de l'Eurasie tout entière, de la fameuse “Route de la Soie” et de la Terre du Milieu (Heartland). Quand ce n'est pas un peuple européen qui tient fermement cette ligne, comme le firent les Huns et les Turcs, l'Europe entre irrémédiablement en déclin. Les Huns s'en sont rendu maîtres puis ont débouché, après avoir franchi la Volga, dans la plaine de Pannonie (la future Hongrie) et n'ont pu être bloqués qu'en Champagne. Les Avars, puis les Magyars (arrêtés à Lechfeld en 955), ont suivi exactement la même route, passant au-dessus de la rive septentrionale de la Mer Noire. De même, les Turcs seldjoukides, passant, eux, par la rive méridionale, prendront toute l'Anatolie, détruiront l'Empire byzantin, remonteront le Danube vers la plaine hongroise pour tenter de conquérir l'Europe et se retrouveront 2 fois devant Vienne.
En 1838, les Britanniques prévoient que les Russes, s'ils continuent sur leur lancée, vont arriver en Inde et établir une frontière commune avec les possessions britanniques dans le sous-continent indien. D'où, bons connaisseurs des dynamiques et des communications dans la région, ils forgent la stratégie qui consiste à occuper la Route de la Soie sur son embranchement méridional et sur sa portion qui va de Herat à Peshawar, point de passage obligatoire de toutes les caravanes, comme, aujourd'hui, de tous les futurs oléoducs, enjeux réels de l'invasion récente de l'Afghanistan par l'armée américaine. On constate donc que le but de guerre de 1838 ne s'est réalisé qu'aujourd'hui seulement !
Un Afghanistan jusqu'ici imprenable
Sur le plan stratégique, il s'agissait, pour les Anglais de l'époque, de :
- 1) protéger l'Inde par une plus vaste profondeur territoriale, sous la forme d'un glacis afghano-himalayen, sinon l'Inde risquait, à terme, de n'être qu'un simple réseau de comptoirs littoraux, plus difficilement défendable contre une puissance bénéficiant d'un vaste hinterland centre-asiatique (les Anglais tirent les leçons de la conquête de l'Inde par les Moghols islamisés) ;
- 2) de contenir la Russie selon les principes énoncés en 1791 pour la Mer Noire, cette fois le long de la ligne Herat-Peshawar (cf. à ce propos, K. Marx & F. Engels, Du colonialisme en Asie - Inde, Perse, Afghanistan, Mille et une nuits, n°372, 2002). Les opérations anglaises en Afghanistan se solderont en 1842 par un désastre total, seule une poignée de survivants reviendront à Peshawar, sur une armée de 17.000 hommes. La victoire des tribus afghanes contre les Anglais en 1842 sauvera l'indépendance du pays. Jusque aujourd'hui, en effet, mise à part la tentative soviétique de 1979 à Gorbatchev, l'Afghanistan restera imprenable, donc indépendant. Un destin dont peu de pays musulmans ont pu bénéficier.
De 1852 à 1854 a lieu la Guerre de Crimée. L'alliance de l'Angleterre, de la France et de la Turquie conteste les positions russes en Crimée, exactement selon les critères avancés par l'Angleterre depuis 1783. En 1856, au terme de cette guerre, perdue par la Russie sur son propre terrain, le Traité de Paris limite la présence russe en Mer Noire, ou la rend inopérante, et lui interdit l'accès aux Détroits. En 1878, les armées russes, appuyées par des centaines de milliers de volontaires balkaniques, serbes, roumains et bulgares, libèrent les Balkans de la présence turque et avancent jusqu'aux portes de Constantinople, qu'elles s'apprêtent à libérer du joug ottoman. Le Basileus byzantin a failli être vengé. Mais l'Angleterre intervient à temps pour éviter l'effondrement définitif de la menace ottomane qui avait pesé sur l'Europe depuis la défaite serbe sur le Champ des Merles en 1389. Tous ces événements historiques vont contribuer à faire énoncer clairement les concepts de la géopolitique moderne.
Mackinder et Lea : deux géopolitologues toujours actuels
En effet, en 1904, Halford John MacKinder prononce son fameux discours sur le “pivot” de l'histoire mondiale, soit la “Terre du Milieu” ou “Heartland”, correspondant à l'Asie centrale et à la Sibérie occidentale. Les états-majors britanniques sont alarmés : le Transsibérien vient d'être inauguré, donnant à l'armée russe la capacité de se mouvoir beaucoup plus vite sur la terre. Le handicap des armées de Paul Ier et de Napoléon, incapables de marcher de concert vers la Perse et les Indes en 1801, est désormais surmonté. En 1912, Homer Lea, géopolitologue et stratège américain, favorable à une alliance indéfectible avec l'Empire britannique, énonce, dans The Day of the Saxons, les principes généraux de l'organisation militaire de l'espace situé entre Le Caire et Calcutta. Dans le chapitre consacré à l'Iran et à l'Afghanistan, Homer Lea explique qu'aucune puissance — en l'occurrence, il s'agit de la Russie — ne peut franchir la ligne Téhéran-Kaboul et se porter trop loin en direction de l'Océan Indien. De 1917 à 1921, le grand souci des stratèges britanniques sera de tirer profit des désordres de la révolution bolchevique pour éloigner le pouvoir effectif, en place à Moscou, des rives de la Mer Noire, du Caucase et de l'Océan Indien.
Les préliminaires de cette révolution bolchevique, qui ont lieu immédiatement après le discours prémonitoire de MacKinder en 1904 sur le pivot géographique de l'histoire et sur les “dangers” du Transsibérien pour l'impérialisme britannique, commencent dès 1905 par des désordres de rue, suivis d'un massacre qui ébranle l'Empire et permet de décrire le Tsar comme un monstre (qui redeviendra bon en 1914, comme par l'effet d'un coup de baguette magique !). Selon toute vraisemblance, les services britanniques tentent de procéder de la même façon en Russie, dans la première décennie du XXe siècle, qu'en France à la fin du XVIIIe : susciter une révolution qui plongera le pays dans un désordre de longue durée, qui ne lui permettra plus de faire des investissements structurels majeurs, notamment des travaux d'aménagement territorial, comme des lignes de chemin de fer ou des canaux, ou dans une flotte capable de dominer le large. Les 2 types de projets politiques que combattent toujours les Anglo-Saxons sont justement :
- 1) les aménagements territoriaux, qui structurent les puissances continentales et diminuent ipso facto les atouts d'une flotte et de la mobilité maritime, et qui permettent l'autarcie commerciale ;
- 2) la construction de flottes concurrentes. La France de 1783, la Russie de 1904 et l'Allemagne de Guillaume II développaient toutes 3 des projets de cette nature : elles se plaçaient par conséquent dans le collimateur de Londres.
De 1905 à 1917
Pour détruire la puissance russe, bien équipée, dotée de réserves immenses en matières premières, l'Angleterre va utiliser le Japon, qui était alors une puissance émergeante, depuis la proclamation de l'ère Meiji en 1868. Londres et une banque new-yorkaise — la même qui financera Lénine à ses débuts — vont prêter les sommes nécessaires aux Japonais pour qu'ils arment une flotte capable d'attirer dans le Pacifique la flotte russe de la Baltique et de la détruire. C'est ce qui arrivera à Tshouchima (pour les tenants et aboutissants de cet épisode, cf. notre article sur le Japon : R. Steuckers, « La lutte du Japon contre les impérialismes occidentaux », in : Nouvelles de Synergies Européennes n°32, 1998).
En 1917, on croit que la Russie va être plongée dans un désordre permanent pendant de longues décennies. On pense :
- 1) détacher l'Ukraine de la Russie ou, du moins, détruire l'atout céréalier de cette région d'Europe, grenier à blé concurrent de la Corn Belt américaine ;
- 2) on spécule sur l'effondrement définitif du système industriel russe ;
- 3) on prend prétexte du caractère inacceptable de la révolution et de l'idéologie bolcheviques pour ne pas tenir les promesses de guerre faites à la Russie pour l'entraîner dans le carnage de 1914 ; devenue bolchevique, la Russie n'a plus droit à aucune conquête territoriale au-delà du Caucase au détriment de la Turquie ; ne reçoit pas d'accès aux Détroits ; on ne lui fait aucune concession dans les Balkans et dans le Delta du Danube (les principes du mémorandum de 1791 et du Traité de Paris de 1856 sont appliqués dans le nouveau contexte de la soviétisation de la Russie).
En 1918-19, les troupes britanniques et américaines occupent Mourmansk et asphyxient la Russie au Nord ; Britanniques et Turcs, réconciliés, occupent le flanc méridional du Caucase, en s'appuyant notamment sur des indépendantistes islamiques azéris turcophiles (exactement comme aujourd'hui) et en combattant les Arméniens, déjà si durement étrillés, parce qu'ils sont traditionnellement russophiles (ce scénario est réitéré de nos jours) ; plus tard, Enver Pacha, ancien chef de l'état-major turc pendant la première guerre mondiale, organise, au profit de la stratégie globale des Britanniques, des incidents dans la zone-clef de l'Asie centrale, la Vallée de la Ferghana.
De la “Question d'Orient” à la révolte arabe
L'aventure d'Enver Pacha dans la Vallée de la Ferghana, qui s'est terminée tragiquement, constitue une application de ce que l'on appelle désormais la “stratégie lawrencienne” (cf.: Jean Le Cudennec, « Le point sur la guerre américaine en Afghanistan : le modèle “lawrencien” », in : Raids n°189, fév. 2002). Comme son nom l'indique, elle désigne la stratégie qui consiste à lever des “tribus” hostiles à l'ennemi sur le propre territoire de celui-ci, comme Lawrence d'Arabie avait mobilisé les tribus arabes contre les Turcs, entre 1916 et 1918. Déboulant du fin fonds du désert, fondant sur les troupes turques en Mésopotamie et le long de la vallée du Jourdain, la révolte arabe, orchestrée par les services britanniques, annihile, par le fait même de son existence, la fonction de “tremplin” vers le Golfe Persique et l'Océan Indien que le binôme germano-turc accordait au territoire anatolien et mésopotamien de l'Empire ottoman. L'objectif majeur de la Grande Guerre est atteint : la grande puissance européenne, qui avait le rôle du challengeur le plus dangereux, et son espace complémentaire balkano-anatolo-mésopotamien (Ergänzungsraum), n'auront aucune “fenêtre” sur la Mer du Milieu (l'Océan Indien), qui, quadrillé par une flotte puissante, permet de tenir en échec la “Terre du Milieu” (le “Heartland” de MacKinder).
Après les traités de la banlieue parisienne, les Alliés procèdent au démantèlement du bloc ottoman, désormais divisé en une Anatolie turcophone et sunnite, et une mosaïque arabe balkanisée à dessein, où se juxtaposent des chiites dans le Sud de l'Irak, des Alaouites en Syrie, des chrétiens araméens, orthodoxes, de rite arménien ou autre, nestoriens, etc. et de larges masses sunnites, dont des wahhabites dans la péninsule arabique ; le personnage central de la nouvelle république turque devient Moustafa Kemal Atatürk, aujourd'hui en passe de devenir un héros du cinéma américain (cf. : Michael Wiesberg, « Pourquoi le lobby israélo-américain s'engage-t-il à fond pour la Turquie ? Parce que la Turquie donne accès aux pétroles du Caucase », in : Au fil de l'épée, Recueil n°3, oct. 1999).
Les atouts de l'idéologie d'Atatürk
Atatürk est un atout considérable pour les puissances thalassocratiques : il crée une nouvelle fierté turque, un nouveau nationalisme laïc, bien assorti d'un solide machisme militaire, sans que cette idéologie vigoureuse et virile, qui sied aux héritiers des Janissaires, ne mette les plans britanniques en danger ; Atatürk limite en effet les ambitions turques à la seule Anatolie : Ankara n'envisage plus de reprendre pied dans les Balkans, de porter ses énergies vers la Palestine et l'Égypte, de dominer la Mésopotamie, avec sa fenêtre sur l'Océan Indien, de participer à l'exploitation des gisements pétroliers nouvellement découverts dans les régions kurdes de Kirkouk et de Mossoul, de contester la présence britannique à Chypre ; le “turcocentrisme” de l'idéologie kémaliste veut un développement séparé des Turcs et des Arabes et refuse toute forme d'État, de khanat ou de califat regroupant à la fois des Turcs et des Arabes ; dans une telle optique, la reconstitution de l'ancien Empire ottoman se voit d'emblée rejetée et les Arabes, livrés à la domination anglaise. On laisse se développer toutefois, en marge du strict laïcisme kémaliste, une autre idéologie, celle du panturquisme ou pantouranisme, qu'on instrumentalisera, si besoin s'en faut, contre la Russie, dans le Caucase et en Asie centrale. De même, le turcocentrisme peut s'avérer utile si les Arabes se montrent récalcitrants, ruent dans les brancards et manifestent leurs sympathies pour l'Axe, comme en Irak en 1941, ou optent pour une alliance pro-soviétique, comme dans les années 50 et 60 (Égypte, Irak, Syrie). Dans tous ces cas, la Turquie aurait pu ou pourra jouer le rôle du père fouettard.
Le rôle de l'État d'Israël
Israël, dans le jeu triangulaire qui allie ce nouveau pays, né en 1948, aux États-Unis (qui prennent le relais de l'Angleterre), et à la Turquie — dont la fonction de “verrou” se voit consolidée — a pour rôle de contrôler le Canal de Suez si l'Égypte ne se montre pas suffisamment docile. Au sud du désert du Néguev, Israël possède en outre une fenêtre sur la Mer Rouge, à Akaba, permettant, le cas échéant, de pallier toute fermeture éventuelle du Canal de Suez en créant la possibilité matérielle d'acheminer des troupes et des matériels via un système de chemin de fer ou de routes entre la côte méditerranéenne et le Golfe d'Akaba (distance somme toute assez courte ; la même stratégie logistique a été utilisée du Golfe à la Caspienne, à travers l'Iran occupé, dès 1941 ; le matériel américain destiné à l'armée soviétique est passé sur cette voie, bien plus longue que la distance Méditerranée-Akaba et traversant de surcroît d'importants massifs montagneux).
Dans ce contexte, très effervescent, où ont eu lieu toutes les confrontations importantes d'après 1945, voyons maintenant quelle est, plus spécifiquement, la situation de l'Afghanistan.
Entre l'année 1918, ou du moins après l'échec définitif des opérations envisagées par Enver Pacha et ses commanditaires, et l'année 1979, moment où arrivent les troupes soviétiques, l'Afghanistan est au frigo, vit en marge de l'histoire. En 1978 et 1979, années où l'Iran est agité par la révolution islamiste de Khomeiny, l'URSS tente de réaliser le vieux rêve de Paul Ier : foncer vers les rives de l'Océan Indien, procéder au “grand bond vers le Sud” (comme le qualifiera Vladimir Jirinovski dans un célèbre mémorandum géopolitique, qui suscita un scandale médiatique planétaire).
Guerre indirecte et “counter-insurgency”
Les États-Unis, héritiers de la stratégie anglaise dans la région, ne vont pas tarder à réagir. Le Président démocrate, Jimmy Carter, perd les élections de fin 1980, et Reagan, un faucon, arrive au pouvoir en 1981. Le nouveau président républicain dénonce la coexistence pacifique et rejette toute politique d'apaisement, fait usage d'un langage apocalyptique, avec abus du terme “Armageddon”. Ce vocabulaire apocalyptique, auquel nous sommes désormais habitués, revient à l'avant-plan dans les médias, au début du premier mandat de Reagan : on parle à nouveau de “Grand Satan” pour désigner la puissance adverse et son idéologie communiste. Sur le plan stratégique, la parade reaganienne est simple : c'est d'organiser en Afghanistan une guerre indirecte, par personnes interposées, plus exactement, par l'intermédiaire d'insurgés locaux, hostiles au pouvoir central ou principal qui se trouve, lui, aux mains de l'ennemi diabolisé. Cette stratégie s'appelle la counter-insurgency et est l'héritière actuelle des sans-culottes manipulés contre Louis XVI, des Vendéens excités contre la Convention — parce qu'elle a fini par tenir Anvers — et puis ignoblement trahis (affaire de Quiberon), des insurgés espagnols contre Napoléon, des guérilleros philippins armés contre les Japonais, etc.
En Afghanistan, la counter-insurgency se déroule en 3 étapes : on arme d'abord les “moudjahiddins”, qui opèrent en alliant anti-communisme, islamisme et nationalisme afghan, pendant toute la période de l'occupation soviétique. Le harcèlement des troupes soviétiques par ces combattants bien enracinés dans le territoire et les traditions de l'Afghanistan a été systématique, mais sans les armements de pointe, notamment les missiles “Stinger” fournis par les États-Unis et financés par la drogue, ces guerriers n'auraient jamais tenu le coup.
Seconde étape : entre 1989 et 1995/96, nous assistons en Afghanistan à une sorte de modus vivendi. Les troupes soviétiques se sont retirées, la Russie a cessé d'adhérer à l'idéologie communiste et de la professer. De ce fait, la diabolisation, le discours sur le “Grand Satan” n'est plus guère instrumentalisable, du moins dans la version établie au temps de Reagan. La troisième étape commence avec l'arrivée sur la scène afghane des talibans, moudjahiddins plus radicaux dans leur islam de facture wahhabite. Il s'agit d'organiser une counter-insurgency contre un gouvernement central afghan russophile, qui entend conserver la neutralité traditionnelle de l'Afghanistan, acquise depuis la terrible défaite subie par les troupes britanniques en 1842, neutralité qui avait permis au pays de rester à l'écart des 2 guerres mondiales.
Ben Laden, l'ISI et Leila Helms
Les talibans déploient leur action avec le concours de l'Arabie Saoudite, dont est issu leur maître à penser, Oussama Ben Laden, du Pakistan et de son solide service secret, l'ISI, et des services américains agissant sous l'impulsion de Leila Helms. Les Saoudiens fournissent les fonds et l'idéologie, l'ISI pakistanais assure la logistique et les bases de repli sur les territoires peuplés par l'ethnie pachtoune. Les 2 experts français Brisard et Dasquié (cf. JC Brisard & G. Dasquié, Ben Laden - La vérité interdite, Denoël, 2001) explicitent clairement le rôle joué par Leila Helms dans leur ouvrage magistral, bien diffusé et immédiatement traduit en allemand (cette simultanéité laisse espérer une cohésion franco-allemande, critique à l'égard de l'unilatéralisme américain). Toutefois, dans ce jeu, chacun des acteurs poursuit ses propres objectifs. Dans le livre de Brisard et Dasquié, le double jeu de Ben Laden est admirablement décortiqué ; par ailleurs Bauer et Raufer (cf. : Alain Bauer & Xavier Raufer, La guerre ne fait que commencer - Réseaux, financements, armements, attentats… les scénarios de demain, JC Lattès, 2002) soulignent le risque d'une exportation dans les banlieues françaises (et ailleurs en Europe) d'une effervescence anti-européenne, conduisant à terme à la dislocation totale de nos sociétés.
Le pétrole et le coton
Les objectifs immédiats des États-Unis, tant dans l'opération consistant à appuyer les talibans de manière inconditionnelle, que dans l'opération ultérieure actuelle, visant à les chasser du pouvoir à Kaboul sont de 2 ordres ; le premier est avoué, tant il est patent : il s'agit de gérer correctement l'acheminement du pétrole de la Caspienne et de l'Asie centrale via les futurs oléoducs transafghans. Le second est généralement inavoué : il s'agit de gérer la production du coton en Asie centrale, de faire main basse, au profit des grands trusts américains du coton, de cette matière première essentielle pour l'habillement de milliards d'êtres humains sur la planète. L'exploitation conjointe des nappes pétrolifères et des champs de culture du coton pourrait transformer cette grande région en un nouvel Eldorado.
Les deux anacondas
La gestion optimale de l'opération militaire, prélude à une gigantesque opération économique, est désormais possible, à moindres frais, grâce à la couverture de satellites que possèdent désormais les Américains. Haushofer, le géopolitologue allemand, disait que les flottes des thalassocraties parvenaient à étouffer tout développement optimal des grandes puissances continentales, à occuper des bandes littorales de comptoirs soustraites à toute autorité politique venue de l'intérieur des terres, à priver ces dernières de débouchés sur les océans. Haushofer utilisait une image expressive pour désigner cet état de choses : l'anaconda qui enserre sa proie, c'est-à-dire les continents eurasien et sud-américain. Si les flottes anglo-saxonnes des premières décennies du XXe siècle, consolidées par le traité foncièrement inégal que fut ce Traité de Washington de 1922, sont le premier anaconda, il en existe désormais un nouveau, maître de l'espace, autre res nullius à l'instar des mers au XVIIIe siècle. Le réseau des satellites observateurs américains constitue le second anaconda, enserrant la terre tout entière.
Le réseau des satellites consolide un autre atout que se sont donné les puissances anglo-saxonnes depuis la Seconde Guerre mondiale : les flottes de bombardiers lourds. Il faut se rappeler la métaphore de Swift, dans les fameux Voyages de Gulliver, où un peuple, vivant sur une île flottant dans les airs, écrase ses ennemis selon 3 stratégies : le lancement de gros blocs de roche sur les installations et les habitations du peuple ennemi, le maintien en état stationnaire de leur île volante au-dessus du territoire ennemi afin de priver celui-ci de la lumière du soleil, ou la destruction totale du pays ennemi en faisant atterrir lourdement l'île volante sur une ville ou sur la capitale afin de la détruire totalement. Indubitablement, ce récit imaginaire de Swift, répété à tous les Anglais pendant des générations, a donné l'idée qu'une supériorité militaire aérienne totale, capable d'écraser complètement le pays ennemi, était indispensable pour dominer définitivement le monde. Toutefois la théorisation du bombardement de terreur par l'aviation vient du général italien Douhet (cf. : Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie - Des origines au nucléaire, Laffont, 1990). Elle sera mise en application par les “Bomber Commands” britannique et américain pendant la Seconde Guerre mondiale, mais au prix de plus de 200.000 morts, rien que dans les forces aériennes. Aujourd'hui, la couverture spatiale, les progrès de l'avionique en général et la précision des missiles permettent une utilisation moins coûteuse en hommes de l'arme aérienne (de l'air power). C'est ainsi qu'on envisage des opérations de grande envergure avec “zéro mort”, côté américain, côté “Empire du Bien”, et un maximum de cadavres et de désolation, côté adverse, côté “Axe du Mal”.
Face à la situation afghane actuelle, qui est le résultat d'une politique délibérée, forgée depuis près de 2 siècles, avec une constance étonnante, quels sont les déboires, les possibilités, les risques qui existent pour l'Europe, quelle est notre situation objective ?
Les déboires de l'Europe :
◊ 1. Nous avons perdu sur le Danube, car un complot de même origine a visé l'élimination physique ou politique de 4 hommes, très différents les uns des autres quant à leur carte d'identité idéologique : Ceaucescu, Milosevic, Haider et Kohl (voire Stoiber). À la suite d'une guerre médiatique et de manipulations d'images (avec les faux charniers de Timisoara), le dictateur communiste roumain est éliminé. On a pu penser, comme nous-mêmes, à la liquidation d'une mauvaise farce, mais ce serait oublier que ce personnage balkanique haut en couleur avait réussi vaille que vaille à organiser les “cataractes” du Danube, à faire bâtir 2 ponts reliant les rives roumaine et bulgare du grand fleuve et à creuser le canal “Danube - Mer Noire” (62,5 km de long, afin d'éviter la navigation dans les méandres du delta). Notons que le creusement de ce canal avait mécontenté les Soviétiques qui ont un droit d'accès au delta, mais non pas à un canal construit par le peuple roumain. Même si l'arbitraire du régime de Ceaucescu peut être jugé a posteriori pénible et archaïque, force est de constater que sa disparition n'a pas apporté un ordre clair au pays, capable de poursuivre un projet danubien cohérent ou de générer des fonds suffisants pour financer de tels travaux.
Milosevic, le Danube et l'Axe Dorien
Les campagnes médiatiques visant à diaboliser Milosevic ont 2 raisons géopolitiques majeures : créer sur le cours du Danube, à hauteur de Belgrade, point stratégique important comme l'attestent les rudes combats austro-ottomans pour s'emparer de cette place, une zone soustraite à toute activité normale, via les embargos. L'embargo ne sert pas à punir des “méchants”, comme veulent nous le faire croire les médias aux ordres, mais à créer artificiellement des vides dans l'espace, à soustraire à la dynamique spatiale et économique des zones visées, potentiellement puissantes, afin de gêner des puissances concurrentes plus fortes. La Serbie, de dimensions fort modestes, n'est pas un concurrent des États-Unis ; par conséquent son élimination n'a pas été le véritable but en soi ; l'objectif visé était manifestement autre ; dès lors, il s'est agi d'affaiblir des puissances plus importantes.
Dans la région, ce ne peut être que l'Europe en général et son cœur germanique en particulier. Enfin, le vide créé en Serbie par la politique d'embargo, empêche tout consortium euro-serbe, toute fédération balkanique ou tout resserrement de liens entre petites puissances balkaniques (comme la Grèce et la Serbie), empêche d'organiser définitivement le corridor Belgrade - Salonique, excellente “fenêtre” de l'Europe centrale sur la Méditerranée orientale, que nous avions appelé naguère “l'Axe Dorien”.
Haider et Kohl : dénominateur commun : le Danube
Les campagnes de diffamation contre Jörg Haider relèvent d'une même volonté de troubler l'organisation du trafic danubien. Les tentatives, heureusement avortées, d'organiser un boycott contre l'Autriche, auraient installé une deuxième zone “neutralisée”, un deuxième vide, sur le cours du grand fleuve qui est vraiment l'artère vitale de l'Europe. Enfin, le Chancelier allemand Helmut Kohl, qui a réalisé le plus ancien rêve européen d'aménagement territorial, soit le creusement du Canal Rhin - Main - Danube, a été promptement évacué de la scène allemande à la suite d'une campagne de presse l'accusant de corruptions diverses (mais bien bénignes à côté de celles auxquelles les féaux de l'OTAN se sont livrées au cours des décennies écoulées). Son successeur, à la tête des partis de l'Union chrétienne-démocrate (CDU/CSU), le Bavarois Stoiber, a subi, à son tour, des campagnes de diffamations infondées, qui l'ont empêché d'accéder aux commandes de la RFA — du moins jusqu'à nouvel ordre.
◊ 2. Nous avons perdu dans le Caucase. L'Azerbaïdjan est complètement inféodé à la Turquie, fait la guerre aux Arméniens au Nagorni-Karabakh, s'aligne sur les positions anti-russes de l'Otan, coince l'Arménie résiduaire (ex-république soviétique) entre la Turquie et lui-même, ne permettant pas des communications optimales entre la Russie, l'Arménie et l'Iran (ou le Kurdistan potentiel). En Tchétchénie et au Daghestan, les troubles suscités par des fondamentalistes financés par l'Arabie Saoudite — également soutenus par les services turcs travaillant pour les États-Unis — empêchent l'exploitation des oléoducs et réduisent l'influence russe au nord de la chaîne du Caucase. Plus récemment, la Géorgie de Chevarnadze, en dépit de la solidarité orthodoxe qu'elle devrait avoir avec la Russie et l'Arménie, vient de s'aligner sur la Turquie et les États-Unis. Ces 3 faisceaux d'événements contribuent à empêcher l'organisation des communications en Mer Noire, dans le Caucase et dans la Caspienne.
Du “containment” de l'Iran
◊ 3. Nous avons perdu sur la ligne Herat - Ladakh, dans le Cachemire. Le verrouillage pakistanais des hauteurs himalayennes au Cachemire sert à empêcher l'établissement de toute frontière commune entre la Russie (ou une république post-soviétique qui resterait fidèle à une alliance russe) et l'Inde. La présence américaine à Herat, par fractions de l'Alliance du Nord interposées, permet aussi de placer un premier pion dans le containment de l'Iran. Celui-ci est désormais coincé entre une Turquie totalement dépendante des États-Unis et un glacis afghan dominé par ces derniers. Il reste à éliminer l'Irak pour parfaire l'encerclement de l'Iran, prélude à son lent étouffement ou à son invasion (comme pendant l'été de 1941).
◊ 4. Nous avons perdu dans les mers intérieures. Les 2 mers intérieures qui sont le théâtre de conflits de grande ampleur depuis plus d'une décennie sont l'Adriatique et le Golfe Persique. Ces 2 mers intérieures, comme j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de le démontrer, sont les 2 espaces maritimes (avec la Mer Noire) qui s'enfoncent le plus profondément dans l'intérieur des terres immergées de la masse continentale eurasienne. La Guerre du Golfe (et celles qui s'annoncent dans de brefs délais), de même que les complots américains qui ont amené à la chute du Shah (cf. : Houchang Nahavandi, La révolution iranienne - Vérité et mensonges, L'Âge d'Homme, 1999), visent non seulement à contrôler l'embouchure des 2 grands fleuves mésopotamiens, artères du Croissant Fertile, soit le Chatt El Arab, et à contenir l'Iran sur la rive orientale du Golfe.
La révolution islamiste d'Iran a eu la même fonction que la révolution sans-culotte en France ou la révolution bolchevique en Russie : créer le chaos, abattre un régime raisonnable en passe de réaliser de grands travaux d'infrastructure et d'aménagement territorial, et, dès que le nouveau régime révolutionnaire se stabilise, l'attaquer de front et appeler à la croisade contre lui, sous prétexte qu'il incarnerait une nouveauté perverse et diabolique.
Quant à l'idée de verrouiller l'Adriatique, elle apparaît évidente dès que l'Allemagne et l'Autriche, par l'intermédiaire d'une petite puissance qui leur est traditionnellement fidèle, comme la Croatie, accèdent à nouveau à la Méditerranée via les ports du Nord de l'Adriatique. Ce verrouillage aura lieu exactement comme au temps de la domination ottomane (éphémère) sur ces mêmes eaux, à hauteur du Détroit d'Otrante, dominé par l'Albanie.
Formuler une stratégie claire
Face à cette quadruple défaite européenne, il convient de formuler une stratégie claire, un programme d'action général pour l'Europe (qu'il sera très difficile de coordonner au départ, les Européens ayant la sale habitude de tirer toujours à hue et à dia et de travailler dans le désordre). Ce programme d'action contient les points suivants :
◊ Les Européens doivent montrer une unité inflexible dans les Balkans, s'opposer de concert à toute présence américaine et turque dans la péninsule sud-orientale de notre continent. Cette politique doit également viser à neutraliser, dans les Balkans eux-mêmes et dans les diasporas albanaises disséminées dans toute l'Europe, les réseaux criminels (prostitution, trafic de drogues, vol d'automobiles), liés aux structures albanaises anti-serbes et anti-macédoniennes, ainsi qu'au binôme mafias-armée de Turquie et à certains services américains. La cohésion diplomatique européenne dans les Balkans passe dès lors par un double travail : en politique extérieure — faire front à toute réimplantation de la Turquie dans les Balkans — et en politique intérieure — faire front à toute installation de mafias issues de ces pays et jouant un double rôle, celui de déstabiliser nos sociétés civiles et celui de servir de cinquièmes colonnes éventuelles.
◊ Les Européens doivent travailler de concert à ôter toute marge de manœuvre à la Turquie dans ses manigances anti-européennes. Cette politique implique :
• 1) d'évacuer de Chypre toutes les unités militaires et les administrations civiles turques et de permettre à toutes les familles grecques expulsées lors de l'agression de l'été 1974 de rentrer dans leurs villages ancestraux ; d'évacuer vers la Turquie tous les “nouveaux” Cypriotes turcs, non présents sur le territoire annexé avant l'invasion de 1974 ;
• 2) d'obliger la Turquie à renoncer à toute revendication dans l'Égée, car la conquête de l'Ionie s'est faite à la suite d'un génocide inacceptable à l'encontre de la population grecque, consécutif d'un autre génocide, tout aussi impitoyable, dirigé contre les Arméniens ; la Turquie n'a pas le droit de revendiquer la moindre parcelle de terrain ou les moindres eaux territoriales dans l'Égée ; la Grèce, et derrière elle une Europe consciente de ses racines, a, en revanche, le droit inaliénable de revendiquer le retour de l'Ionie à la mère patrie européenne ; la Turquie dans ce contexte, doit faire amende honorable et s'excuser auprès des communautés chrétiennes orthodoxes du monde entier pour avoir massacré jadis le Patriarche de Smyrne, d'une manière particulièrement effroyable (le cas échéant payer des réparations sur son budget militaire) ;
• 3) d'obliger la Turquie à cesser toute agitation auprès des musulmans de Bulgarie ;
• 4) d'obliger la Turquie à cesser toute manœuvre contre l'Arménie, avec la complicité de l'Azerbaïdjan ; de même, à cesser tout soutien aux terroristes tchétchènes ;
• 5) l'Europe, dans ce contexte, doit se poser comme protectrice des minorités orthodoxes en Turquie ; au début du siècle, celles-ci constituaient au moins 25% de la population sous la souveraineté ottomane ; elles ne sont plus que 1% aujourd'hui ; cette élimination graduelle d'un quart de la population interdit à la Turquie de faire partie de l'UE ;
• 6) d'obliger la Turquie à évacuer toutes ses troupes disséminées en Bosnie et au Kosovo ;
• 7) de faire usage des droits de veto des États européens au sein de l'OTAN, au moins tant que les problèmes de Chypre et d'Arménie ne sont pas résolus ; dans la même logique, refuser toute forme d'adhésion de la Turquie à l'UE.
La question du Danube
◊ La politique commune d'une Europe rendue à elle-même, à ses racines et ses traditions historiques, doit évidemment travailler à rendre la circulation libre sur le Danube, depuis le point où ce fleuve devient navigable en Bavière jusqu'à son embouchure dans la Mer Noire. Le problème de la navigation sur le Danube est fort ancien et n'a jamais pu être réglé, à cause de la rivalité austro-russe au XIXe siècle, des retombées des 2 guerres mondiales dont la rivalité hungaro-roumaine pendant l'entre-deux-guerres, et de la présence du Rideau de Fer pendant 4 décennies. Le dégel et la fin de la guerre froide auraient dû remettre à l'ordre du jour cette question cruciale d'aménagement territorial sur notre continent, dès 1989, dès la chute de Ceaucescu. L'impéritie de nos gouvernants a permis aux Américains et aux Turcs de prendre les devants et de gêner les flux sur l'artère danubienne ou dans l'espace du bassin danubien. Une logique qu'il faut impérativement inverser.
Le corridor Belgrade/Salonique
◊ L'Europe doit avoir pour objectif de réaliser une liaison optimale entre Belgrade et Salonique, par un triple réseau de communications terrestres, c'est-à-dire autoroutier, ferroviaire, fluvial (avec l'aménagement de 2 rivières balkaniques, la Morava et le Vardar, selon des plans déjà prévus avant la tourmente de 1940, auxquels Anton Zischka fait référence dans C'est aussi l'Europe, Laffont, 1960). Le trajet Belgrade Salonique est effectivement le plus court entre la Mitteleuropa danubienne et l'Egée, soit le bassin oriental de la Méditerranée.
◊ L'Europe doit impérativement se projeter, selon ce que nous appelons l'Axe Dorien, vers le bassin oriental de la Méditerranée, ce qui implique notamment une maîtrise stratégique de Chypre, donc la nécessité de forcer la Turquie à l'évacuer. L'adhésion prochaine de Chypre à l'UE devrait aussi impliquer le stationnement de troupes européennes (en souvenir des expéditions médiévales et de Don Juan d'Autriche) dans les bases militaires qui sont aujourd'hui exclusivement britanniques. La maîtrise de Chypre permettra une projection pacifique de puissance économique en direction du Liban, de la Syrie, de l'Égypte et du complexe volatile Israël-Palestine (dont une pacification positive doit être le vœu de tous).
Libérer l'Arménie de l'étau turco-azéri
◊ Dans le Caucase, la politique européenne, plus exactement euro-russe, doit consister à appuyer inconditionnellement l'Arménie et à la libérer de l'étau turco-azéri. Face à la Turquie, l'Europe et la Russie doivent se montrer très fermes dans la question arménienne. Comme à Chypre, il convient de protéger ce pays par le stationnement de troupes et par une pression diplomatique et économique continue sur la Turquie et l'Azerbaïdjan. Prévoir de sévères mesures de rétorsion dès le moindre incident : si la Turquie possède un atout majeur dans sa démographie galopante, l'Europe doit savoir aussi que ces masses sont difficilement gérables économiquement, et qu'elles constituent dès lors un point faible, dans la mesure où elles constituent un ballast et réduisent la marge de manœuvre du pays. Par conséquent, des mesures de rétorsions économiques, plongeant de larges strates de la population turque dans la précarité, risquent d'avoir des conséquences sur l'ordre public dans le pays, de le plonger dans les désordres civils et, par suite, de l'empêcher de jour le rôle d'“allié principal” des États-Unis et de constituer un danger permanent pour son environnement immédiat, arménien ou arabe. De même, le renvoi de larges contingents issus de la diaspora turque en Europe, mais uniquement au cas où il s'avèrerait que ces individus sont liés à des réseaux mafieux, déséquilibrerait aisément le pays, au grand soulagement des Arméniens, des Cypriotes grecs, des Orthodoxes araméens de l'intérieur et des pays arabes limitrophes. Le taux d'inflation catastrophique de la Turquie et sa faiblesse industrielle devrait, en toute bonne logique économique, nous interdire, de toute façon, d'avoir des rapports commerciaux rationnels avec Ankara. La Turquie n'est pas un pays solvable, à cause justement de sa politique d'agression à l'égard de ses voisins. Enfin, une pression à exercer sur les agences de voyage et sur les assureurs, qui garantissent la sécurité de ces voyages, limiterait le flux de touristes en Turquie et, par voie de conséquence, l'afflux de devises fortes dans ce pays virtuellement en faillite, afflux qui lui permet de se maintenir vaille que vaille et de poursuivre sa politique anti-hellénique, anti-arménienne et anti-arabe.
◊ Dans la mesure du possible, l'Europe et la Russie doivent jouer la carte kurde, si bien qu'à terme, l'alliance américano-turco-azérie dans la région devra affronter et des mouvements séditieux kurdes, bien appuyés, et l'alliance entre l'Europe, la Russie, l'Iran, l'Irak et l'Inde, amplification d'un axe Athènes-Erivan-Téhéran, dont l'embryon avait été vaguement élaboré en 1999, en pleine crise serbe.
◊ En Asie centrale, l'Europe, de concert avec la Russie, doit apporter son soutien à l'Inde dans la querelle qui l'oppose au Pakistan à propos des hauteurs himalayennes du Cachemire. L'objectif est d'obtenir une liaison terrestre ininterrompue Europe-Russie-Inde. La réalisation de ce projet grandiose en Eurasie implique de travailler 2 nouvelles petites puissances d'Asie centrale, le Tadjikistan persanophone et le Kirghizistan, point nodal dans le futur réseau de communication euro-indien. De même, le tandem euro-russe et l'Inde devront apporter leur soutien à la Chine dans sa lutte contre l'agitation islamo-terroriste dans le Sinkiang, selon les critères déjà élaborés lors de l'accord sino-russe de Changhaï (2001).
Une politique arabe intelligente
◊ L'Europe doit mener une politique arabe intelligente. Pour y parvenir, elle devrait, normalement, disposer de 2 pièces maîtresses, la Syrie et l'Irak, qu'elle doit protéger de la Turquie, qui assèche ces 2 pays en régulant le cours des fleuves Tigre et Euphrate par l'intermédiaire de barrages pharaoniques. Autre pièce potentielle, mais d'importance moindre, dans le jeu de l'Europe : la Libye, ennemie d'Oussama Ben Laden, ancien agent de la CIA (cf. : Dasquié/Brisard, op. cit.). En Égypte, allié des États-Unis, l'Europe doit jouer la minorité copte et exiger une protection absolue de ces communautés en butte à de cruels attentats extrémistes islamistes. La protection des Coptes en Égypte doit être l'équivalent de la protection à accorder aux Orthodoxes araméens de Turquie et aux Kurdes.
◊ L'Europe doit spéculer sur la future guerre de l'eau. L'allié secondaire des États-Unis au Proche-Orient, Israël, est dépendant de l'eau turque, récoltée dans les bassins artificiels d'Anatolie, créés par les barrages construits sous Özal. L'Europe doit inscrire dans les principes de sa politique arabe l'idée mobilisatrice de sauver le Croissant Fertile de l'assèchement (bassin des 2 fleuves, Tigre et Euphrate, et du Jourdain). Ce projet permettra d'unir tous les hommes de bonne volonté, que ceux-ci soient de confession islamique, chrétienne ou israélite. La politique turque d'ériger des barrages sur le Tigre et l'Euphrate est contraire à ce grand projet pour la sauvegarde du Croissant Fertile. Par ailleurs, l'Égypte, autre allié des États-Unis, est fragilisée parce qu'elle ne couvre que 97% de ses besoins en eau, en dépit des barrages sur le Nil, construits du temps de Nasser. Toute augmentation importante de la population égyptienne accentue cette dépendance de manière dramatique. C'est un des points faibles de l'Égypte, permettant aux États-Unis de tuer dans l'œuf toute résurgence d'un indépendantisme nassérien. Enfin, la raréfaction des réserves d'eau potable redonne au centre de l'Afrique, dont le Congo plongé depuis 1997 dans de graves turbulences, une importance stratégique capitale et explique les politiques anglo-saxonnes, notamment celle de Blair, visant à prendre pied dans certains pays d'Afrique francophone, au grand dam de Paris et de Bruxelles.
Les risques qu'encourt l'Europe :
Perdante sur tous les fronts que nous venons d'énumérer, fragilisée par la vétusté de son matériel militaire, handicapée par son ressac démographique, aveugle parce qu'elle ne dispose pas de satellites, l'Europe court 2 risques supplémentaires, incarnés par les agissements des réseaux trotskistes et par les dangers potentiels des zones de non-droit qui ceinturent ses grandes villes ou qui occupent le centre même de la capitale (comme à Bruxelles).
Deux exemples : les réseaux trotskistes, présents dans les syndicats français, et obéissant en ultime instance aux injonctions des États-Unis, ont montré toute leur puissance en décembre 1995 quand Chirac a testé de nouveaux armements nucléaires à Mururoa dans le Pacifique, ce qui déplaisait aux Etats-Unis. Des grèves sauvages ont bloqué la France pendant des semaines, contraignant le Président à lâcher du lest (Louis-Marie Enoch & Xavier Cheneseau, Les taupes rouges - Les trotskistes de Lambert au cœur de la République, Manitoba, 2002 ; Jean Parvulesco, « Décembre 1995 en France : “La leçon des ténèbres” », Cahier n°3 de la Société Philosophique Jean Parvulesco, 2e trimestre 1996 - paru en encart dans Nouvelles de Synergies Européennes n°18, 1996).
Quant aux zones de non-droit, elles peuvent constituer de dangereux abcès de fixation, paralyser les services de police et une partie des effectifs militaires, créer une psychose de terreur et fomenter des attentats terroristes. Les ouvrages de Guillaume Faye, dans l'espace militant des droites françaises, et surtout l'ouvrage de Xavier Raufer et Alain Bauer, pour le grand public avec relais médiatiques, démontrent clairement que les risques de guerre civile et de désordres de grande ampleur sont désormais parfaitement envisageables à court terme. Une grande puissance extérieure est capable de manipuler des “réseaux” terroristes au sein même de nos métropoles et de déstabiliser ainsi l'Europe pendant longtemps. Notre situation n'est donc pas rose. Sur les plans historique et géopolitique, notre situation équivaut à celle que nous avions à la fin du XVe siècle, où nous étions coincés entre l'Atlantique, res nullius, mais ouvert sur sa frange orientale par les Portugais en quête d'une route vers les Indes en contournant l'Afrique, et l'Arctique, étendue maritime glaciaire an-écouménique, sans accès direct à des richesses comme la soie ou les épices.
En 1941, les États-Unis étendent leurs eaux territoriales à plus de la moitié de la surface maritime de l'Atlantique Nord, confisquent à l'Europe son poumon océanique, si bien qu'il n'est plus possible de manœuvrer sur l'Atlantique, d'une façon ou d'une autre, pour rééditer l'exploit des Portugais du XVe siècle.
Les conditions du développement européen
En résumé, l'Europe a le vent en poupe, est un continent viable, capable de se développer, si :
◊ si elle a un accès direct à l'Égypte, comme l'avait très bien vu Bonaparte en 1798-99 ;
◊ si elle a un accès direct à la Mésopotamie, ou du moins au Croissant Fertile, comme l'avait très bien vu Urbain II, quand il prêchait les Croisades en bon géopolitologue avant la lettre ; les tractations entre Frédéric II de Hohenstaufen et Saladin visent un modus vivendi, sans fermeture aux voies de communications passant par la Mésopotamie (Califat de Bagdad) ; la Question d'Orient, à l'aube du XXe siècle, illustre très clairement cette nécessité (géo)politique et la Guerre du Golfe de janvier-février 1991 constitue une action américaine, visant à neutraliser l'espace du Croissant Fertile et surtout à le soustraire à toute influence européenne et russe.
◊ si la route vers les Indes (terrestre et maritime) reste libre; tant qu'il y aura occupation pakistanaise du Jammu et menaces islamistes dans le Cachemire, la route terrestre vers l'Inde n'existera pas).
L'épopée des Proto-Iraniens
Rappelons ici que la majeure partie des poussées européennes durant la proto-histoire, l'antiquité et le moyen âge se sont faites en direction de l'Asie centrale et des Indes, dès 1600 av. JC, avec l'avancée des tribus proto-iraniennes dans la zone au Nord de la ligne Caspienne - Mer d'Aral - Lac Balkhach, puis, par un mouvement tournant, en direction des hauts plateaux iraniens, pour arriver en lisière de la Mésopotamie et contourner le Caucase par le Sud. La Perse avestique et post-avestique est une puissance européenne, on a trop tendance à l'oublier, à cause d'un manichéisme sans fondement, opposant un “Occident” grec-athénien (thalassocratique et politicien) à un “Orient” perse (chevaleresque et impérial), auquel on prête des tares fantasmagoriques.
Quoi qu'il en soit, l'œuvre d'Alexandre le Grand, macédonien et impérial plutôt que grec au sens athénien du terme, vise à unir le centre de l'Europe (via la partie macédonienne des Balkans) au bassin de l'Indus, dans une logique qu'on peut qualifier d'héritière de la geste proto-historique des Proto-Iraniens. L'opposition entre Rome et la Perse est une lutte entre 2 impérialités européennes, où, à la charnière de leurs territoires respectifs, dont les frontières sont mouvantes, se situait un royaume fascinant, l'Arménie. Ce royaume a toujours été capable de résister farouchement, tantôt aux Romains, tantôt aux Perses, plus tard aux Arabes et aux Seldjoukides, grâce à un système d'organisation politique basé sur une chevalerie bien entraînée, mue par des principes spirituels forts. Cette notion de chevalerie spirituelle vient du zoroastrisme, a inspiré les cataphractaires sarmates, les cavaliers alains et probablement les Wisigoths, a été islamisée en Perse (la fotowwah), christianisée en Arménie, et léguée par les chevaliers arméniens aux chevaliers européens. L'ordre ottoman des Janissaires en a été une imitation et doit donc aussi nous servir de modèle (cf. ce qu'en disait Ogier Ghiselin de Busbecq, l'ambassadeur de Charles-Quint auprès du Sultan à Constantinople ; le texte figure dans Gérard Chaliand, Anthologie…, op. cit.).
Des Croisades à Eugène de Savoie et à Souvorov Dans cette optique d'une histoire lue à l'aune des constats de la géopolitique, les Croisades prennent tout naturellement le relais de la campagne d'Othon Ier contre les Magyars, vaincus en 955, qui se soumettent à la notion romaine-germanique de l'Empire.
Ces campagnes de l'Empereur salien, de souche saxonne, sont les premières péripéties de l'affirmation européenne. Après les Croisades et la chute de Byzance, la reconquista européenne se déroule en 3 actes : en Espagne, les troupes d'Aragon et de Castille libèrent l'Andalousie en 1492 ; une cinquantaine d'années plus tard, les troupes russes s'ébranlent pour reprendre le cours entier de la Volga, pour débouler sur les rives septentrionales de la Caspienne et mater les Tatars ; il faudra encore plus d'un siècle et demi pour que le véritable sauveur de l'Europe, le Prince Eugène de Savoie-Carignan, accumule les victoires militaires, pour empêcher définitivement les Ottomans de revenir encore en Hongrie, en Transylvanie et en Autriche. Quelques décennies plus tard, les troupes de Catherine II, de Potemkine et de Souvorov libèrent la Crimée. Cet appel de l'histoire doit nous remémorer les grands axes d'action qu'il convient de ne pas oublier aujourd'hui. Ils sont restés les mêmes. Tous ceux qui ont agi ou agiront dans ce sens sont des Européens dignes de ce nom. Tous ceux qui ont agi dans un sens inverse de ces axes sont d'abjects traîtres. Voilà qui doit être clair. Limpide. Voilà des principes qui ne peuvent être contredits.
Regards nouveaux sur la Deuxième Guerre mondiale
Pour terminer, nous ramènerons ces principes historiques et géopolitiques à une réalité encore fort proche de la nôtre, soit les événements de la Seconde Guerre mondiale, préludes à la division de l'Europe en 2 blocs pendant la guerre froide. Généralement, le cinéma et l'historiographie, le discours médiatique, évoquent des batailles spectaculaires, comme Stalingrad, la Normandie, les Ardennes, Monte Cassino, ou en montent de moins importantes en épingle, sans jamais évoquer les fronts périphériques où tout s'est véritablement joué. Or ces fronts périphériques se situaient tous dans les zones de turbulences actuelles, Afghanistan excepté. Soit sur la ligne Caspienne - Iran (chemins de fer) - Caspienne, dans le Caucase ou sur la Volga (qui se jette dans la Caspienne) (cf. George Gretton, « L'aide alliée à la Russie », in Historia Magazine n°38, 1968).
Les Britanniques et leurs alliés américains ont gagné la seconde guerre mondiale entre mai et septembre 1941. Définitivement. Sans aucune autre issue possible. En mai 1941, les troupes britanniques venues d'Inde et de Palestine (cf. : H. Stafford Northcote, « Révolte de Rachid Ali - La route du pétrole passait par Bagdad », in Historia Magazine n°20, 1968 ; Luis de la Torre, « 1941 : les opérations militaires au Proche-Orient », in : Vouloir n°73/75, 1991 ; Marzio Pisani, « Irak 1941: la révolte de Rachid Ali contre les Britanniques », in : Partisan n°16, nov. 1990) envahissent l'Irak de Rachid Ali (cf. : Prof. Franz W. Seidler, Die Kollaboration 1939-1945, Herbig, München, 1995), qui souhaitait se rapprocher de l'Axe. Les Britanniques disposent alors d'une base opérationnelle importante, bien à l'arrière du front et à l'abri des forces aériennes allemandes et italiennes, pour alimenter leurs troupes d'Égypte et de Libye. En juin et juillet 1941, les opérations contre les troupes de la France de Vichy au Liban et en Syrie parachèvent la maîtrise du Proche-Orient (cf.: Général Saint-Hillier, « La campagne de Syrie », in : Historia Magazine n°20, 1968 ; Jacques Mordal, « les opérations aéronavales en Syrie », ibid.). Au cours des mois d'août et de septembre 1941, l'Iran est occupé conjointement par des troupes anglaises et soviétiques, tandis que des équipes d'ingénieurs américains réorganisent les chemins de fer iraniens du Golfe à la Caspienne, ce qui a permis de fournir, au départ des Indes, du matériel militaire américain à Staline, en remontant, à partir de la Caspienne, le cours de la Volga (notons que les Soviétiques, en vertu des règles codifiées par Lea en 1912 — cf. supra — n'ont pas été autorisés à demeurer à Téhéran, mais ont dû se replier sur Kasvin).
L'Axe n'a pas pu prendre pied à Chypre et la Turquie a conservé sa neutralité “égoïste” comme le disait le ministre Menemencioglu (Prof. Franz W. Seidler, Die Kollaboration 1939-1945, Herbig, München, 1995) ; par conséquent, cet espace proche-oriental, au Sud-Est de l'Europe, a permis une reconquista des territoires européens conquis par l'Axe, en prenant les anciens territoires assyrien et perse comme base, en encerclant l'Europe selon des axes de pénétration imités des nomades de la steppe (de la Volga à travers l'Ukraine) et des cavaliers arabes (de l'Égypte à la Tunisie contre Rommel). Les opérations soviétiques dans le Caucase, grâce au matériel américain transitant par l'Iran, ont pu dès l'automne 1942, sceller le sort des troupes allemandes arrivées à Stalingrad et prêtes à couper l'artère qu'est la Volga. Les résidus des troupes soviétiques acculées aux contreforts septentrionaux du Caucase peuvent résister grâce au cordon ombilical iranien. De même, les troupes allemandes ne peuvent atteindre Touapse et la côte de la Mer Noire au Sud de Novorossisk et sont repoussées en janvier 1943, juste avant la chute de Stalingrad (cf. : Barrie and Frances Pitt, The Month-By-Month Atlas of World War II, Summit Books, New York/London, 1989). Le sort de l'Europe tout entière, au XXe siècle, s'est joué là, et se joue là, encore aujourd'hui. Une vérité historique qu'il ne faut pas oublier, même si les médias sont très discrets sur ces épisodes cruciaux de la Seconde Guerre mondiale.
De l'aveuglement historique
“L'oubli” des opérations au Proche-Orient en 1941 et dans le Caucase en automne 1942 et en janvier 1943 profite d'une certaine forme d'occidentalisme, de désintérêt pour l'histoire de tout ce qui se trouve à l'Est du Rhin, a fortiori à l'Est de la Mer Noire. Cet occidentalisme est une tare rédhibitoire pour toutes les puissances, trop dépendantes d'une opinion publique mal informée, qui se situent à l'Ouest du Rhin. L'atlantisme n'est pas seulement un engouement imbécile pour tout ce qui est américain, il est aussi et surtout un aveuglément historique, dont nous subissons de plein fouet les conséquences désastreuses aujourd'hui.
En effet, l'Europe actuelle a perdu la guerre, bien plus cruellement que le Reich hitlérien en 1945. Jugeons-en :
◊ L'Atlantique est verrouillé (ce qui réduit à néant les efforts de Louis XVI, dont la flotte, commandée par La Pérouse, avait ouvert cet océan au binôme franco-impérial).
◊ La Méditerranée orientale est verrouillée.
◊ La Mer Noire est également verrouillée.
◊ La voie continentale vers l'Inde est verrouillée.
◊ La “Route de la Soie” est verrouillée.
◊ Nous vivons dans le risque permanent de la guerre civile et du terrorisme. La renaissance européenne, que nous appelons tous de nos vœux, passe par une prise de conscience des enjeux réels de la planète, par une connaissance approfondie des manœuvres systématiquement répétées des ennemis de notre Europe. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans cet exposé. Il faut savoir que nos ennemis ont la mémoire longue, que c'est leur atout majeur. Il faut leur opposer notre propre “longue mémoire” dans la guerre cognitive future. Autre principe méthodologique : l'histoire n'est pas une succession de séquences, coupées les unes des autres, mais un tout global, dans lequel il est impossible d'opérer des coupures.
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°54, 2002.
• Note :
◘ 1 : À cette époque, l'Angleterre était alliée à la France pour détruire les Provinces-Unies des Pays-Bas, alliées au Brandebourg (la future Prusse), à l'Espagne (pourtant son ennemie héréditaire), au Saint Empire et à la Lorraine. Les troupes d'invasion françaises, bloquées par l'ouverture des digues, sont chassées des Provinces-Unies en 1673. Avec l'alliance suédoise, les Français retournent toutefois la situation à leur avantage entre 1674 et 1678, ce qui débouche sur le Traité de Nimègue, qui arrache au Saint Empire de nombreux territoires en Flandre et dans le Hainaut. Cet épisode est à retenir car les puissances anti-européennes, la France, l'Angleterre, la Suède et l'Empire ottoman se sont retrouvés face à une coalition impériale, regroupant puissances protestantes et catholiques. Les unes et les autres acceptaient, enfin, de sauter au-dessus du faux clivage religieux, responsable du désastre de la guerre de Trente Ans (comme l'avait très bien vu Wallenstein, avant de finir assassiné, sous les coups d'un zélote catholique). Cette alliance néfaste, d'abord dirigée contre la Hollande, a empêché l'éclosion de l'Europe et explique les menées anti-européennes plus récentes de ces mêmes puissances, Suède exceptée.

L’Afghanistan, cœur géopolitique du nouveau grand jeu eurasiatique
Le nouveau “Grand Jeu” est multipolaire. Il oppose les États-Unis, la Russie et la Chine, mais aussi l'Inde et le Pakistan, sans compter l'Iran et d'autres encore.
Le nouveau grand jeu en Afghanistan n’est plus bipolaire. Il n’est plus la vieille opposition du XIXe siècle, dont on a tiré la formule de “Grand Jeu”, entre l’Angleterre présente aux Indes et la poussée russe vers les mers chaudes ; il n’est pas plus réductible à l’opposition du XXe siècle entre les intérêts américains et russes.
Un grand jeu multipolaire
Le nouveau grand jeu en Afghanistan est à l’image de la géopolitique mondiale : il est multipolaire. Trois grandes puissances mondiales s’entrechoquent en Afghanistan : États-Unis, Russie, Chine. Deux puissances régionales s’y livrent ensuite, par délégation, une guerre féroce : Pakistan et Inde. Dans ces rivalités de premier ordre, interfèrent des intérêts de second ordre, mais qui peuvent influer fortement sur le jeu afghan : les intérêts de l’Iran, ainsi que ceux des républiques musulmanes indépendantes, ex-soviétiques (en particulier, pour des raisons à chaque fois spécifiques, l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Turkménistan).
Combiné à ces rivalités géopolitiques classiques de 3 ordres (rivalités identitaires, stratégiques, énergétiques), le jeu du fondamentalisme sunnite est également à prendre en compte. L’islamisme est un acteur global, une créature ancienne, mais réveillée et excitée durant les années 1980 et 1990 par les apprentis-sorciers américains et pakistanais de la CIA et de l’ISI (Inter Services Intelligence), au point de finir par échapper à l’autorité de ses maîtres, sans pour autant avoir complètement rompu avec eux.
L'affrontement triangulaire : USA, Chine, Russie
Pour quelles raisons le grand jeu en Afghanistan est-il triangulaire ? Tout d’abord, parce que les États-Unis veulent refouler d’Asie centrale au moins autant la Chine que la Russie. Ensuite, parce que la Russie veut non seulement limiter l’influence de Washington dans ses ex-républiques musulmanes soviétiques aujourd’hui indépendantes, mais également empêcher la Chine de combler le vide que les Américains laisseraient s’ils s’avisaient de quitter l’Afghanistan. Car pour la Russie, l’influence de Pékin en Asie centrale, ce n’est pas la parenthèse artificielle d’une Amérique projetée trop loin de sa terre ; c’est la réalité implacable d’une histoire millénaire, celle des routes de la Soie. Enfin, le grand jeu en Afghanistan est triangulaire, parce que la Chine ne sera la première puissance géopolitique mondiale que lorsqu’elle aura chassé la flotte américaine du Pacifique et que ses trains rapides atteindront les rivages de l’Atlantique, en France, après avoir parcouru des milliers de kilomètres à travers l’Asie centrale et les plaines d’Europe.
Les États-Unis tentent aujourd’hui d’éliminer une force, les Talibans, qu’ils ont contribué à amener au pouvoir à Kaboul en 1997, avant de les en déloger en 2001. Les Talibans sont l’aboutissement ultime d’une stratégie de radicalisation des mouvements islamistes, entamée à la fin des années 1970 par l’ISI soutenu par la CIA, au profit d’un triple djihad : contre les chiites pakistanais menacés par l’influence de la Révolution islamique iranienne, contre les communistes pro-russes en Afghanistan, contre les Indiens dans le Cachemire.
Le jeu des États-Unis et des talibans
Après que des seigneurs de la guerre afghans soient devenus, comme résultat de cette stratégie, à la fois des seigneurs du djihad et de la drogue (lire l’article p. 58 pour comprendre l’importance essentielle du “facteur drogue”), et que les Soviétiques aient reflué (1989), les Américains se sont aperçus que leur société pétrolière UNOCAL n’arriverait jamais à tendre un gazoduc, du Turkménistan au Pakistan, à travers un territoire afghan tribalisé, rançonné par des clans en lutte pour le contrôle du pouvoir politique et de l’héroïne. Leurs amis pakistanais de l’ISI, également agacés de ne pouvoir contrôler des chefs de guerre féodaux turbulents, ont alors suggéré les Talibans comme solution. Des fanatiques absolus, essentiellement issus de l’ethnie majoritaire d’Afghanistan, les Pachtouns (ethnie divisée par la ligne Durand de 1893, qui deviendra la frontière entre Afghanistan et Pakistan), décidés à imposer la chape de plomb d’un « islam pur des origines », au-dessus des clans, et qui présentaient l’avantage, aux yeux du gouvernement démocrate de William Clinton qui les soutint dès 1994, d’être une solution d’ordre et un interlocuteur unique avec lequel négocier le passage des hydrocarbures. Puis les Américains se sont fâchés avec les Talibans en 1998, un an après leur arrivée, et c’est ainsi que s’est nouée l’alliance entre les Talibans et Oussama Ben Laden, semble-t-il également fâché depuis lors avec la CIA.
En 2001, en se projetant en Afghanistan, et pour cela également en Ouzbékistan et au Kirghizstan, quels avantages géopolitiques Washington pouvait-il attendre ? À ce moment, le Groupe de Shanghaï, constitué par les Chinois et les Russes, coopérait fortement dans la lutte contre le terrorisme islamiste, mais également dans le domaine énergétique. L’irruption des États-Unis brisa cette dynamique eurasiatique et contribua à repousser la Chine pour quelques années.
Aujourd’hui, la Chine est revenue en force. Elle est, depuis 2009, à la fois le premier partenaire commercial de l’Asie centrale ex-soviétique et le premier fournisseur de l’Iran, devant l’Allemagne qui l’avait été ces 20 dernières années. Or, Moscou n’entend pas voir les Américains remplacés par les Chinois.
La nouvelle stratégie russe face aux USA
 Quelle est alors la stratégie des Russes ? Laisser les Américains contenir l’islamisme en Afghanistan, mais devenir incontournables pour eux, stratégie identique à celle suivie sur le dossier nucléaire iranien. D’où le soutien officiel de la Russie aux opérations de l’OTAN en Afghanistan ; d’où, également, l’accord russo-américain de transit aérien de juillet 2009, qui, à mi-avril 2010, avait permis d’acheminer 20.000 militaires occidentaux en Afghanistan.
Quelle est alors la stratégie des Russes ? Laisser les Américains contenir l’islamisme en Afghanistan, mais devenir incontournables pour eux, stratégie identique à celle suivie sur le dossier nucléaire iranien. D’où le soutien officiel de la Russie aux opérations de l’OTAN en Afghanistan ; d’où, également, l’accord russo-américain de transit aérien de juillet 2009, qui, à mi-avril 2010, avait permis d’acheminer 20.000 militaires occidentaux en Afghanistan.
Pour Moscou, obliger les Américains à passer par la Russie, revient à les chasser de sa périphérie musulmane. Le 7 octobre 2001, les États-Unis avaient signé un accord antiterroriste avec Tachkent (l’Ouzbékistan partage une longue frontière avec l’Afghanistan). Les bases aériennes et l’espace aérien du pays le plus peuplé de l’Asie centrale ex-soviétique leur étaient ouverts. Un an plus tard, le 5 décembre 2002, Washington prenait pied également au Kirghizstan grâce à la base de Manas. Mais en 2005, après la répression d’Andijan (une région turbulente à l’est du pays, où les islamistes sont forts), et refusant l’ingérence démocratique américaine, les Ouzbeks décidaient de se tourner de nouveau vers la Russie (et la Chine) et contraignaient l’armée américaine à plier bagages.
Aujourd’hui, la base de Manas au Kirghizstan et son corridor de 1.500 km par voie terrestre jusqu’en Afghanistan, constitue la seule base arrière solide pour les Américains. Environ 35.000 soldats transitent entre Manas et l’Afghanistan chaque mois. La base assure aussi le ravitaillement en vol des avions militaires et apporte beaucoup de sang (100 kg en moyenne chaque nuit, par des vols entre Manas et Kandahar). Mais les Russes admettent difficilement cette implantation. Le 23 octobre 2003, le président Poutine inaugurait une base aérienne russe de soutien à Kant, à quelques kilomètres de la base américaine.
Ces dernières années, les Kirghizes, conscient de l’immense valeur stratégique de cette base pour la réussite des opérations en Afghanistan, ont fait monter les enchères entre Moscou et Washington. En 2009, les Russes qui avaient sans doute reçu des assurances, ont versé 2 milliards de dollars sous forme de prêt sans intérêt au Kirghizstan ; non seulement le président Bakiev n’a pas fermé la base, mais il a accepté la présence américaine pour une année supplémentaire, en échange d’un triplement du loyer. Le Kirghize a payé sa crapulerie par son renversement début avril 2010, sans doute avec l’appui discret des Russes. Quelques jours plus tard, les Américains étaient autorisés à rester un an de plus à Manas. Désormais, cela dépend davantage de Moscou. C’est une donnée essentielle. Plus le temps passe, moins l’action américaine en Afghanistan ne peut se faire en contournant les Russes. C’est, pour Moscou, une assurance devant la montée des Chinois en Asie centrale ex-soviétique.
La Russie confrontée à la Chine en Asie centrale
On oublie que la Russie est le premier pays à avoir soutenu Washington, le lendemain du 11 septembre 2001, dans son action globale contre le terrorisme islamiste. Poutine ne cherchait pas seulement, comme on l’a dit, l’assurance de ne plus être gêné par les critiques occidentales sur la Tchétchénie. Il cherchait un partenariat équilibré avec Washington face à la montée de Pékin, [partenariat] qui eût été possible si Washington n’avait pas étendu l’OTAN jusqu’aux portes de la Russie en 2002, installé dans la périphérie de Moscou des gouvernements proaméricains (Révolutions colorées de Géorgie en 2003, d’Ukraine en 2004) et convaincu d’anciens pays soviétisés (République tchèque et Pologne) d’accepter un bouclier anti-missiles sur leur sol. Aujourd’hui, la donne est redevenue favorable aux Russes : si les Américains ont reculé sur le bouclier antimissile, c’est qu’ils ont besoin des Russes sur l’Afghanistan et l’Iran, et qu’ils ont aussi perdu l’Ukraine.
Ce que craignent Washington comme Moscou en Asie centrale, dans une perspective de plus longue durée, va au-delà du retour d’un islamisme fort : c’est la domination de la Chine. Investissant dans les hydrocarbures et l’uranium du Kazakhstan, dans le gaz du Turkménistan, construisant des routes pour exporter ses productions vers le Tadjikistan et le Kirghizstan, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Asie centrale ex-soviétique en 2009.
La Chine convoite les hydrocarbures de l'Afghanistan
Washington est au moins autant en Afghanistan dans le cadre de sa vaste stratégie globale de contrôle de la dépendance énergétique chinoise et d’encerclement de l’Empire du Milieu (voir notre article dans la NRH n°2, sept. 2002 : « Comment l’Amérique veut vaincre la Chine », que les années passées ont confirmé), que dans sa lutte contre un islamisme devenu incontrôlable. La Chine a son Turkestan, le Xinjiang, avec sa minorité turcophone ouïghour que les États-Unis tentent d’agiter. Elle ne peut relier sans risque son Turkestan à l’ex-Turkestan russe, qu’à la condition de jouir d’une influence politique et économique forte dans le second. Ainsi, ni l’Afghanistan, ni l’Asie centrale ex-soviétique ne risqueraient d’être des bases arrière du séparatisme ouïghour. Ainsi, son grand projet de “China’s Pan-Asian railway”, ces routes de la Soie du XXIe siècle, qui mettraient Londres à 2 jours de train de Pékin deviendrait possible avant 2025 (1).
En 2006, dans un pays sous tutelle américaine, la Chine n’a pas hésité à investir 3 milliards de dollars dans la mine de cuivre d’Aynak, une des plus grandes du monde. En 2010, les présidents chinois Hu Jintao et afghan Hamid Karzaï ont signé d’importants accords économiques et commerciaux et l’Afghan a commencé à menacer les Américains de se tourner vers Pékin, alors que ceux-ci critiquaient la manière dont l’élection présidentielle s’était déroulée. L’intérêt de la Chine pour l’Afghanistan ne peut qu’aller croissant, depuis qu’Hamid Karzaï a annoncé (le 30 janvier 2010) ce que les Américains savaient depuis longtemps : « les gisements d’hydrocarbures d’Afghanistan valent sans doute plus d’un millier de milliards de dollars », en plus des gisements de cuivre, de fer, d’or, de pierres précieuses, qui restent non exploités. Ainsi, l’Afghanistan n’est plus seulement une route stratégique pour le désenclavement des richesses ; il est aussi un territoire riche en ressources stratégiques.
Le conflit de l'Inde et du Pakistan
La Chine n’est pas la seule future superpuissance à regarder vers l’Afghanistan. Depuis la chute des Talibans en 2001, l’Inde a engagé 1,3 milliards de dollars dans la reconstruction de l’Afghanistan, soit dix fois plus que la Chine ; cela fait de New Delhi le premier donateur de la région (signe politique fort : le nouveau Parlement afghan a été financé par l’Inde). Si les États-Unis se retiraient d’Afghanistan, l’Inde pourrait devenir l’allié du régime afghan face aux Talibans. C’est le cauchemar du Pakistan qui, sous pression américaine, doit réduire ses créatures fondamentalistes. L’ISI a façonné des groupes fanatiques pour massacrer l’Indien dans le Cachemire et il est probable que les attentats graves qui ont frappé les intérêts indiens à Kaboul (en 2007 et 2009 contre l’ambassade) soient encouragés par le service pakistanais, lequel s’emploie à pousser l’Inde hors de l’Afghanistan. Sans l’Afghanistan, le Pakistan a encore moins de profondeur stratégique, ce qui est déjà sa faiblesse face à l’Inde (le déficit en puissance conventionnelle du Pakistan expliquant sa doctrine nucléaire de première attaque). Islamabad a donc comme priorité stratégique absolue d’empêcher la formation d’une alliance stratégique Kaboul-New-Delhi.
L’Inde et le Pakistan, qui se sont fait 3 guerres depuis l’indépendance de 1947, mènent une nouvelle guerre par procuration en Afghanistan. La stratégie d’inflammation du rapport entre les 2 voisins, menée par les groupes pakistanais les plus radicaux (attentats de Bombay en 2008 et de nombreux autres depuis), a fonctionné.
Cet islam du Pachtounistan (terre des Pachtouns, à cheval sur l’Afghanistan et le Pakistan, notamment les fameuses zones tribales) menace l’équilibre régional et peut-être même au-delà. Il est certain que si les États-Unis se désengageaient maintenant, un autre acteur majeur serait contraint de s’engager, dans le but de prévenir le double risque de basculement de l’Afghanistan et du Pakistan (pays doté de l’arme nucléaire) dans les mains d’un régime sunnite fanatique. On voit mal les Russes revenir, ne reste que l’Inde. Mais que ferait alors le Pakistan, si les troupes indiennes débarquaient en force sur le territoire afghan ?
Le gazoduc Iran-Pakistan-Inde
L’Inde a besoin d’une Asie centrale stable, pour satisfaire ses besoins énergétiques. Deux routes d’alimentation essentielles s’offrent à elle : le gazoduc IPI (Iran Pakistan Inde), qui lui amènera du gaz iranien provenant du gisement géant de South Pars dans le Golfe Persique (le Pakistan, après des années d’hésitation a fini par signer en mars 2010 le projet de pipe) ; et le fameux gazoduc TAPI (Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde) voulu par UNOCAL, un tuyau lui-même raccordé vers l’Ouest aux autres « routes américaines » (celles qui concurrencent le réseau russe), le corridor transcaspien et le BTC (Bakou Tbilissi Ceyhan).
Les États-Unis, qui soutiennent depuis longtemps ce projet de pipe vers l’Inde et l’Asie du Sud-est, depuis le Turkménistan et à travers l’Afghanistan et le Pakistan, veulent absolument doubler l’Iran et empêcher le régime chiite de devenir incontournable pour l’Asie (Chine, Japon, Inde) ; ils n’ont pas pu empêcher le Pakistan de signer l’IPI avec l’Iran, car ils ont besoin de la coopération d’Islamabad dans la lutte contre les Talibans. Ils sont par ailleurs empêchés de réaliser le TAPI, à cause de la situation sécuritaire en Afghanistan.
Deux enjeux majeurs : l'Iran et le Pakistan
L’Iran (en plus de la Chine) est bien l’une des cibles que les Américains veulent atteindre depuis l’Afghanistan [par ex. à travers l'aide discrète au séparatisme baloutche]. Les accusations américaines concernant une hypothétique collaboration entre Téhéran et les Talibans se sont multipliées en 2009 et 2010.
Ainsi, l’amiral américain Mullen a parlé (fin mars 2010) de fournitures d’armes et d’entraînement militaire par les Pasdarans. On sait que les Américains remuent aussi le séparatisme baloutche (le peuple baloutche est à cheval sur l’Est de l’Iran, le Sud de l’Afghanistan et l’Ouest du Pakistan) contre Téhéran.
Mais l’intérêt des Iraniens est-il de voir les talibans triompher en Afghanistan ? Certainement pas. Mieux vaut un Afghanistan infecté, dans lequel les Américains s’engluent sans jamais l’emporter (d’où la possibilité d’éventuels coups de pouce dosés aux Talibans), plutôt que l’installation d’un régime sunnite radical, violemment anti-chiite, à Kaboul. Les intérêts iraniens et pakistanais se rejoignent, d’une certaine manière, dans l’idée suivante : « une bonne dose de Talibans, mais pas trop, de sorte que les Américains restent là où ils sont aujourd’hui ».
On le voit, nombreuses sont les puissances qui ont intérêt à ce que les Américains restent en Afghanistan sans jamais l’emporter vraiment : Russes, Chinois, Iraniens, Pakistanais, Indiens même. Dans ces conditions, il n’est plus certain que les Américains et les Européens qui les suivent mènent une guerre pour leurs intérêts propres. En réalité, aucune victoire durable n’est possible en Afghanistan, sans une transformation profonde du Pakistan lui-même. Or, en se démocratisant, le Pakistan a ouvert d’immenses perspectives aux fondamentalistes (contrairement aux régimes anti-islamistes forts d’Asie centrale ex-soviétique). En toute logique, une arme nucléaire qui existe déjà et qui est susceptible de tomber dans les mains de Talibans devrait inquiéter davantage Washington, qu’une arme qui n’existe pas dans les mains d’Iraniens bien plus pragmatiques que les islamistes pachtouns et finalement potentiellement capables d’équilibrer… le danger nucléaire pakistanais.
► Aymeric Chauprade, NRH n°49, été 2010.
◘ L'auteur : Professeur de géopolitique et directeur de la Revue Française de géopolitique et du site Realpolitik.tv. A publié not. l'ouvrage à la fois méthodologique et descriptif : Géopolitique, constantes et changements dans l’histoire (Ellipses, 2001, 912 p., 110 cartes).
• Note :
1 : Ce projet de train à grande vitesse traversant l’Eurasie à travers Asie centrale doit relier 17 pays reliés suivant 3 routes différentes et au total 81.000 km : a) la route du Sud allant de Kunming sur les contreforts du Tibet en Chine jusqu’à Singapour à travers l’Asie du Sud Est, b) la route de l’Europe depuis Urumqi (capitale du Xinjiang) jusqu’à l’Allemagne, à travers l’Asie centrale, c) la route de l’Europe du Sud enfin, depuis Heilongjiang au nord est de la Chine jusqu’à l’Europe du Sud Est à travers la Russie.