Nationalisme
Pour une nouvelle définition du nationalisme
♦ Conférence donnée par Robert Steuckers, le 16 avril 1997 à Bruxelles
“Nationalisme” signifie, au départ, selon une définition minimale, la défense de la “nation” sur les plans politique, culturel et économique. Par conséquent, toute définition du “nationalisme” dérive forcément d'une définition de la “nation”.
Qu'est-ce qu'une “nation” ? Le terme “nation” vient du latin natio, substantif dérivé du verbe nasci, naître. Donc, dans sa signification originelle, natio signifie naissance, origine, famille, clan (Sippe), la population d'un lieu précis (d'une ville, d'une province, d'un État ou, plus généralement, d'un territoire). Dans nos régions au Moyen-Âge, on appelait diets(ch) ou deutsch les locuteurs de langue thioise (= germanique), en précisant que ceux qui habitaient la rive gauche du Rhin étaient des Westerlingen, tandis que ceux qui habitaient à l'Est du grand fleuve se faisaient appeler Oosterlingen. Cette terminologie se retrouve encore dans les noms de famille Westerlinckx ou Oosterlinckx (ainsi que leurs variantes, orthographiées différemment).
À l'époque médiévale, Regino de Prüm, en évoquant les nationes populorum, indique que les “nations” sont des groupes de populations possédant tout à la fois des ancêtres communs, une langue commune et, surtout, ce que l'on a tendance à oublier quand on fait aujourd'hui du “nationalisme” comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, des systèmes communs de droit, voire des esquisses de constitutions. Dans la définition de Regino de Prüm, l'aspect juridique n'est pas exclu, le continuum du droit fait partie intégrante de sa définition de la nation, alors que certains nationalismes actuels ne réfléchissent pas à la nécessité de rétablir des formes traditionnelles de droit national et se contentent d'interpréter le droit en place, qui fait, par définition, abstraction de toutes les appartenances supra-individuelles de l'homme.
Ce droit en place n'a pas été voulu par les néo-nationalistes : il s'opposera toujours à eux. Ou alors, les néo-nationalistes se bornent à rejeter le droit et plaident pour des mesures d'exception ou pour un gouvernement par ukases ou par comités de salut public, ce qui n'est possible que dans des périodes troublées, notamment quand un ennemi extérieur menace l'intégrité du territoire ou quand des bandes de hors-la-loi troublent durablement la convivialité publique (attaques de forugons convoyant des fonds ou initiatives de réseaux de pédophiles en chasse de “chair fraîche”).
Dans le contexte belge, il conviendrait de rejeter toutes les formes de droit et toutes les institutions qui nous ont été léguées par la Révolution française et le code napoléonien, pour les remplacer par des formes modernisées du droit coutumier flamand, brabançon, liégeois, etc. La grande faiblesse des mouvements nationaux dans notre pays, y compris du mouvement flamand, a été de ne pas proposer un droit alternatif, inspiré du droit coutumier d'avant 1792 et de contester globalement et systématiquement les formes de “droit” (?) dominantes, non-démocratiques et héritées de la révolution française.
Dans quel contexte le terme de “nation” a-t-il été employé pour la première fois ? Dans les universités : une natio, dans la Sorbonne du Moyen-Âge, est une communauté d'étudiants issus d'une région particulière. Ainsi, la Sorbonne comptait une natio germanica ou teutonica regroupant les étudiants flamands, allemands et scandinaves, une natio scozia (ou scotia) regroupant les étudiants venus des îles britanniques, une natio franca, regroupant les étudiants d'Ile-de-France et de Picardie, une natio normanica, avec les Normands (que l'on distinguait des “Français”) et une natio provencialensis, pour les Provençaux, et, plus généralement, les locuteurs des parlers d'oc.
Mais, par ailleurs, au Moyen-Âge, les gens voyageaient peu, sauf pour se rendre à Compostelle ; ils n'avaient que rarement affaire à des étrangers. Ceux-ci étaient généralement bien accueillis, surtout s'ils avaient des choses originales, drôles, étranges à raconter. Le rôle de l'étranger est souvent celui du conteur d'histoires insolites. Certaines manières des étrangers étonnent, sont considérées comme bizarres, voire inquiètent ou suscitent l'animosité : très souvent, on est choqué quand ils parlent trop haut ou trop vite ; dans le Nord, on est rebuté par la manie méridionale de toucher autrui, dans le Sud, on est froisé par la distance corporelle qu'aiment afficher les gens du Septentrion. Les habitudes alimentaires sont généralement mal jugées. L'animosité à l'égard de l'étranger se limitait, au fond, à ces choses quotidiennes, ce qui est bien souvent le cas encore aujourd'hui.
La conscience d'une “nationalité” n'est pas perceptible dans les grandes masses au Moyen-Âge. Seuls les nobles, qui ont fait les croisades, les clercs qui sont davantage savants et connaissent l'existence d'autres peuples et d'autres mœurs, et les marchands, qui ont accompli de longs voyages, savent que les coutumes et les manières de vivre sont différentes ailleurs, et que ces différences peuvent être sources de conflictualités.
Le nationalisme ne devient une idéologie qu'avec la Révolution française. Celle-ci exalte la nation, mais dans une acception bien différente des nationes de la Sorbonne médiévale. La nation est la masse des citoyens, qui n'appartenaient pas auparavant à la noblesse ou au clergé. Cette masse est désormais politisée à outrance, pour des raisons d'abord militaires : les hommes du peuple, indistinctement de leurs origines régionales ou tribales, sont mobilisés de force dans des armées nombreuses, par la levée en masse. À Jemappes et à Valmy, en 1792, les beaux régiments classiques de la guerre en dentelles, qu'ils soient wallons, autrichiens, croates, hongrois ou prussiens, sont submergés par les masses compactes de conscrits français hâtivement vêtus et armés. Jemappes et Valmy annoncent l'ère de la “nationalisation des masses” (George Mosse). Celle-ci, dit Mosse, prend d'abord l'aspect d'une militarisation des corps et des gestes, par le truchement d'une gymnastique et d'exercices physiques à but guerrier : Hébert en France, Jahn en Prusse, drillent les jeunes gens pour en faire des soldats. Plus tard, les premiers nationalistes tchèques les imitent et créent les sokol, sociétés de gymnastique.
Après les guerres de la Révolution et de l'Empire, le nationalisme en Allemagne est révolutionnaire et se situe à gauche de l'échiquier politique. Puisque le peuple allemand s'est dressé contre Napoléon et a aidé le roi de Prusse, les princes locaux, la noblesse et le clergé à chasser les Français, il a le droit d'être représenté dans une assemblée, dont il choisit directement les députés, par élection. En 1815, dans l'Europe de Metternich, le peuple ne reçoit pas cette liberté, il est maintenu en dehors du fonctionnement réel des institutions. D'où une évidente frustration et un sentiment de profonde amertume : si le simple homme du peuple peut être ou doit être soldat, et mourir pour la patrie, alors il doit avoir aussi le droit de vote. Tel est le raisonnement, telle est la revendication première des gauches nationales sous la Restauration metternichienne en Europe centrale.
Dans l'Allemagne de l'ère Metternich, le nationalisme est un “nationalisme de culture” (Kulturnationalismus), où l'action politique doit viser la préservation, la défense et l'illustration d'un patrimoine culturel précis, né d'une histoire particulière dans un lieu donné. La culture ne doit pas être l'apanage d'une élite réduite en nombre mais être diffusée dans les masses. Le nationalisme de culture s'accompagne toujours d'une “pédagogie populaire” (Volkspedagogik) ou d'une “pédagogie nationale”. Concours de chants et de poésie, promotion du patrimoine musical national, inauguration de théâtres en langue populaire (Anvers, Prague), intérêt pour la littérature et l'histoire locale/nationale sont des manifestations importantes de ce nationalisme, jugées souvent plus importantes que l'action politique proprement dite, se jouant dans les élections, les assemblées ou les institutions. Le nationalisme de culture permet d'organiser et de capillariser dans la société un “front du refus”, dirigé contre les institutions nées d'idées abstraites ou détachées du continuum historique et culturel du peuple. Ce nationalisme de culture est toujours tout à la fois affirmateur d'un héritage et contestataire de tout ce qui fonctionne en dehors de cet héritage ou contre lui.
Le nationalisme selon Herder et le nationalisme selon Renan
De la volonté d'organiser une “pédagogie populaire” découlent 2 tendances, dans des contextes différents en Europe.
◘ 1) D'une part, il y a les pays où la nation est perçue comme une “communauté naturelle”, c'est-à-dire une communauté reposant sur des faits de nature, de culture, sur des faits anthropologiques ou linguistiques. Cette vision provient de la philosophie de Herder et elle structure le nationalisme allemand, le nationalisme des peuples slaves (Russes, Serbes, Bulgares, Croates ; en Pologne et chez les Tchèques, cet héritage herdérien s'est mêlé à d'autres éléments comme le catholicisme, le messianisme de Frank, un héritage hussite ou un anti-cléricalisme maçonnique), et, enfin, le nationalisme flamand qui est “herdérien” tant dans ses acceptions catholiques que dans ses acceptions laïques (souvenir de la révolte des Gueux contre l'Espagne).
◘ 2) D'autre part, nous trouvons dans l'histoire européenne une conception de la nation comme “communauté de volonté” (wilsgemeenschap) ; pour l'essentiel, elle est dérivée des écrits de Renan. Elle est la caractéristique principale d'un nationalisme français postérieur à l'ère révolutionnaire et jacobine. Le nationalisme français n'est pas un nationalisme de culture (et donc ne constitue nullement un nationalisme pour les Allemands, les Slaves et les Flamands) parce qu'il implique un refus des faits naturels, une négation du réel, c'est-à-dire des mille et unes particularités historiques des nations concrètes. Renan savait que la France de son temps n'était déjà plus un peuple homogène, mais un mixte complexe où intervenaient un fonds préhistorique cromagnonique-aurignacien (grottes de Lascaux, sites archéologiques périgourdins, etc.), un fonds gaulois-celtique ou basque-aquitain, un apport romain-latin et des adstrats francs-germaniques ou normands-scandinaves.
Aucune de ces composantes ne peut revendiquer de représenter la France seule : donc ces réalités, pourtant impassables, doivent être niées pour que fonctionne la machine-État coercitive, de Bodin, des monarques, de Richelieu et des jacobins. Pour que l'idéologie ne soit pas trop raide, schématique et abstraite, donc rébarbative, Renan table non pas sur les réalités concrètes, anthropologiques, ethniques ou linguisitiques, mais sur une émotion artificiellement entretenue pour des choses construites, relevant de l'“esprit de fabrication” (dixit le Savoisien Joseph de Maistre) ou sur des modes assez ridicules et des fantaisies sans profondeur (modes vestimentaires parisiennes, glamour féminin, produits culinaires ou cosmétiques à la réputation surfaite et toujours parfaitement inutiles, etc.). Le citoyen d'une telle nation adhère avec un enthousiasme artificiel à ces constructions abstraites ou à ces styles de vie mondains et citadins sans profondeur ni épaisseur, et, en même temps, nie ses patrimoines réels, ses traditions rurales, ses héritages, qu'il brocarde par une sorte de curieuse auto-flagellation, de concert avec les propagandistes politiques et les mercantiles qui diffusent ces modes ne correspondant à aucun substrat populaire réel.
Cette adhésion est une “volonté”, dans l'optique de Renan. Sa fameuse idée d'un “plébiscite quotidien” n'est jamais que l'exercice d'auto-flagellation des citoyens, le catéchisme qu'il doit apprendre pour être un “bon élève” ou un “bon citoyen”, pour oublier ce qu'il est en réalité, pour exorciser le “plouc” qui est en lui et l'empêche d'adhérer béatement à tous les parisianismes. Aujourd'hui, les modes vestimentaires, musicales, cinématographiques américaines, diffusées en Europe, jouent un rôle analogue à celui qu'avaient les modes françaises jusqu'en 1940. Les manifestations d'américanisme oblitèrent les traditions historiques et culturelles d'Europe comme les manifestations du parisianisme avaient oblitéré les traditions historiques et culturelles des provinces soumises aux rois de France, puis à la secte jacobine-fanatique.
Que signifie cette dualité dans les traditions nationalistes en Europe ? Pour Herder, le peuple, en tant qu'héritage et continuité pluriséculaire, prime toutes les structures, qu'elles soient étatiques, démocratiques, républicaines, monarchiques ou autres. Les structures passent, les peuples demeurent (Geen tronen blijven staan, maar een Volk zal nooit vergaan [Aucun trône ne reste debout, mais un peuple ne passe jamais]), dit l'hymne national flamand, contenant ainsi une magistrale profession de foi herdérienne dont les Flamands qui le chantent aujourd'hui ne sont plus guère conscients et dont la portée philosophique est pourtant universelle).
Pourquoi, chez Herder, cette primauté du donné brut et naturel qu'est le peuple par rapport aux institutions étatiques construites ? Parce qu'au moment où il écrit ses traités sur l'histoire, il n'y a pas un État allemand unitaire. Les Allemands du continent sont éparpillés sur une multitude d'État, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Dans le contexte allemand du XVIIIe s., on ne peut donc pas parler de l'État comme d'une réalité concrète, puisque cet État n'existe pas. Ce qui existe en réalité, ce qui est vraiment là, sous les yeux de Herder, c'est une vaste population germanique, diversifiée dans ses façons de vivre et par ses dialectes, mais unie seulement par une langue littéraire et une culture générale permettant d'harmoniser ses différences régionales ou dialectales. Herder voit une nation germanique en devenir constant, un édifice non achevé. Les nationalismes qui dérivent de sa philosophie de l'histoire perçoivent leur objet privilégié, soit la nation-peuple, comme un phénomène mouvant, en évolution constante.
La primauté de la culture sur les institutions (jugées toujours éphémères et sur la voie de la caducité), du peuple sur l'État, conduit aisément à la pratique de défendre les Volksgenossen (“congénères”) contre les États étrangers qui les oppriment ou qui, plus simplement, ne permettent pas leur déploiement optimal. Tous les “congénères” doivent en théorie bénéficier d'institutions souples et protectrices, déduites de l'héritage juridique et historique national voire d'institutions partagées par la majorité nationale. Il apparaît intolérable que certains “congénères” soient sous la coupe d'institutions étrangères ou contraints de servir de chair à canon dans des armées non nationales. Le sentiment qui naît de voir des “congénères” subir des injustices conduit parfois à une volonté d'irrédentisme. Dans cette optique nationale-allemande et herdérienne, les Autrichiens, les Alsaciens, les Luxembourgeois, les habitants d'Eupen et de Saint-Vith, les Tyroliens du Sud, les ressortissants des disporas allemandes de la Vistule à la Volga et de Bessarabie au Turkestan sont des compatriotes allemands à part entière.
Pour les Flamands, les habitants du Westhoek ou les diasporas flamandes réparties jusqu'au pied des Pyrénées sont des compatriotes — indépendamment de leur “nationalité de papier” — qu'il faut protéger quand ils ont maille à partir avec l'État étranger qui les tient sous tutelle. Le conflit entre Serbes et Croates vient du fait que ni les uns ni les autres ne peuvent accepter de voir les leurs sous la coupe d'un État reposant sur des principes qui leur sont étrangers : orthodoxes-byzantins pour les uns, catholiques-romains pour les autres. Les Russes aussi se sentent les protecteurs de leurs compatriotes en Ukraine, en Estonie, au Kazakstan et dans toutes les républiques musulmanes de l'ex-URSS. Les Hongrois affirment aujourd'hui haut et fort qu'ils protègent leurs compatriotes des Tatras et de la Voïvodine et laissent sous-entendre, notamment à la Slovaquie et à la Serbie, qu'ils sont prêts à intervenir militairement si les droits des minorités hongroises sont bafoués.
Pour Renan, l'idée d'une “communauté de volonté” ou d'un “plébiscite quotidien” repose de fait sur une volonté d'oublier chaque jour ce que l'on est en substance, afin de correspondre à une idée abstraite (la citoyenneté républicaine et universelle dans la version rationaliste, délirante et fanatique) ou à une image idéale (dans la version édulcorée et modérée). Pour les tenants du nationalisme de culture, une telle démarche est une aberration. C'est ce que reprochent les nationalistes flamands ou les germanophiles alsaciens à leurs franskiljoens ou à leurs Französlinge. Rien de plus ridicule évidemment que le francophile brabançon ou strasbourgeois qui se pique de suivre les modes de Paris. Gauche et maladroit, il camoufle, derrière des propos grandiloquents et un catéchisme schématique, une honte et une haine pathologiques de soi, qu'il essaye fébrilement, de surcroît, d'inculquer à ses compatriotes. À Bruxelles, certaines nullités politiciennes de bas étage inféodées au FDF (Front des Francophones) jouent ce jeu avec une obstination inquiétante, avec un fanatisme comparable à celui qui s'est exercé sous la Terreur, et bénéficient du soutien à peine dissimulé de quelques services du Quai d'Orsay.
Pour Tilman Mayer (cf. Prinzip Nation : Dimensionen der nationalen Frage am Beispiel Deutschlands, 1986 ; B.. Estel/T. Mayer, Das Prinzip Nation in modernen Gesellschaften : Länderdiagnosen und theoretische Perspektiven, 1994), philosophe allemand qui s'est penché sur la question du nationalisme, il convient de distinguer dans cette problématique Herder/Renan, les notions d'ethnos et de demos.
L'ethnos est un groupe démographique humain, avec une base ethnique bien clairement profilée. Le demos est l'ensemble des électeurs (donc des habitants de toutes les circonscriptions électorales d'un pays donné), sans qu'il ne soit nécessairement tenu compte de leur profil ethnique/anthropologique ; ceux-ci peuvent certes exprimer leurs opinions sur le plan politique et institutionnel, mais ils ne peuvent en aucun cas porter atteinte au fait naturel, au factum qu'est l'ethnos. Pour Mayer, comme jadis pour Herder, les peuples sont autant d'expressions spécifiques de cette humanité diversifiée voulue par Dieu (Herder est pasteur protestant), autant de façons de “l'être-homme” (het menszijn/Mensch-sein). Cette affirmation appelle d'autres réflexions d'ordre philosophique et anthropologique. À leur tour, ces réflexions conduisent à l'affirmation de principes politiques pratiques :
• Première réflexion : l'homme (l'humanité) est ontologiquement faible. Dans le donné naturel brut, dans sa déréliction, jeté au beau milieu d'un monde souvent hostile, l'homme nu, seul, est désarmé, ne pourrait survivre. Le “petit d'homme” n'a ni la fourrure de l'ours, ni les crocs du tigre, ni la fulgurante rapidité du guépard, ou l'agilité du dauphin ou les muscles puissants des grands singes anthropomorphes. Pour pallier à ces défauts, l'homme a besoin de la technique et de la culture.
• La technique, la fabrication d'outils, l'habilité manuelle lui procurent les instruments quotidiens (vêtements, armes, ustensiles divers, récipients, etc.) qui lui assurent sa survie biologique.
• La culture, en ce sens, est un ensemble de rites, de traditions, de règles ou d'institutions anthropologiques (mariage, famille, etc.) ou politiques (État, organisation militaire, judiciaire, etc.), qui permettent soit d'orienter les comportements vers le maximum d'efficacité soit de déployer autant de stratégies possibles pour répondre aux innombrables défis que lancent le monde et l'environnement.
Pluriversalité
L'humanité est répandue sur l'ensemble du globe, sous toutes les latitudes et dans tous les climats ou les biosphères ; cette répartition humaine est mouvante par l'effet des phénomènes migratoires, la pluralité des modes culturels/institutionnels est dès lors un postulat nécessaire, pour ne pas désorienter les hommes, pour leur conserver à tous un fil d'Ariane dans leurs pérégrinations à travers un monde labyrinthique. Les cultures doivent être maintenues et promues dans leur extrême diversité, de façon à ce que les stratégies de survie restent nombreuses pour affronter les innombrables situations ou contextes auxquels l'homme est sans cesse confronté.
Ce postulat de la diversité nécessaire induit un “pluriversalisme” et réfute les démarches universalistes. Le monde est un plurivers et non un univers. Un monde qui serait géré par une et une seule vision des choses serait un danger pour l'humanité, car cette vision unique, cette pensée unique, éliminerait la possibilité de déployer, ne fût-ce que par imitation, des stratégies multiples éprouvées avec succès dans d'autres Umwelten que le mien (les explorateurs polaires européens imitent les Esquimaux, les soldats européens imitent en Guyane, au Gabon ou en Birmanie les stratégies de survie des Pygmées dans les forêts vierges africaines, les explorateurs du désert calquent leurs comportement sur les Bédouins ou les Touaregs, etc.).
La pluriversalité est donc bel et bien une nécessité et un avantage pour l'homme, et la volonté perverse de certains cénacles, officines ou bureaux d'imposer une “political correctness”, niant cette luxuriante pluriversalité au profit d'une fade universalité, est une dangereuse aberration.
Si, en permanence, on peut tester au quotidien des stratégies vitales ethniquement ou biorégionalement profilées, on donne à l'humanité dans son ensemble plus de chances de survie. Dans une telle optique, l'Autre (l'Étranger) est toujours un enseignant, tout comme nous sommes pour lui aussi des enseignants. L'ennemi dans une telle optique est celui, compatriote ou étranger, qui refuse d'entendre et d'écouter l'Autre, d'enseigner ce qu'il sait, d'approfondir ce qu'il est, celui qui impose des modèles abstraits et inféconds par coercition ou par séduction perverse. Car dans un monde régi par le mono-modèle préconisé par les tenants de l'idéologie dominante et par leurs inquisiteurs, une réciprocité féconde et bienveillante, comme celle que nous souhaitons planétariser, ne serait pas possible.
Ces options pour la pluriversalité ou la pluralité doivent se répercuter au sein même de la nation. Au sein de sa nation, l'homme public ou politique, qui opte pour la vision herdérienne, plurielle et pluriverselle, doit, pour demeurer logique avec lui-même, respecter la pluralité qui constitue sa propre nation. Car la nation n'est jamais un monolithe, même quand elle est apparemment homogène ou plus homogène que ses voisines. La nation est une communauté complexe et multidimensionnelle, et non un groupe humain simple et unidimensionnel. La complexité et la multidimensionalité permettent de réaliser au sein de la nation ce qui se fait dans le monde : tester à chaque instant autant de stratégies vitales différentes que possible.
Le personnel politique pluriversaliste sélectionne alors les meilleures stratégies disponibles et les adapte à la situation et aux défis du moment : tel est le véritable pluralisme, et non pas cette pluralité d'options partisanes figées que l'on nous suggère aujourd'hui, en nous disant qu'elle est la panacée et l'unique forme de démocratie possible. Un État trop centralisé assèche ses potentialités : c'est le cas de la France qui tombe en quenouille sous le poids de ses contradictions mais c'est aussi le cas de la Wallonie ruinée où le PS francophile impose trop unilatéralement ses schémas et ce serait le cas d'une Flandre où seul le CVP aurait le dernier mot. Une vision organique de la nation implique la présence constante d'une pluralité de réseaux d'opinions ou une pluralité de projets, qui doivent avoir pour but, évidemment, de renforcer la cohésion de la nation, d'y introduire de l'harmonie, d'optimiser son déploiement.
La typologie des nationalismes chez John Breuilly
Dans Nationalism and the State (1993), John Breuilly nous offre une excellente classification de différents types de nationalismes qui se sont présentés sur la scène mondiale.
Première remarque de Breuilly : le nationalisme peut être porté par des strates très différentes de la société. Il peut être porté par la noblesse et la ruling class (comme en Angleterre), par la classe bourgeoise révolutionnaire (en France, de la Révolution à la Troisème République), par les paysans, par les ouvriers ou par les intellectuels. En Afrique du Sud, en Bulgarie, en Croatie, partiellement en Flandre (pendant la révolte paysanne contre la république française en 1796-99), en Irlande ou en Roumanie, les paysans sont porteurs de l'idée nationale. Avec James Connolly en Irlande et avec le péronisme en Argentine, les ouvriers et les syndicats (socialistes ou justicialistes) affirment la souveraineté nationale. Les intellectuels jouent un rôle moteur dans l'éclosion du nationalisme en Tchèquie, en Finlande, en Flandre, en Irlande, au Pays Basque et en Catalogne.
◘ 1. Dans un contexte où il n'existe pas d'États-nations, nous trouvons :
• des nationalismes d'unification, comme en Italie, en Allemagne ou en Pologne au XIXe siècle.
• des nationalismes de séparation, où les nations tentent de s'affranchir des empires dans lesquels elles sont incluses, comme la Hongrie, la Tchèquie, la Croatie dans l'empire austro-hongrois, ou la Roumanie, la Grèce et la Bulgarie dans l'empire ottoman.
La Serbie, par ex., est séparatiste contre les Ottomans, mais unificatrice dans le contexte yougoslave à partir de 1918, où elle est dominante. Les Arabes sont séparatistes contre les Turcs pendant la première guerre mondiale, mais unitaires dans leurs revendications nationales ultérieures. On peut également dire que le nationalisme flamand est tout à la fois séparatiste contre l'État belge mais vise l'unification pan-néerlandaise dans l'idée des Grands Pays-Bas, l'unification de Dunkerque à Memel dans l'idée hanséatique et “basse-allemande” (Aldietse Beweging) de C. J. Hansen (1833-1910), l'unification de tous les peuples germaniques chez quelques ultras de la collaboration entre 1940 et 1945 (De Vlag, etc.).
Pour les nations qui ne disposent pas d'une pleine souveraineté et sont incluses dans de vastes empires coloniaux, le nationalisme peut revêtir les aspects suivants :
♦ a. Être un nationalisme anti-colonialiste, comme en Inde jusqu'à l'indépendance en 1947 ou comme dans les nations africaines avant la grande vague de décolonisation des années 60 (où les soldats ghanéens revenus du front de Birmanie et travaillés par les miliants indiens et gandhistes, hostiles à la tutelle britannique, ont joué un rôle primordial).
♦ b. Être un sous-nationalisme dans des États issus des partages impérialistes décidés en Europe et/ou des administrations coloniales qui en ont résulté. Ce fut le cas du Pakistan en Inde, ce qui conduira à la partition du sous-continent indien. Ce fut également le cas au Katanga dans l'ex-Congo belge, mais cette sécession fut un échec.
♦ c. Être un nationalisme réformiste. Le nationalisme réformiste est un nationalisme qui se rend compte que la souveraineté formelle de la nation est insuffisante voire inutile, qu'elle ne peut faire valoir clairement ses prérogatives théoriques, vu le retard économique, industriel, institutionnel, militaire et technique que le pays a accumulé au cours de son histoire. Le nationalisme réformiste vise donc à accélérer le passage à un stade de développement optimal qui permet de faire face plus efficacement aux impérialismes qui tentent d'empiéter la souveraineté nationale. Les exemples historiques de nationalisme réformiste sont le Japon de l'ère Meiji, la Chine de Sun Ya-Tsen et la Turquie des Jeunes Turcs.
◘ 2. Dans un contexte où n'existent que des États-nations, où les impérialismes coloniaux ont théoriquement disparu et où les empires multinationaux tendent à disparaître, plusieurs types de nationalismes peuvent se manifester :
♦ a. Les nationalismes d'unification, qui prennent parfois le relais d'un nationalisme anti-colonialiste et sont, à ce titre, séparatistes. Ces nationalismes d'unification post-coloniaux sont le panafricanisme après la vague des indépendances dans les années 60. Ou le panarabisme, le nationalisme panarabe de Nasser.
♦ b. Le nationalisme de réforme en Europe. En Italie, par ex., le nationalisme démarre dans le giron du libéralisme italien qui est rigoureusement étatiste et centraliste. Il vise à créer en Italie un appareil industriel capable de concurrencer l'Angleterre, la France et l'Allemagne. L'obsession des libéraux italiens est de voir le pays basculer dans le sous-développement et devenir ainsi le jouet des puissances étrangères. Le fascisme prendra directement le relais de ce libéralisme national : sur le plan philosophique, la filiation libéralisme/fascisme prend son envol à partir de Hegel pour aboutir à l'interprétation italienne originale de Benedetto Croce et de celui-ci, qui reste libéral et s'oppose au fascisme, à l'actualisme hégélien/fasciste de Giovanni Gentile. À cette volonté permanente de modernisation de la société, de l'économie et des institutions italiennes, s'ajoute l'idéologie du futurisme qui proclame haut et clair ses intentions de balayer tous les archaïsmes qui frappent la société italienne d'incapacité. En Allemagne, à partir de Bismarck et de Guillaume II, la volonté de ne pas devenir le jouet de l'Angleterre ou de la France est clairement affichée : le programme d'industrialisation va bon train, couplé à une vision autarcique et contextuelle de l'économie (où les règles du jeu économique doivent favoriser un contexte politique et historique précis, sans prétendre à l'universel ; cf. les “écoles historiques” en économie et les pratiques préconisées par le “socialisme de la chaire”). Les historiens anglais reconnaissent volontiers que les Allemands les ont battus à la fin du XIXe siècle sur le plan des technologies chimiques et que la chimie a été le moteur d'un développement ultra-rapide de l'industrie allemande.
♦ c. Le nationalisme de séparation au sein d'États constitués, bi-ethniques ou multiethniques, bilingues ou multilingues, se manifeste dans des contextes de déséquilibres entre les composantes. Le nationalisme de séparation flamand prend actuellement de l'ampleur car le déséquilibre entre les 2 modèles d'économie en Belgique (le wallon et le flamand) ne sont pas compatibles au niveau fédéral, n'exigent pas les mêmes réponses et les mêmes modulations. En effet, une vieille structure économico-industrielle comme la Wallonie, qui correspond à la “première vague” de la société industrielle et a connu de graves difficultés à cause de l'effondrement des conjonctures en Europe, ne peut être gérée par les mêmes principes qu'une Flandre au tissu plus neuf, composé de PME, mais plus fragile face à la grande finance internationale. En Écosse, les problèmes sont également différents de ceux de l'Angleterre. En Italie du Nord, avec les ligues régionalistes, les clivages qui opposent les provinces septentrionales à l'État fédéral et aux structures sociales complexes (mafias incluses) des régions méridionales sont profonds, mais s'expriment davantage par un populisme séparatiste plutôt que par un nationalisme de culture ou d'État, d'ancienne mouture, avec son folklore et ses rituels.
Le besoin vital d'identité selon Kurt Hübner
Sur les plans psychologique, anthropologique et ontologique, l'homme a un besoin vital d'identité, tant au niveau personnel qu'aux niveaux communautaire et politique. Le philosophe allemand contemporain Kurt Hübner (in : Das Nationale : Verdrängtes, Unvermeidliches, Erstrebenswertes, 1991) résume brillamment en 8 points majeurs ce besoin vital d'identité :
◘ 1. L'identité d'une nation est un postulat anthropologique.
◘ 2. L'identité nationale repose sur un ensemble structuré de systèmes de règles, qui harmonisent les liens entre les individus et les groupes au sein de la nation.
◘ 3. Ces systèmes de règles fonctionnent comme des régulateurs et ne doivent pas être définis plus précisément, car toute définition serait ici un enfermement conceptuel infécond qui ferait fi des innombrables potentialités de la nation, en tant que fait de vie.
◘ 4. Ces systèmes nationaux sont instables et connaissent des hautes et des basses conjonctures.
◘ 5. Cette instabilité exige une adaptation constante, c'est-à-dire une attention constante aux transformations potentielles qui ne cessent de survenir. Dans un tel contexte, le nationaliste est celui qui demeure toujours en état d'alerte, parce qu'il souhaite que la conjoncture reste toujours haute pour le bénéfice de son peuple et est prêt à consacrer volontairement toutes ses énergies personnelles à ce travail quotidien de réception et d'adaptation des défis et des nouveautés.
◘ 6. Les transformations qu'une nation est appelée à subir ne sont jamais prévisibles. Dans l'appréhension du fait national (das Nationale), on ne peut donc pas faire appel à une grille de déchiffrement déterministe. Le nationalisme est toujours plutôt volontariste, il refuse d'accepter les basses conjonctures ou les dysfonctionnements de la machine étatique ou les imperfections génératrices de déclins et de crises : c'est là la grande différence entre le nationalisme et les autres grandes idéologies des XIXe et XXe siècles, comme le libéralisme, qui accepte les effets pervers de l'économie et les juge inéluctables, ou le marxisme (de moutures sociale-démocrate ou communiste), qui se réclame philosophiquement du déterminisme positiviste le plus plat et rejette toutes les formes et les manifestations de volontarisme comme des irrationalités dangereuses.
◘ 7. Le nationalisme ne parle donc jamais de déterminations mais de destin (lot, Schicksal, destiny). La notion de destin, à son tour, postule l'adhésion à la raison pratique (voire à des jeux diversifiés de raisons pratiques), plutôt qu'à la raison pure, toujours perçue comme unique en soi. La/les raison(s) pratique(s) appréhende(nt) les imperfections, les chutes de conjoncture, sans jamais chercher à les éluder mais, au contraire, visent à les travailler de multiples façons et à améliorer les situations dans la mesure du possible, tandis que la raison pure, en politique, dans le flux de l'histoire, tente de plaquer des principes irréels sur le réel, provoquant à terme des déphasages insurmontables. La manie de la “political correctness” est un avatar médiocre de cette raison pure de kantienne mémoire, appliquée maladroitement et déformée outrancièrement par des idéologues a-critiques. Dont les agitations frénétiques provoqueront bien évidemment des déphasages catastrophiques selon l'adage : qui veut faire l'ange, fait la bête.
◘ 8. La nation n'est donc pas une essence figée, comme l'affirment trop souvent les vieilles droites ou les romantismes nationaux étriqués, car tout caractère figé implique une sorte de déterminisme, induit une propension problématique à répéter des formes mortes, à proclamer des discours répétitifs, en porte-à-faux par rapport au réel mouvant et effervescent. Au contraire, la nation doit toujours être perçue comme un mouvement dynamique, comme une modulation localisée du destin auquel tous les hommes sont confrontés, comme un mouvement dynamique qu'il n'est jamais simple de définir ou d'enfermer dans une définition trop étroite. Cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter sans ménagement l'héritage romantique ou les formes anciennes de nationalisme. Un tel rejet se perçoit dans les gauches qui font toujours abstraction du temps et de l'espace (catégories auxquelles personne ne peut se soustraire) ou dans un parti ex-nationaliste comme la Volksunie flamande où l'on court d'un novisme sans épaisseur à l'autre, en se moquant méchamment et sottement des héritages que le nationalisme plus traditionnel aime à cultiver. Le travail des nationalistes romantiques constitue un héritage divers, où s'accumulent des trésors de découvertes culturelles, littéraires et archéologiques. Parmi tous ces éléments, on trouve des matériaux utiles pour promouvoir une dynamique nationale actuelle. La manie du rejet est donc une aberration supplémentaire du modernisme actuel.
Conclusion + remarques sur la “marche blanche”
En résumé, dans notre optique, tout nationalisme doit placer la concrétude “peuple” (Volk) avant l'abstraction “État”. Si l'État passe avant le peuple concret, et si cette pratique se proclame “nationaliste”, nous avons affaire à un paradoxe pervers. La priorité accordée à la population concrète dans un continuum historique concret signifie que, dans tous les cas de conflit ou de contestation violente, la vérité ou la solution est à rechercher dans la population elle-même. La “marche blanche” du 20 octobre 1996 à Bruxelles a montré que cette idée est ancrée dans le fond du subconscient populaire, tant en Flandre qu'en Wallonie, mais qu'elle ne peut pas s'exprimer dans les institutions étatiques belges, ce fatras d'abstractions dysfonctionnantes et sans avenir positif possible. La “marche blanche” a exprimé un mécontentement sans proposer un droit alternatif, clairement exprimé.
L'échec de cet étonnant mouvement populaire est dû à l'absence, dans la société belge, d'écoles (méta)politiques cohérentes, capables de vivifier constamment les legs du passé : seule l'Inde actuelle a donné l'exemple d'un mouvement parapolitique actif et efficace, vieux de près d'un siècle, le RSS, think tank bien drillé se profilant derrière la victoire récente du BJP. Les parents des enfants disparus ou assassinés ont eu tort de répondre à l'invitation du Premier Ministre à la fin de cette journée mémorable du 20 octobre 1996 : ils auraient dû refuser de le voir ce jour-là et réclamer, devant la foule innombrable venue les acclamer, la poursuite des grèves spontanées et des manifestations populaires contre les palais de justice et poser davantage de conditions :
• exiger au moins le retour inconditionnel du juge Connerotte, la démission de Stranard et Liekendael voire la dissolution de toute la Cour de Cassation,
• exiger l'incarcération des magistrats notoirement incompétents et leur jugement dans les 2 mois par une cour populaire spéciale,
• réclamer que les gendarmes fautifs et/ou négligeants soient traduits devant une cour martiale expéditive, composée de militaires de réserve, occupant tous une profession indépendante dans la société (médecins, chefs d'entreprise, avocats d'affaires, professeurs d'université, gestionnaires de grandes entreprises de pointe), expression d'une souveraineté populaire, d'une créativité professionnelle qui ont le droit de s'exprimer et de juger très sévèrement, avec une rigueur implacable, les fonctionnaires incompétents, auxquels on autorise de porter des armes et à qui on accorde des prérogatives ou des passe-droits et qui ne s'en servent pas à bon escient, qui sont assermentés dont parjures quand ils défaillent ; de telles négligences sont des crimes graves de trahison à l'encontre de notre peuple ;
• imposer le rétablissement de la peine de mort pour les crimes contre les enfants et, enfin,
• imposer la mise sur pied immédiate d'un comité de salut public composé d'officiers de réserve, de juristes indépendants et de citoyens n'étant ni fonctionnaires de l'État ou d'une région ni membres d'un parti (quel qu'il soit) ; ce comité de salut public aurait été commandé par un lieutenant-drossard (fonction prévue par le droit brabançon au XVIIIe s. pour lutter contre la grande criminalité, notamment les bandes de “chauffeurs” qu'étaient les bokkenrijders, avant l'adoption aberrante du droit révolutionnaire et napoléonien, véhicule d'abstractions perverses et de délires juridiques modernistes) ; ce comité de salut public et ce lieutenent-drossard auraient eu préséance sur toutes les autres institutions judiciaires et auraient pu agir à leur guise et procéder à des arrestations rapides, mais uniquement dans le cadre de l'enquête sur les agissements de Dutroux, menée par le juge Connerotte, légalement désigné au départ (Un comité de salut public ne saurait avoir la prétention de régenter tout le fonctionnement de la société au-delà des compétences concrètes des professionnels, mais seulement de gommer ponctuellement, au plus vite, par une bonne et diligente justice, les anomalies les plus dangereuses de la société).
La naïveté des parents et de la foule a été incommensurable et le cynisme abject du pouvoir en place — qui ne se soucie ni des dysfonctionnements ni de la vie des enfants et des humbles — a pu s'imposer rapidement, au bout de quelques semaines. Sur le plan philosophique et politique, le comité de salut public aurait eu pour fonction de prouver urbi et orbi la priorité de l'homme concret sur toutes les structures abstraites, assurant ainsi le triomphe d'une idée vivante mais étouffée qui traverse notre peuple. Devant le citoyen simple et honnête, meurtri dans ce qu'il a de plus cher, les autorités doivent toujours plier, que ces autorités soient la gendarmerie, la magistrature ou l'État.
Enfin, dernière remarque, le nationalisme, dans ce pays, ne doit pas se contenter de discours idéalistes, de grandiloquences sans objet, de lamentations interminables sur tout ce qui ne va plus, mais travailler à imposer au pouvoir corrompu — qui se revendique d'idéologies irréelles ne donnant jamais la priorité aux faits réels marqués par le temps et le lieu — les instruments juridiques qui sanctionneraient cette priorité : p. ex. le referendum et la multiplication des ombudsmen, dans tous les domaines de la fonction publique.
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°32, 1997.
◘ Sources principales :
- John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester Univ. Press, Manchester-UK, 1993, 474 p.
- Bernd Estel / Tilman Mayer (Hrsg.), Das Prinzip Nation in modernen Gesellschaften. Länderdiagnosen und theoretische Perspektiven, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994, 325 p. Dans ce volume, cf. Wolfgang Lipp, « Regionen, Multikulturalismus und Europa : Jenseits der Nation ? », pp. 97-114 ; Tilman Mayer, « Kommunautarismus, Patriotismus und das nationale Projekt », pp. 115-130 ; Klaus Schubert, « Frankreich - von der Großen Nation zur ziellosen Nation ? », pp. 171-196.
- Kurt Hübner, Das Nationale : Verdrängtes, Unvermeidliches, Erstrebenswertes, Styria, Graz, 1991, 313 p.
- Tilman Mayer, Prinzip Nation : Dimension der nationalen Frage am Beispiel Deutschlands, Leske & Budrich, Leverkusen, 1986, 267 p. Sur cet ouvrage, cf. Luc Nannens, « Le principe “Nation” », in Vouloir n°40/42, 1987.
- Heinrich August Winckler (Hrsg.), Nationalismus, Verlagsgruppe Athenäum/ Hain/ Scriptor/ Hanstein, Königstein/Ts., 1978, 308 p. À propos de ce livre, cf. Robert Steuckers, « Pour une typologie opératoire des nationalismes », in Vouloir n°73-74-75, 1991, pp. 25-30.
◘ Sources secondaires :
- Colette Beaune, « La notion de nation en France au Moyen-Âge », in : Communications n°45/1987 « Éléments pour une théorie de la nation », pp. 101-116, Seuil, 1987.
- Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard Univ. Press, Cambridge-Massachussetts, 1994 (2nd ed.), 270 p. Ouvrage capital pour comprendre comment Français et Allemands conçoivent les notions de nationalité et de citoyenneté. Ces approches allemande et française sont fondamentalement différentes.
- Liah Greenfeld, Nationalism : Five Roads to Modernity, Harvard Univ. Press, 1993 (2nd pbk ed.). Les sources du nationalisme en Angleterre, en France, en Allemagne, en Russie et aux États-Unis.
- Georges Gusdorf, « Le cri de Valmy », in : Communications n°45/1987, op. cit., pp. 117-146.
- Stein Rokkan, « Un modèle géo-économique et géopolitique », in : Communications n°45/1987, op. cit., pp. 75-100.
- Heinrich August Winckler & Hartmut Kaelble, Nationalismus, nationalitäten, Supra-nationalität, Klett-Cotta, Stuttgart, 1993, 357 p. Dans ce volume, cf. Gilbert Ziebura, « Nationalstaat, Nationalismus, supranationale Integration : Der Fall Frankreich », pp. 34-55 ; Wolfgang Kaschuba, « Volk und Nation : Ethnozentrismus in Geschichte und Gegenwart », pp. 56-81.

◘ Quel “nationalisme” pour les années 90 et le XXIe siècle ?
• nota bene : Texte préalablement publié en langue néerlandaise dans la revue Revolte (été 1991). Il entrait dans le cadre d'un débat sur le nationalisme en Flandre.
 Dans nos régions, nous avons coutume d'opposer 2 formes de nationalisme, le nationalisme de culture (ou nationalisme populaire : volksnationalisme) et le nationalisme d'État (staatsnationalisme). Le nationalisme culturel/populaire tient compte essentiellement de l'ethnicité, en tant que matrice historique de valeurs précises qui ne sont pas transposables dans un autre humus. Le nationalisme d'État met l'ethnicité ou les ethnicités d'un territoire au service d'une machine administrative, bureaucratique ou militaire. Pour cette idéologie, l'ethnicité n'est pas perçue comme une matrice de valeurs mais comme une sorte de carburant que l'on brûlera pour faire avancer la machine. L'État, dans la perspective du staatsnationalisme, n'est pas une instance qui dynamise les forces émanant de la Volkheit mais un moloch qui les consomme et les détruit.
Dans nos régions, nous avons coutume d'opposer 2 formes de nationalisme, le nationalisme de culture (ou nationalisme populaire : volksnationalisme) et le nationalisme d'État (staatsnationalisme). Le nationalisme culturel/populaire tient compte essentiellement de l'ethnicité, en tant que matrice historique de valeurs précises qui ne sont pas transposables dans un autre humus. Le nationalisme d'État met l'ethnicité ou les ethnicités d'un territoire au service d'une machine administrative, bureaucratique ou militaire. Pour cette idéologie, l'ethnicité n'est pas perçue comme une matrice de valeurs mais comme une sorte de carburant que l'on brûlera pour faire avancer la machine. L'État, dans la perspective du staatsnationalisme, n'est pas une instance qui dynamise les forces émanant de la Volkheit mais un moloch qui les consomme et les détruit.
Les nationalismes culturels/populaires partent d'une vision plurielle de l'histoire, du monde et de la politique. Chaque peuple émet des valeurs qui correspondent aux défis que lui lance l'espace sur lequel il vit. Dans les zones intermédiaires, des peuples en contact avec 2 grandes aires culturelles combinent les valeurs des uns et des autres en des synthèses tantôt harmonieuses tantôt malheureuses. Les nationalismes d'État arasent généralement les valeurs produites localement, réduisant la diversité du territoire à une logique unique, autoritaire et stérile.
Valoriser l'histoire, relativiser les institutions
Par tradition historique, noua sommes, depuis l'émergence des nationalismes vers l'époque de la révolution française, du côté des nationalismes culturels contre les nationalismes d'État. Mais au-delà des étiquettes désignant les diverses formes de nationalisme, noua adhérons, plus fondamentalement, à des systèmes de valeurs qui privilégient la diversité plutôt qu'à des systèmes d'action qui tentent de la réduire à des modèles simples, homogénéisés et, de ce fait même, stérilisés. Toute approche plurielle des facteurs historiques et politiques implique une relativisation des institutions établies ; celles-ci ne sont pas d'emblée jugées éternelles et indépassables. Elles sont perçues comme exerçant une fonction précise et doivent disparaître dès que cette fonction n'a plus d'utilité. Les approches homogénéisantes imposent un cadre institutionnel que l'on veut intangible. La vitalité populaire, par définition plurielle dans ses manifestations, déborde tôt ou tard ce cadre rigide. Deux scénarios sont alors possibles : a) les mercenaires au service du cadre répriment la vitalité populaire par violence ou b) le peuple met à bas les institutions devenues obsolètes et chasse ou exile les tenants têtus du vieil ordre.
Qu'en est-il de cette opposition entre pluralité et homogénéisation à la veille du XXIe siècle ? Il me semble inopportun de continuer à répéter tel quel les mots d'ordre et les slogans nés lors de l'opposition, au début du XIXe siècle, entre “nationalismes de culture” (Verlooy, Jahn, Arndt, Conscience, Hoffmann von Fallersleben) et “nationalismes d'État” (jacobinisme, bonapartisme). Pour continuer à exprimer notre opposition de principe aux stratégies d'homogénéisation, qui ont été celles du jacobinisme et du bonapartisme, noua devons choisir, aujourd'hui, un vocabulaire moderne, dérivé des sciences récentes (biocybernétique, informatique, physique etc.). En effet, les “nationalismes d'État” ont pour caractéristique d'avoir été forgés sur le modèle des sciences physiques mécanicistes du XVIIIe siècle. Les “nationalismes culturels”, eux, ont voulu suggérer un modèle d'organisation politique calqué sur les principes des sciences biologiques émergentes (J.W. Ritter, Carus, Oken, etc.). Malgré les progrès énormes de ces sciences de la vie dans le monde de tous les jours, certains États (Belgique, France, Italie, URSS, Yougoslavie, “démocraties socialistes”, Algérie, etc.) fonctionnent toujours selon des critères mécanicistes et demeurent innervés par des valeurs mécanicistes homogénéisantes.
Les leçons d’Alvin Toffler
Le nationalisme, ou tout autre idéologie, qui voudrait mettre un terme à cette anomalie, devra nécessairement être de nature offensive, porté par la volonté de briser définitivement les pouvoirs anciens. Il ne doit pas vouloir les consolider ni remettre en selle des modèles passés de nationalisme statolâtrique. La lecture du dernier livre d'un écrivain américain célèbre, Alvin Toffler, nous apparaît utile pour comprendre les enjeux des décennies à venir, décennies où les mouvements (nationalistes ou non) hostiles aux établissements devront percer sur la scène politique. Entendons-nous bien, ces mouvements, dans la mesure où ils sont hostiles aux formes figées héritées de l'ère mécaniciste/révolutionnaire, sont authentiquement “démocratiques” et “populistes” ; nous savons depuis les thèses de Roberto Michels que le socialisme a basculé dans l'oligarchisation de ses cadres. Nous savons aussi que ce processus d'oligarchisation a affecté le pilier démocrate-chrétien, désormais connecté à la mafia en Italie et partout éloigné du terreau populaire. Si bien que les élus socialistes ou démocrates-chrétiens eux-mêmes se rendent compte que les décisions sont prises, dans leurs partis, en coulisse et non plus dans les assemblées générales (les tripotages de Martens au sein de son propre parti en sont une belle illustration).
Ce phénomène d'oligarchisation, de gigantisme et de pyramidalisation suscite l'apparition de structures pachydermiques et monolithiques, incapables de capter les flux d'informations nouvelles qui émanent de la réalité quotidienne, de la Volkheit en tant que fait de vie. Je crois, avec Alvin Toffler, que ce hiatus prend des proportions de plus en plus grandes depuis le milieu des années 80 : c'est le cas chez nous, où le CVP s'effrite parce qu'il ne répond plus aux besoins des citoyens actifs et innovateurs ; c'est le cas en France, où les partis dits de la “bande des quatre” s'avèrent incapables de résoudre les problèmes réels auxquels la population est confrontée. Toffler nous parle de la nécessité de provoquer un “transfert des pouvoirs”. Ceux-ci, à l'instar de ce qui s'est effectivement produit dans les firmes gigantesques d'Outre-Atlantique, devront passer, « des monolithes aux mosaïques ». Les entreprises géantes ont constaté que les stratégies de concentration aboutissaient à l'impasse ; il a fallu inverser la vapeur et se décomposer en un grand nombre de petites unités à comptabilité autonome, opérationnellement déconcentrées. Autonomie qui les conduira inévitablement à prendre un envol propre, adapté aux circonstances dans lesquelles elles évoluent réellement. Les mondes politiques, surtout ceux qui participent de la logique homogénéisante jacobine, restent en deçà de cette évolution inéluctable : en d'autres termes, ils sont dépassés et contournés par les énergies qui se déploient au départ des diverses Volkheiten concrètes. Phénomène observable en Italie du Nord, où les régions ont pris l'initiative de dépasser le monolithe étatique romain, et ont créé des réseaux alpin et adriatique de relations interrégionales qui se passent fort bien des immixtions de l'État central. La Vénétie peut régler avec la Slovénie ou la Croatie des problèmes relatifs à la région adriatique et, demain, régler, sans passer par Rome, des problèmes alpins avec la Bavière, le Tyrol autrichien, la Lombardie ou le canton des Grisons. Ces régions se dégagent dès lors de la logique monolithique stato-nationale pour adopter une logique en mosaïque (pour reprendre le vocabulaire de Toffler), outrepassant, par suite, les niveaux hiérarchiques établis qui bloquent, freinent et ralentissent les flux de communications. Niveaux hiérarchiques qui deviennent ipso facto redondants. Par rapport aux monolithes, les mosaïques de Toffler sont toujours provisoires, réorientables tous azimuts et hyper-flexibles.
La “Troisième Vague”
Caractère provisoire, réorientabilité et hyper-flexibilité sont des nécessités postulées par les révolutions technologiques de ces 20 dernières années. L'ordinateur et le fax abolissent bon nombre de distances et autonomisent d'importantes quantités de travailleurs du secteur tertiaire. Or les structures politiques restent en deçà de cette évolution, donc en discordance avec la société. Toffler parle d'une “Troisième Vague” post-moderne qui s'oppose à la fois au traditionalisme des mouvements conservateurs (parfois religieux) et au modernisme homogénéisant. Aujourd'hui, tout nationalisme ou tout autre mouvement visant l'innovation doit être le porte-voix de cette “Troisième Vague” qui réclame une révision totale des institutions politiques établies. Basée sur un savoir à facettes multiples et non plus sur l'argent ou la tradition, la “Troisième Vague” peut trouver à s'alimenter au nationalisme. de culture, dans le sens où ce type-là de nationalisme découle d'une logique plurielle, d'une logique qui accepte la pluralité. Les nationalismes d'État, constructeurs de molochs monolithiques, sont résolument, dans l'optique de Toffler, des figures de la “Seconde Vague”, de “l'Âge usinier”, ère qui a fonctionné par monologique concentrante ; preuve : devant les crises actuelles (écologie, enseignement, organisation du secteur de santé, transports en commun, urbanisme, etc.), produites par des étranglements, des goulots, dus au gigantisme et à l'éléphantiasis des structures datant de “l'âge usinier”, les hommes politiques, qui ne sont plus au diapason, réagissent au coup par coup, c'est-à-dire exactement selon les critères de leur monologique homogénéisante, incapable de tenir compte d'un trop grand nombre de paramètres. Les structures mises en place par les nationalismes d'État sont lourdes et inefficaces (songeons à la RTT ou la poste), alors que les structures en mosaïques, créées par les firmes qui se sont déconcentrées ou par les régions nord-italiennes dans la nouvelle synergie adriatique/alpine, sont légères et performantes. Tout nationalisme ou autre mouvement innovateur doit donc savoir s'adresser, dès aujourd’hui, à ceux qui veulent déconcentrer, accélérer les communications et contourner les monolithes désormais inutiles et inefficaces.
Les “lents” et les “rapides”
Toffler nous parle du clivage le plus important actuellement : celui qui distingue les “lents” des “rapides”. L'avenir proche appartient évidemment à ceux qui sont rapides, ceux qui peuvent prendre des décisions vite et bien, qui peuvent livrer des marchandises dans les délais les plus brefs. Les pays du Tiers-Monde appartiennent évidemment à la catégorie des “lents”. Mais bon nombre de structures su sein même de nos sociétés “industrielles avancées” y appartiennent également. Prenons quelques exemples : l'entêtement de plusieurs strates de l'establishment belge à vouloir commercer avec le Zaïre, pays hyper-lent parce qu'hyper-corrompu (tel maître, tel valet, serait-on tenté de dire...) relève de la pure aberration, d'autant plus qu'il n'y a guère de profits à en tirer ou, uniquement, si le contribuable finance partiellement les transactions ou les “aides annexes”. Quand Geene a voulu infléchir vers l'Indonésie, pays plus rapide (dont la balancé commerciale est positive !), les flux d'aides belges au tiers-monde, on a hurlé au flamingantisme, sous prétexte que l'Insulinde avait été colonie néerlandaise. Pour toute perspective nationaliste, les investissements doivent, comme le souligne aussi Toffler, opérer un retour au pays ou, au moins, se relocaliser en Europe. Deuxième exemple : certains rapports de la Commission des Communautés européennes signalent l'effroyable lenteur des télécommunications en Belgique (poste, RTT, chemin de fer, transports en commun urbains, etc.) et concluent que Bruxelles n'est pas la ville adéquate pour devenir la capitale de l'Europe de 1992, en dépit de tout ce que Martens, les banques de l'établissement, la Cour, etc. ont mis en œuvre pour en faire accepter le principe. Hélas pour ces “lents”, il y a de fortes chances pour que Bonn ou Strasbourg emportent le morceau !
Partitocratie et apartheid
Des démonstrations qui précédent, il est facile de déduire quelques mots d'ordre pour l'action des mouvements innovateurs :
• lutte contre toutes les formes d'oligarchisation issues de la partitocratie ; ces oligarchisations ou pilarisations (verzuiling) sont des stratégies de monolithisation et d'exclusion de tous ceux qui n'adhérent pas à la philosophie de l'un ou l'autre pilier (zuil). Sachons rappeler à Paula d'Hondt que ce ne sont pas tant les immigrés qui sont des exclus dans notre société, qui seraient victimes d'un “apartheid”, mais qu'une quantité impressionnante de fils et de filles de notre peuple ont été ou sont “exclus” ou “mal intégrés” à cause des vices de fonctionnement de la machine étatique belge. Ne pas pouvoir être fonctionnaire si l'on n'est pas membre d'un parti, ou devoir sauter plus d'obstacles pour le devenir, n'est-ce pas de “l'apartheid” ? Conclusion : lutter contre l'apartheid de fait qu'est la pilarisation et rapatrier progressivement les immigrés, après les avoir formés à exercer une fonction utile à leur peuple et pour éviter précisément qu'ils soient, à la longue, victimes d'un réel apartheid, n'est-ce pas plus logique et plus humain que ce qui est pratiqué actuellement à grands renforts de propagande ?
• abattre vite toutes les structures qui ne correspondent plus au niveau actuel des technologies ; un nationalisme de culture, parce qu'il parie sur les énergies inépuisables du peuple, n'est forcément pas passéiste.
• s'inscrire, notamment avec la Lombardie et la Catalogne, dans les stratégies interrégionales en mosaïques ; tout en sachant que l'obstacle demeure la France, dont le conseil constitutionnel vient de décider que le peuple corse n'existait pas ! Ne dialoguer en France qu'avec les régionalistes et renforcer par tous les moyens possibles le dégagement des régions de la tutelle parisienne. Solidarité grande-néerlandaise avec la région Nord-Pas-de-Calais et grande-germanique avec l'Alsace. Pour la Wallonie, si d'aventure elle se dégage de la tutelle socialiste et maçonnique (pro-jacobine), solidarité prioritaire avec les cantons romans de la région Nord-Pas-de-Calais et avec la Lorraine, en tant que régions originairement impériales et romanes à la fois (la Wallonie traditionnelle, fidèle à sa vocation impériale, a un devoir de solidarité avec les régions romanes de l'ancien Reich, la Reichsromanentum, victime des génocides perpétrés par Louis XIV en Lorraine et en Franche-Comté, où 50% de la population a été purement et simplement massacrée ; les énergies de la Wallonie post-socialiste devront se porter le long d'un axe Namur / Arlon /Metz / Nancy / Genève). Appui inconditionnel aux régionalismes corse, breton, occitan et basque, si possible de concert avec les Irlandais, les Catalans, les Lombards et les Piémontais. Forcer les Länder allemands à plus d'audace dans les stratégies de ce type.
• diplomatie orientée vers les “rapides”. Ne plus perdre son temps avec le Zaïre ou d'autres États corrompus et inefficaces. Les relations avec ce pays ne sont entretenues que pour défendre des intérêts dépassés, que l'on camoufle souvent derrière un moralisme inepte.
• combattre toutes les lenteurs intérieures, même si nous ne souhaitons pas que Bruxelles devienne la capitale de l'Europe. Si les institutions européennes déménagent ailleurs, les projets de Martens s'effondreront et son régime autoritaire, appuyé notamment sur la Cour et non sanctionné par la base de son propre parti, capotera. L'effondrement du CVP, comme son tassement annoncé, permettra l'envol d'un néo-nationalisme futuriste, tablant sur la longue mémoire et sur la vitesse. Car l'une n'exclut pas l'autre. Un peuple qui garde sa mémoire intacte, sait que l'histoire suit des méandres souvent imprévus et sait aussi quelles réponses ses ancêtres ont apportées aux défis insoupçonnés de l'heure. La mémoire garantit toujours une réponse modulée et rapide aux défis qui se présentent. L'ordinateur n'est-il pas précisément un instrument performant parce qu'il est doté d'une mémoire ? Donc, le nationalisme culturel/populaire, plurilogique, est un bon logiciel. Gardons-le et sachons l'améliorer.
► Robert Steuckers, Vouloir n°83/86, 1991.
• Source : Alvin Toffler, Les Nouveaux Pouvoirs : Savoir, richesse et violence à la veille du XXle siècle, Fayard, 1991, 658 p.

◘ Nationalisme, concert européen impérial , nouvelle droite et renouveau catholique
Entretien avec Robert Steuckers, 1994
 • Animateur des revues Vouloir et Orientations (qui ont pris peu à peu la place d'Éléments dans le public de la “Nouvelle Droite”), pouvez-vous nous dire comment vous percevez le retour des nationalismes en Europe ?
• Animateur des revues Vouloir et Orientations (qui ont pris peu à peu la place d'Éléments dans le public de la “Nouvelle Droite”), pouvez-vous nous dire comment vous percevez le retour des nationalismes en Europe ?
Le terme “nationalisme” recouvre une quantité d’aspirations politiques, parfois divergentes. Alors, je commencerai par mettre les choses au point : pour moi, le “nationalisme”, en tant qu’idéologie et pratique politiques, dérive tout naturellement du mot “nation” ; au sens étymologique, c’est-à-dire au sens premier, le mot “nation” contient la même racine que “naître” (du latin nascere / nasci, natus). La nation est donc la grande famille dans laquelle je nais, et aussi le sol où cette grande famille s’est épanouie. La nation est donc le peuple et le pays au sens charnel du terme. Toute autre définition de la nation est pour moi abusive, tronquée ou extrapolée. Donc fausse. Comme l’Europe est faite de multiples nations, voisines les unes des autres, le philosophe, l’historien ou le militant qui pensent en termes de nationalité déploient automatiquement une pensée qui accepte la variété, la diversité, la multiplicité, la pluralité et s’en réjouissent. Il veut un monde fait d’une infinité de coloris et non un monde de grisaille, comme nous en connaissons dans les banlieues de nos grandes villes. Cette définition de la nation postule que je dois admettre que l’autre veuille gérer son destin local à sa manière.
Mais cette multiplicité est difficile à gérer à l’échelle de notre continent, surtout à l’heure où de vieux peuples réclament une structure étatique propre et une voix dans le concert européen. De cette revendication peut jaillir un nouveau désordre, si toutes ces entités politiques, les vieilles comme les nouvelles, se ferment sur elles-mêmes et se refont la guerre au nom de querelles anciennes. Mais si l’on se place directement au niveau européen, au niveau de notre civilisation, et que nous acceptons que cette civilisation s’exprime par une grande variété de modes et de façons, on s’efforcera automatiquement d’élaborer un droit des gens capable de gérer cette diversité sans heurts. Et ce droit des gens s’inspirera des techniques impériales (propres au Saint-Empire médiéval), des modalités fédéralistes de gestion de l’État (Suisse, RFA) et acceptera les clauses de la CSCE quant à la protection des minorités linguistiques.
En effet, le retour des nationalismes n’est pas tant un retour à l’État fermé qu’une volonté de se débarrasser des centralismes trop contraignants et des modes de gestion propres au communisme marxiste-léniniste et au technocratisme libéral occidental. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies de communication, le centralisme rigide d’autrefois n’est plus de mise. L’homme du XXIe siècle devra faire face à cette triple nécessité : nécessité géopolitique de concevoir l’unité de l’Europe, nécessité éthique de respecter les diversités productrices de richesses et nécessité pratique de mettre les appareils politiques au diapason des nouvelles techniques de communications.
• Ces nationalismes peuvent-ils déboucher sur l'émergence d'un Empire européen ?
Il me semble qu’il est encore trop tôt pour parler d’“Empire européen”. D’abord parce que la logique impériale, qui est fédérale, et fonctionne selon le principe de subsidiarité, n’est pas également répartie en Europe. Il subsiste des zones rétives à cette logique de pacification intérieure du continent. Je crois qu’il faut d’abord travailler au sein d’une structure qui existe et qui est la CSCE (qui regroupe tous les pays européens, Russie comprise, plus les États-Unis et le Canada). L’idéal, ce serait que la CSCE évolue vers un concert civilisationnel européen et euro-centré, que les États-Unis et le Canada s’en retirent pour concentrer leurs efforts sur l’ALENA (Association de Libre-Echange Nord-Américaine). Les États d’Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique) auront une longueur d’avance : tous 3 sont effectivement gérés par un système fédéral. Ce qui facilite les choses.
La CEE, c’est-à-dire l’Europe de Maastricht est insuffisante. La fermer sur elle-même est une erreur géopolitique et une injustice sociale à l’égard des pays de l’Est. De plus, sur le plan stratégique et militaire, cette CEE n’est pas viable. La seule entité géostratégiquement viable à très long terme, c’est l’union stratégique des pays européens et asiatiques de la CSCE, reposant sur une interprétation du droit des gens qui accepte les différences culturelles, les gère et les cultive. L’erreur de la CEE a été de vouloir uniformiser l’économie avant d’arriver à un accord inter-européen sur les principes de droit (droit des gens et droit constitutionnel).
Le travail de la CEE a été de déconstruire les barrières douanières en tous domaines. Il est évident que c’était peut-être nécessaire dans certaines grosses industries (le charbon et l’acier, d’où la CECA) mais nullement en agriculture. Résultat, nous avons partout en Europe des zones périphériques déshéritées, incapables de sortir de la mélasse puiqu’elles ne peuvent plus recourir à la technique des barrières douanières pour protéger l’emploi chez elles. De surcroît, globalement, l’Europe n’est pas indépendante sur le plan alimentaire, ce qui la met à la merci des puissances exportatrices de céréales (les États-Unis).
La CSCE est intéressante parce qu’elle repose prioritairement sur le droit et non sur l’économie. Et ce droit règle notamment des problèmes de minorités, qui sont des entités collectives porteuses de culture. Si un “Empire européen” doit advenir — mais je préfère parler d’un concert européen intégré — il reposera sur la généralisation d’un droit constitutionnel de type fédéral, sur la défense de toutes les minorités linguistiques et culturelles et sur l’effort concret de parvenir à l’indépendance alimentaire.
• Longtemps la “Nouvelle Droite” s'est présentée comme païenne, comment voyez-vous le renouveau du catholicisme en Europe et dans le monde ?
Je tiens beaucoup à préciser que le paganisme, pour moi, dès le départ, n’a jamais été la volonté de forger un comportement religieux nouveau, mais essentiellement une défense des humanités gréco-latines et l’étude des racines culturelles de tous les autres grands goupes ethniques européens. Ces “humanités” nous dévoilaient une conception du droit et de l’État (des res publicae, des choses publiques : notons le pluriel !) qui pourrait parfaitement nous inspirer encore aujourd’hui. Je rappelle aux zélotes d’une religion caricaturale et sulpicienne que les notions de droit, propres aux Romains, aux Grecs et aux Germains, sont plus anciennes que la religion chrétienne et que ce sont eux qui forment véritablement l’armature de la civilisation européenne.
Bien sûr, j’ai toujours reproché aux cercles de la Nouvelle Droite de ne jamais avoir exploré cette veine-là et d’avoir voulu rétablir un culte païen, en ne tenant pas compte du fait que l’Europe pré-chrétienne était animée par une religion de la Cité, c’est-à-dire une religion éminemment politique et non prioritairement esthétique, morale ou éthique. En voulant théoriser une “éthique païenne” ou recréer ex nihilo une “esthétique païenne”, avant de rétablir le droit romain ou germanique dans sa plénitude et dans son sens initial, les vedettes les plus bruyantes de la “Nouvelle Droite” ont fait du christianisme inversé, ont tout simplement joué, comme des adolescents irrévérencieux, à renverser les tabous de leur éducation catholique. C’était stupide et peu constructif.
Quant au renouveau catholique, je suis sceptique. Évidemment, plusieurs revues italiennes, plus ou moins proche du Vatican (Il Sabato, 30 Giorni), publient des textes de grande valeur, qui renouent avec les grands principes généraux de la politique romaine et abandonnent les chimères de Vatican II ou de mai 68. Par ailleurs, la dépravation morale contemporaine, due aux excès de matérialisme socialiste ou capitaliste, rend attirantes la religion en général et l’idée de communauté fraternelle en particulier. Mais, je ne suis pas prêt à parier pour un catholicisme qui voudrait réduire à néant les acquis du protestantisme ou le caractère sublime de l’orthodoxie gréco-byzantine et russe ou reprendre une croisade contre l’Islam ou dénaturer le vieux fond gréco-celto-romano-germano-slave. Chez les catholiques, il faut retenir, à mon sens, mais en laïcisant ces intuitions et en les ramenant à leur matrice juridique romaine :
◘ 1) L’idée d’un œkumène européen, animé par une nouvelle synthèse spirituelle (ce qu’avait voulu réaliser le Tsar Alexandre Ier après la parenthèse napoléonienne).
◘ 2) La notion de forme politique basée sur la famille (mais non plus la famille nucléaire actuelle ou évangélique, mais la gens au sens romain ou la Sippe au sens germanique). Carl Schmitt est le penseur qui a théorisé la notion de « forme politique catholique (au sens d’universel) ». Il faut le relire.
◘ 3) Reprendre, en les laïcisant, les linéaments du catholicisme social, tant dans sa variante corporatiste que dans sa variante sociologique (Othmar Spann).
◘ 4) En France, s’inspirer des études de Stéphane Rials et de Chantal Millon-Delsol, pour y généraliser un droit inspiré par la subsidiarité.
Le renouveau catholique ne saurait être, pour mes camarades et moi-même, le triste guignol intégriste avec ses monstrations esthétiques et ses vaines recherches d’une vérité éthique ; ce qui fait urgence, c'est bien le retour à une forme romaine du politique, valable pour toute l’Europe. Un véritable renouveau catholique devrait abandonner la fibre religieuse évangélique, renoncer à toute forme de bigoterie, sphères où désormais les pires simagrées psycho-pathologiques sont possibles, où ont sévi les pires vecteurs de l’anti-politisme, pour redevenir purement et pleinement religiosité politique. Il ne faut retenir du message catholique que ce qui a amélioré et perfectionné le vieux fond politico-juridique romain (au sens pré-impérial, républicain, du terme). Méditons en ce sens Caton l’Ancien.
► Propos recueillis par Xavier Cheneseau, 1994.

DOSSIER “LE NATIONALISME EN QUESTION”
◘ Sommaire : Itinéraire (Robert Steuckers) — Les équivoques du nationalisme (Charles Champetier) — Idée d'Empire et universalisme (Julius Evola) — Les lois de la variété requise (Yann Fouéré) — Pour une typologie opératoire des nationalismes (RS) — L'universalisme de la différence (Arnaud Dubreuil) — Le joujou nationalisme - Autopsie d'un phantasme anachronique (Pierre Chalmin) — Un regard indien sur le fait “nationalisme” (RS).
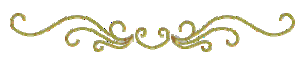
◘ Itinéraire
À l'avant-scène du monde politique, il y a retour de mouvements qui se donnent l'étiquette de “nationalisme”. Leurs adversaires croient dénoncer le nationalisme. Résultat : affirmations et critiques se succèdent dans le désordre le plus complet. Motif : le nationalisme est une réalité plus complexe et davantage plurielle que ce que ses zélotes et ses critiques contemporains veulent bien admettre. D'abord, l'adhésion à la nation s'est effectuée, dans les différents pays européens, à des moments historiques différents, sous-tendus par des traditions philosophiques différentes. De ce fait, se réclamer de tel ou tel nationalisme, revient à se réclamer de telle ou telle tradition philosophique. Se réclamer du nationalisme jacobin et révolutionnaire, c'est adhérer aux principes universalistes et équarisseurs. Se réclamer d'un nationalisme issu de la pensée universelle et différentialiste de Herder, c'est adhérer à une philosophie qui accepte le monde tel qu'il est : comme un kaléidoscope de différences culturelles qu'il serait aberrant de vouloir homogénéiser.
Or l'ère du nationalisme, que ce soit celui des sans-culottes ou celui de Herder, est révolue. La nation impliquait une limitation territoriale qui n'est plus de mise à l'heure où les moyens de communications permettent d'organiser dans l'harmonie des ensembles continentaux. Mais l'homme moyen étant un être limité, incapable de connaître tous les paramètres de l'univers ni même tous les paramètres d'une grande nation ou d'un continent, il doit nécessairement être imbriqué dans un “pays”, dans un horizon appréhendable par ses limites. Le recours au pays et à l'enracinement est donc une nécessité psychologique qui fait que la pensée de Herder, dans ses dimensions non encore politisées, n'est pas entièrement révolue.
Cette double nécessité, de penser en termes de continents (Jordis von Lohausen) et en termes de pays, implique tout naturellement de refuser les logiques unilatérales qui veulent à tout prix l'homogénéisation (dans un cadre national, continental ou mondial) au nom de ce fameux “progrès” qui apporterait, disent ses zélotes, la connaissance de tous les paramètres par on ne sait quel miracle. Le tour de force, que cette fin de siècle exige de ceux qui veulent penser le politique, c'est de forger et de manier une pensée à vitesses multiples, une pensée combinatoire qui joue sur la multitude des paramètres, qui sait que la loi du monde est celle de l'hétérogénéité hétérogénéisante.
En conséquence, il convient de ne plus mettre l'histoire entre parenthèses, de ne plus la refouler comme un passé mort, mais d'aller y déceler des valeurs, lesquelles sont toujours immortelles, et de les remettre en avant, pour dissiper les pesanteurs prétentieuses que les maniaques de l'homogénéisation imposent avec une régularité têtue aux peuples. La logique des nationalismes de culture, quand ils ont recouru en Finlande au Kalevala, en Allemagne aux Nibelungen, en Irlande, au Pays de Galles ou en Bretagne aux légendes de Cuchulain ou des Mabinogion, est une logique d'introspection collective, de mise en exergue dé valeurs impassables et une logique d'attention à ce qui est ici et non pas là-bas, à ce qui hétérogénéise et fait que le monde est beau de ses différences. (RS)

◘ Les équivoques du nationalisme
« D'abord, vous n'êtes pas des Germains, assez de ces blagues. Pas plus que nous ne sommes Gaulois ou Latins, ou que les Italiens sont Romains. Figures esquissées par la poésie, épaissies en forme de monstres politiques par des petits-bourgeois nostalgiques au fond des bibliothèques du XIXe siècle. Dieux tôt fatigués. Vous êtes un groupe d'hommes au milieu de l'Europe qui, péniblement, avez formé un État et une nation. État à peine achevé, nation imparfaite et qui le resteront car maintenant s'imposent d'autres soins que d'arrondir un État national à une époque où l'on est rien quand on n'est pas un continent ».
Pierre Drieu la Rochelle, L'Europe contre les patries
« La folie des nationalités est cause que les peuples d'Europe sont devenus étrangers les uns aux autres, et que cette ignorance morbide dure encore aujourd'hui ; elle a porté au pinacle les politiciens à courte vue et aux mains lentes, qui ne se doutent pas à quel point la politique de division qu'ils pratiquent ne peut être qu'une politique toute épisodique ».
Friedrich Nietzsche, Par-delà le bien et le mal
L'antagonisme libéralisme-marxisme, qui a dominé toute la seconde moitié de notre siècle, s'est achevé par la victoire du premier. À l'effondrement du mur de Berlin, au morcellement de l'empire soviétique, à la fossilisation de l'intelligentsia socialiste répondent l'extension indéfinie de la culture de masse, le monopole moral de l'idéologie des droits de l'homme, l'exclusivité institutionnelle du modèle démocratique-représentatif. Mais cette victoire opère également un renversement de perspective : un débat idéologique global s'instaure qui, dépassant l'analyse du libéralisme comme “moindre mal” (face aux systèmes totalitaires), en dénombre les défauts, en déconstruit les soubassements idéologiques et tente d'ériger son alternative.
Francis Fukuyama (1) dans un article célèbre paru voici plus d'un an et enterré depuis sous la Porte de Brandebourg, avait énuméré ces alternatives dressées face au libéralisme. Alternatives idéologiques, qui avaient été historiquement vaincues (fascisme puis marxisme), alternatives “sentimentales”, irrationnelles, qui perduraient sporadiquement : nation et religion. Comme pour appuyer cette thèse, on constate de fait l'explosion, à l'Est comme au Sud de la planisphère (i.e. dans les régions les plus récemment contaminées par l'ordre libéral) de cette « vengeance des nations » — dont parle l'industriel-essayiste Alain Minc (2) — qui sous forme laïque, qui sous forme religieuse (ou empruntant les 2 masques de la révolte, comme le fit le caricatural dissident Saddam Hussein). Le fait national revient donc au premier plan de l'actualité et de l'interrogation intellectuelle (3).
Beaucoup sont tentés, à la lueur de cette expérience récente, de substituer à l'antagonisme libéralisme-marxisme un nouveau débat, posé comme le “véritable” débat (parce que, contrairement au précédent, ses 2 termes ne dériveraient pas de la même matrice) : cosmopolitisme libéral versus nationalisme. La nation, que l'on croyait pourtant rangée au magasin des accessoires idéologiques depuis 1945, resurgit au centre des positionnements. Parce que les notions d'identité et de différence sont des valeurs cardinales de notre vision du monde, parce que des discussions idéologiques en cours surgira, comme à la fin du XVIIIe siècle, une nouvelle ère pour l'humanité, nous ne pouvons éviter, à notre tour, de prendre position. Et c'est une position de défiance à l'égard du nationalisme qui nous semble s'imposer.
Avant de commencer notre développement, signalons ce que nous entendons par nationalisme. Celui-ci ne désigne pas à titre essentiel le simple amour de la nation conçu comme synonyme de patriotisme pas plus que les exaltations passagères du principe national auquel certains événements historiques donnent lieu (guerre, occupation...). Le nationalisme désigne ici la doctrine politique à dimension de vision du monde dont la valeur normative centrale, exclusive, est la nation (comme a pu l'être l'individu pour le libéralisme ou la classe pour le socialisme) et qui affirme la nécessaire congruence de l'unité politique et de l'unité nationale. Une remise en question du nationalisme impose donc une interrogation de fond sur la nation elle-même.
Une histoire controversée
La genèse des nations est une question d'école. Si chacun reconnaît que l'Etat-nation s'est affirmé comme forme politique dominante avec les 3 révolutions bourgeoises de l'époque moderne (anglaise, américaine et surtout française), tout le monde ne s'accorde pas sur l'ancienneté du fait national et de la conscience nationale. Les historiographies du XIXe siècle, qui les puisaient sans sourciller dans l'esprit des tribus gauloises ou germaniques, prêtent aujourd'hui à sourire. À défaut de constituer des analyses fiables, elles constituent néanmoins les symptômes de la difficulté latente qui existe à donner son cadre anthropologique au fait national.
Elles démontrent également la fréquente mais fausse assimilation de la nationalité (appartenance ethnoculturelle, au sens des nationes de la Sorbonne, divisant les étudiants selon leur langue véhiculaire) et de la nation (où l'élément politique est appelé à dominer les autres puisque la nation naît d'une rupture étatique avec les continuités historiques et ethniques qu'incarnaient les multiples strates de la féodalité). Comme le rappelle Colette Beaune (4), « ce sont les historiens qui créèrent la nation » (5). La plupart des auteurs s'entendent néanmoins pour faire naître au Moyen Âge, et plus particulièrement en France, l'idée de nation.
La rupture des œkoumènes européens
Comme l'ont noté un Julius Evola ou un René Guénon (6), c'est avec Philippe IV le Bel que la “nation” (qui ne se dit pas encore telle) apparaît. Chacun connaît le conflit qui opposa le Capétien au Pape, Boniface VIII. Pour répondre aux bulles papales le condamnant, le roi, appuyé par ses légistes (surtout Nogaret), prit l'initiative de réunir, en 1302, une assemblée parisienne composée de clercs, de nobles et de bourgeois qui devait constituer la première réunion des États généraux. Cette initiative se répéta en 1308 et 1311, pour soutenir la lutte du Capétien contre l'ordre des Templiers.
Ce faisant, le Capétien introduisait un certain nombre de bouleversements. Il inventa en premier lieu une forme nouvelle de légitimité, non plus sacrale mais déjà “nationale” dans son principe. Il consacra en second lieu la rupture définitive de l'œkoumène européen, qu'incarnait jusqu'alors l'Empire et la papauté, et face auxquels la lignée capétienne n'avait cessé d'opposer une défiance atavique. Il crée enfin, ex nihilo, une conscience unitaire là où elle n'existait pas si ce n'est à l'état d'ébauche : l'idée pointe, dont la bourgeoisie parisienne était déjà l'avant-garde, d'une nation unitaire regroupant l'ensemble des peuples reconnaissant l'autorité unique et exclusive de l'État capétien. Comme le souligne Carl Schmitt (7), « mentalité juridico-légistique, centralisme, neutralité religieuse et théologique, rationalisme bourgeois : ces ingrédients s'allient ici pour la première fois ».
L'histoire du royaume de France s'analyse alors comme la recherche ardue de la congruence unité politique-unité nationale. Et de la répression de l'hérésie cathare puis de l'identité occitane au démembrement du grand Duché de Bourgogne, de l'asservissement matrimoniale de la Bretagne à l'invasion armée de la Franche-Comté, les peuples du royaume se souviendront longtemps du prix de cette unité. Comme le souligne Simone Weil (8), qui classe par ailleurs la nation parmi les formes de déracinement, « on loue les rois de France d'avoir assimilé les pays conquis, la vérité est qu'ils les ont surtout déracinés. C'est un procédé d'assimilation facile, à la portée de chacun ».
Serge Latouche note ainsi qu'au Moyen Âge « le politique n'est pas le principe d'identification sociale ; celle-ci repose sur des bases concrètes infiniment plus riches et plus complexes, comme les cultures populaires, et sur l'imaginaire unificateur de la religion. En réactivant la pensée politique et philosophique de l'Antiquité, les humanistes offraient aux bureaucraties royales et aux bourgeoises montantes qui les appuient, les instruments symboliques d'un ordre qui sera proprement l'ordre politique, et d'ailleurs le seul principe dans l'ordre social, celui de l'État-nation » (9). Carl Schmitt (10) a également souligné comment, face aux formes traditionnelles et charismatiques de légitimité, les légistes, et particulièrement la figure du légiste français, ont contribué à instaurer, dans le cadre de la nation étatique, un champ uniforme de normes contraignantes et englobantes.
Le caractère abstrait de cette identité nationale ainsi générée se manifestant à l'envi par la prolifération de ses agents fonctionnels, la bureaucratisation constituant le pendant politique de la technocratisation économique. Chacun connaît la continuité existant à cet égard entre l'Ancien Régime et la Révolution, continuité mise en évidence pour la première fois par Tocqueville : renforcement du gouvernement central, extension de l'administration (intendance, gouvernorats, bailliages, sénéchaussées, etc.) dans le royaume, patrimonialité des offices (le nombre des offices décuple entre 1515 et 1665, permettant l'infiltration de la classe bourgeoise dans toutes les charges publiques), etc.
Une identité exclusive
En réalité l'originalité essentielle de la nation tient à ce qu'elle surgit non seulement comme la forme dominante, à une époque donné, de la représentation sociale, mais surtout comme sa forme exclusive. Depuis l'Antiquité régnait, de façon consciente ou non, ce qu'Émile Benveniste a nommé les « quatre cercles de l'appartenance sociale » (11). De ces 4 cercles (globalement : famille, clan/voisinage, tribu/ethnie, pays/cité), aucun ne s'excluait et aucun n'interdisait la reconnaissance d'une unité supérieure de civilisation.
Avec la nation se rompt cet équilibre. Née comme nous l'avons vu sur les ruines des œkoumènes médiévaux, elle se parfait dans l'élimination tantôt “douce” (la centralisation capétienne, la généralisation du français comme langue vernaculaire imposée par décision étatique, la mise au pas des Parlements provinciaux, l'extension bureaucratique, etc.) ou tantôt “dure” (la centralisation jacobine, l'interdiction des patois et langues régionales, la départementalisation comme découpage rationnel et géométrique du territoire, la disparition des représentations locales, etc.) de l'hétérogénéité dont elle est constitutive.
Analysant cette forme inédite et monopolistique de la réprésentation collective, Marcel Mauss (12) note que les nations s'apparentent aux sociétés « non segmentaires », c'est-à-dire ayant aboli « toute segmentation par clans, cités, tribus, royaumes, domaines féodaux... ». Au contraire, les nations sont des sociétés « moralement et matériellement intégrées », dont l'idéaltype d'organisation sociale est l'absence d'intermédiaire entre le citoyen et le corps national lui-même. Situation à son sens anormale puisque « la toute puissance de l'individu sur la société et de la société sur l'individu... a quelque chose de déréglé et que la question se pose de la reconstitution des sous-groupes... ».
Une analyse très exactement partagée par Ernst Gellner, pour qui la différence essentielle entre le nationalisme proprement dit et l'attachement traditionnel à un groupe donné tient « à la nature de masse du groupe auquel il faut être attaché... le fait que l'adhésion est directe, sans l'intermédiaire ni la reconnaissance d'un sous-groupe » (13). Pour lui, les racines du nationalisme plongent étroitement dans les exigences de la société industrielles : formation générique des individus, grande mobilité sociale, normalisation du véhicule linguistique, substitutabilité du personnel, en bref, une exosocialisation généralisée de l'individu, la nation devenant le reflet historicisé et subjectif d'un besoin objectif d'homogénéité exprimé par le marché.
La nation et l'idéologie économique
Il est des coïncidences qui ne trompent guère : dans le même temps que la nation s'affirme comme la catégorie politique et territoriale dominante, l'idéologie économique (14) s'instaure comme modèle exclusif de représentation du monde.
Du XVIe au XVIIIe siècle s'est tenu une lutte essentielle, bien mise en évidence par Fernand Braudel (15), entre les états nationaux d'une part, centres de la puissance politique, et les zones urbaines d'autre part, centre de la richesse économique, soit un axe Ouest-Est (Angleterre, France, Hongrie, Pologne) contre un axe Nord-Sud (Hanse, Pays-Bas, Italie du Nord). Ce mouvement s'achèvera au XVIIIe siècle par la victoire des premiers, par la corrélation entre la puissance économique et la puissance politique (dans l'ordre interne, fusion de l'État national et du marché national), dont l'Angleterre fut le symbole.
Dès le XVIe siècle apparaissent les premières théories du pré-mercantilisme, qui peut se définir de façon globale comme le transfert de la direction de l'activité économique des villes et provinces à l'État, devenu le moteur principal de la relocalisation des zones d'entreprises et des déplacements d'hommes et de capitaux à l'intérieur de l'espace national (16). Pour les mercantilistes (Montchrétien, Cantillon, Mun, Child, Temple, Petty, Boisguillebert...), l'État se doit de dépasser le particularisme défendu par les villes et les provinces. Il s'agit d'insinuer entre le marché Iocal/intermunicipal (forme non concurrentielle et autocentrée de marché) et le commerce su long cours (réservé à l'ordre des marchands, transnational et, dans une certaine mesure, non concurrentiel également), un marché intérieur, national, mixte de concurrence et de régulation (17).
Première conséquence : le jeu du marché économique détermine une exosocialisation des individus, qui trouvera son apogée au XIXe siècle, c'est-à-dire au cœur de la révolution industrielle, et dont Ernst Gellner (18) a montré l'importance dans le genèse de l'idéologie nationaliste. Dans un monde où le rapport aux choses supplante le rapport aux autres, où la valeur d'usage se réduit à la valeur d'échange, où l'adaptation forcée de la génétique sociale aux besoins structurels du marché arrache l'individu à sa communauté d'appartenance, le nationalisme apparaît comme une scotomisation de l'ordre utilitaire, une identité substitutive, où l'idéel remplace le charnel, dont on célèbre le culte et l'efficace à mesure que l'ordre marchand installe sa loi. La logique marchande ainsi sublimée par l'exaltation nationale s'imposera dans le marché intérieur dans un premier temps, puis, par le biais du colonialisme (où la double logique marchande/nationaliste joue à plein, cf. les célèbres harangues de Jules Ferry sur le droit des nations supérieures à éduquer les êtres inférieurs) à l'échelle planétaire.
Seconde conséquence, parfaitement saisie par François Fourquet (19) : la puissance politique ne se détermine plus qu'en fonction de la puissance économique. Ce qui donne lieu, dans un premier temps, à l'exaltation de la nation contre l'État dispendieux. Boisguillebert reproche au Prince de se comporter avec son peuple « comme avec un pays ennemi », car la fiscalité du pouvoir absolu étouffe la richesse nationale (20). Pour Quesnay, « la nation est réduite à trois classes de citoyens : la classe productive, la classe des propriétaires et la classe stérile ». Déjà se dessinent la réduction de la nation au Tiers-État (Siéyès, Mirabeau) et les nouvelles hiérarchies stato-nationales fixées par l'ordre bourgeois.
Comme le voit F. Fourquet, une double équation politique (nature = raison = nation) et économique (nation productive = capital = richesse nationale), est posée : « Dans le langage de la science économique en gestation, c'est sous le nom de capital que la nation se distingue du Roi qui, à force d'être sourd à ses conseillers et aveugle à son peuple, finit par s'aliéner la nation, par créer politiquement une nation qui s'est séparée de lui. À l'époque où, en philosophie politique, la nation se distingue du roi, la nation productive se distingue de l'État économique : c'est une vraie richesse sociale, une richesse capitale ou capital tout court. Cette autonomisation du capital (dans le discours économique) concorde avec la légende bourgeoise du discours historique ... » (21).
C'est enfin avec Adam Smith que cette mise en rapport entre souveraineté politique et nation économique s'inverse totalement. La nation pénètre entièrement dans l'orbe du discours économique. Comme l'a parfaitement analysé Gérard Mairet (22), « la nation, catégorie politique, trouve chez Smith un contenu, une efficacité économique. Pour Smith, la nation n'est rien moins qu'un espace d'échange. Mieux qu'au centre de ses Recherches, l'idée de nation en forme l'horizon, le but : quant au concept de division du travail, si fondamental en effet, il est le schéma conceptuel qui permet de cerner cet horizon et d'atteindre ce but : circonscrire l'espace national comme espace naturel du libre-échange autorégulé par la division du travail. Se donnant la nation comme horizon théorique d'investigation, Smith se donne en même temps les moyens conceptuels de la cerner : la corrélation échange/division du travail ».
L'opposition entre la nation productive et l'État improductif culmine dans la négation des prérogatives du second. Le marché intérieur, création des politiques mercantilistes, doit persister, non plus comme un moyen de la puissance politique, mais comme espace économique idéal, pacifié et homogénéisé, où peut s'exercer pleinement la logique marchande (par opposition à l'économie mondiale, encore perçue comme un champ de force où règne un état de nature préjudiciable au commerce).
Nationalisme et individualisme
En réalité, comme l'a rappelé Louis Dumont (23) « une nation ne naît pas d'un simple tissu de solidarités sans relation aux valeurs. Un système de valeurs [holiste] exclut la nation, un autre [individualiste] n'admet pas d'autres groupes politiques ». L'émergence du national-étatisme comme forme exclusive de représentation identitaire/institutionnelle, sa consolidation intérieure puis son extension planétaire sous la forme d'une “société des nations”, sont intimement liés à la modernité occidentale. On ne peut faire l'économie d'une analyse des rapports unissant ces 2 tendances lourdes de notre histoire. Au cœur de l'idéologie nationale comme au cœur de toute l'idéologie moderne se retrouve donc l'individu.
On connaît la définition de Siéyès, pour qui la nation se forme « par un nombre plus ou moins considérable d'individus qui veulent se réunir. Par ce seul fait, ils forment déjà une nation ». La volonté nationale « est le résultat des volontés individuelles comme la nation est l'assemblage des individus » (in Qu'est-ce que le Tiers État ?). Emmerich de Vattel (Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliquée aux affaires des nations et des souverains) rappelle que « les nations étant composées d'hommes entièrement libres et indépendants et qui, avant l'établissement de sociétés civiles, vivaient ensemble dans l'état de nature, les nations, ou les états souverains, doivent être considérés comme autant de personnes libres ou vivant entre elles dans l'état de nature ». On multiplierait aisément ces déclarations de foi unissant dans le même discours le plus extrême individualisme et l'affirmation nationale.
L. Dumont a remarquablement conceptualisé la logique individualiste qui est à l'œuvre dans le monopole nationale de la représentation collective : « la nation... est le groupe sociopolitique moderne correspondant à l'idéologie de l'individu. À ce titre, elle est 2 choses en une : d'une part, une collection d'individus, de l'autre, l'individu au plan collectif, face à d'autres individus-nations » (24). Ces 2 visions correspondent aux conceptions françaises et allemandes de la nation.
La première est née au sein des théories universalistes/égalitaires orientées contre l'État dynastique. Elle est le fruit d'un transfert idéologique opéré au XVIIIe siècle, au terme duquel, comme l'ont noté Luc Ferry et Alain Renaut (25), « la nation n'est plus pensée comme une hiérarchie d'ordres différents par nature, mais bien comme une entité abstraite comprenant en elle une multitude d'individus égaux ». La citoyenneté, confondue avec la nationalité, est l'aboutissement d'un acte rationnel, d'une adhésion volontaire, contractualisée, à des principes généraux incarnés dans un moment historique par l'État français (liberté, égalité, droit de l'homme...). (26). La nation française est alors l'institution intermédiaire entre l'individu et l'humanité, permettant au premier d'entrer en résonance avec la seconde. La citoyenneté française est une citoyenneté précosmopolitique (le cosmopolitisme désignant d'ailleurs le rayonnement de la culture française en Europe au XVIIIe siècle).
La réaction allemande, menée par Herder, puis Fichte, peut paraître antithétique. Elle naît dans la pratique contre l'occupation napoléonienne, dans la théorie contre les excès de l'Aufklärung. La valeur centrale en est la nation comme être collectif face à l'individualisme dissolvant des Lumières. Célébrant la diversité des cultures et leur irréductibilité, Herder, grand relecteur de Leibniz, dessine une sorte de « monadologie holiste », où chaque nation-monade est l'ingrédient de “l'harmonie préétablie” du monde. Cette exaltation des invariants culturels transhistoriques amène à l'exaltation particulière de la nation allemande (pangermanisme), chargée par Dieu de montrer la voie nouvelle au monde.
Derrière leurs apparentes opposition, on retrouve plusieurs points communs à ces 2 conceptions. Comme l'a bien vu Louis Dumont, « les Allemands se posaient, et essayaient de s'imposer, comme supérieurs en tant qu'Allemands, tandis que les Français postulaient consciemment la supériorité de la culture universaliste mais s'identifiaient naïvement à elle au point de se prendre pour les instituteurs du genre humain » (27).
Le nationalisme s'inscrit ainsi dans le passage général de l'hétéronomie à l'autonomie qui caractérise l'époque moderne. A contrario des sociétés traditionnelles dont le système de valeurs découle entièrement d'un principe supérieur et transcendant, déterminant et légitimant une hiérarchie horizontale, le nationalisme participe d'une sacralisation du corps social devenu sa propre finitude, ne se renvoyant plus qu'à lui-même.
D'autre part, un même esprit messianique prévaut dans la genèse des nationalismes du XVIIIe et du XIXe siècles : les acteurs de la Révolution française, Gioberti et Mazzini en Italie, Fichte, Schelling ou Hegel en Allemagne, tous sont persuadés d'une tâche historique de développement de l'humanité, d'une mission universelle dont l'accomplissement revient en propre à leur nations respectives.
Ce transfert messianique, véritable généralisation à l'échelle européenne, puis planétaire, de l'idée de “peuple élu”, induit un nouveau rapport à l'autre, caractéristique du nationalisme. La sanctuarisation des territoires, la sacralisations des frontières, l'absolutisation des différences parviennent à créer l'altérité radicale. Celle-ci est pensée tantôt sous le mode de la domination/extermination : lutte contre l'ennemi intérieur, l'étranger, qui fut l'aristocrate à la fin du XVIIIe siècle, le juif à la fin du XIXe et le beur à la fin du XXe... (on a l'ennemi que l'on peut). Tantôt sous le mode de la conversion : c'est toute l'œuvre du colonialisme, que l'on retrouve, à rebours, dans le discours contemporain sur l'intégration nationale - en fait déculturation de l'autre (28).
Un bilan
Que dire, au terme de notre analyse, de l'avenir du nationalisme ? Forme maximaliste, prométhéenne de la Modernité — ce qui n'est pas sans jouer dans la séduction qu'elle a pu exercer sur les masses — l'idéologie nationaliste a été condamnée par l'histoire. Aux Européens qui font enfantée, elle n'a apporté que 2 siècles de luttes fratricides, de querelles intestines, dont l'aboutissement fut la division de notre continent, son occupation par les Blocs, l'éloignement de ses peuples à qui l'on a enseigné l'oubli d'une appartenance commune plurimillénaire.
Quant au tiers-monde qui l'a reçue dans l'héritage indivis du colonialisme, le bilan est à peu près aussi noir. La libanisation moyen-orientale (29) ou les incessants conflits interethniques du continent africain viennent nous rappeler, à nos portes, le fruit amer des unions forcées entre les théories occidentales et les enracinements concrets. Contredit à l'intérieur par l'émergence des nouveaux mouvements sociaux, par la prolifération des tribus, par la résurgence des identités régionales, par l'indifférence généralisée aux discours surplombants, la réalité nationale s'efface. Comme l'a bien vu Michel Maffesoli (30), aux “identités” épuisées succèdent la profusion orgiastique, empathiques des “identifications” proxémiques. Formes encore désordonnées d'agrégations organiques qui témoignent d'une vivacité et d'une hétérogénéité retrouvée du corps social.
Le nationalisme est enfin contredit à l'extérieur par la continentalité des enjeux mondiaux, par la construction européenne, aujourd'hui économique, mais dont chacun sait qu'elle deviendra un jour politique, culturelle et militaire, appelant ce jour-là d'autres principes fédérateurs que ce qui fut, 2 siècles durant, son plus grand diviseur commun : l'exaltation nationale.
► Charles Champetier, Vouloir n°73-75, 1991.
♦ Notes :
- (1) Commentaires n°47, 1989.
- (2) La vengeance des nations, Grasset, 1990. Un essai qui ne brille pas par l'originalité de ses analyses ni l'ampleur de ses perspectives, l’auteur se contentant d'opposer, sur un fond journalistique d'énumération des conflagrations à venir, le nationalisme identitaire porteur d'exclusion à l'État-nation rationalisé facteur d'intégration et d'ouverture. Sans donner le mode d'emploi du lifting idéologique censé permettre à l'État-nation, singulièrement décati après son bicentenaire, de redevenir une idée neuve, séduisante et adaptée aux défis de notre époque.
- (3) En témoignent, en plus du livre évoqué ci-dessus, des numéros spéciaux de La Règle du jeu, du Débat, de Krisis, le livre d'Hélène Carrère d'Encausse sur le Retour des nations, etc.
- (4) « La notion de nation en France au Moyen-Âge », Communications n°45, 1987, p. 102. Du même auteur, Naissance de la nation France, Gal., 1985, est un bon exemple de la confusion nation/nationalité.
- (5) Conséquence d'une telle dépendance de la cohésion nationale envers un passé idéalisé et historiquement reconstruit, cette déclaration d'Ernest Renan dans sa conférence Qu'est-ce-que la nation ?, souvent citée mais peu lue : « l'oubli, et je dirai même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la formation d'une nation, et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour les nationalistes un danger ». C'est à une véritable neutralisation du passé et de la mémoire qu'appelle Renan, pour fonder son nationalisme sur des assises quasi-religieuses, de l'ordre de la révélation.
- (6) cf. Révolte contre le monde moderne, J. Évola, éd. de l'Homme, Montréal, surtout pp. 419-431 et Autorité spirituelle et pouvoir temporel, R. Guénon, éd. Traditionnelles, 1984, surtout pp. 84-92.
- (7) Du politique, légalité et légitimité et autres essais, Pardès, 1990, p.189.
- (8) L'enracinement, Folio, 1990, p. 141.
- (9) L'occidentalisation du monde, La Découverte, 1989, p.96.
- (10) C. Schmitt, op. cit.
- (11) Vocabulaire des institutions indo-européennes, Minuit, 1987, p. 293-321.
- (12) Marcel Mauss, « La nation », Année sociologique, 1953-1954, p. 7-68.
- (13) Nation et nationalisme, Payot, 1989.
- (14) Au sens que Louis Dumont a donné à « l'idéologie économique » dans Homo Æqualis (Gal., 1985).
- (15) Voir Civilisation matérielle, économie et capitalisme, A. Colin, 3 t., dernière éd. 1988.
- (16) Voir à ce sujet L'espace dans la pensée économique du XVIe au XVllle siècle, de Pierre Dockès (Flam., 1969, 461 p.).
- (17) Voir les analyses de Karl Polanyi sur l'évolution des modèles de marché vers le marché autorégulateur caractéristique de l'ère moderne, développée dans La grande transformation, Gal., 1988, (not. pp. 87-102).
- (18) Nation et nationalisme, op. cit.
- (19) Richesse et puissance, La Découverte, 1989, 316 p. Un livre qui ouvre de nombreuses pistes, d'autant plus intéressant que l'auteur, économiste de formation, utilise le paradigme de la trifonctionnalité indo-européenne pour analyser le rapport moderne de l'économie et du politique. Voir également « Économie et souveraineté, G. Dumézil et le prix des services non-marchands » in Revue du MAUSS n° 10, 1990.
- (20) Fiscalité dont la mise en place, comme l'a vu F. Braudel, a fini par faire entrer le paysannat dans la logique nationale/capitaliste : « La construction politique d'un vaste État, surtout s'il s'édifie par la guerre, comme c'est généralement le cas, suppose un budget important, un appel croissant à l'impôt lequel exige une administration, laquelle exige à son tour plus d'argent et plus d'impôts... Mais dans une population à 90 % rurale, le succès de la fiscalité suppose que l'État atteigne efficacement la paysannerie, que celle-ci sorte de l'autosuffisance, accepte de produire un surplus, de vendre sur le marché, de nourrir les villes. (op. cit., t. 3, p. 252).
- (21) F. Fourquet, op. cit., p. 184.
- (22) Introduction des Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Gal./Folio, 1973.
- (23) Homo hierarchicus, Gal./Tel, p. 386.
- (24) Essai sur l'individualisme, Seuil, 1983, p. 123.
- (25) Philosophie politique, t. 3, PUF, 1985, p. 92.
- (26) Ce qui permettra, par ex., à Bentham ou Fichte de se déclarer citoyens ou patriotes français, parce qu'ils se trouvaient en accord avec les idées générales de la Révolution.
- (27) op. cit., p. 130.
- (28) Parmi d'autres champions de cette intégration (dont A. Minc cité plus haut), on pourra lire Julia Kristeva, Lettre ouverte à Harlem Désir, Rivages, 1989, qui offre un bon exemple de la relecture, très à la mode aujourd'hui, de l'esprit national (ici renvoyé à « l'esprit général » de Montesquieu) comme système contractuel/rationnel à assimiler l'autre.
- (29) Libanisation qu'un auteur aussi fécond que Georges Corm a mis en parallèle avec la balkanisation européenne du XIXe siècle, la dénonçant à juste titre comme la conséquence directe du démembrement de l'Empire ottoman et de l'imposition du cadre stato-national. Lire à ce sujet L'Europe et l'Orient, La Découverte, 1988.
- (30) Au creux des apparences, Plon, 1990.

◘ Idée d'Empire et universalisme
 Quiconque s'interroge sérieusement sur le nouvel ordre européen perçoit de plus en plus nettement l'importance et la force révolutionnaire des idées de « grand-espace » (Grossraum) et d'« espace vital » (Lebensraum). Cependant, au lieu de « grand-espace », nous préférons ici parler d'« espace impérial », d'espace reichisch, c'est-à-dire déterminé par l'idée de Reich, ou encore d'« espace de Reich ». Il s'agit en effet de dissiper l'idée selon laquelle l'ordre nouveau serait essentiellement dicté par des facteurs matériels plutôt que par une idée ou par un droit supérieur qui fonde l'autorité. Bien entendu, l'« espace déterminé par l'idée de Reich » englobe aussi ce que nous appelons « l'espace vital » ; mais il peut en dépasser les limites, soit en fonction de considérations militaro-stratégiques, soit en raison d'influences indirectes, de relations affinitaires ou de ces affinités électives qui poussent les petits peuples à se grouper autour d'un « peuple impérial ».
Quiconque s'interroge sérieusement sur le nouvel ordre européen perçoit de plus en plus nettement l'importance et la force révolutionnaire des idées de « grand-espace » (Grossraum) et d'« espace vital » (Lebensraum). Cependant, au lieu de « grand-espace », nous préférons ici parler d'« espace impérial », d'espace reichisch, c'est-à-dire déterminé par l'idée de Reich, ou encore d'« espace de Reich ». Il s'agit en effet de dissiper l'idée selon laquelle l'ordre nouveau serait essentiellement dicté par des facteurs matériels plutôt que par une idée ou par un droit supérieur qui fonde l'autorité. Bien entendu, l'« espace déterminé par l'idée de Reich » englobe aussi ce que nous appelons « l'espace vital » ; mais il peut en dépasser les limites, soit en fonction de considérations militaro-stratégiques, soit en raison d'influences indirectes, de relations affinitaires ou de ces affinités électives qui poussent les petits peuples à se grouper autour d'un « peuple impérial ».
Nous ne sonderons pas ici la notion générique de « grand-espace » ou d'espace « déterminé par l'idée de Reich » (reichisch). Nous nous pencherons plutôt sur un de ses aspects particuliers, qui dépasse à la fois le mythe nationaliste et le mythe universaliste.
En ce qui concerne le mythe nationaliste, il connaîtra dans l'avenir une double limitation : d'abord, aucun peuple ne peut assumer et exercer une fonction supérieure de direction s'il ne s'élève pas au dessus des intérêts et des allégeances de type particulariste. Ensuite, les petits peuples devront réapprendre qu'il existe une subordination qui, loin d'être un "esclavage", peut au contraire être source de fierté puisqu'elle permet l'intégration à une communauté culturelle plus vaste et la participation à une autorité plus haute et plus forte. On peut ici songer à des exemples historiques comme le Saint-Empire romain dont les souverains incarnaient une autorité et une fonction dissociées et distinctes de celles qu'ils détenaient en tant que princes d'un peuple particulier. Il pouvait même arriver que des peuples sollicitent d'eux-mêmes l'honneur d'être rattachés à une communauté qui était plus que nationale puisqu'elle se définissait par l'emblème impérial.
En ce qui concerne maintenant le second aspect, par lequel l'espace déterminé par l'idée de Reich apparaît comme le dépassement non seulement du nationalisme étriqué mais du mythe universaliste, il faut préciser que cet espace n'est pas un "espace impérial": il faudrait plutôt penser à des entités distinctes, caractérisées par des idées et des traditions spécifiques, mais agissant conjointement et solidairement. Seule, à l'évidence, cette idée peut dépasser l'universalisme, que ce soit sous sa forme utopique (« le royaume mondial ») ou sous sa forme juridico-positiviste qui postule des principes rationnels, universellement valables et obligatoires.
Quant à l'« espace déterminé par l'idée de Reich », il ne faut pas y voir un assemblage plus ou moins lâche, mais un véritable organisme défini par des frontières précises et axé sur une idée centrale imprégnant toutes les forces qu'il rassemble.
Si l'espace déterminé par l'idée de Reich ne constitue pas un tout cohérent puisqu'il se présente sous la forme d'un ordre dynamique, il obéit cependant toujours à une certaine loi d'évolution et s'articule autour de valeurs fondamentales qui constituent son principium individuationis :
Par son caractère organique, vivant, et par les conditions géopolitiques nécessaires qui sont les siennes, l'idée d'espace déterminé par l'idée de Reich s'oppose notamment à ce que nous appelerions « l'impérialisme qui se cherche » (vortastender Imperialismus) et dont le prototype est l'Angleterre. Pour des raison identiques, il s'oppose également à toute conception abstraite, "spiritualiste", du Reich, qui bien souvent n'est qu'un paravent de l'universalisme. or, en Italie, la compréhension de ce dernier point a été obscurcie par nombre d'idées fausses et de lieux communs désuets.
L'exemple de l'idée romaine
Le grand-espace dont l'Italie peut éventuellement se réclamer est essentiellement méditerranéen. À ce titre, sa référence "impériale" et supranationale ne peut être que l'idée romaine. Or, certains milieux développent à propos de Rome une rhétorique telle que l'on éprouve une sensation de lassitude chaque fois qu'il est question de Rome et de la romanité. Et pourtant, l'Italie n'a pas d'autre choix. Mussolini l'a dit : « Rome est notre point de départ et notre référence : c'est notre symbole et notre mythe ».
La difficulté que nous venons de signaler provient de ce que, pour beaucoup, romanité et universalisme sont synonymes. L'« universalisme romain » est un slogan qui, visiblement, sert les ambitions douteuses de certains milieux. D'autres s'eforcent bien de faire une distinction entre le principe universel de Rome et l'universalisme de type démocrate, franc-maçon ou humanitariste, ou encore celui de l'Internationale communiste. Mais cela ne dissipe pas le malentendu.
Est universaliste tout principe qui prétend à la validité générale. Le rationalisme franc-maçon, la démocratie, l'internationalisme et le communisme sont, de fait, des idées qui se répandent dans le monde entier et qui pourraient donc effectivement devenir "universelles", à condition de déraciner d'emblée et de niveler méthodiquement tous les peuples et toutes les cultures. On retrouve à peu près un projet identique dans les très controversés Protocoles des Sages de Sion.
Le symbole de Rome — s'il ne s'épuise pas dans une rhétorique creuse — implique tout au contraire quelque chose de concret et de défini : nul ne songe sérieusement à unifier tous les continents et tous les peuples sous l'égide de Rome. Telle est pourtant l'intention des utopies antitraditionnelles, niveleuses et collectivistes. Rome, pour nous, peut effectivement signifier quelque chose et si ce "quelque chose" n'est pas "l'universalisme", ce sera l'idée fondamentale, la force qui met-en-forme, la loi inhérente à un certain « espace déterminé par l'idée de Reich »
D'ailleurs, il n'en allait pas autrement dans l'Antiquité, Rome était l'axe sacré d'une communauté soudée de peuples et de cultures, mais en dehors de laquelle il existait d'autres cultures, ce que traduit du reste l'expresion de "barbare" qui, à l'origine, n'avait aucune connotation péjorative et servait simplement à désigner l'étranger.
Dans l'Empire romain finissant, il a pu, certes, exister – dans les limites de cet espace où soufflait l'esprit d'empire – un certain "universalisme" : on laissa s'introduire à Rome des éléments hétérogènes et des races inférieures dont on fit abusivement des "Romains". La ville du Tibre intégra sans difficulté des cultes et des mœurs allogènes dont le contraste avec la romanité des origines était parfois stupéfiante, comme le notait Tite-Live. C'est dans cet universalisme-là que réside l'une des pricnipales raisons de l'effondrement de Rome. Voir dans un tel universalisme une caractéristique propre au « principe romain » serait le plus grave des contresens. Le principe romain vrai, c'est-à-dire viril et hiérarchisé, celui qui a fondé notre grandeur, n'a absolument rien à voir avec cet universalisme de la Rome tardive et abâtardie.
Nous vivons une époque de rassemblement, d'organisation et de structuration de forces, où le discours universaliste abstrait n'a pas sa place. Une époque où la dimension spirituelle ne doit pas nous conduire à des déviations ni à des transgressions mais sublimer le sens des forces et des contraintes d'une réalité concrète. Que Rome ait fait don au nom de la « lumière de la culture », que l'esprit romain soit illimité, que tous les peuples doivent à Rome des éléments de culture, voilà qui est bien. Il reste cependant à tester la vitalité actuelle de cet héritage millénaire au regard d'entreprises moins poétiques mais plus précises. Pour celui qui ne se satisfait pas du verbiage, la moindre des choses à exiger de la force de l'idée romaine est qu'elle puisse faire naître, à partir des peuples que rassemblera notre grand-espace, un organisme véritablement déterminé par l'idée d'Empire, un reichischer Organismus doté d'une structure solide, d'un visage et d'une culture propre, ce que permettrait, par ex., un recours à l'idée organique et hiérarchique du Moyen-Âge aryen et combattant. Ce n'est que lorsque que cet exemple aura pris consistance que le prestige de l'idée romaine franchira de nouveau les limites de notre espace. Alors, d'autres pays se demanderont si ces idées fondamentales peuvent être adoptées et façonner le réel selon des formes propres au type d'humanité auquel ils appartiennent.
► Julius Evola, Vouloir n°73-75, 1991. (tr. fr. : JLP)
***
♦ Pièce-complémentaire : Julius Evola et la critique du nationalisme
 Présentation
Présentation
La critique évolienne de la nation et du nationalisme me semble présenter au moins 3 intérêts.
• 1/ Cela permet tout d’abord de découvrir ou de redécouvrir la richesse et l’originalité des analyses de Julius Evola, qu’une gauche bien pensante a relégué, quand elle a pris la peine d’ouvrir ses livres, au rang d’intellectuel de seconde catégorie, aidé en cela il est vrai par une certaine droite qui l’a à peine mieux lu et n’a souvent voulu y voir qu’une confirmation de ses propres fantasmes idéologiques.
• 2/ Cela permet ensuite de prendre conscience du fossé idéologique séparant le nationalisme de la philosophie traditionnelle – philosophia perennis – et, dans une certaine mesure, de la pensée contre-révolutionnaire. Ces systèmes de pensées divergents, souvent antithétiques, ont longtemps souffert d’un étiquetage sommaire comme notre époque aime, hélas !, à en produire, qui les avait rangé dans le même camp “réactionnaire” ou “conservateur”, quand on ne se contentait pas du qualificatif infamant d’“extrême droite”.
• 3/ Cela permet enfin d’apporter une lumière nouvelle au grand débat intellectuel qui s’ouvre aujourd’hui sur l’idée nationale, ouverture dont témoigne des numéraux spéciaux du Débat, de La Règle du jeu, de Krisis, le feu brûlant de l’actualité est-européenne et arabe et même un livre de l’industriel-essayiste Alain Minc, signe ultime s’il en était besoin que la nation, hier enfermée dans le magasin des accessoires idéologiques dépassés, revient à la mode…
Analyse évolienne de la nation et du nationalisme
La critique du nationalisme n’a pas fait l’objet d’un ouvrage spécial de Julius Evola. On la retrouve disséminée dans son œuvre, depuis ses premiers articles dans la revue Vita italiana jusqu’à ses derniers essais. Si la montée du fascisme, puis du national-socialisme, a pu jouer un rôle dans cette mise en question, il serait faux de penser que ce rôle fut central. Loin de se contenter d’une critique des événements dont il fut le contemporain et parfois l’acteur, le philosophe italien dresse une véritable généalogie du nationalisme. La nation y est élevée au rang d’un idéaltype d’identité collective, de forme politique dominant et même caractérisant la modernité. C’est d’ailleurs dans la seconde partie de sa Révolte contre le monde moderne, intitulée « Genèse et visage du monde moderne », qu’il place son étude du fait national.
Evola se porte d’emblée en faux contre l’idée, fort répandue par l’historiographie du XXe siècle, selon laquelle la nation est un phénomène “naturel”, une issue logique de notre histoire inscrite dans les grandes migrations de l’Antiquité tardive, les sédentarisations du haut Moyen Âge et l’apparition des dynasties royales ou impériales. Pour Evola, dès 1931, « on ne peut comprendre un phénomène tel que le nationalisme sans le situer dans le cadre d’une vision globale de l’histoire qui repose sur de solides assises, en fait de critères de valeurs. Or, pour une vision de cet ordre, ce qui se relève comme un fait patent, c’est la chute progressive du pouvoir politique de l’un à l’autre des plans qui, dans les anciennes civilisations, attestaient la différenciation qualitative des possibilités humaines » [DVN 43].
La nation apparaît donc dans le cadre d’une chute qualitative de civilisation, chute que la pensée traditionnelle — et singulièrement Evola — analyse dans des termes proches de la trifonctionnalité indo-européenne qui nous est familière : à la domination première des souverains sacrés (basileus autocraton) succède celle des rois la laïcs, issus de l’aristocratie guerrière, lesquels sont à leur tour supplantés par les représentants de la troisième fonction, de la masse, dont les figures modernes sont le bourgeois et le prolétaire.
Plaquant cette grille d’analyse sur l’histoire européenne, Evola note en premier lieu la concomitance, dès l’époque médiévale, du déclin de l’Empire et de l’émergence de la nation.
Le lent déclin de l’Empire commence par la désacralisation de son principe, c’est-à-dire par la sécularisation et la matérialisation de l’idée politique. La sacralité est, en effet, pour Evola, la condition constitutive de l’idée d’Empire, dont elle fonde la légitimité et l’autorité. La disparition du caractère religieux du pouvoir, incarné par le sacre de l’empereur, s’est affirmée par étapes historiques, qui vont de la décision de Louis IV de Bavière, en 1338, selon laquelle l’élection de l’empereur est le seul principe légitimant son pouvoir (en dehors, donc, de la consécration) jusqu’au dernier sacre d’un empereur à Rome, celui de Frédéric III d’Autriche, en 1452.
Or, la disparition de cette dignitas sacrée rend de plus en plus difficile le maintien des structures décentralisées et multiples qui caractérisent la féodalité. Alors que l’impérialité œcuménique dominait, sans jamais les uniformiser, de multiples seigneuries et nationalités, sa disparition implique la transformation de l’ancienne fides supra-politique et spirituelle en une unité politique désormais violente et étatique, non plus organique mais mécanique, non plus sacrée mais profane. C’est ainsi, rappelle Evola, « que les rois commencent à revendiquer pour leurs unités particulières le principe d’autorité absolue propre à l’Empire en le matérialisant et en proclamant finalement l’idée nouvelle et subversive d'État national » [RCM].
Désormais prévaudra la défense des intérêts particuliers contre l’aspiration universelle de l’ancien œcoumène européen. Un François Ier ou un Clément VII en viendront à soutenir le Turc contre l’empereur. Un Richelieu, prélat catholique, appuiera lui aussi les ligues protestantes contre l’empereur, à la fin de la guerre de Trente ans. Comme l’écrit Evola : « l’Empire est définitivement supplanté par les impérialismes, c’est-à-dire par les menées des États nationaux désireux de s’affirmer militairement et économiquement sur les autres nations » [RCM].
Au cœur de cette politique de menée nationale, la Maison de France joue un rôle prépondérant et, pour tout dire, initiateur. À la suite de René Guénon, qui l’évoque dans Autorité spirituelle et pouvoir temporel [cf. not. pp. 81-87, Trédaniel], Evola voit en Philippe le Bel le fondateur véritable de l’idée moderne de nation. Son règne fut marqué, en plus d’une impopulaire réforme fiscale, qui le fit qualifier par Dante de « cupide », et de la liquidation des Templiers, par le conflit avec le pape Boniface VIII. Ce dernier ayant condamné Philippe le Bel par la bulle Ausculta filii carissime, celui-ci, sous l’influence de ses légistes, prit la décision, pour appuyer sa réplique au pape, de réunir une assemblée parisienne de notables, de bourgeois et de clercs, qui devaient constituer la première réunion des États généraux. Il en fera de même en 1308 et en 1311, pour soutenir sa lutte contre l’ordre des Templiers. Ce geste est à plus d’un égard symptomatique.
Comme l’a analysé C. Schmitt, « mentalité juridico-légistique, centralisme, neutralité religieuse et théologique, rationalisme bourgeois : ces ingrédients s’allient ici pour la première fois » [Du politique, Pardès, 1990, p. 189]. Ce faisant, Philippe le Bel crée, quasiment ex nihilo, une conscience unitaire négative (là où elle n’existait qu’à l’état de vague ébauche). Fondant sa démarche sur le droit laïc fixé par ses légistes, il contribue au remplacement des formes charismatiques et traditionnelles de légitimité par les normes englobantes et contraignantes du législateur. La pyramide féodo-vassalique, qui constituait le corps de la hiérarchie médiévale, unifiée par la fidélité au seigneur, commence à être remplacée par les représentants des institutions centrales dépêchés dans les provinces. Le souverain associe pour la première fois la bourgeoisie à l’exercice du pouvoir, et cette association du roi et de la bourgeoisie, dirigée contre l’ordre féodal, ne cessera dès lors de se renforcer, jusqu’au jour où la bourgeoisie sera assez puissante pour renverser, en se réclamant précisément de la nation, une monarchie déclinante.
Bâtie sur les ruines de la féodalité, l’idée nationale se développe de la Renaissance au XVIIIe siècle dans le cadre d’un État centralisateur dont nous avons décrit plus haut la politique extérieure de division de l'œcoumène européen, et dont chacun connaît la politique intérieure d’encadrement et d’étouffement de la diversité du royaume. Le pouvoir se pare d’un ersatz d’aura religieuse : l’absolutisme, dont Evola rappelle à juste titre qu’il représente la « transposition à l’âge matérialiste de l’idée unitaire traditionnelle ».
Le caractère abstrait et désacralisé de l’identité nationale en cours de formation s’exprime à l’envi par la prolifération de ses agents fonctionnels, de sa bureaucratie : baillis, sénéchaux, gouverneurs, intendants, autant d’agents du pouvoir royal qui, lorsque s’instituera la patrimonialité des offices, seront surtout recrutés dans les rangs de la bourgeoisie. Cette artificialité du fait national s’exprime encore par le rôle dévastateur et souvent oublié de la mise en place, à partir du XVIe siècle, d’un marché national unifié, sous l’influence des idées mercantilistes, puis physiocratiques.
Aux 2 formes supérieures de l’épanouissement individuel, l’action pure qu’incarne la voie héroïque & la contemplation pure que visent l’ascèse et la connaissance, succède l’engouement utilitaire de plus en plus marqué pour l’abondance et la richesse. L’individu n’est plus appelé à se reconnaître dans un type supérieur d’humanité, le clerc ou le chevalier, puisque ceux-ci sont supplantés par une idéologie bourgeoise uniforme, mais plutôt à se fondre dans des entités surplombantes et massifiantes qui ont d’abord pour nom nation, puis classe ou humanité.
« Dans ce nationalisme, écrit Evola, le fait important n’est pas que surgisse une conscience nationale distincte par rapport à une autre, mais que la “nation” y devienne une personne, une entité en soi ; et l’impossibilité de dépasser le droit de la terre et du sang — qui ne concerne que l’aspect naturel et infra-intellectuel de l’homme —, l’impossibilité par l’individu d’acquérir une valeur sinon dans les termes propres à une collectivité et à une tradition données finissent par être élevés au rang de valeurs éthiques » [DVN 51]. Il y a donc passage de la personne à la collectivité, du supérieur à l’inférieur, du spirituel au matériel.
C’est bien évidemment avec la Révolution française que culmine l’idée nationale. En quelques années révolutionnaires se résume et s’accélère le mouvement de plusieurs siècles d’histoire. La monarchie, dernier vestige traditionnel, pourtant vidé de sa substance, est supplanté par la souveraineté nationale. La nation n’est plus pensée, à l’intérieur, comme une hiérarchie d’ordre différents par nature mais comme une entité abstraite d’individus égaux (on connaît le mot de Siéyès : « La nation est une collection d’individus »). Et l’identité nationale est désormais rationnellement reconnue par l’individu citoyen, c'est une citoyenneté interne précosmopolitique. Phase ultime et logique du dclin de l'ide impériale, décrite en ces termes par Evola : « à l’émancipation vis-à-vis de l’Empire des États devenus absolus devait succéder l’émancipation vis-à-vis de l'État des individus souverains, libres et autonomes » [RCM].
À cette conception du nationalisme, conception étatique et jacobine, on a coutume d’opposer la conception dite romantique de la nation, qui s’est développée au XIXe siècle en Allemagne et qui eut pour initiateurs principaux Herder et Fichte. Pour la première, le développement national présuppose l’existence d’un cadre étatique ; la seconde pose, au contraire, la préexistence du fait national, de la culture nationale dont découle l’État. Or Evola ne verse ni dans l’une ni dans l’autre de ces conceptions du fait national. C’est l’émergence du national-socialisme, son idolâtrie poussée à l’extrême de la Volksgemeinschaft [communauté populaire] (par ailleurs réduite à une donne biologique), qui lui donne l’occasion de rappeler l’opposition existant à ses yeux entre l’État d’une part, principe masculin, anagogique (« tirant vers le haut »), éthique et spirituel, et la nation d’autre part, principe féminin, démagogique parce qu’elle est un autre nom du plus grand nombre, naturaliste et sentimentale.
Cette opposition, dans la grille d’analyse traditionnelle rapportée à la trifonctionnalité évoquée au début de cette intervention, est la suivante : l’État vrai, non le pur fait de puissance ou la superstructure juridique mais la force spirituelle de formation et de sélection, est l’instance légitime d’autorité qui assure le pouvoir. La nation, quant à elle, qui désigne simplement la masse mise en forme par un héritage historique ou une caractérisation ethnique, est un concept de troisième fonction.
Admettre que l’État puisse tirer sa légitimité (et les limites de sa souveraineté) de la nation, poser, comme fait le nationalisme, la nécessaire congruence de l’unité politique et de l’unité nationale, c’est ramener le première fonction à se déterminer par rapport à la troisième. Or, écrit Evola, « animée de valeurs hiérarchiques, idéales, anti-hédonistes et, dans une certaine mesure, anti-eudémonistes, la sphère politique se situe en dehors du plan de l’existence simplement “naturelle” ou “végétative” » [HMR 32], a fortiori [et par opposition aux fins de la sphère sociale] hors de l’échelle des valeurs utilitaires, économiques qui régentent le plus grand nombre à l’époque moderne. Ainsi le XVIIIe siècle vit-il, dans la défense de la “nation productive” face au souverain “improductif”, le renversement complet des valeurs traditionnelles, la nation étant à l’origine, dans le langage révolutionnaire, une limitation de l’autorité de l’État (comme le seront plus tard la défense libérale de l’individu ou du marché face au “constructivisme”).
« Les concepts de nation, de peuple, de patrie, malgré le halo romantique et idéaliste qui les entoure parfois, appartiennent par essence au plan “naturaliste” et biologique, non au plan politique, et correspondent à la dimension “naturelle” et physique d’une collectivité donnée » [HMR 36].
Cette contradiction qui consiste à vouloir faire coïncider 2 sphères qualitativement différentes de l’action et de l’existence humaine est apparue en pleine lumière dans certaines entreprises modernes, dont le national-socialisme fut, dans sa phase tardive, le dernier exemple en date. D’où provient son échec théorique : « la cause en est, répond Evola, la contradiction à vouloir être, dans le même temps, “nation” et “empire” — ainsi que l’absence, à la base, d’une véritable universalité » [UIPN 63].
Toute tentative historique appelant à intégrer, dans un même projet historique des réalités différentes, appelle nécessairement un dépassement du particulier dans l’universel. « Une race impériale, dit le philosophe italien, s’éloigne tout autant de ses particularités propres que de celles qui caractérisent d’autres races ; elle n’oppose pas un patriotisme à un autre : elle oppose l’universel au particulier » [UIPN 66].
Ainsi, une vision du monde qui pose la communauté nationale-raciale comme centrale et l’État comme une réalité secondaire et dérivée, ne pourra jamais dépasser sa propre particularité sans user de coercition. L’Europe napoléonienne et l’Europe hitlérienne sont 2 exemples parlants de constructions politiques à rhétorique “impérial” mais à caractère national, dont les contributions constitutives ne purent générer, à terme, qu’une division un peu plus profonde d’une unité européenne depuis longtemps perdue : « Si les tentatives impériales des temps modernes ont avorté ou mené à la ruine les peuples qui les ont entreprises, ou bien si elles se sont chargées en cause de calamités innombrables, il faut en chercher précisément la raison dans l'absence de tout facteur vraiment spirituel, donc suprapolitique et supranationaliste » (ibid.).
A contrario, rappelle Evola, « le Moyen Âge catholique aussi bien que l’Empire romain ou l’Inde sont des exemples d’une universalité ainsi conçue : ils nous montrent la possibilité d’une unité culturelle et spirituelle profonde, au sein de la pluralité, et souvent même de la lutte d’États ou de races distinctes sur le plan ethnique. S’il fallait évoquer une future conscience européenne, c’est uniquement en ces termes qu’il conviendrait de le faire » [DVN 57].
Réserves critiques
Au terme de cette présentation de l’analyse évolienne de la nation et du nationalisme, quelques réserves critiques nous semblent nécessaires.
En premier lieu, il nous faut ici signaler, ce que les nombreux et attentifs lecteurs d’Evola qui se trouvent, j’en suis sûr, dans cette salle ne manqueront pas de me rappeler, que J. Evola, dans l’un de ses textes, donne un sens positif au nationalisme, à un « nationalisme aristocratique » qui s’opposerait au « nationalisme démagogique », un nationalisme qui ne serait pas la phase transitoire de lutte contre la Tradition que nous venons d’évoquer, mais plutôt une réaction face aux formes ultimes de la régression moderne, la collectivisation. Plusieurs raisons nous ont poussé à ne pas l’évoquer dans notre développement principal.
Tout d’abord, ce nationalisme positif n’est, sous la plume d'Evola, qu’un autre nom de la restauration aristocratique pure et simple et n’a plus grand chose à voir avec le concept de nation. Il s’agit plus d’une tentative de récupération terminologique et idéologique (l’article date de 1931, époque où s’affirment un peu partout en Europe des pouvoirs nationalistes). D’autre part et curieusement, Evola évoque la possibilité qu’accorderait ce nationalisme de reconstruire méthodiquement un ordre traditionnel, dans un sens exactement inverse à celui de la subversion moderne :
« Dans l’optique de ce nationalisme restaurateur, l’objectif serait donc le suivant : en premier lieu, donner une forme, ordonner tout ce qui, dans la société, correspond à la part physico-vitale ou animale d’un organisme humain et relevait du monde propre aux 2 dernières classes subalternes : travail, économie, organisation politique au sens étroit du terme, débouchant sur une “paix économique” qui, par ses effets permettra aux énergies d’ordre supérieur de se libérer et d’agir sur un plan plus élevé. On pourrait alors commencer à s’attaquer à la reconstruction de la seconde caste, l’aristocratie guerrière, à laquelle appartient le premier des aristocrates, le monarque » [DVN 55].
Outre ce que cette planification peut avoir de sympathiquement irréaliste dans son calme énoncé, il faut remarquer qu’Evola y défend une position contraire à la lecture traditionnelle de l’histoire, pour laquelle l’achèvement du dernier âge, le Kali Yuga, l’Âge sombre, l’Âge de fer, donne lieu à un gigantesque bouleversement, une révolution au sens premier du mot, qui replonge le monde dans un nouveau cycle, dans un nouvel âge d’or. Rien à voir donc avec de “programme” évolien de reconstruction à partir du niveau inférieur (« la paix économique ») d’un ordre traditionnel. On ne retrouve pas, dans son œuvre, une telle opinion reproduite, ce qui laisse penser qu’elle devait plus à la pression de la conjoncture qu’à une réflexion de fond de son auteur.
Hormis ce point somme toute annexe, la deuxième critique de fond qui nous vient à l’esprit concerne l’assimilation constante, sous la plume d’Evola, des concepts de demos, de masse, de nation, de société lesquels incarnent pourtant des réalités qualitativement différentes et que l’auteur confond avec le principe de la quantité, principe lunaire et féminin, règne du plus grand nombre.
On ne peut distinguer — et à bon droit nous semble-t-il — 2 visages de la fonction souveraine, une auctoritas sacrée et une potestas laïque (1), sans discerner également 2 modes possibles de légitimitation du pouvoir. À l'autorité souveraine, dont la charge est de faire de faire de ses parties un tout qui les dépasse, de maintenir une unit spirituelle, une légitimation “cosmique” ; au pouvoir public, dont la charge est d'organiser et de représenter chacune de ses parties, une légitimation démocratique.
Nulle part n’apparaît donc un éclairage positif sur la notion de totalité sociale ou de communauté comme paradigme alternatif à l’individualisme dominant (Evola ne répugnant pas, comme un certain Nietzsche, à défendre un “individualisme aristocratique” face à la collectivité ou à la masse).
À ne voir dans l’irruption de la nation qu’une cause de « déclin par le haut », comme il se plaît à l’écrire, à n’y voir qu’un visage de la subversion ou de la guerre occulte menée par quelques uns, Evola se refuse à saisir la multiplicité des facteurs expliquant le succès et la pérennité de l’ordre national-étatique. Car la nation n’a prospéré qu’en répondant à une aspiration collective née du déclin des communautés réelles d’appartenance, sous le double effet de l'étatisation et de la mercantilisation du lien social. Elle est ce que Serge Latouche a justement qualifié de « compromis sociétal de la modernité » (L’Occidentalisation du monde, 1987), le refuge des individus déracinés par la révolution industrielle, la part de rêve accordée aux masses pour leur faire oublier les conséquences directes de l’imposition d’un ordre utilitaire à l’échelle du corps social tout entier. Elle est la forme d’appartenance tolérée, et parfois générée, par l’idéologie économique.
Louis Dumont, qui est un autre admirateur de l’Inde et des sociétés traditionnelles, et dont la lecture est souvent complémentaire de celle d’Evola, a bien mis en lumière l’importance de la distinction individualisme/holisme pour saisir l’originalité de la nation. Pour lui, « une nation ne naît pas d’un simple tissu de solidarités sans relations aux valeurs. Un système de valeurs exclut la nation (celui des sociétés holistes) ; un autre n’admet pas d’autres groupes politiques (…) La nation est le groupe sociopolitique moderne correspondant à l’idéologie de l’individu » (2). Qu’elle soit collection d’individu ou individu collectif, elle n’échappe pas au paradigme individualiste qui la fonde, et qui néglige la totalité sociale et la relation des hommes entre eux.
La nation n’est donc pas qu’une subversion « d’en haut », elle est aussi un désir d'identité « d'en bas », une réponse moderne à un déracinement généralisé. Mais par son abstraction même, par ses rapports ambigus à la réification et à la marchandisation du lien social, par son inadaptation à la situation géopolitique présente, par son incapacité actuelle à renouveler ses mythes fondateurs et par son repli sur ses fondements rationnels/égalitaire, la nation étatique est appelée à disparaître. Alors certes, la mise en place d’un ordre de « citoyens d’une idée » ou « d’une cause », comme le proposait Evola, doit retenir toute notre attention, même si elle est appelée à ne rester qu’un vœu pieux, mais on peut aussi penser que c’est d’«en bas » que la réponse au déracinement national viendra aussi — car c’est là que les conséquences de l’idéologie moderne ont été, sont et seront encore le plus durement ressenties. Il faut penser ensemble l'au-delà et l'en-deçà de la nation et du nationalisme.
► Charles Champetier in Nation & Empire : Histoire et d'un concept (actes du XXIVe colloque national du GRECE), 1991, intervention reprise et remaniée sous le titre « Nation et nationalisme chez Julius Evola » dans le Dossier H consacré à ce penseur (L'Âge d'Homme, 1997), p. 99 sq.
◘ abrévations :
- DVN = « Les deux visages du nationalisme » (1931), et son corollaire, UIPN = « Universalité impériale et particularisme nationaliste » (1931), in Essais politiques, Pardès, 1988.
- RCM = Révolte contre le monde moderne (1934).
- HMR = Les Hommes au milieu des ruines (1972), Pardès, 1984.
◘ notes :
1 – « Qu’est-ce qui distingue fondamentalement l’Empire de la nation ? C’est d’abord le fait que l’Empire n’est pas avant tout un territoire, mais fondamentalement un principe ou une idée. L’ordre politique y est en effet déterminé, non par des facteurs matériels ou par la possession d’une étendue géographique, mais par une idée spirituelle ou politico-juridique. Ce serait donc une erreur de s’imaginer que l’Empire diffère de la nation avant tout par la taille, qu’il est en quelque sorte "une nation plus grande que les autres". Certes, par définition, un empire couvre une large superficie. Mais l’essentiel n’est pas là. L’essentiel tient au fait que l’empereur tient son pouvoir de ce qu’il incarne quelque chose qui excède la simple possession. En tant que dominus mundi, il est le suzerain des princes comme des rois, c’est-à-dire qu’il règne sur des souverains, non sur des territoires, qu’il représente une puissance transcendant la communauté dont il a la direction. Comme l’écrit J. Evola, "l’Empire ne doit pas être confondu avec l’un des royaumes et des nations qui le composent, car il est quelque chose de qualitativement différent, antérieur et supérieur, dans son principe à chacun d’eux". Evola rappelle également que "l’ancienne notion romaine de l’imperium, avant d’exprimer un système d’hégémonie territoriale supranationale, désigne la pure puissance du commandement, la force quasi mystique de l’auctoritas". La distinction est précisément courante, au Moyen Âge, entre la notion d’auctoritas, de supériorité morale et spirituelle, et celle de potestas, simple pouvoir politique public s’exerçant par des moyens légaux. Dans l’empire médiéval comme dans le Saint-Empire, cette distinction sous-tend la dissociation entre l’autorité propre à la fonction impériale et l’autorité que détient l’empereur comme souverain d’un peuple particulier. Charlemagne, par ex., est d’une part empereur, d’autre part roi des Lombards et des Francs. L’allégeance à l’empereur n’est donc pas soumission à un peuple ou à un pays particulier. Dans l’empire austro-hongrois, la fidélité à la dynastie des Habsbourg constitue encore "le lien fondamental entre les peuples et tient lieu de patriotisme" (J. Béranger) ; elle l’emporte sur les liens de caractère national ou confessionnel. » [AdB, L'idée d'Empire]
2 – Essai sur l’individualisme, Seuil, 1983, p. 128. Sur le même thème, on lira aussi Homo hierarchicus, appendice D (« Nationalisme et communalisme »), Tel-Gallimard, pp. 376-395.

◘ Les lois de la “variété requise”
 Il ne m’arrive pas souvent de parler de philosophie. Mes lecteurs me pardonneront pour une fois d’attirer leur attention sur les lois de la “variété requise”, formulées par un certain nombre de chercheurs, de physiciens, de philosophes et d’analystes à l’occasion de leurs recherches sur la “théorie des systèmes”. Cette dernière s’est élaborée peu à peu depuis les années 40 dans diverses branches de la science et des techniques tant en biologie, qu’en physique, en cybernétique et en informatique. Leurs recherches les plus récentes confirment que les progrès accomplis en de multiples domaines par la civilisation de plus en plus avancée et complexe dans laquelle nous vivons, ne peuvent manquer d’avoir d’inévitables répercussions sur l’organisation “physique” et institutionnelle des sociétés humaines.
Il ne m’arrive pas souvent de parler de philosophie. Mes lecteurs me pardonneront pour une fois d’attirer leur attention sur les lois de la “variété requise”, formulées par un certain nombre de chercheurs, de physiciens, de philosophes et d’analystes à l’occasion de leurs recherches sur la “théorie des systèmes”. Cette dernière s’est élaborée peu à peu depuis les années 40 dans diverses branches de la science et des techniques tant en biologie, qu’en physique, en cybernétique et en informatique. Leurs recherches les plus récentes confirment que les progrès accomplis en de multiples domaines par la civilisation de plus en plus avancée et complexe dans laquelle nous vivons, ne peuvent manquer d’avoir d’inévitables répercussions sur l’organisation “physique” et institutionnelle des sociétés humaines.
J’ai déjà indiqué dans plusieurs de mes livres et notamment dans L’Europe aux Cent Drapeaux, qu’il y avait une “physique” de l’organisation politique et administrative comme il y a une physique de l’eau, de l’air et de l’espace. Beaucoup de nos contemporains sont égarés par des idéologies ou des systèmes de pensée qui leur font oublier l’inévitable priorité que l’on doit accorder au concret et aux impératifs de la nature, plus qu’aux théories et aux systèmes, trop souvent figés, de pensée. Il n’y a pas, en d’autres termes, de théories ou d’idéologies valables, même en politique, si ces dernières refusent de tenir compte de ce qui est et qui s’impose à nous en nous dépassant, pour privilégier seulement ce qu’il serait préférable qu’il soit.
La loi fondamentale de la vie est celle de l’équilibre, de l’action, de la réaction et de l’interaction réciproque d’organismes vivants, celles des cellules du corps humain, comme celles des hommes, des familles, des villes et des entreprises, comme celles de l’économie et des institutions que les hommes peuvent se donner. L’organisation de nos sociétés, en un mot, n’échappe pas à cette règle fondamentale de la vie. Rappelons-le : il n’y a d’unité que dans la mort. À des systèmes vivants de plus en plus complexes, il faut nécessairement des systèmes d’organisation de plus en plus diversifiés.
Nous assistons de nos jours à l’éclatement de sociétés politiques devenues trop grandes et trop despotiques pour répondre aux besoins de la vie et aux désirs des hommes et des peuples. À force de vouloir tout diriger, tout réglementer, tout commander, tout décider, ils sont automatiquement conduits vers l’éclatement et la mort. Ceux qui aujourd’hui pensent encore que l’unité est inséparable de l’uniformité, tournent le dos à la vie et aux leçons des sciences, des techniques et des recherches les plus modernes, dont les lois de la “variété requise” est l’une des formulations. J’ai déjà dit que de nos jours et au point de l’évolution politique à laquelle nous sommes arrivés, il fallait bien souvent diviser pour pouvoir, par la suite, plus valablement unir.
Aux exigences d’une civilisation de plus en plus complexe doivent répondre des formes d’organisation de plus en plus décentralisées, qui remettent le choix de la décision au niveau d’organisation et de gouvernement le plus proche des citoyens. Confirmé par l’étude des disciplines modernes, l’application du principe de subsidiarité, qui est à la base de toute organisation fédéraliste, permet de concilier les contraires, d’équilibrer les besoins et les impératifs du tout ou de l’ensemble, en assurant en même temps le respect des libertés nécessaires à l’épanouissement des sociétés de base ? Ce sont ces dernières qui, en s’élevant de niveau en niveau, finissent par former le tout ou l’ensemble, et permettent de réaliser ainsi l’unité dans le respect de toutes les diversités.
En économie comme en gestion, en administration comme en politique, toute centralisation excessive stérilise, car elle entraîne une simplification et un appauvrissement des canaux de communication entre la base et le sommet. Or tout le monde s’accorde à reconnaître que, en cybernétique comme en biologie et en informatique, le feed-back joue un rôle fondamental ; c’est-à-dire que l’information ou l’organisation descendante doit se doubler, pour bien fonctionner, d’une information et d’une organisation descendante qui part de la base pour se diriger vers le sommet. Personne, en effet, ne peut mieux connaître un problème que celui qui en est le plus rapproché.
Cette page de philosophie, écho donné aux études les plus récentes, ne nous confirme-t-elle pas que la conception « totalitariste » de l’État centraliste qui est celle de l’État français, et celle d’autres grands États à l’éclatement desquels nous assistons, est de moins en moins adaptée à nos sociétés modernes ? Nous devons y puiser des motifs supplémentaires de mener à l’écart d’idéologies et de systèmes qui cherchent à conserver ou à renforcer l’unitarisme et l’unicité des décisions, le combat pragmatique et concret qui est le nôtre, le seul qui puisse conduire à l’avènement des libertés qui sont nécessaires au peuple breton comme à tous les autres peuples de l’Europe.
► Yann Fouéré, Vouloir n°73-75, 1991. (article tiré de Gwen ha Du)

◘ Pour une typologie opératoire des nationalismes
[Ci-dessous : août 1968 à Prague. La révolte contre le stalinisme et l'occupant soviétique avait une dimension nationale et populaire. Dans ce cas, le nationalisme de libération est moralement justifié, contrairement aux affirmations chauvines et cocardières qui, elles, n'ont rien de "moral".]
 Le mot “nationalisme” recouvre plusieurs acceptions. Dans ce vocable, les langages politique et politologique ont fourré une pluralité de contenus. Par ailleurs, le nationalisme, quand il agit dans l'arène politique, peut promouvoir des valeurs très différentes selon les circonstances. Par ex., le nationalisme peut être un programme de libération nationale et sociale. Il se situe alors à “gauche” de l'échiquier politique, si toutefois on accepte cette dichotomie conventionnelle, et désormais dépassée, qui, dans le langage politique, distingue fort abruptement entre une “droite” et une “gauche”.
Le mot “nationalisme” recouvre plusieurs acceptions. Dans ce vocable, les langages politique et politologique ont fourré une pluralité de contenus. Par ailleurs, le nationalisme, quand il agit dans l'arène politique, peut promouvoir des valeurs très différentes selon les circonstances. Par ex., le nationalisme peut être un programme de libération nationale et sociale. Il se situe alors à “gauche” de l'échiquier politique, si toutefois on accepte cette dichotomie conventionnelle, et désormais dépassée, qui, dans le langage politique, distingue fort abruptement entre une “droite” et une “gauche”.
Les gauches conventionnelles, en général, avaient accepté comme “progressistes”, il y a une ou 2 décennies, les nationalismes de libération vietnamien, algérien ou nicaraguéen car ils se dressaient contre une forme d'oppression à la fois colonialiste et capitaliste. Mais le nationalisme n'est pas toujours de libération : il peut également servir à asseoir un programme de soumission, d'impérialisme. Un certain nationalisme français, dans les années 50 et 60, voulait ainsi oblitérer les nationalismes vietnamien et algérien de valeurs jacobines, décrétées quintessence du “nationalisme français” même dans les rangs des droites, pourtant traditionnellement hostiles à la veine idéologique jacobine. Nous constatons donc, au regard de ces exemples historiques récents, que nous nageons en pleine confusion, à moins que nous ayons affaire à une coïncidentia oppositorum...
Depuis quand peut-on parler de nationalisme ?
Pour clarifier le débat, il importe de se poser une première question : depuis quand peut-on parler de “nationalisme” ? Les historiens ne sont pas d'accord entre eux pour dire à quelle époque, les hommes se sont vraiment mis à parler de nationalisme et à raisonner en termes de nationalisme. Avant le XVIIIe siècle, on peut repérer le messianisme national des Juifs, la notion d'appartenance culturelle commune chez les Grecs de l'Antiquité, la notion d'imperium chez les Romains. Au Moyen Âge, les nations connaissent leurs différences mais les assument dans l'œkumène chrétien, qui reste, en ultime instance, le seul véritable référent. À la Renaissance, en Italie, en France et en Allemagne, la notion de “nation”, comme référent politique important, est réservée à quelques humanistes comme Machiavel ou Ulrich von Hutten. En Bohème, la tragique aventure hussite du XVe siècle a marqué la mémoire tchèque, contribuant fortement à l'éclosion d'un particularisme très typé. Au XVIIe siècle, l'Angleterre connaît une forme de nationalisme en instaurant son Église nationale, indépendante de Rome, mais celle-ci est défiée par les non-conformistes religieux qui se réclament de la lettre de la Bible.
Avec la Révolution française, le sentiment national s'émancipe de toutes les formes religieuses traditionnelles. Il se laïcise, se mue en un nationalisme purement séculier, en un instrument pour la mobilisation des masses, appelées pour la première fois aux armées dans l'histoire européenne. Le nationalisme moderne survient donc quand s'effondre l'universalisme chrétien. Il est donc un ersatz de religion, basé sur des éléments épars de l'idéologie des Lumières. Il naît en tant qu'idéologie du Tiers-état, auparavant exclus du pouvoir.
Celui-ci, à cause précisément de cette exclusion, en vient à s'identifier à LA Nation, l'aristocratie et le clergé étant jugés comme des corps étrangers de souche franque-germanique et non gallo-romane (cf. Siéyès). Ce Tiers-état bourgeois accède seul aux affaires, barrant en même temps la route du pouvoir au quatrième état qu'est de fait la paysannerie, et au quint-état que sont les ouvriers des manufactures, encore très minoritaires à l'époque (1). Le nationalisme moderne, illuministe, de facture jacobine, est donc l'idéologie d'une partie du peuple seulement, en l'occurrence la bourgeoisie qui s'est émancipée en instrumentalisant, en France, l'appareil critique que sont les Lumières ou les modes anglicisantes du XVIIIe siècle.
Après la parenthèse révolutionnaire effervescente, cette bourgeoisie se militarise sous Bonaparte et impose à une bonne partie de l'Europe son code juridique. La Restauration d'après Waterloo conserve cet appareil juridique et n'ouvre pas le chemin du pouvoir, ne fût-ce qu'à l'échelon communal/municipal, aux éléments avancés des quart-état et quint-état (celui en croissance rapide), créant ainsi les conditions de la guerre sociale. En Allemagne, les observateurs, d'abord enthousiastes, de la Révolution, ont bien vite vu que les acteurs français, surtout parisiens à la suite de l'élimination de toutes les factions fédéralistes (Lyon, Marseille), ne cherchaient qu'à hisser au pouvoir une petite “élite” clubiste, coupée du gros de la population.
Ces observateurs développeront, à la suite de cette observation, un “nationalisme” au-delà de la bourgeoisie, capable d'organiser les éléments du Tiers-état non encore politisés, c'est-à-dire les paysans et les ouvriers (que l'on pourrait appeler quart-état ou quint-état). Ernst-Moritz Arndt prend pour modèles les constitutions suédoises des XVIIe et XVIIIe siècles, où le paysannat, fait unique en Europe, était représenté au Parlement en tant que “quart-état”, aux côtés de la noblesse, du clergé et de la bourgeoisie marchande et industrielle (2).
Le Baron von Stein, juriste inspiré par la praxis prussienne de l'époque frédéricienne, par les théories de Herder et de Justus Möser, par les leçons de l'ère révolutionnaire et bonapartiste, élabore une nouvelle politique agraire, prévoyant l'émancipation paysanne en Prusse, projette de réorganiser la bureaucratie d'État et d'instaurer l'autonomie administrative à tous les niveaux, depuis la commune jusqu'aux instances suprêmes du Reich. Les desiderata d'Arndt et du Baron von Stein ne seront pas traduits dans la réalité, à cause de la « trahison des princes allemands », de l'« obstination têtue des principules et ducaillons », préférant l'expédiant d'une restauration absolutiste pure et simple.
Le désordre des nationalismes
[En réaction à la mise sous tutelle politique et religieuse au XVIIe s. du royaume de Bohême (en grande majorité protestant) par les Habsbourg, à partir de la Révolution francaise et surtout à partir du Printemps des Révolutions de 1848 (suite à la “Constitution d'avril” de l'Autriche), une renaissance nationale tchèque prend forme. La langue tchèque est purifiée des germanismes qu'elle avait naturellement adopté tout au long de la coexistence avec la minorité allemande, sous l'influence, entre autres, de František Palacký (1798-1876, ci-dessous). Connu à l'Ouest que pour sa participation à la révolution de 1848, ses travaux d'historien, qui ont amorcé le renouveau national tchèque, sont en revanche beaucoup moins connus. Son Histoire de la nation tchèque est un monument d'érudition. Dans son cas, comme dans celui de Grundtvig au Danemark, de Conscience en Flandre ou de Hoffman von Fallersleben en Flandre et en Allemagne, le nationalisme qu'il développe est un nationalisme issu d'une nouvelle “première fonction” ancrée dans le peuple et non plus aliénée. Ce nationalisme-là prend ses distances par rapport au jingoïsme des marchands et du tiers-état bourgeois. En tant que député tchèque, F. Palacký défendit tout d'abord la politique de l'austroslavisme, d'une Autriche forte et indépendante, fédéralisée et garante des “petites” nations d’Europe centrale menacées tant par les Allemands que les Russes et, selon Marx lui-même, vouées à disparaître… Craignant, dans le cas de l'intégration de l'Autriche dans l'Allemagne réunifiée, la dissolution de la nation tchèque dans une “mer allemande”, il préférera soutenir la politique polonaise, malgré de grandes déclarations progaliciennes, et finira même par se tourner vers la Russie quand Vienne le trahira. En effet la fondation en 1867 d’un empire dual austro-hongrois, excluant les Slaves qui n’aspiraient qu’à transformer l’empire en une confédération de peuples égaux, replacera la Russie au centre du panslavisme.]
 Comment le nationalisme va-t-il évoluer, à la suite de cette naissance tumultueuse dans les soubresauts de la Révolution ou du soulèvement allemand de 1813 ? Il évoluera dans le plus parfait désordre : la bourgeoisie invoquera le nationalisme dans l'esprit de 1789 ou de la Convention, les socialistes dans la perspective fédéraliste ou dans l'espoir de voir la communauté populaire politisée s'étendre à tous les états de la société, les Burschenschaften allemandes contre les Princes et l'ordre imposé par Metternich à Vienne en 1815, les narodniki russes dans la perspective d'une émancipation paysanne généralisée, etc. Le mot “nationalisme” en vient à désigner des contenus très divers, à recouvrir des acceptions très hétérogènes.
Comment le nationalisme va-t-il évoluer, à la suite de cette naissance tumultueuse dans les soubresauts de la Révolution ou du soulèvement allemand de 1813 ? Il évoluera dans le plus parfait désordre : la bourgeoisie invoquera le nationalisme dans l'esprit de 1789 ou de la Convention, les socialistes dans la perspective fédéraliste ou dans l'espoir de voir la communauté populaire politisée s'étendre à tous les états de la société, les Burschenschaften allemandes contre les Princes et l'ordre imposé par Metternich à Vienne en 1815, les narodniki russes dans la perspective d'une émancipation paysanne généralisée, etc. Le mot “nationalisme” en vient à désigner des contenus très divers, à recouvrir des acceptions très hétérogènes.
En Hongrie, avec Petöfi, le nationalisme est un nationalisme ethnique de libération comme chez Arndt et Jahn. En Pologne, l'ethnisme slavisant se mêle, chez Mickiewicz, d'un messianisme catholique anti-russe et anti-prussien, donc anti-orthodoxe et anti-protestant. En Italie, avec Mazzini, il est libéral et illuministe. En Allemagne avec Jahn et au Danemark, avec Grundtvig, il est nationalisme de libération, ethniste, ruraliste, racialisant et s'oppose au droit romain (non celui de la vieille Rome républicaine mais celui de la Rome décadente et orientalisée, réinjecté en Europe centrale entre le XIIIe et le XVIe siècles), c'est-à-dire à la généralisation d'un droit où l'individu reçoit préséance, au détriment des communautés ou de la nation.
Dans l'Allemagne nationale-libérale de Bismarck, le Tiers-état allemand accède au pouvoir tout en concédant une bonne législation sociale au quint-état ouvrier. La France de la IIIe République consolide le pouvoir bourgeois mis en selle lors de la Convention. Entre 1914 et 1918, le monde assiste à la conflagration généralisée des nationalismes tiers-étatistes. En 1919, à Versailles, l'Ouest impose le principe de l'auto-détermination dans la Zwischeneuropa, l'Europe sise entre l'Allemagne et la Russie. La France va ainsi accorder aux Polonais et aux Tchèques ce qu'elle refusera toujours aux Bretons, aux Alsaciens, aux Corses et aux Flamands. Mais cette auto-détermination n'est pas accordée directement aux peuples pris dans leur globalité, mais aux militaires polonais ou roumains, aux clubs tchèques (Masaryk), etc.
Ces strates dirigeantes, exploitant à fond les idéologèmes nationalistes, ont affaibli leurs peuples en imposant des budgets militaires colossaux, notamment en Pologne et en Roumanie. Dans ce dernier pays, ce n'est pas un hasard non plus si la contestation néo-nationaliste, hostile au nationalisme de la monarchie et des militaires, se soit basée sur les idéologies agrariennes (poporanisme) ou les ait faits dévier dans une sorte de millénarisme paysan, comparable, écrit Nolte (3), aux millénarismes de la fin du Moyen Âge ouest-européen (Légion de l'Archange Michel, Garde de Fer).
La classification de Carlton J.H. Hayes
Devant ce désordre événémentiel, la pensée européenne n'a pas été capable d'énoncer tout de suite une théorie scientifique, assortie d'une classification claire des différentes manifestations de l'idéologie nationaliste. Avec un tel désordre de faits, une typologie est nécessaire, vu qu'il y a pluralité d'acceptions. Les linéaments de nationalisme se sont de surcroît mêlés à divers résidus, plus ou moins fortement ancrés, d'idéologies non nationales, non limitées à un espace ou à un temps précis. La première classification opératoire n'a finalement été suggérée qu'en 1931 par l'Américain Carlton J.H. Hayes (4). Celui-ci distinguait :
- 1) Un nationalisme humanitaire, faisant appel à des valeurs intériorisées et critique vis-à-vis du système en place. L'idéologie humanitaire pouvant reposer tantôt sur la morale tantôt sur la culture ;
- 2) Un nationalisme jacobin, réclamant une adhésion formelle, donc extérieure, et s'instaurant comme système de gouvernement ;
- 3) Un nationalisme traditionaliste, autoritaire et contre-révolutionnaire, explorant peu les ressorts de l'intériorité humaine, et s'opposant au système en place au nom d'une tradition, posée comme pure, comme réceptacle exclusif de la vérité ;
- 4) Un nationalisme libéral, se réclamant du droit ou des droits, généralement hostile au système en place, car celui-ci n'accorde aucun droit à certaines catégories de la population ou n'en accorde pas assez au gré des protagonistes du nationalisme ;
- 5) Un nationalisme intégral, opérant une synthèse de différents éléments idéologiques pour les fusionner en un nationalisme opératoire. Maurras est le théoricien par excellence de ce type de nationalisme de synthèse, hostile, lui aussi, au régime en place.
Le découpage que nous suggère Carlton J.H. Hayes est intéressant mais l'expérience historique nous prouve que les nationalismes qui ont fait irruption sur la scène politique européenne ont souvent été des mixtes plus complexes, vu les affinités qui pouvait exister entre ces différents nationalismes, comme par ex. entre le nationalisme humanitaire et le nationalisme libéral, entre le libéralisme et le jacobinisme, entre les traditionalistes et les nationalistes intégraux, etc.
Nation-État et de Nation-Culture chez Hans Kohn
Hans Kohn (5), disciple de Meinecke, réduira conceptuellement la pluralité des nationalismes à 2 types de base :
- 1) les nationalismes émanant de la Nation-État, d'essence subjective et politique, où l'on adhère à une nation comme à un parti. C'est une conception occidentale, d'après Kohn ;
- 2) les nationalismes émanant de la Nation-Culture, d'essence objective et culturelle, déterminée par une appartenance ethnique dont on ne peut se débarrasser aisément. C'est une conception orientale, slave et germanique, d'après Kohn.
L'Occident, selon sa classification, développerait donc une idée de la nation comme communauté volontaire, comme un « plébiscite de tous les jours » (Renan). Jordis von Lohausen, géopoliticien autrichien contemporain, disait dans ce sens que l'on pouvait devenir français ou américain comme l'on devient musulman : par simple décision personnelle et par acceptation de valeurs universelles non liées à du réel concret, à un lieu précis et objectif.
L'Est européen développe une approche contraire des faits nationaux. Cette approche, dit Kohn, est déterministe : on appartient à une nation comme on appartient à une famille, pour le meilleur et pour le pire.
Kohn en déduit que les approches occidentales sont libérales, démocratiques, rationnelles et progressistes. Les approches orientales, quant à elles, sont irrationnelles, anti-individualistes, passéistes, voire “fascistes” et “racistes”.
Cette dichotomie, un peu simple, mérite une critique ; en effet, les nationalismes jacobins, occidentaux, de facture libérale et démocratique, se sont montrés agressifs dans l'histoire, bellogènes, incapables de créer des consensus réels et d'organiser les peuples (de faire des peuples des organismes harmonisés). Quant aux nationalismes dits orientaux, ils reposent sur un humanisme culturel, dérivé de Herder, qu'il serait difficile de qualifier de “fasciste”, à moins de condamner comme telle toute investigation d'ordre culturel ou littéraire dans un humus précis. Par ailleurs, l'Irlande qui est située à l'Ouest du continent européen, n'est ni slave ni germanique mais celtique, déploye un nationalisme objectif, ethnique, culturel, littéraire qui n'a jamais basculé dans le fascisme. De même pour l'Écosse, le Pays de Galles, la Flandre, la Catalogne, le Pays Basque.
La Pologne, située à l'Est, assimile de force les Ruthènes, les Kachoubes, les Lithuaniens, les Ukrainiens, les Allemands et les Tchèques qui tombent sous sa juridiction non pas au nom d'un nationalisme ethnique polonais mais au nom d'une idéologie universaliste messianisée, le catholicisme. Si bien que tous les Slaves catholiques sont considérés comme Polonais, en dépit de leur nationalité propre. Dans la Russie du XIXe siècle, le nationalisme est un mixte qui n'a rien de la netteté dichotomique de Kohn : l'étatisme anti-volontariste, mi-occidental mi-oriental, se conjugue au panslavisme culturel, “oriental” et non humaniste, et au narodnikisme, “oriental” et humaniste.
Le rôle du facteur « temps » chez Theodor Schieder
Theodor Schieder (6) critique les classifications de Hayes et de Kohn, parce qu'il les juge trop figées et parce qu'elles ne tiennent pas compte du facteur temps. La formation des nationalismes européens s'est déroulée en plusieurs étapes, dans 3 zones différentes. La première étape s'est déroulée en Europe occidentale ; la seconde étape, en Europe centrale ; la troisième étape, en Europe orientale. En Europe occidentale, c'est-à-dire en France et en Angleterre, le cadre territorial national était déjà là ; il n'y a donc pas eu besoin de l'affirmer. Le Tiers-état s'émancipe dans ce cadre et conserve les éléments d'universalisme propre au Lumières parce que le romantisme attentif aux spécificités ethno-culturelles ne s'est pas encore développé. La culture est toujours au stade du subjectif-universaliste et non encore au stade de l'objectif-particulariste.
Ce qui explique qu'en Angleterre, le terme « nationalisme » sert à désigner des mouvements de mécontents sociaux en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles. Cette acception, à l'origine typiquement britannique, du terme nationalisme est passée aux États-Unis : on y parle du “nationalisme noir” pour désigner le mécontentement des descendants des esclaves africains importés en Amérique, jadis, dans les conditions que l'on sait. Aux États-Unis comme en France, le nationalisme ne peut être ni objectif ni linguistique ni ethnique mais doit être subjectif et politique parce ces pays sont pluri-ethniques et, au départ, peu peuplés, donc contraints de faire appel à l'immigration. Tout recours à l'objectivité ethno-linguistique y briserait la cohésion artificielle, obtenue à coup de propagande idéologique.
En Europe centrale, il a fallu d'abord que les nationalismes créent le cadre territorial sur le modèle des cadres occidentaux. C'est ainsi que l'on a pu observer, dans la première moitié du XIXe siècle, les lents processus des unifications allemande et italienne. Il a fallu aussi chasser les puissances tutrices (la France en Allemagne ; l'Autriche en Italie). L'obsession de se débarrasser des armées napoléoniennes et de l'administration française ainsi que de ses reliquats juridiques est bien présente dans les écrits des ténors du nationalisme allemand du début du XIXe s. : chez Arndt, chez Jahn et chez Kleist.
Dans cette première phase, le nationalisme émergeant révèle une xénophobie, qui unit le peuple en vue d'un objectif précis, la libération du territoire national, et qui, sur le plan théorique, cherche à démontrer une homogénéité somatique de tout le corps social et populaire. Ensuite, la démarche unificatrice passe par l'élaboration d'un droit alternatif, devant nécessairement accorder un plus en matière de représentation que le droit ancien, imposé par une puissance extérieure. D'où, en Allemagne, la recherche constante d'une alternative au droit romain et la volonté d'un retour au droit coutumier germanique, laissant plus de place aux dimensions communautaires, territoriales ou professionnelles (cf. Otto von Gierke), ce qui permet de répondre aux aspirations concrètes d'autonomie communale et aux volontés d'organisation syndicale, exprimées dans la population.
En Europe orientale, les processus nationalitaires se heurtent à une difficulté de taille : créer un cadre est excessivement compliqué, vu la mosaïque ethnique, à enclaves innombrables, qu'est la partie d'Europe sise entre l'Allemagne et la Russie. Cette difficulté explique la neutralisation de cette zone bigarrée au sein d'empires pluri-nationaux. La raison d'être de la monarchie austro-hongroise était précisément due à l'impossibilité d'un découpage territorial cohérent sur base nationale dans cette région, ce qui l'aurait affaiblie face à la menace ottomane.
Pendant la guerre 14-18, Allemands et Autrichiens renoncent, sur le plan théorique, à l'idéologie nationale, tandis que l'Entente et les États-Unis, malgré leurs idéologies dominantes cosmopolites, instrumentalisent, contre la logique fédérative autrichienne, le fameux principe wilsonien de l'« auto-détermination nationale » (7). Quand, à Versailles, sous l'impulsion de Wilson et de Clémenceau, on accorde à l'Europe orientale l'auto-détermination, on le fait par placage irréfléchi du modèle jacobin, subjectivo-politique, sur la mosaïque ethnique, objectivo-culturelle. Le mélange du nationalisme subjectif et des faits objectifs d'ordre ethnique et culturel a provoqué l'explosion d'irrédentismes délétères.
Le nationalisme des « petits peuples » dans les travaux de Miroslav Hroch
 Miroslav Hroch (8), de nationalité tchèque, analyse le nationalisme des « petits peuples », soit les nationalismes norvégien, finlandais, flamand, baltes et tchèque. Ces nationalismes, tous culturels à la base, ont également évolué en 3 étapes.
Miroslav Hroch (8), de nationalité tchèque, analyse le nationalisme des « petits peuples », soit les nationalismes norvégien, finlandais, flamand, baltes et tchèque. Ces nationalismes, tous culturels à la base, ont également évolué en 3 étapes.
La première de ces étapes est la phase intellectuelle, « philologique », où des érudits redécouvrent le Kalevala en Finlande ou exhument de vieilles poésies ou épopées ou, encore, créent des romans historiques comme Conscience en Flandre. L'archéologie, la littérature et la linguistique sont mobilisées pour une « prise de conscience ». Vient ensuite la seconde phase, celle du réveil, où cette nouvelle culture encore marginale passe des érudits aux intellectuels et aux étudiants. Le Tchèque Palacký (9) a été, par ex., l'initiateur d'un tel passage dans la société tchèque du début du XIXe s. La troisième phase est celle où le nationalisme, au préalable engouement d'érudits et d'intellectuels, devient « mouvement populaire », atteint les masses qui passent, ainsi, à une « conscience historique » [ex. récent : cas slovaque]. C'est la littérature, dans tous ces cas, qui est le moteur d'un mouvement social. Au XIXe s., dans le sillage du romantisme, c'est le roman qui a joué le rôle de diffuseur. Aujourd'hui, ce pourrait être le cinéma ou la bande dessinée.
Qui porte cette évolution ? Ce n'est pas, comme dans les cas des nationalismes tiers-étatistes, la bourgeoisie industrielle ou marchande. Celle-ci ne montre aucun intérêt pour la philologie, la poésie ou le roman historique. Sur le plan culturel, elle est strictement analphabète (Kulturanalphabet, dirait-on en allemand). Le nationalisme des « petits peuples » émane au contraire de personnalités cultivées, issues de classes diverses, mais toutes hostiles à la caste marchande inculte (les « Philistins », disait l'humaniste anglais Matthew Arnold). Schumpeter, en économie, Veblen, en sociologie, ont montré combien puissante était cette hostilité du peuple, des clergés et des aristocrates à l'encontre des riches sans passé, porteurs de la civilisation capitaliste.
Constatant que cette haine allait croissante, Schumpeter prévoyait la fin du capitalisme. Cette haine est donc partagée entre d'une part, les nationalismes culturels et, d'autres part, les gauchismes de toutes moutures, qui, quand ils conjuguent leurs efforts et abandonnent le faux clivage gauche/droite en induisant un nouveau clivage, cette fois entre cultivés et non-cultivés, font sauter la domination des castes marchandes, spéculatrices et incultes (« middelmatiques » disait le socialiste belge Edmond Picard).
Des intellectuels issus des milieux paysans
Les intellectuels qui initient ces nationalismes de culture sont souvent issus de milieux populaires paysans, ruraux, ou sont de petits hobereaux cultivés, dépositaires d'une « longue mémoire ». Miroslav Hroch pose, après ce constat sur l'origine sociale de ce type d'intellectuels, une question cruciale : sont-ils des « modernisateurs » (progressistes) ou des « traditionalistes » (réactionnaires et passatistes) ? Dans sa réponse, Hroch reconnaît que ces intellectuels sont plutôt des « modernisateurs », vu qu'ils cherchent à redonner un bel éclat à leur patrie et à souder leur peuple, de façon à ce qu'il échappe au déracinement de la révolution industrielle.
Les nationalismes de culture sont tous nés dans des régions d'Europe développées, au passé riche. La Flandre a été une zone urbanisée depuis le Moyen Âge. Le Pays Basque est la zone la plus évoluée d'Espagne, qui, après une brève éclipse au XIXe siècle sur fond de pronunciamentos castillans, a connu un nouvel essor au XXe s. Même chose pour la Catalogne. La Finlande dispose d'une bonne industrie et présente un bon alliage politique fait de ruralité et de modernité. La Norvège a toujours eu d'excellents chantiers navals et dispose, aujourd'hui, d'une industrie électronique de premier plan, capable de fabriquer des missiles modernes. La Bohème-Moravie a été, après l'Allemagne, la principale zone industrielle d'Europe centrale et Prague a une université pluri-séculaire.
Au vu de ces faits, le reproche de passéisme qu'adressait Kohn aux nationalismes de culture ne tient pas. Notre conclusion : le nationalisme est difficilement acceptable quand il émane du Tiers-état, parce qu'il véhicule alors l'égoïsme de classe et l'impolitisme délétère à long terme du libéralisme ; il est acceptable quand il émane d'une sorte de « première fonction » reconstituée dans le fond-de-peuple enraciné et encore doté de sa « longue mémoire ».
E.H. Carr et le reflet des périodes de l'histoire européenne dans la définition des nationalismes
 Pour l'historien britannique E.H. Carr, les nationalismes, aux divers moments de leur évolution, sont des reflets de l'idéologie politique et économique dominante de leur époque. Ainsi, avant 1789, le nationalisme — ou ce qui en tenait lieu avant que le vocable ne se soit imposé dans le vocabulaire politique — dans les États au cadre territorial formé, comme la France ou l'Angleterre, est régalien ; il est le corollaire du pouvoir royal et inclut dans ses corpus doctrinaux l'idéal mécaniciste et absolutiste en vigueur chez les théoriciens du politique au XVIIIe siècle.
Pour l'historien britannique E.H. Carr, les nationalismes, aux divers moments de leur évolution, sont des reflets de l'idéologie politique et économique dominante de leur époque. Ainsi, avant 1789, le nationalisme — ou ce qui en tenait lieu avant que le vocable ne se soit imposé dans le vocabulaire politique — dans les États au cadre territorial formé, comme la France ou l'Angleterre, est régalien ; il est le corollaire du pouvoir royal et inclut dans ses corpus doctrinaux l'idéal mécaniciste et absolutiste en vigueur chez les théoriciens du politique au XVIIIe siècle.
De 1789 à 1870, le nationalisme est démocratique ; la révolution de 1789 est démocratique et libérale, bourgeoise et tiers-étatiste. En 1813, en Allemagne, avec Arndt et Jahn, elle s'adresse à l'ensemble du peuple, paysannerie comprise. En 1848, elle est démocratique au sens le plus utopique du terme, tant à Paris qu'à Francfort. De 1870 à 1939, quand on abandonne petit à petit les principes libéraux et l'économie du “laisser-faire”, le nationalisme devient socialiste car il faut impérativement organiser l'industrie et les masses ouvrières, ce que l'utopisme libéral n'avait pas prévu, aveuglé qu'il était par le mythe de la “main invisible” que Hayek nommera, quelques décennies plus tard, la « catallaxie ». Bismarck accorde aux ouvriers une protection sociale.
Les idéologies planistes (De Man, Freyer), le stalinisme, le fascisme (sur-tout dans sa dimension futuriste et industrialiste), le New Deal de Roosevelt et le national-socialisme hitlérien (avec ses constructions d'autoroutes et son Front du Travail) visent à faire accèder leur nation à la puissance et y parviennent en appliquant de nouvelles méthodes, chaque fois différentes mais radicalement autres que celles appliquées aux époques antérieures. La France et l'Angleterre, véhiculant des nationalismes anciens, de type régalien, et appliquant en économie les théorèmes du libéralisme, intègrent mal leurs classes ouvrières et ne parviennent pas à asseoir en elles une lo-yauté optimale.
L'Allemagne bismarckienne, en effet, a été un modèle d'intégration social à son époque. Appliquant les théories de l'économiste List sur les tarifs douaniers protecteurs de toute industrie naissante, le gouvernement impérial impose les Schutzzölle en 1879 qui protègent non seulement le capital national mais aussi le travail national, ce qui lui vaut la reconnaissance de la social-démocratie dirigée à l'époque par Ferdinand Lassalle. Dès que le capital et le travail sont protégés, il faut les organiser, c'est-à-dire les rendre ou les re-rendre « organiques ». Pour ce faire, il a fallu injecter de la protection sociale et légiférer dans le sens d'une sécurité sociale.
La nation, dans cette optique, était le système qui “organisait” et octroyait de la protection. Nation et système social se voyaient désormais confondus dans la classe ouvrière : le patriotisme du “prolétariat” allemand en 1870 et en 1914 venait du simple fait que ces masses ne souhaitaient ni le knout russe archaïsant ni l'arbitraire libéral français ou anglais. En août 1914, les travailleurs allemands couraient aux armes pour que Russes et Français ne viennent pas réduire à néant la sécurité sociale construite depuis Bismarck et non pas pour la gloire du Kaiser ou de la Sainte-Allemagne des réactionnaires et des romantiques médiévisants.
Pour E.H. Carr, la phase 1 du nationalisme est régalienne et portée par les cours et l'aristocratie ; la phase 2 est politique et démocratique ; sa classe porteuse est la bourgeoisie ; la phase 3 est économique et portée par les masses. Les nations à nationalisme de phases 1 et 2 ont opté pour un colonialisme, où les territoires d'outre-mer devaient servir de débouchés à l'industrie métropolitaine que, du coup, on ne modernisait plus. Les nationalismes de phase 3 préfèrent la « colonisation intérieure », c'est-à-dire la rentabilisation maximale des terres en friches de la métropole, des énergies nationales, des ressources du territoire. Cette « colonisation intérieure » a pour corollaire un système d'éducation très solide et très complexe. En bout de course, ce sont les nations qui ont renoncé au libéralisme stricto sensu et au colonialisme qui sortent victorieuses de la course économique : le Japon et l'Allemagne.
Le nationalisme contre les établissements ?
Donc tout nationalisme efficace doit être une idéologie contestatrice ; il doit toujours vouloir miner les établissements qui s'endorment sur leurs lauriers ou veulent bétonner des injustices. Il doit vouloir l'émancipation des masses et des catégories sociales dont l'établissement refuse l'envol et vouloir aussi leur intégration optimale dans un cadre solide, épuré de toutes formes de dysfonctionnements. Il n'y a aucun vrai nationalisme possible dans une société qui dysfonctionne à cause de sa maladie libérale. Les discours nationalistes dans les sociétés libérales sont des hochets, des joujoux, de la propagande, de la poudre aux yeux.
Dans les sociétés protégées, appliquant intelligemment et souplement les principes du protectionnisme, qui permet l'éclosion d'un capitalisme national, d'un socialisme national, d'une pédagogie nationale, le nationalisme devient automatiquement l'idéologie de ceux que favorise le protectionnisme, contre le cosmopolitisme libéral et l'internationalisme prolétarien qui sont des fois sans ancrage social réel et conduisent les sociétés à la ruine ou à la déliquescence. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de volonté protectionniste, ni à l'échelon étatique ni à l'échelon continental, il n'y a plus de nationalisme, si ce n'est des contre-façons grotesques, à verbosité militariste, qui servent de véhicule à d'autres utopies internationalistes, comme, par ex., les intégrismes religieux ou les stratégies néo-spiritualistes qui nous viennent des États-Unis ou de Corée.
Les nouveaux fronts
Chaque étape du développement de la pensée nationale crée de nouveaux fronts politiques, que le manichéisme de la pensée d'aujourd'hui refuse de percevoir. Avant 1789, le morcellement territorial des États et les douanes intérieures constituaient des freins à l'expansion du libéralisme et de l'industrie. La nécessité de les éliminer a généré une idéologie à la fois nationale (parce que la nation était le cadre élargi nécessaire à la promotion des industries et manufactures) et libérale (l'accession du Tiers-état marchand à la gestion des affaires). Cette idéologie mettait un terme aux dimensions rigidifiantes et fossilisantes de l'Ancien Régime.
Mais quand le libéralisme a atteint ses limites et montré qu'il pouvait dissoudre mais non organiser, l'idéologie idéale à appliquer dans le cadre concret de la nation est devenue le protectionnisme. Par la création de zones autarciques à dimensions territoriales précises — la nation, l'État — le pouvoir mettait un frein aux velléités cosmopolites donc dissolutives du libéralisme. L'Angleterre, ayant une longueur d'avance dans la course à l'industrialisation, exploitait à fond la pratique du libre-échange pour inonder de ses produits les pays d'Europe non encore industrialisés ou moins industrialisés, empêchant du même coup le développement d'un tissu industriel autochtone et privant la population d'opportunités multiples. Le cosmopolitisme est précisément l'idéologie qui, sous prétexte d'élargir les horizons à l'infini, refuse de tourner son regard vers la concrétude ambiante et condamne du même coup la population fixée dans et sur la concrétude ambiante à demeurer dans ses chaînes. L'idéologie cosmopolite des Lumières servait l'Angleterre au XIXe siècle comme elle sert les États-Unis aujourd'hui.
De cet état de choses découlent précisément les nouveaux fronts. Le regalien, qui est politique pur, et le protectionnisme, qui veut intégrer les masses ouvrières et fortifier l'économie, s'opposent avec une égale vigueur au libéralisme cosmopolite. Le monarchisme, le socialisme et le syndicalisme (ersatz à l'ère industrielle des associations professionnelles d'Ancien Régime) s'oppose tantôt dans le désordre tantôt dans l'ordre au libéralisme.
Les idéologues libéraux comme Hayek et von Mises ou, dans une moindre mesure, Myrdal, décrivent le socialisme et le syndicalisme comme « réactionnaires » parce qu'ils s'opposent à l'expansion illimitée du capitalisme. Cette attitude procède d'un refus des léviathans équilibrants, d'un refus de mettre un frein aux désirs utopiques et subjectifs, irréalisables parce que trop prétentieux. Le politique étant précisément la création de tels « léviathans équilibrants », on peut déduire que le libéralisme, fruit de l'idéologie des Lumières, est anti-politique, cherche à briser le travail éminemment humain — l'homme étant zôon politikon — du politique.
Le retour de Hayek et de von Mises dans un certain discours conservateur, aux États-Unis, en Angleterre et en France et d'une vulgate idéologique insipide ayant pour thème les « droits de l'homme », de même que la destruction de l'Irak baasiste et de l'institutionalisation, amorcée par Kouchner, du droit d'ingérence dans les affaires intérieures de pays tiers, avec la triste affaire des Kurdes, participe d'une totalitarisation du libéralisme qui, par la force militaire les 3 puissances où le conservatisme se réclame de Hayek et les gauches du discours « droits-de-l'hommard », cherche à homogénéiser la planète en brisant par déchaînement de violence outrancière (la destruction des colonnes irakiennes en retraite par bombes à neutrons et à effet de souffle) les petits léviathans locaux, ancrés régionalement. Comme par hasard, les 3 puissances qui amorcent cette apocalypse sont celles dites de l'« Ouest » dans le discours anti-impérialiste de l'école nationale-bolchévique (Niekisch, Paetel)...
Le commun dénominateur politisant du conservatisme monarchiste, créateur de léviathans non socialisés, et du syndicalisme, organisateur du tissu social, explique le rapprochement entre l'AF et les syndicalistes soréliens au sein du Cercle Proudhon en 1911-12, le rapprochement entre De Man et Léopold III en Belgique, le rapprochement — hélas marginalisé — entre le CERES de Chevénement et la NAR monarchiste...
L'exemple latino-américain
En 1945, le monde assiste à l'achèvement de la dynamique enclenchée par les nationalismes européens. Ce ne sont plus désormais des nations qui s'affrontent mais des blocs idéologiques transnationaux à vocation globale. Une sorte de nouvelle guerre de religion commence, réclamant, surtout chez les communistes, une forte dose de foi, qu'un Sartre contribuera notamment à injecter. Le nationalisme glisse alors vers le Tiers-monde, comme l'avait prévu le géopoliticien allemand Karl Haushofer.
En effet, en 1949, la Chine de Mao proclame son autarcie par rapport aux grands flux financiers internationaux, vecteurs du processus de dénationalisation. Malgré le discours communiste-internationaliste, la Chine se replie sur elle-même, redevient nationale-chinoise, repli qui sera encore accentué par la « révolution culturelle » des années 60. En 1954, l'Égypte de Nasser, à son tour, tente de se déconnecter des grands circuits occidentaux. Les nationalismes du Tiers-monde visent donc l'indépendance, essayent la non-intégration dans la sphère américaine, que Roosevelt et Truman voulaient étendre au monde entier (d'où l'expression « mondialisme »).
Le modèle dans le Tiers-monde est, tacitement, celui de l'Allemagne nationale-socialiste, et, plus officiellement, celui de la Russie de Staline. Mais le Tiers-monde n'est pas homogène : l'Amérique latine, par ex., était déjà, par l'action des bourgeoisies « monroeïstes », dans l'orbite américaine avant-guerre comme nous le sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, les Latino-Américains ont pensé un nationalisme de libération continental qui peut nous servir d'exemple, à condition que nous ne le concevions plus sur le mode trop romantique du guévarisme d'exportation qui avait, jadis, séduit la génération de ceux qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans. Mis à part ce nationalisme de libération, l'Amérique latine présente :
- 1) Un nationalisme d'intégration pour populations hétérogènes (Mexique-Brésil).
- 2) Un nationalisme hostile aux investisseurs étrangers à l'espace latino-américain. Ce nationalisme continentaliste avait été surtout développé au Chili (avant Pinochet) et en Bolivie.
- 3) Un nationalisme qui est recours au passé pré-colonial. Ce nationalisme a surtout été théorisé par le Péruvien Mariategui. Il s'apparente du point de vue des principes aux nationalismes de culture européens, comme le nationalisme finlandais qui exhume le Kalevala ou le nationalisme irlandais qui exhume balades celtiques et épopée de Cuchulain, etc. Ou qui recourt au passé pré-chrétien de l'Europe.
- 4) Un nationalisme dérivé du populisme urbain, dont l'expression archétypique demeure le péronisme argentin.
Ces 4 piliers théoriques du nationalisme continentaliste latino-américain réduisent à néant les clivages gauche/ droite conventionnels ; en effet, on a vu alternativement groupes de « gauche » et groupes de « droite » se revendiquer tour à tour de l'un ou l'autre de ces piliers théoriques.
En quoi ces piliers théoriques peuvent-ils servir de modèles pour l'Europe ? Quand le nationalisme de la gauche chilienne exprime son agressivité tranchée à l'égard des exploiteurs étrangers, il a le mérite de la clarté dans la définition et la désignation de l'ennemi, acte politique par excellence, comme nous l'ont enseigné Carl Schmitt et Julien Freund.
Quant au nationalisme péruvien, théorisé par Mariategui, il constitue un mixte de dialectique indigéniste et de dialectique économiste. La lutte contre l'exploitation économique passe par une prise de conscience indigéniste, dans le sens où le retour aux racines indigènes implique automatiquement une négation du système économique colonial. L'anti-impérialisme, dans la perspective péruvienne-indigéniste, consiste à recourir aux racines naturelles, non aliénées, du peuple. Cet indigénisme est hostile aux nationalismes des « bourgeoisies monroeistes », d'origine coloniale et alignées généralement sur les États-Unis avec, comme seul supplément d'âme, un esthétisme européisant, tantôt hispanophile, tantôt francophile ou anglophile.
Les mythes castriste, guévariste, sandiniste, chilien ont eu du succès en Europe parce qu'inconsciemment, ils correspondaient à des désirs que les Européens n'exprimaient plus en leur langage propre, qu'ils avaient refoulés. Lorsque l'on analyse des textes cubains officiels, parus dans la célèbre revue Politica Internacional (La Havane) (10), on découvre une analyse pertinente de l'offensive culturelle américaine en Amérique latine. Par l'action dissolvante de l'américanisme, la culture cesse d'être conscience historique et politique et se mue en instrument de dépolitisation, d'aliénation, par surenchère de fiction, de psychologisme, etc. Nous pourrions comparer cette analyse, très courante et généralisée dans le continent latino-américain, à celle qu'un Steding (11) avait fait du neutralisme culturel dépolitisé en Hollande, en Suisse et en Scandinavie ou à celle que Gobard avait fait de l'aliénation culturelle et linguistique en France (12).
Indigénisme, populisme ou nationalisme ?
En conclusion, toute idéologie et toute pratique politique qui veulent prendre en compte les racines du peuple, ses productions culturelles doivent :
- 1) tenir compte des lieux et du destin qu'ils imposent, ce qui implique une politique régionaliste fédérante à tous les échelons ; c'est là une logique fédérante
- 2) opérer un retour aux racines, par un travail archéologique et généalogique constant, de façon à pouvoir repérer les moments où ont été imposées des structures aliénantes, à comprendre les circonstances de cette anomalie et à en combattre les résidus ; c'est là une logique indigéniste ;
- 3) déconstruire les mécanismes aliénants introduits dans nos tissus sociaux au moment de la révolution industrielle (une relecture de Carlyle s'impose à ce niveau) et organiser les nouvelles jungles urbaines, ce qui signifie ré-enraciner les populations agglutinées dans les grandes métropoles ; c'est là une logique justicialiste et populiste ;
- 4) rassembler les peuples et les entités politiques de dimensions réduites au sein de grands espaces économiques semi-autarciques, dépassant l'étroitesse de l'État-Nation ; c'est une logique continentaliste ou « regnique » (reichisch) ;
- 5) rompre avec les nationalismes séculiers et laïques classiques, nés à l'époque des Lumières et véhiculant sa logique d'homogénéisation, éliminatrice de nombreux possibles (l'omologazzione de Pier Paolo Pasolini) ; rompre également avec les nationalismes qui se sont rebiffés contre les Lumières pour retomber dans le fantasme de la conversion forcée, dans un culturalisme passéiste conservateur et déréalisé.
Une idéologie politique est acceptable — qu'elle se donne ou non l'étiquette de « nationaliste » — si et seulement si :
- 1) elle se fonde sur une « culture » enracinée, impliquant une conscience historique et portée par une sorte de nouvelle « première fonction » (au sens dumézilien du terme) ;
- 2) si cette nouvelle « première fonction » est issue du fond-du-peuple (principe d'indigénat) ;
- 3) si elle donne accès à une représentation juste et complète à toutes les strates sociales ;
- 4) si elle organise une sécurité sociale et prévoit une allocation fixe garantie à chaque citoyen, ce qui n'est possible que si l'on limite sévèrement l'accès à la citoyenneté, laquelle doit désormais comprendre le droit à un pécule mensuel garanti, permettant une relative indépendance de tous (diminution de la dépendance du salariat, égalité des chances, accès possible au recylage professionnel ou à de nouvelles études, garantie de survie et d'indépendance de la mère au foyer, meilleures chances pour les enfants des familles nombreuses) ; comme la richesse nationale ou régionale n'est pas extensible à l'infini, les droits inhérents à la citoyenneté doivent rester limités à l'« indigénat » (selon certains principes institués en Suisse) ;
- 5) si elle organise l'affectation des richesses financières nées des prestations de l'indigénat dans le cadre de son « espace vital », de façon à renoncer à toutes formes de colonialisme ou de néo-colonialisme financier aliénant et à n'accepter, en matières de colonisation, que les « colonisations intérieures » (ère agronomique en France au XIXe s., assèchement des Polders aux Pays-Bas ou des marais pontins en Italie, colonisation des terres en friche du Brandebourg ou de Transylvanie par des communautés paysannes autonomes, mobilisation de toutes les énergies de la population sans recours à l'immigration comme au Japon) ;
- 6) si elle traque toutes les traces d'universalisme militant et homogénéisant, toujours susceptible de faire basculer les communautés humaines concrètes dans l'aliénation par irréalisme têtu : cette traque, objet d'une vigilance constante, permet l'envol d'une appréhension du monde réellement universelle, qui accepte le monde tel qu'il est : soit bigarré et kaléidoscopique.
Enfin, toute idéologie acceptable doit affronter et résoudre les grands problèmes de l'heure ; ce serait notamment aujourd'hui l'écologie. Le nationalisme classique, ou celui qui resurgit aujourd'hui, n'insiste pas assez sur les dimensions indigénistes, populistes-justicialistes et continentalistes. Il est dans ce sens anachronique et incapacitant. Il reste tiers-étatiste dans le sens où il n'est plus universel comme l'était la pensée de la caste souveraine des sociétés traditionnelles, ce qui explique qu'il est incapable de penser la dimension continentale ou l'idée de Regnum (Reich) et qu'il refuse de prendre en compte le fait du fond-du-peuple, propre des quart-état et quint-état. Le nationalisme risque d'occulter 2 dimensions : l'ouverture au monde et le charnel populaire. Il reste à mi-chemin entre les 2 sans pouvoir les englober dans une pensée qui va au-delà du simple positivisme.
► Robert Steuckers, Vouloir n°73-75, 1991.
♦ Pour faire le point : Les grandes théories du nationalisme, Antoine Roger, A. Colin, 2001, 224 p.
◘ Notes :
- 1) Olof Petersson, Die politischen Systeme Nordeuropas : Eine Einführung, Nomos, Baden-Baden, 1989.
- (2) Olof Petersson, op. cit.
- (3) Ernst Nolte, Die faschistischen Bewegungen, dtv 4004, München, 1966-71, pp. 212-226.
- (4) C.J.H. Hayes, Essays on Nationalism, New York, 1966 ; The Historical Evolution of Modern Nationalism, NY, 1968 (3ème éd.) ; Nationalism : A Religion, NY, 1960.
- (5) H. Kohn, The Age of Nationalism : The First Era of Global History, New York, 1962 ; The Idea of Nationalism : A Study in its Origin and Background, NY, 1948 (4ème éd.) ; Prophets and Peoples : Studies in 19th Century Nationalism, NY, 1952.
- (6) Th. Schieder, « Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaats in Europa », in Historische Zeitschrift, 202, 1966, pp. 58-81 (repris in : Heinrich August Winkler, Nationalismus, Athenäum/Hain, Königstein/Ts, 1978, pp. 119-137) ; Der Nationalstaat in Europa als historisches Phänomen, Köln, 1964.
- (7) Rudolf Kjellen, Die politischen Probleme des Weltkrieges, 1916.
- (8) Miroslav Hroch, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas, Prag, 1968 ; « Das Erwachen kleiner Nationen als Problem der komparativen Forschung », in H.A. Winkler, Nationalismus, op. cit., pp. 155-172.
- (9) Joseph F. Zacek, Palacky : The Historian as Scholar and Nationalist, Mouton, Den Haag/Paris, 1970.
- (10) Pedro Simón Martínez, « Penetración y explotación del imperialismo en la Cultura Latinoamericana », in Politica Internacional, n°19/1967, Instituto de politica internacional, La Habana/Cuba, pp. 252-255.
- (11) Christoph Steding, Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur, 1942 (3ème éd.).
- (12) Henri Gobard, L'aliénation linguistique : Analyse tétraglossique, Flammarion, 1976 ; La guerre culturelle : Logique du désastre, Copernic, Paris, 1979.

◘ L'universalisme de la différence
Le nationalisme, c'est l'égoïsme des peuples, José Antonio Primo de Rivera.
L'appartenance à une même patrie ou à une même terre sera remplacée par l'appartenance ou la non-appartenance à une même cause, Julius Evola
 Nationalisme et cosmopolitisme sont 2 doctrines qui obéissent à une logique de destruction des identités collectives. Il est donc temps d'opérer de grandes mutations idéologiques qui permettent d'entrevoir une nouvelle vision identitaire du monde (identitätsbewußte bzw. identitätsgeprägte Weltanschauung) : celle de l'universalisme de la différence.
Nationalisme et cosmopolitisme sont 2 doctrines qui obéissent à une logique de destruction des identités collectives. Il est donc temps d'opérer de grandes mutations idéologiques qui permettent d'entrevoir une nouvelle vision identitaire du monde (identitätsbewußte bzw. identitätsgeprägte Weltanschauung) : celle de l'universalisme de la différence.
Les intellectuels occidentaux ont parfaitement réussi leur opération de déstabilisation des esprits. Ils ont permis que se développe dans l'inconscient collectif l'idée selon laquelle le nationalisme et le cosmopolitisme étaient rigoureusement antagonistes. Or la réalité est beaucoup plus complexe. En effet, nationalisme et cosmopolitisme ne s'opposent pas systématiquement. Au contraire, ils communient tous 2 dans un même rejet du différencialisme relativiste et conduisent inéluctablement au totalitarisme de type ethnocentrique.
Le nationalisme est une idéologie du moi exacerbé. Système coagulateur d'intérêts particuliers, le nationalisme édicte comme vérité universelle la supériorité d'une appartenance identitaire individuelle. Dans sa logique hétérophobique, il rejette le droit à la différence et interdit aux identités populaires de se cristalliser dans un phénomène culturel global. D'essence bourgeoise, lé nationalisme se rattache à la période du déclin de l'unité œkuménique médiévale.
Bourgeoisisme et nationalisme apparaissent dans l'histoire comme indissolublement liés. Un penseur contre-révolutionnaire comme Joseph de Maistre est beaucoup plus le citoyen d'une idée (englobant un certain nombre de référents culturels et spirituels) que citoyen d'une nation. Le terme nationalisme ne sera récupéré par les contre-révolutionnaires qu'au début du XXe siècle avec l'école du nationalisme intégral d'Action française et son maître à penser, Charles Maurras.
Fidélité à l'idée
À propos du nationalisme, Julius Evola écrit, dans Chevaucher le tigre : « le propre de l'idéologie nationaliste, c'est de considérer la patrie et la nation comme des valeurs suprêmes, de les concevoir comme des entités mystiques presque dotées d'une vie propre et ayant un droit absolu sur l'individu alors que celles-ci ne sont que des réalités dissociées et informes, en ce qu'elles nient tout véritable principe hiérarchique et tout symbole ou marque d'une autorité transcendante ». Il est donc faux de prétendre qu'il y a un lien de parenté ou une connivence entre le nationalisme et la droite historique.
Le cosmopolitisme, quant à lui, aboutit au brassage des cultures. Les individus s'agrègent à des groupes socio-humains indifférenciés qui se caractérisent par leur interchangeabilité. L'individu n'est plus porteur d'une culture propre qui le distingue des autres. Il est devenu un simple numéro. Le dialogue interculturel disparaît au profit d'une uniformisation de masse. Niant le fait mésologique, le cosmopolitisme conduit à la mixophilie communautaire. C'est alors que naît le racisme et la xénophobie. Le cosmopolitisme engendre donc paradoxalement le racisme xénophobe. La société multiraciale devient une société multiraciste. Dans les Nouveaux enjeux idéologiques (Labyrinthe, 1985), Guillaume Faye affirme : « Le racisme est du côté de ceux qui dévalorisent l'identité ethnique, entendue au sens le plus riche, c'est-à-dire bio-culturel, au profit de fausses appartenances, d'identifications déculturantes et primitives à des modèles strictement politiques ("démocratie occidentale", culture des droits de l'homme, etc.) ».
L'antithèse ne se situe pas entre nationalisme et cosmopolitisme, mais bien entre ethnocentrisme et différencialisme relativiste. C'est ce que démontre inconsciemment et de façon contradictoire Alain Finkielkraut dans son livre La défaite de la pensée (1987, Gal.) : « l'ethnocentrisme conduit à un arbitraire culturel qui s'arroge le monopole de la légitimité, dévalorise les modes de pensée, les savoir-faire et les arts de vivre qui ne sont pas les siens et les rejette dans les ténèbres de la sauvagerie et de l'ignorance ».
L'opposition différencialisme relativiste/ monoculturisme trouve un relief particulier au XVIIIe siècle. Finkielkraut rappelle qu'en 1774, en Allemagne, le philosophe romantique Herder prend la défense du concept de Volksgeist (génie national) dans son livre Pour une autre philosophie de l'histoire. Selon Herder, l'optimisme rationaliste de Voltaire reflète l'arrogance de sa nation. Ce qui le conduit à croire à la supériorité de son pays (la France) et de son temps (le siècle des Lumières) ».
À la plaidoirie autodifférentielle (affirmation de sa propre identité) d'Herder succède la critique hétérodifférentielle (affirmation de la différence de l'autre) des anticolonialistes.
C'est ainsi qu'en 1951, dans Race et histoire, Claude Lévi-Strauss vilipende la pseudo-mission civilisatrice de l'Occident qui vise à convertir les « peuples barbares » à la dictature de l'intérêt, au primat du rendement, aux lois du marché... « Le barbare, ce n'est pas le négatif du civilisé, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie » affirme Lévi-Strauss.
Sur cet impérialisme occidental qui détruit le ciment communautaire et culturel des sociétés traditionnelles, Finkielkraut poursuit : « Quand les peuples européens ne méprisaient pas ces peuples pour leur arriération, ils en faisaient de bons sauvages. C'était de toute façon les dépouiller de leurs caractères originaux et se servir d'eux, en les investissant d'une fonction mythique pour naturaliser la culture occidentale. Il ne suffit pas d'octroyer l'indépendance aux peuples assujettis, il faut encore prononcer l'équivalence des cultures ».
Ce souci de préservation des cultures différenciées, on le retrouve dans le rapport remis au président de la république française par le Collège de France, en 1985. Ce rapport, qui porte le nom de Propositions pour l'enseignement de l'avenir, indique la nécessité d'un relativisme culturel qui doit être enseigné dès le plus jeune âge à l'école : « Un enseignement harmonieux doit pouvoir concilier l'universalisme inhérent à la pensée scientifique et le relativisme qu'enseignent les sciences humaines attentives à la pluralité des modes de vie, des sagesses, des sensibilités culturelles ».
Contre le nationalisme étriqué et le déracinement planétaire, il convient d'adopter une ligne idéologique radicale, celle des négations absolues et des affirmations souveraines pour reprendre les fameuses expressions de Donoso Cortès, qui défende avec acharnement les spécificités culturelles des peuples à travers le monde.
Nous devons opposer à l'unilinéarité déracinante ce que Carl Schmitt appelle le pluriversum, c'est-à-dire la prise en compte de l'existence de plusieurs univers culturels, ethniques et religieux.
Dans son livre La force du préjugé (La Découverte, 1988), Pierre-André Taguieff affirme que cette absolutisation des différences aboutit à ce qu'il nomme un « racisme différentialiste ». Or Taguieff utilise pour une telle caractérisation une définition abusive et par trop extensive du racisme. Cette volonté délibérée d'étendre et de démocratiser à l'excès l'usage du terme « racisme » correspond à un choix subjectif qui porte préjudice aux travaux par ailleurs fort sérieux du sociologue.
Notre position ne compose aucune ambiguïté. Nous rejetons en bloc la standardisation culturophobique de masse, que celle-ci soit d'essence nationale-raciste ou antiraciste cosmopolite.
Nous sommes résolument ethnopluralistes et non racistes différencialistes et autres expressions fantasmagoriques. L'universalisme de la différence s'oppose catégoriquement aux idéologies provoquant des morts identitaires que constituent d'un côté l'universalisme de type marxiste et de l'autre côté l'universalisme de type libéral.
Le particularisme nationaliste et le cosmopolitisme massifiant doivent s'effacer et laisser place à une nouvelle perspective destinale qui comprenne la nécessité de la diversité. Comme l'affirme Jean Baudrillard : « L'autre est ce qui permet de ne pas me répéter à l'infini ».
► Arnaud DUBREUIL, Vouloir n°73/75, 1991.

◘ Le joujou nationalisme
Le joujou nationalisme — Autopsie d'un phantasme anachronique
La nation est « la réunion d'hommes habitant un même territoire, soumis ou non à un même gouvernement, ayant depuis longtemps des intérêts assez communs pour qu'on les regarde comme appartenant à la même race » : voilà l'idée de Littré et on lui fait crédit. Quant au « nationalisme », qui relève du mirage sémantique (et on sait comme il faut se méfier des néologismes), on le supposera l'exaltation, la défense et l'illustration de la communauté de territoire, d'intérêts et d'histoire, supra définie.
Bien. Mais si la nation est un état, cette réunion sans épithète, donc sans question d'hommes réciproquement intéressés à demeurer ensemble, pourquoi donc l'exalter ? Prêche-t-on la respiration aux vivants ? Ou ses incendies au soleil ? Non sans doute... Ah ! Mais c'est oublier les Ennemis de la Nation ! Et le grand mot est jeté, dévoilé le très actif péril des naufrageurs étrangers aux intérêts nationaux et qu'il faut réduire. L'argument fait recette en temps de guerre (contre une autre nation qui naturellement obéit au même principe « nationaliste »), ou quand l'État qui gouverne à la prétendue nation n'en émane pas expressément... En revanche, sous le meilleur des régimes (démocratique comme chacun sait) et dans le meilleur des mondes possible qu'il détermine nécessairement, on ne voit plus d'où pourrait venir le danger..., sinon de la nation elle-même qui, par incroyable aveuglement et très inédite non-conformité se résoudrait au pire. L'hypothèse contredit le postulat, on n'imagine pas une communauté d'intérêts qui se réunirait contre les intérêts mêmes qui la fondent. Les nations ne se suicident pas, dont la sagesse proclame que ce qui tue ne peut être identique à ce qui est tué. Coexistaient donc des intérêts contraires : la nation était morte déjà, ce qu'il fallait démontrer.
C'est trop triste : parvenus à ce degré de lucidité, les nationalistes font une pirouette et cherchent à ranimer le cadavre. Là encore, ils cafouillent parmi les fantômes : les uns font le bouche-à-bouche à Martel ou à Capet, d'autres à Jeanne (qui pourtant mange de l'ail), certains à quelque Louis, d'autres encore à l'Empereur, au Maréchal ou au Général... : la plupart soufflent à tous les râteliers, tous y aspirent l'âme d'une « France éternelle » à ressusciter, Lazare national étrangement attifé selon les canons impressionnistes d'un éclectisme saugrenu... Mais l'Histoire ne repasse pas les plats ; les contradictoires mots d'ordre des surréalistes prosopopées (fameux discours aux morts qui glissent en discours des morts*) invoquent en acousmie des voix qui se sont tues, évoquent en mirage un auditoire d'avant la Chute.
Tout est dit : du passage d'une liberté de participation, celle de la démocratie athénienne ou de la monarchie très-chrétienne, dont l'exercice collectif (politique ou religieux) fondait une race de citoyens ou de croyants, une nation selon Littré, à l'absurdité triomphale de la liberté-autonomie, de pratique strictement individuelle et prométhéenne, incompatible avec l'intérêt commun renié donc contraire à toute tradition nationale, le bel Occident est entré en irréversible décadence... Comme on doit au stupide XIXe siècle le deuil ignoble des communions d'antan, la postérité nous devra celui des ultimes vigueurs de la chimère nationaliste dont elle stigmatisera l'invraisemblable maladresse au long de nos charniers cosmopolites et de nos enthousiasmes brouillons... Danton, Péguy, jusqu'à l'Internationale prosélyte, tout s'efface. Les Chinois sont annoncés à Cognac.
Restent le mythe crevé d'une race guerrière, la rhétorique grotesque d'une réaction anachronique, le bavardage et la confusion d'une peuple anémié... Restent le folklore et la psychologie des foules : ce Front national qui n'est, à bien entendre Littré, que la nation du Front, un joujou dilatoire pour le divertissement des agonies fétichistes.
Les peuples aussi doivent apprendre à mourir.
► Pierre Chalmin (22 novembre 1990), Vouloir n°73/75, 1991.
(*) Prosopopées de Fabricius par Rousseau, de Jean Moulin par Malraux ou de Jeanne d’Arc par Jean-Marie Le Pen.

◘ Un regard indien sur le fait “nationalisme”
♦ Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World : A Derivative Discourse ?, ZED Books, London, 1986, 181 p.
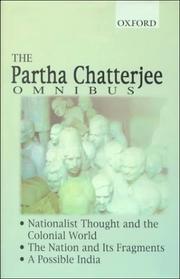 Le Professeur Partha Chatterjee, formé aux États-Unis, a enseigné dans bon nombre d'universités dont celles de Rochester et d'Amritsar. Auteur de plusieurs livres de sciences politiques, il enseigne aujourd'hui ces matières à Calcutta, dans son pays. Armé d'une bonne connaissance des théories occidentales du nationalisme, Partha Chatterjee critique le regard que portent les Occidentaux, tant les libéraux que les marxistes, sur les nationalismes du tiers-monde. Chatterjee démontre comment les théoriciens occidentaux, en mettant l'accent sur le pouvoir de la raison, le primat des sciences exactes et de la méthode empirique, ont déclaré leurs présupposés universellement valables. Par le biais des systèmes d'éducation, monopoles de l'Occident, les conceptions occidentales du nationalisme se sont imposées aux peuples non-occidentaux, au détriment de conceptions autochtones. Cette oblitération a parfois été si totale qu'elle a détruit les ressorts de toute autochtonité. L'objet du livre de Partha Chatterjee est d'explorer la contradiction majeure qui a fragilisé les nationalismes africains et asiatiques. Ceux-ci ont voulu s'affranchir de la domination européenne tout en restant prisonniers du discours rationaliste issu de l'Europe des Lumières.
Le Professeur Partha Chatterjee, formé aux États-Unis, a enseigné dans bon nombre d'universités dont celles de Rochester et d'Amritsar. Auteur de plusieurs livres de sciences politiques, il enseigne aujourd'hui ces matières à Calcutta, dans son pays. Armé d'une bonne connaissance des théories occidentales du nationalisme, Partha Chatterjee critique le regard que portent les Occidentaux, tant les libéraux que les marxistes, sur les nationalismes du tiers-monde. Chatterjee démontre comment les théoriciens occidentaux, en mettant l'accent sur le pouvoir de la raison, le primat des sciences exactes et de la méthode empirique, ont déclaré leurs présupposés universellement valables. Par le biais des systèmes d'éducation, monopoles de l'Occident, les conceptions occidentales du nationalisme se sont imposées aux peuples non-occidentaux, au détriment de conceptions autochtones. Cette oblitération a parfois été si totale qu'elle a détruit les ressorts de toute autochtonité. L'objet du livre de Partha Chatterjee est d'explorer la contradiction majeure qui a fragilisé les nationalismes africains et asiatiques. Ceux-ci ont voulu s'affranchir de la domination européenne tout en restant prisonniers du discours rationaliste issu de l'Europe des Lumières.
Traitant du cas indien, le Professeur Chatterjee montre à ses lecteurs quelles ont été les évolutions du nationalisme indien au départ de la matrice moderne que lui avait légué le colonialisme. Il met essentiellement 3 étapes principales en évidence : la pensée de Bankimchandra, la stratégie de Gandhi et la « révolution passive » de Nehru. Malgré la volonté indienne de rompre, le plus complètement possible, avec le discours occidental imposé par les Britanniques, le nationalisme du sub-continent n'a pas réussi à se dégager réellement d'un pouvoir structuré par des idéologèmes qu'il cherchait pourtant à répudier. Résultat de cet échec : les nationalismes du tiers-monde se sont vite mué en de purs instruments de domination, manipulés par des classes dominantes cherchant à préserver voire à légitimer leur propre pouvoir. Ces classes s'appropriaient les fruits de la vitalité nationale pour pouvoir se propulser sur la voie de la « modernisation universelle ». Mais cette volonté, parfois inconsciente, de rationaliser à outrance, d'entrer dans le jeu de la concurrence internationale, s'accompagnait d'une négligence, tragique et dangereuse, de larges pans de la réalité nationale. L'appareil d'État, belle mécanique importée se voulant universelle donc délocalisée, se trouvait dans l'incapacité d'intégrer les diversités du tissu local ou, pire, se retournait contre elles, les accusant de freiner l'élan vers le progrès ou d'être des reliquats incapacitants. De ce fait, tout nationalisme étatique d'essence moderne/occidentale apparaît aux yeux des peuples du tiers-monde comme un appareil oppresseur et négateur de leur identité. Ce questionnement, explicité par Chatterjee, peut être transposé en Europe même, où les principes des Lumières ont également oblitéré des réalités sociales beaucoup plus complexes, trop complexes pour être appréhendées dans toute leur complétude par les simplifications rationalistes. La démonstration de Chatterjee débouche sur une théorie diversifiée du nationalisme : est nationalisme négatif, tout nationalisme issu d'une matrice « illuministe » ; est nationalisme positif, tout nationalisme issu d'un fond immémorial, antérieur au colonialisme et aux Lumières. Le destin des peuples doit jaillir de leurs fonds propres et suivre une voie propre, en dépit de tous critères quantitativistes.
► Robert Steuckers, Vouloir n°73-75, 1991.

La Vengeance des nations (à propos du dernier livre d'Alain Minc)
♦ La Vengeance des nations, Alain Minc, Grasset, 1990, 273 p.
Dans cet ouvrage, Alain Minc part du postulat que la fin du XXe, le début du XXIe siècle, sont et seront marqués par le retour de l'idée de nation. Un renouveau engendré par le double choc de la nouvelle instabilité mondiale, née de la mort eu communisme, et de la résurgence des réflexes identitaires, dont la France avec le Front national, et l'Allemagne, avec le mouvement des Verts, montrent la préfiguration. Minc craint que cette renaissance des nations, du nationalisme, fasse apparaître des tensions, des conflits, sources d'affrontements intenses. Mais il pense également que ce retour de l'Histoire, riche de crises, obligera la France à se débarrasser de ses pesanteurs de société, de son arthrite de la pensée. Face au renouveau du concept de nation, la France doit revoir sa place sur l'échiquier mondial et européen et restaurer le politique, en l'incarnant dans une vision moderne et forte de l'État, sur la base de la raison et du droit. Une analyse utopique pour les tenants de la politique gaullienne.
L'effondrement du bloc communiste aura libéré des forces jusqu'alors endormies à l'Est de l'Europe, celles de la nation. La société communiste en se coupant du reste du monde, en s'isolant du « village mondial » (Marshall Mc Luhan) a préservé coutumes, traditions, en un mot les différences, qui permettent aujourd'hui au sentiment national de s'exalter. « Qui oserait affirmer que, dans les cinq ans à venir, les Hongrois ne se battront pas avec les Roumains, les Bulgares avec les Grecs et, plus vite encore, les Serbes avec les Croates ? » (La Vengeance des nations, p. 12). Ce réveil des nationalismes à l'Est est d'autant plus important qu'il se joue en parallèle de l'évolution de l'Allemagne et du Japon, retrouvant aussi le sentiment de l'identité. Ces 2 pays, privés du nationalisme par leur défaite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cherchent à dépasser leur actuel statut de géant économique mais de nain politique, pour devenir des grandes puissances à part entière.
Cette quête de la nation se révèle décisive car le Japon et l'Allemagne, loin d'être à l'image des États de l'Europe de l'Est une sous-Amérique latine, détiennent les clés de l'hypermodernité. « Daniel Bell, voit le XXIe siècle commencer sous le règne de la religion et des races, comme le vingtième a vécu sous l'emprise de l'idéologie et des classes » (p. 27). Triomphant dans les pays baltes, sous-jacent à Tokyo ou Berlin, le nationalisme ne tient pas du phénomène localement circonscrit. L'effondrement du rideau de fer pourrait avoir pour imprévisible conséquence une osmose des nationalismes entre Est et Ouest. Ce que résume A. Minc : « (...) l'air du temps ne sera pas le même qu'aujourd'hui à Paris, Francfort ou Londres lorsque le populisme catholique règnera à Varsovie, que les réminiscences slaves auront repris le dessus à Moscou (...) » (p. 18).
Ce retour de la nation s'accompagne en Occident, d'une exception française. Si l'Allemagne connaît un refoulé de ses tendances au nationalisme, la France exalte son penchant pour le réflexe identitaire. Depuis près de 10 ans, Jean-Marie Le Pen oscille entre 10 et 20 % des voix. A. Minc estime que l'extrême-droite française est partie à la conquête du pouvoir. « À cette déviance, la question nationale sert d'alibi et de levier » (p. 21). L'ascension du Front national est à mettre en parallèle avec l'engouement que rencontrent les thèmes écologistes. L'écologie présente plusieurs facettes et le ton badin et mineur adopté par Antoine Waechter dissimule d'étranges confluences de l'Histoire. « Assonance avec des réflexes, des modes de pensées qui commencent par "la terre, qui, elle, ne ment pas", continuent avec le refus de la contraception et de l'avortement contraires aux exigences de la nature et se terminent par la vision d'un société hiérarchisée : entre hommes et femmes, entre citoyens nationaux et étrangers » (p. 38).
Cette symbiose entre réaction et écologie, autour de la négation de l'idée de progrès, trouve son illustration chez les Grünen, ses écologistes d'Outre-Rhin. De l'exaltation des forêts comme refuge de l'âme allemande par les romantiques, aux manifestations contre les pluies acides, il est selon A. Minc des apparentements terribles qui ne trompent pas. Est-ce à dire que du refus des émigrés à la défense des vertes campagnes, la voie de l'extrême droite est tracée vers le pouvoir ? Ce serait, considère l'auteur de La Vengeance des nations, surestimer la force des propositions du courant nationaliste. L'extrêmedroite a des réflexes, elle n'a pas de pensée.
D'après lui, le corpus doctrinal du FN s'apparente à une codification du rejet, rien de plus. Haine de la gauche, de l'« établissement », de l'évolution des mœurs. Cris d'orfraies poussés sous la statue du Christ-Roi et dans les replis du drapeau français. Minc pêche là par méconnaissance du discours du FN, qu'il réduit à ses propres phantasmes de l'extrême-droite. En réalisant la synthèse entre cadres issus de la ND ou influencés par elle (Vial, Mégret, Bariller), nationaux-libéraux du Club de l'Horloge (Blet, Le Gallou), catholiques traditionalistes (le courant Présent, la clientèle de Mgr Lefèbvre), les populistes (National-Hebdo, Marie-France Stirbois), le FN propose un discours maintenant à la fois solide et original. Il demeure certes des faiblesses et contradictions et notamment l'absence d'uns synthèse entre la rationalité politique gaullienne et la soif d'identité. L'analyse la plus pertinente qui a été faite du FN est parue dans le numéro 52/53 (février-mars 1989) de Vouloir sous la plume de Robert Steuckers et le titre de : « Il faut instruire le procès des droites ». On s'y reportera pour une bonne compréhension de la problématique « Front national », que quelques membres influents du FN, prisonniers de vieilles idées révolues, n'ont pas trouvé fort à leur goût...
Le surgissement de l'identité des peuples n'implique pas de toute façon selon Minc cette caricature de nationalisme. Si la nation revient à la fois sous la pression du monde extérieur et sous la poussée interne, et que derrière elle, se profile à nouveau l'État, il demeure possible de redécouvrir l'une et de réinventer l'autre. C'est là en tout cas selon Minc le moyen de dompter l'Histoire, non de la subir. Redécouvrir la nation représente d'abord pour la France l'obligation de redéfinir sa place dans le concert international. Le fait de se croire une grande puissance, continuation des rêves gaulliens, appartient désormais aux tics de la pensée que dénoncent BH Lévy dans La Règle du jeu (n°2). La France n'infère plus sur les variations géopolitiques. Volontiers cocardière, elle ne dispose pas des ressources de l'Allemagne et du Japon, frileuse et somme toute stable (un des bons élèves du SME), elle ne peut faire trembler en s'agitant tel un baril de poudre, à l'image des pays du Tiers-monde. La puissance de la France résidait en fait dans l'héritage de Yalta. Le condominium russo-américain lui offrait le rôle d'héraut d'une « Troisième Voie », seul au sein de l'OCDE et de l'OTAN à affirmer sa différence. Gage d'une amitié avec le monde arabe, l'Afrique noire ou les défavorisés du Sud, avides d'entendre « la mano en la mano ».
Le champ d'action de la France s'est rétréci, il n'a pas disparu, affirme A. Minc. À nous de ne pas nous illusionner, de croire par ex. que la construction européenne forme la panacée de nos problèmes. Le Grand Marché se révèle fumeux car ne répondant pas à des frontières, des limites précises. « C'est une des conditions pour faire d'une zone de libre-échange une entité homogène : l'Allemagne bismarckienne nous le rappelle » (p. 77). Chacun sait à Bruxelles que la Commission européenne que préside Jacques Delors n'a plus la possibilité de fixer des frontières monétaires ou budgétaires. Pour A. Minc, l'irruption des pays de l'Est dans les mécanismes de l'économie dé marché du continent européen, rend obsolète la CEE. D'ores et déjà de facto élargie à des pans des sociétés soviétique, polonaise ou hongroise, elle voit son centre de gravité, entraîné par l'Allemagne réunifiée, se déplacer.
La chance de la France est de le comprendre et de créer une politique étrangère « polygame ». À savoir maintenir des relations avec l'Allemagne, locomotive économique du continent, et tisser des liens avec l'Europe du Sud au nom de la latinité. Renouer avec l'entente anglaise, ce qui équivaut à un retour à l'amitié Londres-Paris, chère à Delcassé avant la Première Guerre mondiale. Enfin, se porter à l'avant des États-Unis ou plutôt à l'arrière puisqu'il s'agirait de les retenir par la manche pour les empêcher de se retirer en un protectionnisme ombrageux.
La richesse de l'analyse n'empêche que certains aspects de ces prospectives de politique étrangère sont difficilement acceptables pour les tenants des principes gaulliens. La France devrait se résoudre à l'abandon de son rôle d'avocat des plus faibles, de trublion de l'ordre mondial ? Voire. La mort de la confrontation des blocs substitue à l'injuste affrontement Est/Ouest, un nouvel équilibre planétaire tout aussi arbitraire, fait de la rivalité du Nord riche et du Sud pauvre. Entre les 2, la France peut exprimer sa différence. Comme le dirait Michel Jobert, profiter de son sentiment d'être « ailleurs », pour rapprocher les antagonistes.
Contrairement à ce que laisse présager l'engagement sans condition des Français dans la guerre du Golfe, l'Hexagone en usant de son héritage d'amitiés précieuses (monde arabe, francophonie, Afrique noire) dispose virtuellement d'une politique extérieure novatrice et dynamique. Encore faut-il en avoir la volonté. A. Minc a raison d'insister sur le caractère multiple que devraient recouvrir les liaisons diplomatiques de la France. Les impératifs de notre situation géopolitique nous commande d'être à la fois tournés vers le Sud et l'Allemagne, de nous poser en puissance maritime et continentale. Croire à des liens diversifiés n'autorise cependant pas à envisager n'importe quel type de relations.
Les précédents des années 1900 (Triple-Entente contre Triple Alliance), le rejet gaulliste de la Grande-Bretagne, jugée « porte-avion des États-Unis », au profit de la main tendue à l'Allemagne (1963, refus de la candidature anglaise au Marché commun par opposition au traité de coopération France-Allemagne signé la même année), démontrent que la France doit faire un choix entre Londres ou Berlin. Les géopoliticiens (Haushofer, Mackinder, Mahan) énoncent que l'on ne peut être de la même façon l'allié d'une puissance maritime et d'un État continental. Quant à retenir les Américains sur le sol de l'Europe, A. Minc est bien en peine d'en expliciter le gain politique. Au contraire, la décision gaullienne de sortir du commandement intégré de l'OTAN en 1966, permet de penser que le départ des GI's, placé sous le signe de la fin de l'OTAN, alliance militaire devenue superflue avec la faillite du Pacte de Varsovie, obligerait l'Europe à prendre sa défense en main. Un premier pas pour une véritable construction européenne.
A. Minc ne se contente pas, à l'aune de la revanche des nations, d'émettre des propositions en politique étrangère, il croit également en une prochaine renaissance de l'État. Jusqu'à maintenant, la société française tend à imiter le modèle américain. L'État est éclipsé. Son rôle est contesté en économie où les libéraux l'accusent de freiner le libre exercice des lois du marché. Déconsidéré, attaqué, il ne séduit plus les élites. Normaliens, énarques, préfèrent le privé au service public. Autre symptôme, le renforcement du droit qui prime la loi, comme l'illustre la place accordée au Conseil constitutionnel. Ensuite, le poids de l'opinion publique, puisque tout n'est que sondage. Enfin, l'éclatement de la société sous le poids des lobbies et groupes d'intérêts. Parallèlement, Minc fustige les blocages de l'Hexagone. Les partenaires sociaux (syndicats, patronat) sont peu représentatifs, leurs initiatives faibles. Les partis politiques sont déconsidérés. Le pouvoir absolu du Président de la République assure la stabilité mais inhibe la réflexion.
Heureusement, la résurrection du politique va bouleverser la donne. « Avec une Histoire à nouveau en mouvement, les hommes d'État reviennent au centre de la toile » (p. 243). Il ne s'agit pourtant pas selon Minc de recourir à l'homme providentiel. Derrière de Gaulle se profile Boulanger, remarque-t-il. Les politiques doivent exercer leur action dans un cadre précis, celui de l'État. Le nouvel État-nation est à inventer. Pour ce dernier, Minc rêve des vêtements de la modernité, non de ce qu'il considère comme les oripeaux de Gambetta et Ferry. Il s'oppose à la mystique républicaine d'un Régis Debray, qui s'appuye sur les principes d'égalité et sur la « vieille trinité » : un même État, un même citoyen, une même nation. Minc ne croit pas en l'État républicain mais en l'État démocrate. Le fondement de ce dernier s'enracinerait dans le droit. II s'irriguerait par la morale, sous la direction éclairée de la raison. La possibilité de saisie du Conseil constitutionnel par chaque citoyen rendrait opérante et surtout pratique cette réforme.
À la lumière du droit et par l'action de la justice, préférée à la lourde administration, les problèmes délicats de société, audiovisuel, libertés et informatique, éthique de la fécondation in vitro, immigration, seraient examinés sans agressivité et avec circonspection. A. Minc pose ce modèle d'État différent, l'État juge, à l'opposé de l'État-aiguillage de Rocard, ce Premier ministre qui « se réclame de l'acupuncture comme doctrine d'action » (p. 260). L'auteur de La Vengeance des nations refuse l'État tuteur et interventionniste mais espère un État opérant. Un État-nation du troisième type, ouvert et intégrateur, susceptible de faire coexister une aspiration collective à l'identité, les contraintes d'un univers stratégique complexe et la préservation de ce qui demeure d'internationalisme : les lois inévitables du marché.
Face au retour du fait national, que Minc pense dans sa conclusion comme un véritable danger, cet État idéal s'axerait surtout sur une citoyenneté plus ouverte, selon le modèle britannique de la british citizenship, stade intermédiaire entre la citoyenneté britannique pure et simple et le statut d'immigré, et conférant le droit de vote. Il veillerait également à l'intégration (pris au sens d'insertion de tous les exclus) par la réussite matérielle, en développant les aides spécifiques comme le RMI [actuel RSA] et en brisant l'échec scolaire. Guidé par la raison, l'État-nation de Minc ferait coexister heureusement un monde de plus en plus ouvert en matière économique, sociale et culturelle ; une identité nationale en pleine résurrection.
Cette analyse va à l'encontre des presupposés de la tradition politique d'inspiration « gaullienne ». Premier heurt, elle est aussi irréaliste que le gaullisme tient, ainsi que le rappelait Michel Debré, du pragmatisme. Le recours à la raison vient sans doute de la formation kantienne de Minc. Se draper dans la philosophie du penseur de Königsberg amène à la question des fondements de cette pure raison. Comme l'écrit A. de Benoist dans Krisis (n°6) : « Adversaire du moralisme kantien, Hegel, dans sa Phénoménologie de l'esprit (1807), n'a pas eu de mal à montrer que la philosophie de Kant se ramène à un formalisme abstrait, incapable en tant que tel de donner naissance à une véritable doctrine immanente des devoirs ». Il n'existe en fait nulle personne capable d'agir par « pur devoir » en dehors de toute référence au contexte de son action.
Le général de Gaulle, qui n'était pas dénué de formation philosophique, avait compris l'inanité de constructions aussi fumeuses et préférait comme ciment de l'État la « légende de la République », que Malraux clame en son discours de l'Hôtel de ville du 14 juillet 1958. Minc critique Régis Debray. Il devrait plutôt relire son Que vive la République (Odile Jacob, 1989), parfaite démonstration que le modèle d'État reposant sur le droit, les États-Unis, est tellement lié à des présupposés religieux et historiques que le copier est une erreur.
Deuxième obstacle, l'État rêvé par A. Minc non seulement ne dispose pas de fondements, mais ses éventuelles actions sont chimères. En qui concerne l'identité, menace interne du fait national, une citoyenneté élargie à la britannique néglige l'influence en France de la conception allemande du droit du sang, très restrictif. Le droit de vote pour les immigrés, loin de signifier l'intégration, pousserait à l'exacerbation des passions. Rien ne sert non plus d'exalter l'importance du politique et de prôner la saisie du Conseil constitutionnel, véritable frein aux décisions des pouvoirs, menace virtuelle d'un enlisement procédurier de toute initiative des collectivités publiques.
Pour parodier une phrase célèbre de Laurent Fabius, Minc pose de bonnes questions mais apporte de fausses réponses. À sa conclusion utopique d'un Etat-nation basé sur la raison, on préférera le choix gaullien de l'État républicain, revisité par la modernité du référendum, de la participation et d'une politique étrangère différente. Charles de Gaulle a posé les jalons d'un mariage de la tradition de Jules Ferry et des impératifs d'une société en mouvement. À l'irréalisme d'Alain Minc répond en écho cette citation du général de Gaulle : « La politique de la France s'inspire autant que possible de sens pratique et, tranchons le mot, de modestie. Elle cherche à réaliser ce qui paraît et ce qui est à sa portée » (conférence de presse, 15 mai 1962).
► Hughes Rondeau, Vouloir n°73-75, 1991.

