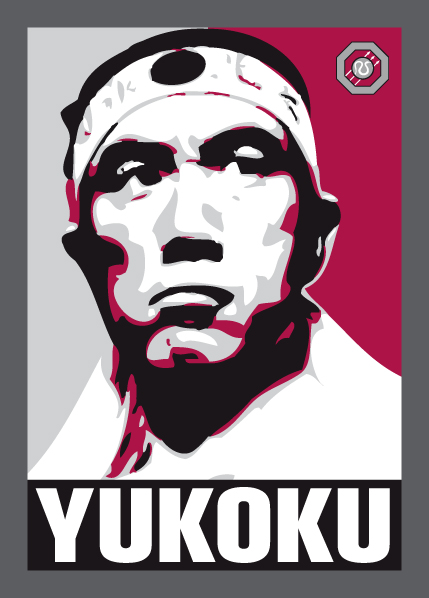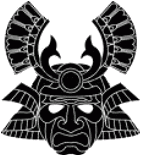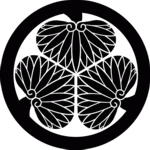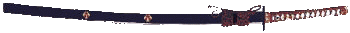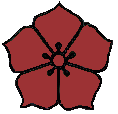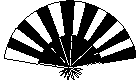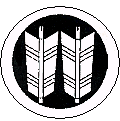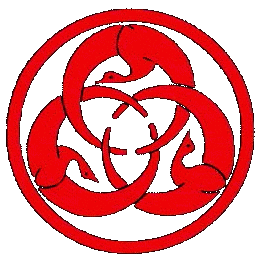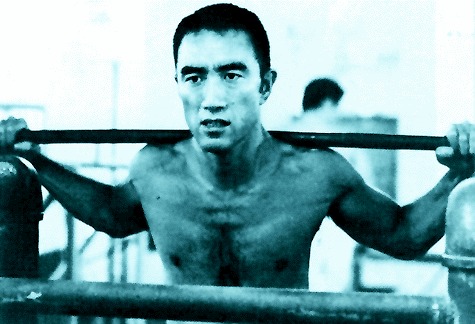Mishima
◘ Yukio Mishima : « Seul l'invisible est japonais »
C'était la fin d'un après-midi ensoleillé de décembre 1968. Nous venions, avec une équipe de l'ORTF d'achever une longue interview de Mishima. Sur la terrasse, face à l'infini moutonnement des toits, Mishima Yukio posait pour les dernières photos. J'observais les lignes de son visage parfaitement dessiné, aussi net et défini qu'il apparaissait dans chacun de ses gestes et de ses propos. J'avais devant moi un homme calme, posé, et même grave. Où était donc l'image extravagante de l'homosexuel excentrique qui se faisait photographier nu, percé de flèches, en saint Sébastien ? Et le “militaire”, en costume seyant, chef d'une milice privée qui faisait le bonheur des médias ? Il était tout simplement un écrivain de grand talent déjà mondialement connu qui venait de renoncer discrètement au prix Nobel de littérature en faveur de son vieil ami et concitoyen Kawabata Yasunari. Il me présenta avec une parfaite courtoisie son épouse, une gentille et élégante petite dame, et ses deux filles. Enfin, il me fit visiter sa maison.
Elle était située à près d'une heure du centre de Tôkyô et détonnait curieusement dans ces faubourgs banals à souhait. Dans le jardin qui lui faisait face, il avait placé, au centre d'un zodiaque de marbre, une statue d'Orphée tenant dans sa main gauche une lyre. La maison elle-même, avec de hautes portes-fenêtres, balustrades blanches, amphores, palmiers nains, terrasses, ressemblait à une villa spacieuse et confortable de la Côte d'Azur. Le rez-de-chaussée était, raffinement et luxe extrêmes au Japon, meublé en style du XVIIIe siècle français, au contraire du premier étage, qui, large et spacieux, était d'un style ultra-moderne.
Je m'étonnais un peu de ce décor appartenant à un personnage entre tous renommé pour symboliser dans ses contrastes mêmes les vertus de l'âme japonaise.
« Comment expliquez-vous, dis-je, que dans toute votre maison il n'y ait rien de japonais ? »
Mishima Yukio sourit.
« Ici, dit-il, seul l'invisible est japonais. »
Je ne crois pas avoir encore trouvé à ce jour un mot et un trait si pertinents décrivant si opportunément l'âme même du Japon. « Seul l'invisible est japonais. » Quand on a connu tant soit peu ce pays unique en tous genres au monde, cette pensée revient sans cesse, comme une vibration continue qui investit aussi bien l'histoire, la stratégie, l'économie, la poésie, la religion, l'art et la politique. Le secret réside en ceci : ce qui n'est ni dit, ni exprimé, ni écrit est la véritable force, la vraie source secrète de l'énergie subtile qui traverse tout et vient à bout de toutes choses. C'est sans doute pourquoi, aussi, les amoureux ne prononcent jamais, au Japon, le mot si commun en Occident : le fameux “je t'aime”. Certes, le mot “aimer” existe dans le dictionnaire. C'est aishitemasu. Mais le prononcer est plus qu'une incongruité, cela s'apparente à un acte impudique, sinon obscène. Si deux êtres s'aiment, ils n'ont pas besoin d'un mot pour se le dire, toute la tension de l'être, du regard, le frôlement des mains et les dix mille riens de l'amour sont le langage qui suffit, à la fois universel, personnel et éloquent.
Nous savons que les mots sont pauvres quand ils veulent exprimer la nature du réel. Les Japonais utilisent fréquemment des mots-concepts. Leur définition traduit une réalité complexe, un “état des choses”, un “état de l'être” ou encore un “état de la réalité subtile”.
Comme ces mots-concepts, le sens de l'efficacité japonaise se révèle et se dérobe à la fois quand on le cherche. Les occidentaux regardent avec étonnement ce pays qui leur ressemble apparemment comme un frère, bien qu'à force d'extrême ressemblance ce frère soit transparent et inaccessible. Aucun autre pays n'incarne peut-être aussi puissamment l'image ultra-sophistiquée de la science et de la technologie conquérantes. Les USA eux-mêmes sont souvent dépassés sur leur propre terrain. Quand on pense futur, c'est le mot “nippon” qui apparaît. Et pourtant, malgré les fantastiques bouleversements qui s'opèrent devant l'invasion omniprésente de cette hypertechnologie, le fond immuable et traditionnel du Japon n'a pas changé, et ne changera sans doute pas.
Il existe, de fait, un mot d'ordre lui aussi implicite et caché au Japon : être, rester et demeurer japonais envers et contre tous.
En effet, devant un Occident déshumanisé, le Japon possède un trésor national, une âme qui est une entité venant des dieux ou kami originels. Cette âme est peut-être immortelle ; en tous cas, elle se doit d'être invincible. Devant l'événement, le Japon peut éventuellement plier. Mais, jusqu'ici, son histoire prouve qu'il est resté et restera probablement invaincu. La défaite de 1945, après Hiroshima et Nagasaki ne prouvant rien.
Après cette première interview filmée, je retournais voir Mishima. Il me consacra toute une soirée pour une rencontre d'homme à homme, à condition qu'il n'y ait ni caméra, ni magnétophone, ni carnet de notes. Nous étions là pour parler, avec pour seul témoin mon interprète.
Pour Mishima, le jour le plus sombre de l'histoire du Japon fut celui où, dans un langage archaïque et incompréhensible à presque tous les Japonais, l'empereur Hirohito s'adressa à la nation. Quand, quelques minutes plus tard, on traduisit enfin clairement ce que l'empereur venait de dire dans l'ancien langage de la cour, des millions de Japonais eurent envie de se faire hara-kiri. Des centaines d'entre eux affluèrent devant les douves du palais impérial et le firent effectivement. Avant la radiodiffusion, une révolte éclata parmi les officiers. Il fallut toute l'autorité et le sang-froid traditionnel de la vieille garde japonaise, celle des autorités de tout genre, pour que le pays ne sombrât pas dans le chaos. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, l'empereur venait de dire en clair que la nation baissait pavillon. Les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki venaient d'avoir raison de lui. C'était, devant les USA, la reddition inconditionnelle. Et l'homme-dieu, l'homme le plus sacré du pays, l'Empereur, qu'on n'entendait ni ne voyait jamais, venait de le dire lui-même.
« À vingt ans, me dit Mishima, j'étais étudiant et je travaillais dans une usine de la marine japonaise. Je me sentis sauvé quand la guerre fut terminée. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut la déclaration de l'empereur signifiant qu'il n'était plus un dieu. Je ressentis cela comme une espèce de trahison, une trahison à l'égard de ceux qui étaient morts pour lui. »
À ses yeux, et dès ce jour, le Japon avait failli. Ce n'était plus le Grand Nippon, cher à tous les ultra-nationalistes japonais. Et de dégénérescense du pays en était la preuve. Lui, Mishima, continuait de rêver à un Japon pur et dur. Si cette attitude extrême vaut d'être racontée, c'est parce qu'elle illustre, sous un aspect spectaculaire, celle de la mort de Mishima lui-même, à quel point rien, dans ce pays, n'appartient au passé. Comment, aussi, tous les faits de l'histoire gardent leur impact et leur sens dans un perpétuel présent.
Descendant d'une famille de samouraï, Mishima, en dépit de ses excentricités daliniennes, savait qu'il devait lui aussi respecter un code caché, un code d'honneur, qui implique qu'on ne peut adresser un reproche à un supérieur, sinon en le motivant au prix de sa vie. Il avait attendu longtemps, conservant par-devers lui cette inoubliable blessure. D'autant qu'à la fin de ses études, couronné premier de la célèbre université de Tôkyô, l'empereur lui avait personnellement offert une montre en or. Mishima ressentait cela comme un lien personnel avec l'empereur, et ceci renforçait son sentiment naturel de respect. Sans effacer pour autant son ressentiment fondamental existant depuis le jour de la capitulation. On connaît la suite : le 25 novembre 1970, Mishima Yukio envahit l'état-major de l'armée japonaise à la tête de sa milice privée ; l'un de ses hommes tue un garde, pendant que Mishima se précipite dans le bureau du chef de l'état-major et le tient en respect.
De la fenêtre, il harangue les hommes et officiers de troupe, hâtivement réunis, qui se demandent si cet écrivain excentrique, célèbre par les journaux et la télévision, n'est pas en train de monter un nouveau coup publicitaire. Mais, cette fois-ci, Mishima est sérieux, terriblement tragique même. Quelques instants plus tard, et conformément aux règles, il effectuera un parfait seppuku, un suicide rituel qui consiste à plonger un petit sabre dans le ventre en perçant celui-ci en dessous du nombril, puis, en tranchant, à l'élever non loin du foie, enfin, sans extraire la lame, à redescendre pour fendre le ventre à l'horizontal. Le plus proche ami de Mishima, qui était à ses côtés, lui trancha selon le rituel, la tête d'un coup de sabre. Trois jours avant son seppuku, Mishima avait remis à son éditeur le quatrième tome de son roman, dernier roman à épisodes. Sur la dernière page du livre, il avait écrit la date de sa mort : 25 novembre 1970.
Mishima apparaît ainsi comme une sorte de symbole de ce qui est irréductible dans l'âme japonaise. À retardement, son suicide méticuleusement organisé était une protestation sans doute spectaculaire, mais tout à fait traditionnelle. Nous pourrions y voir une calme violence, mais aussi la permanence d'une pensée irréductible.
Certes, Mishima ne symbolise pas dans sa personne tous les Japonais, mais un aspect profond de ce Japon, à la fois présent et souterrain, un Japon indomptable dont nous aurons l'occasion de parler.
« Pour nous, disait un industriel japonais, le budô, le théâtre nô, le kabuki sont des nourritures ; le fond de notre âme est très ancien. C'est pourquoi nous pouvons être modernes ou ultramodernes sans perdre nos racines. Rien, au Japon, n'est séparé : le goût léger du sake (ou vin de riz), la saveur des poissons crus (sashimi), le respect que nous accordons à nos traditions et la vénération que nous apportons à notre empereur, tout cela ne fait qu'un tout. La différence entre nous et l'Occident, c'est qu'il nous reste un centre, ou ce que vous appelez une âme. Le centre, c'est aussi le noyau. Sans lui, le fruit dépérit et meurt. »
► Michel Random, La Stratégie de l'invisible, Félin, 1985.
◘ Mishima : L'homme, l'œuvre, la mort - 
 Dans son autobiographie Le Soleil et l'acier, Kimitake Hiraoka, bien plus connu sous le pseudonyme qui le révèlera à l'humanité, Mishima Yukio [en japonais on met le nom de famille avant le prénom], confessait son irréfragable désir d'assouvissement tragique par ces quelques mots, jetés en une fausse interrogation, et alors fort peu écoutés : « Qu'est-ce qui distingue une mort héroïque d'une mort décadente ? (...) Résister à la mort et à l'oubli ». Cette phrase, le 25 novembre 1970 consommé, personne ne devait plus l'oublier. De fait, pacte suicidaire du plus célèbre des auteurs japonais marque aujourd'hui encore les esprits à un point tel qu'elle recouvre d'ombre sa pourtant foisonnante et géniale œuvre littéraire. La biographie recomplétée de son ami journaliste Henry Scott-Stokes est éclairante en la matière, qui lui consacre près de 400 pages à décortiquer la troublante personnalité du dernier samouraï nippon, rejetant l'étude de ses textes à une simple énumération-explicitation insipide et sans profondeur aucune.
Dans son autobiographie Le Soleil et l'acier, Kimitake Hiraoka, bien plus connu sous le pseudonyme qui le révèlera à l'humanité, Mishima Yukio [en japonais on met le nom de famille avant le prénom], confessait son irréfragable désir d'assouvissement tragique par ces quelques mots, jetés en une fausse interrogation, et alors fort peu écoutés : « Qu'est-ce qui distingue une mort héroïque d'une mort décadente ? (...) Résister à la mort et à l'oubli ». Cette phrase, le 25 novembre 1970 consommé, personne ne devait plus l'oublier. De fait, pacte suicidaire du plus célèbre des auteurs japonais marque aujourd'hui encore les esprits à un point tel qu'elle recouvre d'ombre sa pourtant foisonnante et géniale œuvre littéraire. La biographie recomplétée de son ami journaliste Henry Scott-Stokes est éclairante en la matière, qui lui consacre près de 400 pages à décortiquer la troublante personnalité du dernier samouraï nippon, rejetant l'étude de ses textes à une simple énumération-explicitation insipide et sans profondeur aucune.
Étonnante inconséquence bien ancrée à “droite” également, pour qui le seppuku du Grand Quartier Général de Tokyo, plus coup d'éclat que coup d'État, est devenu un évènement prépondérant sa mythologie, qu'il est inutile ici d'évoquer à nouveau, tant il l'a déjà à maintes reprises été :
« Yukio Mishima choisit d'être le dernier samouraï. Sa sortie fulgurante hors d'un monde qu'il abhorrait se camoufle sous une tentative de putsch. Mais un putsch à la nippone, voué à l'échec, ayant pour seul dessein de mettre en scène un évènement inoubliable » (Jean Mabire).
Pourtant, un rapide retour sur ses écrits jette un éclairage nouveau et bien plus instructif que tous les cours de psychologie ou études de philosophie orientale (sa vie durant, il restera sceptique à l'égard du bouddhisme et du shintoïsme institutionnels) que depuis 27 ans littérateurs, critiques journalistiques ou prétendus exégètes nippophiles s'acharnent à plaquer sur la personne de Mishima pour en finir avec son geste fatal.
Tout dans ses romans, nouvelles, essais et recueils autobiographiques annonçaient par la plume ce que leur auteur allait bientôt sceller par le sang. L'idée précède l'action, l'action la complète. Le mot, trompeur, factice transposition scripturale du fatum humain, pallié, transcendé par l'action elle-même. Et si Mishima nous paraît si proche, c'est que derrière le vernis de l'artiste insulaire imprégné de culture sino-nippone se profile, tantôt en filigrane, tantôt frappant d'évidence, l'écrivain baigné de littérature européenne, de philosophie allemande, de mythologie hellénique. Ceux qui l'ont connu ou approché s'accordent tous à le reconnaître : sa maison, délirant bâtiment baroque mariant avec plus ou moins bon goût pilastres massifs, fioritures et plâtres moulés de statues de l'antiquité et de la renaissance, sa passion pour la Grèce, son culte de l'haltérophilie, son goût immodéré pour Thomas Mann et Friedrich Nietzsche, le philosophe au marteau, attestent de son regard tourné vers le berceau de la tragédie. « Il faut ne jamais s'être ménagé soi-même, il faut avoir fait de la dureté une habitude pour rester serein et de bonne humeur parmi de dures vérités », quelle meilleure traduction que cet aphorisme nietzschéen tiré d'Ecce Homo pourrait mieux percer à jour la complexité de Mishima, sa pensée profonde et la vision unique qui guida sa vie, son œuvre, et, point d'orgue terrible, sa mort par suicide.
Mishima, d'abord un écrivain européen ? Perspective ambitieuse certes, mais qui s'appuie sur des faits et des écrits-mêmes de Mishima qu'il serait navrant de vouloir oblitérer, au titre fallacieux d'une compréhension plus aisée d'un auteur ultra-nationaliste et impérialiste en rupture de ban. En un dernier aveu au monde qu'il allait définitivement quitter, il laissait sur son bureau, accompagnant la dernière partie manuscrite de sa tetralogie La Mer de la fertilité, ce billet, disant « La vie est brève, mais je voudrais vivre toujours ». Espoir d'éternité concrétisé certes par sa postérite littéraire, que confirme la récente sortie dans la prestigieuse collection NRF-Gallimard du Pélerinage aux Trois Montagnes, mais qui, s'il n'avait été qu'un “quelconque” écrivain de talent, lui aurait au contraire évité sa mort volontaire et prématurée. Son acte, s'il reste nimbé de mystère, doit sa raison d'être à une toute autre inspiration, divine ou classique, indubitablement tragique, nourrie de références européennes, classiques grecs, littérature du “Grand Siècle” et bréviaires sils-mariens, juste retour des choses pour un Nietzsche volontiers “schopenhaueriennement” vulgarisateur du bouddhisme. Mishima, le plus occidental des écrivains asiatiques, tellement opposé au précepte Zen : “Aller droit devant soi, sans se retourner et sans se poser aucune question”.
« L'homme qui sait mourir ne sera jamais esclave » prêchait déjà Sénèque, conseiller de l'Empereur Néron et maître de la Rome stoïcienne, pour qui la vie, ascèse virile et souveraineté aristocratique sur ses pulsions tendues vers la liberté absolue de l'Être, trouvait sa conclusion la plus pure et olympienne dans son propre abandon volontaire. Mais se sacrifier sous le coup de la passion, preuve de son inaptitude à s'affirmer contre le monde, ne saurait mériter que mépris et déshonneur. Or, c'est bien dans ce sens qu'abonde Henry Scott-Stokes quand il affirme péremptoirement que le suicide de Mishima ne fut jamais que shinjū, double suicide amoureux en compagnie de son prétendu amant et second au sein de la Taté-no-kai ; Morita Masakatsu, connotant l'acte d'une homosexualité sado-masochiste honteuse qui ne résiste pas devant l'examen des faits. Quand meurt Mishima, il y a longtemps qu'il s'est défait de ses oripeaux romantiques. Son passage à la Bungei-Bunka, association militariste de littérateurs nationalistes et son appartenance au mouvement Nippon Roman-Ha (“Romantiques japonais”) regroupés derrière la figure du romancier Yasuda Yajura remonte aux dernières années du second conflit mondial.
Glorifiant la « guerre sainte » et prônant la valeur salvatrice du sacrifice et de l'autodestruction du peuple japonais guidé par l'infaillabilité de son Empereur-thaumaturge, seul aux yeux de ce cercle avait droit de cité l'exploit intrinsèque, la défaite et la mort, inéluctables, magnifiant comble du romantique la plus belle des victoires, d'ores et déjà acquise par le seul fait que le Japon, peuple à la supériorité divine, ait osé lever le sabre sur l'Asie et s'aliéner la haine de l'Occident. Profondément influencé en ses jeunes années par l'école néo-confucéenne Wang-Yang-Ming du Dr Inoue Tetsujuio (« La mort du corps n'est rien face à la mort de l'esprit »), Mishima confiera bien plus tard, dans Le Soleil et l'acier (1968), son progressif changement d'orientation :
« L'élan romantique, à partir de l'adolescence, avait toujours été en moi une veine cachée, n'ayant de signification qu'en tant que destruction de la perfection classique (...) En l'espèce, je chérissais un élan romantique vers la mort, tout en exigeant en même temps comme véhicule un corps strictement classique (...). Me manquaient, en bref, les muscles qui convenaient à une mort tragique ».
Le grand bouleversement de sa vie a lieu en 1952, lorsque Mishima, alors tout jeune romancier mondialement célébré pour Confession d'un masque (1949) met le pied en Grèce. Lecteur assidu d'Homère, Eschyle et Sophocle, des classiques grecs et du “Grand Siècle”, cas rarissime dans le Japon post-1945, il « tombe amoureux des mers bleues et des ciels vifs de cette terre classique » et echafaude une théorie pour sublimer son Voyage à Sparte : dans les temps anciens, la spiritualité (« cette excroissance grotesque du christianisme »), inexistante, était palliée par un équilibre précaire entre le corps et l'esprit nécessitant un effort constant pour le préserver, que les Grecs sublimèrent dans la beauté et la tragédie, punition infligée aux hommes par les dieux pour leur arrogance. « Mon interprétation était peut-être fausse, mais telle était la Grèce dont j'avais besoin ». Aristote ne disait-il pas qu'un « beau pied est l'indice d'une belle âme » ?
À travers cette nouvelle grille de lecture éthique, le jeune et chétif écrivain désapprend la solitude, la haine de soi et découvre la beauté du corps travaillé, sculpté par l'exercice. À son retour au Japon, dégoûté du romantisme, « caractéristique typiquement bourgeoise (...) fadaises poétiques, héroïsmes mélodramatiques, pathétiques complications d'amour » (dixit Julius Evola), il décide que l'heure est venue pour lui désormais d'écrire des « œuvres classiques », et, en corollaire, autre lecon rapportée de l'Hellade, de s'adonner au culturisme. « Le bon endroit, c'est le corps, l'apparence physique, le régime, la physiologie — et le reste suit de lui-même (...) c'est pourquoi les Grecs constituent toujours le premier évènement capital de la culture de l'humanité. Ils savaient — et ils faisaient —, ce qu'il fallait » (Nietzsche, Crépuscule des Idoles).
La mort, qui jusque là n'était que trouble nihilisme destructeur, et attrait morbide pour la souffrance (« Le penchant de mon cœur vers la mort, la nuit et le sang était indéniable » notera-t-il à l'occasion de la publication de Confession d'un masque) se voit rehaussé au rang d'idéal, de suprême geste de domination, de puissance et de liberté. Patet Exitus : « Lorsque vous ne voulez plus combattre, il vous est toujours possible de vous retirer. Rien ne vous est plus facile que de mourir » (Sénèque). Chacune des œuvres qui paveront le panthéon de sa gloire littéraire sera dorénavant un pas supplémentaire dans son approche définitive du néant.
En 1951 puis 1953 paraissent 2 versions de Couleurs Interdites, évocation de la société homosexuelle de Tokyo et des relations tumultueuses qui unissent le vieil écrivain Shinsuke et le bel éphèbe ingrat Yuichi, conclue par la mort par injection de drogue du vieillard, au terme d'un sermon inutile. Saisissante préfiguration de ce qui allait attendre Mishima... Cette même année 1953 sort La Mort en été, roman qui conte l'histoire d'une femme désespérée après la noyade accidentelle de ses 2 enfants. Se profile à nouveau l'étude d'une âme en proie au chaos existentiel, qui lutte pour sa dignité dans le dépassement de ses sentiments. Définissant sa perception de la tragédie classique, Mishima écrit, toujours dans Le Soleil et l'acier :
« Selon ma définition de la tragédie, le pathos tragique naît lorsqu'une sensibilité parfaitement moyenne assume pour un temps une noblesse privilégiée qui tient les autres à distance, et non pas quand un type particulier de sensibilité émet des prétentions particulières (...). Pour que, parfois, un individu touche au divin, il faut dans des conditions normales, qu'il ne soit lui-même ni divin ni rien qui en approche. C'est seulement lorsque, à mon tour, je vis le ciel bleu, étrange et divin, uniquement perçu par ce type d'individu, qu'enfin j'eus confiance en l'universalité de ma propre sensibilité, que je pus étancher ma soif et que fut dissipée ma foi aveugle et maladive dans les mots. À cet instant, je participai à la tragédie de tout être ».
 La parution du Pavillon d'or en 1956, qui confère définitivement à Mishima le rang d'écrivain à la renommée mondiale, entérine son rejet viscéral de la laideur physique et mentale, son mépris pour ce qu'incarne ici le personnage de Kashiwagi, être vil dont les pieds bots ne sont qu'extériorisation corporelle de sa bassesse intérieure, dans la formule toute kantienne « le beau est le symbole du bien moral » : « Il avait pour marque particulière deux pieds aussi bots que pieds peuvent l'être et une démarche extrêmement étudiée. Il avait toujours l'air de marcher dans la boue : lorsqu'une jambe parvenait, non sans peine, à s'extraire, l'autre au contraire paraissait s'engluer. En même temps, tout son corps s'agitait avec véhémence ; sa démarche était une espèce de danse extraordinaire, aussi peu banale que possible ». Autre approche de la mort avec Le Marin rejeté par la mer (1963), qui voit une bande d'adolescents nihilistes combattant leur sensibilité s'essayer à l'exercice macabre de la mise à mort de Ryuji, l'officier de marine marchande, amant de la mère de Noboru, membre du groupe, par l'ignoble sacrifice longuement détaillé par l'auteur d'un innocent chaton abandonné.
La parution du Pavillon d'or en 1956, qui confère définitivement à Mishima le rang d'écrivain à la renommée mondiale, entérine son rejet viscéral de la laideur physique et mentale, son mépris pour ce qu'incarne ici le personnage de Kashiwagi, être vil dont les pieds bots ne sont qu'extériorisation corporelle de sa bassesse intérieure, dans la formule toute kantienne « le beau est le symbole du bien moral » : « Il avait pour marque particulière deux pieds aussi bots que pieds peuvent l'être et une démarche extrêmement étudiée. Il avait toujours l'air de marcher dans la boue : lorsqu'une jambe parvenait, non sans peine, à s'extraire, l'autre au contraire paraissait s'engluer. En même temps, tout son corps s'agitait avec véhémence ; sa démarche était une espèce de danse extraordinaire, aussi peu banale que possible ». Autre approche de la mort avec Le Marin rejeté par la mer (1963), qui voit une bande d'adolescents nihilistes combattant leur sensibilité s'essayer à l'exercice macabre de la mise à mort de Ryuji, l'officier de marine marchande, amant de la mère de Noboru, membre du groupe, par l'ignoble sacrifice longuement détaillé par l'auteur d'un innocent chaton abandonné.
À cette époque Mishima a déjà pris conscience, au cours des évènements de 1960, de son intérêt pour la politique. Les émeutes qui émaillèrent le renouvellement de l'ANPO (traité de sécurité américano-japonais), humiliante charte imposée par Mac Arthur en 1945, agirent sur Mishima comme le révélateur d'un engagement à venir. C'est alors qu'il découvre la richesse de la tradition militariste nippone. À l'automne 1960, il termine la nouvelle Yûkoku (Patriotisme, aujourd'hui insérée dans le volume La Mort en été) qui traite à travers l'histoire d'un jeune officier, le lieutenant Takeyama Shinji, de l'affaire Ni-niroku-jiken, putsch entrepris le 26 février 1936 par la société secrète impérialiste Kodo-Ha. Tiraillé entre sa fidélité pour l'Empereur et celle pour la Kodo-Ha, Takeyama préfère se suicider en compagnie de son amie Reiko, shinjū fort idéalisé et accompagné d'un véritable luxe de détails :
« Il est difficile d'imaginer spectacle plus héroïque que le sursaut du lieutenant qui brusquement rassembla ses forces et releva la tête (...). Il y avait du sang partout. Le lieutenant baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé et sans force, une main sur le sol. Une odeur âcre emplissait la pièce. Le lieutenant, tête ballante, hoquetait sans fin et chaque hoquet ébranlait ses épaules. Il tenait toujours dans sa main droite la lame de son sabre, que repoussaient les intestins et dont on voyait la pointe ».
À 2 reprises, Mishima reprend ce thème, dans la pièce Toka no Kiku (Les chrysanthèmes du dixième jour, 1961) puis dans l'essai Eirei no Koe (Les Voix des morts héroïques, 1966). De Patriotisme, il dira : « Ce n'est ni une comédie, ni une tragédie, mais simplement l'histoire d'un bonheur... Le douloureux suicide du soldat équivaut à une mort honorable sur le champ de bataille ». De cette nouvelle devait être tiré un film éponyme en 1965, où Takeyama sera joué par... Mishima lui-même. On se souvient de la honte qui l'étouffa sa vie durant d'avoir triché au conseil de révision en 1945 (*), alors que le Japon mobilisait ses dernières forces pour repousser l'hydre américaine. Dix ans après ce film, Mishima se rejouait la même scène, sans caméra cette fois.
Mais si Mishima manifeste un réel intérêt pour la politique, il reste un parfait apoliteia, seulement préoccupé par la figure de l'Empereur, à qui il reproche d'avoir trahi et sa charge divine et son peuple, sacrifié en son nom propre pendant 8 ans de guerre. « Pourquoi fallait-il qu'il devienne un être humain... », écrira-t-il. La lecture de son roman Après le Banquet (1960) prouve quant à elle le profond mépris que ressentait Mishima pour la classe politique en général et le rôle prégnant qu'y tient l'argent. Le ridicule dont il affuble des personnages à l'identité réelle à peine voilée que manipule allègrement une sombre prostituée ne manqua pas de lui causer des déboires avec les milieux politiciens et certains groupes extrémistes [de plus Mishima perd le procès en diffamation, action juridique rarissime au Japon, intenté par l'ancien ministre Achiro Arita].
Il s'initie aux règles du Bushido [tradition non-écrite du credo chevaleresque] ainsi qu'aux arts martiaux (Kendo et Karaté), réédite le premier en 1967 le bréviaire du Samuraï condamné par l'occupant en 1945, le Hagakuré, du guerrier Yamamoto Jocho (XVIIIe siècle), qu'il adapte aux conditions du XXe siècle et sous-titre Le Japon moderne et l'éthique samouraï : il en retient particulièrement quelques idées-clés, la soumission à son destin et à la mort, au relent fortement teinté de stoïcisme : « La mort recèle toujours un combat obscur entre la liberté de l'homme et un destin qui le dépasse ». En introduction, il note : « Un homme d'action est destiné à subir une longue période de tension et de concentration jusqu'au dernier instant où il achève sa vie par son acte final : la mort — soit par causes naturelles, soit par seppuku » Si la mort l'obsède depuis son enfance, sa propre mort lui devient dès à présent prépondérante. « Aux abords de la quarantaine, l'âge commence à tracasser Mishima » remarque Scott-Stokes dans sa biographie. Toujours en excellente condition physique, ses muscles se font maintenant moins proéminents, ses contractions moins impressionnantes. Comment un homme si pétri d'esthétique classique pourrait s'en contenter, lui qui écrivait, toujours dans Le Soleil et l'acier, qu'à un muscle dur correspond la force de caractère et « la sentimentalité à un ventre flasque ».
Impossible d'accepter l'inéluctable décrépitude de l'âge, lui qui sait que la grande idée de l'art classique se trouve dans la commémoration dans le marbre de l'instant parfait où s'affirme la beauté ultime, l'extrême moment qui précède le déclin et derrière lui, la mort. C'est désormais à elle qu'il consacrera ses dernières années. Dans l'ouvrage Shobu No Kokoro (L'Âme des guerriers, 1970) reprise d'un dialogue avec Murakami Ichiro, paru après son décès, il confie : « On doit assurer la responsabilité de ses paroles, une fois qu'on les a prononcées. Il en va de même du mot écrit. Si l'on écrit : Je mourrai en novembre, alors on doit mourir. Si l'on fait une fois bon marché des mots, on continuera de le faire ». Sa tétralogie achevée, La Mer de la fertilité, certainement le sommet de son écriture, et interrogation sur la réincarnation où s'exprime un bouddhisme plus universitaire que mystique, Mishima Yukio pourra se considérer enfin au bord de la falaise et rejoindre le héros qu'il vénère le plus, lui-même. « Le suicide est quelque chose qui s'organise dans le silence du cœur, comme une œuvre d'art » disait Albert Camus. Alors que persomne ne voulait voir en Mishima la réunion de la plume et de l'épée, il décidait de mourir fièrement, puisqu'il ne lui était plus permis de vivre avec fierté.
Dans son excellente biographie, Mishima ou la vision du vide, Marguerite Yourcenar devait écrire : « Il y a deux sortes d'êtres humains : ceux qui écartent la mort de leur pensée pour mieux et plus librement vivre, et ceux qui, au contraire, se sentent d'autant plus sagement et fortement exister qu'ils la guettent dans chacun des signaux qu'elle leur fait à travers les sensations de leur corps ou les hasards du monde extérieur. Ces deux sortes d'esprit ne s'amalgament pas. Ce que les uns appellent une manie morbide est pour les autres une héroïque discipline ». Mishima aura vécu en artiste tragique, acceptant posément de se retirer en “joyeux pessimiste”. Dyonisien aurait sans doute conclu Nietzsche.
Quand du haut du balcon du GQG des Jieitaï, ce 25 novembre fatidique de 1970, Mishima, revêtu de son uniforme moutarde, le front masqué par son hachi-maki, le poing tendu vers la foule qui le conspue, s'écrie « Au nom du passé, à bas l'avenir ! », c'est d'abord et surtout à lui-même qu'il s'adresse, lui, subtile réunion d'irrationalisme nippon et d'universalisme européen, ayant décidé d'en finir avec une vie qui ne peut plus répondre à son idéal de beauté physique, de grandeur virile, de pureté olympienne. Sa résolution est prise, recouvrer sa liberté dans l'extase finale de la mortification purificatrice, à l'image de ce Saint Sébastien agonisant peint par Gueno Reni qu'il ne cessera jamais de révérer dans son martyre, allant jusqu'à l'imiter pour le photographe Kishin Shinoyama. Deux mois avant son seppuku, il posait encore pour un recueil de photos jamais publié et intitulé Otoko no Shi (La Mort d'un Homme). Sur certaines on le voit couvert de sang, sur d'autres mimant son seppuku. « Qu'est-ce que l'éternité ? » — s'interrogeait Pierre Drieu la Rochelle. « Une minute excessivement intense ». De son amour pour Saint Sébastien devait découler sa passion pour Gabriele d'Annunzio, dont il traduisit Le Martyre de Saint Sébastien et comme lui s'écriant : « J'ai tout risqué, j'ai tout donne, j'ai vaincu », il put lancer fièrement à la face de ce monde vieillot et assoupi, dernier acte d'insoumission à la fatalité, cet épitaphe : « La mort violente est l'ultime beauté, toujours, et surtout quand on est jeune ».
► Laurent Schang, Nouvelles de Synergies Européennes n°29, 1997.
* note en sus : en 1944, Mishima passe pourtant le conseil de révision et est déclaré "bon pour le service". Il subit en juillet un entraînement militaire à l'école de construction navale et est mobilisé en octobre pour travailler à une usine d'armement. Le 15 février 1945, il reçoit l'ordre d'incorporation et le lendemain, après un examen médical au domicile à la campagne, le jeune appelé, en raison d'une forte fièvre, induit en erreur un jeune médecin inexpérimenté qui confondit bronchite et pleurésie : Mishima ne fit rien pour le détromper ; il fut déclaré inapte. Un examen ultérieur révéla l'erreur mais Mishima avait entretemps bénéficié d'un an de sursis. Lorsqu'il fut enfin appelé en avril 1945, la guerre touchait à son terme (le régiment qu'il devait rejoindre fut anéanti aux Philippines) et il fut affecté à l'arsenal maritime de Koza (près de Tokyo) jusqu'à la reddition du Japon (15 août 1945).

 ◘ Saint Mishima, ou le pèlerin aux Trois Montagnes
◘ Saint Mishima, ou le pèlerin aux Trois Montagnes
« Au soleil couchant la lumière sous les auvents passe et disparaît
Mais sur les fleurs de cerisier un instant s'est attardée »
(Eifuku Monin, 1270-1342)
Pour peu qu'on puisse encore parler de controverse au sujet de l'homosexualité présumée ou avérée de Mishima Yukio, débat relancé en ce début d'année par l'interdiction au Japon sur pression de son épouse des mémoires de Fukushima Jiro, amant de jeunesse du littérateur maudit, Le Sabre et le piment rouge (Bungei Shunjū Ltd, Tokyo, 1998), l'ami intime du prix Nobel de littérature Kawabata Yasunari, frère en Ourania [pays du ciel] du dramaturge Henry de Montherlant, n'a jamais fait silence de ses préférences. Son œuvre, pour éclatée dans ses formes et ses thèmes, n'en demeure pas moins, du Pavillon d'or à Cinq Nôs modernes, [cf. QL n°99 ; cf. adpatation d'Hanjo], mue par ce fil conducteur, tout de sensualité et d'appétit retenu. L'esthète romantique Mishima, le romancier apollinien, le polémiste samuraï ne sont jamais que les 3 visages du même Janus, chez qui le tragique naît, non de son désespoir feint, mais de la pleine acceptation de sa « différence », qui le voue à l'unique. Confession d'un masque, Une Soif d'amour, Les Amours interdites, L'École de la chair sont les 4 Évangiles canoniques de sa révélation, près desquelles Le Soleil et l'acier figure le cinquième apocryphe. L'Evangile selon Saint Sébastien ?
L'Évangile selon Saint Sébastien
Sans doute le tabou toujours en vigueur au Japon autour de l'homme tient-il en ce que Mishima, à travers son propre exorcisme littéraire, a mis à nu l'essence même de l'âme nippone, socialisation du Beau viril et, par jeu de miroirs, aveu de ce que Karl Heinrich Ulrichs, écrivain homosexuel allemand du XIXe, déclarait déjà au milieu du siècle : « Nous sommes tous des femmes dans l'âme ». Incarnation paroxystique du dualisme ontologique de Nihon, symbolisé par l'omniprésence du disque solaire, mâle incarnation de la chaleur divine répandue par Amaterasu, déesse-mère originelle, Mishima reste la mauvaise conscience d'un Japon qui n'en finit pas de se noyer dans les affres du consumérisme à l'occidentale, ou le portable du self-made man a supplanté le sabre du Bushi (v. NdSE n°29, « Mishima : l'homme, l'œuvre, la mort »).
N'ayant laissé à la postérité aucune autobiographie digne de ce nom (tout juste peut-on considérer Le Soleil et l'acier comme ses très partielles mémoires), c'est donc dans son œuvre qu'il convient de quester une vérité par-delà la réalité. Rendons grâce aux éditions Gallimard d'avoir par conséquent publié dans leur collection Folio le recueil de 7 nouvelles composant Pèlerinage aux Trois Montagnes (initialement publié en NRF) : Jets d'eau sous la pluie, Pain aux raisins, Ken, La Mer et le couchant, La Cigarette, Martyre, Pèlerinage aux Trois Montagnes. De valeur inégale, ces nouvelles n'en présentent pas moins dans leur ensemble le fascinant spectrographe d'une vie, tableau impressionniste où se dévoilent par petites touches les contours d'une existence en mouvement dans ses travers, ses fluctuations, ses fantasmes. Déroutante, parfois agaçante, souvent dérangeante, sa plume livre le fond d'une pensée profonde, qui s'interroge sur son homosexualité, la spiritualité orientale confrontée aux dogmes occidentaux, l'éthique martiale, la valeur de l'art. Yukio par Mishima.
L'apprentissage de soi et des autres, hostiles
 « Traversée çà et là de brillants soleils — ainsi que le chante Baudelaire —, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage ». C'est par ces mots que s'engage l'action de La Cigarette (Tabako), nouvelle autobiographique qui révéla le jeune Kimitake Hiraoka à Kawabata, où le jeune Nagasaki, qui n'est pas encore Mishima Yukio, fait l'apprentissage de soi et des autres, hostiles. Solitaire, mélancolique, romantique, l'adolescent maladif découvre sa sexualité auprès du champion de rugby de l'école, Imura, cependant que s'affirme sa détestation de son propre corps, sa volonté de se perdre : « Instants bénis où, moi qui avais toujours voulu m'y fondre, je crus enfin ne plus faire qu'un avec ce calme (...) cette sérénité qui me semblait couler tout droit d'une vie antérieure et dont je gardais la nostalgie ». Sentiments qui se précisent et s'exacerbent dans Martyre (Junkyo). Jamais l'image du Saint Sébastien de Guido Reni n'aura été plus obsessionnelle. Mishima y conte les amours sado-masochistes de Watari et Hatakeyama, 2 garçons pensionnaires de la même institution. Le premier, Mishima, refusant tout contact avec ses camarades, « d'une entêtante séduction », le second, projection du même quelques années plus tard, « nu, son corps d'athlète (...) modèle même de la jeunesse (...) sa silhouette et une lueur telle qu'on eût dit la statue antique d'un jeune dieu ». Ces « relations particulières » aiguiseront la haine de leurs camarades, et dans un simulacre de pendaison, Watari-Saint Sébastien, les yeux plongés dans l'azur du ciel infini, subira le douloureux rituel social du passage du même au même : « un adolescent qui prétend rester lui-même sera martyrisé par les autres. L'adolescence a toujours été un effort pour se rendre semblable, ne fut-ce qu'un instant, à quelque chose d'autre ». Confession (d'un masque)...
« Traversée çà et là de brillants soleils — ainsi que le chante Baudelaire —, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage ». C'est par ces mots que s'engage l'action de La Cigarette (Tabako), nouvelle autobiographique qui révéla le jeune Kimitake Hiraoka à Kawabata, où le jeune Nagasaki, qui n'est pas encore Mishima Yukio, fait l'apprentissage de soi et des autres, hostiles. Solitaire, mélancolique, romantique, l'adolescent maladif découvre sa sexualité auprès du champion de rugby de l'école, Imura, cependant que s'affirme sa détestation de son propre corps, sa volonté de se perdre : « Instants bénis où, moi qui avais toujours voulu m'y fondre, je crus enfin ne plus faire qu'un avec ce calme (...) cette sérénité qui me semblait couler tout droit d'une vie antérieure et dont je gardais la nostalgie ». Sentiments qui se précisent et s'exacerbent dans Martyre (Junkyo). Jamais l'image du Saint Sébastien de Guido Reni n'aura été plus obsessionnelle. Mishima y conte les amours sado-masochistes de Watari et Hatakeyama, 2 garçons pensionnaires de la même institution. Le premier, Mishima, refusant tout contact avec ses camarades, « d'une entêtante séduction », le second, projection du même quelques années plus tard, « nu, son corps d'athlète (...) modèle même de la jeunesse (...) sa silhouette et une lueur telle qu'on eût dit la statue antique d'un jeune dieu ». Ces « relations particulières » aiguiseront la haine de leurs camarades, et dans un simulacre de pendaison, Watari-Saint Sébastien, les yeux plongés dans l'azur du ciel infini, subira le douloureux rituel social du passage du même au même : « un adolescent qui prétend rester lui-même sera martyrisé par les autres. L'adolescence a toujours été un effort pour se rendre semblable, ne fut-ce qu'un instant, à quelque chose d'autre ». Confession (d'un masque)...
Se purifier dans le suicide et rejoindre l'éther
 Composer un personnage qui puisse soutenir le regard fondamentalement détestable de l'Autre devient la préoccupation fondamentale de Mishima dans Jets d'eau sous la pluie (Ame No Naka No Funsui) : « Je n'ai jamais été l'esclave de mes désirs... ». La rupture entre Akio et Masako, « Mots talismans que seul un homme, un vrai, un être humain enfin, pouvait s'autoriser à prononcer... Ces mots : « Séparons-nous ! », marque, dans son grotesque sordide, l'initiation à l'âge adulte et au monde d'un jeune être désespérément sensible, intérieurement réprouvé, en arrêt devant la chair. « Le monde était un parfait non-sens. Les hommes complètement stupides ». Pain aux raisins (Budopan) résonne lourdement de cette chétivité tant physique que morale. Jack, l'anti-héros de la nouvelle, est de cette jeunesse de l'après-1945 gavée de références américaines : « (...) taillé dans une sorte de cristal transparent. N'avait-il pas eu toujours en tête de devenir un homme invisible ? (...) un beau visage comme sculpté dans un ivoire immaculé (...). Pour se garantir une liberté totale et une transparence absolue, le jeune homme bannissait muscles et graisse superflus ».
Composer un personnage qui puisse soutenir le regard fondamentalement détestable de l'Autre devient la préoccupation fondamentale de Mishima dans Jets d'eau sous la pluie (Ame No Naka No Funsui) : « Je n'ai jamais été l'esclave de mes désirs... ». La rupture entre Akio et Masako, « Mots talismans que seul un homme, un vrai, un être humain enfin, pouvait s'autoriser à prononcer... Ces mots : « Séparons-nous ! », marque, dans son grotesque sordide, l'initiation à l'âge adulte et au monde d'un jeune être désespérément sensible, intérieurement réprouvé, en arrêt devant la chair. « Le monde était un parfait non-sens. Les hommes complètement stupides ». Pain aux raisins (Budopan) résonne lourdement de cette chétivité tant physique que morale. Jack, l'anti-héros de la nouvelle, est de cette jeunesse de l'après-1945 gavée de références américaines : « (...) taillé dans une sorte de cristal transparent. N'avait-il pas eu toujours en tête de devenir un homme invisible ? (...) un beau visage comme sculpté dans un ivoire immaculé (...). Pour se garantir une liberté totale et une transparence absolue, le jeune homme bannissait muscles et graisse superflus ».
En proie au nihilisme surgi des décombres du grand rêve impérial, Jack ressent un jour l'impérieux besoin de quitter l'univers étouffant des villes, « pour qui les enseignes au néon les affiches des films sales et déchirés, les gaz d'échappement des voitures, les phares tenaient lieu de lumière naturelle, de parfum des champs, de parterre moussu, d'animaux domestiques, de fleurs des prés ». « Pour pallier la stupidité du monde, il fallait d'abord procéder en quelque sorte à un véritable lessivage de cette stupidité, à une sanctification passionnée de ce que les moutons considéraient comme ridicule ».
Se purifier dans le suicide et rejoindre l'éther. Mais l'acte fatal, d'abandon à l'occidentale, échouera. « Jack était guéri maintenant. Il s'était trompé en pensant que son propre suicide entraînerait automatiquement la destruction de cet univers de moutons endormis ». Mishima, de retour de Grèce, a reçu l'illumination. Nietzsche, les rayons du soleil en Apollon ont ressuscité l'enfant pâle. Le corps et l'âme ne font qu'un et l'entretien de l'un favorise l'expression de l'autre. Cet état d'esprit nouveau, véritable révolution culturelle dans l'univers mental du jeune littérateur, Ken le magnifie. Placée sous le signe du soleil, astre de l'éternel recommencement, cette nouvelle nietzschéenne exalte le sacrifice de Kokubu Jirô, jeune étudiant quatrième dan de kendo, entièrement dévoué à son art. « Violence pure », Jirô rejette toute émotivité, mollesse, mépris, tous les « j'aimerais bien... » pour ne s'infliger que des « je dois... ». « L'homme n'a en fait que deux possibilités : être fort et droit, ou se donner la mort ». L'exigence de sa règle de conduite, la pression psychologique qu'impose l'excellence, transfigurent Jirô, ultime affirmation d'une pureté millénaire désormais anachronique. « Dans son dôjô, il était tel un dieu furieux : toute l'énergie et l'ardeur de l'entraînement semblaient venir de lui, rayonner et comme se propager autour de lui. Cette chaleur et cette passion, il les tenait sans doute du soleil, de cette boule de feu qu'il avait contemplée lorsqu'il était enfant ».
Art et spiritualité, défis lancés à la mort
Entrevu dans La Cigarette, le soleil irradie Jirô de sa force, le nimbe de son évidence divine : « Mais seul Jirô était là, transparent. Au milieu de ce monde troublé, il gardait une évidence cristalline (...) regard calme et vierge de tout sentiment ». Image sublime : « Inondé du soleil qui perçait à travers les arbres, sabre au côté (...). Du sang tombé de l'aile blessée se répandit sur la joue de Jirô ». Héros tragique de théâtre nô, Jirô, tout tendu vers la perfection du geste et de la pensée, sera vaincu par la médiocrité des siens. Trahi par la désinvolture de ses élèves, Jirô mesure le néant de sa tâche. Insupportable. « La lumière de la lampe de poche fit apparaître l'éclat de l'armure de laque noire, fit briller l'or du blason, les deux cotylédons dorés. Jirô, serrant son sabre de bambou entre ses bras vêtus d'indigo, était couché sur le dos, mort ». Le fil de soie qui le retenait toutes ces années à la vie s'était rompu.
Jumelle de la nouvelle Patriotisme (publiée dans le recueil La Mort en été), Ken préfigure, « antitestament », le crépuscule de Mishima. Le culte de la plénitude de l'instant, Mishima le découvre à l'époque dans la lecture des textes bouddhiques. « Ayant bien compris l'enseignement du Maître, il savait qu'il n'y avait pas à prier en vain pour un monde futur, ni à désirer un pays encore inconnu. Mais lorsque le soleil du soir colorait le ciel d'été, lorsque la mer n'était plus qu'un immense horizon pourpre, ses jambes d'elles-mêmes le conduisaient irrésistiblement au sommet du mont Shôjôgatake ». Placés dans la bouche du moine Anri (Henri), personnage central de La Mer et le couchant (Umi To Yukake, 1955), disciple français du grand Maître Rankei Dôryù (1213-1278), ces propos reflètent le dernier tournant de son œuvre.
Art et spiritualité, défis lancés à la mort, sont au centre de la dernière nouvelle, la plus longue aussi, Pélérinage aux Trois Montagnes (Mikumano Mode). Histoire d'amour étouffée et complexée entre un vieux maître en poésie tanka, professeur Fujimiya, et sa dévouée servante Tsuneko, Mishima tire de sa nouvelle le prétexte, convenons-en très scolaire, de résumer mille ans de littérature nippone, à la manière de La Mer de la fertilité, où la démonstration académique des préceptes bouddhistes et shinto prenaient le pas sur l'ardeur de la conviction. Mais, écrites sous la double tutelle de la poétesse Eifuku Monin et des Nihon Shoki (Annales du Japon, fondement du nationalisme impérial), ses pistes littéraires portent en elles l'idéal frontispice de son œuvre :
« Pour soutenir l'idée que, quelle que soit l'époque ou la société, c'est en regardant de beaux paysages que l'on compose de beaux poèmes, ne fallait-il pas, du moins pour une femme, posséder comme Monin, richesse, pouvoir et prestige, ou, si l'on était un homme, préserver une pensée ferme, inébranlable dans l'adversité ? (...) Eh bien, la leçon que l'on peut tirer des tankas d'Eifuku Monin, c'est précisément que la faculté de dissimuler fait partie de l'art lui-même, qu'elle en est même une des composantes des plus importantes ».
L'adolescence est un état qui devrait se poursuivre éternellement
Confessions d'un masque, Watari, Nagasaki, Jirô, Anri sont les multiples facettes de la même personne, réunies en un précieux document “auto-bibliographique” où perce la nostalgie de la jeunesse, jeunesse du monde, des hommes, des sentiments. N'écrivait-il pas dans La Cigarette, phrase qui transperça le cœur de Kawabata : « L'adolescence est un état qui devrait se poursuivre éternellement ».
► Laurent Schang, Nouvelles de Synergies Européennes n°35/36, 1998.
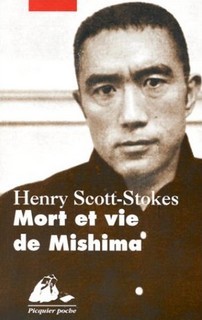 Mort et vie de Mishima est le titre de la biographie de Mishima par Henry Scott-Stokes qui fut son ami. Publiée en français chez Balland en 1985, elle vient d'être rééditée, révisée et mise à jour, par les excellentes éditions Philippe Picquier. L'auteur a eu raison de choisir comme titre “Mort et vie” et non “Vie et mort”, car c'est bien le suicide rituel du 25 novembre 1970 qui constitue le Couronnement de son existence, l'acte essentiel vers lequel il tendit en toute conscience. Dans Le Soleil et l'acier, il écrivait : « Le but de ma vie fut d'acquérir tous les divers attributs du guerrier ». Et cela fut accompli. À propos de l'implication politique de son acte, le biographe écrit : « L'acte de Mishima était, à la base, un cas classique de remontrance envers le monarque et ses conseillers. Au Japon, la ligne suivie en cas de désastre est que la personne la plus haut placée doit en assumer les conséquences, même si sa responsabilité individuelle reste en fait minime et d'ordre symbolique. Il n'était pas rare, pour des Japonais de la génération de Mishima, d'exprimer l'opinion que l'empereur aurait dû abdiquer en faveur de son fils aîné, le prince Akihito, actuel empereur. L'empereur lui-même semble avoir défendu cette position à 3 reprises : en 1945-1946, en 1948 et en 1951. En réalité, ce n'était pas le fait que l'empereur n'ait jamais abdiqué que lui reprochait Mishima, mais plutôt qu'il ait pu renoncer à ses prétentions à la divinité et à celle de ses ancêtres, ce qu'il fit lors du célèbre discours du Nouvel An de 1946, sous la pression américaine. Dans Les Voix des morts héroïques, Mishima écrivait : « Nadote sumerogi wa hito to naritamashi » (« Pourquoi fallait-il que l'empereur devienne un être humain ? »). C'est ainsi que l'empereur avait désavoué les sacrifices de millions d'hommes qui étaient morts en son nom. Aujourd'hui encore, débattre ouvertement de ces questions, avec l'ampleur qu'elles méritent, reste une tâche délicate au Japon. Fukashiro, le journaliste de l'Asahi mentionné plus haut, m'avait bien mis en garde lors de la rédaction de mon livre : “L'empereur reste notre ultime tabou”. Il entendait par là qu'il lui était impossible d'écrire librement au sujet de l'empire, et qu'il en était de même pour ses collègues. Hirohito fut le dernier des rois-prêtres au Japon et dans le monde entier. Même depuis sa mort en 1989 et la succession de son fils à la tête de l'empire, il n'est toujours pas d'usage chez les Japonais d'aborder ce sujet. En s'attaquant au tabou, Mishima est devenu tabou lui-même, ce qui est l'une des principales raisons pour laquelle il restera probablement une énigme pour ses compatriotes pendant des siècles ! En tant qu'Américain, H. Scott-Stokes ne pouvait guère apprécier le “fanatisme politique” de Mishima mais son amitié pour lui était réelle. Il écrit dans son épilogue : « Dans la dernière lettre que Mishima m'adressa le 4 octobre 1970, il me mit en garde contre “la fin du monde” qui s'approchait (sekai no owari). Je compris immédiatement qu'il comptait se suicider et de quelle manière il l'accomplirait. C'était un homme fier qui ne parlait jamais à la légère. Dans son “terrible discours corporel”, Mishima réclama à cor et à cri une réponse à sa question : “Que représente notre nation ?”. Ce qu'il avait tenté dans La Mer de la fertilité, c'était de tracer une carte panoramique de l'époque contemporaine japonaise. Il a peut-être échoué dans cette tâche, mais du moins est-il le seul à l'avoir tentée ». Ce qui est sûr, c'est qu'en regard de son acte sacrificiel, la littérature semble bien dérisoire.
Mort et vie de Mishima est le titre de la biographie de Mishima par Henry Scott-Stokes qui fut son ami. Publiée en français chez Balland en 1985, elle vient d'être rééditée, révisée et mise à jour, par les excellentes éditions Philippe Picquier. L'auteur a eu raison de choisir comme titre “Mort et vie” et non “Vie et mort”, car c'est bien le suicide rituel du 25 novembre 1970 qui constitue le Couronnement de son existence, l'acte essentiel vers lequel il tendit en toute conscience. Dans Le Soleil et l'acier, il écrivait : « Le but de ma vie fut d'acquérir tous les divers attributs du guerrier ». Et cela fut accompli. À propos de l'implication politique de son acte, le biographe écrit : « L'acte de Mishima était, à la base, un cas classique de remontrance envers le monarque et ses conseillers. Au Japon, la ligne suivie en cas de désastre est que la personne la plus haut placée doit en assumer les conséquences, même si sa responsabilité individuelle reste en fait minime et d'ordre symbolique. Il n'était pas rare, pour des Japonais de la génération de Mishima, d'exprimer l'opinion que l'empereur aurait dû abdiquer en faveur de son fils aîné, le prince Akihito, actuel empereur. L'empereur lui-même semble avoir défendu cette position à 3 reprises : en 1945-1946, en 1948 et en 1951. En réalité, ce n'était pas le fait que l'empereur n'ait jamais abdiqué que lui reprochait Mishima, mais plutôt qu'il ait pu renoncer à ses prétentions à la divinité et à celle de ses ancêtres, ce qu'il fit lors du célèbre discours du Nouvel An de 1946, sous la pression américaine. Dans Les Voix des morts héroïques, Mishima écrivait : « Nadote sumerogi wa hito to naritamashi » (« Pourquoi fallait-il que l'empereur devienne un être humain ? »). C'est ainsi que l'empereur avait désavoué les sacrifices de millions d'hommes qui étaient morts en son nom. Aujourd'hui encore, débattre ouvertement de ces questions, avec l'ampleur qu'elles méritent, reste une tâche délicate au Japon. Fukashiro, le journaliste de l'Asahi mentionné plus haut, m'avait bien mis en garde lors de la rédaction de mon livre : “L'empereur reste notre ultime tabou”. Il entendait par là qu'il lui était impossible d'écrire librement au sujet de l'empire, et qu'il en était de même pour ses collègues. Hirohito fut le dernier des rois-prêtres au Japon et dans le monde entier. Même depuis sa mort en 1989 et la succession de son fils à la tête de l'empire, il n'est toujours pas d'usage chez les Japonais d'aborder ce sujet. En s'attaquant au tabou, Mishima est devenu tabou lui-même, ce qui est l'une des principales raisons pour laquelle il restera probablement une énigme pour ses compatriotes pendant des siècles ! En tant qu'Américain, H. Scott-Stokes ne pouvait guère apprécier le “fanatisme politique” de Mishima mais son amitié pour lui était réelle. Il écrit dans son épilogue : « Dans la dernière lettre que Mishima m'adressa le 4 octobre 1970, il me mit en garde contre “la fin du monde” qui s'approchait (sekai no owari). Je compris immédiatement qu'il comptait se suicider et de quelle manière il l'accomplirait. C'était un homme fier qui ne parlait jamais à la légère. Dans son “terrible discours corporel”, Mishima réclama à cor et à cri une réponse à sa question : “Que représente notre nation ?”. Ce qu'il avait tenté dans La Mer de la fertilité, c'était de tracer une carte panoramique de l'époque contemporaine japonaise. Il a peut-être échoué dans cette tâche, mais du moins est-il le seul à l'avoir tentée ». Ce qui est sûr, c'est qu'en regard de son acte sacrificiel, la littérature semble bien dérisoire.
♦ Henry Scott-Stokes, Mort et vie de Mishima, Picquier,1996, 420 p. et 24 planches hors texte.
► Jean de Bussac, Nouvelles de Synergies Européennes n°24, 1996.
◘ Yukio Mishima et le Jieitai
 « Quand le tonnerre gronde dans le lointain, le temps qui passe à travers la lumière de la lampe, qui frappe à travers la fenêtre, et le son sourd qui s’ensuit paraissent incroyablement long. Dans mon cas particulier, il a duré 20 ans. La voix des héros disparus est la voix de la lampe. Dans un futur proche, la rumeur nostalgique du tonnere fera vibrer nos ventres virils et avec la promesse de fécondités sauvages fera vibrer aussi le cœur du Japon ».
« Quand le tonnerre gronde dans le lointain, le temps qui passe à travers la lumière de la lampe, qui frappe à travers la fenêtre, et le son sourd qui s’ensuit paraissent incroyablement long. Dans mon cas particulier, il a duré 20 ans. La voix des héros disparus est la voix de la lampe. Dans un futur proche, la rumeur nostalgique du tonnere fera vibrer nos ventres virils et avec la promesse de fécondités sauvages fera vibrer aussi le cœur du Japon ».
Cette phrase, Mishima l’a écrite dans la préface à Vie et mort de Hasuda Zenmei de la Kodakane Jirô. Il m’apparait superflu de souligner que Hasuda Zenmei a contribué durablement à la formation spirituelle et idéologique de l’adolescent Mishima. On le sait aujourd’hui : Hasuda, le 19 août 1945, peu de jours avant la défaite du Japon, servait encore l’Empire au titre de commandant de compagnie dans une base proche de Singapour. Hasuda apprend que le commadant du régiment avait lu lui-même à la troupe la déclaration de reddition de l’Empereur et avait demandé à ses hommes de donner le drapeau à l’ennemi. Hasuda le tue à coups de revolver et puis se suicide.
La signification de la mort de Hasuda est restée longtemps obscure, y compris pour Mishima : « Quand j’ai compris son geste, j’étais proche de la quarantaine : un âge peu éloigné de celui du Disparu... La signification d’une telle façon de mourir, comme une fulguration improvisée, a soudain éclairé les ténèbres épais qui assombrissaient mon propre long cheminement... ». Cette fameuse préface nous explique quels sont les rapports entre Hasuda et Mishima, mais elle nous livre aussi, pour la première fois, explicitement, la clef de voûte qui explique le propre suicide de Mishima et révèle l’arrière-plan politique, historique et culturel qui l’a justifié.
Cependant, si l’on jette un regard plus attentif, derrière les allégories de la “lampe” et du “tonnerre”, on repère, cachées, les étapes de l’iter spiritualis de Mishima. Pour beaucoup de citoyens dont les années d’adolescence et de jeunesse se sont passées pendant la guerre, l’expérience guerrière est devenue a posteriori un point de référence existentiel et politique indépassable. En particulier, pour tous les Japonais, qu’ils soient de droite ou de gauche, la défaite de 1945 est une expérience communément partagée et le turning point le plus significatif du siècle. Y. Mishima se souvient de cette expérience comme d’un sentiment de bonheur indicible, désormais perdu :
« ... Mis à part toute autre considération, il n’était pas étrange, à cette époque, pour les pilotes kamikaze, d’écrire : Tenno Heika Banzai (Vive l’Empereur !). Admettons que cette époque puisse revenir, ou revenir sous une autre forme ou ne jamais revenir. Et pourtant, moi, cette époque où il n’était pas étrange d’écrire [cette parole], je l’ai connue, et le fait de l’avoir connue, en y pensant, me donne une incroyable sensation de bonheur. Mais quelle fut cette expérience ? Quelle fut cette sensation de bonheur ? » (Débats sur les Japonais).
Plus tard, cependant, cette “sensation de bonheur”, ressentie par l’adolescent Mishima, qui avait entrevu la guerre sous la forme de la “lumière d’une lampe”, chavire misérablement avec la défaite. La “sensation du tonnerre”, qui s’ensuivit, et qui aurait apporté ce bonheur, n’a plus jamais été ressentie. Y. Mishima va vivre le temps de l’après-guerre (« une époque faite de fictions », « un veillissement en toute harmonie »), pendant 25 années « terriblement longues » pour se retrouver lui-même transformé en “lampe”, pour faire vibrer par son propre “tonnerre”, d’acier et de sang, le cœur des hommes, le flux de l’histoire.
Les banderoles qu’il a fait claquer au vent sur la terrasse du Quartier Général d’Ichigaya le 25 novembre 1970 proclamaient :
« Nous, les hommes du Tate-no-Kai (Secte des Boucliers / Shield Society selon la propre traduction anglaise de Mishima) avons été élevé par le Jieitai (le “Corps d’Auto-Défense”, soit l’actuelle armée japonaise, ndlr). En d’autres morts, le Jieitai a été pour nous un père, un frère aîné. Alors pourquoi avons-nous été poussés à commettre une telle action ? Moi, depuis 4 ans, les autres membres étudiants de notre société, depuis 3 ans, avons été acceptés dans le Jieitai à titre de quasi-officiers, nous avons reçu une instruction sans autre fin. Par ailleurs, nous aimons le Jieitai profondément, nous avons rêvé du véritable Japon, de ce Japon qui n’existe plus désormais en dehors de ces murs d’enceinte. C’est justement ce Japon que nous avons pleuré pour la première fois, nous, hommes nés après la guerre. La sueur que nous avons dépensée est pure. Tous ensemble, nous avons couru et marché à travers les champs aux pieds du Fukuyama, nous étions des camarades unis par l’esprit de la patrie. Nous n’avons aucun doute. Pour nous, le Jieitai est comme un pays natal. Dans la sordidité du Japon actuel, nous avons réussi à respirer seulement en ce lieu, où l’air est excitant. L’esprit qui nous a été communiqué par les officiers et les instructeurs est indépassable. Alors pourquoi avons-nous posé un acte aussi extrême ? Cela peut paraître un paradoxe, mais j’affirme que nous l’avons posé parce que nous aimions le Jieitai ».
27 ans se sont écoulés depuis le suicide de Mishima et le Jieitai, qu’il avait tant aimé, a changé lentement. Il avait été une sorte de “Cendrillon” des institutions japonaises ; il s’est transformé en une armée quasi normale et respectée. Dernièrement, il a participé (ironie de l’histoire !) pour la première fois aux activités de “pacification” sous la bannière de l’ONU au Cambodge, à Madagascar et au Liban. Désormais, le Parti Socialiste (social-démocrate) japonais le “reconnaît”. Deux occasions ont permis au Jieitai de se placer sous les feux de la rampe : l’action humanitaire menée à la suite du tremblement de terre de Kobe et l’aide technique apportée aux forces de police lors de l’attaque au gaz neurotoxique perpétré par la secte Aum Shinri-kio, il y a 2 ans.
Le problème fondamental pour le Japon demeure toutefois la constitution pacifiste imposée par les Alliés après 1945. L’article 9 de cette constitution interdit au pays de façon unilatérale l’usage de la force (militaire). C’est le plus gros obstacle à la restauration complète des droits de l’État japonais. Mishima, dans un bref essai intitulé Le Tate-no-kai, publié dans la revue anglaise Queen, écrivait à propos de la constitution pacifiste :
« Je suis las de l’hypocrisie de l’après-guerre japonais : par là, je ne veux pas dire que le pacifisme est une hypocrisie, mais vu que la Constitution pacifiste est utilisée comme excuse politique tant par la gauche que par la droite, je ne crois pas qu’il existe un pays au monde, mis à part le Japon, où le pacifisme est autant synonyme d’hypocrisie. Dans notre pays, le mode de vie que tous honorent est celui d’une existence définitivement soustraite à tout danger, un mode de vie tout compénétré de sinistrose, celui des pacifistes et des adeptes de la non-violence. En soi, cette chose n’est pas criticable, mais le conformisme exagéré des faux intellectuels m’a convaincu que tous les conformismes sont une calamité et que les intellectuels, au contraire, devraient mener une vie dangereuse. D’autre part, l’influence des intellectuels et des salons socialistes s’est développée de manière absurde et ridicule. Ils conseillent aux mères de ne pas donner à leurs garçons des jouets imitant des armes à feu et considèrent que c’est du militarisme d’aligner les enfants sur des files à l’école et de leur demander de se nommer et d’énoncer leur numéro... ce qui a pour résultat que les enfants se rassemblent de manière éparpillée et mollement comme une bande de députés ».
L’action de Mishima, de Morita et des autres membres du Tate-no-kai au Quartier Général d’Ichigaya fut pour l’essentiel un acte symbolique, destiné à donner le coup d’envoi à une révision de la constitution et à la transformation du Jieitai en une armée nationale légitime. Dans un certain sens, l’échec apparent de cette tentative a toutefois été le point de césure entre les 2 droites japonaises : la droite contre-révolutionnaire des années 60 et la nouvelle droite radicale des années 70 (Shin-Uyoku).
► Giuseppe Fino, Nouvelles de Synergies Européennes n°35/36, 1998. (article issu de Marginali n°22, avril 1998)
 ♦ Du même auteur : Mishima, écrivain et guerrier, Trédaniel/La Maisnie, 1983, 140 p. (contient 12 photos). Cette biographie se donne pour tâche de comprendre Mishima dans son activité d'essayiste, versant éthique de son travail d'écrivain et de dramaturge. L'auteur resitue Mishima dans un courant néo-romantique, puis évoque son parcours d'écrivain, pour ensuite approfondir sa vision de la culture (l'union de la Plume et du Sabre) et sa pensée politique. Le fil conducteur de son itinéraire si complexe en apparence ressort ainsi bien : « l'exaltation de la force et de la beauté physique, et plus généralement, de l'esprit primordial et héroïque » ainsi que de « sa foi dans la transcendance ».
♦ Du même auteur : Mishima, écrivain et guerrier, Trédaniel/La Maisnie, 1983, 140 p. (contient 12 photos). Cette biographie se donne pour tâche de comprendre Mishima dans son activité d'essayiste, versant éthique de son travail d'écrivain et de dramaturge. L'auteur resitue Mishima dans un courant néo-romantique, puis évoque son parcours d'écrivain, pour ensuite approfondir sa vision de la culture (l'union de la Plume et du Sabre) et sa pensée politique. Le fil conducteur de son itinéraire si complexe en apparence ressort ainsi bien : « l'exaltation de la force et de la beauté physique, et plus généralement, de l'esprit primordial et héroïque » ainsi que de « sa foi dans la transcendance ».
◘ Sur le Japon
Entretien avec le Prof. Guiseppe Fino
Aujourd’hui, la modernité a certes récupéré le Japon et l’a enveloppé dans sa grisaille, mais de temps en temps, un trait de lumière perce l’obscurité, nous rappelant un passé assez récent qui n’est pas encore complètement oublié. Le Professeur Giuseppe Fino vit au Japon. Il est l’auteur d’une étude sur Yukio Mishima (Mishima et la restauration de la culture intégrale, 1980). Nous lui avons posé quelques questions sur les “manifestations lumineuses qui rappellent la chaleur incandescente du Soleil Levant.
 ♦ Q. : Il y a quelques temps, les journaux télévisés italiens ont évoqué l’épisode de ce soldat japonais qui considérait être encore en guerre, en dépit de la défaite de 1945. Que signifie le comportement de ce soldat pour les Japonais d’aujourd’hui ?
♦ Q. : Il y a quelques temps, les journaux télévisés italiens ont évoqué l’épisode de ce soldat japonais qui considérait être encore en guerre, en dépit de la défaite de 1945. Que signifie le comportement de ce soldat pour les Japonais d’aujourd’hui ?
R. : Au Japon aussi, les journaux télévisés ont rendu compte de la disparition de Yokoi Shoichi, le soldat japonais qui avait continué à “combattre” dans la jungle de l’île de Guam après 1945. Pour les Japonais de “gauche”, nés et élevés dans le climat pacifiste et démocratique de l’après-guerre, le comportement de Yokoi est difficilement compréhensible et acceptable : pour eux, c’est une manifestation du fanatisme qu’il faut taire ou dont il faut avoir honte. Pour les Japonais nés avant la guerre ou pour ceux qui ont encore la fibre patriotique, le comportement de Yokoi est exemplaire et héroïque. Pour les plus jeunes générations, en revanche, le nom de ce soldat ne dit hélas plus rien. Je voudrais ajouter une considération personnelle. Plus que Yokoi Shoichi, qui, en quelque sorte avait fini par s’accommoder au climat de l’après-guerre, je voudrais rendre hommage à l’un de ses camarades, Onada Hiroo, qui avait préféré abandonner le Japon consumériste et américanisé pour aller s’installer en Amérique du Sud et y “élever des veaux et des lapins”.
♦ Dans le livre Tenchû (Punition du ciel), paru aux éditions Sannô-kai, on décrit les événements qui ont conduit à la révolte des officiers de 1936. Existe-t-il aujourd’hui au Japon des forces politiques qui se souviennent de ces événements, de ces hommes et des idéaux de cette époque ?
Non, il n’y a absolument aucune réminiscence valable. L’insurrection des “Jeunes Officiers” du 26 février 1936 (Ni-niroku jiken) n’est plus qu’un sujet de romans, d’essais et de films un peu nostalgiques. Les familles des “révoltés”, qui ont été exécutés, ont constitué des associations pour les réhabiliter mais aucun groupe politique ne se réfère plus à cette expérience, qualifiée de “pure néo-romantisme fasciste”. Enfin la droite japonaise extra-parlementaire considère que cet épisode est déshonorant et “hérétique”, car il n’a pas été approuvé par l’Empereur. Cela en dit long sur le conformisme qui règne au Japon. Mishima est le seul à avoir donné en exemple le sacrifice de ces “Jeunes Officiers” et à les avoir réhabilité dans l’après-guerre.
♦ Mishima est l’auteur japonais le plus traduit en Europe, mais la plus grande partie de ses lecteurs se contente de l’aspect narratif de ses œuvres. Prof. Fino, vous êtes le seul à avoir reconstitué les racines culturelles de l’œuvre de Mishima dans Mishima et la restauration de la culture intégrale ; pouvez-vous nous synthétiser les points essentiels de sa vision du monde ?
Les racines culturelles de Mishima sont nombreuses et complexes. Dans sa jeunesse, il a fait partie du mouvement néo-romantique de Yasuda Yojuro et du poète Ito Shizuo, mais il a surtout été influencé par Hasuda Zenmei, le théoricien de la “belle mort”. Dans l’après-guerre, après une période de réflexion et d’activité littéraire un peu “intimiste” et “autobiographique”, Mishima s’est mis à redécouvrir et réinterpréter la culture japonaise (Nipponjin-ron ou Débats sur les Japonais). Dans son essai Défense de la culture (1969), Mishima découvre 3 caractéristiques de cette culture japonaise, à ses yeux essentielles : la cyclicité, la totalité et la subjectivité. Pour Mishima, l’action, elle aussi, est culture. La forme la plus élevée de la culture est le bunburyodo, l’union de l’art et de l’action. Mishima retrouve aussi, dans la foulée, la philosophie activiste et intuitive du Wang Yang-ming (en japonais : Yomeigaku), le bushido intégral de l’Hagakuré (Cf. Il pazzo morire, ed. Sannô-kai), le traditionalisme ou l’anti-modernisme du Shinpuren (Ligue du Vent Divin) et l’idéalisme impérialiste et romantique des “Jeunes Officiers” du Ni niroku jiken. Au centre de la pensée de Mishima demeure toutefois l’Empereur comme concept culturel suprême, corollaire de son opposition politique contre-révolutionnaire et de son implacable critique de l’intellectualisme pacifiste et démocratique de l’après-guerre.
♦ En Occident, c’est devenu une habitude de pratiquer des disciplines physiques extrême-orientales, tantôt comme pratiques sportives tantôt comme disciplines martiales. Cependant, je doute qu’il soit resté beaucoup d’éléments originaux dans ces disciplines telles qu’elles sont pratiquées en Occident. Qu’en est-il au Japon ?
La situation au Japon n’est guère différente. Surtout pour le judo et le karaté, il devient de plus en plus difficile de trouver des palestres donnant tout son poids à l’aspect “spirituel” de ces disciplines qui ne sont pas seulement sportives et agonales. La situation est légèrement meilleure dans les palestres de kendo et d'aïkido. Elle est satisfaisante dans ceux qui s’adonnent au kyudo (tir à l’arc) et au i-ai (discipline de l’épée nue). Telle est du moins mon impression. Je dois vous confesser que je n’ai jamais fréquenté que les salles de judo...
♦ Est-il possible de recevoir du Japon ultra-technologique d’aujourd’hui des enseignements valables pour l’Homme de la Tradition ?
Oui, il existe des possibilités, mais elles sont limitées à quelques monastères Zen et à quelques palestres d’arts martiaux, justement ceux qui sont influencés par la pensée Zen. Il faudrait une bonne dose de patience et de chance avant de trouver le Maître juste et le milieu adapté. Pour ceux qui voudraient éventuellement pratiquer le Zen, je conseille un engagement inconditionnel à long terme, si possible auprès des monastères de l’École ou de l’Ordre Rinzai.
► Nouvelles de Synergies Européennes n°35/36, 1998. (propos parus dans Margini n°21, juin 1998)
◘ Mishima, dernier des samouraïs - 
 « Nous vous présentons une valeur qui est plus élevée que le respect de la vie. Cette valeur n'est ni la liberté ni la démocratie. Cette valeur, c'est le Japon, le pays de notre histoire et de notre tradition, c'est le Japon que nous aimons » (Mishima, Gekibun [Manifeste]).
« Nous vous présentons une valeur qui est plus élevée que le respect de la vie. Cette valeur n'est ni la liberté ni la démocratie. Cette valeur, c'est le Japon, le pays de notre histoire et de notre tradition, c'est le Japon que nous aimons » (Mishima, Gekibun [Manifeste]).
Parmi les héros de ce sombre siècle qui s'achève, Mishima prend une place particulière, d'abord parce qu'il a été un décadent. Après une enfance dorlotée, il se découvrit d'abord des tendances sado-masochistes d'orientation homo-érotique ; et, conséquence logique, aborda des écrivains occidentaux décadents, comme Thomas Mann. Derrière ses déguisements en acteur, en modèle pour photographe, en prince des poètes et en journaliste politique, il a toutefois suivi sa véritable vocation : témoigner pour le Japon éternel dans la seule forme encore possible, la pure affirmation de l'éternité par la mort de l'éphémère.
Mishima n'était pas un archange terrestre comme Codreanu, pas un bouc émissaire ascétique comme Rudolf Hess, par un Bouddha martial comme Ungern-Sternberg. Il était un écrivain décadent, qui a prouvé qu'au départ de cette décadence, il est aussi possible de s'élever vers l'héroïsme. La reconnaissance des principes sur lesquels reposent l'ordre, la tradition et le patriotisme, oblige à être conséquent dans ses actes. Tirer au flanc, dire que l'on n'est pas taillé dans le même bois que les héros, sont des attitudes sans valeur. Dans l'Hagakuré, fil conducteur de la philosophie des Samouraïs, il est écrit :
« Un Samouraï Nabeshim n'a pas besoin de force spirituelle ni de talent ; pour le dire en un seul mot : il suffit qu'il ait la volonté de porter la maison princière sur ses propres épaules ».
Dans son choix d'extraits de l'Hagakuré, Mishima a rédigé quelques commentaires sur cette source d'énergie, accessible à tous les hommes dotés d'une volonté de décider :
« Jocho [l’auteur de l'Hagakuré] nous indique qu'il s'agit ici de la force la plus importante et la plus originelle qui meut l'homme vers ses actions. Si la vie normale est limitée par la vertu de réserve, alors les exercices de la vie quotidienne ne peuvent faire passer l'idée en acte, un acte qui transcende ces exercices par son intensité. L'acte a besoin d'un degré plus élevé de certitude de soi et aussi de la conviction que l’on doit soi-même porter la maison sur ses épaules. Comme les Grecs, Jocho connaissait très bien la magie, le clinquant et l'effroi de ce que l'on appelle l'hybris » (Mishima, D'une éthique de l'action).
Or cet hybris est précisément ce qui manque à notre époque. Celui qui est encore en mesure de prendre acte en profondeur du déclin qui nous entoure, semble penser que les autres devraient entreprendre quelque chose, que tant que les autres ne font rien, son action, elle aussi, est dépourvue de sens ; ou qu'il faut d'abord rassembler 1.000, puis 10.000, puis 100.000 personnes, ou qu'il faut... à moins qu'il ne faille... ou bien il faudrait que... Dans de telles circonstances, rien ne se fait.
« Voulez-vous laisser mourir votre âme ? »
 Le 25 novembre 1970, Mishima se rend — accompagné de 4 disciples, ses étudiants, vêtus d'uniformes très élégants qu'ils se sont faits confectionner — au quartier général de l'armée japonaise, tient son dernier “discours littéraire” sous la forme d'un appel à un coup d'État devant les soldats convoqués, et sanctionne ses principes par le témoignage le plus élevé, en se donnant la mort selon le mode japonais du seppuku, le “couper-le-ventre” : « Redonnons au Japon sa véritable forme et mourrons ! Ou voulez-vous vous maintenir en vie en laissant mourir votre âme ? ».
Le 25 novembre 1970, Mishima se rend — accompagné de 4 disciples, ses étudiants, vêtus d'uniformes très élégants qu'ils se sont faits confectionner — au quartier général de l'armée japonaise, tient son dernier “discours littéraire” sous la forme d'un appel à un coup d'État devant les soldats convoqués, et sanctionne ses principes par le témoignage le plus élevé, en se donnant la mort selon le mode japonais du seppuku, le “couper-le-ventre” : « Redonnons au Japon sa véritable forme et mourrons ! Ou voulez-vous vous maintenir en vie en laissant mourir votre âme ? ».
Le cœur de la véritable forme impériale du Japon est l'Empereur, le Tennô. C'est lui qui est le point central entre le ciel et la terre ; il est le cœur du peuple japonais. L'exercice de son pouvoir au sein de l'État est peut-être limité, mais il agit seul par son existence, son être, dans la mesure où, homme, il représente les hommes devant Dieu. Justement parce que le Tennô n'agit pas, mais est, il a besoin d'organisation de protection, de ligues masculines, de guerriers, qui rendent possible le déploiement de son impérialité. Mishima, justement, a créé en 1968 une société de ce type, le Tate-no-kai (Communauté du bouclier). Deux douzaines d'étudiants, pour lesquels Mishima lui-même avait conçu des uniformes, qui recevaient une instruction plus sportive que militaire sur les terrains de manœuvre des forces d'auto-défense japonaises, au pied de la montagne sacrée, le Fuji. Leur loyauté n'allait pas à Mishima, mais à travers lui, au Tennô !
Ces samouraïs modernes n'étaient pas soudés entre eux à la manière de leurs anciens, c'est-à-dire par le mérite d'une vie vertueuse, mais par l'éventualité d'une mort vertueuse. Cette mort est une mort pour la nation, pour son expression suprême, le Tennô. L'objectif de telles communautés de combat n'est pas d'atteindre des objectifs politiques, mais de mourir en communauté. Les résultats politiques — et Mishima cultivait évidemment des idées politiques et une vision de l'État — surviennent comme produits annexes de l’action pure. L'action pure et la forme d'approche la plus élevée du mode d'existence pur du Tennô.
Dans le monde décadent, occidentalisé et démocratisé, du Japon actuel, la Tradition n'est évidemment plus présente et la pratique du seppuku acquiert l'aspect d'un sacrifice, qui peut et doit appeler un retour, le lever du soleil nippon. Mishima a prévu le lever du soleil intérieur dans un de ses derniers romans :
« Isao respira profondément, se frotta le corps de la main gauche, ferma ensuite les yeux, puis dirigea la pointe de la dague, qu'il avait prise de la main droite, les doigts de la main gauche placés à l'endroit précis, il appuya avec toute la force de son bras droit. Juste au moment où la lame lui perça le ventre, derrière ses paupières, le disque lumineux et rouge du soleil se leva » (Mishima, Sous le dieu de la tempête).
Les 4 principes de la mutation Intérieure du Samouraï
Mishima avait une brillante carrière d'écrivain derrière lui, qui avait démarré, pour satisfaire à l'air du temps, avec un livre qui fit scandale par sa coloration érotique, Confession d'un masque. Il pratiquait le body building, aimait danser avec des hommes et battait son épouse. Ces activités avaient un rapport avec sa philosophie et avec la forme de sa mort : mais elles reflètent trop à l'évidence ses tentatives d'approcher la beauté, la force et la mort. Avec des moyens terrestres, on ne peut que montrer (de loin) ces qualités, mais on ne peut aucunement les réaliser, les faire passer à l'Être. Dans la mort, le samouraï peut réaliser les principes éternels, s’il a préalablement subi une mutation intérieure, que nous pouvons résumer en 4 étapes avec Julius Evola (cf. La voie du Samouraï) :
♦ Dominer les impressions et les pulsions venues de l'extérieur (l'ascèse virile)
♦ Imposer sa propre autorité à son organisme; impassibilité (ce qui correspond à la formation militaire au sens étroit du terme)
♦ Contrôler les passions et les sentiments, du moins sous la forme d'un équilibre intérieur (sans toutefois les émousser)
♦ Rejet et dissolution du moi.
Isao face au Soleil
Ce n'est qu'avec ce rejet du moi, avec cette attitude qui consiste à ne plus prendre son moi pour important, que l'on est prêt à accepter la mort héroïque dans la bataille ou le seppuku. Tous ceux qui s'ôtent la vie par suicide ne sont pas des amoureux de la mort. La noce avec la mort doit être préparée et choisie. Dans ce cas, on ne se rate pas, comme le montre ce bref dialogue dans Sous le dieu de la tempête, entre un lieutenant et un étudiant, qui veut faire un putsch :
« L'insurrection de la Ligue de la Tempête des Dieux a été un échec ; cela ne vous fait-il rien ? ».
« Ce n'était pas un échec ».
« Vous trouvez ? Mais soit, sur quoi repose votre croyance ? » « Sur le sabre », répondit Isao, sans dire un mot de trop. Le lieutenant se tut un instant. Il semblait soupeser dans son esprit la prochaine question.
« Bien. Mais alors je voudrais savoir ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même ».
Dans un murmure, mais de manière décidée, Isao lui dit : « Face au soleil... Sur le sommet d'une falaise abrupte quand le soleil se lève, prier le disque levant... Jeter mon regard vers le bas, sur la mer étincelante... et, au pied d'un vieux et vénérable pin, me tuer avec mon sabre... Voilà mon souhait le plus profond ».
► Martin Schwarz, Nouvelles de Synergies Européennes n°48, 2000.
♦ L'auteur : Martin Schwarz, traducteur de Raido - Die Welt der Tradition : Ein Handbuch (Verlag Zeitenwende, 2000), manuel du cercle culturel Raido qui a son siège à Rome, et qui se donne pour tâche le relèvement authentique de la Tradition dans les domaines culturel, religieux et politique. La forme didactique entend offrir une contribution à la formation d'une nouvelle élite de promoteurs de la Tradition. La première partie offre un bon aperçu des aspects de la cosmologie traditionelle ; quant à la seconde, elle développe les conditions d'une structure à la fois avant-gardiste et de type traditionnel dans le monde actuel afin de rétablir celui-ci dans sa dimension cosmique et pluridimensionnelle. Cet dimension pratique, donnant à exercer un ethos chevaleresque au sein d'une communauté, est inspirée par les bases fermes de la Garde de fer de Codreanu. Par ailleurs, M. Schwarz est animateur du site Eiserne Krone, qui se caractérise par une défense de l'entente avec l'islam traditionnaliste intégré au sein d'un espace eurasien, non sans parfois un certain prosélytisme qui a pu soulever certaines réserves.
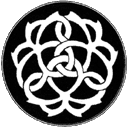
◘ L'esthétique de Yukio Mishima - 
 L'Institut Universitaire Oriental de Naples a organisé, le 28 avril 1997, un congrès international sur le thème « Mishima Yukio, entre ironie et tragédie ». Après l'ouverture des travaux, par Paolo Calveffi, il y a eu une intervention de Donald Keene, le plus fameux parmi les historiens occidentaux, spécialiste de la littérature japonaise et grand ami de l'auteur. il a prononcé un exposé sur l'esthétique de Mishima dont nous vous proposons un extrait (avec l'aimable autorisation de l'auteur).
L'Institut Universitaire Oriental de Naples a organisé, le 28 avril 1997, un congrès international sur le thème « Mishima Yukio, entre ironie et tragédie ». Après l'ouverture des travaux, par Paolo Calveffi, il y a eu une intervention de Donald Keene, le plus fameux parmi les historiens occidentaux, spécialiste de la littérature japonaise et grand ami de l'auteur. il a prononcé un exposé sur l'esthétique de Mishima dont nous vous proposons un extrait (avec l'aimable autorisation de l'auteur).
Hors de son pays, Y. Mishima est probablement le Japonais le plus célèbre de l'histoire de ces dernières décennies. Les Américains et les Européens, qui ont bien du mal à retenir le nom d'un empereur, d'un homme politique, d'un général, d'un savant ou d'une localité du Japon, connaissent le nom de Mishima et même, souvent, ses œuvres. Ceci est naturellement dû à son suicide spectaculaire mais, même avant cela, ce fut le seul Japonais cité par le très sérieux Enquire Magazine parmi les cent personnages principaux du globe.
La mort de Mishima, le 25 novembre 1970, a été un véritable choc pour les Japonais. Beaucoup d'entre eux furent alarmés par ce qu'ils craignaient être une recrudescence du nationalisme de droite qui avait dominé le Japon avant 1945. Les commentateurs commencèrent à publier des explications concernant le geste de Mishima et ses motivations et s'exprimaient aussi sur le pourquoi il avait choisi le seppuku, le démembrement rituel. Certains écrivains, se demandant peut-être quelles raisons pouvaient l’avoir poussé dans son choix, suggérèrent que Mishima avait découvert qu'il ne pouvait plus écrire. Le Premier ministre japonais définit le suicide de Mishima comme un acte de pure folie. Par la suite, de nombreuses interprétations furent formulées. Mon interprétation personnelle est que sa mort a été le couronnement d'une vie dédiée à un type particulier d'esthétique (*).
“Bu”, qui signifie “guerrier”
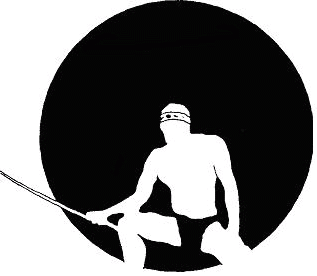 Dans ses dernières œuvres — un manifeste (geki) et 2 poésies d'adieu au monde (jisei) — Mishima s'auto-définit comme une ébauche de soldat, déçu et attristé par les conditions misérables que connaissait son pays, au point de sacrifier sa vie en signe de protestation. Mishima laissa des dispositions pour que son nom posthume, le nom bouddhiste qui serait gravé sur sa stèle, comprenait le mot bu, qui signifie guerrier. Je ne peux m'empêcher de croire que son dernier manifeste et ses dernières poésies représentaient une sorte d'auto-hypnose, dans la tentative de se convaincre lui-même qu'on se souviendrait de lui plutôt comme un patriote que comme un écrivain. Sa dernière œuvre littéraire fut un tanka composé le 23 novembre 1970, 2 jours avant de s’en aller, en compagnie des jeunes qu'ïl avait choisis comme témoins de son immolation, pour le quartier général de la Force d'Auto-Défense :
Dans ses dernières œuvres — un manifeste (geki) et 2 poésies d'adieu au monde (jisei) — Mishima s'auto-définit comme une ébauche de soldat, déçu et attristé par les conditions misérables que connaissait son pays, au point de sacrifier sa vie en signe de protestation. Mishima laissa des dispositions pour que son nom posthume, le nom bouddhiste qui serait gravé sur sa stèle, comprenait le mot bu, qui signifie guerrier. Je ne peux m'empêcher de croire que son dernier manifeste et ses dernières poésies représentaient une sorte d'auto-hypnose, dans la tentative de se convaincre lui-même qu'on se souviendrait de lui plutôt comme un patriote que comme un écrivain. Sa dernière œuvre littéraire fut un tanka composé le 23 novembre 1970, 2 jours avant de s’en aller, en compagnie des jeunes qu'ïl avait choisis comme témoins de son immolation, pour le quartier général de la Force d'Auto-Défense :
La nuit, le vent de la tempête murmure le message,
qui tombe devant le monde et devant les hommes qui pavoisent cette chute,
c'est la chute d'une fleur.
Ce tanka est un pastiche du langage et des images des poésies jisei écrites par d'innombrables soldats japonais avant de mourir. Par le verbe “tomber”, Mishima entendait bien sûr “mourir”. Les autres évoquaient l’idée de la mort, mais le samouraï (et, par extension, le poète lui-même) était une fleur parmi les hommes car il était prêt à mourir, comme la fleur du cerisier, qui se dissout en un instant. Au mois de juillet de cette même année, Mishima avait écrit un autre tanka, considéré aussi comme un jisei :
Pendant combien d'années
le guerrier a-t-il supporté le tintement
de l'épée qu'il portait à son côté :
la première gelée
s'est déposée cette nuit
Je ne parviens pas à comprendre ce que Mishima entendait exactement par “première gelée” (hatsushimo) mais c'était un terme incongru dans une poésie écrite au cours d'un mois de juillet. Peut-être le poète annonçait, avec 4 mois d'avance, le moment de sa mort, en novembre, quand la terre est recouverte d'une gelée immaculée.
La poésie d'adieu des samouraï
Celles-ci étaient les 2 dernières tanka qu'il écrivit [tr. fr. Mitsuo Yuge, Nouvelle Revue Française n°219, 1970]. C'étaient aussi les premières depuis 1942, lorsqu'ïl avait 17 ans. Pendant 28 ans, il n'avait pas ressenti le besoin d'utiliser la forme classique de la poésie japonaise comme véhicule de ses émotions, mais il était résolu à jouer jusqu'au bout le rôle du samouraï mourant et la poésie d'adieu au monde représentait un des éléments de ce rôle. Les jisei étaient composés aussi par ceux qui mouraient de vieillesse, mais les jisei de Mishima ont quelque chose de sinistre. Il nous dit que, jusque là, il a ignoré intentionnellement le tintement de son épée, en luttant pour étouffer la colère, mais maintenant il a perdu patience et il laissera gagner l'épée.
Le premier roman important de Y. Mishima, Kamen no Kokuhaku, publié en 1949 quand il n'avait que 24 ans, raconte comment l’auteur s'est senti obligé de porter un masque devant les autres. Au début il aurait pu porter le masque comme un instrument d'autodéfense, comme le fit Dazai Osamu, écrivain que Mishima n'a jamais aimé. Dazai écrivait que, étant très jeune, il avait découvert qu'il était très différent de ceux qui le côtoyaient et la seule façon de se défendre des autres était de porter un masque et faire semblant d'être comme eux. Derrière ce masque, se cachait sûrement une expression de pitié pour soi-même.
Mourir avec son masque solidement attaché au visage
Mishima portait le masque pour d'autres raisons. Il essayait de modeler son visage dans le masque qu'il avait choisi. Il utilisait le masque pour vaincre la sensibilité, la timidité et la pitié pour soi-même que Dazai défendait jalousement sous le sien. Mishima parvint à transformer le masque en partie intégrante de son corps et il mourut avec son masque solidement attaché à son visage.
Le masque (l'homme d'action franc et simple) et l’écrivain Mishima croyaient tous les 2 dans la beauté de la mort prématurée. Quand Mishima était un lycéen de la Peer's School, il était surtout attiré par les œuvres et la personnalité de Raymond Radiguet, le brillant écrivain français disparu en 1923 à l'âge de 20 ans. Pendant tout son itinéraire d'écrivain, Mishima fut toujours fasciné par la jeunesse et surtout par la mort prématurée. Au contraire du Docteur Faust, qui désira la jeunesse seulement après avoir vieilli, Mishima voulait la jeunesse, même quand il était encore très jeune, non la jeunesse éternelle mais celle qui se brise avec la tragique rapidité des fleurs du cerisier.
Jeunesse éternellement belle...
 En 1966, à l'âge de 41 ans, il écrivait : « Je crois très profondément que les vieux seront éternellement laids et les jeunes éternellement beaux. Je crois que la sagesse des vieux est éternellement ténébreuse et que les actions des jeunes resteront transparentes à jamais. Plus on vit et plus on empire. En d'autres mots, l'existence humaine n'est qu'un parcours à l'envers de décadence et de déclin ».
En 1966, à l'âge de 41 ans, il écrivait : « Je crois très profondément que les vieux seront éternellement laids et les jeunes éternellement beaux. Je crois que la sagesse des vieux est éternellement ténébreuse et que les actions des jeunes resteront transparentes à jamais. Plus on vit et plus on empire. En d'autres mots, l'existence humaine n'est qu'un parcours à l'envers de décadence et de déclin ».
Je ne peux pas démontrer que Mishima ait été influencé par le moine bouddhiste du XIVe siècle Yoshida Kenko, mais leurs façons de s'exprimer sont étonnamment proches. Kenko, qui a exercé une influence capitale sur l'évotution de l'esthétique japonaise, insistait sur l'importance de la caducité des choses. Même les Japonais qui n'ont jamais lu le Tsurezuregusa peuvent se reconnaître dans cette idée, comme le montre leur amour particulier pour les fleurs du cerisier. Il est vrai que les fleurs du cerisier sont fort jolies, mais pas assez pour éclipser la beauté des fleurs du prunier ou du pêcher ; mais les Japonais plantent des cerisiers n'ïmporte où, même dans des régions où le climat n'est pas idéal et ils sont vraiment peu intéressés par les fleurs du prunier ou du pécher.
Les trois jours de gloire des fleurs de cerisier
Très probablement, la fascination des fleurs du cerisier ne réside pas tellement dans leur beauté que dans leur caducité. Les fleurs du prunier restent sur l'arbre au moins un mois et il existe d'autres arbres fruitiers dont les fleurs ne résistent qu'une semaine, mais les fleurs du cerisier tombent après à peine 3 jours. En outre, à la différence du prunier et du pêcher, le cerisier ne produit pas de fruits comestibles, les Japonais plantent ces arbres uniquement pour leurs 3 jours de gloire. En fin de compte, je me demande si l'insistance, souvent soulignée, de Mishima pour la beauté de la mort prématurée n'avait pas, après tout, des origines proches de celles que je viens d'évoquer.
► Donald Keene, Nouvelles de Synergies Européennes n°48, 2000. (article paru dans Sole 24 Ore, avril 1997, tr. fr. : LD)
* note en sus :
« S'il tenait un discours engagé, Mishima, même à la fin de sa vie, restait profondément apolitique. Malgré ses sympathies de droite, il ne coopéra jamais avec les douteux groupes réactionnaires, qu'il traita plutôt rudement dans des romans comme Les Chevaux échappés. Il se montrait caustique avec les politiciens et les hommes d'affaire qui dirigeaint le pays, mais pour des motifs différents de ceux de ses collègues de gauche. Jeune, il n'avait jamais montré un intérêt particulier pour ces militaires qui avaient voulu renverser la classe dirigeante, mais il s'associa plus tard à leur patriotisme magnifique et aveugle, parce qu'il transcendait les ambitions personnelles, et même l'instinct de conservation. Mishima proclama un jour sa croyance en l'infaillibilité de l'Empereur ; mais pour lui, l'Empereur était une représentation abstraite du Japon – cela pouvait être n'importe quel empereur y compris celui de son époque. Dans Eirei no Koe (Les Voix des âmes héroïques, 1966), celui de ses livres qui sacrifie de la manière la plus visible au culte de l'Empereur, les esprits des pilotes kamikaze accusaient l'actuel empereur d'avoir renoncé au droit divin ; s'il n'était pas un dieu, leur mort n'avait plus de signification. Les idées politiques de Mishima se firent de plus en plus abstraites, jusqu'à devenir une extension de son esthétique. » (« Mishima saint et martyr », D. Keene, Magazine littéraire n°216/217, 1985, p. 34).

◘ Le Japon après Mishima
 30 années ont passé depuis la mort de Y. Mishima. Beaucoup de choses ont changé au Japon et dans les rangs de la droite japonaise. La guerre du Golfe, les exercices balistiques de la Chine contre Taiwan, les tensions dans la péninsule coréenne à la suite de l'effondrement de l'Union Soviétique, la fin de la guerre froide ont contribué à réveiller un “nationalisme”, qui semblait s'être assoupi. Au cours de ces années, certains tabous liés à la défaite de la Seconde Guerre mondiale sont tombés, alors qu'ils avaient marqué tout le long après-guerre japonais. On parle désormais avec davantage de liberté et de réalisme :
30 années ont passé depuis la mort de Y. Mishima. Beaucoup de choses ont changé au Japon et dans les rangs de la droite japonaise. La guerre du Golfe, les exercices balistiques de la Chine contre Taiwan, les tensions dans la péninsule coréenne à la suite de l'effondrement de l'Union Soviétique, la fin de la guerre froide ont contribué à réveiller un “nationalisme”, qui semblait s'être assoupi. Au cours de ces années, certains tabous liés à la défaite de la Seconde Guerre mondiale sont tombés, alors qu'ils avaient marqué tout le long après-guerre japonais. On parle désormais avec davantage de liberté et de réalisme :
♦ de changer la constitution imposée par les alliés,
♦ de reconnaître au “Corps de Défense” (Jieitai) le statut d'armée nationale,
♦ d'abolir l'article 9 de la constitution qui, en pratique, empêche le Japon de participer à des missions internationales de paix par renvoi de contingents militaires,
♦ de réformer la législation sur renseignement, qui est truffé d'esprit “pacifiste” et d'individualisme.
Les idéaux de Mishima sont de retour
Récemment, certains hommes politiques de la majorité gouvernementale ont aussi eu le courage de souligner la nécessité de remettre à l'honneur le “Rescrit impérial” sur l’enseignement, promulgué au siècle dernier par l'Empereur Meiji et basé sur les concepts confucéens de loyauté au souverain et à la patrie, de piété filiale et de solidarité sociale. L'actuel Premier Ministre a ensuite perçu clairement l'importance de la religiosité shintoïste dans la vie et la culture japonaises. Il a affirmé qu'au sommet de la hiérarchie sociale devait trôner la figure divine de l'Empereur. On imagine aisément les réactions des médias et des tenants des idéologies “progressistes”. C'est significatif : à 30 ans de distance, on ne peut plus nier que ces problèmes, redevenus actuels, avaient été soulevés par Mishima. Ce sont justement les idéaux que l'on tente de raviver aujourd'hui, qui ont conduit Mishima, jadis, à choisir le sacrifice de sa personne par un geste de haute valeur symbolique, inscrit dans la tradition des samouraïs.
Avant d'examiner ce que fut le monde de la droite japonaise après le suicide de Mishima, nous voudrions préciser que la vulgate journalistique japonaise actuelle, et, par effet de ricochet, celle de la plus grande partie de la presse étrangère, tend systématiquement à confondre le crime organisé (yakuza, sokai-ya, bôryoku-dan) avec la droite (uyoku) et de définir, ipso facto, cette criminalité comme étant “de droite”. En réalité, l'équivoque est due au fait que ces organisations, pour échapper à la rigueur de la loi, se font enregistrer comme des “associations politiques” et présentent des programmes politiques au ton férocement nationaliste. En conséquence, les médias les assimilent à la droite, selon un procédé devenu désormais automatique. Les exposants de la droite politique plus orthodoxe, quand on les interpelle, refusent tout rapport et tout amalgame avec ce monde, qu'ils définissent comme la “pseudo-droite” (nise-uyoku) et veulent ignorer.
Shintarô Ishihara et la réhabilitation du “Corps de Défense”
Dans les partis représentés au Parlement, nous pouvons considérer comme étant de droite, le Jimintô (Parti Libéral-Démocrate), qui recueille la majeure partie des suffrages ; le Hoshutô (Parti Conservateur) et le Jiyûtô (Parti Libéral). Les 2 premiers font partie de la majorité gouvernementale. Le troisième est actuellement dans l'opposition. Tous 3 présentent des programmes assez semblables. Plusieurs membres connus de ces partis politiques ont eu des rapports avec Mishima. À l'époque, certains se sont opposés à lui, n'ont pas hésité à émettre des critiques à l'encontre de ses activités, mais, par la suite, beaucoup d'entre eux ont fini par reconnaître de facto l'exactitude des thèses de l'écrivain. Par ex., Shintarô Ishihara, lui aussi auteur d'un roman à succès, Tayô no kietsu (La saison du Soleil) et ancien parlementaire du Parti Libéral-Démocrate, était lié à Mishima d'une amitié fraternelle, bien qu'il émettait des critiques sur la pensée et l'œuvre de cet ami. Aujourd'hui, Shintarô Ishihara a été élu par un vote quasi plébiscitaire au poste important de Gouverneur de Tokyo, sorte de super-maire de toute la zone métropotitaine de la capitale. Il vient de réhabiliter quasi complètement la figure de Mishima et défend des programmes politiques qui auraient rendu Mishima heureux, surtout celui qui consiste à revaloriser de fond en comble le “Corps de Défense”.
Passons ensuite au panorama bigarré des associations de droite (uyoku) et d'extrême-droite (uyoku-undô) qui ne sont pas représentées au Parlement. Leur activité principale consiste à organiser des rassemblements ou des défilés d'autobus blindés et de jeeps pour protester contre le syndicat des enseignants de gauche, ou contre les Russes, pour obtenir la restitution des “territoires du Nord” (4 îles de l'Archipel des Kouriles). Depuis le suicide de Mishima, ce type de mouvements de droite, que l'on appelle au Japon la “droite activiste” (kôdô uyoku), a amorcé un débat sur le “geste” de Mishima. Des associations comme l'Issuikai et la Dai Nippon seisan-tô ont quasiment éliminé de leurs activités politiques toutes les traces de philo-américanisme de facture anti-communiste. Au contraire, l'accent est placé désormais sur la reconquête de l'identité nationale, à laquelle s'ajoutent diverses formes de lutte contre le néo-capitalisme sauvage et contre le nouvel ordre mondial. Elles organisent aussi des “actions démonstratives” sur des îlots du Pacifique revendiqués tant par le Japon que par la Chine, notamment l'archipel Senkaku à l'Ouest d'Okinawa.
“Une mort en reconnaissance à la patrie”
Autre thématique chère à cette “droite activiste” : l'abolition des datations selon l'ère chrétienne, auxquelles elle veut substituer le système traditionnel basé sur les années de règne de chacun des Empereurs. Enfin, en prévision d'un éventuel conflit entre la Chine et Taiwan ou d'une guerre qui éclaterait dans la péninsule coréenne, les groupes activistes évoquent la nécessité, également chère à Mishima, de faire approuver par le Parlement une législation sur l'état de guerre. La constitution “pacifiste”, actuellement en vigueur, s'avèrerait vite insuffisante pour affronter une crise militaire dans la région, qui impliquerait automatiquement le Japon.
Dans les milieux de la “droite activiste”, on trouve, face à la personne de Mishima, un sentiment mêlé de vénération (“un écrivain à succès, candidat au Prix Nobel”), d'admiration (son suicide rituel avec la katana, l'épée japonaise) et d'envie parce qu'il a réalisé, par son geste, un des idéaux les plus populaires parmi ces militants de droite, qu'ils ont synthétisé par le slogan isshi hôkotu, c'est-à-dire “une mort en reconnaissance à la patrie”.
Nouvelle droite et nouvelle gauche
Notons également que, depuis le suicide de Mishima, contacts et échanges idéologiques ont commencé entre la droite et la gauche japonaises. En particulier, on s'aperçoit que lors des colloques organisés par des groupes de droite, on invite des intellectuels et des activistes de la gauche extraparlementaire. Et vice-versa. Dans cette optique de rompre avec les schémas traditionnels d'appartenance, on peut parler de l'existence au Japon d'une “nouvelle droite” (shinuyoku), phénomène né après Mishima. Il s'agit souvent de petits groupes chaque fois centrés autour d'une revue, dans laquelle sont développés des thèmes anti-capitalistes et anti-bourgeois, souvent très similaires à ceux qu'étudie la shin-sayoku (“nouvelle gauche”), et qui culminent dans les attaques lancées contre le siège central de la Confindustria japonaise (keidanren) à Tokyo. La “nouvelle droite” japonaise a aussi lancé des initiatives dans le domaine de l'écologie, notamment contre la construction irraisonnée de digues dans tout le Japon et contre l'ordre mondial né à Yalta et à Potsdam. La radicalité de certaines de ses thèses provient de l'influence de Mishima et, plus particulièrement, des conceptions éminemment révolutionnaires que recèle une maxime du philosophe et général chinois Wang Yangming, que Mishima avait redécouvert pour en faire l'antidote au pacifisme verbeux des intellectuels progressistes : « L'action est connaissance. La connaissance est action. Il n'existe pas de connaissance sans action ».
Enfin, en ce qui concerne la Tate-no-kai (Société des boucliers), c'est-à-dire la petite milice créée par Mishima pour défendre l'Empereur contre une éventuelle insurrection des gauches, l'ordre de dissolution qu'il avait consigné dans son propre testament politique a été fidèlement respecté. Les membres qui ont participé à “l'insurrection” (que quelqu'un a défini très judicieusement comme “un coup d'État spirituel”) du 25 novembre 1970 et qui ont subi par la suite de brèves peines de prison après leur arrestation et leurs longs interrogatoires, ne sont plus jamais apparus en public. Le même sort a été partagé par la majeure partie des autres membres de la Tate-no-kai. lis ont quasiment tous abandonné leurs activités politiques. Ils se retrouvent une fois par an pour commémorer leurs morts, ainsi que le Maître Yukio Mishima et le leader du groupe, Masakatsu Morita. Le nom de cette association est le Nowake-no-kai (Société de la Tempête). La cérémonie se déroule à Tokyo sous une forme privée, à la différence des autres commémorations, plus célèbres et attirant davantage de monde, organisées chaque année par la Yûkokuki-no-kai (Société pour commémorer les patriotes).
L'œuvre du Musée Mishima sur les rives du lac Yamanaka
 Pendant toutes ces années, on a écrit beaucoup d'articles, d'essais et de livres au Japon et à l'étranger sur Mishima et sur la Tate-no-kai. Beaucoup de colloques et d'émissions télévisées en ont également parlé. Au Japon, de nombreux ouvrages fondamentaux ont été édités pour mieux comprendre l'activité littéraire et politique de Mishima, comme par ex. les essais d'Akira Muramatsu, de Shôichi Saeki, de Kôichi Isoda et Masahiro Miyazaki. Ont également été publiés des écrits jusqu'alors inédits, parmi lesquels il convient de signaler la correspondance avec Donald Keene, célèbre érudit américain, spécialisé en littérature japonaise, et les lettres au Prix Nobel et “Maître” Yasunari Kawabata.
Pendant toutes ces années, on a écrit beaucoup d'articles, d'essais et de livres au Japon et à l'étranger sur Mishima et sur la Tate-no-kai. Beaucoup de colloques et d'émissions télévisées en ont également parlé. Au Japon, de nombreux ouvrages fondamentaux ont été édités pour mieux comprendre l'activité littéraire et politique de Mishima, comme par ex. les essais d'Akira Muramatsu, de Shôichi Saeki, de Kôichi Isoda et Masahiro Miyazaki. Ont également été publiés des écrits jusqu'alors inédits, parmi lesquels il convient de signaler la correspondance avec Donald Keene, célèbre érudit américain, spécialisé en littérature japonaise, et les lettres au Prix Nobel et “Maître” Yasunari Kawabata.
Ensuite, plus récemment, dans la préfecture de Yamanashi, sur les rives du lac Yamanaka, a été fondé le Mishima Yukio Bungaku-kan, un musée entièrement dédié à l'écrivain. Ce musée abrite non seulement tous les livres et manuscrits qui ont appartenu à la famille Mishima, mais patronne aussi des travaux de recherche et veille à la publication de manuscrits inédits, comme ce fut le cas, naguère, d'un roman écrit dans la prime jeunesse de l'écrivain.
Aux yeux de beaucoup de Japonais, Mishima est certes un romancier talentueux, mais aussi, bien sûr, un personnage discuté et controversé. L'éducation particulière qu'il a reçue dans sa famille, sous la tutelle de sa grand-mère, a beaucoup influencé son caractère. Certaines poses décadentes et narcissiques, en effet, ne manquent pas de susciter la perplexité. Mais Mishima n'est pas seulement ce décadent et ce Narcisse. Il est un auteur dont les essais demeurent d'une grande pertinence d'analyse et sont même prophétiques dans leurs conclusions. La redécouverte du rôle qu'il a joué dans le monde culturel de l'après-guerre est désormais un processus largement entamé, confirmé par le fait que la société japonaise vit aujourd'hui des changements radicaux, comme c'est le cas tous les 30 ans, affirment certaines thèses. Le nouveau millénaire qui commence nous apprendra si c'est vrai ou faux.
► Giuseppe Fino, Nouvelles de Synergies Européennes n°48, 2000. (article paru dans Area n°52, nov. 2000)
pièces-jointes :
◘ Mishima écrivain et guerrier - 
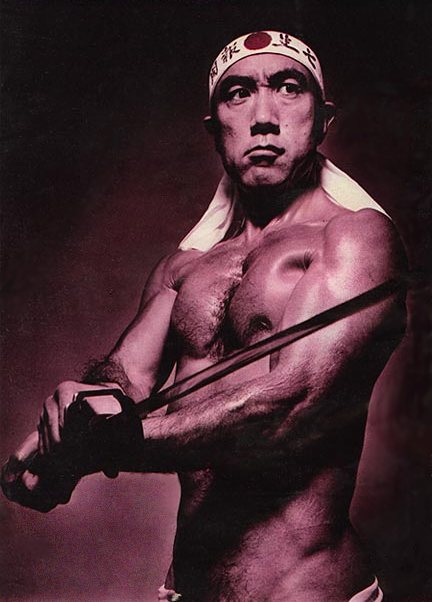 La récente parution, chez Gallimard, de 2 nouveaux livres de Yukio Mishima – le recueil de nouvelles La mort en été et la pièce de théâtre Le palais des fêtes –, ainsi que l'annonce, il y a peu, qu'un film sur sa vie allait être réalisé en 1984 sous la direction du cinéaste américain Paul Schrader (le réalisateur de Blue Collar et de Hardcore), suffiraient à prouver que ce personnage déroutant et son œuvre suscitent un intérêt grandissant en dehors du Japon. Avec désormais 15 ouvrages disponibles, Mishima est en tout cas l'écrivain japonais contemporain le plus traduit en français.
La récente parution, chez Gallimard, de 2 nouveaux livres de Yukio Mishima – le recueil de nouvelles La mort en été et la pièce de théâtre Le palais des fêtes –, ainsi que l'annonce, il y a peu, qu'un film sur sa vie allait être réalisé en 1984 sous la direction du cinéaste américain Paul Schrader (le réalisateur de Blue Collar et de Hardcore), suffiraient à prouver que ce personnage déroutant et son œuvre suscitent un intérêt grandissant en dehors du Japon. Avec désormais 15 ouvrages disponibles, Mishima est en tout cas l'écrivain japonais contemporain le plus traduit en français.
Les critiques ont généralement insisté sur le caractère foisonnant de son œuvre et, plus encore, sur les traits contradictoires de sa personnalité. Mishima, de fait, a abordé pratiquement tous les genres littéraires : le roman, la nouvelle, la poésie, le drame, la comédie, l'essai, la critique. Sa vie, elle aussi, a été marquée par une multitude déconcertante d'activités : il a pratiqué plusieurs sports et arts martiaux, a été acteur (cinéma, théâtre et kabuki), metteur en scène (cinéma et théâtre), et même chanteur de musique légère et journaliste sportif !
Un auteur italien, Giuseppe Fino, s'est proposé de découvrir dans Mishima écrivain et guerrier le fil conducteur de l'œuvre, la cohérence profonde de l'itinéraire de Mishima et l'explication de ses choix ultimes en étudiant tout spécialement les essais de l'auteur du Pavillon d'or. Mineurs d'un point de vue strictement littéraire, les essais de Mishima – consacrés au problème de la culture et à la redéfinition d'une “tradition japonaise” – sont en réalité fondamentaux sur le plan idéologique. Comme le dit G. Fino, « en élaborant une théorie de la culture, l'écrivain cherche en effet, sur le plan individuel, un moyen d'harmoniser la mare magnum de ses activités, proprement littéraires, politiques et autres. Sur le plan général, il vise à fournir une interprétation globale de la culture japonaise ». À vrai dire, Fino n'a aucun mal à montrer les liens qui unissent le jeune Mishima romantique au Mishima néo-romantique de la période finale (1960-1970), après l'intermède du classicisme et la critique ironique et corrosive du Japon de l'après-guerre, tant l'écrivain a été parfaitement explicite, dans ses écrits et ses actes, sur son évolution personnelle.
Cette étude vient donc à point nommé pour faire place nette des interprétations sournoisement désireuses de voir en Mishima l'esthète poignant d'un décadentisme morbide, hanté par une homosexualité mal assumée et des complexes sado-masochistes, à la limite un alter ego nippon de Jean Genet, toujours à mi-chemin entre le scandale et le martyre. Mishima avait lu Sade, aimait Wilde et Villiers, avait été charmé par les amants passionnés de Radiguet, appréciait D'Annunzio et Cocteau. De toute évidence pourtant, l'essentiel, chez lui, est ailleurs. Mishima a été fasciné par la décadence et la décomposition, mais il a tué en lui, consciemment et délibérément, le décadent ; il a subi l'obsession trouble et passive de la mort, avant d'aller cependant au devant d'elle en samouraï du XXe siècle ; il a tout juste esquissé ce qu'on pourrait appeler un embryon de pensée politique, mais ses orientations idéologiques, à partir de 1960, ne laissent place à aucune équivoque.
Au Japon d'ailleurs, bon nombre de critiques ne s'y sont pas trompés, tel Isoda Kôichi, cité par Fino, qui affirme que « l'activité littéraire et théorique de Mishima pendant les 24 années de l'après-guerre n'est qu'un défi paradoxal lancé au progressisme de cette période, une prophétie de ce qui viendra après l'après-guerre ». Et ce n'est pas un hasard si l'esprit de la première œuvre de Mishima (Forêt tout en fleurs) se retrouve dans la dernière (La Mer de la fertilité) par le biais des rêves et des réincarnations, le parallélisme étant ouvertement souligné par le fait que certains personnages portent les mêmes noms dans les 2 livres.
Avant de se pencher sur la théorie de la culture exposée par Mishima et sur le type d'homme intégral qui, ayant comblé en lui l'abîme séparant aujourd'hui intellect et action, doit en être la vivante projection, il est donc indispensable d'évoquer les débuts littéraires de l'écrivain. Ceux-ci sont indissociables du courant le plus extrémiste du romantisme japonais, dont la principale expression fut la revue Bungei-Bunka (Art & Culture), laquelle dura de juillet 1938 à août 1944. C'est dans cette revue que paraît sur plusieurs numéros, en 1941, Forêt en fleur. Son auteur, un jeune prodige de 16 ans, ne s'appelle pas encore Mishima, mais ne va pas tarder à prendre ce nom d'écrivain car c'est à Mishima, petite ville au pied du mont Fuji, que se réunit le groupe de Bungei-Bunka.
Le premier à deviner les dons du collégien est le critique et poète Hasuda Zenmei (1904-1945), qui se suicidera sous les yeux de ses camarades de régiment après l'annonce de la reddition du Japon. Les grands thèmes de son œuvre – le rapport de la culture japonaise à la mort et l'idée que la mort, lorsqu'elle est conforme au miyabi (la “beauté aristocratique”), peut devenir une “œuvre d'art” et la modalité par excellence pour exprimer toute une culture – vont marquer profondément le jeune Mishima. D'un autre animateur de Bungei-Bunka, le poète Itô Shizuo, il dira qu'il a été « le maître de (ma) jeunesse ». En novembre 1946, enfin, est publié un hommage à Hasuda Zenmei, contenant un bref poème de Mishima qui mérite d'être cité : « Il a réalisé en soi-même l'antiquité et il est mort en se retirant parmi les nuées. Moi, abandonné dans l'époque moderne, je soupire vainement après de majestueux orages ».
Mais les majestueux orages de la guerre sont passés. D'ailleurs, l'adolescent maladif qu'était Mishima, précocement éveillé à la vie de l'esprit et tenu à l'écart de celle de la chair par une grand-mère cultivée mais affreusement possessive, aurait été incapable de les affronter. « Quelle ironie ! À une époque où la coupe sans avenir de la catastrophe avait été débordante, je ne m'étais pas trouvé qualifié pour m'y abreuver. Je m'étais éloigné et quand, après un long entraînement, j'étais revenu bardé de qualifications, ce fut pour trouver la coupe asséchée, le fond visible sans fard » (1). Dès lors, hostile à l'univers culturel japonais postérieur à 1945, dominé par le réalisme et l'existentialisme, Mishima va se réfugier dans la citadelle de l'art pour l'art et dans un refus implicite du monde environnant, qu'il voit « avec les yeux de Cervantes » pour reprendre l'expression de Fino.
En 1951, au retour d'un voyage en Grèce il adhère avec enthousiasme au classicisme, qui le réconcilie avec une partie de lui-même trop longtemps oubliée : son corps. Il pressent alors que la chair, elle aussi, a un “langage” et comprend, comme il l'écrira plus tard dans Le Soleil et l'acier (1968) que « le temps approchait où traiter le soleil en ennemi équivaudrait à suivre le troupeau ». C'est l'époque du Tumulte des flots (1954) – exaltation de la beauté de la chair et du soleil purificateur – et du Pavillon d'or (1956) – expression d'un “faux narcissisme” employé comme une défense contre les valeurs dominantes –, souvent considérés comme les meilleurs romans de Mishima. L'adhésion à des valeurs authentiques se prépare afin d'échapper au climat étouffant d'une « paix souriante aux panses pleines », à la médiocrité sans bornes de la société du bien-être, « la plus désespérée des conditions » selon Mishima. La modernité est pour lui la négation même, c'est-à-dire un univers totalement artificiel, anorganique en tant que privé de la présence muette de la mort, où les relations humaines deviennent mécaniques et utilitaires, où il est finalement impossible de se sentir vivant.
Dans le journal qu'il tient au moment où il rédige La maison de Kyôko (1959), énorme roman-bilan annonciateur de la période néoromantique, Mishima note ceci : « Un abîme sépare la “mort” que nous sentîmes si proche pendant la guerre (...) du monde d'aujourd'hui, pacifique et sans événements. Nous passâmes à l'improviste d'une vie où la mort était une réalité à un monde où la mort n'est guère plus qu'une idée : l'impression de réalité que nous goûtâmes dans une vie qui était proche de la mort s'est maintenant changée en une idée » (2). D'après Fino, La maison de Kyôko, qui met en scène 4 personnages masculins représentant autant d'aspects du tempérament de Mishima, doit être lu comme suit : « Mishima a présenté ces personnages reflétés dans un miroir, qui n'est autre que l'héroïne du roman, Kyôko, personnage passif par excellence puisqu'il se contente de refléter les autres. Le miroir veut dire que ces personnages, donc Mishima lui-même, se meuvent dans le vide. Pourquoi le vide ? Parce que la maison de Kyôko représente l'après-guerre, caractérisé par la reprise économique, la démocratie, le nouveau système éducatif, la “seconde jeunesse” des intellectuels révolutionnaires, et par tous les “esprits du temps”. Pour Mishima, tout cela est vide, non-sens ».
À partir de 1960, l'écrivain va donc revenir progressivement au romantisme exacerbé de sa jeunesse, en même temps qu'il procède à une recherche sur les grandes caractéristiques de la culture japonaise et à une enquête sur la tradition (dentô) nationale et sur ses incarnations les plus pures. Avec toutefois un facteur décisif qui modifie toute l'optique de Mishima : les masses d'acier et la pratique de plusieurs arts martiaux lui ont donné les indispensables qualifications physiques pour que l'axiome de Bungei-Bunka – faire de la mort une œuvre d'art – soit désormais autre chose que la justification théorique des excès morbides d'une sensibilité juvénile. Au fur et à mesure qu'il se dote d'une demeure de chair puissante, Mishima saisit que « toute confrontation entre une chair faible et flasque et la mort » est « inadéquate jusqu'à l'absurde » (3). En réaction contre une certaine complaisance moderne pour la laideur et la déchéance, il voit dans « des signes individuels tels qu'un ventre en brioche (signe de relâchement spirituel) ou une poitrine plate où percent les côtes (signe d'une sensibilité par trop inquiète) (...) des exemples d'indécence éhontée, comme si leur propriétaire avait exposé à l'extérieur de son corps son sexe spirituel » (4).
Cette formation du corps n'a rien à voir avec un narcissisme culturiste, puisqu'il s'agit au contraire de faire du corps une “forme” en quelque sorte impersonnelle, conforme à un “type” préalablement fixé : pour l'écrivain, c'est « passer d'un être créateur de mots à une créature des mots » (5), c'est-à-dire incarner au plein sens du terme une idée de l'homme reconnue et acceptée sur un plan purement théorique d'abord, donc par l'entremise des mots : le guerrier. Tout ce qui sépare Mishima des adeptes du body building et des 3 S (Sea, Sun, Sex) qui chaque été étalent sur les plages leur vulgarité pétulante, tient à la conscience aigue de la mort et du caractère évanescent de toute perfection :
« La chose qui finalement épargne à la chair d'être ridicule, c'est l'élément de mort qui réside dans un corps vigoureux, en pleine santé ; je comprenais que c'était là ce qui soutenait la dignité de la chair. Comme l'on trouverait comiques l'éclat et l'élégance du toréador si son métier n'avait aucun commerce avec la mort ! » (6).
Grâce au langage des muscles, Mishima va aussi pouvoir se livrer à une critique génétique de certains comportements et de certaines idées, montrer en quoi ils ne sont que la conséquence et la justification a posteriori d'un laisser-aller dans le domaine physique :
« Le cynisme, qui estime comique tout culte des héros, s'accompagne toujours du sentiment d'une infériorité physique. Invariablement, c'est celui qui se croit lui-même dépourvu d'attributs héroïques qui parle du héros avec dérision (...) Le cynisme facile va de pair (...) avec des muscles mous ou l'obésité, tandis que le culte des héros et un nihilisme puissant s'accompagnent toujours d'un corps puissant et de muscles bien trempés » (7).
La dérision des qualités héroïques, véritable profession de foi du cloporte de salon, est par excellence l'apanage des “intellectuels” et de leur subjectivisme délétère. Mishima a été l'un d'eux pendant quelques années et connaît à merveille les ressorts cachés de ces prédicateurs du ressentiment :
« Peut-il être pire défaite que lorsqu'on est corrodé, brûlé de l'intérieur par les sécrétions acides de la sensibilité jusqu'à perdre finalement sa silhouette, jusqu'à se dissoudre, se liquéfier ; ou quand la chose se produit dans la société alentour et que l'on y accommode son propre style » (8).
Pour tous les intellectuels japonais progressistes qui ont trahi les valeurs nationales et fortement contribué à l'occidentalisation du Japon, Mishima, à la fin de sa vie, n'avait pas de mots assez durs. Dans un de ses derniers écrits, la préface d'un essai sur son père spirituel Hasuda Zenmei, il énumère les caractéristiques des représentants japonais de la « stupidité intelligente », égale à elle-même partout, à Tokyo comme au quartier latin : « La couardise, le sarcasme, “l'objectivité”, l'inconsistance, la malhonnêteté, la mentalité servile, les fausses attitudes de résistance, la prétention, l'inactivité, le bavardage et la rapidité dans le reniement » (cité par Fino).
Cette enquête psychologique qui déshabille les intellectuels et fait apparaître leur laideur est en rapport étroit avec la façon de concevoir la culture. Dans son principal essai, le Bunka bôei-ron (Défense de la culture, 1969, tr. fr. : P. Pons, Esprit, fév. 1973), Mishima dévoile les causes inavouées de l'interprétation humaniste et utilitaire de la culture :
« Quand on nie la force du point de vue éthique, on éprouve le besoin de démontrer l'inefficacité même de la force ; en vérité, ceci reste simplement un processus psychologique après coup, provoqué par la peur. Si l'intellectualisme finit par tomber de la négation de la violence dans la négation finale de l'État, cela vient du fait qu'un processus, la “Culture” et la “Conservation du moi”, agissent selon le même mécanisme psychologique » (cité par Fino).
Dans la perspective bourgeoise et moderne, la culture est la chasse gardée des intellectuels, ces prêtres de la superstition vague et abstraite du Beau. L'œuvre d'art est avant tout quelque chose dont on jouit, la référence à son contenu passant toujours au second plan, et non l'expression particulièrement apte à résumer puissamment la vision du monde d'une communauté et qui n'a de véritable raison d'être qu'en tant qu'elle est profondément signifiante (Quintilien disait déjà : Docti rationem artis intelligunt, indocti voluptatem [De l'art, les savants goûtent la théorie, et les ignorants le plaisir qu'il leur procure]). Pour Mishima, cette conception revient à « juger chaque chose selon une optique humanitaire et optimiste », en séparant la culture de la matrice sanglante de la vie et de l'acte procréateur. Dans le cas précis du Japon, cette conception reflète la fracture qui s'est produite entre intellect et action, entre esthétique et éthique, entre le “Chrysanthème” et “l'Épée”.
La culture intégrale, en fait, investit tous les modèles de comportement et ne laisse rien en dehors d'elle-même :
« ... la culture ne comprend pas seulement ce qu'on appelle les œuvres d'art, mais aussi l'action et le style de l'action. La culture comprend toutes les actions : d'un spectacle de nô à l'action d'un officier de marine lorsque, brandissant son sabre, il sort d'une torpille remontée en surface dans la mer de la Nouvelle-Guinée par une nuit qu'éclaire la lune (...) Elle va du Genji Monogatari aux romans modernes (...) de la cérémonie du thé au kendô et au judô » (Essai, cité par Fino).
À l'opposé des intellectuels japonais très soucieux de jeter un voile pudique sur les innombrables témoignages “encombrants” et “dangereux” de la culture nippone, Mishima affirme que la culture forme un tout indissociable et qu'elle « doit être acceptée et défendue en bloc », parce qu'ombres et lumières appartiennent au même cadre. La nation ne peut renoncer à aucune partie de son héritage : Mishima est ici en accord avec Kita Ikki (1883-1936), souvent présenté comme “le théoricien du fascisme japonais”, lequel définissait la “révolution” comme « la réduction à l'unité de l'orthodoxie et des hérésies de la nation ». [cf. « Mishima Yukio and Kita Ikki : The Aesthetics and Politics of Ultranationalism in Japan », Noguchi Takehiko, The Journal of Japanese Studies, 10 (2), 1984]
En recourant aux 2 symboles par lesquels l'orientaliste Ruth Benedict avait cru pouvoir résumer l'essence de la culture japonaise [Le Chrysanthème et le sabre, 1946, étude opposant culture de la honte et culture de la culpabilité], Mishima estime que la crise grave que traverse celle-ci s'explique par le fait que le “Chrysanthème” a été exagérément valorisé (au sens d'une admiration passive et neutre des trésors culturels du passé) au détriment de “l'Épée”. Défendre la culture, pour lui, revient donc, dans les conditions présentes, à défendre l'élément menacé, l'Épée. Fait particulièrement significatif : Mishima annonce à la presse la fondation du Tate-no-kai, sa milice de poètes et de guerriers, un 3 novembre (1968), alors qu'on fête au Japon, comme chaque année, la “Journée de la Culture”.
L'insistance de Mishima sur l'Épée ne doit pas induire en erreur et faire croire qu'il rêvait de faire du Japon une société de reîtres. La dernière phrase du Manifeste contre-révolutionnaire du Tate-no-kai, rédigé par l'écrivain lui-même, dit ceci : « Nous sommes ceux qui incarnent la tradition japonaise du Beau », et dans son Essai Mishima glisse même vers l'utopie pure et simple en concevant un projet de « règles générales pour la création d'un État esthétique ». Son idéal reste le bunburyôdô, la “double voie” des lettres et des arts martiaux, l'union de la Plume et du Sabre, de l'élégance raffinée et du courage indomptable : idéal qu'avaient surtout cultivé les samouraïs de l'époque Tokugawa (1600-1868).
 À partir de 1960 Mishima part donc à la recherche de comportements paradigmatiques et trouve sans peine des hommes et des courants de pensée pouvant conférer une base idéologique à son action : les traités de bushidô, évidemment ; la philosophie de Wang Yang-ming (1472-1529), confucianiste chinois prônant la synthèse de la connaissance et de l'action ; Oshio Heihachirô (mort en 1837), disciple de cette école et animateur d'une révolte populaire à Osaka contre les spéculateurs qui affamaient les paysans ; la Ligue du Vent Divin, groupe de samouraïs qui se révoltèrent en 1876 avec les seuls armes blanches et au sujet desquels Fino rapporte que « craignant d'être contaminés, ils ne ramassaient la monnaie de papier qu'avec des baguettes de bois » et « se couvraient la tête d'un éventail blanc » lorsqu'ils « étaient obligés de passer sous les lignes télégraphiques nouvellement installées » ; Saigô Takamori, qui guida la rébellion anti-moderne de Satsuma en 1877 ; les “Jeunes Officiers” de l'Incident du 26 février 1936, dont le loyalisme absolu n'eut pas droit au soutien d'Hiro-Hito ; enfin les unités de kamikazes. Tout un crescendo idéologique qui permet d'apprécier la portée et le sens univoque du seppuku accompli le 25 novembre 1970.
À partir de 1960 Mishima part donc à la recherche de comportements paradigmatiques et trouve sans peine des hommes et des courants de pensée pouvant conférer une base idéologique à son action : les traités de bushidô, évidemment ; la philosophie de Wang Yang-ming (1472-1529), confucianiste chinois prônant la synthèse de la connaissance et de l'action ; Oshio Heihachirô (mort en 1837), disciple de cette école et animateur d'une révolte populaire à Osaka contre les spéculateurs qui affamaient les paysans ; la Ligue du Vent Divin, groupe de samouraïs qui se révoltèrent en 1876 avec les seuls armes blanches et au sujet desquels Fino rapporte que « craignant d'être contaminés, ils ne ramassaient la monnaie de papier qu'avec des baguettes de bois » et « se couvraient la tête d'un éventail blanc » lorsqu'ils « étaient obligés de passer sous les lignes télégraphiques nouvellement installées » ; Saigô Takamori, qui guida la rébellion anti-moderne de Satsuma en 1877 ; les “Jeunes Officiers” de l'Incident du 26 février 1936, dont le loyalisme absolu n'eut pas droit au soutien d'Hiro-Hito ; enfin les unités de kamikazes. Tout un crescendo idéologique qui permet d'apprécier la portée et le sens univoque du seppuku accompli le 25 novembre 1970.
Les dernières années de la vie de Mishima illustrent en fait de façon limpide cette maxime de Pound : « Souviens-toi que je me suis souvenu et passe à la tradition ». Mishima, par son identification aux modèles d'une culture archaïque, mythique, muette, analogique, “venait de loin” et avait donc le sens des distances. Il savait qu'il perdrait sur le court terme et s'offrait le luxe aristocratique de reverser la moitié de ses droits d'auteur provenant des compte-rendus des débats auxquels il participait dans les universités à ses adversaires d'ultra-gauche du Zengakuren. Imagine-t-on un tel acte chez un marxiste ? À l'inverse des déracinés, il faisait plus confiance à la mémoire collective de son peuple qu'aux résultats tangibles trop facilement atteints. Or, un livre superbe nous a appris qu'au Japon seuls demeurent dans le souvenir populaire les héros solitaires et vaincus, qui embrassèrent avec une sincérité totale une cause vouée à l'échec immédiat (9). Et cela, Mishima ne l'ignorait pas.
Comme l'a confirmé une remarquable émission de France-Culture diffusée le 26 mars dernier, les “Sociétés Mishima” se multiplient au Japon et chaque année qui passe voit grossir le nombre de ceux qui, le 25 novembre, viennent se recueillir sur sa tombe. Si bien qu'on est maintenant en droit d'affirmer que le sacrifice de Mishima n'a pas été vain, non pour conclure sur une note d'optimisme affecté mais simplement pour signaler les prémices d'une évolution inattendue des Japonais dans leur manière de considérer une partie de leur héritage culturel.
♦ Mishima écrivain et guerrier, Giuseppe Fino, Guy Trédaniel,140 p.
► Philippe Baillet, éléments n°47, 1983.
• notes :
(1) Y. Mishima, Le Soleil et l'acier, Gal., 1973, pp. 85-86.
(2) Cité dans l'anthologie : Y. Mishima, Ancora intorno al pazzo morire, Padova 1980, p., 77.
(3), (4), (5), (6), (7) et (8) : citations du Soleil et l'acier, p. 36, p. 22, p. 87, p. 56, p. 55, p. 65.
(9) Cf. Ivan Morris, La noblesse de l'échec : Héros tragiques de l'histoire du Japon, Gal., 1980.
◘ « Pour être digne de ce livre... »
 Lecteur, pour être digne de ce livre... où s'entend la parole souveraine de Yukio Mishima, je te demande le repos. Ce sera une pause soudaine dans la vie qui est la tienne. Ce sera une pause dure parce que ta vie, comme la mienne, est imbécile et grossière et parce que tu as pris l'habitude, comme moi, de laisser la peau de ton cœur et de ton âme s'envelopper jour après jour de minces couches de crasse qui à la fin forment cuirasse et te donnent une mauvaise chaleur et la protection de la honte. Mais tu ne le sais pas. Tu respires notre monde et tu y marches. Tu es son complice. Il faut, paraît-il, que tu y gagnes ta vie. C'est vrai que nous en sommes là : personne ne nous demande aujourd'hui de mériter et de gagner une mort. Et nous travaillons, en échange de francs, de dollars, de marks ou de yens. Et nous marchons. Et si nous nous arrêtons, quoi allons-nous compter, notre argent ou le vide de notre “ventre” (de notre hara) brusquement tordu et effaré ?
Lecteur, pour être digne de ce livre... où s'entend la parole souveraine de Yukio Mishima, je te demande le repos. Ce sera une pause soudaine dans la vie qui est la tienne. Ce sera une pause dure parce que ta vie, comme la mienne, est imbécile et grossière et parce que tu as pris l'habitude, comme moi, de laisser la peau de ton cœur et de ton âme s'envelopper jour après jour de minces couches de crasse qui à la fin forment cuirasse et te donnent une mauvaise chaleur et la protection de la honte. Mais tu ne le sais pas. Tu respires notre monde et tu y marches. Tu es son complice. Il faut, paraît-il, que tu y gagnes ta vie. C'est vrai que nous en sommes là : personne ne nous demande aujourd'hui de mériter et de gagner une mort. Et nous travaillons, en échange de francs, de dollars, de marks ou de yens. Et nous marchons. Et si nous nous arrêtons, quoi allons-nous compter, notre argent ou le vide de notre “ventre” (de notre hara) brusquement tordu et effaré ?
Alors, lecteur, je te préviens que ce livre est dangereux si tu oses installer en toi le repos pour en boire le liquide aux reflets d'acier et de soleil. Pour mériter que cette liqueur t'inonde et pour ne point la vomir, il te faudra beaucoup de courage. Vas-tu accepter sa brûlure ? Je ne te demande pas de “comprendre”, ce serait trop facile et je ne veux pas que tu t'en tires comme ça, par vifs crochets de lièvre d'une intelligence couarde – mais d'être mort, au long instant, lorsque tu auras refermé ce livre. Mort comme le Grand Prêtre du temple de Shiga et comme le lieutenant Sehinji Takeyama. Un long instant, sois stupide de lumière. Sois mort. Comme eux. Ensuite, essaie de renaître et de vivre. Ça te regarde. J'ai trop à faire moi-même pour m'intéresser à ton sort. Si tu mérites ces pages, rien que le temps d'un éclair, j'espère sans espoir que nous nous retrouverons.
Ce livre d'honneur et d'amour, tu ne l'auras pas lu si tu n'es pas effrayé par la beauté du royaume que tu découvres, debout à la proue d'acier d'un navire qui déchire sans aucun bruit des paysages de soie. Tais-toi. Fais silence. Écoute l'incomparable voix du héros. Elle est monstrueuse d'une telle élégance et d'une telle noblesse, sa musique est si brûlante et froide qu'on pourrait croire qu'elle vient de ce monde où l'homme ne mérite de crier son nom que s'il est hors de soi. Fais silence. Écoute ta pauvreté. Tu n'es pas capable de cet amour parce que tu as oublié, abruti de romans, où en est la source. Tu patauges dans deltas et marais. Tu vas au cinéma, non ? Peut-être même regardes-tu la télévision... Je te devine alors très ahuri : comment “incarner” dans de la viande de ce XXe siècle, le Grand Prêtre, la Grande Concubine Impériale, le lieutenant et Roiko, sa taciturne épouse qui se farde précieusement pour mourir après lui ? Comment vêtir de chair quotidienne les esprits et les corps solaires des héros ?
Car voici la révélation prononcée par Yukio Mishima et qui foudroie : la vérité d'amour est dans l'honneur ; la vérité d'honneur est dans l'amour. Hors de l'un, l'autre n'est rien. Honneur, amour : le même mot. Il ne s'agit pas là d'une “leçon”, comme un moralisme pourrait nous inviter à le croire afin que nous y retrouvions des traces qui nous rassureraient, mais d'une évidence vertigineuse que seul peut réveiller en nous le courage qui contemple la beauté. La contemple-t-il, au fait ? Non puisque, une fois encore, courage et beauté sont un même mot. De leur étreinte naît la noce.
Je sais de quoi je parle, moi qui écris et qui titube dans ce temps en épousant et en injuriant la décadence. Ce qui me donne ma démarche d'ivrogne qui parfois se redresse, c'est que je sais. Courtisane et vestale, je me connais et n'ai pas besoin d'autre juge que moi lorsque je comparais, chaque matin, devant mon miroir et à ma face. Je connais les voix qui me traversent mais mon mince honneur c'est que je sais ce qui, de moi, me donne virtu ou exige mon mépris. En d'autres termes, je suis un écriveur de la décadence mais, si je sais ce qu'en moi elle souille, je sais aussi ce que mon combat l'empêche de délabrer, dans ma citadelle, afin que se dresse une tour et que tout ne soit pas ruines. Reste que je vis dans ce siècle. Je vis. C'est trop. Que si un tribunal appelle ma mémoire à la barre, un jour, et m'oblige à entendre la lecture de ma vie et de mes proses, il s'écriera justement : « Quoi ? Vous avez vécu le siècle ? Par votre seule vie savez-vous au moins que vous fûtes le complice de sa honte ? »
Je répondrai, en effet, que j'ai vécu et ne nierai point mon rôle de complice. Pour ma défense, je dirai seulement que, dans la bande d'escrocs, j'étais le traître. À preuve, je fus démasqué et chassé de la table de la Cène. Et les apôtres de la bouffe décadente, sachant que je connaissais aussi bien qu'eux les recettes de leurs pâtées, m'appelèrent Judas. Ce fut mon honneur. Je me suis levé de table. J'ai roté des livres que les bâfreurs attablés ne comprenaient plus et que “les autres” n'entendaient pas toujours parce qu'ils craignaient que mon haleine ne fût chargée d'anciens alcools. Cela s'appelle, n'est-ce pas, “déconcerter parfois ses nouveaux amis”... Pourtant, ô Yukio Mishima, à moins de suivre ton exemple et de hausser une œuvre et une parole jusqu'au suicide, il n'y a guère d'autre chemin.
Tout écrivain décadent et qui accepte de vivre en révolte de la décadence, est un ivrogne debout. Debout : ce n'est pas déjà si mal. Évidemment, il y a le suicide vers lequel Mishima hisse son œuvre et son personnage. La mort-phare, dès lors, du haut de ce promontoire, éclaire et explique tout. Chaque ligne de l'œuvre est soulignée de sang. Ô mort, face au héros, au kamikaze, au soldat qui dérobe sa vie au vainqueur désigné par l'incertaine Histoire, face au poète qui a épuisé son chant et ne veut pas de la fatigue de se survivre, face à Yukio Mishima qui, en un seul acte, signifie son œuvre, quels qu'en soient les plaines et les reliefs, sous la lumière du suicide, ô mort où est ta victoire ? Nulle part. Tu es vaincue.
Il y a donc le suicide. Je ne l'oublie pas. Cela mérite réflexion.
Le Grand Prêtre, le lieutenant, Roiko et Yukio Mishima marchent vers la mort et s'y reposent. Ce n'est pas une leçon. C'est la voie. Lecteur, ni toi ni moi ne sommes dignes de ce livre mais si nous sommes immobiles, après l'avoir refermé, nous sentirons à nos côtés une présence. Nous n'emprunterons pas la voie mais il nous aura suffi de la connaître ouverte, et d'y suivre du regard des silhouettes plus hautes que la nôtre et qui là-bas s'éloignent, pour que nous sachions comment, dans l'orgueil plénier de la solitude, s'appelle l'Éternité.
♦ Yukio Mishima : La mort en été, nouvelles traduites par D. Aury. Gal., 252 p.
► Jean Cau, éléments n°47, 1983.
◘ Le printemps de Mishima
 « Je pense qu’il est devenu fou ». Le 25 novembre 1970, Eisaku Sato, Premier ministre du Japon, vient d’apprendre le suicide par seppuku (que nous appelons en Occident hara-kiri) de l’écrivain Yukio Mishima. Sato, qui battit le record de longévité des Premiers Ministres japonais, était loin d’être stupide. Très lié aux milieux capitalistes des “cliques financières” (le groupe Mitsui en particulier), représentant éminent d’un Japon sans passé né en janvier 1946, le chef du parti conservateur, en bon “laquais des USA” (l’expression est de Chou En-Lai), niait ainsi le geste rituel de Mishima pour le réduire à un acte de dément, relevant tout au plus de l’asile psychiatrique ou de la psychanalyse.
« Je pense qu’il est devenu fou ». Le 25 novembre 1970, Eisaku Sato, Premier ministre du Japon, vient d’apprendre le suicide par seppuku (que nous appelons en Occident hara-kiri) de l’écrivain Yukio Mishima. Sato, qui battit le record de longévité des Premiers Ministres japonais, était loin d’être stupide. Très lié aux milieux capitalistes des “cliques financières” (le groupe Mitsui en particulier), représentant éminent d’un Japon sans passé né en janvier 1946, le chef du parti conservateur, en bon “laquais des USA” (l’expression est de Chou En-Lai), niait ainsi le geste rituel de Mishima pour le réduire à un acte de dément, relevant tout au plus de l’asile psychiatrique ou de la psychanalyse.
Plus lucide ou plus naïf que Sato, le ministre d’État Nasakone déclarait : « Nous devons tout faire pour empêcher les extrémistes de suivre l’exemple de Mishima, leurs actions détruisent la démocratie établie par la constitution actuelle ». Le mot était lâché : quiconque osait contester le système imposé par l’occupant américain était traité d’extrémiste. La mort de Mishima procédant de la plus pure tradition nipponne, ainsi qu’en témoigne l’important essai d’Ivan Morris, La Noblesse de l’échec, sur les héros tragiques du Japon, c’est l’histoire entière d’un peuple qui basculait dans l’interdit, révélant ainsi combien la classe politique du pays était devenue étrangère à ce peuple.
Le lendemain, 26 novembre, les grands quotidiens de Tokyo mettaient à la une “l’acte criminel” de Mishima : le Mainichi Shimbum — tirage à 6 millions d’exemplaires — écrivait que la société japonaise était une « société démocratique, où la loi et l’ordre sont respectés » et que « des actes de fou, contraires aux règles de la société, ne sont pas admissibles ». « Horreur et stupéfaction », telle avait été, selon le correspondant du Monde, la réaction de l’opinion. Quelle société ? Quelle opinion ? Fut-il vraiment stupéfait, le lecteur de Mainichi ou de l’Asahi, lorsqu’il apprit que « saisissant le sabre, il se l’enfonça au-dessous du sein gauche avec une telle force que la lame faillit lui ressortir dans le dos » et qu’« ensuite il s’entailla profondément le ventre et, élargissant la blessure dans 3 directions, il en fit jaillir les entrailles » ? Ainsi était décrit dans une chronique médiévale aussi célèbre que chez nous la Chanson de Roland, le suicide par seppuku, en 1189, de Yoshitsune.
Dans la mort, la distance séparant Y. Mishima du héros japonais devenait aussi floue qu’au bord du rivage, la limite entre l’océan et la terre. Était-il vraiment horrifié, le spectateur, lorsqu’il vit les têtes décapitées de Mishima et du jeune Morita qui l’avait suivi dans la mort, après lui avoir tranché la tête d’un coup de sabre et s’être ouvert le ventre ? Par bribes, le récit de la célèbre bataille de la rivière Minato en 1336 lui revenait en mémoire ; la tête de Masashige et celle de son frère, reposaient, tels des lis fraîchement coupés, « sur le même oreiller ». Dans la mesure où les autorités américaines d’occupation, aptes à déterminer ce qui est nocif dans la culture d’un peuple et ce qui ne l’est pas, avaient interdit les chants patriotiques qui louaient le geste de Masashige, il était logique que celui de Mishima soit nié ou condamné. Tout se tenait.
Au Japon, et surtout en Occident, il était plus rassurant de fouiller dans la vie de l’écrivain pour expliquer ce suicide qui ne pouvait être alors interprété que comme un aveu de faillite. Les chacals furent prompts à réagir. Insidieux, le Monde parla de « personnage déjà bizarre et trouble, connu pour ses penchants spéciaux et son culte immodéré de la force virile » et brocarda son « armée d’opérette » ; les formules du prêt-à-penser idéologique furent mobilisées : “sado-masochisme” et “fascisme” entamèrent la valse poussive que Sartre avait jadis orchestrée dans L’enfance d’un chef.
Aujourd’hui une Vie de Mishima signée John Nathan, malheureusement sans les photos et l’index de l’édition américaine parue en 1974, vient de sortir en traduction française. Discrète dans l’analyse critique sur des œuvres-clefs comme Le Pavillon d’or ou La Mer de la fertilité, elle s’enferme dans les limites inhérentes à toute biographie extérieure : elle satisfait le goût de notre époque pour l’anecdote, apporte quelques éclairages sur la vie intime, mais ne nous apprend rien d’essentiel sur « ce qui animait l’âme » de l’écrivain, pour reprendre une expression de Mishima lui-même.
Kimitaké Hirakoa (Yukio Mishima est un pseudonyme littéraire) naît en 1925 à Tokyo, dans une famille bourgeoise. Son biographe américain ne cite jamais Montherlant auquel pourtant certains traits de son existence l’apparentent : une enfance protégée, déchirée entre une grand-mère abusive et une mère trop tendre ; le sentiment d’avoir raté un grand moment de l’histoire de son pays lorsqu’il est déclaré inapte au service militaire en 1945 ; plus tard un goût immodéré de l’exercice violent depuis l’haltérophilie et la boxe jusqu’au kendo, sorte d’escrime japonaise, qu’il décrit avec exaltation dans Chevaux échappés.
La personnalité de Mishima déconcerte un Européen. Aussi révolté qu’il ait pu être, il ne mettra jamais en cause l’autorité paternelle : sur les conseils de son père, il pose sa candidature au ministère des Finances et c’est avec son accord qu’il démissionne 9 mois plus tard ; par piété filiale il se marie à l’âge de 33 ans, n’intervenant que dans le choix des multiples candidates proposées par ses parents. Ceux qui l’ont approché se souviennent d’un homme d’une ponctualité maniaque, terriblement exigeant (comme Montherlant, il ne pardonnait pas la médiocrité), aussi réglé qu’un banquier.
 Ambiguïté du personnage ! Célèbre à 24 ans pour un roman, Confession d’un masque, qui fait scandale au Japon, il écrit entre 1949 et 1970 une quarantaine de romans, 18 pièces de théâtre et un nombre considérable de nouvelles et d’essais. L’écrivain Mishima joue sur plusieurs registres littéraires : pour un public de midinettes, il bâcle en quelques jours des romans à deux sous qui paraissent en feuilleton ; grâce à quelques œuvres admirables comme Le Tumulte des flots, Le Pavillon d’or, Après le banquet et Le Marin rejeté par la mer (trahi par un médiocre film anglais), il est, avec son aîné et ami Kawabata, l’un des romanciers les plus connus du Japon contemporain ; les milieux traditionnels cultivés l’apprécient car il est le seul à pouvoir manier la langue et les conventions du Kabuki classique.
Ambiguïté du personnage ! Célèbre à 24 ans pour un roman, Confession d’un masque, qui fait scandale au Japon, il écrit entre 1949 et 1970 une quarantaine de romans, 18 pièces de théâtre et un nombre considérable de nouvelles et d’essais. L’écrivain Mishima joue sur plusieurs registres littéraires : pour un public de midinettes, il bâcle en quelques jours des romans à deux sous qui paraissent en feuilleton ; grâce à quelques œuvres admirables comme Le Tumulte des flots, Le Pavillon d’or, Après le banquet et Le Marin rejeté par la mer (trahi par un médiocre film anglais), il est, avec son aîné et ami Kawabata, l’un des romanciers les plus connus du Japon contemporain ; les milieux traditionnels cultivés l’apprécient car il est le seul à pouvoir manier la langue et les conventions du Kabuki classique.
Plus ou moins provocateur — certains diront exhibitionniste — il joue les gangsters dans des films de série B et expose des photographies de lui-même, jugées “indécentes” par un public volontiers puritain. En 1968, avec quelques étudiants nationalistes, il fonde une association para-militaire, la “Société du bouclier”, inspirée des ligues du “Vent Divin” (en japonais kami-kazé, typhons qui avaient anéanti providentiellement les invasions mongoles au XIIIe siècle), et visant à rétablir le culte de l’Empereur.
Moins intègre — le mot a une résonance petite-bourgeoise et manque d’envergure — qu’obsédé de pureté et de perfection, Mishima croit au geste et estime que le savoir sans acte est “obscène”.
Un trait définit parfaitement cette attitude. Invité à s’expliquer à l’université de Tokyo par les étudiants gauchistes du Zenkyoto (Front commun), il refusa la protection de la police et leur reprocha violemment de « ne pas croire suffisamment à ce pourquoi ils se battaient », puisque lors de la révolte estudiantine de 1968, aucun n’avait eu le courage « de se jeter par une fenêtre ou de tomber à la pointe du sabre ». Le texte de l’affrontement entre Mishima et les étudiants contestataires fut publié en librairie. Grand seigneur, Mishima fit don de la moitié de ses droits d’auteur au Zenkyoto, déclarant plus tard : « Ils utilisèrent l’argent à acheter des casques et des cocktails Molotov. Pour moi, j’achetai des tenues d’été pour la Société du bouclier. Ainsi, tous les intéressés sont satisfaits ». Bref, dans la société conformiste et optimiste du Japon d’après-guerre, Mishima dérangeait.
Humilié, condamné à vivre le cauchemar américain, le nouveau Japon refusait de suivre Mishima dans son désir pathétique de mourir. « J’ai scrupule à vivre quand j’aurai pu mourir à tout moment » déclare Isao, le héros de Chevaux échappés. Dans un pays qui oublie l’art de mourir, Mishima soutient comme les anciens samouraï que « la manière dont meurt un homme peut valoriser sa vie entière ».
Aucune œuvre n’a lié autant que celle de Mishima, et de façon aussi constante, la mort au désir érotique, sinon celle de T. Mann. Pour l’écrivain allemand, comme pour le japonais, la vie ne s’exalte qu’aux approches de la mort. Thomas Mann, en analyste subtil de la maladie, s’intéresse à l’étroit tunnel qu’elle creuse dans le vivant : peste dans La Mort à Venise, tuberculose dans La Montagne magique, syphilis dans Le docteur Faustus, cancer dans Le Mirage, la mort est un mal qui ronge, une passion. Pour Mishima en revanche, elle découle d’une mise en scène, d’un jeu violent du corps, de même nature que l’amour ou que l’exercice physique : la sueur, le sperme et le sang sont les 3 fleuves qui coulent vers l’océan, image de la gloire et de la mort.
Cet océan terrible et lisse, qui absorbe les amants suicidés et rejette les marins pour avoir perdu la « conscience du danger » et choisi la terre ferme, s’achève par quelques vagues « entêtées à atteindre leur but » dans un ultime échec. Lorsqu’il a trouvé l’occasion de mourir, il importe peu au héros ayant choisi le bushidô (la voie du guerrier) que ce soit en vain. Plus que la noblesse de l’échec, c’est la noblesse du néant qu’il faudrait dire. Il est évident que dans cette perspective, nos catégories psychologiques — celles de Freud, en particulier, que Mishima jugeait grossières — ne signifient plus rien. Le sacrifice du héros par le suicide permet « de changer sa vie en un instant de poésie » : la mort est à la fois aussi violente et inutile que les vagues de l’océan à l’assaut des falaises, aussi douce et nécessaire que la chute des fleurs de cerisier au printemps, sort que se souhaitaient les kamikazes de la Seconde Guerre mondiale.
Cette vocation impériale de la mort est manifeste dans sa dernière œuvre, écrite entre 1965 et 1970, La Mer de la fertilité, cycle de 4 romans dont les 2 premiers, Neige de printemps et Chevaux échappés, viennent de paraître chez Gallimard. Cette monumentale tétralogie contient, selon Mishima, « le principal de ce qu’il avait à dire ». En l’absence des romans suivants, Le Temple de l’aube et L’Ange en décomposition, en cours de traduction, il est trop tôt pour juger l’ensemble.
Ce roman de la société japonaise au XXe siècle oscille entre la “chrysanthème” et “l’épée” ; par là Mishima entendait la culture japonaise totale, aussi bien les objets “inoffensifs”, féminins et raffinés qui plaisent tant à l’étranger, que les éléments jugés dangereux comme les arts martiaux, le bushidô, le seppuku, voire le terrorisme. Côté chrysanthème, Neige de printemps, histoire d’une passion amoureuse et tragique à la fin de l’ère Meiji. Côté épée, Chevaux échappés, qui se déroule dans le Japon militarisé de l’entre-deux-guerres. Isao, un jeune champion de kendo sacrifie tout à la pureté de son idéal. Non seulement il échoue dans sa tentative terroriste de tuer les capitalistes corrompus, mais découvre dans un Japon pollué par « l’écume de l’humanisme », que la pourriture n’a épargné personne, pas même les cercles patriotiques financés en sous-main par les grands trusts. Lâché par les militaires, trahi pour être sauvé de la mort par son père et celle qu’il aime, il s’aperçoit que tout n’a été qu’illusion. Décidé à « détruire l’esprit de mort qui détruit le Japon », il tue un riche capitaliste, puis se suicide devant l’océan. Ce roman, beaucoup mieux qu’une biographie, indique que Mishima ressentait le déshonneur du Japon dans sa chair, et que son “désir de mort” était éminemment culturel, bien plus profond que de vagues problèmes psychologiques.
On ne peut comprendre qu’en revenant à la catastrophe de 1945. Je ne veux pas parler seulement de la défaite militaire, mais des nombreux Hiroshima de l’âme dont furent coupables, en toute bonne conscience, les autorités américaines d’occupation : l’empereur dépouillé de son caractère divin, la démilitarisation constitutionnelle, le démantèlement du Shintô, l’interdiction d’œuvres littéraires largement antérieures à la naissance de la puissance occupante, le kabuki mutilé, etc. Le pessimisme naturel des Japonais ne pouvait être compris par une nation qui dépouille la vie de tout sens tragique, à plus forte raison si elle est victorieuse. Il faut relire, dans Le Pavillon d’or, les passages où l’occupant américain, méprisé pour son sans-gêne, souille par sa seule présence le temple qui, pour le jeune moine zen réduit à se donner en spectacle aux touristes, est l’essence même de la beauté.
Semblable à « un koto dont la moitié des cordes seraient cassées », le Japon, dans l’opération chirurgicale séparant le chrysanthème de l’épée, a perdu sa musique intérieure et rend « un ton grêle ». Au siècle précédent, un philosophe samouraï, Oshio Heihachiro, que Mishima admirait fort, n’avait-il pas écrit : « Qu’est donc cette chose qu’on appelle la mort ? Il nous est impossible de nier la mort du corps, mais la mort de l’âme, voilà, certes, ce qui est à craindre ». N’est-ce pas l’âme du Japon, et en même temps la sienne, que Mishima voulait retrouver en combattant ? En ce sens c’est moins de nationalisme ou de patriotisme qu’il faut parler, que de frémissement sacré en présence de la tradition Japonaise toute imprégnée de légendes et de rites.
Situé, de par ses origines familiales, au carrefour de différentes variantes du bouddhisme, du confucianisme et du shintoïsme, Mishima semble avoir opté à la fin de sa vie pour un shintoïsme fortement influencé par le karman [acte rituel accompli selon les prescriptions des textes sacrés]. Il est significatif que dans Chevaux échappés, les bouleversements révélateurs se manifestent sur des lieux ou au cours de cérémonies shintôs : avec ses montagnes saintes, couvertes de cèdres, de pins rouges et de sakakis, l’arbre du rituel shintô par excellence, ses cascades et ses grottes sacrées, ses petits sanctuaires de bois, ses joutes sportives d’adolescents purs de toute souillure ou ses vierges qui dansent un bouquet de lis roses à la main, ses banquets en l’honneur des dieux, le Japon de Mishima nous aide à comprendre ce que dut être la Grèce de Pindare...
Mais il n’était plus, le temps où le héros japonais, en toute sérénité, faisait ses derniers adieux à son prunier en fleur avant de se suicider. En une époque où le ciel et la terre sont séparés, où le soleil, image de la majesté sacrée de l’empereur, est obscurci, seul l’acte pur, décisif, du messager qui « hasarde sa vie, sans du tout songer pour soi-même à gagner ou à perdre », peut contraindre le ciel et la terre « à se rencontrer pour s’étreindre en souriant ». « À l’instant précis de sa mort, je vis son visage devenir le visage même de quelqu’un qui était né pour mourir d’amour. Toute discordance, en cet instant, était effacée » (Chevaux échappés). Il était midi, ce 25 novembre 1970. En cette fin d’automne, le soleil brillait d’un pâle éclat. Mais celui que vit Mishima derrière ses paupières lorsque « la lame tranchait dans les chairs », sphère éclatante, disque rouge pur et parfait, bondissait vers le zénith.
• Y. Mishima, La Mer de la fertilité, Gallimard (2 vol. : Neige de printemps, 440 p. ; Chevaux échappés, 458 p.).
• John Nathan, La vie de Mishima, Gal., 318 p.
• Ivan Morris, La noblesse de l’échec : héros tragiques de l’histoire du Japon, Gal., 398 p.
N.B. : Les 4 volumes de la tétralogie de La Mer de la fertilité sont présentement disponibles chez Gallimard en Folio ou rassemblées en un volume dans la collection Quarto (2004, 1204 p., 24,50 €, tr. Tanguy Kenec'hdu, préf. M. Yourcenar ). Pour l'ouvrage d'Ivan Morris, cf. aussi la recension de M. Yourcenar : « Le Japon de la Mort choisie », L'Express nº1494, 1er mars 1980, repris dans le recueil Le Temps, ce grand sculpteur (Gal., 1983), à son tour repris dans : Essais et mémoires (Gal. / Pléiade, 1991) dans lequel on retrouvera aussi l'essai sur Mishima.
► Denys Magne, éléments n°34, 1980.
◘ La résurrection de Mishima
[Ci-dessous : Paul Schrader (à d.) et Ken Ogata pendant le tournage de Mishima (séquence finale). Ce film américain, qui pouvait. inspirer les pires inquiétudes, s'est révélé d'une grande honnêteté intellectuelle et d'une réelle sensibilité]
 Dans le cadre de la dialectique modernité-antimodernité au sein de la littérature japonaise contemporaine, une étude approfondie de la figure et de l'œuvre de Yukio Mishima s'avère indispensable. Sous cet aspect, le rôle joué par ce dernier apparaît fondamental, car c'est chez Mishima que cette dialectique culturelle se donne à voir avec le plus de force.
Dans le cadre de la dialectique modernité-antimodernité au sein de la littérature japonaise contemporaine, une étude approfondie de la figure et de l'œuvre de Yukio Mishima s'avère indispensable. Sous cet aspect, le rôle joué par ce dernier apparaît fondamental, car c'est chez Mishima que cette dialectique culturelle se donne à voir avec le plus de force.
De nombreux critiques littéraires, japonais et étrangers, ont souligné (touchant peut-être ainsi quelque chose d'essentiel) que pour Mishima, la polémique n'a jamais été une drogue destinée à le couper de tout contact avec la réalité, mais bien plutôt un moyen efficace de la comprendre de manière plus lucide et plus pénétrante. Certes, aux yeux d'un observateur superficiel, bien des aspects de la personnalité de Mishima peuvent sembler contradictoires, voire “frivoles”. Un seul exemple : parallèlement à une indiscutable ouverture à la modernité, se traduisant jusqu'en des formes extrêmes (Mishima volant à bord d'avions supersoniques, pratiquant la boxe, posant comme modèle, composant des chansonnettes), on trouve chez l'écrivain japonais une exaltation de la culture traditionnelle, dont l'expression la plus dramatique sera le suicide rituel (acte d'une liturgie libératrice, qui rappelle la “culture de la mort” des néo-romantiques japonais de l'entre-deux-guerres).
À la dichotomie progrès-antiprogrès, Occident-Orient, s'oppose aussi un autre trait de Mishima : sa connaissance remarquable, soulignée par de nombreux critiques non japonais, de la culture occidentale. Tout le discours culturel complexe de Mishima envisage donc la question des rapports entre la culture japonaise et la culture occidentale. Cette dernière imprègne profondément l'écrivain : sa tension, son désir de retrouver l'unité de l'action et de l'intellect se révèle typiquement occidental, puisque c'est précisément en Occident que s'est produit cette fracture, inexistante dans la culture orientale. De même que sont occidentaux son exaltation du corps et son idéal classique de la beauté solaire et apollinienne où se croisent et se fondent le Bon et le Beau.
Redécouverte, exhumation d'une Urheimat [patrie originelle] spirituelle, le “retour au Japon” de Mishima est donc soutenu par un solide bagage de culture occidentale, auquel l'écrivain n'entend pas du tout renoncer. Du reste, le Japon où vit Mishima, où il écrit, est un Japon bien réel, un pays où la culture occidentale remplit désormais une fonction très définie mais importante, influence l'attitude des gens devant la vie et le monde. En dépit de sa nostalgie de la société traditionnelle – dont il sait qu'elle ne reviendra pas, du moins dans un avenir proche – Mishima présente donc, sans aucun doute possible, des éléments tout à fait modernes. Jusque dans sa vie privée enfin, et bien qu'il croie aux valeurs de la tradition japonaise, l'écrivain, loin de rester fermé à l'Occident, adopte un cadre de vie délibérément occidental. C'est ainsi, par ex., qu'il fait bâtir une maison dont le style reflète un mélange de ugly Victorian et de baroque italien, avec dans le jardin une statue d'Apollon (« Mon modeste symbole du rationnel », dira-t-il).
Tout cela peut être interprété à la lumière du caractère “récapitulatif” – sorte de résumé morphologique – que Mishima attribue à la culture japonaise contemporaine. Pour saisir la réalité japonaise, il est en effet nécessaire de ne pas fermer les yeux sur les éléments modernes qui y coexistent avec tant d'autres facteurs. L'écrivain perçoit donc dans son intégralité la physionomie culturelle du Japon d'aujourd'hui, manifestant à l'égard de l'Occident, répétons-le, une ouverture sans préjugés ou réserves mentales de nature littéraire ou socio-culturelle, comme en témoigne d'ailleurs sa sensibilité aux questions sociales, politiques et économiques de notre époque.
Somme toute, Mishima décrit la nouvelle société japonaise en des termes relativement positifs. Il tire de son expérience romantique l'exaltation de l'individu, soulignée avec emphase sur le plan de la syntaxe également (recours fréquent à la virgule après le sujet, comme l'a noté un critique), et l'exaltation de l'amour.
L'amour est un des thèmes majeurs de son œuvre, et Mishima lui confère la plus grande liberté, même si son choix, en privé, fut différent puisqu'il se maria dans le respect de l'orthodoxie traditionnelle la plus rigide (optant pour un “mariage de raison” qui fit d'ailleurs beaucoup de bruit). Chez Mishima, l'amour n'a rien à voir avec la morale et l'écrivain n'hésite pas à en décrire les formes les plus passionnées ou les plus scabreuses (homosexualité, adultère, etc.), se montrant en cela très proche de Jun'ichirô Tanizaki (1). Corollaire obligé de cette exaltation de l'amour : la dignité reconnue à la femme qui, chez Mishima, n'apparaît pas soumise, comme le voudrait le cliché traditionnel, mais toujours en possession d'une forte personnalité. Dans Utage no Ato (Après le banquet, 1963), par ex., le personnage le plus important est une geisha, qui tire les fils d'une manœuvre politique compliquée. Même lorsqu'il décrit l'image de la femme traditionnelle, telle l'épouse du lieutenant Shinji Takeyama dans Yûkoku (Patriotisme, 1960), Mishima, qui pourtant retombe ici dans une certaine vision stéréotypée, n'en attribue pas moins à cette femme une très forte volonté et fait d'elle un être parfaitement conscient de ses actes dans toute leur réalité dramatique.
Pour comprendre l'œuvre de Mishima, il faut donc opérer un distinguo préliminaire entre éléments prémodernes et éléments modernes, dans le droit fil des études récentes et de la terminologie de Romano Vulpitta (2). On devrait en fait parler ici, plus que d'une dichotomie, d'une trichotomie : modernité, prémodernité, anti-modernité. La présence prémoderne concerne en particulier ce qui rattache Mishima à l'ancien monde japonais, qui exerce sur lui – contrairement à ce qui se passe pour Shintarô Ishihara (3) – une séduction considérable, sans pour autant avoir l'évidence presque excessive qu'il acquiert dans les personnages de Yasunari Kawabata (4). Le charme de la vieille société affleure çà et là : par ex. dans Kinu to Meisatsu (Soie et perspicacité, 1964), roman d'inspiration politique où l'auteur se livre à une satire sévère des syndicats, instruments dociles entre les mains des groupes industriels, qui les utilisent dans le cadre des luttes pour le pouvoir. Le héros de ce roman, Komazawa, est un self-made man qui a bâti à partir de rien une grande entreprise, devenue sa seule raison de vivre. Insistant sur le thème de la direction paternaliste de l'entreprise, avec le rapport personnel qui lie le patron aux ouvriers, Mishima se propose d'évoquer la société japonaise d'avant la guerre, et l'on entrevoit ici une sorte de nostalgie du modèle du père, figure anéantie par la “libération” américaine de l'après-guerre. L'auteur exprime aussi la conviction que, dans un ordre de ce type, l'homme, en tant que membre d'une communauté, parvenait encore, fût-ce difficilement, à vivre dans la justice et la dignité. Komazawa, qui peut paraître odieux en raison de la façon tyrannique avec laquelle il exerce son autorité, fait cependant penser à la fin du roman, lorsque ses adversaires triomphent, à une figure pathétique de Don Quichotte de l'industrie, qui a cru en toute bonne foi à un monde fait de rapports directs entre les hommes. Mais, soulignons-le, Mishima est moderne lorsqu'il décrit les défauts de ce monde, qui a d'ailleurs disparu depuis.
 Le sens donné à l'œuvre d'art révèle, lui aussi, un trait prémoderne chez Mishima. Celui-ci conçoit l'œuvre d'art à la manière de Rôhan Kôda (5), c'est-à-dire comme un moyen d'élévation de l'individu : pour l'artiste, l'art est une vocation à laquelle il doit obéir complètement. C'est à cela que renvoie l'image du Kinkaku-ji (Le Pavillon d'or, 1956), qui a le pouvoir, en vertu de l'influence terrible et surnaturelle qu'elle charrie, d'anéantir l'individu, au point que ce dernier, pour se défendre, en est réduit à détruire la cause du sortilège. Dans cette perspective, le fait que Mishima identifie l'œuvre d'art à tout l'héritage culturel japonais est significatif. Cet idéal de l'art comme mission et fonction est réaffirmé dans un drame de 1969, Raiô no Têrasu (La Terrasse du roi lépreux), qui puise son inspiration dans une vieille légende cambodgienne. À Angkor Wat, au Cambodge, existe un temple, le Bayon, dont l'imagination populaire attribue la construction à un roi lépreux (Jayavarman VII), à cause de la statue d'un noble qui se trouve sur les lieux et qui, pour avoir été sculptée dans un matériau fragile, a subi les injures du temps, lequel a rendu le personnage semblable à un lépreux. Mishima considère la construction du temple comme la mission impartie au roi. Le jour où celui-ci décide d'entamer les travaux apparaissent les premiers symptômes de la maladie, qui progressera au même rythme que la construction de l'édifice. Le roi mourra le jour même où le temple sera achevé, comprenant alors, mais alors seulement, que le Bayon est à la fois la représentation et la projection de sa personnalité. En somme, œuvre d'art et artiste s'identifient dans la théorie de la culture définie par Mishima.
Le sens donné à l'œuvre d'art révèle, lui aussi, un trait prémoderne chez Mishima. Celui-ci conçoit l'œuvre d'art à la manière de Rôhan Kôda (5), c'est-à-dire comme un moyen d'élévation de l'individu : pour l'artiste, l'art est une vocation à laquelle il doit obéir complètement. C'est à cela que renvoie l'image du Kinkaku-ji (Le Pavillon d'or, 1956), qui a le pouvoir, en vertu de l'influence terrible et surnaturelle qu'elle charrie, d'anéantir l'individu, au point que ce dernier, pour se défendre, en est réduit à détruire la cause du sortilège. Dans cette perspective, le fait que Mishima identifie l'œuvre d'art à tout l'héritage culturel japonais est significatif. Cet idéal de l'art comme mission et fonction est réaffirmé dans un drame de 1969, Raiô no Têrasu (La Terrasse du roi lépreux), qui puise son inspiration dans une vieille légende cambodgienne. À Angkor Wat, au Cambodge, existe un temple, le Bayon, dont l'imagination populaire attribue la construction à un roi lépreux (Jayavarman VII), à cause de la statue d'un noble qui se trouve sur les lieux et qui, pour avoir été sculptée dans un matériau fragile, a subi les injures du temps, lequel a rendu le personnage semblable à un lépreux. Mishima considère la construction du temple comme la mission impartie au roi. Le jour où celui-ci décide d'entamer les travaux apparaissent les premiers symptômes de la maladie, qui progressera au même rythme que la construction de l'édifice. Le roi mourra le jour même où le temple sera achevé, comprenant alors, mais alors seulement, que le Bayon est à la fois la représentation et la projection de sa personnalité. En somme, œuvre d'art et artiste s'identifient dans la théorie de la culture définie par Mishima.
L'attirance (amae [sollicitude]), enfin, que Mishima éprouve pour la figure de l'Empereur (au point d'en faire le pilier de son esthétique), sert une fois de plus à mettre en relief l'élément prémoderne dans la culture de l'écrivain. Le Tennô est vu comme le centre de la société japonaise traditionnelle, le symbole de l'unité du monde patriarcal d'avant la guerre vers lequel l'auteur se tourne avec une vénération nostalgique : l'Empereur est le gardien de l'essence et de l'intégrité de la culture nippone. L'exaltation du Tennô revient sous de multiples formes, pour culminer dans Eirei no Koe (Les Voix des âmes héroïques, 1966), où Mishima affirme le caractère divin de l'Empereur, n'en déplaise à la volonté individuelle de celui-ci, et accuse Hiro-Hito de trahison envers le peuple japonais.
Mais les traits les plus voyants chez Mishima restent indubitablement antimodernes. On peut distinguer, à titre de classification provisoire, 3 points essentiels : a) l'exaltation de l'énergie et de la beauté physiques, d'une part, de l'esprit primordial et héroïque, de l'autre ; b) l'exaltation des valeurs de la race, telles qu'elles s'expriment dans le bushidô et le Shintô ; c) la foi dans la transcendance (traditions bouddhiste et shintoïste), veine “mystique” clairement perceptible et qui court dans toute l'œuvre, dès les premiers romans.
On peut dire, en résumé, que c'est précisément le caractère multiforme de l'activité culturelle de Mishima qui fait que son œuvre se prête à des interprétations divergentes. À ce sujet, il suffit de penser à la variété des positions successivement adoptées par Mishima au long de sa carrière, précoce et mouvementée, d'homme de lettres (néoromantisme, confession, existentialisme, classicisme, etc.). Ou, plus simplement, aux choix politiques qu'il a faits à partir de 1960, après avoir abandonné son attitude d'ironie polémique et d'indifférence envers les milieux politiques et littéraires de son pays – pour se tourner vers une redéfinition du “style” total de la culture japonaise en partant de la réunion des signes de reconnaissance de son harmonie profonde : le Chrysanthème et l'Épée.
►Giuseppe Fino, éléments n°54/55, 1985. (tr. fr. P. Baillet)
• notes :
- (1) Jun'ichirô Tanizaki (1886-1965), l'un des plus grands écrivains japonais contemporains, est l'auteur de nombreux romans d'inspiration fortement esthétisante et “décadentiste”. Il a été l'un des champions de la réaction aux excès du vérisme et du naturalisme en littérature (5 livres de Tanizaki ont été traduits en français, dont Journal d'un vieux fou et La confession impudique, tous 2 disponibles en Folio).
- (2) Spécialiste de la culture japonaise, auteur, notamment d'un essai comparatif sur Mircea Eliade et Yojûrô Yasuda (1910-1982), fondateur et chef de file reconnu de l'École romantique japonaise. Des extraits de l'essai en question ont été publiés dans Risguardo IV (éd. di Ar, Padova, Italie) sous le titre « Les épis de riz du jardin céleste ».
- (3) Shintarô Ishihara (né en 1932) a été particulièrement actif dans les années 50. Son œuvre la plus connue est Taiyô no Kisetsu (La saison du soleil, 1955), qui décrit, dans l'optique d'un nihilisme actif et “solaire”, les vicissitudes d'un jeune boxeur obligé de vivre dans le climat étouffant de l'après-guerre. Ishihara a été considéré par de nombreux critiques comme l'héritier le plus digne de Mishima. Ayant délaissé le métier d'écrivain, il s'est lancé dans la politique et est aujourd'hui député du parti conservateur majoritaire (PLD).
- (4) Yasunari Kawabata (1899-1972) est un des plus grands représentants de la littérature japonaise contemporaine. Il a su fondre admirablement la sensibilité lyrique et poétique de la tradition classique avec les sentiments et les thèmes des temps modernes. Il est aussi le seul écrivain japonais à avoir reçu le prix Nobel. Kawabata a exercé une influence considérable sur Mishima, qui l'appelait respectueusement “Maître”. Ses œuvres les plus connues sont La danseuse d'Izu et Pays de neige. De nombreux romans de cet auteur ont été édités chez Albin-Michel.
- (5) Rôhan Kôda (1867-1947) est un romancier connu de l'Ère Meiji (1867-1915). Son univers littéraire relève de la plus pure tradition culturelle et religieuse du Japon prémoderne. Ses œuvres principales sont Fûryû butsu (Un Bouddha à la mode) et Gojü-no-tô (La Pagode aux cinq étages).
♦ Prolongations cinéphiles
♦ L'Affaire Mishima : documentaire réalisé par Michaël Macintyre (BBC, 1985, 54 min). [consultation vidéo]
 ♦ Le Château de l'Araignée (1957) : Même s'il serait injuste de réduire la filmographie d'Akira Kurosawa au genre historique du film de sabre (chanbara), il n'en reste pas moins que l'éthique des samouraïs y apparaît dans tout son mystère et sa cohérence, cette même éthique sur laquelle Mishima s'est exprimée dans son commentaire du Hakaguré. Taxé dans son propre pays, à l'instar de Mishima, de complaire au monde occidental, l'éminent cinéaste n'a eu de cesse au contraire de mettre en interrogation valeurs ancestrales et histoire. En effet si Shakespeare occuppe une grande place (Les salauds dorment en paix s’inspirera d’Hamlet en 1960, le scénario de Rân en 1985 du Roi Lear et dans Kagemusha nous retrouvons dans la scène de la bataille finale des échos de Richard III), cette transposition de la tragédie Macbeth dans le Japon médiéval (XVIe s.) restitue non seulement l’ambiance crépusculaire de la pièce mais également la "nipponise" : ce serait une erreur de perspective que de considérer ce qui nous semblerait familier comme allant de soi sans tenir compte des réalités japonsaises. Si ce film a pour toile de fond une période troublée de l’histoire du Japon, ayant pour cadre les guerres de clans qui ont précédé l’ère Edo où le pouvoir centralisé assurera une stabilité militaire et politique, il n'en demeure pas moins une façon indirecte d'interroger l'inconscient collectif de ses contemporains en explorant l'âme japonaise (dont par ex. chacun des Sept Samouraïs symbolise une facette). Kurosawa n'en aborde pas moins les questions de son époque : Vivre (1952) à travers l'histoire d'un "homme sans qualités" au soir de sa vie traite de manière hallucinante de la bureaucratie et Chien enragé (1949) décrit le Japon moderne, traumatisé par la défaite, humilié par la présence des soldats américains sur son sol, déchiré entre la nostalgie d'une ancienne grandeur et ses choix de société. Le choix ici d'une époque chaotique, ajoutant pour nous à l'éloignement dans l'espace la distance temporelle, renforce l'émotion tragique transfigurée par la stylisation en pièce de nô (théâtre traditionnel japonais) où compte moins le verbe que l'expressivité (où excelle le charismatique Toshiro Mifune). L'épure de l'esthétique apparemment mortuaire (renvoyant à un espace-temps tragique) délivre par le chœur final en off (un psaume bouddhiste) une catharsis imprégnant l'imaginaire d'un baume cicatrisant bien des déchirures à cette âme japonaise. Si cette purification ritualisée témoigne d'un réalisateur obsédé par l’autodestruction (guerres civiles) et par la façon dont le code d’honneur guerrier peut conduire au suicide collectif d’une nation, elle n'en présente pas moins l'éthique chevaleresque comme légitimement réappropriable qu'au service de la concorde sociale ; en ce sens elle se montre proche de Mishima (contrairement aux idées reçues opposant l'humanisme de l'un au fanatisme de l'autre) entendant restaurer non point un "concept culturel" mais un principe impérial symbolisé par un monarque effectif et mystique, protecteur des humbles et des opprimés. L'édition en double DVD parue chez Wildside (2006) assortie de bonus appréciables, rend justice par son soin qualitatif à ce grand film.
♦ Le Château de l'Araignée (1957) : Même s'il serait injuste de réduire la filmographie d'Akira Kurosawa au genre historique du film de sabre (chanbara), il n'en reste pas moins que l'éthique des samouraïs y apparaît dans tout son mystère et sa cohérence, cette même éthique sur laquelle Mishima s'est exprimée dans son commentaire du Hakaguré. Taxé dans son propre pays, à l'instar de Mishima, de complaire au monde occidental, l'éminent cinéaste n'a eu de cesse au contraire de mettre en interrogation valeurs ancestrales et histoire. En effet si Shakespeare occuppe une grande place (Les salauds dorment en paix s’inspirera d’Hamlet en 1960, le scénario de Rân en 1985 du Roi Lear et dans Kagemusha nous retrouvons dans la scène de la bataille finale des échos de Richard III), cette transposition de la tragédie Macbeth dans le Japon médiéval (XVIe s.) restitue non seulement l’ambiance crépusculaire de la pièce mais également la "nipponise" : ce serait une erreur de perspective que de considérer ce qui nous semblerait familier comme allant de soi sans tenir compte des réalités japonsaises. Si ce film a pour toile de fond une période troublée de l’histoire du Japon, ayant pour cadre les guerres de clans qui ont précédé l’ère Edo où le pouvoir centralisé assurera une stabilité militaire et politique, il n'en demeure pas moins une façon indirecte d'interroger l'inconscient collectif de ses contemporains en explorant l'âme japonaise (dont par ex. chacun des Sept Samouraïs symbolise une facette). Kurosawa n'en aborde pas moins les questions de son époque : Vivre (1952) à travers l'histoire d'un "homme sans qualités" au soir de sa vie traite de manière hallucinante de la bureaucratie et Chien enragé (1949) décrit le Japon moderne, traumatisé par la défaite, humilié par la présence des soldats américains sur son sol, déchiré entre la nostalgie d'une ancienne grandeur et ses choix de société. Le choix ici d'une époque chaotique, ajoutant pour nous à l'éloignement dans l'espace la distance temporelle, renforce l'émotion tragique transfigurée par la stylisation en pièce de nô (théâtre traditionnel japonais) où compte moins le verbe que l'expressivité (où excelle le charismatique Toshiro Mifune). L'épure de l'esthétique apparemment mortuaire (renvoyant à un espace-temps tragique) délivre par le chœur final en off (un psaume bouddhiste) une catharsis imprégnant l'imaginaire d'un baume cicatrisant bien des déchirures à cette âme japonaise. Si cette purification ritualisée témoigne d'un réalisateur obsédé par l’autodestruction (guerres civiles) et par la façon dont le code d’honneur guerrier peut conduire au suicide collectif d’une nation, elle n'en présente pas moins l'éthique chevaleresque comme légitimement réappropriable qu'au service de la concorde sociale ; en ce sens elle se montre proche de Mishima (contrairement aux idées reçues opposant l'humanisme de l'un au fanatisme de l'autre) entendant restaurer non point un "concept culturel" mais un principe impérial symbolisé par un monarque effectif et mystique, protecteur des humbles et des opprimés. L'édition en double DVD parue chez Wildside (2006) assortie de bonus appréciables, rend justice par son soin qualitatif à ce grand film.
 ♦ Yûkoku (Rites d'amour et de mort) : court-métrage (29 mn, 1965) réalisé par Y. Mishima sur la base de sa nouvelle intitulée Patriotisme, considéré introuvable. Maudit, détruit, pratiquement oublié dans son propre pays, ce film est ressorti au Japon grâce à une copie miraculeusement retrouvée en 2005. Ces images quasi inédites font partie intégrante de la construction mythique de soi-même à laquelle Mishima a voué sa vie. Suivant exactement la narration de la nouvelle éponyme, ce film montre de façon stylisée la dernière étreinte amoureuse et le seppuku d'un jeune lieutenant entièrement dévoué à l'honneur samouraï, le Bushido : répétition de la mort spectaculaire que l'écrivain choisira, le 25 novembre 1970, à Tokyo. Disponible en DVD (éd. Montparnasse, 2008), avec en bonus un court entretien av. JC Coudry, accompagné d'un livret sur le film par Stéphane Giocanti et de la nouvelle. [Ci-contre : Mishima interprétant le rôle du héros de sa nouvelle ; les caractères japonais qui sont visibles à l'arrière-plan résument parfaitement ce qui fut le fil directeur de toute sa vie : ils signifient “Fidélité”]
♦ Yûkoku (Rites d'amour et de mort) : court-métrage (29 mn, 1965) réalisé par Y. Mishima sur la base de sa nouvelle intitulée Patriotisme, considéré introuvable. Maudit, détruit, pratiquement oublié dans son propre pays, ce film est ressorti au Japon grâce à une copie miraculeusement retrouvée en 2005. Ces images quasi inédites font partie intégrante de la construction mythique de soi-même à laquelle Mishima a voué sa vie. Suivant exactement la narration de la nouvelle éponyme, ce film montre de façon stylisée la dernière étreinte amoureuse et le seppuku d'un jeune lieutenant entièrement dévoué à l'honneur samouraï, le Bushido : répétition de la mort spectaculaire que l'écrivain choisira, le 25 novembre 1970, à Tokyo. Disponible en DVD (éd. Montparnasse, 2008), avec en bonus un court entretien av. JC Coudry, accompagné d'un livret sur le film par Stéphane Giocanti et de la nouvelle. [Ci-contre : Mishima interprétant le rôle du héros de sa nouvelle ; les caractères japonais qui sont visibles à l'arrière-plan résument parfaitement ce qui fut le fil directeur de toute sa vie : ils signifient “Fidélité”]
 ♦ Mishima, une vie en quatre chapitres : ce film de Paul Schrader (1985), doté d'une belle photographie et servi par une bande originale inspirée (due à Philipp Glass), se veut une tentative de pénétrer l'œuvre et la pensée de l'écrivain japonais à la lumière de sa propre vie, des grands thèmes et des grandes figures de son œuvre littéraire, ces 2 niveaux de lecture convergeant au niveau du scénario vers un troisième qui sert de ligne narrative : la dernière journée de Mishima, de son lever jusqu'au geste suicidaire, que la mise en scène de Schrader stylise et rend à la fois elliptique et emphatique. Se voulant trop pédagogique, soumis à la volonté “hagiographique” de la veuve de Mishima (qui a voulu au maximum gommer l'aspect homosexuel de l'écrivain), Mishima se présente comme œuvre ambitieuse narrativement et stylistiquement (reconstitution très stylisée du Pavillon d'or par la décoratrice japonaise Ishioka Eiko) mais qui ne fait qu'illustrer lourdement un programme-scénario qui finit par fonctionner comme une grille de lecture trop rigide. Conseillons la version restaurée sortie en double DVD (Wildside, déc. 2010) offrant d'éclairants bonus. [chronique radio]
♦ Mishima, une vie en quatre chapitres : ce film de Paul Schrader (1985), doté d'une belle photographie et servi par une bande originale inspirée (due à Philipp Glass), se veut une tentative de pénétrer l'œuvre et la pensée de l'écrivain japonais à la lumière de sa propre vie, des grands thèmes et des grandes figures de son œuvre littéraire, ces 2 niveaux de lecture convergeant au niveau du scénario vers un troisième qui sert de ligne narrative : la dernière journée de Mishima, de son lever jusqu'au geste suicidaire, que la mise en scène de Schrader stylise et rend à la fois elliptique et emphatique. Se voulant trop pédagogique, soumis à la volonté “hagiographique” de la veuve de Mishima (qui a voulu au maximum gommer l'aspect homosexuel de l'écrivain), Mishima se présente comme œuvre ambitieuse narrativement et stylistiquement (reconstitution très stylisée du Pavillon d'or par la décoratrice japonaise Ishioka Eiko) mais qui ne fait qu'illustrer lourdement un programme-scénario qui finit par fonctionner comme une grille de lecture trop rigide. Conseillons la version restaurée sortie en double DVD (Wildside, déc. 2010) offrant d'éclairants bonus. [chronique radio]
 ♦ Ghost Dog : film atypique de l'auteur-réalisateur Jim Jarmusch (1999) dans la même veine que son western décalé Dead Man (1995). Ce polar caustique et imaginatif, au personnage central donquichottesque et improbable, propose une marche de nuit pour la question jusqu'aux conséquences extrêmes. L'interpénétration entre “l'ancien & le nouveau” (pour reprendre un titre de l'essai de Marthe Robert sur Cervantès et Kafka) prend ici le rôle d'un manifeste d'une esthétique postmoderne, servie de manière originale par les maximes de l'Hagakuré.
♦ Ghost Dog : film atypique de l'auteur-réalisateur Jim Jarmusch (1999) dans la même veine que son western décalé Dead Man (1995). Ce polar caustique et imaginatif, au personnage central donquichottesque et improbable, propose une marche de nuit pour la question jusqu'aux conséquences extrêmes. L'interpénétration entre “l'ancien & le nouveau” (pour reprendre un titre de l'essai de Marthe Robert sur Cervantès et Kafka) prend ici le rôle d'un manifeste d'une esthétique postmoderne, servie de manière originale par les maximes de l'Hagakuré.

◘ Lectures complémentaires :
• 2 recensions parues dans La Lettre du crocodile n°3/2004 :
♦ Bushidô, la voie des samouraïs, Rinaldo Massi (Pardès) : Ce petit texte, vraiment remarquable, fut publié en 1976 et 1980, comme introduction aux 2 éditions italiennes parues chez Sannô-Kai à Padoue, du livre d’Inazô Nitobe, Bushidô, the Soul of Japan. R. Massi démontre en quoi le bushidô est une voie d’éveil. Rappelons que certains vieux maîtres ne voulaient pas entendre parler d’art martial. Pour eux, il n’était question que d’éveil. En 5 petits chapitres, l’auteur dresse un exposé non seulement du bushidô comme voie d’éveil mais de l’esprit de Tradition : Bushidô no kokoro, l’essence du bushidô – Kami to Eiyû, la voie des dieux et des héros -Zen to bushi, la voie du Zen et des guerriers – Kôshi to Bushi, la voie de Confucius et des samouraïs – Tennô to Gunjin, la voie de l’Empereur et des soldats. Le Bushidô se situe au carrefour du shintoïsme, des bouddhismes, et de la religion de l’Empereur, mais sa finalité est de faire face à la mort, puis de dépasser vie et mort en demeurant dans mushin no shin, « un esprit non troublé par les questions de la mort ou de l’immortalité » selon le maître Takuan. « Quel était le “noyau” du bushidô ? La voie du guerrier, étroitement connexe avec le Zen d’un côté et les voies martiales (budô) de l’autre, confluait naturellement, à un niveau supérieur, dans une seule discipline ascétique, celle du Zen. Toutefois, il est possible de relier directement le bushidô – compris comme une “religion” de l’action héroïque et de la réalité, ou aussi comme le “Zen des samouraïs” – à une forme autonome d’ascèse. Le complément conscient et prédestiné de l’action héroïque était la mort dans la bataille ou le suicide par le rite de seppuku (harakiri), par loyauté (chû), par le sens du devoir (giri), ou pour suivre dans le monde de “l’au-delà” (yukai) son seigneur (junshi : le seppuku du bienheureux départ). Pendant la période du Bushidô guerrier, le samouraï qui ne terminait pas sa vie ainsi se retirait dans un monastère zen. Le guerrier était donc un volontaire de la mort et l’essence de son entraînement était la préparation à la mort héroïque ».
♦ La mer de la fertilité, Yukio Mishima (Gallimard, coll. Quarto) : Gallimard ressort dans sa collection Quarto l’œuvre fondamentale de Mishima. La mer de la fertilité est composée de 4 romans : Neige de printemps, Chevaux échappés, Le temple de l’aube et L’ange en décomposition. Quelques heures après avoir achevé ce dernier roman pour son éditeur, Mishima se faisait seppuku, le 25 nov. 1970. Cette tétralogie couvre l’histoire du Japon de 1912 à 1970, c’est-à-dire dans cette période si particulière du passage complexe de la Tradition à la modernité, sur 4 générations. La préface de M. Yourcenar ne permet pas au lecteur de saisir toute la profondeur symbolique de l’œuvre. Sous la plume de Mishima, le choc entre traditions et modernité est tel qu’il emporte le lecteur avec violence dans les subtilités de l’âme japonaise. Ce livre, testament littéraire et spirituel de Mishima, outre son intérêt littéraire est porteur de l’esprit de Tradition si particulier au pays du soleil levant. Pour mieux comprendre le geste ultime de Mishima, nous vous conseillons l’étude de Maurice Pinguet : La mort volontaire au Japon (Gal.). L’auteur familier du Japon a réalisé une grande enquête historique et sociologique sur le seppuku. Même si la poésie est la seule parole qui puisse donner le pressentiment de l’essence de l’acte, les regards multiples de Maurice Pinguet explorent toutes les dimensions d’une tradition qui demeure incompréhensible pour la plupart des occidentaux et même des orientaux qui ne sont ni culture nippone ni de culture martiale. L’auteur consacre son dernier chapitre à L’acte Mishima : « Depuis le romantisme, un écrivain ne compose pas moins ses attitudes que ses phrases : Mishima s’y efforce, il voudrait devenir statue, monument. Mais en même temps son œuvre, toute de franchise et de transparence, s’obstine à ne rien cacher des coulisses de ce théâtre. Il serait prêt à rire parfois le premier de ses poses, si la mort n’était pas là pour rappeler tout le monde au sérieux. Ou plutôt, n’est-ce pas la mort qui fait que rien n’est sérieux ici-bas ? Il a conçu son dernier acte pour y mourir : à ce prix, il s’appropriera une identité irréfutable. Encore, s’il croyait à la vérité – mais il pense, avec Nietzsche, qu’il n’existe en ce monde que des apparences et des interprétations. Il mourra donc en soldat de l’Empire. Ou bien, en écrivain jouant au soldat ? S’il est prêt à payer aussi cher le dernier de ses masques, c’est pour expier la vacuité que le rêve creusa en lui, c’est pour assouvir son besoin de punition sur la vanité de l’imaginaire, qui fit sa torture et ses délices. Il aura, de surcroît, la satisfaction de jouer encore un autre rôle : le voilà censeur confucéen, fustigeant les mœurs d’aujourd’hui. Sa mort sera la remontrance qu’il destine à tout et à tous : à l’empereur d’abord, infidèle à sa souveraineté, à la nation déchue de sa tradition, aux soldats indignes de leurs armes, au monde moderne avili et dégradé, à tous ceux qui croient vivre et ne savent pas mourir ».
◘ Les Japonais redécouvrent Mishima
 Dans un récent entretien publié par la revue Shokun, la veuve de Mishima, Yoko Hiraoka ; faisait allusion à une série d'événements prouvant la vivacité du souvenir de son mari au Japon, où certains extrémistes, par opposition à l'américanisation de leur pays, affichent le portrait de l'homme de plume et de sabre lorsque celui-ci haranguait les Forces d'autodéfense en les exhortant à se rebeller contre une constitution qui les empêchait de devenir de “vrais militaires”.
Dans un récent entretien publié par la revue Shokun, la veuve de Mishima, Yoko Hiraoka ; faisait allusion à une série d'événements prouvant la vivacité du souvenir de son mari au Japon, où certains extrémistes, par opposition à l'américanisation de leur pays, affichent le portrait de l'homme de plume et de sabre lorsque celui-ci haranguait les Forces d'autodéfense en les exhortant à se rebeller contre une constitution qui les empêchait de devenir de “vrais militaires”.
Dans l'éphéméride des 15 dernières années, qui ont suivi la mort de Mishima, nous trouvons malheureusement trop souvent des actes à placer dans la rubrique des faits divers. Certains montrent d'ailleurs à quel point il continue de déranger.
C'est ainsi qu'en 1971, l'urne contenant les restes de l'écrivain fut volée dans le cimetière de Tama. Dans La mort en été , Mishima a décrit ce grand cimetière des faubourgs de Tokyo : « Des pelouses vertes, de larges avenues bordées d'arbres, sous un ciel bleu et clair jusqu'au lointain. La cité des morts était plus propre et mieux ordonnée que la cité des vivants ».
Puis, en 1975, des vandales brisèrent la lourde pierre gravée au nom des Hiraoka (le véritable patronyme de Mishima), élevée sur le monument mortuaire. Ils firent aussi tomber la plaque tombale qui se dresse à sa droite et qui porte les noms des différents défunts de la famille. Yoko Hiraoka demanda alors à la police d'enquêter discrètement.
Le 3 mars 1977, des anciens membres de la Tate-no-kai investirent l'immeuble du patronat en prenant en otage 2 employés. La Tate-no-kai (Société du bouclier) était la milice fondée par Mishima pour servir de rempart à l'Empereur. Elle fut dissoute en 1971. Les 4 membres du nouveau groupe, ceints d'un bandeau avec le soleil levant sur le front, voulaient faire un acte de loyalisme envers Mishima. Auparavant, ils s'étaient recueillis sur sa tombe. Sa femme, dépêchée sur les lieux, parvint à mettre fin à l'opération. « Mishima n'aurait pas apprécié une telle action », dit-elle alors.
Un événement original est à noter en 1983. Un religieux shintoïste a en effet élevé un temple à la mémoire de l'écrivain sur les pentes du Mont Fuji, la “montagne sans pareille”, montagne sacrée et symbole du Japon. Il faut se rappeler que le nom de Mishima vient d'une ville située non loin du Mont Fuji. Dans le recueil d'estampes de Hiroshige, Mishima est le onzième relais sur la route du Tokaïdo. De la ville de Mishima, le Mont Fuji apparaît sous son profil le plus pur. Malheureusement les brumes, les nuages, la pollution de cette région aujourd'hui industrielle permettent rarement de l'apercevoir.
L'année dernière le réalisateur américain Paul Schrader est venu tourner à Tokyo son Mishima. Après de multiples contraintes exercées par la famille de l'écrivain, Schrader a obtenu l'autorisation de tourner le film. Mais au fur et à mesure de l'avancement des prises de vue, les relations se détériorèrent avec Yoko Hiraoka. Elle exigea que le tournage soit interrompu, accusant le réalisateur de traiter son mari d'homosexuel, avec en plus « un ton de Yakuza ». Elle parla même de poursuites. Par ailleurs, l'extrême-droite proféra des menaces de mort. Terminé en secret, à la manière d'un film pornographique, Mishima ne sera sans doute pas présenté au public japonais.
Paul Schrader connut ensuite une nouvelle épreuve. Le biographe anglais de Mishima, Henry Scott Stokes, lui reprocha d'avoir violé ses droits d'auteur en empruntant des dialogues qu'il avait inventés pour son livre...
 Le 24 novembre 1984, pour son premier numéro, l'hebdomadaire à scandale Friday titrait : « Quatorze ans après sa mort, des photos choquantes de Mishima ». Ces photos, sorties mystérieusement des archives de la police, représentaient la tête de Mishima après décollation lors de sa mort volontaire. Aussitôt sa femme engagea une action en justice contre la revue. C'est à cette occasion qu'elle accorda son entretien au magazine Shokun.
Le 24 novembre 1984, pour son premier numéro, l'hebdomadaire à scandale Friday titrait : « Quatorze ans après sa mort, des photos choquantes de Mishima ». Ces photos, sorties mystérieusement des archives de la police, représentaient la tête de Mishima après décollation lors de sa mort volontaire. Aussitôt sa femme engagea une action en justice contre la revue. C'est à cette occasion qu'elle accorda son entretien au magazine Shokun.
Mais certains faits sont plus encourageants. Actuellement, les Japonais découvrent l'homme d'idées derrière l'écrivain. De son vivant, on ne comprenait pas qu'un romancier puisse parler de “choses sérieuses” comme la pensée politique. Mais avec les années, les passions se calment. L'étude de ses essais et analyses théoriques se développe, parallèlement à l'exégèse de son génie artistique. Ainsi vient de paraître un ouvrage, Résurrection de Mishima, sous la signature d'un docteur en droit, Komuro Naoki. Il étudie les thèses de Mishima sur l'histoire, la culture, le système de l'Empereur, la libre disposition de soi, l'action, et cite ses écrits idéologiques essentiels pour le comprendre dans sa totalité.
Cet homme tourmenté qui, à force de volonté, s'était forgé un destin exceptionnel, devient peu à peu un exemple dans un univers où la pureté est signe d'inversion.
► Riyo Kiyokawa, éléments n°54/55, 1985.
• Rajout des encadrés :
 ♦ La voie du samouraï, c'est la mort : Il y a dans le film de Paul Schrader, qui vient de sortir sur nos écrans, une image poignante : celle où l'on voit Mishima, magnifiquement interprété par Ken Ogata, haranguer des soldats de la garnison de Tokyo. Pendant qu'il parle d'honneur, de courage, de vertu militaire, la troupe, habillée à l'américaine, mal alignée, indisciplinée, se fait goguenarde et bientôt lui lance des boîtes de Coca-Cola et des canettes de bière. Stupéfait, désespéré, Mishima réalise soudain à quel point le Japon moderne, corrompu par les marchands, est loin de l'idéal qu'il lui propose. Alors, fidèle à l'éthique samouraï qui est la sienne depuis sa jeunesse, il se suicide. Or, 3 mois avant son seppuku rituel, Mishima avait publié un essai intitulé Le Japon moderne et l'éthique samouraï qui vient enfin d'être traduit en français, et dont on regrettera qu'il l'ait été de l'anglais, et non du japonais ! Il s'agit, en fait, d'une méditation sur un ouvrage du XVIIIe siècle, le Hagakuré où un samouraï, Jôchô Yamamoto, expose ce que doit être la “voie du guerrier”. Mishima publie de longs extraits de cet ouvrage que les autorités d'occupation avaient voulu interdire après 1945. Il s'interroge aussi sur le sens de quelques-unes des maximes les plus célèbres du Hagakuré et notamment sur la première : « La voie du samouraï, c'est la mort ». Non pas délectation morbide, non pas nihilisme de pacotille, mais : sérénité, maîtrise de soi. Le guerrier sait que la mort est au bout du chemin, inéluctablement. Sa grandeur – sa vertu – c'est d'accepter lucidement cette échéance, en tâchant de la justifier par l'œuvre accomplie. Comme le dit Yamamoto : « celui qui meurt en ayant échoué, sa mort est celle d'un fanatique ; une mort vaine ». Il faut donc combattre pour vaincre, pour réussir. Il est vrai aussi que Yamamoto ajoute que la mort dans l'échec, si elle est vaine, n'est pas pour autant déshonorante, pourvu que le combat ait été mené selon l'éthique guerrière. Et l'on devine comment de telles paroles ont pu résonner dans l'âme de ce chevalier des temps modernes (temps d'adversité et d'abjection) que fut Mishima... (Frédéric Aumage)
♦ La voie du samouraï, c'est la mort : Il y a dans le film de Paul Schrader, qui vient de sortir sur nos écrans, une image poignante : celle où l'on voit Mishima, magnifiquement interprété par Ken Ogata, haranguer des soldats de la garnison de Tokyo. Pendant qu'il parle d'honneur, de courage, de vertu militaire, la troupe, habillée à l'américaine, mal alignée, indisciplinée, se fait goguenarde et bientôt lui lance des boîtes de Coca-Cola et des canettes de bière. Stupéfait, désespéré, Mishima réalise soudain à quel point le Japon moderne, corrompu par les marchands, est loin de l'idéal qu'il lui propose. Alors, fidèle à l'éthique samouraï qui est la sienne depuis sa jeunesse, il se suicide. Or, 3 mois avant son seppuku rituel, Mishima avait publié un essai intitulé Le Japon moderne et l'éthique samouraï qui vient enfin d'être traduit en français, et dont on regrettera qu'il l'ait été de l'anglais, et non du japonais ! Il s'agit, en fait, d'une méditation sur un ouvrage du XVIIIe siècle, le Hagakuré où un samouraï, Jôchô Yamamoto, expose ce que doit être la “voie du guerrier”. Mishima publie de longs extraits de cet ouvrage que les autorités d'occupation avaient voulu interdire après 1945. Il s'interroge aussi sur le sens de quelques-unes des maximes les plus célèbres du Hagakuré et notamment sur la première : « La voie du samouraï, c'est la mort ». Non pas délectation morbide, non pas nihilisme de pacotille, mais : sérénité, maîtrise de soi. Le guerrier sait que la mort est au bout du chemin, inéluctablement. Sa grandeur – sa vertu – c'est d'accepter lucidement cette échéance, en tâchant de la justifier par l'œuvre accomplie. Comme le dit Yamamoto : « celui qui meurt en ayant échoué, sa mort est celle d'un fanatique ; une mort vaine ». Il faut donc combattre pour vaincre, pour réussir. Il est vrai aussi que Yamamoto ajoute que la mort dans l'échec, si elle est vaine, n'est pas pour autant déshonorante, pourvu que le combat ait été mené selon l'éthique guerrière. Et l'on devine comment de telles paroles ont pu résonner dans l'âme de ce chevalier des temps modernes (temps d'adversité et d'abjection) que fut Mishima... (Frédéric Aumage)
 ♦ La mort, c'est le rendez-vous avec soi : Entre le Monde et les Mots, il y a la Vie. Les Mots prétendent faire le Monde, mais ils ne sont que ses “amants trompeurs”, car le Monde est loin de leurs réalités. Alors comment pouvoir oser tempérer par les mots la pureté de l'âme d'un Mishima, que Paul Schrader dans son dernier film réussit à nous communiquer ? Comment décrire en mots un procès qui leur est adressé, mais aussi un procès qui accuse une Nation et un Peuple de se castrer de sa Culture au nom du dollar et du pouvoir des politiciens ? Pourquoi tricher ? Le Monde est spectacle, autant entrer en scène et faire tomber le masque de notre très confortable rôle de spectateur afin de libérer les larmes de notre colère. Schrader n'est pas Mishima et Mishima est à lui seul une œuvre d'art, un Pavillon d'or ; Schrader ne l'est peut-être pas encore, mais au-delà de ses lourdeurs cinématographiques, il a voulu faire de son film une œuvre d'Art de cette œuvre d'Art vivante : Mishima. Rien n'est vrai, donc tout est permis, Mishima l'aura compris au point de mettre en scène à la fois sa vie mais aussi sa mort. Qu'est-ce au fond la justification de notre existence sinon celle de la confession de nos masques dans les tortures des rôles où nous nous débattons comme un taureau face à un matador ? Être spectateur ou acteur de cette colère que l'on sait si bien refouler, au point d'en crever écorché vif, et même si l'on suit ce rêve de révolution déchue, on se demande : où est le bonheur, entre recevoir ou donner des coups ? Se taire ou crier, oser dire merde et être exclu, avoir la volonté de dénoncer l'ennemi qui est dans l'ami ? Déchirement du blanc et du noir, de l'ombre et de la lumière. Isolé dans sa colère, moqué par ses compatriotes, Mishima n'a plus rien, plus personne en qui croire. Allez donc, ne me persuadez pas que la mort, c'est comme de dormir ! La mort, c'est le rendez-vous avec soi. La seule chose en quoi l'on puisse croire. Ce film, dans ses clins d'œil théâtraux, respecte la symbolique et la poésie du grand nationaliste Mishima, même si Schrader et ses acteurs, quelque peu incantatoires, nous plongent dans une atmosphère qu'on peut aimer ou rejeter. Il y a des œuvres que l'on regarde et d'autres que l'on ressent... (Hugues Bouchu)
♦ La mort, c'est le rendez-vous avec soi : Entre le Monde et les Mots, il y a la Vie. Les Mots prétendent faire le Monde, mais ils ne sont que ses “amants trompeurs”, car le Monde est loin de leurs réalités. Alors comment pouvoir oser tempérer par les mots la pureté de l'âme d'un Mishima, que Paul Schrader dans son dernier film réussit à nous communiquer ? Comment décrire en mots un procès qui leur est adressé, mais aussi un procès qui accuse une Nation et un Peuple de se castrer de sa Culture au nom du dollar et du pouvoir des politiciens ? Pourquoi tricher ? Le Monde est spectacle, autant entrer en scène et faire tomber le masque de notre très confortable rôle de spectateur afin de libérer les larmes de notre colère. Schrader n'est pas Mishima et Mishima est à lui seul une œuvre d'art, un Pavillon d'or ; Schrader ne l'est peut-être pas encore, mais au-delà de ses lourdeurs cinématographiques, il a voulu faire de son film une œuvre d'Art de cette œuvre d'Art vivante : Mishima. Rien n'est vrai, donc tout est permis, Mishima l'aura compris au point de mettre en scène à la fois sa vie mais aussi sa mort. Qu'est-ce au fond la justification de notre existence sinon celle de la confession de nos masques dans les tortures des rôles où nous nous débattons comme un taureau face à un matador ? Être spectateur ou acteur de cette colère que l'on sait si bien refouler, au point d'en crever écorché vif, et même si l'on suit ce rêve de révolution déchue, on se demande : où est le bonheur, entre recevoir ou donner des coups ? Se taire ou crier, oser dire merde et être exclu, avoir la volonté de dénoncer l'ennemi qui est dans l'ami ? Déchirement du blanc et du noir, de l'ombre et de la lumière. Isolé dans sa colère, moqué par ses compatriotes, Mishima n'a plus rien, plus personne en qui croire. Allez donc, ne me persuadez pas que la mort, c'est comme de dormir ! La mort, c'est le rendez-vous avec soi. La seule chose en quoi l'on puisse croire. Ce film, dans ses clins d'œil théâtraux, respecte la symbolique et la poésie du grand nationaliste Mishima, même si Schrader et ses acteurs, quelque peu incantatoires, nous plongent dans une atmosphère qu'on peut aimer ou rejeter. Il y a des œuvres que l'on regarde et d'autres que l'on ressent... (Hugues Bouchu)
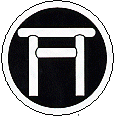
◘ Pourquoi, le 25 novembre 1970, le grand écrivain japonais Yukio Mishima a fait seppuku
Tadao Takemoto nous explique ici les raisons de la rébellion et du suicide de Mishima. En toute objectivité. Nous avons rajouté en fichier pdf joint les précieux documents photographiques communiqués par ses soins à son article : ils nous montrent Mishima au milieu de sa petite armée privée, la Taté-no-kai.
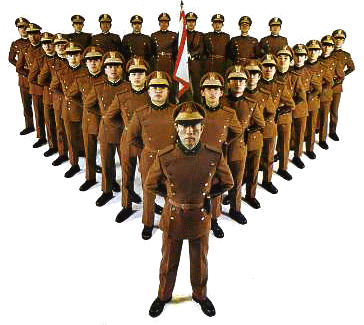 Il y a 35 ans, le 25 novembre 1970 l'écrivain japonais Y. Mishima faisait seppuku, conformément à l'éthique du Bushido, pour réaffirmer sa fidélité au culte de l'empereur, protester contre l'américanisation du Japon et réclamer une nouvelle Constitution qui rétablisse la totale souveraineté du pays. Dans la Constitution imposée par les Américains en 1946, l'un des articles les plus exécrés par l'écrivain était le fameux article 9, qui stipule que le Japon « ne possède pas de forces armées de terre, mer et air, et qu'il renonce à tout recours à la guerre ». Le mot “armée” lui-même était banni et avait été remplacé par “agence de défense”.
Il y a 35 ans, le 25 novembre 1970 l'écrivain japonais Y. Mishima faisait seppuku, conformément à l'éthique du Bushido, pour réaffirmer sa fidélité au culte de l'empereur, protester contre l'américanisation du Japon et réclamer une nouvelle Constitution qui rétablisse la totale souveraineté du pays. Dans la Constitution imposée par les Américains en 1946, l'un des articles les plus exécrés par l'écrivain était le fameux article 9, qui stipule que le Japon « ne possède pas de forces armées de terre, mer et air, et qu'il renonce à tout recours à la guerre ». Le mot “armée” lui-même était banni et avait été remplacé par “agence de défense”.
Le projet de Mishima, au départ, était de tenter un coup d'État comme celui des officiers de la Kodo-ha (groupe de la Voie impériale) en 1936, épisode qui lui avait inspiré sa célèbre nouvelle Patriotisme. C'est en vue de cet objectif qu'il crée en 1967 la Taté-no-kai, “Société du bouclier”, en référence à un poème du VIIIe siècle :
Aujourd'hui, je pars
Sans souci de ma vie,
Bouclier de l'Empereur.
Mishima recrute ses premiers membres au sein de l'Université, mais son “armée privée” ne dépassera jamais 200 à 250 hommes. Il dira lui-même de celle-ci : « C'est l'armée la plus petite et la plus spirituelle du monde ». Il en dessinera l'uniforme et le drapeau, qui représente 2 anciens casques japonais, rouges sur fond blanc.
Pour former sa troupe et chercher un appui au sein de l'armée, Mishima va se lier avec le général Tomokatsu Yamamoto, spécialiste du renseignement. C'est ce même général qui confiera, de mars 1968 à novembre 1970, l'entraînement de la Taté-no-kai au lieutenant Hisaro Hosonami, spécialiste de la guérilla, et qui livrera par la suite un passionnant témoignage sur les activités militaires et sur la personnalité de Mishima.
Que dit Hosonami ? Que son rôle était d'entraîner les membres de la Taté-no-kai, mais aussi de les surveiller, car l'armée s'inquiétait des projets de l'écrivain. Cette situation lui posait un dilemme : comment préparer militairement un groupe d'hommes que l'on soupçonne de préparer une action contre l'État ? Hosonami était un légaliste, Mishima un rebelle.
En 1970, en 4 périodes, la troupe du commandant Mishima suit un entraînement appelé “exercice de rafraîchissement”, qui consiste à mesurer les capacités de la Taté-no-kai en tant qu'organisation urbaine, son aptitude à la défense du pays et au combat de guérilla. Le stage s'effectue à Takigahara, dans la montagne du mont Fuji, sous le commandement d'Hosonami et de Mishima. Hosonami précise que la demande pour organiser le stage de guérilla a été acceptée par l'armée pour remercier Mishima d'avoir envoyé régulièrement, depuis 1968, des étudiants suivre des cours de formation militaire.
En octobre 1970, Mishima participe à un exercice dont il a lui-même fixé le cadre : s'emparer d'objectifs dans la capitale (la Bourse, les ponts, des installations électriques, des studios de radio et de télévision...). Les activités d'espionnage et de recherche d'informations sont dirigées par Mishima lui-même.
À la fin des 4 périodes, Hosonami est convaincu que la Taté-no-kai n'est pas en mesure d'organiser un coup d'État. De son coté, Mishima fait paraître le 25 septembre 1970, dans le journal de la base, un article intitulé « Le site du cantonnement de Takigahara est ma deuxième maison », où il remercie ceux qui lui ont donné l'hospitalité :
« Le temps passe vite, ça fait déjà 4 ans que je me suis confié à ce lieu de cantonnement de Takigahara. Je suis entré tout seul ici, avec cette troupe en formation, sous mon véritable nom : Hiraoka. On a pris soin de moi au printemps suivant, pendant un mois, encore un mois l'année suivante, puis l'été 1969 et en automne. Aussi ai-je accumulé les entraînements commandos de courte durée, devenant ainsi une sorte de vétéran. J'ai connu l'hiver sévère de Takigahara, son printemps précoce, son printemps ensoleillé avec les cerisiers du Fuji en pleine floraison, l'été de l'œillet et enfin l'automne. En discutant avec les novices, c'est moi maintenant qui leur raconte ce qui s'est passé avant à Takigahara.
De toute ma vie, sauf ma propre maison, il n'y a aucun autre lieu où j'ai séjourné aussi longtemps. Je dis aux autres que l'école du Fuji est mon école maternelle et Takigahara ma seconde maison. Ici, j'ai toujours été accueilli chaleureusement, traité avec humanité et en toute confiance, sans aucune considération d'intérêt... La rigueur et la beauté des hommes du Japon se trouvent seulement ici. Nous avons parlé sans ambages du destin du Japon et nous nous sommes souciés de son avenir, comme si nous avions de l'appréhension pour la destinée de nos familles. Ici, pour moi, c'était un lieu d'exercice et de réflexion. C'est ici que j'ai appris le respect et la sévérité de l'altruisme, et que l'unité de l'idée et de l'acte était la voie authentique. Ici que j'ai appris la transpiration, le labeur, la ténacité, la patience de l'homme, la quête de soi jusqu'à l'extrême, la discipline, enfin la joie que peut seul connaître celui qui a conquis et maîtrisé tout cela. »
Et Mishima termine son article par une phrase mystérieuse :
« N'empêche qu'en même temps, j'éprouve une certaine pitié à l'égard du cœur quasi frénétique que j'ai fini par porter, n'ayant d'autre souci que le destin de l'armée, pensant à son avenir et au moyen de le construire. Enfin, à l'égard de moi-même qui suis devenu un homme “qui en sait trop” ».
Que savait Mishima pour en savoir trop ? Une cruelle déception : l'armée japonaise se voulait la gardienne de la Constitution qui la désavouait, elle n'était pas mûre pour un coup d'État. À l'origine, le soulèvement devait comprendre des membres de l'armée, mais le général Yamamoto bloquera le mouvement. C'est un mois avant la mort de Mishima qu'eut lieu leur dernière rencontre. L'écrivain rendit visite au général et, sans rien dire, le regarda en face. Enfin, il l'interrogea. Yamamoto répondit : « Si vous voulez le faire, faites-le, mais après m'avoir tué ». Un an après, dans ses mémoires, le père de Mishima écrira : « Mon fils me paraissait accablé de déception, ayant été trahi par un certain général qui est au sommet de sa réputation et qui vit toujours... » Le père ajoute : « Comment se fait-il que mon fils ne le sut pas plus tôt, lui qui connaissait si bien l'histoire du coup d'État avorté du 26 février 1936, où l'on voit une même volte face, avec la trahison d'un général uniquement préoccupé de sa situation... »
Mishima avait pourtant tout préparé et même rédigé une nouvelle Constitution, récemment retrouvée. Alors, il résolut de montrer l'exemple, réunit 5 de ses plus proches compagnons et leur dit : « Le soulèvement aura lieu le 25 novembre et je dois mourir ». L'explication au geste de Mishima est peut-être dans la réponse qu'il fit à cette question posée par le lieutenant Hisaro Hosonami : « Dans votre Hagakuré et vos autres livres, les personnages meurent souvent. Pourtant le vrai Hagakuré n'enseigne-t-il pas que, même mutilé, on doit vivre et combattre avec les dents ? » Mishima répondit alors calmement : « Mais une mort peut agir sur l'avenir comme une irradiation ».
► Tadao Takemoto, éléments n°119, 2005. [carnet photos]
 ♦ L'auteur : Écrivain, poète, critique d'art, professeur honoraire à l'université de Tsukuba. Il descend d'une très ancienne lignée de samouraïs. Titulaire d'un doctorat à l'université de Tokyo, il a fait ses débuts littéraires en 1960, puis il est venu à Paris à partir de 1963 poursuivre des études à la Sorbonne sous la direction de Jean Grenier. Tout en collaborant à des revues françaises, il est devenu conseiller technique culturel à l'ambassade du Japon et fut professeur invité au Collège de France, où il donna une série de leçons sur André Malraux dont il fut l'ami et le traducteur en japonais, ultérieurement publiées chez Julliard (André Malraux et la cascade de Nashi, 1989). Il est l'auteur de plusieurs livres en japonais, not. Requiem de Mishima à Paris et Le Bushido (2004). De Mishima, il a traduit l'« Essai sur Georges Bataille » (Nouvelle Revue Française n°256), et (av. M. Cazenave) « Sur l′Erotisme » et « Sur Madame Edwarda » (Exil n° 3). Signalons également sa traduction (av. O. Germain-Thomas) et commentaire du sublime Sé-oto, Le chant du gué par l'impératrice Michiko, une anthologie de 53 waka (poèmes en style archaïque) paru chez Signatura en 2006 ainsi que sa préface à l'ouvrage d'Albert Palma : Geïdô : la voie des arts (Albin Michel, 2001). Parmi ses contributions, outre celles aux Cahiers de l'Herne consacrés à Malraux et à Charles de Gaulle, notons celle au colloque de Tsukuba, « Le dialogue de l’Orient et de l’Occident », rendant l'intraduisible imaginal par rencontre de 2 fleurs, paru dans Sciences et symboles : voies de la Connaissance (Albin Michel, 2001). Il a aussi co-écrit un ouvrage historique sur la controverse entre Chinois et Japonais quant au sac de Nankin (1937) : The Alleged “Nanking Massacre” : Japan's rebuttal to China's forged claims (bilingue anglais-japonais, Meiseisha, Tokyo, 2000), cf. cette lettre non publiée au journal Le Monde.
♦ L'auteur : Écrivain, poète, critique d'art, professeur honoraire à l'université de Tsukuba. Il descend d'une très ancienne lignée de samouraïs. Titulaire d'un doctorat à l'université de Tokyo, il a fait ses débuts littéraires en 1960, puis il est venu à Paris à partir de 1963 poursuivre des études à la Sorbonne sous la direction de Jean Grenier. Tout en collaborant à des revues françaises, il est devenu conseiller technique culturel à l'ambassade du Japon et fut professeur invité au Collège de France, où il donna une série de leçons sur André Malraux dont il fut l'ami et le traducteur en japonais, ultérieurement publiées chez Julliard (André Malraux et la cascade de Nashi, 1989). Il est l'auteur de plusieurs livres en japonais, not. Requiem de Mishima à Paris et Le Bushido (2004). De Mishima, il a traduit l'« Essai sur Georges Bataille » (Nouvelle Revue Française n°256), et (av. M. Cazenave) « Sur l′Erotisme » et « Sur Madame Edwarda » (Exil n° 3). Signalons également sa traduction (av. O. Germain-Thomas) et commentaire du sublime Sé-oto, Le chant du gué par l'impératrice Michiko, une anthologie de 53 waka (poèmes en style archaïque) paru chez Signatura en 2006 ainsi que sa préface à l'ouvrage d'Albert Palma : Geïdô : la voie des arts (Albin Michel, 2001). Parmi ses contributions, outre celles aux Cahiers de l'Herne consacrés à Malraux et à Charles de Gaulle, notons celle au colloque de Tsukuba, « Le dialogue de l’Orient et de l’Occident », rendant l'intraduisible imaginal par rencontre de 2 fleurs, paru dans Sciences et symboles : voies de la Connaissance (Albin Michel, 2001). Il a aussi co-écrit un ouvrage historique sur la controverse entre Chinois et Japonais quant au sac de Nankin (1937) : The Alleged “Nanking Massacre” : Japan's rebuttal to China's forged claims (bilingue anglais-japonais, Meiseisha, Tokyo, 2000), cf. cette lettre non publiée au journal Le Monde.

◘ Mishima : réponse au nihilisme
Entretien avec Tadao Takemoto
35 ans après le suicide de Mishima, l'un de ses confrères japonais évoque pour nous la signification de cette mort. Mishima ne cherchait pas une revanche sur la défaite. Par sa mort rituelle, il renouait avec le fil perdu de la tradition.
Il y a 35 ans, le 25 novembre 1970, Mishima se donnait publiquement la mort selon le rite du seppuku (éventrement au poignard). Âgé seulement de 45 ans, il était le plus célèbre écrivain japonais vivant. Il venait de mettre le point final à l'ultime volume de sa tétralogie, La Mer de la fertilité. Vers midi, ayant revêtu l'uniforme de la petite troupe qu'il avait constituée dans l'intention de protéger l'Empereur, il pénétra au quartier général des Forces d'autodéfense avec 3 de ses disciples. Après avoir harangué des soldats plus ou moins hostiles, il se retira dans le bureau du général Mashita qu'il avait pris en otage. S'étant dépouillé de sa tunique, il s'agenouilla comme le voulait le rite et se dénuda sous la ceinture.
De la main droite, il s'empara d'un poignard, dirigeant la pointe sur son ventre. Ayant expulsé brusquement l'air de ses poumons avec un cri, il enfonça la dague. Courbé par la douleur, il s'ouvrit l'abdomen de gauche à droite, maintenant à 2 mains la lame que rejetaient ses entrailles. Derrière lui, son assistant, Morita, très ému, dut s'y reprendre à 3 fois pour le décapiter avec son sabre et abréger ses souffrances. Puis Morita prit le poignard afin de s'éventrer lui aussi. Un troisième assistant lui trancha aussitôt la tête. Les 2 survivants délivrèrent alors le général, faisant aux 2 morts l'hommage de leurs prières. À l'extérieur, régnait l'affolement tandis que vombrissaient des hélicoptères de la police et qu'accouraient les journalistes.
La nouvelle de cette mort provoqua une immense stupeur, mais également un questionnement profond qui s'étendit par radiation, tout particulièrement à la France où Mishima était connu et apprécié. Une si extraordinaire conclusion à la vie d'un homme en pleine force, qui s'était jusqu'alors consacré à la quête esthétique de la beauté, ne pouvait laisser indifférent. Beaucoup de commentateurs cédèrent à la tentation de trouver à ce suicide des clés dans l'enfance ou l'adolescence de l'écrivain. Et il est vrai que sa vie offrait une matière riche aux psychanalystes amateurs. Pour sa part, Mishima n'avait que mépris pour de tels exercices. Dans son essai La Mort volontaire au Japon (Gallimard, 1984), Maurice Pinguet ne s'est pas trompé sur la réponse au nihilisme de ce suicide, méditant aussi sur « le défi que la mort ne cesse de proposer à la volonté », et sur « la souveraineté sans mesure de l'homme qui se donne la mort ».
Longtemps, la mort de Mishima a ébranlé la conscience des Occidentaux qui ont de l'attrait pour l'ancienne tradition japonaise. Ce sentiment révèle sans doute chez nombre d'Européens une nostalgie muette à l'égard de leur propre tradition. L'élan de sympathie pour Mishima a rejoint celui dont a bénéficié aussi Ernst Jünger, comme si l'on admirait par procuration chez ce Japonais et chez cet Allemand ce que l'on n'ose penser pour soi et chez soi.
Afin de répondre aux questions que pose encore aujourd'hui le suicide de Mishima, nous avons interrogé l'écrivain japonais Tadao Takemoto, fidèle défenseur de sa mémoire.
♦ La Nouvelle Revue d'Histoire : Sans avoir eu de relations directes avec Mishima, vous n'étiez pas des inconnus l'un pour l'autre.
Tadao Takemoto : J'admirais son œuvre. Il avait lu plusieurs de mes écrits et nous avions des amis en commun. Nous devions nous rencontrer, ce qui ne s'est pas fait parce que je vivais à cette époque à Paris où je travaillais comme conseiller technique culturel de l'ambassade du Japon. Deux semaines après la mort de Mishima, j'ai eu l'émotion de recevoir son dernier livre dédicacé la veille de son seppuku. J'ai pris cet envoi comme un message de l'au-delà. Ce livre est mon bien le plus précieux. Dans sa dédicace, Mishima me reconnaissait comme l'un des siens.
♦ À l'époque, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans la presse française et à la télévision.
L'ambassade ne souhaitait pas intervenir directement. Elle m'en a confié le soin. J'ai publié plusieurs articles dans la presse française, La NRF, Le Figaro littéraire, etc. J'ai également participé à une table ronde à la télévision, notamment avec Étiemble et Robert Guillain, correspondant du Monde à Tokyo.
♦ Lors de cette table ronde, quels étaient les sentiments de vos interlocuteurs français ?
Au début, ils ont exprimé leur désarroi devant ce qu'ils appelaient « la violence du seppuku » qui choquait leur sensibilité. R. Guillain disait craindre le retour du « militarisme nippon ».
♦ Par la suite, les milieux littéraires français et européens ont évolué au point d'éprouver une sorte de fascination pour la mort de Mishima.
C'est exact. Dans un numéro spécial du Figaro littéraire, Michel Droit a qualifié Mishima de « héros national ». Marguerite Yourcenar a publié un essai devenu célèbre, Mishima ou la vision du vide. Et à l'occasion du dixième anniversaire de la mort, Le Magazine littéraire [n°169, fév. 1981] a réalisé un dossier avec une grande honnêteté.
♦ On entend dire que la mort de Mishima aurait été moins bien comprise au Japon qu'en Europe. Qu'en fut-il réellement ?
En dehors des milieux politiques, l'opinion a été bouleversée. La plupart des confrères de Mishima ont salué la qualité exceptionnelle de l'écrivain et la grandeur de son geste.
♦ Vous avez eu l'occasion de vous entretenir de cette mort avec André Malraux. Que vous a-t-il dit ?
Je peux vous citer ses paroles [en mai 1974] puisqu'elles ont été publiées [une partie dans la revue Tel Quel en 1982 puis en livret : André Malraux : entretiens avec Tadao Takemoto, Au signe de la licorne, 1998] : « Pour Mishima, disait-il, la mort en tant qu'acte a eu une réalité très forte. Par la grande tradition japonaise et par les rites ». Il voulait dire que ce n'était pas seulement la mort de Mishima qui était importante, mais sa façon de mourir. Je le cite : « C'est quand même extraordinaire ! En Occident, on confond cette mort romaine avec un suicide romantique, mais nos romantiques ne se sont pas du tout suicidés de la même façon, il s'agit d'actes tout différents ». Malraux manifestait de l'admiration pour la mort volontaire que l'on se donne avec une arme, poignard ou revolver. Je le cite encore : « je me sens plus à l'aise avec le suicide de Mishima, qui n'est pas un suicide, qu'avec le tuyau à gaz. je ne défends rien. Mais enfin, je me sens avec le revolver dans un domaine familier. Peut-être parce qu'il marque un caractère de volonté dans la mort. Le revolver aujourd'hui, c'est l'ancien poignard romain qui n'est pas tellement loin de votre sabre ». Au cours de nos conversations, André Malraux a établi un parallèle entre les samouraï et la chevalerie européenne d'autrefois. Il y voyait comme un lien spirituel secret entre le Japon et l'Europe. C'est une idée qui m'a paru forte et vraie. Je crois à un dialogue entre l'esprit français de la chevalerie et l'esprit du Bushido.
♦ Selon vous, Mishima avait-il décidé son suicide depuis longtemps ?
Un an après la mort de Mishima, j'ai organisé une soirée commémorative. À cette occasion, nous avons projeté le film de Mishima Patriotisme (Yūkoku). Ilétait tiré d'une nouvelle de l'écrivain. Celui-ci y décrivait le drame de conscience d'un jeune officier des années 1930 qui, après le coup d'État auquel ses camarades avaient participé, finit par se suicider faute de pouvoir concilier son serment de loyauté à l'armée et son devoir de fidélité envers eux. Mishima interprétait lui-même le rôle du lieutenant jusqu'à la scène du seppuku rituel. C'était prémonitoire.
♦ La mort de Mishima fut-elle un acte politique ou un acte spirituel, on pourrait même dire sacrificiel ?
Il ne pensait pas au concept de sacrifice comme la postérité a été tentée de le dire. L'important pour lui était de mourir.
♦ Qu'entendez-vous par « l'important était de mourir » ?
Mishima avait compris que ses projets politiques ne pouvaient aboutir. Dès lors, il lui fallait mourir. Ce ne fut pas un acte de désespoir mais d'affirmation. Par cet acte spectaculaire, il voulait faire revivre l'âme ancienne du Japon qui avait été tuée par l'occupation américaine, après la défaite japonaise de 1945.
♦ S'agissait-il d'une revanche sur cette défaite ?
Pas une revanche, mais une réappropriation des valeurs spirituelles du Japon. Mishima pensait que si le Japon avait perdu la guerre, c'était pour avoir combattu avec les armes de l'Occident au lieu de combattre avec ses propres armes. Par sa mort rituelle, l'écrivain renouait avec le fil perdu de la tradition.
► Propos recueillis par D. Venner, La Nouvelle Revue d'Histoire n°21, 2005.
◘ La mort de Mishima
 Il sort le sabre du fourreau, très lentement et l'acier bleu scintille d'un éclat lourd, puis il entoure cette lame d'un bandeau blanc qui laisse libre à la pointe cinq pouces d'acier nu.
Il sort le sabre du fourreau, très lentement et l'acier bleu scintille d'un éclat lourd, puis il entoure cette lame d'un bandeau blanc qui laisse libre à la pointe cinq pouces d'acier nu.
Il repose le sabre ainsi enveloppé devant lui.
Il se soulève sur les genoux, s'accroupit les jambes croisées et défait les agrafes de son col d'uniforme. Lentement, un à un, il fait sauter les minces boutons de cuivre. Sa brune poitrine apparaît. D'un mouvement d'épaules, il fait tomber le doman derrière lui, sur le sol. Il déboucle son ceinturon et ouvre le haut de son pantalon. On voit l'éclat pur et blanc du pagne qui lui serre les reins. Il tire à deux main pour dégager davantage le ventre, puis il saisit la lame du sabre. De la main gauche, il se masse le ventre, les yeux baissés.
Le fer doit s'enfoncer quelques centimètres au-dessus du nombril, un peu sur la gauche, en pleines entrailles.
Pour s'assurer que le fil de l'arme est bien aiguisé, il replie la jambe gauche de son pantalon, dégageant ainsi une partie de la cuisse et coupe légèrement la peau. Le sang remplit aussitôt la blessure et des petits ruisseaux rouges s'écoulent, qui brillent dans la lumière.
Ses yeux ont pris l'intensité immobile du regard d'un oiseau de proie, mais il ne voit plus. Tournant vers lui- lui-même le sabre, il se soulève légèrement pour incliner le haut du corps vers la pointe de l'arme. La contraction des muscles de ses épaules trahit l'effort qui mobilise toutes ses forces. Il vise à gauche, au plus profond du ventre.
Une crispation brusque des traits de son visage.
En dépit de la force qu'il a lui-même déployée pour frapper, il a l'impression que quelqu'un un d'autre vient de lui porter un atroce coup de barre de fer au côté. Une seconde ou deux, la tête lui tourne. Il ne sait plus. Les cinq pouces d'acier ont disparu complètement dans la chair et le bandeau blanc, qu'il serre de sa main crispée, appuie directement contre son ventre.
Il reprend conscience. La lame a certainement percé la paroi abdominale, se dit-il. Il respire avec difficulté. Son cœur bat à grands coups et, dans quelque profond lointain dont il peut à peine croire que c'est une part de lui-même, surgit l'effrayante, l'abominable douleur. Le sol s'entrouvre pour laisser échapper la lave des roches en fusion. La douleur se rapproche à une vitesse terrifiante. Il se mord la lèvre pour éviter un involontaire gémissement.
Sa volonté et son courage, qui lui semblaient si fermes avant l'entaille, se réduisent à l'épaisseur d'un fil d'acier fin. Il éprouve comme un affreux malaise le soupçon dérisoire qui l'assaille. Son poing crispé est tout humide. Il baisse les yeux sans bouger la tête et voit que sa main et l'étoffe qui entoure le sabre sont trempés de sang. Son pagne est profondément teinté de rouge clair. Chose incroyable qu'au milieu d'une si terrible souffrance, ce qui peut être regardé puisse encore être regardé et que ce qui existe puisse exister encore.
La souffrance flambe aussi fort que le soleil de l'été. Elle augmente sans cesse. Elle monte.
La main droite sur le sabre, il commence à s'entailler le ventre par le travers. La sueur brille sur son front. Il ferme les yeux, puis les rouvre, comme pour se rendre compte. Son regard a perdu son éclat, il semble innocent et vide comme celui d'un animal. La lame rencontre l'obstacle des intestins qui s'emmêlent et dont l'élasticité repousse. Il comprend qu'il lui faut les deux mains pour maintenir la lame enfoncée. Il appuie pour couper par le travers. Il mobilise toute sa force et l'entaille s'agrandit de trois ou quatre pouces.
Lentement, des profondeurs internes, la couleur irradie le ventre tout entier. Des cloches en folie sonnent. Mille cloches ensemble ! À chaque souffle, à chaque battement du pouls, ébranlant tout son être. Il ne peut plus s'empêcher de gémir. Mais la lame est arrivée à l'aplomb du nombril et lorsqu'il le constate, il reprend courage.
Le volume du sang répandu a régulièrement augmenté et commence à jaillir de la blessure, au même rythme que celui du pouls. Le sol est rouge. Il est complètement éventré.
Morita lève alors son sabre sur son épaule droite et, dans un froissement d'air vif, il fait voler la tête de Yukio Mishima.
► Jean Mabire et Yves Bréhéret, Les samouraï, Balland, 1971.
◘ Une ordalie pour Mishima
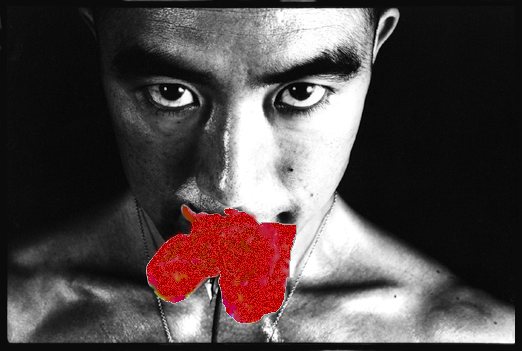 Le drame de la vie de Yukio Mishima, comme sa gloire posthume, tient bien, au niveau du public que l’on qualifie habituellement de “grand”, en ce que le personnage, et plus précisément sa fin, marquée par le sang, qui souleva l’indignation, l’horreur ou l’admiration, évince l’œuvre, du moins en partie ; l’écrivain, par sa mort — et sa vie —, cache l’écriture. Contrairement à Jack London, par ex., dont la vie d’aventure, au contraire, exalte les romans. Le drame de l’écrivain japonais est d’avoir subi, soutenu et provoqué tous les clichés de l’artiste maudit. “Nihiliste”, comme égaré dans le Japon moderne de “stricte observance économique” et s’abîmant dans le néant de l’esprit dont il fut le grand contempteur — ces clichés, dans son cas, étaient en partie vrais, ce qui ne les empêche nullement d’être des clichés, c’est-à-dire des “jugements” simplistes, pour ne pas dire primaires. Cette “disparition” de l’œuvre derrière l’homme, met par conséquent celui-ci très en relief. Elle est une nouvelle fois confirmée, bien qu’en vue d’une œuvre non-gratuite, au thème fortement signifiant, — par l’album de photos réalisées par le photographe qui bouleversa l’art photographique, et plus particulièrement celui du Nu : E. Hosoe.
Le drame de la vie de Yukio Mishima, comme sa gloire posthume, tient bien, au niveau du public que l’on qualifie habituellement de “grand”, en ce que le personnage, et plus précisément sa fin, marquée par le sang, qui souleva l’indignation, l’horreur ou l’admiration, évince l’œuvre, du moins en partie ; l’écrivain, par sa mort — et sa vie —, cache l’écriture. Contrairement à Jack London, par ex., dont la vie d’aventure, au contraire, exalte les romans. Le drame de l’écrivain japonais est d’avoir subi, soutenu et provoqué tous les clichés de l’artiste maudit. “Nihiliste”, comme égaré dans le Japon moderne de “stricte observance économique” et s’abîmant dans le néant de l’esprit dont il fut le grand contempteur — ces clichés, dans son cas, étaient en partie vrais, ce qui ne les empêche nullement d’être des clichés, c’est-à-dire des “jugements” simplistes, pour ne pas dire primaires. Cette “disparition” de l’œuvre derrière l’homme, met par conséquent celui-ci très en relief. Elle est une nouvelle fois confirmée, bien qu’en vue d’une œuvre non-gratuite, au thème fortement signifiant, — par l’album de photos réalisées par le photographe qui bouleversa l’art photographique, et plus particulièrement celui du Nu : E. Hosoe.
Superbe livre, à maints égards, cette Ordalie par les Roses où collaborent et se répondent, le “regard” d’Hosoe et les “attitudes” de Mishima, sans oublier divers arrière-plans –, composés de peintures de la Renaissance, comme la Naissance de Vénus de Botticelli et de mobilier espagnol.
En fait, la première impression sera une impression de “malaise”, de “gêne”, quant au montage du livre et des photos : omniprésence de Mishima et apparent manque de liaison entre ces dernières. Avant tout approfondissement, l’œuvre apparaît comme un amas de clichés, au sens photographique du terme, sans aucun rapport “organique”. Il semble qu’un créateur fou les ait disposés là, sans schéma directeur préalable, pratiquant ainsi l’art pour art.
Cependant, une lecture des quelques textes qui y figurent, celle des titres des chapitres et l’étude des photos elles-mêmes, nous conduisent à une tout autre conclusion. Cette œuvre se présente, de l’aveu même d’Hosoe, comme « un témoignage sur la vie et la mort » et, aurait-il pu ajouter, avec une double fascination, de laquelle devait naître cette forte création. Née essentiellement de la hantise que ressentait Mishima pour le supplice, le sang, la mort et la rose, jointe à l’admiration qu’il avait pour Hosoe, et de la fascination que celui-ci avait pour Mishima lui-même. Elle se présente comme une célébration d’Éros et de la Mort, un véritable défi, lancé à ce que l’écrivain nommait “le déclin de la chair”, l’une des nombreuses lois à laquelle il refusait catégoriquement, en tant qu’homme, de se soumettre et donc de s’y noyer.
La Préface, — nous l’avons indiqué en titre —, est de Y. Mishima. Ce n’est pas là la partie la moins intéressante de ce recueil. L’auteur de La Mer de la fertilité s’y efforce de nous restituer ce que fut pour lui l’univers, né de l’élaboration du commun travail de lui-même et d’Hosoe, dans lequel il s’est senti absorbé. « Le monde où je fus entraîné sous l’enchantement magique de son objectif, était hors de toutes normes, infléchi, ironique, bizarre, sauvage, hétérogène (...) où s’écoulait pourtant un lyrisme sous-jacent qui murmurait doucement à travers ces canaux invisibles ». Mais ce fut essentiellement « en un sens, l’inverse du monde où nous vivons, où notre culte des apparences sociales et notre souci de moralité et d’hygiène publiques engendrent d’infects et répugnants égouts ».
D’autre part, Mishima en profite pour nous livrer quelques-unes de ses “réflexions philosophiques”, subjectives, mais cependant non dénuées d’intérêt, sur l’art photographique. « Tout le travail du photographe revient à filtrer ce dernier par l’une de ces deux méthodes. Il convient de choisir entre l’enregistrement et le témoignage », avance-t-il. À partir de ces 2 choix, 2 catégories de chefs-d’œuvre photographiques peuvent exister : celle de la photographie de presse qui appartient à l’enregistrement. « Les images filtrées par le photographe à partir de la réalité, (...), portent déjà un cachet d’authenticité que le photographe est impuissant à modifier (...) ; la signification même des objets, (...), devient le thème de l’ouvrage ». La photo d’enregistrement capte « l’authenticité absolue de l’objet photographié pour forme et la purification du sens pour thème ». Quant à la photographie de témoignage, « le sens des objets rapportés par la caméra perd certains éléments au cours du filtrage, tandis que d’autres éléments sont déformés (...), afin de servir d’éléments constitutifs de l’œuvre ». Le thème de l’ouvrage, lui, tient « uniquement à l’expression du jugement subjectif du photographe ». Dans cette optique, « l’art d’Hosoe est, au suprême degré, celui du “témoignage” (...) », conclut Mishima. Tout cela nous paraît assez bien vu ; mais ne pourrait-on pas avancer le fait que, en réalité, toute “démarche photographique” enregistre “pour” témoigner, et témoigne “par” l’enregistrement ? Si bien que, loin d’apparaître comme 2 modes d’application particuliers et distincts de l’art photographique, l’enregistrement et le témoignage s’inscriraient en fait dans un même processus du “faire” photographique.
Suit alors l’œuvre elle-même, constituée de superbes photographies en noir et blanc. Celle-ci se compose de 5 parties : le Prélude, 1ère partie, variations sur un même thème ; la 2e partie, a pour titre La Vie au Quotidien, exposant les « absurdités du citoyen moyen, estimable, honnête homme » où l’homme seul devient fou ; la 3e partie, La pendule qui rit et le Témoin passif, ou l’homme moyen, autrement dit l’homme-gris, l’homme insignifiant à force d’être « moyen », quitte sa « folie d’intimité » de la 2e partie, pour devenir « railleur et témoin » et « contrefaire la vie humaine toute entière ». Cependant, malgré le rire dédaigneux et la quiète observation d’autrui, le « petit homme » est promis au châtiment qui viendra en temps utile. Auparavant, il lui faut passer par la 4e partie, Profanations diverses, un vaste monde où, à l’instar des animaux promis à un futur abattage, lâchés dans un champ pour leurs dernières heures de vie et de liberté, l’homme se trouve plongé, y ressentant, « par-delà le temps et l’espace », la libération de toutes ses contraintes, inhibitions et entraves, « de toutes les responsabilités de la vie en société ». Cependant, tout cela n’est qu’une vaste illusion et parodie, où l’homme n’est libre que parce qu’il se croit libre. C’est essentiellement le domaine de la “Grande Illusion”. Cela se conclut à la 5e partie, Le Châtiment de la Rose ; c’est le temps du “Grand Règlement”, du jugement, de “l'Ordalie” précisément, où le symbole de la Rose, fleur de beauté, de perfection, d’amour, fleur mystique, mais aussi fleur de sang et de mort, “armée” de ses cruelles épines, « apparaît au premier plan (...) ». L’homme se doit alors d’affronter « la torture et une disparition sans cesse reculée ». Mais la mort viendra et le conduira, enfin, « vers un sombre soleil ».
À la fin de l’album se trouve une Note du photographe, Hosoe, qui nous fait part de sa rencontre avec Mishima, de ses intentions et de la longue élaboration photographique et artistique qui devait aboutir au livre ; suit une Histoire du livre, dont la première édition japonaise, Barakei (Ordalie par les Roses), ou Killed by Roses (Tué par les Roses), en anglais, fut publiée par Shueisha à Tokyo en 1963. En fait, la signification de l’œuvre prend toute sa dimension, si on sait qu’elle fut ardemment voulue par Mishima qui, se “servant” du photographe, mime un étrange rituel, celui de la vie et de la mort ; l’écrivain y est à la fois “la plaie” et “la flèche”, tel saint Sébastien, si cher à Mishima. Ordalie par les Roses est le prélude à la “mort volontaire” de Mishima, apparaissant, au même titre que sa tétralogie La Mer de la fertilité, comme un poème, mais cette fois imagé, un adieu au monde. Vaste “dialectique de la vie et de la mort”, cet album est, au demeurant, explicité, pour qui sait voir, à sa première et dernière page, par une figure spécifique : sous la forme d’une “serrure”. N’est-ce pas la “serrure” qui ouvre la vie — ou l’accès à cette vie — et qui “ferme” celle-ci, par la mort ? Mais est-ce bien là l’intention de l’auteur ?
Une dernière remarque s’impose, quant à l’emploi du terme “Ordalie” [A. Montandon préfère retraduire le titre par Torture par les roses]. Comme on le sait, il était employé au Moyen Âge occidental pour désigner le “Jugement de Dieu”, l’épreuve judiciaire à laquelle étaient soumises 2 personnes en litige. Il y avait donc un “aspect divin” dans ce type de jugement : Dieu y est partie prenante, départageant l’innocent et le coupable par un signe quelconque, en général par la mort de ce dernier. Or, il ne semble pas que, dans l’œuvre commune d’Hosoe et de Mishima, qui sont Japonais, avec les conséquences que cela entraîne sur le plan de la spiritualité, différente, en tout cas, de celle qui prévalait lors de l’emploi courant de ce mot, Dieu soit présent. Dans ces conditions, l’utilisation de ce terme d’“Ordalie”, provenant de la sphère chrétienne médiévale, choisi par Mishima, s’imposait-il ? Mais peut-être, il est vrai, la Divinité est-elle présente dans cette œuvre. Dans ce cas, il nous appartiendrait de découvrir à quel endroit et sous quelle forme Mishima l’a dissimulée à nos profanes regards.
♦ Yukio Mishima / Eikoh Hosoe : Ordalie par les Roses, préf. Y. Mishima, traduit de l’anglais par Tanguy Kenec’hdu, éd. Hologramme, 1986, 39 photos noir et blanc et ill. couleur, 104 p.
► Bernard Marillier, Kalki n°4, 1987.
 ♦ Du même auteur : Mishima, Pardès coll. Qui suis-je ?, 2007. Cette monographie entend sortir des ornières du culturellement correct. Il étudie, dans sa “double voie”, celui qui se voulait de “l'autre race” – la race solaire opposée à la race lunaire. Il retrace son parcours existentiel, littéraire et métapolitique ; de la naissance au sacrifice exemplaire. En 1970, témoignant qu'il fut, selon ses propres équations, un rebelle total à la vision moderne du monde, Y. Mishima se donnait la mort selon l'ancien rite samouraï du seppuku. Le geste souverain du plus grand écrivain de la littérature nippone d'après-guerre a beaucoup contribué à le faire connaître hors de son pays, tout en suscitant de multiples et contradictoires interprétations. Excellent connaisseur des littératures occidentales, notamment française, et auteur inclassable au sein de la littérature japonaise moderne, Mishima et son œuvre constituent le paradoxe d'être simultanément dans et hors du monde moderne, ils réussissent une critique sans concession de ses antivaleurs, du climat étouffant de « paix souriante aux panses pleines » avec son “bien-être” bourgeois. Mishima lui oppose, radicalement, par son œuvre et l'exemple de sa vie, les valeurs du Japon traditionnel : conception martiale et sacrificielle, conscience de la dimension tragique de la vie, fidélité au principe impérial et, surtout, défi du bunburyôdô, la “double voie” de l'art et de l'action, l'éthique et l'esthétique, dont la réalisation suprême ne peut aboutir que par la mort consciente et désirée. C'est la nouvelle union du Chrysanthème et du Sabre des anciens samuraï.
♦ Du même auteur : Mishima, Pardès coll. Qui suis-je ?, 2007. Cette monographie entend sortir des ornières du culturellement correct. Il étudie, dans sa “double voie”, celui qui se voulait de “l'autre race” – la race solaire opposée à la race lunaire. Il retrace son parcours existentiel, littéraire et métapolitique ; de la naissance au sacrifice exemplaire. En 1970, témoignant qu'il fut, selon ses propres équations, un rebelle total à la vision moderne du monde, Y. Mishima se donnait la mort selon l'ancien rite samouraï du seppuku. Le geste souverain du plus grand écrivain de la littérature nippone d'après-guerre a beaucoup contribué à le faire connaître hors de son pays, tout en suscitant de multiples et contradictoires interprétations. Excellent connaisseur des littératures occidentales, notamment française, et auteur inclassable au sein de la littérature japonaise moderne, Mishima et son œuvre constituent le paradoxe d'être simultanément dans et hors du monde moderne, ils réussissent une critique sans concession de ses antivaleurs, du climat étouffant de « paix souriante aux panses pleines » avec son “bien-être” bourgeois. Mishima lui oppose, radicalement, par son œuvre et l'exemple de sa vie, les valeurs du Japon traditionnel : conception martiale et sacrificielle, conscience de la dimension tragique de la vie, fidélité au principe impérial et, surtout, défi du bunburyôdô, la “double voie” de l'art et de l'action, l'éthique et l'esthétique, dont la réalisation suprême ne peut aboutir que par la mort consciente et désirée. C'est la nouvelle union du Chrysanthème et du Sabre des anciens samuraï.
◘ Mishima, la renaissance du samouraï
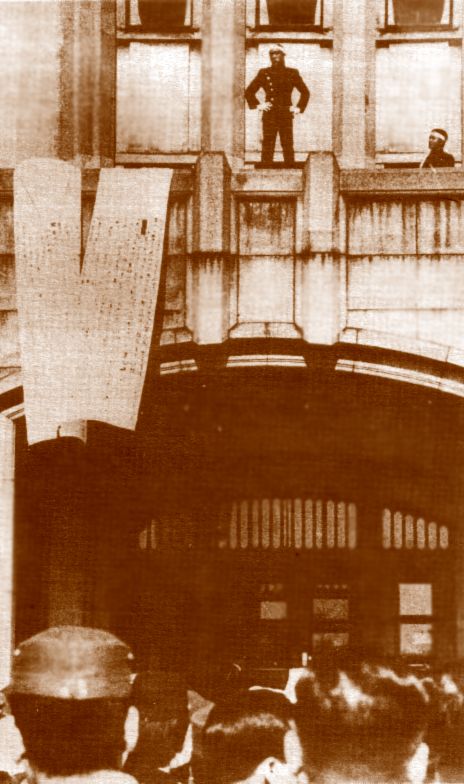 Dans le vaste bureau occupé naguère par le commandant de l'armée de l'Est, rien n'évoque “l'incident Mishima”, comme l'appelle pudiquement le militaire japonais qui conduit la visite. Des uniformes de l'époque Meiji sont exposés. Quelques estampes représentant les troupes à l'exercice tapissent les murs. Une épaisse moquette rouge et des boiseries sombres assourdissent la rumeur de la capitale. Au cœur de Tokyo, l'ancien quartier général d'Ichigaya a été transformé en mémorial des Forces d'autodéfense, l'armée nipponne. La vingtaine de visiteurs quotidiens vient surtout voir la salle où se tint, de 1946 à 1948, le tribunal militaire chargé de juger les principaux criminels japonais. La plupart ignorent même qu'au deuxième étage, s'est déroulé le 25 novembre 1970 un épisode qui provoqua à travers le monde une stupéfaction mêlée d'horreur : le suicide par éventrement (seppuku), selon l'ancienne tradition des samouraïs, de l'un des plus célèbres écrivains de l'archipel, Yukio Mishima. Cet événement spectaculaire, « au confluent de l'imaginaire et du réel » comme l'écrit Maurice Pinguet (La Mort volontaire au Japon, Gal.), a été minutieusement théâtralisé par un maître en communication avant la lettre. À 11 heures, ce matin-là, Mishima se présente à la caserne d'Ichigaya avec 4 jeunes membres de sa petite armée privée, la Société du bouclier, la Taté-no-kai. Il a 45 ans. Depuis plusieurs mois, il a résolu de mourir avec son plus proche disciple, un étudiant nommé Masakatsu Morita. Introduits auprès du général commandant la place avec qui ils avaient pris rendez-vous, les 5 hommes le ceinturent, le ligotent, et se barricadent dans la pièce. Mishima exige que la troupe se rassemble. Cintré dans l'uniforme à gros boutons de cuivre de la Taté-no-kai, en gants blancs, le front ceint d'un bandeau orné du Soleil-Levant, il se lance dans une harangue enflammée. Quelques journalistes ont été prévenus. Aux 800 soldats réunis dans la cour, il demande de se soulever pour l'empereur et contre une Constitution « sans honneur », imposée par les États-Unis après la défaite. « Votre âme est pure, nous le savons ; c'est notre désir farouche que vous renaissiez de vrais hommes qui nous a conduits à ce geste » déclame Mishima depuis le balcon du quartier général. Mais les insultes fusent et couvrent sa voix. Sans achever sa proclamation, il rentre dans la pièce, après un dernier Tenno Heika banzai ! (Vive Sa Majesté impériale !). Puis, s'agenouillant sur le sol, il ouvre sa tunique et s'enfonce une dague dans l'abdomen. D'un signe, il demande à Morita de lui donner le coup de grâce, comme l'exige le bushido, le code d'honneur des samouraïs. Mais, tremblant, le jeune homme ne parvient pas à le décapiter. C'est un de leurs compagnons qui, d'un seul coup de lame, achève la besogne. Puis Morita s'ouvre le ventre à son tour.
Dans le vaste bureau occupé naguère par le commandant de l'armée de l'Est, rien n'évoque “l'incident Mishima”, comme l'appelle pudiquement le militaire japonais qui conduit la visite. Des uniformes de l'époque Meiji sont exposés. Quelques estampes représentant les troupes à l'exercice tapissent les murs. Une épaisse moquette rouge et des boiseries sombres assourdissent la rumeur de la capitale. Au cœur de Tokyo, l'ancien quartier général d'Ichigaya a été transformé en mémorial des Forces d'autodéfense, l'armée nipponne. La vingtaine de visiteurs quotidiens vient surtout voir la salle où se tint, de 1946 à 1948, le tribunal militaire chargé de juger les principaux criminels japonais. La plupart ignorent même qu'au deuxième étage, s'est déroulé le 25 novembre 1970 un épisode qui provoqua à travers le monde une stupéfaction mêlée d'horreur : le suicide par éventrement (seppuku), selon l'ancienne tradition des samouraïs, de l'un des plus célèbres écrivains de l'archipel, Yukio Mishima. Cet événement spectaculaire, « au confluent de l'imaginaire et du réel » comme l'écrit Maurice Pinguet (La Mort volontaire au Japon, Gal.), a été minutieusement théâtralisé par un maître en communication avant la lettre. À 11 heures, ce matin-là, Mishima se présente à la caserne d'Ichigaya avec 4 jeunes membres de sa petite armée privée, la Société du bouclier, la Taté-no-kai. Il a 45 ans. Depuis plusieurs mois, il a résolu de mourir avec son plus proche disciple, un étudiant nommé Masakatsu Morita. Introduits auprès du général commandant la place avec qui ils avaient pris rendez-vous, les 5 hommes le ceinturent, le ligotent, et se barricadent dans la pièce. Mishima exige que la troupe se rassemble. Cintré dans l'uniforme à gros boutons de cuivre de la Taté-no-kai, en gants blancs, le front ceint d'un bandeau orné du Soleil-Levant, il se lance dans une harangue enflammée. Quelques journalistes ont été prévenus. Aux 800 soldats réunis dans la cour, il demande de se soulever pour l'empereur et contre une Constitution « sans honneur », imposée par les États-Unis après la défaite. « Votre âme est pure, nous le savons ; c'est notre désir farouche que vous renaissiez de vrais hommes qui nous a conduits à ce geste » déclame Mishima depuis le balcon du quartier général. Mais les insultes fusent et couvrent sa voix. Sans achever sa proclamation, il rentre dans la pièce, après un dernier Tenno Heika banzai ! (Vive Sa Majesté impériale !). Puis, s'agenouillant sur le sol, il ouvre sa tunique et s'enfonce une dague dans l'abdomen. D'un signe, il demande à Morita de lui donner le coup de grâce, comme l'exige le bushido, le code d'honneur des samouraïs. Mais, tremblant, le jeune homme ne parvient pas à le décapiter. C'est un de leurs compagnons qui, d'un seul coup de lame, achève la besogne. Puis Morita s'ouvre le ventre à son tour.
Lorsqu'on s'étonne qu'à Ichigaya rien ne rappelle le tragique événement, le guide finit par ouvrir la porte du bureau. Elle garde 3 grosses entailles : des coups de sabres donnés par les centurions de Mishima lorsque des officiers ont tenté de les maîtriser. « C'est tout ce qui reste », dit le guide. « Du point de vue des Forces d'autodéfense, c'est une affaire très fâcheuse », explique-t-il, en avouant “à titre personnel”, son admiration pour le courage de Mishima. Sacrifice patriotique d'un orphelin du “véritable Japon” ? Fatale outrance d'un Narcisse hanté depuis l'adolescence par l'esthétique du martyre et son relent de sadomasochisme ? Acte de désespoir d'un grand écrivain quitté par l'inspiration, ou dépit amoureux du héros qui, comme dans le théâtre kabuki, s'abolit dans un double suicide d'amants ? La complexité du personnage n'épuise aucune piste. L'incroyable sortie de scène de Y. Mishima gardera toujours sa part de mystère. À l'étranger, son suicide le propulse au rang de mythe. Ce hara-kiri, comme on dit en Occident, coïncide parfaitement avec l'image exotique que l'on se fait de la culture nipponne. Il devient emblématique. Mais dans l'archipel, Mishima le scandaleux indispose. Son geste public a souligné d'un trait de sang les grandes contradictions de l'après-guerre. En déplorant la perte par le souverain de son statut divin, en exaltant le rôle de l'armée impériale, en dénonçant les conséquences de la tutelle américaine, il embarrasse un pays condamné au pacifisme intégral par ses errements militaristes. Son ultranationalisme sent le soufre et ses frasques dérangent. La gauche le met au ban. Le gouvernement conservateur, où il comptait des appuis, prend ses distances. Le Japon, ce “troisième Grand” qui célèbre en 1970 sa renaissance économique à l'Exposition universelle d'Osaka, ne veut pas d'une telle icône. Mishima est envoyé au purgatoire. Il faudra 3 décennies pour l'en sortir. « La réhabilitation de Mishima a été progressive », raconte Donald Richie, écrivain américain installé au Japon depuis 1947. En 1951, il a guidé le jeune romancier nippon à New York, lors de son premier grand voyage à l'étranger.
En 1991, la guerre du Golfe, même si le Japon n'y contribue que financièrement, introduit une première brèche dans le mur du silence. L'Irak, où Tokyo dépêche des troupes, mais aussi les tensions avec la Chine et la Corée créent un contexte propice à la redécouverte de Y. Mishima. « Le pays a changé, il s'est “droitisé”, les Japonais débattent maintenant de leur Constitution et du rôle de leur armée », poursuit Donald Richie. En outre, « les mentalités concernant les mœurs ont évolué, rendant acceptable l'homosexualité de Mishima », estime-t-il. Selon lui, seul un dernier tabou demeure : la question impériale. Au club des correspondants étrangers de Tokyo, le Britannique Henry Scott-Stokes témoigne de la “renaissance” de Mishima. C'est ici qu'il a vu l'écrivain pour la première fois, lors d'un dîner en avril 1966. Il deviendra par la suite son ami et son biographe (Mort et vie de Mishima, Picquier). « Je reçois beaucoup de lettres à son sujet, ce qui n'était pas le cas auparavant », relève-t-il. « Les Japonais réalisent qu'un de leurs écrivains majeurs à sacrifié sa vie pour son pays en leur disant : il est temps de prendre vos responsabilités ». L'auteur incandescent du Pavillon d'or demeure peu lu et mal connu dans son pays. Ses livres ont cependant été réédités. Des films ont été récemment réalisés d'après ses principaux ouvrages. Sa famille, longtemps gardienne vigilante d'une image très épurée de l'écrivain, a quelque peu relâché son contrôle. Désargenté, son fils Ichiro a cédé les droits de certaines œuvres, notamment ceux du célèbre Patriotisme (Yûkoku), film prémonitoire tourné en 1965 par Mishima où celui-ci mime son seppuku. Une grande exposition a été organisée au printemps dernier à Yokohama. Elle a fait date. Pour la première fois, toutes les facettes du personnage ont été présentées : l'écrivain, le cinéaste, l'homme de théâtre, l'artiste mondain, l'adepte des arts martiaux, le chef de milice, le body-builder…
Mishima a toujours eu ses fidèles. Chaque année, le 25 novembre, 1.000 à 2.000 personnes se retrouvent à Tokyo pour honorer sa mémoire. « La portée de son geste était spirituelle », estime Masahiro Miyazaki, l'un des organisateurs de ces “rassemblements patriotiques”. « On peut dire qu'il avait vu juste, ce pays est devenu outrancièrement matérialiste ». Selon un autre fervent, Tadao Takemoto, ancien professeur, écrivain, poète et critique d'art, l'influence de Mishima et son « acte total » agissent toujours « comme par irradiation ». À Tsukuba, non loin de Tokyo, nous avons retrouvé Hiroshi Mochimaru, premier chef de la Taté-no-kai aux côtés de Mishima. Ce petit homme sec au visage carré déploie précautionneusement un rouleau : la copie du serment fondateur de la Société du bouclier. Mishima et ses jeunes recrues l'ont signée après avoir mélangé leur sang, un soir de février 1968. « Nous jurons de faire l'orgueil des hommes du Yamato (nom du Japon ancien, ndlr) et, avec notre esprit de samouraïs, de former l'assise d'une nation dédiée à l'empereur », peut-on y lire. « Nous devions servir de détonateur à une réforme de l'armée », relate Hiroshi Mochimaru en rappelant qu'après le reflux des manifestations étudiantes, en 1969, Mishima avait changé de combat : « Il dénonçait la “paix des esclaves” subie par le Japon et voulait que l'empereur retrouve sa position de Dieu vivant ». « Des idées toujours considérées comme dangereuses, — admet-il. Mais si elles ne sont pas mises un jour en pratique, le Japon est perdu ». Mais hors d'un cercle restreint, le nom de Mishima n'est guère invoqué alors même que le pays connaît un regain nationaliste. L'homme est trop atypique, trop paradoxal. « Il avait une idée fantaisiste de la politique », juge Shintaro Ishihara, le gouverneur de Tokyo. Âgé de 73 ans, ce politicien controversé est connu pour ses propos provocateurs à la limite de la xénophobie, notamment lorsqu'il prend la Chine pour cible. Également écrivain, il fut, à ses débuts, le protégé et le rival de Mishima. A-t-il été influencé par lui dans son action politique ? La réponse est sèchement négative. « Lorsque moi-même et Mishima avons été consultés par le Premier ministre Sato (au pouvoir de 1964 à 1972) en tant que conseillers politiques, Mishima a proposé que le gouvernement utilise l'armée pour faire une sorte de coup d'État et dissoudre l'assemblée », raconte celui qui fut aussi co-auteur (avec Akio Morita, le PDG de Sony) du best-seller Le Japon qui dit non, publié en 1989. « Il n'a fait qu'utiliser la politique pour se mettre en valeur selon ses propres critères de l'esthétique. Et quand il a vu son existence sombrer et son style littéraire décliner, il n'a eu d'autre choix que de commettre ce stupide suicide », souligne Shintaro Ishihara.
Qui a peur de Mishima ? Plus grand monde, à vrai dire. Le public japonais qui le redécouvre aujourd'hui n'en retient qu'une vision édulcorée. « Depuis 5 ans, on compte de plus en plus de thèses écrites sur Mishima, surtout par des filles qui le considèrent comme un romantique », explique Keiko Tamura, étudiante à Tokyo. « Les jeunes qui lisent ses livres ne savent rien de sa mort et de ses idées », ajoute-t-elle. De jeunes écrivains s'inscrivent dans sa lignée, sans pour autant se réclamer de ses idées. C'est le cas de Keiichirô Hirano (L'Éclipse, Picquier [ et « Essai sur “Le Pavillon d'Or” » in Impur n°1, 2008]). « J'appartiens à la même famille », dit ce romancier à succès de 31 ans, lauréat du prix Akutagawa (le Goncourt nippon). Tout comme celle de Mishima, sa langue est riche et érudite, émaillée de caractères chinois rares. Pour cette relève littéraire, il n'est plus ni ange ni démon. Juste un classique.
► Alain Barluet, Le Figaro, 19 juillet 2006. ©
 Ça commence par un petit garçon noir de jais qui laisse aller ses sentiments. Le visage de Saint Sébastien, plein de sperme, s’étale devant lui. Sur l’encyclopédie grande ouverte, le long des jambes du saint martyr, des filets nacrés s’entrelacent comme la dragonne sur la poignée de sabre d’un officier de marine.
Ça commence par un petit garçon noir de jais qui laisse aller ses sentiments. Le visage de Saint Sébastien, plein de sperme, s’étale devant lui. Sur l’encyclopédie grande ouverte, le long des jambes du saint martyr, des filets nacrés s’entrelacent comme la dragonne sur la poignée de sabre d’un officier de marine.
Trente ans ont passé. Il écrase sa cigarette et s’écarte du bureau. Un secrétaire. Il se penche, ouvre un tiroir. Dans un agenda d’affaire à couverture de cuir épais, il cherche la bonne page. Il dévisse son stylo plume, redresse la tête un bref instant, se penche à nouveau et écrit : « 25 novembre 1970 : Je voudrais vivre éternellement ». Il sort une enveloppe, glisse à l’intérieur le manuscrit du quatrième tome de La Mer de la fertilité, achevé à l’aube. Puis il note, en idéogrammes, de droite à gauche et de bas en haut, à la manière japonaise : À mon éditeur, L’Ange en décomposition, Mishima Yukio. « La mort du corps n’est rien face à la mort de l’esprit », dit-il à voix haute sur un ton détaché. Il se frotte le visage avec les mains et va se regarder dans la glace. L’homme qui le fixe dans le reflet ne lui ressemble pas. Narcisse ne s’aime plus. Faire le vide. Que les automatismes reprennent le dessus. La toilette : retirer ses vêtements. Le polo de coupe anglaise frotte sur le torse velu, la barbe naissante. Une dernière fois, Mishima fait jouer ses pectoraux. Il gonfle ses biceps. Le cœur n’y est pas. Son cœur : un champ d’artichauts. Toute sa vie, il aura rêvé d’un tatouage de marin sur le bras. Une ancre, un cœur percé d’une dague, une rose. Toute sa vie, sa mauvaise conscience l’a retenu. Il a même écrit un livre, Confession d’un masque, pour exorciser ce fantasme de midinette. Il pensait susciter la réprobation générale, être roué de coups, flagellé et transpercé de flèches, il n’a fait que s’attirer le succès et la célébrité. Foncer chez le premier tatoueur venu ? Trop tard. On ne devrait jamais vieillir.
Le feu du rasoir inonde ses joues d’une chaleur irradiante. Il se revoit, son sabre dégainé, posant au guerrier bushi devant le photographe hilare. Hilare de peur. La lame bleuie envoyait des éclairs dans la lumière des projecteurs. Il prend le flacon d’eau de toilette, en verse un trait généreux dans le creux de sa main droite et se frictionne le visage et le cou avec. Aussitôt, une forte odeur de lavande se répand dans la salle de bains. Précepte élémentaire du code d’honneur samouraï : mourir propre. Nu, il traverse le cabinet. L’appel d’air créé dissipe le nuage de vapeur. Il ouvre l’armoire à linge ; son uniforme sort juste du teinturier. Il enfile le pantalon moutarde puis revêt la tunique à double rangée de boutons qu’il a lui-même dessinée. Ensuite seulement, il regarde autour de lui. Il se souvient de la Grèce, de Thomas Mann et de Nietzsche, de Gœthe et de la bonne sueur des séances de musculation. Il se baisse et empoigne avec un infini respect ses 2 sabres, un court, un long. Il n’a plus qu’à aller chercher sa casquette, qu’une fois dehors il portera à sa tête. Dans une heure, il sera mort.
[Ci-contre Mishima (au centre), entouré des 4 officiers de son armée privée qui l'accompagneront, le 25 novembre 1970, dans l'attaque de la caserne d'Ichigaya. De g. à d. : Hissho Morita, Hiroyasu Koga, Masahiro Ogawa et Masayoshi Koga]
 En bas de son domicile, ses lieutenants attendent, serrés dans la Toyota de location. Comme lui, ils ont revêtu l’uniforme fantaisie de la Société du bouclier. Ses 4 mousquetaires : Morita – « mon doux, mon tendre Morita » – ; Ogawa, malin comme un singe, dévoué comme un chien de chasse ; Chibi-Koga, qui pleure toutes les nuits de n’être pas mort en kamikaze un quart de siècle plus tôt ; Furu-Koga, la plus fine lame de la Tate-no-kai. Sera un grand kendoka. Braves garçons, qui sur son ordre ont toujours subi les quolibets sans broncher. L’écrivain et ses groupies, qu’ils disaient. Les lâches. « Mes amis, mes fils ». Pour eux aussi, ce jour sera un grand jour. Ont-ils une idée claire de ce qui se passera pour eux ensuite ? Non bien sûr, ils sont trop jeunes. Mais leur volonté demeurera inflexible, il le sait. L’opération a été tant et tant de fois répété. Dans quelques minutes, ils seront au quartier général de la Force d’Autodéfense japonaise d’Ichigaya, au centre de Tokyo. Comme d’habitude, le planton les laissera entrer avec une déférence teintée d’ironie. Et comme d’habitude, le général Mashita les recevra seul à seul dans son bureau. La prise d’otages pourra alors commencer. Les sabres seront tirés de leurs fourreaux, les portes barricadées, et Mishima prononcera son discours devant la troupe rameutée. Ce sera sa “scène du balcon”. Il les exhortera au courage, à la révolte contre l’insignifiance de l’époque, au rétablissement des valeurs sacrées. Personne, évidemment, ne l’écoutera. Les flashes crépiteront, les hélicoptères tournoieront. Cela aussi, il l’a prévu. Ce sera le signal. Le signal qu’il sera plus que temps pour lui de mourir. Le déroulement de son suicide par seppuku, il l’a conté avec un luxe de détails dans la nouvelle Yûkoku (Patriotisme), terminée d’écrire dix ans plus tôt. Après avoir dégrafé son pantalon et retroussé sa veste, il s’agenouillera au centre de la salle, recouvrira la lame de son sabre de papier de riz, ne laissant dégagée que la pointe. Dans un kiaï retentissant, il enfoncera des 2 mains la partie nue de la lame dans son abdomen, à gauche du nombril. Le sang jaillira de la plaie à gros ruisseaux. Ses tempes cogneront, la sueur perlera sur son front. À cet instant précis, la douleur sera trop intense pour qu’il songe aux inévitables répercussions de son geste. Un dernier sursaut et la lame tranchera le bas ventre de part en part. Les intestins pourront dégueuler tandis qu’il vomira ses restes de la veille dans une mare de sang poisseux. Morita, debout derrière lui, abrégera ses souffrances d’un coup de sabre qui enverra sa tête rouler à l’autre bout de la pièce. Morita pourra à son tour s’éventrer, Furu-Koga procédera à sa décapitation dans les règles. Le tout sous les yeux impuissants et horrifiés du général Mashita. Les 2 Koga et Ogawa ont reçu l’interdiction formelle de se faire seppuku, afin que le suicide amoureux ou shinjū des 2 amants soit respecté.
En bas de son domicile, ses lieutenants attendent, serrés dans la Toyota de location. Comme lui, ils ont revêtu l’uniforme fantaisie de la Société du bouclier. Ses 4 mousquetaires : Morita – « mon doux, mon tendre Morita » – ; Ogawa, malin comme un singe, dévoué comme un chien de chasse ; Chibi-Koga, qui pleure toutes les nuits de n’être pas mort en kamikaze un quart de siècle plus tôt ; Furu-Koga, la plus fine lame de la Tate-no-kai. Sera un grand kendoka. Braves garçons, qui sur son ordre ont toujours subi les quolibets sans broncher. L’écrivain et ses groupies, qu’ils disaient. Les lâches. « Mes amis, mes fils ». Pour eux aussi, ce jour sera un grand jour. Ont-ils une idée claire de ce qui se passera pour eux ensuite ? Non bien sûr, ils sont trop jeunes. Mais leur volonté demeurera inflexible, il le sait. L’opération a été tant et tant de fois répété. Dans quelques minutes, ils seront au quartier général de la Force d’Autodéfense japonaise d’Ichigaya, au centre de Tokyo. Comme d’habitude, le planton les laissera entrer avec une déférence teintée d’ironie. Et comme d’habitude, le général Mashita les recevra seul à seul dans son bureau. La prise d’otages pourra alors commencer. Les sabres seront tirés de leurs fourreaux, les portes barricadées, et Mishima prononcera son discours devant la troupe rameutée. Ce sera sa “scène du balcon”. Il les exhortera au courage, à la révolte contre l’insignifiance de l’époque, au rétablissement des valeurs sacrées. Personne, évidemment, ne l’écoutera. Les flashes crépiteront, les hélicoptères tournoieront. Cela aussi, il l’a prévu. Ce sera le signal. Le signal qu’il sera plus que temps pour lui de mourir. Le déroulement de son suicide par seppuku, il l’a conté avec un luxe de détails dans la nouvelle Yûkoku (Patriotisme), terminée d’écrire dix ans plus tôt. Après avoir dégrafé son pantalon et retroussé sa veste, il s’agenouillera au centre de la salle, recouvrira la lame de son sabre de papier de riz, ne laissant dégagée que la pointe. Dans un kiaï retentissant, il enfoncera des 2 mains la partie nue de la lame dans son abdomen, à gauche du nombril. Le sang jaillira de la plaie à gros ruisseaux. Ses tempes cogneront, la sueur perlera sur son front. À cet instant précis, la douleur sera trop intense pour qu’il songe aux inévitables répercussions de son geste. Un dernier sursaut et la lame tranchera le bas ventre de part en part. Les intestins pourront dégueuler tandis qu’il vomira ses restes de la veille dans une mare de sang poisseux. Morita, debout derrière lui, abrégera ses souffrances d’un coup de sabre qui enverra sa tête rouler à l’autre bout de la pièce. Morita pourra à son tour s’éventrer, Furu-Koga procédera à sa décapitation dans les règles. Le tout sous les yeux impuissants et horrifiés du général Mashita. Les 2 Koga et Ogawa ont reçu l’interdiction formelle de se faire seppuku, afin que le suicide amoureux ou shinjū des 2 amants soit respecté.
Sur le trajet, Mishima imagine la suite des événements. La déclaration du Premier ministre, le procès des survivants, les échos dans les médias. On criera au fanatisme, à la folie meurtrière. Les journaux à sensation feront des gorges chaudes de la fin grand-guignolesque de l’écrivain homosexuel et fasciste le plus connu (le plus lu ?) au monde. Tous croiront à la thèse du coup d’État manqué d’un exalté richissime et de son armée privée d’opérette. Tant mieux, si ça leur chante ! Et comme ils auront raison. À l’autre extrémité, il y en aura aussi pour applaudir l’acte désespéré d’un nationaliste fidèle jusqu’au bout à ses idées. On encensera sa détermination sans faille, on glorifiera sa mort héroïque. On récupérera ses photos. Connaissez-vous plus japonais que lui ? lira-t-on dans la presse de droite. Pourtant, s’il avait voulu s’essayer à la politique, ce n’est pas au Parti du Patriotisme qu’il aurait adhéré. Il se rappelle, il y a un an, il était allé parler aux étudiants mutinés de la Zengakuren, la Fédération générale des étudiants d’extrême-gauche. Seul face à la foule hostile, il avait pris le micro et ils s’étaient tus. Rejoignez-nous, leur avait-il dit, ralliez le camp de la transcendance ! Prêtez allégeance à l’Empereur et je vous apporterai la guerre civile. La Société du bouclier sera le fer de lance de notre insurrection ! Des lazzis avaient couvert la fin de sa phrase. Son regard s’était alors fait plus dur, il avait prononcé chacun de ses mots avec une netteté coupante. J’ai ce que vous n’aurez jamais : la ferme résolution de mourir bientôt. Une bordée d’injures était partie des gradins. Le gauchisme est une impasse, avait-il conclu, en quittant l’amphithéâtre rassuré sur lui-même. Il n’avait pas flanché. Ses muscles n’avaient pas tressailli. L’époque était aux batailles rangées entre la Sekigunka, l’Armée rouge japonaise, cocktails molotov et techniques de karaté, et les forces de l’ordre, et l’on ne comptait plus le nombre d’agressions de policiers par des étudiants – autant dire des adolescents – maoïstes. C’était au printemps dernier, 25 garçons et filles de la Sekigunka s’étaient emparés d’un Boeing “Yo Do” de la Japan Airlines, armés de leurs seuls sabres. Direction Pyong-Yang, la capitale du paradis nord-coréen sur terre. La Beauté était-elle dans leur camp ? Cette question, il se l’était souvent posée. Mais ni Marx ni Castro n’étaient beaux. Le Che ? Juste un guérillero pouilleux abattu comme un chien dans un village perdu des Andes, après une cavale de western-spaghetti.
Encore quelques mètres, puis la voiture s’immobilise. La sentinelle demande le motif de la visite, formalité oblige. Bien sûr qu’ils les a reconnus, c’est encore l’écrivain qu’il n’a jamais lu et ses habituels doux dingues dans leur uniforme de carnaval. Tout de même, devrait pas les laisser se promener ainsi avec leurs sabres de combat. Sont rudement dangereux ces engins-là ! Trop bienveillant, le général, qu’il dit. Surtout avec des excités pareils. Où croient-ils être ? À Saipan, en 45 ? Son grand-père y était, lui. L’a jamais connu. Baïonnette au canon contre les mitrailleuses enterrées, il a chargé, avec toute sa compagnie. Pas un n’a survécu. Un fanatique c’était, affilié à une société paramilitaire comme eux. Mourir pour l’Empereur, la belle affaire ! Y a qu’à voir où ça l’a mené, le Japon. 20 ans pour s’en remettre. Ah ça ! c’est vrai qu’ils étaient beaux ces guerriers violeurs de Coréennes massés les uns contre les autres pour le besoin de la photo, tous drapeaux dehors, brandissant leurs sabres au soleil de la victoire ! P’t-être bien que c’est pour ça qu’ils regrettent que ce soit terminé, l’écrivain homo et ses mignons. Au fait il était où, lui, en 45 ? La barrière se lève sur le véhicule et ses 5 passagers. Le général Mashita a bien été informé de leur visite.
Les portières claquent. Mishima rajuste sa tenue, vérifie que sa casquette est bien droite. Toujours le masque. Sa grand-mère paternelle, chez qui il vécut cloîtré de sa naissance jusqu’à l’âge de 12 ans, serait fière de lui. C’est elle qui lui inculqua les principes du Bushido. « Hiraoka Kimitake – son vrai nom –, tu es l’héritier d’une prestigieuse lignée de samouraïs-paysans. Sache toujours t’en montrer digne ». C’est elle qui lui apprit que la liberté de l’homme réside dans le choix de sa mort, et que les forts ont seuls le droit de se suicider, pas les faibles. Qu’est-ce que la vie sans la mort ? C’est à elle qu’il doit d’avoir compris que la Beauté est la suprême loi en toutes choses, quand le bien moral est relatif. À 20 ans, en 1945, il fut recalé à sa grande honte au conseil de révision des armées. Faiblesse pulmonaire, diagnostiquèrent les médecins. À sa grande honte, mais aussi à son grand soulagement. La peur avait été la plus forte. Aujourd’hui, Mishima est prêt. Il va laver son honneur et celui de ses ancêtres. Enfin connaître l’extase de l’anéantissement de soi !
Ensuite, tout est allé très vite. Maintenant qu’il a parlé, debout sur la balustrade, les poings gantés de blanc sur les hanches, les bandeau de résolution noué sur le front, Mishima va mourir. Trois fois, il a proféré la formule rituelle les bras levés vers le ciel. « Tenno Heika Banzaï ! » On l’a brocardé, raillé, traité de pantin. À présent, il va leur montrer à tous ce que c’est que d’être sincère. Il avait cru dépasser son instinct de mort dans l’exercice physique, l’abus des plaisirs. Son appétit de vivre n’était qu’apparent. Plus il progressait dans l’écriture du Soleil et l’acier, et plus sa réalité lui apparaissait violemment. Un beau corps, pour un sadomasochiste, ne se conçoit que fouetté, piétiné, meurtri. Les statues grecques ne sont tragiques que parce qu’en elles se lit déjà la flétrissure prochaine de la beauté à son apogée. Aspiration vers les cimes ou goût morbide pour l’abîme, ce n’est plus à lui d’en décider. La postérité jugera et comme il se doit, elle aura tort. Mishima s’est composé une figure tragique ; la mise en scène de sa mort sera sublime. Son suicide par éventration sera diversement interprété, mais nul ne pourra nier son engagement total, jusqu’au sacrifice, pour la Beauté contre la Laideur. Certains le taxeront de nihilisme. Le nihilisme. La destruction de tout, y compris de soi. Le sentiment d’un déclin irréversible que rien ne peut entraver. Les fanatiques du suicide collectif, qui militaient pour l’immolation de cent millions de Japonais en 1945, l’ichioku gyokusai, étaient des nihilistes. Un peuple qui se tue au travail dix heures par jour, à produire des biens de consommation courante qui ensuite seront exportés en Europe, ce peuple mérite l’appellation de nihiliste. Mais celui qui meurt pour ne pas se voir vieillir, peut-il être qualifié de nihiliste ? Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est qu’en périssant de sa propre main, Mishima s’affirme au monde. Le bonheur ne dure jamais, les grands destins, si.
Il déboutonne sa veste, baisse son pantalon, s’agenouille lentement. Son visage a perdu toute expression. Il prend sa respiration. Une dernière fois, plonger ses yeux dans ceux de Morita... 20 ans qu’il joue la comédie de la vie. La littérature le dégoûte. La sienne en particulier. Trop simple de coucher des personnages sur le papier. La vérité, la vraie, est dans l’action. Il n’y a plus de transcendance possible dans un monde où la mort a été évacuée. Ce monde est laid. Même les généraux en 1945 ont préféré être traînés devant les tribunaux américains plutôt que de se faire justice eux-mêmes. Il va les réveiller, tous ces amnésiques assoupis. Que la mort est belle lorsqu’elle est inutile !
Pour nous, comme le Christ glorieux expirant au soleil couchant, Mishima a rompu dans sa mort le cycle de la modernité stérilisante. Un jour, un dessinateur japonais prendra la peine de se pencher sur le cas Mishima. Arrivé au chapitre de fin, son coup de crayon se fera acéré. Surtout pas de couleurs, sauf le sang. Je vois la planche d’ici. Un corps encore jeune, vigoureux ; un masque écarlate, presque aussitôt livide, mugissant sur un cou durci, tendu par l’effort ; un ventre qui s’ouvre et déverse tout ce que la nature y a mis dans un bouillon d’hémoglobine. Le plus beau des mangas.
À tous les pédés virils de la planète, mes frères.
► Laurent Schang, Cancer n°8, 2003.
 ♦ L'auteur : Né à Metz en 1974, ce néo-hussard, secret admirateur du barrésien Culte du Moi, éclectique en amitiés particulières, n'est pas sans paradoxes : à la fois impérial (idéal lotharingien) et occidental, épris de virilité spirituelle et esthète enclin au raffinement des mœurs, toujours en quête d'une conciliation entre plume et sabre, il pratique avec brio un art du décalage bien que se laissant parfois définir par son adversaire, à savoir une époque moderne qui est notre Ombre. Mais il est avant tout notre ami et ancien collaborateur, chroniqueur littéraire (Figaro littéraire, Cancer !, TsimTsoûm, Journal de la Culture, La Presse Littéraire, Impur), romancier (Constat d'Occident, 2007, Kriegspiel 2014, 2009), journaliste géopolitique (La Voie Stratégique) et créateur d'une récente maison d'édition associative (Le Polémarque). Concernant la culture japonaise, il a rédigé une monographie : Le fondateur de l'aïkido : Morihei Ueshiba (Pygmalion, 2005). Son approche pédagogique combine judicieusement parcours biographique de Morihei Ueshiba (1883-1969) et évolution du cadre historique, des idées et de la vie socio-économique du Japon, éléments-clefs pour bien comprendre la sagesse d'inspiration taoïste de cet art martial défini comme voie de l'union des énergies (ki). À l'instar d'autres initiateurs contemporains d'arts martiaux (comme Jigoro Kano) mariant tradition & modernité, il s'agit en effet d'instituer un relais d'apprentissage social de l'esprit samouraï au sein d'un pays en pleine mutation, esprit pour lequel corps et âme ne se séparent pas (à la différence du sport moderne surdéterminant la performance) et où se vaincre compte plus que vaincre l'adversaire. Mais ce qui particularise l'enseignement du fondateur de l'aïkido qui, à travers sa longue existence, connut toutes les métamorphoses de son pays resté malgré tout foyer d'une culture ancestrale (industrialisation accélérée, tentatives impérialistes anéanties par Hiroshima et Nagasaki, retour sur la scène internationale en tant que puissance économique), ce n'est point tant l'adaptation d'un style particulier d'esquives circulaires et de contre-attaques de manieurs de sabres que de mettre une ascèce d'inspiration bouddhique au service d'un idéal de paix respectueux des phénomènes d'interdépendance : « Nous allons nous entraîner pour prévenir la guerre, pour abolir les armes nucléaires, pour protéger l'environnement et pour servir la société ».
♦ L'auteur : Né à Metz en 1974, ce néo-hussard, secret admirateur du barrésien Culte du Moi, éclectique en amitiés particulières, n'est pas sans paradoxes : à la fois impérial (idéal lotharingien) et occidental, épris de virilité spirituelle et esthète enclin au raffinement des mœurs, toujours en quête d'une conciliation entre plume et sabre, il pratique avec brio un art du décalage bien que se laissant parfois définir par son adversaire, à savoir une époque moderne qui est notre Ombre. Mais il est avant tout notre ami et ancien collaborateur, chroniqueur littéraire (Figaro littéraire, Cancer !, TsimTsoûm, Journal de la Culture, La Presse Littéraire, Impur), romancier (Constat d'Occident, 2007, Kriegspiel 2014, 2009), journaliste géopolitique (La Voie Stratégique) et créateur d'une récente maison d'édition associative (Le Polémarque). Concernant la culture japonaise, il a rédigé une monographie : Le fondateur de l'aïkido : Morihei Ueshiba (Pygmalion, 2005). Son approche pédagogique combine judicieusement parcours biographique de Morihei Ueshiba (1883-1969) et évolution du cadre historique, des idées et de la vie socio-économique du Japon, éléments-clefs pour bien comprendre la sagesse d'inspiration taoïste de cet art martial défini comme voie de l'union des énergies (ki). À l'instar d'autres initiateurs contemporains d'arts martiaux (comme Jigoro Kano) mariant tradition & modernité, il s'agit en effet d'instituer un relais d'apprentissage social de l'esprit samouraï au sein d'un pays en pleine mutation, esprit pour lequel corps et âme ne se séparent pas (à la différence du sport moderne surdéterminant la performance) et où se vaincre compte plus que vaincre l'adversaire. Mais ce qui particularise l'enseignement du fondateur de l'aïkido qui, à travers sa longue existence, connut toutes les métamorphoses de son pays resté malgré tout foyer d'une culture ancestrale (industrialisation accélérée, tentatives impérialistes anéanties par Hiroshima et Nagasaki, retour sur la scène internationale en tant que puissance économique), ce n'est point tant l'adaptation d'un style particulier d'esquives circulaires et de contre-attaques de manieurs de sabres que de mettre une ascèce d'inspiration bouddhique au service d'un idéal de paix respectueux des phénomènes d'interdépendance : « Nous allons nous entraîner pour prévenir la guerre, pour abolir les armes nucléaires, pour protéger l'environnement et pour servir la société ».

◘ 35 ans après sa disparition, la vérité sur Yukio Mishima, milicien de l'empereur
 Le 25 novembre 1970, l'écrivain se donnait la mort de façon spectaculaire. Hiroshi Mochimaru, son homme de confiance et ancien membre de sa milice, revient sur ses dernieres années.
Le 25 novembre 1970, l'écrivain se donnait la mort de façon spectaculaire. Hiroshi Mochimaru, son homme de confiance et ancien membre de sa milice, revient sur ses dernieres années.
35 ans se sont écoulés depuis le suicide de l'écrivain Yukio Mishima. Pour être franc, j'ai beaucoup hésité à écrire sur ce sujet. Il m'est arrivé de répondre à 2 ou 3 interviews dans des magazines et de m'exprimer dans des lieux informels. Mais à chaque fois, j'ai éprouvé un sentiment d'inanité et de remords, comme une légére tristesse. À quoi celà tient t-il ? Ayant signé un pacte avec notre maître et étant considéré comme son bras droit, je crois que j'aipassé toutes les années qui se sont écoulées depuis sa disparition à vérifier la réalité de ces sentiments et à chercher à comprendre leur véritable nature.
Même si j'ai été agacé par les déclarations des soudains “amis de Mishima” qui ont fait apparition au lendemain de sa mort, et par les analyses pleines de suffisances de nombreux critiques, j'ai préferé garder le silence. Mais maintenant qu'un tiers de siècle s'est écoulé, et qu'il est possible de parler sans porter préjudice aux personnes concernées, je me dois de rendre des comptes. J'ai décidé de tout dire , pensant qu'il était de mon devoir de dissiper les malentendus en rapportant les événements tels qu'ils s'étaient déroulés et de transmettre à la postérité à la postérité la réalité des faits et les sentiments qui nous animaient, moi et mes camarades qui avont été impliqués.
En tant que président de la Taté-no-kai (Société du bouclier), la milice privée de Mishima, j'ai été amené à participer à de nombreuses opérations, mais je voudrais commencer mon récit par “le serment par le sang” dans lequel on peut voir l'acte fondateur de la Société du bouclier. J'ai encore en ma possession le rouleau de papier. C'est l'engagement que Mishima, qui était déjà un personnage mythique, et une dizaine de jeunes membres ont signé de leur sang. La scène s'est déroulé le 25 février 1968, soit 7 jours avant leur premier stage de formation dans les forces d'autodéfense (l'armée japonaise). Le vent du nord soufflait avec force et la journée était particulièrement froide. Le serment a été signé dans les locaux du Ronso journal, au 4ème étage d'un immeuble situé à Ginza, quartier animé de Tokyo. Mishima y est apparu peu après 7 heures du soir, le col de son inséparable blouson en cuir relevé. Il portait sous le bras un sachet d'une pharmacie voisine. Contrairement à l'habitude qu'il avait de se présenter à l'improviste, cette visite avait été programmée.
Dix jeunes membres, y compris ma personne, l'attendaient dans le bureau. Le maître a sorti du sachet un flacon d'alcool, un rasoir et du coton, et a déployé le rouleau de papier sur une table. Puis il a donné l'exemple en appliquant légérement la lame du rasoir sur l'extrémité de son auriculaire gauche. Il a accompli ce geste avec la même facilité que s'il pelait un fruit. Nous l'avons tous imité, en commençant par le rédacteur en chef du Ronso journal, Kazuhiko Nkatsuji. Le sang a été recueilli dans un verre et l'on y a ajouté du sel pour qu'il ne coagule pas. Puis, avec un pinceau trempé dans ce sang, Mishima a écrit d'une traite : « Nous jurons de faire l'orgueil des hommes du Yamato et, avec notre esprit de Samouraï, de former l'assise d'une nation dédiée à l'empereur ». Après quoi nous avons signé à tour de rôle, Mishima en tête. Notre maître a inscrit son véritable nom, Kimitake Hiraoka, comme il l'avait annoncé. Après l'apposition de l'ensemble des signatures, la cérémonie a pris fin. Malgré le froid glacial de cette nuit-là, des gouttes de sueurs perlées sur nos fronts.
C'est le père de Mishima, Azusa Hiraoka, qui a révélé l'existence de ce serment après le suicide de son fils, dans un article paru dans un numéro de mars 1972 du mensuel de tendance nationaliste Shokun, sous le titre de « Segare, Mishima Yukio ». Il est propable que ce texte a été rédigé d'après des entretiens avec le père. Cela expliquerait en tout cas pourquoi il fourmille d'expressions vagues et d'informations très éloignées de la réalité. Notre serment a inspiré plusieurs dizaines de biographie et d'étude, mais la plupart font un usage abondant de citations de secondes, voire de troisième main, ce qui a engendré bon nombre d'erreurs d'interprêtation et de malentendus. Le serment, par ex., est souvent daté de 1967, alors qu'il a eu lieu, nous l'avons dis, le 25 février 1968. Ultérieurement, un éminent critique l'a mis en parallèle avec la tentative de coup d'État de jeunes officiers favorables à l'expension impérialiste de 26 février 1936 et, peut être pour ajouter à l'intensité dramatique, a fini par le dater du 26 février. La formule du serment, telle qu'elle est rapportée dans « Segare, Mishima Yukio », est incomplète par rapports à l'original. Elle a été réduite à « Nous jurons de former l'assise d'une nation dédiée à l'empereur ». L'expression « avec notre esprit de samouraï », qui a été omise, est pourtant capitale. C'est avec un pur esprit de samouraï que Mishima appréhendait les affaires de l'État. Cette expression constitue donc un élément-clé pour comprendre les actions de notre maître et de la Société du bouclier. Quant au conditions dans lesquelles ce serment a été décidé, la plupart des spécialistes ont écrit que « les jeunes membres étaient en état d'exaltation et que le serment a été proposé sans que l'on sache par qui ». Or la décision n'a pas été prise en raison d'un quelconque sentiment éphémère. Mishima avait l'habitude de faire des plans minutieux et des calculs précis. Il est inconcevable qu'une humeur passagère ou une atmosphère particulière l'aient amené à prendre une telle décision.
Comme toutes les actions de la future Société du bouclier que nous allions fonder, le serment a été programmé par notre maître, et les dix membres présents triés sur le volet, ont participé à la signature. Cinq d'entre eux collaboraient au sein du Ronso journal et les 5 autres étaient de simples membres du groupe de Mishima. Aujourd'hui, 2 sont décédés et les 8 autres menèrent une vie ordinaire, certains ayant monté leur propre affaire, d'autres étant cadres dans de grandes entreprises. En l'espace de 3 ans, la Taté-no-kai a organisé officiellement 5 stages de formations au seins des forces d'autodéfense et compté au total plus de 150 membres. À l'époque, j'occupais le poste de rédacteur en chef adjoint du Ronso journal, mais, en tant que président de la société, j'accompagnais les jeunes dans leur formation et, avec notre maître, j'en assurais la gestion, depuis le recrutement des candidats jusqu'au programme d'entraînement.
L'histoire de la Taté-no-kai, née de la rencontre de Mishima avec le Ronso journal, peut être tracée en 3 étapes. La première visait à mettre en place sur pied une milice privée selon le “plan des troupes de défense de la patrie”. Cette étape a duré environ 6 mois, de l'époque du serment, en février 1968, à celle du deuxieme stage de formation, en septembre de la même année. L'idée était de suppléer, en cas d'urgence, aux force d'autodéfense pour les opérations soumises aux contraintes de la loi. Les stages au sein des forces d'autodéfense visaient précisement à former les chefs de ces opérations.
La Taté-no-kai cherchait également à passer des accords avec d'autres organisations, à commencer par l'école de renseignements des forces d'autodéfense, pour assurer l'entraînement à la guérilla urbaine et au contre-espionnage. L'information qui suit n'a jamais été révélée jusqu'ici. Par l'intermédiaire d'un patron d'une grande société de surveillance que lui avait présenté un ancien fonctionnaire de l'agence de la défense nationale, le maître Mishima, qui voulait aussi collaborer avec des entreprises privées, a noué des relations très étroites avec un cadre de cette société. Celui-ci n'a pas tardé à devenir un membre spécial de la Taté-no-kai et à participer aux entraînements avec plusieurs employés de son entreprise.
La deuxième étape a duré un an, d'octobre 1968 date à laquelle le groupe a pris le nom de Taté-no-kai, à octobre 1969. Cette année-là, le “plan de troupe de défense de la patrie” a nettement reculé au profit d'un programme de soulèvement et de combats à morts mené par de petites unités. Le contenu de l'entraînement est également devenu plus concret. Il a gagné en professionnalisme et réalisme, avec des exercices anti-guérilla frisant l'illégalité et des plans d'attaque contre certains sites importants de la capitale. J'ai une anecdote à raconter à ce propos.
Chaque semaine, dix membres de la société étaient sélectionnés pour s'entraîner au sabre avec notre maître dans un dojo de la police attaché à la cour impériale. À la fin de l'entraînement, ils devaient laisser les sabres dans le dojo. Le but était de se servir de cette arme en cas d'urgence. L'un des grands facteurs qui ont amené la société à changer de ligne de conduite est l'évolution de la situation politique dans le pays. Contrairement aux prédictions, la crise majeur de 1970 a été évitée du fait de l'apaisement, en 1969, du mouvement de révolte, autrement dit la défaite du Zenkyoto (organisation étudiante d'extrême-gauche). Les manifestations estudiantines violentes se succédaient, mais ne prenaient pas d'ampleur. La situation n'était plus révolutionnaire. Cela est devenu très clair le 21 octobre 1969, avec l'échec de la grande manifestation étudiante, considérée comme cruciale. Cette défaite du mouvement étudiant a marqué un autre grand tournant pour la Taté-no-kai. Jusque là, celle-ci avait pour principe de réagir aux événements, mais à partir de cette date, elle a été obligée de revoir sa stratégie de base, car elle n'avait plus d'ennemi. Elle a alors décidé d'agir et a pris pour ennemi une entité abstraite, le système socio-politique de l'après-guerre, incarné par la constitution (selon laquelle l'empereur n'est plus que le symbole d'une unité nationale).
Juste avant ce tournant, à partir du milieu de 1969, les relations de Mishima avec le Ronso journal ont commencer à se détériorer. Notre maître était en désaccord avec Nakatsuji, le rédacteur-en-chef, sur des problèmes mineurs, comme ses retards aux rendez-vous et son manque de rigueur dans la gestion financière ou encore sur les fonds de roulement de la revue, et il avait aussi avec lui de légers différends d'ordre idéologique. Même si d'autres raisons ont joué, dès le mois d'octobre 1969, la plupart des collaborateurs de la revue, dont moi-même, avaient quitté la Société du bouclier. Cette époque coïncide avec la fin de la deuxième étape. Celle qui suit, la dernière, a conduit Mishima a envisager le seppuku.
À partir de là, les évenements se sont précipités. Le 25 octobre 1970, environ un mois avant son suicide, je me trouvais en compagnie du maître au siège de sa troupe de théâtre Roman-Gekijo au quartier d'Ochanomizu, à Tokyo. À coté de la salle de répétition se trouvait un terrain vague. C'est là que nous avons brûlé le manuscrit du serment. N'ayant plus de relations avec les autres signataires du Ronso journal, Mishima m'avait convoqué pour en discuter et c'est ainsi que nous avons détruit le rouleau. Par crainte de l'égarer, j'avais toutefois pris la précaution au préalable d'en faire une copie au journal. Même s'il est maintenant impossible de voir l'original, la copie suffit a rendre compte de la touche énergique de Mishima, de son intégrité et de sa volonté lors de la création de la société.
« Nous jurons de faire l'orgueil des hommes du Yamato et, avec notre esprit de samouraï... » Au cours des 3 années qui ont suivis la signature de ce serment, notre maître a toujours gardé cette même détérmination, cet esprit de samouraï, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, 35 ans après sa disparition, la réforme constitutionnelle pour laquelle il a donné sa vie est entrée dans le domaine du possible (le PLT au pouvoir vient de rendre public son projet de réforme, voir p. 38). Mais comme le montre le pélerinage du Premier ministre Koizumi au sanctuaire Yasukuni, le Japon n'a pas fini de liquider tout son système de l'après-guerre, plein d'hypocrisie. Et je me demande ce que doit en penser notre maître Mishima.
► Hiroshi Mochimaru (Akihito Usui et Ao Okamura pour Aera), Courrier international n°786 (25/11/2005).
♦ Biographie :
 Une vie controversée : Yukio Mishima, de son vrai nom Kimitake Hiraoka, est né à Tokyo en 1925. C'est sa grand-mère paternelle qui l'initie à la littérature et au théatre classique, nô et kabuki. Une expérience sans doute déterminante pour le futur romancier. Alors qu'il fréquente l'école et le lycée dépendant de Gakushuin, l'université fréquentée par l'aristocratie et la famille impériale, l'adolescent commence à rédiger des poèmes et des nouvelles et découvre des auteurs étrangers comme Oscar Wilde, Jean Cocteau ou encore Thomas Mann. En 1941, il écrit son premier roman, La Forêt tout en fleurs, pour lequel il prend le pseudonyme de Yukio Mishima. L'année 1946 est cruciale pour le jeune Mishima. Il rencontre Yasunari Kawabata, qu'il considéra toute sa vie comme son maître. Le futur prix Nobel l'encourage et lui propose de publier La nouvelle cigarette dans sa revue Ningen. Après avoir obtenu son diplôme de droit de l'université de Tokyo en 1947, Mishima entre au ministère des finances, qu'il quittera dès l'année suivante pour se consacrer à la littérature. Publié en 1949, le roman autobiographique Confession d'un masque lui apporte une grande célébrité. Il fréquente les milieux homosexuels. Au cours d'un périple effectué entre déc. 1951 et mai 1952 en tant qu'envoyé spécial du quotidien Asahi Shimbun, qui l'emmène en Amérique et en Europe où il parcourt notamment l'Italie et la Grèce, l'écrivain découvre « le soleil, le corps et la sensualité ». Ce voyage l'incite à revoir non seulement sa littérature mais aussi sa conception de la vie. En 1955, il décide de pratiquer le culturisme. Ses réflexions se concrétisent en 1956 dans Le Pavillon d'or. Au cours de ces années 1960, Mishima commence à exprimer ses idées nationalistes et crée en 1968, la Tate-no-kai, sa milice. En 1970, Mishima a 45 ans. À l'automne, il est sur le point de terminer sa tétralogie La mer de la fertilité, commencée en 1965 (Neige de printemps, Chevaux échappés, Le Temple de l'aube et L'Ange en décomposition). Le 25 nov. au matin, il achève le 4ème volet et l'expédie à son éditeur. Puis, en compagnie des membre de la Tate-no-kai, il se rend au quartier général des forces d'autodéfense, à Tokyo. Il y prend en otage le commandant en chef et fait convoquer ses troupes. Il tient un discours en faveur des valeurs traditionnelles du Japon et tente d'amener les soldats à se soulever pour l'empereur. Devant leur réaction hostile, il se retire du balcon et se donne la mort. 80 ans après sa naissance, Aera commente : « Mishima reste un écrivain qui suscite un grand intérêt chez beaucoup de Japonais, même chez ceux qui n'apprécient ni son idéologie ni ses actes ».
Une vie controversée : Yukio Mishima, de son vrai nom Kimitake Hiraoka, est né à Tokyo en 1925. C'est sa grand-mère paternelle qui l'initie à la littérature et au théatre classique, nô et kabuki. Une expérience sans doute déterminante pour le futur romancier. Alors qu'il fréquente l'école et le lycée dépendant de Gakushuin, l'université fréquentée par l'aristocratie et la famille impériale, l'adolescent commence à rédiger des poèmes et des nouvelles et découvre des auteurs étrangers comme Oscar Wilde, Jean Cocteau ou encore Thomas Mann. En 1941, il écrit son premier roman, La Forêt tout en fleurs, pour lequel il prend le pseudonyme de Yukio Mishima. L'année 1946 est cruciale pour le jeune Mishima. Il rencontre Yasunari Kawabata, qu'il considéra toute sa vie comme son maître. Le futur prix Nobel l'encourage et lui propose de publier La nouvelle cigarette dans sa revue Ningen. Après avoir obtenu son diplôme de droit de l'université de Tokyo en 1947, Mishima entre au ministère des finances, qu'il quittera dès l'année suivante pour se consacrer à la littérature. Publié en 1949, le roman autobiographique Confession d'un masque lui apporte une grande célébrité. Il fréquente les milieux homosexuels. Au cours d'un périple effectué entre déc. 1951 et mai 1952 en tant qu'envoyé spécial du quotidien Asahi Shimbun, qui l'emmène en Amérique et en Europe où il parcourt notamment l'Italie et la Grèce, l'écrivain découvre « le soleil, le corps et la sensualité ». Ce voyage l'incite à revoir non seulement sa littérature mais aussi sa conception de la vie. En 1955, il décide de pratiquer le culturisme. Ses réflexions se concrétisent en 1956 dans Le Pavillon d'or. Au cours de ces années 1960, Mishima commence à exprimer ses idées nationalistes et crée en 1968, la Tate-no-kai, sa milice. En 1970, Mishima a 45 ans. À l'automne, il est sur le point de terminer sa tétralogie La mer de la fertilité, commencée en 1965 (Neige de printemps, Chevaux échappés, Le Temple de l'aube et L'Ange en décomposition). Le 25 nov. au matin, il achève le 4ème volet et l'expédie à son éditeur. Puis, en compagnie des membre de la Tate-no-kai, il se rend au quartier général des forces d'autodéfense, à Tokyo. Il y prend en otage le commandant en chef et fait convoquer ses troupes. Il tient un discours en faveur des valeurs traditionnelles du Japon et tente d'amener les soldats à se soulever pour l'empereur. Devant leur réaction hostile, il se retire du balcon et se donne la mort. 80 ans après sa naissance, Aera commente : « Mishima reste un écrivain qui suscite un grand intérêt chez beaucoup de Japonais, même chez ceux qui n'apprécient ni son idéologie ni ses actes ».
◘ L'inimitable exemple de Yukio Mishima
Fais que l'affliction et le bonheur, la perte et le gain, la victoire et la défaite, soient égaux pour ton âme. Puis lance-toi dans la bataille : ainsi tu ne pécheras point (Bhagavad-Gîtâ).
Que mon corps devienne apte au sacrifice ! Grâce à lui, je parviendrai à avoir un être (Brhadhâranyaka-Upanishad, 1, 7-8).
Quand il neige sur la mémoire
 Il y a une vingtaine d'années – pour en savoir davantage, il me faudrait troubler une nécropole d'enveloppes toutes égales, contenant les reliques de correspondances plus ou moins assidues, monotonement interrompues par décret de la Mort – me parvint, sur papier noble, jadis dénommé “à la cuve”, une lettre de Yukio Mishima : parce qu'était arrivé, jusqu'à ce grand comestor de livres occidentaux, le premier tome d'un épistolier dannunzien (1) par moi sauvé des cloaques lutétiennes, durant l'hiver de 1941. Cette lettre écrite en un français très correctement singulier, outre à célébrer Gabriel d'Annunzio d'une manière des plus informées, me demandait courtois secours au nom de ma tangible dévotion à la mémoire du héros littéraire et martial, non sans ajouter que des lettres, adressées à certains « dannunziens » de mon langage, étaient demeurées sans réponse, « pour des raisons peut-être compréhensibles ».
Il y a une vingtaine d'années – pour en savoir davantage, il me faudrait troubler une nécropole d'enveloppes toutes égales, contenant les reliques de correspondances plus ou moins assidues, monotonement interrompues par décret de la Mort – me parvint, sur papier noble, jadis dénommé “à la cuve”, une lettre de Yukio Mishima : parce qu'était arrivé, jusqu'à ce grand comestor de livres occidentaux, le premier tome d'un épistolier dannunzien (1) par moi sauvé des cloaques lutétiennes, durant l'hiver de 1941. Cette lettre écrite en un français très correctement singulier, outre à célébrer Gabriel d'Annunzio d'une manière des plus informées, me demandait courtois secours au nom de ma tangible dévotion à la mémoire du héros littéraire et martial, non sans ajouter que des lettres, adressées à certains « dannunziens » de mon langage, étaient demeurées sans réponse, « pour des raisons peut-être compréhensibles ».
Y. Mishima m'informait donc qu'il tentait de traduire en japonais Le martyre de saint-Sébastien, le transverbéré de flèches “qui ne font pas de mal”, mais qu'il ne parvenait pas toujours à déceler, tantôt tout le sens, tantôt la “signification profonde” de plus d'un vocable de l'ancien français, en qui avait été écrit pour Maurice Barrès et pour Claude Debussy le drame ésotérique, odieux au cardinal de Paris et à une kyrielle de bigots littéraires (2). Une liste, assez brève, de tels mots, classés selon les 2 ordres de doutes et de difficultés, accompagnait cette lettre exaltante et consolatrice.
Je répondis avec diligence à Y. Mishima, le priant de bien vouloir patienter un peu, mais de ne point douter de la valeur de ma promesse, équivalant à la parole donnée. C'est ainsi que j'entrepris aussitôt un étrange labeur de lexicologie comparée, chère aux ombres de Gaston Paris, Joseph Bédier, Édouard Champion et Pierre de Nolhac. Non content d'élucider la signification, première et seconde, voire l'étymologie de tous ces mots du “vieux” français – le vrai, celui des cycles épiques et magiques de la Chevalerie du Saint-Esprit, non encore défiguré par l'orthographie humaniste et non encore décoloré par le purisme classique –, je décidais de redoubler mes gloses et d'éclairer mes sources avec les équivalences japonaises de ces vocables, telles que je les avais autrefois apprises chez des wagakushas ou yamatologues du Sendai kujihongi et du Nihon-shoki (3) : autrement dit en “vieux” japonais, aulique et sévère, et non sans m'excuser de les transcrire en simple rômaji (4).
Ayant fait de mon mieux, j'envoyai mes explications minutieuses à Y. Mishima, qui ne s'attendait certainement pas à trouver en son correspondant dannunzien un assidu et secret pèlerin de la “Forêt des Pinceaux”. La réponse de Y. Mishima, en très belle calligraphie – car, dans l'Orient extrême, écrire bien est bien penser, selon l'adage : “À cœur sincère, ferme pinceau” – me fut, certes, une mémorable récompense : une de celles que quelques esprits, encore vivants ou survivants, ont connues ou connaissent, surtout grâce à une relève spirituelle, descendance mentale des héros et des pendus, coupables d'avoir été si difficilement vaincus – de qui sut, comme l'a écrit Julius Evola une fois pour toutes et pour tous, « choisir la voie la plus dure, de qui sut combattre, même en sachant que la bataille était matériellement perdue, de qui sut convalider les paroles de l'antique saga : “Fidélité est plus forte que feu”, à travers lesquelles s'affirma l'idée traditionnelle selon laquelle c'est le sens de l'honneur ou de la honte – non de petites mesures, tirées de petites morales – qui crée une différence substantielle, existentielle, entre les êtres, à peu près comme entre une race et une autre race ».
Répondant à ma tristesse stoïque de savoir ou de deviner que tous mes amis nippons de jadis étaient morts en Chine ou dans l'océan Pacifique, Y. Mishima ne me dissimulait point sa vergogne – lui, né en 1925 – de n'avoir pu mourir en volontaire imberbe, mais de corps jugé trop frêle. Par la suite, et de temps en temps, ces échanges de pensées se renouvelèrent en expressions de dégoût et de mélancolie réciproques. Puis, comme il arrive non rarement, un silence s'établit, né de la tranquillité d'une volonté de totale ataraxie. À un certain degré d'affinités, les esprits n'ont plus que faire du langage et de l'écriture. Ils se pensent. Il leur suffit, à la manière de l'admirable remarque de Henry de Montherlant : « Il pense en nous, comme il neige sur la campagne ».
Devant une tête tranchée
[Ci-contre : les têtes tranchées de Mishima et de Masakatsu Morita, sur le plancher du bureau du général Kanetoshi Masuda. (photos Yomiuri-Shimbun et Asahi-Shimbun)]
 Voici un portrait de Yukio Mishima, à sa table basse, en son étroite bibliothèque, orné de la traduction japonaise d'un tanka que je lui avais jadis envoyé et dont il raffolait hyperboliquement :
Voici un portrait de Yukio Mishima, à sa table basse, en son étroite bibliothèque, orné de la traduction japonaise d'un tanka que je lui avais jadis envoyé et dont il raffolait hyperboliquement :
Mon âme postule.
« Qu'est le Nirvâna ? », dit-elle.
– Une libellule, immobile, à tire-d'aile,
dans l'air que le soleil brûle.
Voici un portrait, encore, de Yukio Mishima, dramaturge et cinéaste, acteur même, interprétant, noblement nu et comme transverbéré de 3 longues flèches, l'extase sans extase de saint-Sébastien. Mais voici le dernier visage.
Voici la photographie du hara-kiri ou seppuku (5) de Y. Mishima : sur un tapis de sang, où se reflète la lumière de quelques hautes baies, la noble tête tranchée, comme d'une statue – posée sur la joue, avec les yeux pleins d'ailleurs : car ils voient enfin. Il y a cette tête et il y a une autre tête, et puis tout ce qui est invisible : les corps accroupis, décapités par la volée miséricordieuse du sabre d'un disciple d'arme, avec les 2 mains encore crispées sur la bande de toile, bien serrée autour de l'extrémité de la longue lame, en un dernier effort vers la droite – et avec le déversement des entrailles jaunes et bleutées, au milieu des rigoles de sang déjà noir.
Il suffit de regarder pour comprendre qu'une telle volonté de disposer de sa propre vie, qu'une telle “césarienne” de l'âme, ne peuvent être inspirées, ni perpétrées, que par un désir furieusement spirituel de devenir un exemple sacramentel : non en secret, dans le clos d'une maison aux cloisons translucides – mais au sommet de la colline d'Ichigaya, là même où Y. Mishima, à l'âge de 23 ans, entendit sûrement la lecture du verdict de l'interminable procès de Tôkyô, dont l'Amérique ne publia jamais les 2 années de sténographie et qui n'est raconté, chez les vaincus – là-bas dénommés “héros infortunés” – que par le Révérendissime Shinshô Hanayama, leur aumônier, dans La voie de l'éternité.
Je regarde encore une fois cette photographie de “police scientifique”, je la tourne doucement en tous sens et, encore une fois, me reviennent, d'abord, cette pensée de Confucius : « Ce n'est point la vérité qui fait la grandeur de l'homme, c'est l'homme qui fait la grandeur de la vérité » – et puis ces mots de Friedrich Nietzsche : « De tout ce qui fut écrit, j'aime seulement ce qui le fut avec le sang. Écris avec ton sang : tu sauras que le sang est esprit ».
Serait-il donc vrai que les plus purs, les plus décidés à mourir pour leur idée d'une vie, parfaite comme un globe, ne doivent plus mourir que de leur patrie ? Serait-ce qu'une note de Henry de Montherlant, dès 1935, était une étrange prophétie, passée inaperçue, mais désormais implacablement réalisée : « S'il ne se fait pas un retournement héroïque, nous allons voir disparaître en Europe les valeurs nobles, sous la haine et la coalition unanime de la médiocrité et de la bassesse. Les hommes du bushidô sont les vaincus et les persécutés de demain ».
Voici les images de vie et de mort de Y. Mishima. Depuis lors, son “corps glorieux” continue à hanter les cœurs fidèles et à préoccuper les consciences infidèles. S'il choisit cette fin, accomplit l'œuvre d'art d'une telle mort, comme pour s'excuser de ne pouvoir donner davantage et pour avertir les aveugles et les sourds avec l'offertoire de sa certitude, Y. Mishima, écrivain et puis légionnaire, s'est fait 2 fois immortel : par son œuvre et par son trépas inimitable, mais aussi par une révolte du devoir, qui peut s'enraciner en toutes bonnes terres. Depuis lors, c'est cette loi d'éveil, que ressentent ceux qui savent penser calmement et patiemment à lui : comme il le voulut et comme il le veut.
XXV Novembre MCMLXX
25 novembre 1970, vers 11 heures du matin : avec 4 disciples de la “Secte des Boucliers” (6), Y. Mishima entre à vive force, de taille et d'estoc, dans la Japan Defense Agency, seule dénomination permise et tolérée par l'américanisme des 4 Libertés, de ce qui fut le ministère impérial de la Guerre. Les 5 messagers de l'Éternité font irruption dans le bureau du lieutenant-général Kanetoshi Masuda, alors chef d'état-major des forces terrestres d'“autodéfense”, qui, avant d'avoir le temps de comprendre, se trouve diligemment ligoté sur son fauteuil avec les cordons des rideaux. Puis Y. Mishima ouvre à 2 battants la fenêtre du balcon. Ganté de blanc, sanglé dans l'uniforme rouge d'une Garde impériale idéale, la tête ceinte de l'ashimaki des “kamikazés”, orné du soleil rouge et de 4 idéogrammes qui signifient “Sept vies pour servir la Patrie”, il s'avance, déroule 2 proclamations calligraphiées à la main, puis se met à haranguer une foule éberluée d'officiers, de soldats et de fonctionnaires, entassés dans la grande cour intérieure du vaste édifice.
Ayant parlé, Yukio Mishima disparaît pour toujours.
S'étant incliné devant le chef d'une armée de fantômes, cent fois vainqueurs et une fois vaincus, il s'agenouille posément, désangle l'uniforme, entoure d'une bande de lin la lame affilée d'un sabre, l'empoigne, l'empoigne à 2 mains, et puis, sans un mot, sans un cri, sans une grimace, s'éventre petit à petit, en diagonale, de gauche à droite. Alors son disciple, le jeune Mazakatsu Morita, le décapite d'un seul coup et la belle tête roule au plancher dans un jet de sang. Aussitôt, M. Morita se met à genoux et accomplit, lui aussi, le seppuku. C'est alors que le troisième témoin lui tranche pareillement le chef. Ce dernier s'agenouille déjà pour s'éventrer rituellement, lorsque la porte verrouillée éclate sous les coups d'épaules des vivants, qui sont vraiment de l'autre monde.
Ainsi s'accomplit le rite de l'ultima ratio, tel qu'il se trouve minutieusement raconté – jusqu'à la beauté insupportable de l'impassibilité – dans le conte intitulé Le très déplorable pays, admirable histoire d'amour et de mort, reconduisant au temps que les Japonais surnommèrent l'époque du kurai tanima ou de la “vallée obscure”, laquelle culmina avec une rébellion militaire de jeunes capitaines, au milieu d'une tempête de neige, à l'aube du 27 février 1936, et s'acheva avec le massacre domiciliaire de la plupart des ministres, accusés d'appartenir au “parti de l'étranger” (7). En ces pages, Y. Mishima raconte comment le lieutenant Shinji Takayama décida de faire hara-kiri, « indigné par son inéluctable certitude de voir des régiments impériaux ouvrir le feu contre d'autres régiments impériaux », et préférant mourir de sa main pour échapper à un tel déshonneur. Or c'est dans cette minutieuse et envoûtante analyse des dernières heures du jeune officier – sa femme le secondera jusqu'au bout, avant de se trancher la gorge – qu'il faut découvrir la “profession de foi”, lentement méditée, de Y. Mishima. Il suffit de lire :
« Il eut la sensation que sa maison se dressait comme une île solitaire dans l'océan d'une société qui, comme toujours, progressait sans trêve en ses entreprises. Tout à l'entour, grand et désordonné, s'étendait le pays qui lui causait tant de chagrin. Il était sur le point de lui donner sa vie. Mais allait-il être capable, ce grand pays, contre lequel il était prêt à protester jusqu'à la destruction de lui-même, de prêter la moindre attention à sa mort ? Il ne le savait pas, mais ceci n'avait nulle importance. Son champ de bataille était sevré de gloire, champ de bataille où personne ne pouvait accomplir des actes de valeur, car il était la ligne du front de l'esprit ».
Le livre d’un destin
[Ci-contre : un combat médiéval, Le Cheval noir de Kay Neilsen (1914). Europe et Japon ont des institions étrangement proches : « Comme notre chevalerie, la caste militaire, véritable colonne marchante du régime, avait un code de l'honneur qui exaltait le courage, la loyauté et un esprit de sacrifice allant jusqu'au suicide », Robert Boutruche, Seigneurie et féodalité, Aubier-Montaigne, 1959]
 La “ligne du front de l'esprit” : définition nécessaire et suffisante – comme disent bien les mathématiciens – qui rejoint l'axiome maurrassien selon lequel « la beauté achevée est au terme des choses » et le postulat d'Ernst Jünger, selon lequel « ce n'est pas dans nos œuvres que vit la part impérissable de nous-mêmes ».
La “ligne du front de l'esprit” : définition nécessaire et suffisante – comme disent bien les mathématiciens – qui rejoint l'axiome maurrassien selon lequel « la beauté achevée est au terme des choses » et le postulat d'Ernst Jünger, selon lequel « ce n'est pas dans nos œuvres que vit la part impérissable de nous-mêmes ».
La “ligne du front de l'esprit” : celle des mages et des chevaliers, pour ceux qui savent entendre ces paroles philosophales, le Syllabus qui ne tolère démentis, ni reniements – cette ligne dont tant de jeunes gens, bonnes et belles têtes de l'an Deux Mille, ont redécouvert, tous seuls, la signification transcendante dans les ténèbres de cette seconde moitié d'un siècle maudit, tant il est vrai, comme l'écrivit un vieux chroniqueur des Gaules, qu'« il n'est pas plus possible de cacher la vérité que de mettre le soleil en un trou ».
La “ligne du front de l'esprit” : celle que symbolise, d'abord, cette maxime de 6 mots japonais : hana wa sakura, hito wa bushi, selon laquelle « de même que la fleur du cerisier est la fleur sublime, de même l'homme par excellence est le chevalier » – et puis cette autre maxime de 5 mots : chitté koso, sakura nari kéré, qu'il sied de dérouler ainsi : « De même qu'au moindre souffle de la brise printanière, la fleur du cerisier, après une brève existence, tombe dans la plénitude de sa splendeur, de même le chevalier est prêt, à chaque instant, à sacrifier sa vie sans le moindre regret ».
La “ligne du front de l'esprit” : celle qui se trouve en “terre de personne”, outre la première tranchée ; celle contre qui ne valent ni les lois, écrites pour plaire aux pires instincts de la plèbe, ni les balles ; celle qui, le 13 mai 1969, inspira à Y. Mishima, bravant le silence d'un auditoire d'étudiants contestataires, ce cri dont l'écho aurait pu devenir un cri de ralliement : « Au nom du passé, à bas l'avenir ! ».
Or cette “ligne du front de l'esprit” se trouve paraphrasée en toute sa signification dans un autre texte de Y. Mishima, texte qui ne sera, sans doute, jamais traduit intégralement et qui se trouve greffé en forme de préface dans une œuvre d'extrême singularité, comme écrit entre porcelaine et émail noir d'un vase impalpable – entre le Yûgen, la nuit subtile du Taô –, et le Yujô, qui est l'indéfinissable surplus, enseignant que toutes les choses, dont l'homme s'approche, perdent leur signification et lui échappent avec leur essence, dès qu'il croit les faire siennes.
Ce texte est donc la préface que Y. Mishima écrivit pour le Hagakuré de Jocho Yamamoto, livre de jadis et d'aujourd'hui, qui n'est pas une œuvre littéraire et qui, ayant été composé au plaisir du pinceau, peut être ouvert au hasard et lu avec un plaisir identique, bien qu'il soit uniquement le Livre de la Mort.
Y. Mishima prélude en déclarant que, depuis la fin de la guerre, ce livre est le seul qu'il ait toujours gardé à portée de la main, de jour comme de nuit : parce qu'il fut le bréviaire de ceux de son âge qui disparurent dans le brasier d'une fidélité innée ; parce qu'il fut ensuite condamné à l'oubli ; parce qu'enfin, répondant à toutes les questions qu'il se posait en grande solitude, ce livre devint pour lui « la première lumière dans les ténèbres de l'époque » et vers la vingt-troisième année de son âge : celle qui convient pour honorer les serments secrets de tous les cœurs bien-nés ; celle des volontés d'altitude, jugées vitales par des prédestinés dont le cœur est à droite comme celui des oiseaux, et d'abord des aiglons ; celle où le désespoir de perfection ne semble laisser d'autre honorable issue, par dégoût du monde natal, que dans l'espoir de quelque mort parfaite.
Pourquoi ? Point de réponse n'existe. Existe seulement le fait que des livres, lus à la bonne heure, plus que souvent à l'insu des familles – comme le dantesque De Monarchia ou Le Prince de Machiavel, ou l'Anthinéa de Charles Maurras, ou Les Olympiques de Henry de Montherlant – peuvent décider de l'abondance encore inconnue d'un esprit hésitant devant plusieurs voies imaginaires, pareillement ardues et rectilignes, évidentes et mystérieuses comme le cri profond de ces admirables vers :
Essence pire que le Pire,
Et meilleure que le Meilleur,
Quelle est la langue qui peut dire
Les deux abîmes de ton cœur ?
Y. Mishima fut fasciné par le Hagakuré de Jocho Yamamoto, pour y avoir découvert ces définitions préliminaires : « Le Bushidô, c'est la mort. Si deux chemins se présentent, il est préférable de choisir celui où l'on mourra le plus vite ». Car tout le livre est l'apologie multiforme de ce précepte. Exactement comme il se lit au début du Livre de l'Ordre qui est de la Chevalerie, composé vers l'an 1275 par le bienheureux Ramon Llull, lorsque, à Tashiro Tsuramoto, venu pour être instruit des devoirs de tout honorable et honoré samouraï, Tsunotomo répond à voix lente : « Quelqu'un pourra se demander : pourquoi devrais-je mourir, lorsqu'il n'y existe nul avantage ? Pourquoi devrais-je dilapider ma vie pour rien ? Cette façon de raisonner est fréquente : il est commun, parmi les hommes, d'en trouver qui se croient importants. Que l'idée du succès ne trouble pas ton esprit, lorsqu'il s'agit d'un choix. Pense à l'infortune de l'homme qui a manqué le but et qui doit vivre encore ! ».
Feuilleter ce livre, c'est comme relire Le chevalier au cygne, Le roman d'Alexandre, et Huon de Méry, et Jehan des Prées, et glaner à foison ces règles d'une Chevalerie qui fut primordialement universelle, commune à toutes les “races de l'esprit”, puisque le royaume de l'Esprit n'est pas plus lié par l'espace que par le temps :
« Sois chiche de paroles. Au lieu d'articuler une dizaine de mots, n'en prononce qu'un seul. Lorsque l'on parle habilement, même un seul mot est suffisant pour démontrer ta valeur et ton courage, en temps de paix comme en temps de guerre. Le lâche se trahit avec un seul mot. Souviens-toi qu'une seule parole en vaut souvent une centaine.
« Notre éducation ne connaît pas de fin. Lorsque quelqu'un se croit devenu un maître, il ne va guère plus loin sur la route qu'il doit suivre. Celui qui veut arriver en haut doit reconnaître qu'il n'est jamais assez en-haut. Seulement ceux qui se proposent d'arriver toujours plus haut, et jusqu'au dernier instant de leur vie, seront considérés par la postérité comme des hommes de perfection.
« Reste immobile en ton propos, même si le Bouddha lui-même, Confucius ou la première déité de l'Empire, s'avançait vers toi pour te flatter. Sois prêt à descendre aux Enfers et à endurer, au besoin, la malédiction de Dieu. Pour toi, n'existe qu'une seule voie à suivre. Seuls les esprits les plus résolus et les plus inébranlables trouveront la faveur de Dieu.
« Vivez chaque jour comme si vous vous trouviez sur le champ de bataille. Celui qui ne peut vivre comme un soldat dans sa maison, celui-ci ne pourra que difficilement se comporter comme un vrai soldat sur le champ de bataille.
« Lorsque tu te trouveras sur le champ de bataille, ferme ton esprit au surplus des raisonnements, car, dès que tu commences à ratiociner, tu es perdu. Trop épiloguer te prive de la force avec laquelle tu peux t'ouvrir la voie qui te conduit au but. Il existe des personnes qui savent tourner de belles phrases, mais plus d'une perdent la tête dans les moments suprêmes. Celui à qui manque l'âme au dernier moment, celui-ci n'est pas courageux ».
Telles furent, par la découverte de tels commandements, les raisons de la fascination, goûtée par Y. Mishima dans le désert de sa majorité, raisons toujours résumées par le postulat préliminaire : « Le Bushidô, c'est la mort. Si deux chemins se présentent, il est préférable de choisir celui où l'on mourra le plus vite ». Qu'est donc le Bushidô ? Par les mots dô et bushi, il est le petit poème des 17 points constituant les “Préceptes du chevalier”, en sorte que le Bushidô est la “Voie du chevalier”, découverte au XIIe siècle, durant l'époque de Kamakura, parvenue à sa totale floraison à l'époque des Tokugawas, et puis brusquement définie, à l'aube de ce siècle, par le général Nogi, le vainqueur de Port-Arthur (8) :
« Il est ce que nos parents nous ont enseigné, avec grand soin, jour et nuit, depuis l'âge de 4 ou 5 ans, c'est-à-dire lorsque nous commencions à avoir quelque connaissance des choses qui nous entourent. Je ne saurais comment le définir diversement, sinon en cherchant à mettre en pratique, non en discussion, les principes de loyauté, de piété filiale, de rectitude et de courage. En d'autres termes, le Bushidô veut dire esprit raffiné et parfaite conduite, toutes choses qui, dès les temps les plus anciens, furent, ou auraient dû être, en grand honneur parmi tous les samouraïs ».
À cette définition exotérique et morale répond la signification ésotérique du Bushidô, qui, par le Zen, enseigne à “aller droit”, à oublier l'ego dans son unité avec la vie, à ne considérer la vie et la mort qu'à la façon d'aspects de l'existence même, et à “marcher sans se retourner pour regarder”, par étrange ressemblance avec le conseil léonardien : Non si volta chi a stella è fisso. Fondé sur le devoir sans terme et sans récompense, sur la fidélité hiérarchique, sur le courage et sur l'état de muga, qui est la volonté de n'avoir conscience de ce que l'on fait, cette règle chevaleresque est contenue, comme il a été dit, en 17 points, dont il n'est pas impossible de proposer enfin une honnête traduction et qu'il sera décent de lire en se souvenant que l'encens, offert à la Divinité, servait aussi – là-bas et au temps d'alors – à parfumer les casques des guerriers, afin de leur permettre de tomber avec élégance :
« Je n'ai de parents : Ciel et Terre sont mes parents.
« Je n'ai de pouvoir divin : la loyauté est mon pouvoir.
« Je n'ai de moyens : l'obéissance est mon moyen.
« Je n'ai de pouvoir magique : la force intérieure est ma magie.
« Je n'ai de vie, ni de mort : l'Éternel est ma vie et ma mort.
« Je n'ai de corps : la force est mon corps.
« Je n'ai d'yeux : mes yeux sont la lumière de l'éclair.
« Je n'ai d'oreilles : mes oreilles sont la sensibilité.
« Je n'ai de membres : mes membres sont la promptitude.
« Je n'ai de desseins : mes desseins sont l'occasion.
« Je n'ai de miracles : mes miracles sont la Loi (9).
« Je n'ai de principes : mes principes sont l'adaptation.
« Je n'ai d'amis : mes amis sont mon esprit.
« Je n'ai d'ennemis : mes ennemis sont l'imprudence.
« Je n'ai de cuirasse : bonne volonté et rectitude sont ma cuirasse.
« Je n'ai de château : l'esprit inébranlable est mon château.
« Je n'ai de sabre : le sommeil de l'esprit est mon sabre ».
C'est donc grâce à cette seule et unique doctrine, plusieurs fois centenaire, que Y. Mishima voulut être l'homme de son œuvre, et c'est grâce à sa préface, écrite à la gloire de l'Hagakuré, qu'il nous est possible d'entrevoir le secret de sa vie et de sa mort. Lui-même, d'ailleurs, nous interdit d'en douter. « L'Hagakuré, écrit-il, est le père de ma littérature. Je vis l'Hagakuré. Vivant en sûreté sur le chemin des arts, grâce à l'Hagakuré, j'ai été contraint assez fréquemment de me tourmenter avec le contraste existant entre ma morale d'action et les arts. Le doute que je nourris depuis longtemps en moi est que, dans la littérature, se cache quelque chose de vil. Par l'Hagakuré, je commence à avoir fortement besoin de l'idée des “deux chemins” : les lettres ou les vertus militaires ». Puis, soudain, cette fulguration prémonitrice : « Pour l'accomplissement de la discipline et pour le perfectionnement de l'homme selon l'Hagakuré, il me semble que n'existe point de grande différence entre la mort naturelle, la mort sur le champ de bataille ou le hara-kiri. L'action, attendue par l'homme d'action, n'est nullement ce qui atténue la règle, selon laquelle l'homme doit résister au “temps” ». Traduit ici pour la première fois, ce texte suffit pour mettre en juste lumière la tête tranchée de celui qui les écrivit. Tout le reste est silence.
Une leçon d’éveil
Afin que soit encore plus fortement connue la pensée d'un si grand sacrifié et afin que soit reconnu le chemin fatal d'un tel esprit, une halte révérente peut être ici, le bon motif d'élever à sa mémoire un petit monument mental avec une simple chrestomathie de cette préface. Il nous suffira donc de feuilleter les premières pages de l'Hagakuré, dont un éditeur japonais a su faire un “livre de poche”, en vérité assez divers des nôtres du même genre (10). Plus d'un esprit d'Occident y trouvera des braises réconfortantes :
« L'énergie, c'est le bien. L'inertie, c'est le mal.
« De la bravoure : être arrogant au point d'être disposé à mourir désespéré.
« Mourir d'amour en souffrant toute la vie : là doit être la vraie signification de l'amour. L'essence de l'amour devrait être l'amour souffrant, non partagé.
« Le monde d'un homme d'action est d'imaginer qu'il a toujours sous les yeux un cercle inachevé, mais qui sera achevé par l'adjonction d'un dernier point. À chaque instant, il envisage d'autres cercles, en abandonnant un cercle inachevé, où il laisse la place d'un point final. Le monde des artistes et des philosophes possède la nature d'une accumulation de cercles concentriques toujours plus grands. Mais, lorsque la mort surviendra, qui sera le plus fort ? L'homme d'action ou l'artiste ?
« Le plus grand malheur de l'homme d'action, c'est de ne point mourir, même après avoir ajouté un juste dernier point.
« Ayant obtenu la liberté paradoxale, l'homme finit par ne savoir qu'en faire, tout comme, ayant la vie, il finit par en éprouver de l'ennui.
« L'époque contemporaine est une époque où toutes les prémisses se trouvent contenues dans le fait de vivre. La vie moyenne s'étant accrue en des proportions jamais atteintes, s'allongent devant nous les perspectives d'une existence monotone. À l'étape où la jeunesse s'efforce de trouver son petit nid, selon la doctrine my home, il y a encore de l'espoir, mais, le nid une fois trouvé, il n'y a plus rien pour l'avenir : rien que la somme de la pension, calculée avec les boules de l'abaque, et la vie tranquille de la vieillesse, où nul ne peut plus travailler.
« Unique prémisse de la démocratie : la survivance.
« Dans la société contemporaine, on oublie toujours la signification de la mort.
« Avoir la mort quotidiennement dans le cœur est comme avoir la vie quotidiennement dans le cœur. Lorsque nous sommes à l'œuvre et lorsque nous pensons que nous mourrons aujourd'hui, c'est alors que notre travail acquiert des lueurs d'éclairs.
« On a oublié que l'un des éléments les plus importants de l'hygiène morale est de faire affleurer la mort à la surface de la conscience.
« Les idées rationalistes, avec leur fonction de toujours faire se lever les yeux des hommes vers la liberté et vers le progrès, et ceci en ôtant le problème de la mort humaine de la surface de la conscience, conduisent, étape après étape, et toujours plus profondément, dans les ténèbres de la subconscience, transformant l'impulsion de la mort en quelque chose de dangereux et d'explosif.
« Le christianisme prit d'assaut Rome et s'y développa parce qu'il y trouva l'impulsion de la mort.
« À l'époque de la Pax Romana, dans toute l'Europe, l’hégémonie romaine, parvenue jusqu'en Asie, jouissait d'une paix durable. Mais seuls, les gardiens des frontières se trouvaient à l'abri d'un ennui qui avait tout imprégné. Seuls, les gardiens des frontières savaient pour quoi il leur était possible de mourir ».
D'autres citations, mais d'un ordre plus difficile sans un commentaire approprié, pourraient enrichir ce florilège, qui donne à suffisance la juste orientation pour connaître et reconnaître la forma mentis de Y. Mishima : son choix entre l'Étoile Polaire et les comètes populaires, et ce “beau désespoir” au nom duquel il voulut à la fois mourir de sa patrie et pour sa patrie puisqu'il en avait une. Il est alors instructif de citer ce que Messire Shintaro Ishihara, sénateur du Parti libéral démocrate nippon écrivit pour présenter la préface de Y. Mishima en l'honneur de l'Hagakuré :
« Au cours de cette époque de décadence, trop d'hommes se délectent à consumer voluptueusement leur vie, sans s'armer pour autant. Ils abandonnent ainsi la dignité et la fierté humaines à la déchéance et à la concupiscence et, ne réfléchissant point sur eux-mêmes, se laissent perdre en tant que chevaliers. Mais voici un homme, voici un guerrier, qui, construisant le château de sa conscience et n'ayant que lui pour centre, s'étend, non sans paradoxe et claire ironie, sur le lit de l'esthétique, avec le tranchant d'un sabre à sa droite. Voici un chevalier, surprenant en ses métamorphoses, qui, au mitan de cette époque de désordre spirituel, mais surprenante malgré tout, tantôt se revêt de l'armure aux sept couleurs mouchetée d'or, et tantôt se montre nu comme ver. Le sabre qu'il tient toujours, sans jamais le lâcher, est ce lui : l'Hagakuré ».
Tel est le sens pur, tantôt scintillant, tantôt voilé – illustré de textes traduits ici pour la première fois – de ce que les commentateurs à la mode appelleraient le “message” de Y. Mishima, mais ce que les Survivants, citoyens de l'unique patrie de l'Idée, où n'existent ni droite ni gauche, se contentent de dénommer fraternellement l'espérance désespérée, non d'un patriote – affreux vocable ! – mais d'un chevalier du Soleil levant et d'une nation qui étonnera, demain, le monde par quelque solennelle réponse de la Nature des choses aux sectateurs de la vieille Bête apocalyptique, « assise et regardant la mer ».
Il y a, parmi les Tao tö king, une tablette mystérieuse où se trouve calligraphié : « Mourir sans périr, telle est la longévité », et qui pourrait être la devise de ce parti unique, celui de l'espérance désespérée, en qui maints jeunes cœurs, n'ayant rien connu de ce que vécurent usque ad sanguinem leurs aînés, devraient trouver des raisons d'être et découvrir – surtout – des disciplines pour la seule revanche qui compte : celle de l'Esprit. Car ils verront la fin d'un siècle, qui ne fut qu'un siècle de révolutions et d'exterminations au seul profit des déicides, siècle dont il n'importe même plus de savoir ce qui demeurera de lui et de ceux qui en furent les héros et les usurpateurs, confondus dans la même nuit.
En mémoire de peu d'exemples et de quelques immortels qui, avec leur sang, parvinrent à écrire : “J'ai ce que j'ai donné” sur le mur d'impasse de leur vie et de leur mort, ces jeunes cœurs se souviendront que l'honneur est d'atteindre des régions de pensée qui se trouvent au-delà des facultés de l'expression verbale – et qu'il importe de se libérer de l'encombrement des mots, de s'exprimer par intuitions aussi brèves que l'éclair au but, de s'en tenir au moment absolu, seul moyen de s'affranchir des concepts et des nuées intermédiaires qui ne conduisent qu'au labyrinthe des contradictions. Car c'est ainsi qu'ils atteindront, une fois et pour toujours, l'éveil, seuil de toute éternité concevable.
► Pierre Pascal, Nouvelle École n°28, 1976.
◘ Notes :
(1) Il s'agit du Livre secret de Gabriel d'Annunzio et de Donatella Cross, dont ne fut jamais publié que le premier tome, en 1946.
(2) Cette traduction de Y. Mishima fut signalée par quelques journalistes, lesquels ne manquèrent point de spécifier qu'elle avait été faite d'après la traduction... française – non sans ajouter qu'« une tendance décadente, mystique et héroïque, avait toujours émergé de la personnalité de Yukio Mishima ».
(3) Le Sendai kujihongi (Relation sur l'origine des antiques événements des générations précédentes), œuvre de Soga-no-Umako, date de l'an 622 de notre ère. Le Nihongi ou Nihon-shoki (Annales du Japon) fut divulgué en l'an 720.
(4) Transcription des idéogrammes en lettres latines, selon les règles bien connues des nippologues.
(5) Le mot harakiri est rarement utilisé par les Japonais, qui lui préfèrent le terme seppuku, lecture chinoise des mêmes idéogrammes. Le vocable contient la racine hara, “ventre”. L'Orient extrême croit en effet que le ventre est le siège de l'équilibre et de l'âme, puisque le nombril (omphalos) est à la fois le centre de gravité et le centre géométrique de l'homme (comme le démontre un fameux dessin de Léonard de Vinci).
(6) En japonais, Taté-no-kai. Le taté était un grand bouclier de bois, recouvert de cuir, que l'archer plantait devant lui, avant le tir.
(7) Cette mémorable «purge» a été remarquablement évoquée et minutieusement reconstituée par l'historien américain William Craig, dans son livre The Fall of Japan.
(8) Lorsque mourut l'empereur Meiji, lé 13 décembre 1912, le général Nogi et son épouse choisirent le suicide rituel. La maison du vainqueur de Port-Arthur – qui, durant cette terrible bataille, perdit ses 2 fils – existe encore à Tôkyô, où elle a échappé aux bombardements au phosphoré de la Seconde Guerre mondiale.
(9) Par le mot “Loi”, il faut entendre le Dharma. À ce propos, il est difficile de découvrir si Y. Mishima appartint à quelque école de la tradition japonaise, malgré la force, enseignée et vécue, avec laquelle il sut détruire toute distinction entre le Moi, la Vie et la Mort. Toutefois, il existe, dans la préface de l'Hagakuré, cette indication intéressante : « Nous avons appris de l'Occident toutes les philosophies de la vie, mais nous ne pouvons nous contenter seulement d'une telle philosophie, pas plus que nous ne pouvons nous familiariser avec une philosophie souillée d'une faute répugnante, comme celle de l'éternel retour selon l'imagerie bouddhique ».
(10) Ce livre a été publié en 1967 par les éditions Kobunsha (coll. Kappa Books). Nous devons de l'avoir connu à notre ami Messire Atsuya Suzuki, qui était alors consul du Japon à Saïgon.
 ♦ L'auteur : Fils de Paul Pascal (1880-1968), membre de la section de chimie de l'Académie des sciences, M Pierre Pascal (1909-1990), écrivain, poète et traducteur français ayant longtemps vécu à Rome après-guerre, a été le premier traducteur en vers français des poèmes de Michelangelo Buonarrotti, (Les Sonnets De Michel-Ange Buonarroti, Jacques Haumont, Paris, 1942) Emily Brontë et Edgar Allan Poe. Orientaliste, parlant couramment 5 langues (italien, anglais, persan, russe et japonais), il a fait paraître des textes de Babâ Tahîr Uryân et Abû Sa'id, et de nouvelles éditions des Robâ'iyyât d'Omar Khayyâm, de l'Apocalypse (Apocalypsis Iesu Xristi) et du livre de Job (éd. du Cœur fidèle, Rome). Seul membre européen de l'Académie impériale japonaise “La Forêt des Pinceaux”, il a composé, selon les règles de la métrique japonaise, un recueil de poésies (haïkus et tankas) en langue française : Le nectar du dragon. Il pratique aussi l'art chevaleresque du tir à l'arc, inspiré du bouddhisme zen. On lui doit de nombreux travaux, encore inédits, sur Edgar Allan Poe ; parmi ces rares parutions notons : Éloge perpétuel de la Sibylle d'Érythrée et de César Auguste fondateur de l'Empire (Trident, Paris, 1938), Poëmes (Mercure de France, 1942), un poème de 6.000 vers, le Discours contre les abominations de la nouvelle Église (éd. du Baucans, Belgique, 1976), un recueil de textes, Gouttes de rosée sur un sabre nu, ainsi qu'une traduction nouvelle du Corbeau de Poe (La Guilde Du Livre, 1949) accompagnée d'une interprétation ésotérique. Collaborateur de Charles Maurras pendant quelque 25 ans (voir son livre-hommage Maurras, Chiré, coll. du Cœur Fidèle, 1986 ; cf. aussi Lecture & Tradition n°130, 1987), M. Pierre Pascal a été également l'un des familiers de René Guénon et de Julius Evola. Ancien éditeur des cahiers de poésie Eurydice, il a traduit plusieurs livres d'Evola (Révolte contre le monde moderne, La doctrine de l'éveil, Masques et visages du spiritualisme contemporain), ainsi que l'ouvrage du prêtre bouddhiste Shinshô Hanayama, La voix de l'éternité (Guy Le Prat, 1972). Notons enfin, en regard de calomnies après-guerre propres au milieux littéraires parisianistes, que l'arrestation du poète surréaliste Robert Desnos en février 1944 par la Gestapo ne peut en rien être imputée à la polémique picrocholine ayant envenimé, malgré l'intercession de Jean Paulhan, entre ce dernier et P. Pascal, alors rédacteur en chef de la revue L'Appel, au prétexte de sa traduction de Poe : elle le doit non à son activité de journaliste résistant restée discrète (Desnos n'ayant jamais été communiste) mais à ses écrits désespérés désignant à la vindicte le régime de Vichy, ce dont témoignent les archives de son arrestation.
♦ L'auteur : Fils de Paul Pascal (1880-1968), membre de la section de chimie de l'Académie des sciences, M Pierre Pascal (1909-1990), écrivain, poète et traducteur français ayant longtemps vécu à Rome après-guerre, a été le premier traducteur en vers français des poèmes de Michelangelo Buonarrotti, (Les Sonnets De Michel-Ange Buonarroti, Jacques Haumont, Paris, 1942) Emily Brontë et Edgar Allan Poe. Orientaliste, parlant couramment 5 langues (italien, anglais, persan, russe et japonais), il a fait paraître des textes de Babâ Tahîr Uryân et Abû Sa'id, et de nouvelles éditions des Robâ'iyyât d'Omar Khayyâm, de l'Apocalypse (Apocalypsis Iesu Xristi) et du livre de Job (éd. du Cœur fidèle, Rome). Seul membre européen de l'Académie impériale japonaise “La Forêt des Pinceaux”, il a composé, selon les règles de la métrique japonaise, un recueil de poésies (haïkus et tankas) en langue française : Le nectar du dragon. Il pratique aussi l'art chevaleresque du tir à l'arc, inspiré du bouddhisme zen. On lui doit de nombreux travaux, encore inédits, sur Edgar Allan Poe ; parmi ces rares parutions notons : Éloge perpétuel de la Sibylle d'Érythrée et de César Auguste fondateur de l'Empire (Trident, Paris, 1938), Poëmes (Mercure de France, 1942), un poème de 6.000 vers, le Discours contre les abominations de la nouvelle Église (éd. du Baucans, Belgique, 1976), un recueil de textes, Gouttes de rosée sur un sabre nu, ainsi qu'une traduction nouvelle du Corbeau de Poe (La Guilde Du Livre, 1949) accompagnée d'une interprétation ésotérique. Collaborateur de Charles Maurras pendant quelque 25 ans (voir son livre-hommage Maurras, Chiré, coll. du Cœur Fidèle, 1986 ; cf. aussi Lecture & Tradition n°130, 1987), M. Pierre Pascal a été également l'un des familiers de René Guénon et de Julius Evola. Ancien éditeur des cahiers de poésie Eurydice, il a traduit plusieurs livres d'Evola (Révolte contre le monde moderne, La doctrine de l'éveil, Masques et visages du spiritualisme contemporain), ainsi que l'ouvrage du prêtre bouddhiste Shinshô Hanayama, La voix de l'éternité (Guy Le Prat, 1972). Notons enfin, en regard de calomnies après-guerre propres au milieux littéraires parisianistes, que l'arrestation du poète surréaliste Robert Desnos en février 1944 par la Gestapo ne peut en rien être imputée à la polémique picrocholine ayant envenimé, malgré l'intercession de Jean Paulhan, entre ce dernier et P. Pascal, alors rédacteur en chef de la revue L'Appel, au prétexte de sa traduction de Poe : elle le doit non à son activité de journaliste résistant restée discrète (Desnos n'ayant jamais été communiste) mais à ses écrits désespérés désignant à la vindicte le régime de Vichy, ce dont témoignent les archives de son arrestation.

La modernité au Japon est une fiction, ou plutôt, elle l'a été. Si l'on a facilement identifié certaines caractéristiques japonaises avec le post-moderne, c'est tout simplement parce que le Japon a vécu la modernité comme une fiction. Autrement dit, ce n'est pas parce que le Japon était en avance qu'il est devenu post-moderne, mais bien au contraire, parce qu'il n'a jamais su être moderne.
Mais si la modernité signifie la possibilité du présent, dans ce cas, il doit bien y avoir modernité pour ce pays également, et peut-être à plus forte raison qu'il est resté en dehors de la modernité historique, je veux dire, occidentale. Seulement, la possibilité du présent n'est pas donnée, elle est à notre charge, à la charge de ceux qui savent qu'il y a modernité et modernité.
Cependant le problème est délicat. Dire que le Japon est resté en dehors de la modernité peut prêter à confusion. Car comment expliquer alors que le Japon soir devenu, du point de vue matériel, c'est-à-dire technologique, l'un des pays les plus modernes du monde. Mais il l'est devenu, en quelque sorte, sans le savoir. Bien sûr, les Japonais, depuis l'Ouverture de Meiji, ont tout fait pour s'approprier la technologie occidentale. Mais ce qui constituait le fondement même de celle-ci, c'est-à-dire la pensée moderne qui puise ses sources dans la découverte de l'homme qui est né de l'incroyable euphorie de la Renaissance, cette pensée qui est devenue chair et réalité à force de combats et de révoltes ensanglantés pour aboutir à la naissance de l'individu, cette pensée-là est restée étrangère au Japon. Ou pour mieux compliquer l'affaire, cette pensée, les Japonais l'ont cherchée et recherchée, faisant d'elle, en s’appropriant par ailleurs son fruit, à à savoir la technologie moderne, une fiction. Il faudrait imaginer un adolescent avide, qui tout en se nourrissant à grand grandes bouchées de technologie, se serait gavé de pensées qu'il trouvait d'autant plus vraies et importantes qu'elles ne sont que fictives pour lui, l'expérience lui faisant défaut. Un adolescent entiché de fictions, et qui peut se le permettre, puisque bien nourri physiquement à force de technologie.
Je voudrais tout d'abord introduire un document tout à fait significatif à cet égard : le symposium organisé par le magazine littéraire Bungakukai en juillet 1942, c'est-à-dire juste après le début de la guerre avec les États-Unis. Le symposium s'intitulait Le dépassement de la modernité. Inspiré par le travail de Paul Valéry à l'Institut International de Coopération Intellectuelle, ce symposium ne ne pouvait que révéler le caractère fictif de la modernité au Japon. Pour ces intellectuels réunis face à la nécessité de formuler une pensée japonaise qui puisse justifier leur position d'intellectuels imbus de culture européenne, par rapport à la guerre qui se combattait pour la cause du Grand Empire de l'Asie, il était nécessaire de voir la modernité comme un stade à dépasser. Or tous les participants, d'horizons fort divers, mêlant physicien, compositeur musical, historiens, philosophes, poètes, critiques et écrivains, les uns nettement nationalistes, d'autre beaucoup plus sceptiques, tous ces intellectuels sont d’accord sur un seul point. Ils ont tous été formés à l'école de la modernité occidentale. Les noms propres qu'ils prononcent sont Dostoïevski, Kant, Platon, Bergson, Spencer ou Francis Jammes, ils peuvent parler de la scolastique ou de Hegel en long et en large, décrire et synthétiser d'une façon cohérente l'hisroire et l'essence de la modernité. Or cette histoire et cette essence là, ils savent qu'ils en sont exclus, qu'elles ne sont pas les leurs. Le débat était condamné à n'aboutir à rien de conclusif. sinon à un sentiment de malaise inavoué. Même l'École philosophique de Kyoto, rassemblée autour de Nishida, et représentée par Nishitani Keiji lors de cette rencontre, tout en prônant l'avènement d'une nouvelle philosophie qui bouleverserait l'occidentale par une nouvelle approche, celle-ci bouddhique et orientale du sujet, ne sait que bredouiller devant le reproche qu'on lui fait d'utiliser un langage obscur, un langage étranger, dû à la traduction des termes philosophiques occidentaux. Nishitani va même jusqu'à avouer que « à dire la vérité, nous avons plutôt le sentiment d'avoir comme interlocuteurs des Occidentaux, nous voulons aller au-delà de ce que pensent les Occidentaux », et il admet implicitement que le Japon n'est pas encore prêt à devenir leur interlocuteur. La vérité que trahit Nishitani n'est autre que l'incapacité de leur philosophie à dépasser la modernité occidentale, puisqu'elle se sert de son langage, puisqu'elle n'est finalement que langage occidental pour l'Occident.
Nakamura Mitsuo, grand connaisseur de la littérature occidentale, et plus tard grand admirateur de Mishima, est beaucoup plus sceptique et conscient du problème. Il exprime son doute quant au bien-fondé du titre du symposium. Il sait que la modernité ne peut être dépassée tant que l’on est pris dans le filet de son discours. Discours, qui plus est, compris seulement en tant discours, sans l'histoire, sans la réalité qui l'a constitué, un discours, si l’on peut dire, à l’état pur. Nakamura est clair sur ce sujet, il dénonce ceux qui croient, dans la foulée de l'expansion économique, qu'ils ont dépassé la modernité. Il fait remarquer que « ce n’est déjà qu'une contradiction pleine d'ignorance que d'emprunter un concept occidental pour nier l'Occident ».
En fait, l'échec de ce symposium a pour cause l'acharnement de ces intellectuels à débattre sur la modernité dans le seul but d’établir leur identité face à l'Occident, les plus sceptiques répétant que leur connaissance de l'Occident n’est que partielle, les plus osés, se retournant vers la culture traditionnelle japonaise. Le tragique éclate lorsque l'on en arrive à parler de ces textes classiques japonais ; ces participants, ressentant une inclination intuitive pour ces textes, ne savent en parler que d'une façon bien laconique, surtout quand on pense à la volubilité tragiquement comique de ces mêmes personnes pour disserter sur l’histoire de la modernité occidentale. Bien peu de noms propres pour leurs ancêtres, à peine de l'histoire. Ils sont tous d'accord pour dire que la littérature classique du Japon n'exerce pas d'attrait sur les jeunes, qu'elle ne commence à projeter une lueur de révélation que lorsqu'on a fait un long détour du côté de Dostoïevski ou de Baudelaire. La culture traditionnelle de leur propre pays est d’avance donnée, en un bloc, pour leur délectation future et non dans la réalité de leur passé ni même de leur présent. Comme si leur propre culture n’était qu’un jardin privé, jalousement gardé contre toute pollution étrangère et que chacun va rejoindre, après un long voyage en silence.
Le contraste est frappant entre le discours littéralement inépuisable sur la modernité, sur l'Occident, et sur l'influence occidentale, d'un côté, et le bredouillement, l'embarras, voire un étrange manque d'explications, pour tout ce qui concerne la culture traditionnelle du Japon. Ces intellectuels sont tous conscients, bien qu'à des degrés différents, de la contradiction qu'ils vivent. Mais la conscience n'aide pas. La conscience elle-même est parcourue par le bavardage du discours, parce qu'elle se profile sur le silence d'un Japon originel, c'est-à-dire imaginaire, qui ne se dit pas. Ils peuvent discourir sur la modernité, ils ont une vie quotidienne modernisée, avec vêtements occidentaux, trains et électricité, mais ils savent aussi qu'ils n'ont pas acquis pour autant le droit de cité dans le discours sur le dépassement de la modernité. La contradiction s'aiguise parce qu'ils ont le sentiment de porter en eux une culture propre qui ne se laisse pas discourir. S'ils cherchent leur identité du côté de la modernité, ils ne sont plus que discours et concepts qu'ils savent être des vêtements étrangers ; mais s'ils se tournent du côté de leur jardin originel, ils perdent la parole. Ils ont été tellement fascinés par le discours, qu'ils sont arrivés à croire que ce n'est qu'un Japon qui ne se dit pas, un Japon qu'ils peuvent sentir spontanément en eux, un Japon donné d'avance à toux ceux qui sont Japonais, que ce n'est que ce Japon-là qui puisse rivaliser avec l'Occident. Et ce Japon est destiné à se taire. Ils ne peuvent vivre la modernité occidentale que comme une fiction, mais un retour inconditionnel à un Japon d'avant l'Ouverture de Meiji est tout aussi irréel. Et l'autre Japon, ce Japon qui aurait survécu à cette extraordinaire aventure de la modernisation et de la modernité, ce Japon qui suscite l'étonnement de l'écrivain Hayashi, lui aussi présent à ce symposium, « le Japon a un côté qui ne se laisse aucunement influencer par l'étranger. Et je voudrais m'étonner là-dessus », ce Japon-là « étonne » très justement, et ne se dit pas.
Alors, tous ces intellectuels déracinés se rabattent sur la modernité, ils n'arrêtent pas de discourir sur elle, de dire le décalage qu'ils sont obligés de vivre, de montrer qu'ils connaissent la vérité de la modernité, et qu'ils savent que la modernité au Japon est destinée à être fictive, comme pour mieux souligner la profondeur du silence qu'ils font sur le Japon originel. Ils fuient la réalité qui n'est autre que le décalage qu'ils vivent en tant qu'individus. Ils veulent à tout prix se ranger du côté de la vérité, en dénonçant le caractère hybride et fictif de la modernité au Japon. C'est dans ce creux de la vérité qu'ils s'abritent, creux bien étroit, puisque coincé entre la fiction d'une part, et une réalité qui n'est pas la leur. Mais ne savent-ils donc pas que retranchés qu'ils sont de la réalité de la modernité, la vérité elle-même ne peut être que la vérité du discours, une vérité fictive ?
L'inaboutissement de ce symposium est dû à ce que ces intellectuels ne peuvent ancrer leur identité que dans cette vérité du discours, et non dans la réalité. Ils oublient que l'identité est un problème de l'individu. Lorsqu'il s'agit de penser le Japon et non plus seulement de traiter de la modernité occidentale, tous ces intellectuels sont pourtant bien obligés de revenir à leur expérience individuelle : comment ils ont été éblouis et fascinés par l’Occident dans leur jeunesse. Bien qu’ils aient vécu cette fascination en tant qu’individus, ces intellectuels n’y voient qu’un perte nationale d’identité. Mais était-ce pour autant une perte d'identité individuelle ? Le tragique de ces intellectuels est qu'ils se sont identifiés au discours. Ils n'ont pas su relier leur réalité individuelle au discours qui les a fascinés. Ils se réfugient dans le discours pour ne pas assumer leur individualité, et pour nourrir le silence mystique de leur jardin secret. Le véritable étranger de ce symposium serait-il donc l'individu ? L'individu n'existait-il donc pas au Japon avant la modernité ? Nous allons voir que si.
1942. À la même époque, un autre intellectuel japonais s'occupait de la modernité, mais lui, en lui faisant face, c'est-à-dire en vivant la modernité dans sa propre réalité individuelle, sans ce soucier de discours. Et cet intellectuel, parce qu'il a su relier la modernité occidentale et la culture japonaise par ce seul point commun, c'est-à-dire la réalité de l'individu, a ouvert la voie vers une possibilité de dépassement de la modernité.
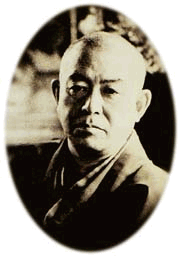 C'est en 1942 que Tanizaki commence d'écrire, Sasameyuki ou Les quatre sœurs, inspiré directement du plus grand roman classique de la littérature japonaise, Le Dit du Genji. Tanizaki, plongé dans l'écriture de ce long roman, n'a pas laissé de commentaire subjectif sur la guerre, à part un journal qu'il a tenu du jour du Nouvel an de l'année 1944 jusqu'au jour de la défaite, journal dont il sera question plus tard. À part donc ce journal, Tanizaki ne s'est compromis dans aucune discussion sur la guerre, ou la modernité à dépasser. Ou plus exactement, il est l'un des rares écrivains qui n'ont jamais vraiment discouru, ne se souciant guère de ce que les critiques et les autres écrivains le prennent pour incapable de raisonnement analytique, ce qui voulait dire, dans ce Japon obsédé par la question de la modernité, un écrivain démodé et dépassé. Mais lorsqu'on lit les pages de vivisection analytique du Journal d'un vieux fou, qui oserait croire que ce vieux romancier ait été incapable dans sa vie d'analyser objectivement et de discourir ?
C'est en 1942 que Tanizaki commence d'écrire, Sasameyuki ou Les quatre sœurs, inspiré directement du plus grand roman classique de la littérature japonaise, Le Dit du Genji. Tanizaki, plongé dans l'écriture de ce long roman, n'a pas laissé de commentaire subjectif sur la guerre, à part un journal qu'il a tenu du jour du Nouvel an de l'année 1944 jusqu'au jour de la défaite, journal dont il sera question plus tard. À part donc ce journal, Tanizaki ne s'est compromis dans aucune discussion sur la guerre, ou la modernité à dépasser. Ou plus exactement, il est l'un des rares écrivains qui n'ont jamais vraiment discouru, ne se souciant guère de ce que les critiques et les autres écrivains le prennent pour incapable de raisonnement analytique, ce qui voulait dire, dans ce Japon obsédé par la question de la modernité, un écrivain démodé et dépassé. Mais lorsqu'on lit les pages de vivisection analytique du Journal d'un vieux fou, qui oserait croire que ce vieux romancier ait été incapable dans sa vie d'analyser objectivement et de discourir ?
Sasameyuki, dès sa parution, a été acclamé comme étant la résurrection de la littérature japonaise classique ; il a été appelé le classique moderne. Or, ce que le symposium posait comme unique possibilité de dépassement de la modernité, était justement non pas un simple retour au classique, mais une réincarnation du classique dans le moderne. C'est ce que Tanizaki a réalisé. On a souvent traité Tanizaki d'esthète ne se souciant pas assez, voire fuyant la réalité de son temps. Mais ce chef-d'œuvre est indubitablement sa réponse à la guerre, la seule qui lui fût possible, la seule qui soit libre du discours fictif, la seule qui lui fût indéniablement personnelle, c'est-à-dire la seule dont il pût porter la responsabilité à lui seul en tant qu'individu. Étrange engagement. Car ce roman commencé en 1942 et achevé en 1948, relatant la vie d'une famille japonaise de 1936 à 1942, parle effectivement de la guerre qui s'annonce, mais seulement à travers ses personnages par rapport auxquels l'auteur se situe à une distance toujours égale. Le résultat est que ce roman, tout en décrivant un monde cerné de part et d'autre par l'atmosphère menaçante de la guerre qui va éclater, semble tout à fait paisible et insouciant du danger imminent. À nous qui savons la réalité qui s'en est suivie, les personnages de Sasameyuki nous semblent totalement inconscients. D'où cette impression d’insouciance générale du roman, qui porte tort à l’auteur, quant à son attitude d’intellectuel ayant vécu la guerre. On dirait qu’il s’est tout simplement complu dans une nostalgie d'un Japon heureux, perdu à jamais.
En rester là ne serait qu'une lecture superficielle. Le roman a réalisé ce que tous ces intellectuels réunis au symposium avaient posé comme unique possibilité de dépassement de la modernité, sans pouvoir, eux, cesser de discourir et passer à l'action. Comment Sasameyuki assume-t-elle la modernité pour aller au-delà et survivre après-guerre ? Il est possible de tenter de répondre à cette question en se basant principalement sur l'œuvre elle-même, mais puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, faisons un raccourci et feuilletons le journal. Ce journal, d'une extrême sobriété, recouvre les années 1944 et 45, et relate les détails de la vie quotidienne d'un ton calme et mesuré. Il ne discourt jamais sur la guerre. Il constate seulement. Son écriture ne se laisse jamais emporter par les émotions personnelles. Mais à travers la sobriété du style, transparaît toute la force de la détermination. On dirait que son auteur est décidé à vivre, qu'il sait qu'il ne se laissera pas prendre par le hasard de la conjoncture. Ce journal se termine le jour de la défaite par ces mots, « À six heures, écoutons derechef les informations. Suicide du Ministre de la guerre Anami. Après dîner ai réaccompagné Senoo jusqu'à l'Auberge Akaïwa. Aujourd'hui, depuis midi, cessation de tout bombardement. Hier soir, dernier bombardement sur la ville de Fukuyama ». Le journal s'arrête là, et la dernière phrase n'est pas ponctuée. Comme s'il avait été impossible d'en finir avec cette guerre, comme si ce dernier bombardement s'ouvrait sur la nuit de l'inconcluable. Comme si l'intimité de cet acte moderne, tenir un journal, devait se perdre dans l'inconnu de la réalité à vivre, dans l'inconcluable de l'individu.
Ce journal a été publié dès 1946. Il a été écrit dans l'intention d'être tout de suite publié. Et ce journal nous informe par ailleurs sur la progression de Sasameyuki dont la publication s'est achevée elle aussi au lendemain de la guerre. L'insouciance apparente de ces deux écrits qui pourtant retracent les jours de guerre au présent, frappent. Le non-dit, l'apparence d'insouciance pèsent de tout leur poids. Une force insoupçonnée se dessine à travers les élisions, les réserves, la retenue, le « je » qui a été tu. Une impression d'un étonnant ascétisme s'en dégage. Tanizaki a su trouver son identité et porter la responsabilité qu'elle impliquait, en assumant la figure de l'écrivain désormais célèbre qu'il était. Il a fait de cette fiction, être un écrivain, sa réalité. Il en a assumé la responsabilité, allant jusqu'à incorporer entièrement sa propre réalité individuelle dans cette figure fictive. C'est pourquoi le journal, cette chose si personnelle de publication d'habitude posthume, devait être publié tout de suite après son écriture et a été écrit à cette fin. La fiction et la réalité ne se distinguent plus. Elles subissent une étrange osmose dans la peau de l'écrivain. Tanizaki a eu le courage inimaginable de faire de son individualité une fiction. Il a su que la réalité de sa personne se situait dans la fiction. Le journal s'interdit impitoyablement toute intimité et Sasameyuki recouvre les mêmes six années qu'il a fallu à son auteur pour l'écrire, et fait vivre un monde fictif que l'on sait avoir été la réalité quotidienne de son auteur.
Tout le monde sait que Tanizaki a été dans sa jeunesse l'écrivain le plus fasciné par la modernité occidentale. Naomi, l'héroïne d'Un amour insensé en est la preuve la plus éloquente. Il avait une grande connaissance de la littérature occidentale, et tout en possédant une très grande culture traditionnelle, il a fait son apprentissage de romancier à l’école occidentale. Mais à la différence des intellectuels dont il a été question plus tôt, sa fascination, il l'a vécue en quelque sorte à fleur de peau. Il avait compris que ce n'était pas lui le Japonais qui devait s'encombrer de concepts et d'idéologies occidentaux, mais que c'était lui l'individu qui devait vivre cette extraordinaire fiction qui se présentait à ses yeux. Et c'est lorsqu'il a senti qu'il avait épuisé toutes les ressources de cette fiction de l'Occident, qu'il a « performé » son célèbre revirement. Un amour insensé, ce manuel de l'occidentalisation a été publié en 1925. Et il ne faut pas attendre 4 ans pour retrouver un Tanizaki fasciné par le Japon traditionnel avec la publication du Goût des orties. Fasciné au sens tanizakien du terme bien sûr, c'est-à-dire vivant, incorporant une nouvelle fiction. Qu'il ressasse des clichés sur le Japon, je pense surtout à l'Éloge de l'ombre (1933), qu'importe. La fascination réincarnée, la fascination entamée par l'individu, c'est la fiction, le devenir autre, qui ne se fait que par des signes, des traits typiques, des clichés. La fascination n'est en réalité permise qu'aux âmes fortes qui n'ont pas peur de se défaire de leur personne, de leur identité superficielle, et vider l'individu de tout présupposé pour le rendre à sa signification brute, c'est-à-dire un individu en tant qu'unité de transformation.
C'est parce que Tanizaki a su faire face à sa propre réalité individuelle qu'il se préoccupe peu ou prou de clichés ou pas clichés. Il n'a pas peur non plus de passer pour un homme superficiel qui se contredirait du tout au tout d'une œuvre à l'autre. Et il n'a surtout pas besoin de s'expliquer sur son revirement, à la différence des intellectuels dont il a été question plus haut. Si l'Occident était une fiction, le Japon traditionnel l'est aussi. L'important est de se saisir de l'individu-unité que l'on est, pour réaliser cette fiction, pour montrer, au moyen de sa propre vie, qu'il y a quelque chose de plus fort que la fiction, que la réalité ne se fait voir qu'au travers de la fiction. Autrement dit, il n'y a pas l'individu et la réalité, ou la fiction et la réalité, mais l'individu n'est là que pour rendre la fiction réelle, juste le temps de l'individu.
Ce que Tanizaki nous apprend par-delà le clivage Occident-Japon, c'est qu'il ne faut jamais croire à l'immanence de la réalité. La réalité n'est jamais sous le masque. Il faut porter le masque, ou plutôt, il faut savoir que l'on porte d'ores et déjà un masque. La réalité se porte elle aussi comme un masque, et elle est une doublure qui fait la consistance du masque.
J'aurais souhaité parler longuement de Mishima, mais le temps me manque. Je voudrais simplement remarquer que Mishima est le seul écrivain qui ait vraiment vu la possibilité que cachait la littérature de Tanizaki, ce qu'elle signifiait pour la modernité. Mais Tanizaki est né en 1886, et en 1942, il avait déjà 56 ans, tandis que Mishima ne savait pas encore quelle fiction il pouvait vivre, n'ayant que 17 ans en 1942. Et ce n'est pas sans raison que la carrière d'écrivain professionnel commence pour Mishima justement avec La confession d'un masque. Mishima débute dans le dépassement de la modernité, là où Tanizaki avait fini. Tanizaki n'a jamais eu besoin de confesser son masque, de rendre explicite le masque, de son vivant. Il a simplement fait graver sur sa tombe et sur celle de sa famille, deux idéogrammes de sa calligraphie, « vide » et « silence ». Mishima commence sur le silence que Tanizaki a emporté à jamais sous sa tombe. Désormais, la réalité et la fiction sont devenues trop saillantes pour qu’un écrivain puisse confondre les deux dans la figure défaillante qu'il représente. Il doit désormais dire le masque, dire le vide de sa personnalité, pour devenir cet individu libre de toutes fictions sinon la fiction qu'il incarne. Autrement dit, dans un Japon au lendemain de la guerre où la fictivité des choses devenait de plus en plus flagrante, Mishima a dû d'emblée confesser son masque pour pouvoir le porter. Tandis que c'est seulement à la fin de sa vie que Tanizaki a en quelque sorte confessé le masque, laissant une calligraphie écrite d'une main tremblante de vieillard et qui dit, « nul autre que moi ne pourra connaître mon cœur », Mishima, lui, à 24 ans, doit faire de son « cœur » une fiction, La confession d'un masque, pour pouvoir rivaliser avec la fiction de la modernité. Pour pouvoir se permettre des fictions dans un monde qui commençait à en abonder, sans se perdre en elles, il a dû s'extravertir, se vendre en quelque sorte, et fictionnaliser sa réalité intérieure en la dilapidant une fois pour toutes, au début de sa carrière. C'est un ascète de la fiction qui s'est promis de ne pas se laisser aller à la fiction tout en s'occupant de fictions. Et c'est en cela qu'il rejoint Tanizaki.
Tous les deux, ils ont incarné la fiction d'un Japon traditionnel face à la modernité occidentale, sans avoir peur des clichés, qui ne font que mieux montrer que ce n'est qu'une fiction. Tanizaki l'a vécue dans la paix, si l'on peut dire, comparé à la tragédie de Mishima, parce qu'il était encore un peu plus près de ce Japon malgré tout. Peut être le décalage était-il devenu trop grand après la guerre pour qu'il soit assumé par un seul individu. Mais ce que Mishima est arrivé à nous transmettre, en renforçant la ligne lancée par Tanizaki, c'est que le Japon a cette ressource de taire la personne au profit de l'individu vivant, c'est-à-dire capable de se transformer et d'agir, sans recourir à aucun discours fictif pour expliquer une quelconque vérité intérieure de la personne.
L'individu est plus fort que la personne. La personne, elle, est traversée de part en part par le discours. Elle se croit identique à elle-même, elle croit à sa personnalité, parce qu'elle se fige sur l'immobilité de la vérité du discours. Elle est incapable d'agir dans sa propre responsabilité, parce qu'elle n'est finalement qu'un recroquevillement sur une intériorité illusoire. Elle se satisfait d'elle-même, et c'est la pire des fictions.
Je dirais que c'est un sens moral inflexible qui traverse l'œuvre et la vie de Mishima. Un sens moral presque inhumain, si humain veut dire la sauvegarde de la personnalité. Mishima veut devenir autre, il veut dénoncer le mensonge romantique qui le fascine et l'immobilise dans son intériorité, et passer à l'action. Il devient sa propre fiction, afin de toujours être conscient de la fiction, afin de ne pas se laisser piéger par son charme. Il cherche la possibilité d'une action consciente d'elle-même, qui ne peut trouver d'excuse nulle part qu'en elle-même.
Autrement dit, Mishima a vécu dans la tension continuelle de la réalité et de la fiction, comme il l'a clairement soutenu dans l'un de ses derniers essais, Qu'est-ce que le roman. Cette tension, vécue dans l'individualité la plus dépouillée, lui était indispensable pour enrichir la réalité de toute la dimension de la fiction et pour ne pas se contenter de dire que la réalité n'est qu'une fiction. Si la littérature sert encore à quelque chose, c'est d'enrichir l’inconnu grâce à la fiction. Car comme Mishima le répète à plusieurs reprises dans ses essais en citant Faust, « seul l'inconnu sert à l’homme, tout ce qui lui est connu lui est inutile ».
Mishima, non plus, n'a pas peur de s'encombrer de clichés, de paraître bête, trop conceptuel ou de mauvais goût, en exagérant le côté fictionnel de ce qu'il veut incarner : la fiction doit être flagrante pour que l'on en prenne pleinement conscience. Il veut seulement agir. Il est déjà trop intelligent pour vouloir être intelligent. Dans un monde où la fiction des choses devient un peu plus flagrante tous les jours et où le relativisme s'impose comme principe d'intelligence, agir n'est possible que par dépossession de soi, dépossession du sentiment de sa vérité intérieure et de son intelligence. Se déposséder jusqu'à cette simple peau qui fait notre corps, jusqu'à l'individu-unité en métamorphose continuelle. Mishima est allé même jusqu'à vouloir transformer cette peau en travaillant sa musculature et en l'entaillant finalement par un seppuku. Les clichés et autres ne font que tatouer la réalité à fleur de peau, ils dessinent des fictions sur cette peau-écran, pour mieux faire ressortir la réalité obscure de cette peau.
Le post-moderne a cru nous enseigner la relativité, la fictivité de la réalité humaine. Ce que Tanizaki et Mishima ont voulu montrer à travers leur fiction, ce genre essentiellement moderne, est justement que le relativisme n'est lui aussi qu'une nouvelle fiction moderne, et que la seule action possible se situe là où la fiction s'incarne dans la réalité, c'est-à-dire dans l'individu unité de transformation. On peut encore, et l'on doit, surtout aujourd'hui que le monde se globalise, plus que jamais prétendre à la réalité, en assumant, sans discourir, son individualité. Car après Tanizaki et Mishima, il ne peut y avoir de vérité qu'individuelle.
► Nemoto Misako, in : La modernité après la post-modernité, dir. H. Meschonnic et S. Hasumi, Maisonneuve & Larose, 2002.
[Extraits sonores : P. Glass / Herbst9 / Golgatha / Molodoï]